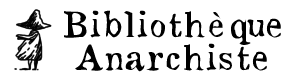L’Encyclopédie Anarchiste — L
L
LABORATOIRE
n. m. (du latin laboratum ; de laborare, travailler, rad. labor)
Se dit d’un local disposé en vue d’un travail défini et muni des instruments et appareils appropriés. S’emploie plus particulièrement pour désigner les ateliers spéciaux où se font des travaux et recherches scientifiques, des opérations et expériences de chimie, de physique, de biologie, de physiologie, d’électricité, etc. Le cabinet de travail d’un écrivain, d’un chercheur érudit, peut être, en ce sens et par extension, son « laboratoire ». Aux lieux où s’accomplissent des transformations, des combinaisons similaires s’applique aussi, par analogie, l’expression de laboratoire : au sein de la terre, parmi les éléments en perpétuelle modification, fourmillent les laboratoires naturels.
A côté des usines de produits chimiques ou métallurgiques, pour les besoins de leur production, nombreux sont de nos jours les grands établissements scientifiques ou d’instruction munis de laboratoires ouverte à l’enseignement. Depuis le sanctuaire mystérieux de l’alchimiste, aux fourneaux inquiétants et au mobilier symbolique, et les premiers cabinets du physicien où se déroulaient plutôt des fantaisies de physique amusante, le caractère des laboratoires s’est curieusement et puissamment modifié. Un matériel toujours accru y facilite des investigations savantes, vérificatrices et créatrices. Ici les éprouvettes, les cornues, les creusets, les alambics, les bocaux, les balances et les chalumeaux, là les seringues à injections, les sondes, les scalpels, les appareils électro-physiologiques, etc. Une technique toujours plus fouillée et étendue préside, avec le concours d’instruments de précision, à des expériences riches d’imprévus, grosses de conséquences incalculables. On peut dire qu’aujourd’hui une curiosité permanente surveille les révélations de laboratoires singulièrement actifs et que toute une vie artificielle, à dessein suscitée, y palpite sous la volonté du cerveau humain peu à peu enrichi et fortifié de con naissances, appuyé sur de solides jalons.
« Il n’y a pas de plus beau spectacle, dit Larousse, que celui d’un laboratoire fréquenté par des gens ardents, curieux, amoureux de savoir, disposés à tous les sacrifices, pourvu qu’une telle abnégation profite à la science, enchainés aux longueurs d’une besogne rebutante et souvent périlleuse, attentifs à toutes tes voix quelquefois imperceptibles qui se peuvent faire entendre dans ce sanctuaire de l’investigation. Le vulgaire est étonné quand il entre dans ces chambres encombrées et souvent infectes, où les ustensiles de toute forme et les ingrédients de toute couleur sont là dans le feu, ici dans la glace, ailleurs dans les chairs sanglantes ou putréfiées, employés à produire quelque résultat ou à révéler quelque mystère ; où l’observation épie, provoque, accélère, ralentit, mesure les mouvements et les manifestations phénoménales, où le théoricien soumet au contrôle de l’expérience les conceptions nées dans les embrasements de son foyer cérébral et assiste, anxieux et ému, au duel de l’inexorable fatalité extérieure avec les aperceptions de cette fatalité intime qu’on appelle la pensée. »
Le nombre des « initiés » aussi s’est accru et si le nombre encore restreint de ces chambres d’étude et le cercle de la jeunesse prenant part à leurs séances est trop minime à notre gré, si l’abord même des laboratoires revêt une solennité trop distante et comme religieuse, nous concevons une ère où, librement accessibles à une progéniture admise enfin au savoir légitime, ils seront le pivot d’une culture vivante et familière... Le laboratoire sera le soutien animé de l’éducateur, et s’y contrôleront, pour tous — et hors des pressions de l’égoïsme et des calculs de l’intérêt — tant de notions aujourd’hui abandonnées à la souveraineté du dogme.
Pour souligner l’importance pratique — déjà réalisée — des laboratoires, signalons que « leur office n’est pas borné à la découverte des lois spéculatives et des vérités abstraites. Ils sont le champ où germent les inventions fécondes et les applications brillantes qui engendrent la richesse des nations. La science des laboratoires a substitué à l’empirisme des anciennes industries des procédés rationnels, et une certitude réfléchie aux tâtonnements séculaires des arts utiles. On ne citerait pas une grande application industrielle qui n’ait sa source dans un laboratoire et bien souvent, la découverte qui a provoqué une telle application a semblé tout d’abord inutile et vaine au point de vue du profit matériel » (Larousse). Et quand on songe à tout ce qui pourrait rejaillir de bienfaisant, pour la collectivité, de tant de découvertes détournées de leur portée générale au seul avantage de bénéficiaires isolés, quand on sait qu’elles favorisent, la plupart du temps, de grotesques et malsaines fortunes individuelles là ou tant d’humains trouveraient un soulagement à leurs maux, un allègement à leurs tâches pénibles, une détente à des conditions de vie déprimantes, avec quelle impatience n’essayons-nous pas de découvrir les symptômes si rares encore, d’une conséquence, d’une utilisation rationnelle et humaine des apports précieux de l’activité des laboratoires.
Parmi les laboratoires parisiens, qui sont en France les plus marquants (notons à part les laboratoires d’études naturalistes situés aux abords des côtes, tels ceux de Roscoff, Concarneau, Villefranche-sur-Mer, Banyuls-sur-Mer, Wimereux, etc.), citons celui de l’Ecole pratique de la Faculté de médecine, centre des études de physiologie et d’anatomie générale où travailla Robin, celui du Collège de France où le grand physiologiste Claude Bernard fit ses principales découvertes, où vint aussi Magendie. Le laboratoire de l’Ecole de médecine connut les recherches triomphantes de Wurtz sur les ammoniaques, les glycols, les urées composées, etc., et vit passer les Lieben, les Craft, les Harnitz-Harnitzkv, les Oppenheim. Quoique plus spécialement affectés à l’enseignement, les laboratoires de l’Ecole normale supérieure, de la Sorbonne, de l’Ecole de Pharmacie ont été les témoins des travaux des Sainte-Claire-Deville (sur la fusion des métaux et la dissociation des vapeurs), des Pasteur sur les fermentations). Les Thénard, les Gay-Lussac ont travaillé dans ceux de Polytechnique et de la Sorbonne. C’est à celui de l’Ecole de Pharmacie et du Collège de France que Berthelot a réalisé ses remarquables synthèses, à ceux du Muséum et des Gobelins que Chevreul étudia les corps gras, etc… Les Facultés des sciences, dans les Universités de province, ont également leurs laboratoires de chimie et le plus grand nombre des Facultés de médecine ont aussi un laboratoire de physiologie, destiné à la pratique des vivisections.
Depuis longtemps, les savants français et la partie du public qui s’intéresse aux conditions qui leur sont faites se sont plaints et se plaignent encore de l’insuffisance et de la pauvreté des laboratoires de leur pays. C’est devenu lieu commun que de parler de « la grande pitié des laboratoires de France ». Et leur misère a pu servir, ces temps derniers, de publicité à un journalisme éhonté... Quand on sait la haute valeur humaine de ces foyers d’interrogation scientifique (je ne parle pas ici des antres où opèrent les chimistes criminels qui mettent leur gloire à doter les nations d’un arsenal de toxiques et à combiner ces gaz foudroyants que les oiseaux de mort porteront à travers les peuples en vagues d’anéantissement), quand on pénètre les bienfaits qui peuvent en surgir pour une humanité encore languissante et douloureuse, on ne peut, sans une bouffée de honte pour notre temps, songer que les laboratoires délaissés par ceux qui ont la charge du bien public sont à la merci de précaires interventions charitables. Alors que des milliards sont allègrement consacrés aux œuvres de destruction, à la multiplication des engins meurtriers, à l’entretien de contingents formidables de parasites armés, il paraîtra invraisemblable aux générations futures qu’on ait pu marchander les crédits et laisser pâtir, dans une humiliante mendicité, les chantiers où l’intelligence humaine accroît notre plus riche et notre meilleur butin...
Que diraient aujourd’hui — en face d’une situation inchangée, d’une incurie chronique — ceux-là qui, il y a cinquante ans, frappés déjà de la pénurie des soins affectés à des œuvres si précieuses et des sommes intimes — ailleurs jetées aux gouffres, dilapidées sans compter dans une gabegie permanente — apportées à l’édification et à l’entretien des laboratoires, s’écriaient :
« Pour donner une impulsion énergique et salutaire aux recherches scientifiques, il faut réorganiser complètement l’enseignement supérieur, en décupler le budget et créer d’opulents sanctuaires pour les ouvrir à deux battants à tous les chercheurs qu’embrase le feu sacré de la découverte. C’est ce qui ne pourra être accompli que par un gouvernement convaincu de la haute importance des sciences spéculatives et assez libéral pour ne pas marchander l’argent aux savants qui veulent se consacrer à la besogne difficile de l’expérimentation féconde. D’ici là, beaucoup de savants seront dans une gêne voisine de la misère et renonceront, faute de ressources, faute d’instruments de travail, à la vérification expérimentale des idées que leur suggère une pensée toujours en travail, une vive et lumineuse conception des lois du monde. »
Après un Palissy brûlant ses meubles, les Curie pleurant sur leur tâche arrêtée!... Les gouvernements avaient, d’ailleurs, besogne plus pressante ; avec les milliards trempés dans le sang des peuples, ils propageaient les charniers. Et ils ne marchandaient pas l’argent, ma foi. Après s’être servis royalement — démocratie oblige ! — nos gouvernants le dispersaient entre les mains des professionnels de l’armée et des fournisseurs de matériel de guerre. Aujourd’hui encore, si les laboratoires végètent, anémiques, on ne chôme pas sur les chantiers de la marine et dans les firmes d’avions et les fonderies du Creusot n’ont pas besoin d’implorer les commandes...
A l’étranger, chez les Germains et les Anglo-Saxons notamment, en Amérique aussi, dans la Russie nouvelle (tant il est dit que les nations latines : France, Espagne, Italie, monuments de verbiage stérile, le bureaucratisme et de furia militaire se laissent incorrigiblement distancer), les laboratoires sont davantage à l’honneur. On ne leur ménage pas les sacrifices et des efforts constants en assurent le progrès. Les Universités, au dehors, ont des laboratoires de physique, de chimie, des instituts anatomiques et physiologiques où de nombreux travailleurs ont à leur disposition les ressources nécessaires à la recherche.
« Pour ce qui concerne, en particulier, les laboratoires de physiologie, il semble que c’est en France, la patrie des premiers grands expérimentateurs de la vie, de Bichat, de Legallois et de Magendie, qu’on aurait dû fonder des établissements aussi utiles au progrès de la médecine. Il n’en a rien été et ce sont nos voisins qui nous ont donné l’exemple de l’expérimentation suivie, publique et régulière... »
Par delà « nos » frontières, on trouve des laboratoires qui sont de véritables palais, et dont la construction a coûté des millions. Bonn, Berlin, sont en Allemagne des centres de chimie magnifiques où peuvent œuvrer, dans l’aisance, des équipes de savants. Les grandes cités universitaires d’Autriche et d’Allemagne, de Suisse aussi, ont également des laboratoires importants qui gardent la mémoire des Liebig, des Bunsen, des Wœhler et de tant d’autres... Les laboratoires de physiologie sont particulièrement bien installés à l’étranger. Vaste est celui de Petrograd, celui d’Utrecht est un modèle. Florence même nous dépasse. En Allemagne : à Heidelberg, Berlin, Leipzig, Vienne, Tübingen, Munich, Göttingen, etc., s’érigent des laboratoires richement organisés pour les études sur la vie.
Pour insuffler aux laboratoires, enfin partout multipliés, l’enthousiasme de la vie saine, pour les situer à leur place, qui est première, et les ouvrir à leur véritable rôle, si fécond, il faudra l’atmosphère d’une société libérée des petitesses de l’argent, de la corruption des affaires et des sophismes patriotiques, des hostilités de la convoitise et des basses émulations de la vanité, de toutes les contraintes qui freinent l’humanité dans sa marche, des déviations qui la désorientent et la déciment, qui la jettent loin des chemins normaux où l’effort des cerveaux les mieux doués assure des conquêtes utiles pour l’espèce toute entière.
— LANARQUE.
LABYRINTHE
n. m. (étymologie probable : latin labyrinthus ou grec laburinthos, même sens. Certains le rattachent aux deux mots égyptiens labari et thi, ville ou monument de Labari, roi d’Egypte)
On donnait ce nom dans l’antiquité à des salles et galeries souterraines, suites de tombeaux, exagérément ramifiées, et cette appellation s’est étendue, plus tard, à des édifices conçus sur le même plan ou à des agencements qui rappelaient le dédale trompeur des labyrinthes anciens. Des cinq plus fameux dont on a conservé les noms, deux appartiennent à l’Egypte : le labyrinthe de Mendès, dans l’île du lac Mœris et le labyrinthe des Douze, ainsi nommé parce qu’il fut construit, vers 660, par les douze seigneurs qui régnaient alors sur l’Egypte. Il y avait aussi le labyrinthe de Crète, près de Gnosse, construit dans les carrières et destiné à la sépulture des rois : la fable l’attribuait à Dédale et y plaçait le Minotaure ; puis le labyrinthe de Lemnos, qui semble avoir été une grotte de stalactites, abri mystérieux du culte des Cabires, et enfin le labyrinthe de Clusium, que l’on attribuait à Porsenna, et qui dut être un de ces hypogées étrusques dont on a découvert un si grand nombre de nos jours...
De ces labyrinthes, les auteurs antiques abondent en descriptions enthousiastes et ils en vantent la richesse. Mais il est curieux qu’aucun de ces édifices n’ait laissé de traces et qu’on ne soit d’accord sur aucun de leurs emplacements. Verrons-nous un jour des fouilles exhumer ces substructions grandioses?... Hérodote a décrit celui des Douze, qu’il dit avoir visité au milieu du Vème siècle av. J.-C. et il lui attribue, outre douze grandes salles parallèles précédées d’un portique de colonnes monolithes, plus de trois mille chambres dont la moitié, souterraines, servaient, assure-t-il à la sépulture des rois et des crocodiles sacrés. Pline en parle également et Strabon, qui déclare l’avoir connu encore sous Auguste. Mais Hérodote, Strabon, Pomponius, Diodore de Sicile, Manéthon, Démostélès, Lycéas sont en désaccord — si l’on s’attache à leurs récits — quant au fondateur dont une pyramide abritait la momie.
Le plus fameux des labyrinthes antiques, si l’on en croit les poètes qui, à profusion, l’ont chanté, fut celui de Crète. Selon la mythologie, il aurait été construit, par ordre du roi Minos, pour servir de repaire au Minotaure. Dédale en aurait tracé le plan, d’après celui du labyrinthe qu’il avait vu en Egypte, près du lac Mœris. C’était un édifice élevé sur le sol à ciel ouvert. Thésée, guidé par le fils d’Ariane, parvint jusqu’à la retraite du Minotaure et le tua. Ovide, qui le dépeint dans ses Métamorphoses, nous conte que l’inventeur put à peine en sortir tant son art fut extrême. Demoustier, dans ses Lettres à Emilie, le compare au cœur de l’infidèle. Les Pline, les Diodore, n’en voient de trace que dans la légende et il semble qu’on puisse se trouver en présence d’une tradition purement poétique
Les églises offrent souvent, vers la fin du XIIème siècle, des ornements en forme de labyrinthes. La cathédrale de Chartres en possède un en sa nef, qu’on dénommait la lieue et où se voyaient, jadis, Thésée et le Minotaure. Il en est aussi en celles de Reims, Poitiers, Auxerre, Amiens, etc. Certains y ont vu des réminiscences païennes, d’autres des rappels d’emblèmes du temple de Jérusalem. Plus simple nous paraît de les attribuer à une fantaisie, familière aux artistes du temps, dont l’imagination se donnait, à travers les œuvres sacrées, si souvent libre cours et qui dotèrent les édifices du culte des scènes les plus audacieuses et les plus hétéroclites...
Les labyrinthes optiques sont des enchevêtrements de glaces qui donnent naissance à des perspectives que le visiteur prend tour à tour pour des chemins. L’horticulture a ses jardins-labyrinthes dont les plus célèbres furent ceux de Versailles et de Choisy. Du premier seulement nous restent des plans et gravures, des descriptions (proses de Perrault, fables de Benserade) et un poème de Delille.
Au figuré, on appelle labyrinthe une complication d’objets parmi lesquels la pensée tâtonne et se fourvoie. Des difficultés, des questions obscures, un réseau d’idées enchevêtré, voire de propositions contradictoires sont aussi qualifiées de labyrinthe :
« Le système général des sciences et des arts, dit d’Alembert, est un labyrinthe où l’esprit s’engage sans connaître la route qu’il doit tenir. »
Lemercier proclame que « le doute fut le premier pas vers les découvertes, dans le labyrinthe de la vérité ». Du cœur humain, Voltaire dira qu’il est « un labyrinthe dont il n’est pas aisé de démêler les tours et détours ». Dans l’inextricabilité du labyrinthe, le philosophe voit l’image de l’esprit humain en proie aux illusions et aux égarements multipliés :
« Nous naissons, dit à ce sujet Condillac, au milieu d’un labyrinthe où mille détours ne sont tracés que pour nous conduire à l’erreur. »
Balzac estime aussi qu’ « il n’est pas un fourré qui ne présente quelque analogie avec le labyrinthe des pensées humaines ». Nombreuses sont les tournures littéraires qui font appel à des comparaisons similaires.
— L.
LÂCHETÉ
n. f. (lat. laxitas, relâchement, de laxus, lâche)
La lâcheté, qu’il ne faut pas confondre avec la poltronnerie — réflexe passager de la peur qu’ébranle l’imprévu — est non seulement un manque naturel de courage, mais souvent une pusillanimité de parti-pris. « La peur tient à l’imagination, la lâcheté au caractère » dit Joubert. C’est par instinct seulement ou par tempérament que le poltron se dérobe au péril ; le lâche s’y soustrait par calcul. Alors qu’à certaines défaillances physiques vont l’excuse de la spontanéité et le bénéfice de la franchise, il y a dans la lâcheté une préméditation et une méthode — un système pourrait-on dire — qui révèlent à la fois les tares et les dangers du vice. Plus encore que la lâcheté qui est effacement d’excessive prudence, retraite voulue en face de dangers redoutés, est avilissante et constitue un amoindrissement de la personnalité, cette lâcheté active -qui imprègne tout l’être moral — par laquelle certains ne reculent pas devant une infamie pour réussir, rampent pour atteindre à la fortune, se prosternent devant les grands quitte à se venger sur les humbles des bassesses que leur esprit d’intrigue ou leur servilisme leur fait commettre. Pire que la lâcheté du pauvre (que son ignorance, le défaut de cohésion avec ses pareils, le préjugé d’une sorte de fatalité de sa condition amènent à un acquiescement permanent à des formes manifestement iniques) est ce souple abandon, habile et circonstancié, de l’arriviste, de l’avide ou du dominateur qui supputent les avantages de leur servilité provisoire et monnaient par avance leur abaissement.
Généralement, couardise physique et lâcheté morale vont de pair. Elles enveloppent et pénètrent l’individualité, lui impriment le sceau du renoncement, l’écartent des actions viriles par lesquelles l’homme, au prix de souffrances souvent, se redresse et s’affirme. Dans l’atmosphère de la moralité courante, distante par tant de points de la moralité théorique, officielle, il flotte, en dépit d’une absolution de fait qui est une adhésion cynique à tout ce qui revêt les apparences de la force et se couvre des attributs du succès, une sorte de réprobation séculaire, un mépris latent pour la lâcheté. Parmi les humains qui admettent la situation de fait du parvenu et pressent la main de celui qui s’est traîné jusqu’au pinacle par ses abdications, ceux-là en qui toute dignité n’est pas obnubilée par les altérations d’un régime d’appétits, ressentent en sa présence le malaise qu’on éprouve au contact de la fourberie et le souvenir — indélébile — de déchéances échelonnées sur le parcours. Rares d’ailleurs sont les lâches qui revendiquent crûment la légitimité de leurs procédés et plastronnent avec ostentation de gloire, poussent le cynisme jusqu’ à revêtir le manteau de Nessus de leurs trahisons...
« C’est une lâcheté que de trahir un parent, un ami, un bienfaiteur. Partout et toujours, c’est une lâcheté de faire ce que la raison condamne. » (Senancour)
Que de trahir quiconque, devrait-on dire, et de faire ce que réprouve le sentiment averti de justice, que de faillir à la loyauté. Plus odieuse si possible est la lâcheté qui s’abrite derrière l’anonymat pour atteindre ses visées. Sur la voie aux scrupules piétinés, n’est-il pas comme obligé que, dans un cortège renforcé de toutes les connivences, la cruauté aussi accompagne, en complice, la lâcheté ? « Les lâches sont cruels » soulignait Voltaire... La lâcheté est un mal endémique qu’ont connu tous les temps et sur une échelle trop vaste :
Qu’injustice, intérêt, trahison, fourberie »
(Molière)
Les peuples, comme les individus, ont donné le spectacle de lâchetés séculaires. Esclaves, faux affranchis, fonctionnaires domestiqués, assemblées dociles ont fait à des tyrans parfois débiles l’offrande des volontés du, nombre et se sont inclinés sans combattre devant les arrêts du despotisme. La lâcheté favorise et renforce les institutions d’écrasement : sans elles s’effriteraient, impuissantes à vaincre, les dictatures dont la passivité multipliée des hommes assure le triomphe.
* * *
Lâche signifie proprement : qui est insuffisamment tendu ou serré : une ceinture, un ventre, une étoffe sont lâches ; c’est aussi un affaiblissement caractéristique.
En botanique, le terme désigne des inflorescences écartées : ombelle lâche. La grappe du faux cytise est lâche. C’est aussi de la paresse, un fléchissement d’activité, de vigueur : quelqu’un de lâche au travail : « mener une vie obscure, lâche, inutile » (Massillon) ou (Fléchier) : « Sa retraite ne fut ni lâche, ni obscure »... En littérature, c’est un manque d’énergie, de concision, de fermeté condensée : « toutes ces expressions impropres, hasardées, lâches, négligées, employées seulement pour la rime, doivent être soigneusement bannies » (Voltaire). Dans les Beaux-arts, l’expression s’applique aux œuvres dont le trait est faible, le dessin hésitant, l’effet mou : « la gravure lâche alourdit, ôte la souplesse, et fatigue l’œil » (Diderot), etc.
— LANARQUE.
LÂCHETÉ
Pour manœuvrer le pantin populaire nos moralistes officiels usent de ficelles, pudiquement voilées par les philosophes universitaires en mal d’avancement, ainsi que par la presse dénommée de gauche et, cela va sans dire, par les écrivains qui font la cour à notre riche et dévote Académie, cette coquette sur le retour. Ce qui plaît aux chefs, ce qui favorise leur volonté de jouissance ou de puissance voilà le bien moral, d’après ces plats valets ; ce qui nuit à leur prestige, à leurs plaisirs, à leur ambition, voilà le mal. Par crainte d’effaroucher les esprits simplistes on évite d’énoncer ce principe essentiel de l’éthique gouvernementale, mais il inspire toutes les appréciations que l’on porte sur la personne ou la conduite des subordonnés. Actes, sentiments, idées, deviennent saints, justes, bons, dans la mesure où l’exige l’intérêt de ces messieurs du Gouvernement et de l’Eglise ; s’ils leur déplaisent ou les contrecarrent, bien vite on les porte sur le catalogue des vices ou des crimes. Parfois des contradictions éclatent, et des manières d’agir comme des états d’âme identiques sont qualifiés vertueux et coupables tout ensemble ; il suffit de les baptiser d’un nom différent pour que le public n’y voie rien et que les intellectuels eux-mêmes s’y laissent prendre. Pendant la guerre, quand les ministres fuyaient à Bordeaux ou que le Grand Quartier Général s’évitait tout bombardement, par accord tacite avec l’adversaire, c’était prudence disait-on ; mais l’on appelait lâche le déserteur à qui sa conscience interdisait de tuer d’autres hommes ses frères. Qu’un politicien abandonne ses idées pour parvenir, qu’un écrivain sacrifie, sans conviction, aux goûts de l’heure qu’un patron requière la force armée contre des ouvriers qui réclament un juste salaire, la presse n’a que sourires pour ces hommes dépourvus d’énergie, par contre elle accable qui ne se soumet aux caprices du maître, l’esprit assez indépendant pour dire : « Je n’obéirai pas ». Courage et vertu abritent depuis des siècles, sous leur manteau tutélaire, les pires orgies guerrières, les crimes innombrables de soudards déchaînés ; des fous inconscients du danger, des ambitieux sanguinaires sont proclamés héros par l’ignorance populaire. Artistes, historiens, prêtres, éducateurs magnifient la séquelle des conquérants illustres, des généraux fameux qui se firent un piédestal de milliers de cadavres humains. La lâcheté du troupeau qui se laisse conduire par de tels bergers s’appelle, au dire de nos moralistes, résignation sainte, discipline glorieuse, loyauté patriotique, comme la lâcheté des forts se dénomme prudence. Et les coupables sont les insoumis, les révoltés qui déclarent avec Lucifer « je ne servirai pas », oubliant que, selon saint Paul, toute autorité vient de Dieu. Avec les autres pères de l’Eglise, saint Augustin voyait encore dans l’esclavage un mal nécessaire, conseillant la soumission aux maîtres même injustes. Et l’on sait à quelle abdication immonde aboutit l’obéissance qui réduit le moine à n’être qu’un aveugle instrument dans la main de ses supérieurs.
Absence d’énergie volontaire, la lâcheté c’est le respect des lois iniques (la lâcheté par excellence est le respect des lois, disait Elisée Reclus), l’aplatissement devant les autorités civiles et religieuses, l’abdication des idées personnelles par intérêt ou par peur. Lâches, les prêtres (ils sont légion dans le haut clergé), qui vivent de l’autel sans croire ; lâches les savants, les écrivains, qui taisent la vérité ou propagent le mensonge, afin de ménager la clientèle riche et d’être reçus dans les salons ; lâches le juge, le patron, l’administrateur qui sacrifient l’innocent à des rancunes politiques ou religieuses ; lâches tous les pleutres riches, titrés, bien-pensants qui disent éternellement : « je n’ose » ; lâches doublement ces larbins de la presse gouvernementale qui encouragent le soldat à mourir, le père de famille à procréer, quand eux-mêmes sont à l’abri et restent célibataires. En voyant combien fréquente la veulerie parmi ceux qu’on dénomme intellectuels, on est conduit à penser que si la science est bonne elle ne suffit pas à rendre un homme supérieur. L’aristocratie de l’esprit, dont rêvent les partisans de l’Ecole Unique, vaudrait-elle mieux que les aristocraties actuelles ? J’en doute. D’abord parce que sélectionnée par des concours et des examens, procédés absolument incapables de faire découvrir les cerveaux vraiment doués ; nous en avons des preuves quotidiennes. De plus, je ne crois pas que, prise seule, l’intelligence suffise. Dans un essai (Métrique Morale), j’ai longuement indiqué pourquoi, et depuis j’ai insisté dans maints articles sur cette idée « Savoir et talent ne valent que dans la mesure où ils permettent d’adoucir la souffrance humaine ; au service d’un égoïsme sans scrupule, ils deviennent les pires auxiliaires du crime ». L’acuité de l’esprit comme la richesse de la mémoire s’allient souvent à une ambition sans frein ou à une irrémédiable sécheresse du cœur. Les intelligences supérieures vont parfois fort loin dans la voie de l’iniquité, et les souffrances des peuples furent généralement le prix de la vanité satisfaite des grands. Malgré les plus belles qualités intellectuelles, ce sont des despotes en germe ceux que n’anime pas un large sentiment de fraternité humaine, ce sont des forts peut-être, mais tout disposés à brimer les faibles. Pour eux, l’autorité devient un commode moyen d’asservir et d’exploiter les masses. Elle est condamnable l’éloquence qui accuse des innocents ; il devient nocif le sociologue que réjouit la souffrance des humbles.
La science, bonne à condition d’être au service d’une volonté compatissante, devient un instrument de torture ou d’esclavage entre des mains expertes au crime. Choisit-on pour cuisinier un empoisonneur parce qu’il est chimiste émérite ? L’intelligence d’un ministre ou sa culture étendue n’ajoute-t-elle pas au danger, quand il fait œuvre rétrograde. Ni l’éloquence, ni l’habileté, ne manquent habituellement aux hommes d’Etat, mais la simple honnêteté leur fait souvent défaut. L’exemple de l’ancienne Chine n’encourage pas davantage à tenir compte de la seule valeur intellectuelle ; malgré la difficulté des examens imposés aux mandarins de tous grades, l’administration fut plus mauvaise qu’ailleurs dans le Céleste Empire. Les meilleurs sont avant tout ceux qu’animent des sentiments généreux et humains. Une élite d’égoïstes habiles, cultivés, détenant les hautes situations et les postes de commandement, pourrait faire courir des dangers terribles au bonheur des humbles comme à la tranquillité du monde. Les exemples abondent de parvenus, enfants du peuple, qui furent les oppresseurs de leurs frères.
Et je m’élevais contre le mur de la vie privée qui dissimule légalement toutes les lâchetés de nos politiciens.
« Celui qui n’aspire point à commander les autres n’a pas à subir leurs critiques : il a droit au silence et à la paix. Médisance et calomnie empoisonnent déjà trop d’existences pour qu’il soit utile d’accorder une prime à la délation. Mais, lorsqu’il s’agit d’un homme qui aspire à devenir l’arbitre de la destinés des autres, ce mur de la vie privée n’a plus de raison d’être. Quiconque a le droit d’être renseigné sur la moralité profonde du législateur ou du juge qui dispose des biens, de l’honneur, de la vie même de ses concitoyens. N’est-il pas inadmissible que les gouvernants, dont les moindres désirs ont des répercussions si redoutables, prétendent se soustraire au contrôle des faits et gestes les plus révélateurs de leur mentalité vraie ? Et dire que tous les partis politiques s’accordent pour perpétuer cette sinistre farce ! »
Inutile d’ajouter que les bons apôtres de la Chambre et du Sénat sont trop adroits pour se soumettre à un contrôle permettant de mesurer leur degré d’hypocrisie. On sait que le monde politique est par excellence celui de la veulerie.
L’Eglise, toujours experte dans l’art d’utiliser les vices, a su tirer également un merveilleux parti de la lâcheté coutumière du bipède humain. Pour se faire obéir au doigt et à l’œil, elle fabriqua l’enfer, vaste rôtissoire, où le Dieu de Miséricorde s’occupe à cuire éternellement ses créatures mises à la broche. Quant au purgatoire d’où les prêtres vous tirent à volonté, il permet d’extorquer mille dons, mille aumônes des fidèles apeurés. Et c’est dans l’esprit incapable de critique, dans le cerveau tendre de l’enfant que l’on dépose ces monstrueuses insanités ; sans action sur l’homme réfléchi, elles s’impriment dans l’imagination horrifiée des jeunes et durent dans l’inconscient, prêtes à revenir aux instants de faiblesse ou à l’heure des dissolutions finales. En réclamant pour elle seule le droit d’enseigner, l’Eglise montre qu’elle ne s’illusionne pas sur la vraie raison d’être de son autorité. Quoiqu’elle dise aux dévotes, elle n’attend rien de Dieu ; elle attend tout de la déformation imprimée, dès la première heure, au cerveau des enfants que lui confient des parents insensés. Car la foi disparue, les dogmes mis en doute, elle sait qu’une peur instinctive persistera presque toujours chez celui qu’elle a façonné. Les néo-catholiques, si nombreux dans la bourgeoisie, la presse, l’Université, et qui détiennent le monopole des honneurs académiques, nous présentent la religion tout au moins comme une poésie respectable, qui soutient le faible et enchante l’âme du fort ; ils s’en tiennent à l’enseigne de la boutique et ne voient pas qu’elle est pleine de reptiles hideux. Au fond l’homme religieux n’est qu’un lâche ; Dieu règne par la peur ; le servilisme habite l’âme de l’immense majorité des croyants.
— L. BARBEDETTE.
LACONISME
n. m. (grec laconismos)
Brièveté d’élocution qui parfois nuit à la traduction de la pensée et rend cette forme inférieure en exactitude aux tournures explicites. Le laconisme peut constituer une insuffisance d’expression au contraire de la concision qui est une concentration gravitant autour de l’essentiel. Cependant il en diffère surtout en ce que cette dernière a pour contraire la diffusion plutôt que la longueur du discours. Dans l’antiquité, notamment, qui en fut le berceau, le laconisme était riche des qualités qui confèrent à un exposé resserré la puissance et la rapidité. Le laconisme était moins négligence, satisfaction d’àpeu-près que recherche assidue d’une forme enfermée dans les limites de l’indispensable et qui, avec énergie et sans dispersion oiseuse, épouse le sujet et s’applique à atteindre le but. On ne peut demander au laconisme que des vertus utilitaires et non les attributs qui font le charme du style. Les beautés littéraires, comme en comporte par exemple la phrase limpide et brève d’un Voltaire ou le tour ramassé, lapidaire de nos auteurs de maximes sont étrangères aux propos laconiques et ne les habitent que par accident. Le laconisme s’accompagne inévitablement de sécheresse et de froideur et ne peut s’embarrasser des figures rythmées de la narration. Il convient éminemment aux proverbes, aux sentences, aux devises armoriales, aux inscriptions monumentales. Deux écueils, d’autre part, menacent le laconisme : l’obscurité et l’affectation.
Le mot tire son origine de la réputation qu’avaient d’en faire usage, avec un à-propos tout particulier, les peuple de la Laconie, voire les Lacédémoniens, les Spartiates. L’esprit du « multa paucis » est l’essence même du laconisme et devrait inspirer la manière de nos orateurs. Si les joutes du prétoire devenaient laconiques, si les assemblées parlementaires, notamment, si fécondes en prolixes stérilités, introduisaient dans leurs délibérations un laconisme rigoureux, c’en serait fini de cette grandiloquence pompeuse et vide, qui auréole la vanité des champions de l’éloquence. Mais un Parlement pratique, aux séances de labeur précis et aux échanges expurgés de fioritures oratoires, aurait la valeur symbolique d’une révolution.
Pour revenir aux sources et fixer notre définition par quelques exemples, rappelons que les Lacédémoniens usaient parfois de monosyllabes décisifs. Si (non) répondirent-ils à Philippe de Macédoine les sommant de lui ouvrir l’accès de leur territoire et les menaçant, s’ils s’y refusaient, de tout mettre à feu et à sang. Léonidas réplique à Xerxès, qui lui ordonnait de rendre les armes : « Viens les prendre ! » On cite aussi comme des modèles du genre le veni, vidi, vici (je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu) de César et le « Sinon, non » des Aragonais, lors de l’investiture de leurs rois... « Ea rus » (je pars à la campagne), écrivait, à la suite d’un défi, Voltaire à Piron. « I » (va), répondit Piron, que son laconisme majeur faisait vainqueur du tournoi.
— L.
LACTÉE (VOIE)
n. f. (lactée, du latin lactis : lait)
Dans la bande blanchâtre qu’on aperçoit pendant les nuits sereines, suspendue sur la voûte céleste, la mythologie grecque, écho poétisé du balbutiement de l’homme primitif, a voulu voir quelques gouttes de lait tombées du sein de Junon allaitant Hercule.
Fable, miracle, religion, en un mot ignorance doublée de crainte, voilà ce qui est à l’origine de l’interprétation des phénomènes de la nature et des rapports de l’homme avec le monde environnant.
Les siècles et les millénaires ont rétréci, tout en allongeant au delà de nos conceptions, la vision du ciel étoilé que la découverte du télescope et du spectroscope commencent à préciser.
Pour la science contemporaine, cette bande blanchâtre est notre Voie Lactée, dont le grand Herschell a été le Christophe Colomb et où on compte déjà plus de deux milliards de soleils. (Dans un espace de quinze degrés de long sur deux de large, Herschell a dénombré jusqu’à 50.000 étoiles et le nombre s’accroît à mesure avec la puissance des télescopes).
Du fait que nous voyons cette bande blanchâtre de toute la surface de la rotondité de la Terre, il ressort, d’une évidence mathématique, que notre Soleil avec toutes ses planètes est profondément plongé dans la Voie Lactée.
La Voie Lactée est une immense agglomération de soleils ou d’étoiles, à forme lenticulaire, d’une longueur d’au moins 25.000 et d’une épaisseur de 5.000 années de lumière dans laquelle notre soleil se trouve à une distance d’environ 400 années de lumière du centre.
Toutes les étoiles que la vision humaine non armée du télescope est susceptible d’embrasser appartiennent à la Voie Lactée proprement dite.
Mais il est probable, pour ne pas dire certain, que les Nuées de Magellan, le Grand et le Petit Nuage, découvertes par Magellan, en 1521, lors de la première circumnavigation de notre terre forment, avec les amas d’Hercule et d’autres amas stellaires, comme les faubourgs de la Voie Lactée, et que tout ce système de mondes, divisés en une infinité de sous-groupements, s’étend dans l’espace à plus de cent mille années de lumière.
Dans le Grand Nuage de Magellan, soit dit entre parenthèses, se trouve la plus grande étoile connue, la super-géante S. Dorade, dont le diamètre dépasse 300 millions de kilomètres (celui du Soleil n’est, que de 1.391.000 kilomètres) et la luminosité 600.000 fois celle de l’astre du jour, c’est-à-dire d’autant de fois que celle du Soleil dépasse la luminosité de la pleine Lune.
A ce sujet, le regretté Camille Flammarion, que continue sa vaillante compagne, a écrit :
« Le rayon lumineux qui part aujourd’hui de S. Dorade n’atteindra la Terre que dans cent mille ans. D’ici là, les théories astronomiques et toutes les idées actuelles des habitants de la Terre se seront quelque peu modifiées. Les générations de ce lointain futur formeront un autre monde sur notre monde... »
Au delà, l’espace paraît privé d’étoiles sur des espaces énormes par rapport aux dimensions de la Voie Lactée.
Plus loin, bien plus loin, à la limite de nos calculs actuels, nous trouvons, à des millions et des millions d’années de lumière, les nébuleuses spirales, dont plusieurs centaines de mille ont été repérées. Elles sont posées comme des escargots argentés dans le jardin des étoiles et constituent des systèmes en tout analogues à notre Voie Lactée et de dimensions comparables aux siennes.
Toutes ces voies lactées avec leurs nébuleuses résolubles et irrésolubles, la nôtre y comprise, se meuvent dans l’espace à raison de 600 à 1.000 kilomètres par seconde, tandis que la vitesse des étoiles ne dépasse guère, en moyenne, 20 à 60 kilomètres dans le même laps de temps.
Les soleils ou étoiles (c’est tout un) sont les atomes, les voies lactées : les molécules de l’Univers et l’homme est leur image en raccourci.
— Frédéric STACKELBERG.
* * *
Les Grecs donnaient à cette couronne d’étoiles de nom de Galaxie (du mot gala, lait) et les astronomes l’ont quelquefois désignée ainsi. Les Romains l’appelaient via lactea (d’où voie lactée) et ce nom est le plus employé de nos jours, tant dans la langue scientifique que dans le langage vulgaire. Dans sa course à travers le ciel, la voie lactée (qui varie de position avec les étoiles fixes, qu’elle suit dans leur marche) rencontre un grand nombre de constellations. Partant de Cassiopée, elle traverse Persée, Orion, les Gémeaux, le Grand Chien ou Syrius, le Centaure, la Croix et le triangle austral ; de là elle continue sa route en passant par le Scorpion, le Sagittaire et, se divisant en deux branches, elle rencontre l’Aigle, la Flèche, le Cygne, le Serpentaire, Céphée et revient enfin à Cassiopée, après avoir décrit son cercle entier. Comme toutes les apparences célestes, la Voie Lactée a servi, dans l’antiquité de point de départ aux fictions poétiques : suivant Ovide, c’était le chemin du palais de Jupiter ; d’autres poètes en rapportaient l’origine à l’embrasement causé par Phaéton : d’autres encore à quelques gouttes de lait échappées des mamelles de la chèvre Amalthée, qu’Hercule laissa tomber de sa bouche, lorsque Junon, apaisée, vint présenter le sein au fils de sa rivale... Si la science a rejeté dans la Fable ces légendes imagées, réponses sommaires à la curiosité de nos ancêtres, elle a, par contre, par ses explications positives, ouvert des horizons infinis aux générations futures et étendu devant l’esprit humain un champ de découvertes illimité. Pour être traversée de chiffres effarants, la poésie de l’espace n’en demeure pas moins attirante et son merveilleux s’élargit...
LACUNE
n. f. (latin lacuna : proprement petit lac, de lactus, lac)
Espace vide dans l’intérieur d’un corps. Les corps lacunaires (minéralogie) sont composés de cristaux agglomérés qui laissent entre eux des intervalles. En botanique, on désigne ainsi des cavités pleines d’air qui constituent des solutions de continuité dans le tissu cellulaire des plantes. Par suite de l’accroissement plus rapide dans un sens que dans un autre ou de la destruction d’une partie du tissu végétal, la tige des graminées, des bambous par exemple, se creuse intérieurement et les sucs déposés en nœuds y limitent des espaces fistuleux irréguliers. Ailleurs, comme dans le noyer, la moelle du canal médullaire se rompt, laissant entre ses fragments des lacunes occupées par des gaz. En anatomie, on donne ce nom à des cavités des membranes muqueuses dont les parois secrètent une humeur visqueuse...
Par analogie, on appelle ainsi une solution de continuité, une interruption dans le corps d’un ouvrage ou le texte d’un auteur. Il y a, par exemple, dans la chronologie des anciens empires d’Orient des lacunes devant lesquelles les érudits demeurent perplexes.
« Parmi les ouvrages qui nous sont venus de l’antiquité, un assez grand nombre en effet sont incomplets et présentent des lacunes qu’on ne pourra sans doute jamais remplir. En des siècles où l’imprimerie était inconnue et où les œuvres manuscrites étaient très rares, comparativement à nos produits typographiques, il est arrivé que de précieux écrits se sont perdus en totalité ou en partie. Les chrétiens des premiers siècles n’ont pas peu contribué à la destruction de ces monuments anciens, qui n’étaient à leurs yeux que des œuvres ennemies de la religion nouvelle et, par conséquent, dignes d’être anéanties. Les moines utilisèrent parfois les vieux manuscrits profanes, pour y écrire des psaumes, des compositions ascétiques, etc... On est parvenu à retrouver, sous leur écriture, les textes primitifs, et c’est ainsi que plusieurs ouvrages, on parties d’ouvrages importants, ont échappé à l’oubli. Il y a des lacunes dans Aristote, dans Tite-Live, dans Vélléius Paterculus. Des copistes, voulant réparer des lacunes, ont souvent mis beaucoup d’inepties là où il y a lieu de croire que les auteurs avaient mis d’excellentes réflexions. Le roman grec de Daphnis et Cloë, par Longus, offrit, jusqu’à P.-L. Courier une lacune considérable, dont ce savant helléniste découvrit le texte dans un manuscrit de la bibliothèque de Florence. L’histoire des Egyptiens présente de nombreuses lacunes. » (Lachâtre)
Ceux qui admettent, ou estiment possible, l’existence de Jésus-Christ, rencontrent dans sa vie, entre douze et trente ans, une lacune qui accroît singulièrement le nombre des conjectures formées sur la période de gestation du christianisme. Les siècles ont ainsi, comme les souvenirs humains, des lacunes susceptibles de n’être jamais comblées.
LAÏCISATION
n. f.
Le fait de remplacer, par un personnel laïque, les congréganistes dans les écoles, les hôpitaux, etc...
Jusqu’à la grande Révolution française, le rôle des congréganistes était très important dans l’Etat. Les ordres religieux tenaient l’enseignement primaire, secondaire et même supérieur ; Albert le Grand, Abélard, Roger Bacon étaient des moines. L’assistance aux pauvres et aux malades était aux mains du clergé. Le clergé séculier possédait les registres des baptêmes qui tenaient lieu d’état civil.
La substitution de la République au régime monarchique et féodal a eu pour conséquence la laïcisation. La religion cesse d’être un appareil d’Etat pour devenir une affaire privée ; le moine et le prêtre sont remplacés par des fonctionnaires publics, neutres en principe an point de vue religieux, tout au moins dans l’exercice de leurs fonctions.
L’Eglise catholique a vu d’un très mauvais œil la laïcisation qui lui enlevait une partie de sa puissance. Les pauvres institutrices primaires des années 1880 à 1890 ont eu une vie très dure. Le clergé tout puissant dans les campagnes ameutait contre elles les paysans. Celle qui venait remplacer les religieuses dans l’école était boycottée ; les commerçants refusaient de lui vendre des aliments, elle était en butte à l’injure, à la calomnie, parfois aux voies de fait.
Dans les hôpitaux, la laïcisation marche très lentement ; encore aujourd’hui, nombre d’hôpitaux de province sont tenus par des sœurs.
La laïcisation de l’enseignement primaire a eu de très heureux effets. Certes l’école laïque a aussi ses dogmes ; elle ment aux enfants en leur présentant des images fausses de la société où ils doivent vivre. Elle leur fait adorer la patrie, le drapeau ; mais enfin l’affranchissement religieux est déjà un résultat. C’est l’école laïque qui a affermi la République, qui, toute mauvaise qu’elle soit, vaut mieux que la monarchie. Il ne faut pas oublier que la France est le pays le moins religieux du monde et il faut en savoir gré à l’école laïque.
Dans les hôpitaux, les religieuses exercent une pression odieuse sur les pauvres malades pour les amener à se soumettre aux pratiques du culte. Elles épouvantent les mourants avec l’évocation de leur fin prochaine, pour les forcer aux derniers sacrements. L’homme en soutane noire vient se dresser au lit du moribond terrorisé, véritable fantôme de la mort elle-même.
Les cléricaux n’ont pas manqué de reprocher au personnel hospitalier sa dureté, son incurie, sa vénalité. Reproches justifiés, surtout avant la guerre. Les infirmiers étaient des hommes inférieurs, qui n’avaient pas appris de métier ; les infirmières venaient des campagnes ; beaucoup étaient illettrées ou presque. Les traitements étaient dérisoires, la nourriture grossière ; le logement, un dortoir infect dans les combles de l’hôpital.
Mais il ne faut pas oublier que les religieuses tenaient le rôle de surveillantes ; elles ne se chargeaient pas des besognes grossières de propreté qui étaient laissées au personnel laïc.
Forcée d’accepter la laïcisation, l’Eglise a changé de méthode. Elle s’applique à conquérir le personnel laïque de l’enseignement primaire et malheureusement elle y réussit.
La dictature intellectuelle qui a sévi pendant la guerre a amené une forte régression.
En outre le parti radical, artisan de la laïcisation, s’est endormi sur ses lauriers et l’Eglise en a profité pour reconquérir peu à peu le terrain perdu. On n’a rien fait pour donner un intérêt à la vie de la pauvre institutrice isolée dans son école de village. La République parlementaire l’a traitée avec indifférence parce que, femme, elle n’était pas électeur. Aujourd’hui, l’Eglise va la trouver ; une société secrète, les Davidées, couvre la France de ses sections ; l’institutrice est enrôlée dans l’armée cléricale. Des professeurs d’école normale primaire affichent ouvertement leur catholicisme.
Le gouvernement ferme les yeux. Il a rétabli l’ambassade du Vatican ; il paie des congrégations missionnaires pour aller enseigner aux peuples attardés l’absurdité religieuse.
C’est que la République capitaliste a compris que la religion est un frein social. Dans sa terreur du communisme, elle abandonne la laïcisation.
— Doctoresse PELLETIER.
LAIQUE
adj. et subst. (lat. laicus, grec laikos, de laos, peuple)
Au sens strict, est laïque tout chrétien qui n’appartient pas à la hiérarchie ecclésiastique ; d’où le nom de frères lais ou laïcs, donné dans les couvents aux imbéciles qui ne reçoivent point les ordres sacrés et se bornent à remplir le rôle de domestiques. D’après le droit canon, sœurs de la charité, frères des écoles chrétiennes, tous les moines non tonsurés, ainsi que l’armée des nonnes restent dans le rang des laïques, malgré les immenses services qu’ils rendent au catholicisme. Pour être clerc, il faut avoir reçu au moins les ordres mineurs ou la tonsure. Ce dernier grade n’est qu’un signe de prise de possession par les autorités ecclésiastiques ; aussi le donnait-on autrefois, presque au sortir du berceau, aux enfants nobles que l’on destinait à la cléricature. Comme les ordres mineurs, il n’engage ni au célibat, ni à aucune des obligations contractées par le prêtre ou le simple sous-diacre ; mais il permettait autrefois de se soustraire aux tribunaux civils, d’obtenir des bénéfices ecclésiastiques et même d’arriver cardinal. Il n’a plus d’importance aujourd’hui que pour les séminaristes assez bêtes ou assez fourbes pour accepter de devenir les fonctionnaires dociles du Vatican.
Le mot laïque a pris un sens bien différent ; il sert à qualifier, à notre époque, toute personne ou toute chose n’étant pas d’Eglise. Sans être prêtres, les frères ignorantins, les jésuites de robe courte, les convers de tout ordre, parfois les sacristains, prétendent se séparer du monde profane et rentrer dans la tribu de Lévi. En s’affublant de cornette et de voile, les femmes elles-mêmes s’imaginent devenir personnes sacrées, oublieuses que l’Eglise les a pour jamais exclues de sa hiérarchie. Car devant le flot montant de l’incrédulité populaire, et pour flatter la vanité d’ouailles assez sottes pour les servir, les autorités ecclésiastiques acceptent de réserver l’épithète de laïques aux hommes, aux doctrines ou aux institutions que n’inspirent pas les idées théocratiques. A lire les écrivains bien pensants, il appert que laïc est, pour eux, synonyme de criminel ou de diabolique ; en conséquence ce maladroit adjectif ne convient plus lorsqu’il s’agit de benoîts serviteurs de messieurs les curés.
« Au temps où l’Eglise était toute puissante, elle s’était profondément séparée de la masse populaire et avait constitué une sorte de société à part, avec des institutions spéciales, à elle propre, et surtout elle n’avait pas négligé de se donner tous les avantages qui lui semblaient de nature à assurer sa domination. Dans l’origine, elle avait été pauvre, faible, populaire alors ; devenue puissante, elle cessa d’être libérale et protectrice comme auparavant. Il n’y eut, au contraire, jamais un gouvernement plus avide de pouvoir ni plus jaloux de ses prérogatives ; et, au lieu de rester peuple, de se maintenir dans ce fécond et vivifiant milieu social, elle s’isola de plus en plus, ayant soin de tracer sur tous les points, autant que possible, des lignes de démarcation entre elle-même et le peuple ; elle ne voulut ni porter le même nom que lui, ni vivre de la même vie. Il y eut alors la condition ecclésiastique et la condition laïque, deux juridictions, deux sortes, sinon deux natures de biens, les uns avec privilèges, les autres avec charges, etc. « Tout laïque, dit un ancien règlement, qui rencontrera en chemin un prêtre ou un diacre, lui présentera le cou pour s’appuyer ; si le laïque et le prêtre sont tous deux à cheval, le laïque s’arrêtera et saluera révéremment le prêtre ; si le prêtre est à pied et le laïque à cheval, le laïque descendra et ne remontera que lorsque l’ecclésiastique sera à une courte distance, le tout sous peine d’être interdit pendant aussi longtemps qu’il plaira au métropolitain ». Il faut convenir que l’Eglise et le clergé en ont un peu rabattu depuis, mais ce n’est pas assurément de leur plein gré. Rois et peuples ont eu à lutter successivement et tour à tour pour échapper à ce joug qui durant des siècles, opprima l’Europe corps et âme, à un degré inouï. » (Lachâtre)
Pleine de défiance pour le simple fidèle, tant qu’elle fut maîtresse, poussant la tyrannie jusqu’à interdire l’enseignement public à quiconque n’était pas clerc, l’Eglise a besoin présentement de ces laïcs si méprisés. On sait que les rois de France étaient chanoines de Rome par droit de naissance ; quiconque est riche ou influent aujourd’hui revêt la dignité de camérier du pape ou de chevalier d’un ordre romain. La jeunesse dorée fournit des brancardiers pour Lourdes, des moniteurs pour le catéchisme, des rabatteurs bénévoles pour toutes les œuvres sacerdotales. Aussi la prélature reconnaissante décerne-t-elle à cette ribambelle calotine les titres de croisés eucharistiques, de pages du Christ, de chevaliers de la croix. Elevés au-dessus du vulgum pecus, ces auxiliaires du clergé ont leur place marquée en fait, sinon en droit, dans la hiérarchie lévitique qui descend, par échelons successifs, des cardinaux aux vulgaires mouchards de sacristie.
C’est en matière d’enseignement que l’Eglise s’est déclarée le plus violemment hostile à l’esprit laïc. Comprenant que des intelligences adultes et normales ne sauraient admettre son absurde credo, elle réclama de bonne heure le droit exclusif d’ouvrir des écoles et d’instruire les enfants. Puis, ses prétentions admises, elle se garda de mettre la science à la portée du populaire. Sans doute Charlemagne, dont l’Eglise fit un bienheureux, malgré ses cinquante bâtards, imposa à des évêchés et à des monastères, l’ouverture de quelques écoles ; il en fonda même dans son palais. Mais ces écoles, fort peu nombreuses, furent bientôt supprimées par ordre de Benoît d’Aniane, dans les couvents bénédictins ; et le concile d’Aix-la-Chapelle, en 817 décida qu’on ne recevrait plus de laïques dans les écoles claustrales ; elles ne devaient s’ouvrir qu’aux enfants destinés à la cléricature. Adalbéric, évêque de Laon, avouait au début du XIème siècle que « plus d’un évêque ne savait pas compter sur ses doigts les lettres de l’alphabet » ; et, des nombreux moines de Saint-Gall, un seul pouvait lire et écrire en 1291. Dans le haut moyen-âge, si les ecclésiastiques arrivaient en général à lire, un grand nombre ne savaient pas écrire. A partir du XIIIème siècle, il y eut des écoles de village, mais les élèves n’y apprenaient souvent pas à lire ; ils se bornaient à réciter des prières et des formules de catéchisme. Quant aux Universités, qui devinrent florissantes à cette époque, c’étaient des institutions essentiellement religieuses, dont les professeurs portaient soutane et n’enseignaient qu’avec une permission expresse des autorités ecclésiastiques. La faculté de théologie tenait le premier rang, et celle des arts s’appliquait exclusivement aux matières utiles pour le sacerdoce : grammaire latine, rhétorique, dialectique, plain-chant, étude du calendrier liturgique. La philosophie, réduite à n’être que la servante de la théologie, tournait à vide, s’arrêtant à des jeux de mots, à des chicanes sans grandeur, à des puérilités indignes d’hommes raisonnables.
Et jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, l’Eglise réussit à maintenir son droit exclusif d’enseigner. Pour lutter contre le protestantisme, les Jésuites organisèrent les écoles secondaires au XVIème ; leurs méthodes furent imitées dans les établissements tenus par le clergé. Quant à l’enseignement primaire, il resta aux mains des frères des Ecoles chrétiennes, fondés par Jean-Baptiste de la Salle, en 1680. Avec Condorcet apparaît, sous la Révolution, l’idée d’un enseignement laïc. Chaque religion, pensait-il, devait être prêchée « dans les temples par ses propres ministres », mais on ne saurait admettre « dans l’instruction publique, un enseignement religieux qui, tout en repoussant les enfants d’une partie des citoyens, détruirait l’égalité des avantages sociaux et donnerait à des dogmes particuliers un avantage contraire à la liberté des opinions ».
« Cette proscription doit s’étendre même sur ce qu’on appelle religion naturelle ; car les philosophes théistes ne sont pas plus d’accord que les théologiens sur l’idée de Dieu, et sur ses rapports moraux avec les hommes. C’est donc un objet qui doit être laissé, sans aucune influence étrangère, à la raison et à la conscience de chaque individu. »
Condorcet veut la même neutralité à l’égard des opinions politiques, mais il réclame l’enseignement d’une morale fondée « sur nos sentiments naturels et sur la raison ». Napoléon, tout en gardant la haute main sur les écoles, y rendit obligatoire l’instruction religieuse ; pour former des sujets fidèles et des fonctionnaires obéissants, il estimait le catéchisme un adjuvant de premier ordre. L’enseignement redevint confessionnel et prêtres, frères, nonnes firent, en grand nombre, partie du personnel universitaire. Naturellement la Restauration vit croître l’influence calotine ; les éducateurs de tout grade et tout ordre furent à la merci de l’Eglise. En 1833, la loi Guizot prescrivit la fondation d’une école par commune ; la gratuité de l’enseignement primaire, proclamée en 1848, disparut avec l’Empire, mais la loi Falloux permit au clergé d’ouvrir des écoles pour y façonner à sa guise les jeunes cerveaux. Sous le second Empire, l’Eglise fut maîtresse de l’enseignement, même universitaire ; en 1875, elle obtint de pouvoir créer des facultés libres. Mais toute une série de mesures, à partir de 1881, aboutirent à la laïcité actuelle.
La loi du 28 mars 1882 porte :
« Article 3. — Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 15 mars 1850, en ce qu’elles donnent aux ministres des cultes un droit d’inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privée et dans les salles d’asile, ainsi que le paragraphe 2 de l’article 31 de la même loi qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques. »
Et la loi du 30 octobre 1886 précise :
« Article 17. — Dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. Article 18. — Aucune nomination nouvelle, soit d’instituteur, soit d’institutrice congréganiste, ne sera faite dans les départements où fonctionnera depuis quatre ans une école normale soit d’instituteurs, soit d’institutrices, en conformité avec l’article premier de la loi du 9 août 1879. Pour les écoles de garçons, la substitution du personnel laïque au personnel congréganiste devra être complète dans un laps de cinq ans après la promulgation de la présente loi. »
Ces mesures furent aggravées par la loi du 7 juillet 1904 qui supprimait l’enseignement congréganiste.
« Article premier. — L’enseignement de tout ordre et de toute nature est interdit en France aux congrégations. Les congrégations, autorisées à titre de congrégations exclusivement enseignantes, seront supprimées dans un délai maximum de dix ans. Il en sera de même des congrégations et des établissements qui, bien qu’autorisés en vue de plusieurs objets, étaient en fait exclusivement voués à l’enseignement, à la date du 1er janvier 1903. Les congrégations, qui ont été autorisées et celles qui demandent à l’être à la fois pour l’enseignement et d’autres objets, ne conservent le bénéfice de cette autorisation que pour les services étrangers à l’enseignement prévus par leurs statuts. Article 2. — A partir de la promulgation de la présente loi, les congrégations exclusivement enseignantes ne pourront plus recruter de nouveaux membres et leurs noviciats seront dissous, de plein droit, à l’exception de ceux qui sont destinés à former le personnel des écoles françaises à l’étranger, dans les colonies et les pays de protectorat. Le nombre des noviciats et le nombre de novices dans chaque noviciat seront limités aux besoins des établissements visés au présent paragraphe. Les noviciats ne pourront recevoir d’élèves ayant moins de vingt et un ans. »
Une mesure récente vient de modifier cette loi, en autorisant neuf congrégations missionnaires à ouvrir des écoles confessionnelles pour assurer, paraît-il, le recrutement de leurs membres ; les jeunes gens y seront reçus dès l’âge de seize ans. Il s’agit, affirment Poincaré et ses compères, de permettre l’expansion de la langue et de l’influence française à l’étranger ; mais chacun a compris que c’était le premier coup de pioche donné aux institutions laïques, et que le gouvernement français rêvait de réconciliation avec le Vatican. Aussi bien la loi du 7 juillet 1904 ne fut-elle jamais appliquée, même sous les gouvernements qui se disaient anticléricaux. Moines et nonnes se sécularisèrent en bloc ; i1s quittèrent leurs habits, mais restèrent secrètement affiliés à leur ordre et continuèrent d’enseigner. Plus florissante que jamais les écoles congréganistes se bornèrent à changer de nom, en se baptisant écoles libres. Ce fut une belle comédie, favorisée par les tribunaux où les bien-pensants dominent, et par ceux mêmes qui devaient faire appliquer la loi : à commencer par les ministres, heureux de gagner, de la sorte l’occulte bienveillance des bons chrétiens. Dès le début de la guerre, en 1914, on suspendit d’office les lois sur les congrégations ; avec l’approbation tacite des pouvoirs publics, elles se réinstallèrent au grand jour. Elles ne demandent présentement que la consécration légale d’un état de fait visible depuis longtemps ; car les hommes de gauche ne deviennent anticléricaux que lorsqu’ils cessent d’être au pouvoir : pendant la guerre et depuis, tant qu’ils détinrent les principaux ministères, nulle concession ne leur parut contraire à l’esprit de laïcité.
Laïcité, d’ailleurs respectueuse de tous les préjugés :
« La bibliothèque scolaire, lit-on, dans une circulaire ministérielle de 1919, ne doit contenir que des ouvrages qu’un petit catholique, un petit protestant, un petit israélite, un petit libre-penseur puissent lire sans que leurs parents leur paraissent de pauvres égarés, voués à l’erreur et peut-être marqués pour le mal, sans qu’ils se sentent eux-mêmes tenus en une sorte de suspicion, sans qu’ils aient l’impression de ne pouvoir mériter l’estime particulière qui va naturellement à telle ou telle catégorie de personnes que celle à laquelle ils appartiennent. »
Et toujours l’Université se montra, à l’égard du catholicisme, d’une tolérance frisant la servilité. Innombrables sont les croyants dans l’enseignement secondaire et supérieur ; dans les trois quarts des lycées, l’aumônier est le vrai chef de 1’établissement : et, pour obtenir les hauts grades universitaires, il semble indispensable de fréquenter église, temple ou loge. Il est couvert d’avance celui qui viole la neutralité scolaire au profit des idées chrétiennes ; mais on pourchasse sans répit l’adversaire de tous les dieux, anciens ou nouveaux. Bien entendu, morale traditionnelle, patriotisme, préjugés de race, etc., font partie du matériel normal de la laïcité. Jusqu’à la guerre, l’enseignement du premier degré s’était défendu avec énergie contre la mainmise cléricale ; ce temps n’est plus. Les Davidées, institutrices laïques, groupées en association religieuse, déclarent publiquement :
« La neutralité de l’Etat est une neutralité confessionnelle, et non pas une neutralité philosophique, c’est-à-dire que c’est une neutralité nécessitée par les conditions de la vie sociale et qui ne s’exerce que sur les confessions religieuses. Ce ne peut être une doctrine comme le scepticisme, encore moins l’athéisme. » (Aux Davidées, octobre 1928.)
« Il faut donc affirmer l’existence d’une morale rationnelle fondée sur Dieu. Il est non seulement possible, mais nécessaire d’enseigner une telle morale dans les établissements publics... Il faut parler de Dieu aux élèves non seulement comme principe de la morale, mais comme objet d’une vertu rationnelle très précise. » (Rapport de Carteron)
Et fort de l’appui ministériel, le Bulletin des Davidées entre dans de minutieux détails sur la façon d’endoctriner les enfants :
« On ne fait pas la prière du matin, ni celle du soir, mais il y a de magnifiques poésies chrétiennes mises en musique. Vous les connaissez toutes. On peut les choisir plus ou moins religieuses, suivant le milieu où l’on se trouve... Au point de vue historique, il y a un moyen d’apostolat magnifique en redressant toutes les erreurs officielles répandues. Mais là, il faut bien dire que les membres de l’enseignement public sont eux-mêmes bien trompés et leur premier devoir est de s’instruire. Signalez-leur donc les livres de Guiraud que nulle institutrice catholique ne devrait ignorer, ceux de Louis Dimier, de Pierre Lasserre... Il y a de bonnes choses dans certains livres de Renan, qu’un prêtre érudit pourrait vous signaler. Après cela, il vous sera beaucoup plus facile d’enseigner la vérité... Au point de vue scientifique, pourquoi ne pas agrémenter chaque leçon par un passage intéressant d’un savant catholique (l’abbé Moreux, par exemple), ou des passages de livres catholiques destinés à la vulgarisation scientifique ? Il en existe que vous pourriez signaler les unes aux autres... Travaux de couture ou de broderie. Donner à ces travaux un but pratique ; indiquer les buts en laissant le choix (neutralité!), mais parmi les buts indiqués, ne pas oublier un dessous de vase pour l’autel de l’église par exemple (apostolat!), ou que sais je encore ? Mais en tout cas, quelque chose qui dirige l’esprit vers la pensée de Dieu... Mais là il ne faut pas être intransigeants, mais plutôt insinuants. »
Et les inspecteurs, gardiens de la laïcité, ne disent rien ; il est vrai que les Davidées sont d’ardentes patriotes et qu’elles défendent avec zèle l’Argent et l’Etat. Si la « Fraternité Universitaire » se permettait la dixième partie de ces attaques contre la neutralité scolaire, en sens inverse naturellement, comme on aurait vite fait de me révoquer ; que d’histoires, que de noises ne me cherchent pas les inspecteurs en mal d’avancement ! Voilà où nous en sommes en fait de laïcité, sous la troisième république. Dans son remarquable livre : La Laïque contre l’Entant, paru en 1911, Stephen Mac Say avait parfaitement prévu cette évolution. Et ses critiques n’ont pas vieilli après la tourmente de 1914–1918, preuve qu’elles ne portaient point sur des vices d’un jour, mais sur les plaies durables de notre enseignement. Tout serait à citer : sur l’imbécillité des programmes, sur les défauts rédhibitoires des procédés pédagogiques, sur les buts avoués ou secrets de l’Etat éducateur. « Les sujets laïques nous semblent moins enchaînés parce qu’ils le sont par une multitude de chaînettes. L’énorme chaîne (bien rouillée quand même) du catholicisme nous saisit davantage. A l’école chrétienne on voit toujours Dieu derrière l’homme, par delà la ligature du devoir. A la laïque, une petite brume de doute masque parfois la divinité, mais l’entrave aux filaments multiples l’asservit aux mêmes obscurs impératifs. Et qu’on ne vienne pas me dire que cet esprit, toujours en vigueur dans les programmes, est en voie d’extinction et qu’avec la religion de la Cause première disparaîtra la « base extérieure » (toute de foi) de la morale. Je répondrai que la laïque n’ignore pas que « prétendre plier l’enfant au joug de la discipline et de l’obéissance, créer en lui un principe qui le fasse accepter volontairement la loi du travail et du devoir et ne pas demander cette force à la religion, c’est tenter une œuvre impossible », qu’elle n’est pas irréligieuse, mais autrement religieuse, et que ce n’est pas sa faute si l’emprise de la religion diminue dès que s’humanise son absolu. A mesure que ce point d’appui s’écroule, on asseoit le dogme du Devoir dans le ciel hypothétique d’une religion nouvelle et la Patrie sera le premier Dieu de la décadence ». Puis quelles vues pénétrantes sur l’étouffement systématique de l’initiative chez l’enfant :
« Son pauvre corps exubérant est la proie des règlements et des prohibitions. Il ne se meut qu’au commandement. Voici huit heures. Un coup de sifflet. Comme une nuée de moineaux fauchée dans son vol, les enfants s’interrompent dans leurs jeux. Sur deux rangs, la colonne franchit le seuil de l’école. Un silence brusque s’établit. Les coiffures s’abaissent. Salut déférent au caporal pédagogue et au temple scolaire. Les élèves s’insinuent à leurs bancs et, au signal, s’asseyent. Dociles, en apparence du moins, à l’emploi du temps qu’appuie le vouloir du maître, ils se plient aux leçons qui, les mêmes jours, aux mêmes instants, accaparent leurs efforts. A l’ordre ils écrivent, à l’ordre ils récitent, à l’ordre ils déplacent livres et cahiers. »
Aussi le bambin de six ans, très ouvert le premier jour, sera plus renfermé le lendemain et complètement refroidi après une semaine de classe... Non que les éducateurs soient toujours coupables, Stephen Mac Say l’a fort bien vu ; dès qu’ils veulent réagir contre la routine, de nombreuses difficultés les assaillent ; matières des programmes, contrôle des directeurs, des inspecteurs, de la bureaucratie, des familles, généralement traditionnalistes, Dans nos écoles laïques, le champ individuel de réaction paraît singulièrement restreint pour le professeur ; il est impossible d’y donner une éducation vraiment humaine. Mais il faudrait des ressources que nous n’avons point pour en fonder d’autres, animées de l’esprit que nous désirons. Ne désespérons pas néanmoins, c’est de notre inertie surtout que résulte le triomphe de nos adversaires.
— L. BARBEDETTE.
LANGAGE
n. m. (de langue, latin lingual)
Dans le sens le plus généralement admis, le langage est :
« Tout ce qui sert à exprimer des sensations et des idées. » (Littré)
« Un moyen quelconque d’exprimer des idées. » (Larousse)
« L’expression de la pensée. » (Grande Encyclopédie)
« Le pouvoir donné à l’intelligence de se manifester par des signes. » (Bescherelle)
« La peinture de nos idées » (Rivarol)
...
Il s’agit là du langage des êtres qui sentent et ont des idées qui nous sont communicables et compréhensibles. Mais il y a un autre langage, celui des choses, qui sont ou que nous supposons sans pensée parce qu’elles ne nous parlent pas un langage direct, compréhensible, et que nous n’en avons d’autre idée que celle que nous nous en faisons. Ainsi, nous interprétons le langage de la nature d’après les sensations que nous en avons et non d’après ce qu’elle dit. Le langage des fleurs est celui que nous leur attribuons d’après la variété de nos sentiments, suivant leurs formes, leurs couleurs, leurs parfums. Le langage d’une œuvre d’art est beaucoup plus dans l’impression qu’elle nous donne que dans l’idée exprimée par l’artiste en la composant. Le langage des choses est ainsi un langage figuré. Nous en reparlerons au mot Sens.
Tout être qui a une sensibilité et une intelligence a des idées à exprimer, si élémentaires, si grossières, si confuses soient-elles. De même qu’il n’y a pas de fonction sans organe ni d’organe sans fonction, tout langage a des idées. Quand la fonction n’existe plus, l’organe disparaît ; si les hommes, un jour, n’ont plus d’idées, ils n’auront plus de langage.
Les animaux ont un langage ; c’est une preuve, parmi beaucoup d’autres, qu’ils pensent et qu’ils ont des idées. L’homme peut ne pas comprendre leur pensée ; il ne peut la nier que par aveuglement ou mauvaise foi. Buffon ne craignait pas d’écrire :
« C’est parce qu’une langue suppose une suite de pensées que les animaux n’en ont aucune. »
C’était là du cartésianisme qui niait la sensibilité des animaux, même lorsqu’ils criaient de douleur. Le langage des animaux a les mêmes formes naturelles que celui de l’homme : non seulement ils s’expriment spontanément par le geste ou par la voix, mais certains possèdent le langage articulé, contrairement à l’affirmation de M. Vinson (Grande Encyclopédie) que ce langage « est la caractéristique exclusive de l’homme ». Max Muller avait vu un fossé infranchissable entre la parole humaine et celle des animaux. Il eût fallu d’abord chercher à franchir le fossé avant de le déclarer infranchissable.
Presque tous les vertébrés ; mammifères, oiseaux, batraciens, reptiles, et certains poissons ont, comme l’homme, une voix d’origine laryngée et susceptible d’articulation. Quand ils ne se servent pas du langage articulé, c’est qu’ils n’en ont pas besoin ; ils ont mieux que ce langage à leur disposition. Les invertébrés ont des sons vocaux produits par stridulation, bourdonnements, etc... Le système articulaire humain n’est pas le même que celui des animaux, mais il varie aussi chez l’homme. Si l’animal éprouve des difficultés à parler le langage humain, il est aussi des hommes qui ne peuvent arriver à prononcer certaines consonnes familières à d’autres. Les langues, même les plus perfectionnées, sont loin de posséder un alphabet comprenant tous les sons et bruits articulables. Dès lors « on comprend que, pauvres nous-mêmes en langage articulaire, nous soyons mal armés pour étudier le langage articulaire des autres races » (Dr Maréchal : Supériorité des animaux sur l’homme).
Le langage des animaux qui ont un appareil vocal est supérieur à celui de l’homme :
-
par l’intensité du son et la portée de la voix qui est considérable chez certains, tels les grands singes ;
-
par la simplicité dans l’expression, une seule articulation permettant d’exprimer des idées et des séries d’idées très complexes ;
-
par l’universalité qui fait se comprendre entre eux des animaux d’espèces différentes, comme des chiens et des poules, bien que chaque espèce ait un langage particulier.
Les animaux apprennent le langage humain alors que les hommes n’apprennent pas le leur. Les animaux sont aidés en cela par le développement de leur ouïe ; les hommes manquent d’oreille.
« Au lieu de cultiver dans notre race le langage des sons, la langue musicale, nous nous sommes efforcés à créer des langues articulaires, ce qui est une faute, car rien n’est variable comme l’articulation qui se modifie presque à l’infini, par l’habitude, par les différenciations d’organes... Avec la langue musicale, pas de fluctuation dangereuse, le son est mathématique, immuable, le la est toujours le la, quelle que soit la voix qui le donne. » (Dr Maréchal, id.)
Dans le langage articulé, par exemple, le latin quisquam doit-il se prononcer kiskam ou kuiskuam ? C’est à la suite de la dispute engendrée par cette question que Charpentier fit assassiner Ramus, au XVIème siècle.
Les hommes ont encore beaucoup à apprendre sur le langage vocal des animaux, et encore plus sur leur langage muet. C’est à peine s’ils ont observé chez les insectes la perfection du langage antennaire qui se communique tactilement et se complète des observations de la vue et de l’ouïe.
On a donné les explications les plus diverses de l’origine du langage humain. Les religions, bien entendu, ont créé les fables les plus ridicules en cultivant cet anthropomorphisme qui a si sottement séparé l’homme de la nature et l’a dressé contre elle. La science, si longue à se dégager de cette sottise et qui est encore loin d’en être complètement libérée, a elle-même établi les systèmes les plus compliqués pour lui venir en aide ; elle a en conséquence fort à faire pour arriver à la vérité.
Les légendes sur la Création du Monde affirment la coexistence du langage avec le premier homme ; mais elles n’expliquent pas plus la formation de l’un que de l’autre. Le premier homme aurait parlé spontanément un langage complet, tout formé, comme il s’est trouvé créé par le souffle de Dieu. Ce langage était universel, parlé par tous les hommes lorsqu’ils eurent l’idée de construire la tour de Babel. Dieu fit alors parler à chacun d’eux, de la même façon spontanée, un langage différent et créa ainsi la confusion des langues. Voilà l’explication biblique de l’origine du langage et des diverses langues parlées dans le monde. De la même façon miraculeuse, Dieu fit plus tard le « don des langues » aux apôtres qui devaient aller prêcher l’Evangile et chacun sut parler le langage des peuples qu’il devait enseigner. Ce phénomène se serait reproduit en diverses circonstances d’après des récits catholiques. Mais il est contredit par les livres religieux eux-mêmes lorsqu’ils racontent que Marc, qui parlait le syriaque, le grec et le latin, aurait servi d’interprète à Pierre lorsqu’il serait venu à Rome. Si Pierre avait besoin d’un interprète pour parler aux Romains, il n’avait pas reçu le don des langues.
Ces sottises n’en ont pas moins trouvé assez de créance pour inspirer des systèmes appelés scientifiques sur la révélation divine du langage humain, celui entre autres de M. de Bonald, dans sa Législation primitive. Max Muller et Renan adoptèrent un moyen terme en déclarant que le langage serait le produit d’une sorte de révélation intérieure, un fait de conscience. Selon Renan, l’homme parlerait naturellement comme l’arbre porte des fruits.
D’après Platon, le langage humain est essentiellement arbitraire, purement artificiel ; il s’est formé successivement, à mesure du développement des idées et des besoins. Par exemple, les ouvriers ont fait le langage de leurs travaux ; ils ont donné leurs noms aux instruments de leur travail. C’est là le véritable terrain scientifique de la question. Elle s’y rencontre, quant à l’origine et à la multiplicité du langage, avec celle de l’origine et de la variété des races humaines.
Il est incontestable que l’origine du langage, animal ou humain, est dans les tentatives de manifestation de la pensée. L’individu n’a parlé que parce qu’il avait quelque chose à dire et son langage a suivi les tribulations et les développements de sa pensée. La question : « le langage a-t-il précédé ou suivi la pensée ? » est aussi puérile que celle du premier œuf et de la première poule ou que celle du nombril du premier homme qui sont la matière des plaisanteries de table d’hôte. Les premiers hommes n’ont eu d’autre langage que celui des animaux : gestes et cris inarticulés. On en a la démonstration par la formation du langage chez l’enfant. Il commence par crier en s’agitant. Seule l’éducation lui permet d’acquérir certaines articulations, puis certaines syllabes. Il les répète au retour de certaines circonstances ; ainsi, il dit : mama, papa, en voyant sa mère et son père. Peu à peu il apprend à parler parce qu’on lui enseigne la parole. A l’état sauvage, il n’aurait pas d’autre langage que celui des êtres au milieu desquels il vivrait. On a trouvé des enfants qui vivaient avec des loups ; ils n’avaient eu aucune révélation extérieure ou intérieure, le Saint-Esprit ne leur avait fait le don d’aucune langue ; ils parlaient le langage des loups.
Le développement du langage chez les animaux s’est fait dans des conditions qui ont de plus en plus échappé à l’homme. Chez l’espèce humaine, il a suivi le rythme qu’on observe chez l’enfant dont le langage se perfectionne avec la pensée. D’abord, des gestes accompagnés d’onomatopées traduisirent les formes et les sons. Ensuite vinrent des gestes et des paroles plus nombreux jusqu’au moment où le nombre des signes mimés, vocaux ou écrits correspondit à celui des idées en cours et forma le langage complet. Ce langage, l’homme l’apprend comme il apprend à penser. Il n’est pas plus inné en lui que telle forme de pensée ou telle autre et il ne le connaîtra, plus ou moins bien, qu’en rapport de l’étude, plus ou moins complète, qu’il en fera, de la même façon qu’il pourra apprendre un autre langage que celui du pays où il est né.
Comme dit M. Beaulavon (Grande Encyclopédie), le problème classique de l’origine du langage ne porte, en réalité, que sur l’origine de la parole qui est le langage en général. La parole est « un instrument artificiel et conventionnel, distinct de la pensée qu’il exprime et uniquement destiné à la communiquer ». Le langage est « essentiellement une manifestation de l’esprit », et pas seulement, comme l’a dit Darmesteter, « une matière sonore que la pensée humaine transforme, insensiblement et sans fin, sous l’action inconsciente de la concurrence vitale et de la sélection naturelle ». La parole « ne subsiste que par l’esprit et on ne peut en comprendre ni l’origine, ni le développement, ni le rôle, sans toujours tenir compte de la dépendance où elle est de la pensée » (Beaulavon).
Le langage s’exprime par des signes (Voir ce mot, voir idée, intelligence, etc.). Ces signes sont, soit le geste (pantomime), soit un son (parole proprement dite), soit un caractère tracé (écriture). Le geste et le son vocal sont spontanés, naturels. Ils ont pris des formes conventionnelles par le développement du langage humain qui, en même temps, a inventé l’écriture.
La parole proprement dite est la parole sonore. Chez l’homme et les animaux pourvus d’un larynx, les sons produits sont appelés voix. Ils sont de trois sortes : le cri, le son modulé et le son articulé. Dans le cri, il n’y a pas de véritable articulation. Il est généralement une interjection poussée sous l’effet d’une émotion subite ou un appel qu’on veut faire entendre le plus loin possible en forçant l’intensité du son aux dépens de l’articulation. Le son modulé est le chant. La voix se fait alors un instrument de musique. Elle est le seul instrument qui permet de joindre la parole articulée au chant. Le son articulé est la forme la plus usuelle du langage et se fait comprendre par les mots (du latin muttum ; mot et grognement, de muttire, grogner, murmurer). On appelle mots « des sons monosyllabiques ou polysyllabiques composés de plusieurs articulations, qui ont un sens, c’est-à-dire qu’ils expriment une représentation, une sensation ou une conception » (Grande Encyclopédie). Plus simplement, les mots sont « des sons ou réunions de sons exprimant une idée » (Larousse). Les mots les plus simples sont des interjections. Les autres prennent leur valeur de leur groupement en phrases et on les comprend par l’étude de leur son, de leur sens et des relations qu’ils ont les uns avec les autres. Leur sens est défini par le dictionnaire. Leurs relations sont établies par la grammaire qui leur donne leur place et leur emploi dans la phrase parlée ou écrite. Le langage humain le plus développé est celui où le sens des mots est le mieux gradué, le plus nuancé et permet d’exprimer toute la pensée avec le moins de mots. Il n’y a pas de mots abstraits dans le langage des primitifs ; aussi, a-t-il plus de mots que celui des civilisés.
Les mots sont des sons dans le langage parlé. Dans le langage écrit, ils sont composés de signes assemblés appelés lettres chez les peuples qui se servent de l’alphabet. La parenté de l’alphabet n’établit nullement une parenté de langage. Les Phéniciens, qui ont appris leur alphabet aux Grecs et à tous les peuples méditerranéens, ne leur ont pas appris à parler. Autant le langage des Grecs était doux, agréable, autant celui des Phéniciens était rude et malsonnant. Le climat, les conditions de vie, celles des mœurs, sont pour beaucoup dans le caractère du langage. Les peuples dont la vie est dure ont de la dureté dans la voix. Les troglodytes paraissaient plutôt siffler que parler. Les Groenlandais parlent sans remuer les lèvres. Les Anglais ont la voix rauque des gens qui vivent dans les brouillards. L’harmonie et la pureté de la langue grecque lui sont venues de celles du ciel de l’Attique. Alors que les langues du Nord sont chargées de consonnes qui font leur rudesse, la langue grecque est plus riche en voyelles en combinaisons de lettres et en accouplements de mots qui la rendent plus douce. Mais si elle est « le tranquille ruisseau dont l’eau coule sans former le moindre murmure » auquel Longin a comparé le style de Platon, elle devient aussi « un torrent impétueux, et peut s’élever avec les vents qui emportèrent la voile du vaisseau d’Ulysse ». (Winckelmann). Voltaire appelait génie d’une langue « son aptitude à dire de la manière la plus courte et la plus harmonieuse ce que les autres langages expriment moins heureusement ». Pour Rivarol, le génie d’une langue est ce qui en fait son caractère particulier.
« Ainsi que son esprit, tout peuple a son langage. » (VOLTAIRE)
Il l’aura tant que le mélange des races et des hommes n’aura pas fait disparaître le caractère et les mœurs particuliers à chacun. C’est le résultat auquel l’humanité arrivera si elle continue à suivre le mouvement social qui uniformisera de plus en plus les hommes en les parquant, quels que soient la latitude où ils vivent, leur couleur, leurs goûts, leurs sentiments, dans deux grandes classes : capitalistes et prolétaires. A l’uniformité sociale correspondrait alors celle du langage. L’une et l’autre seraient l’aboutissement de ce fait arbitraire mais historique qui a fait aller les sociétés humaines du multiple vers l’unité, de l’individu à la famille, au village, à la province, à la nation et qui les conduit à l’unité des nations. De même le langage est passé du parler villageois à celui de la région, à la langue nationale pour tendre à la langue universelle. Fait arbitraire disons-nous parce qu’il sacrifie l’individuel au collectif et le plus faible, individu, groupe ou classe, au plus fort. La disparition de nombreux idiomes a marqué celle de la liberté individuelle ; la réduction de certains autres à l’état de dialectes, et celle des dialectes à l’état de patois, ont correspondu à l’extinction progressive des libertés politiques. La belle lange d’oc a été réduite aux divers patois qui se parlent encore de Bordeaux à Nice, à la suite de la guerre des Albigeois qui a détruit les libertés méridionales du XIIIème siècle. Des milliers d’idiomes ont disparu, avec les populations qui les parlaient, dans les conquêtes des prétendus « civilisés ». Ce sont des documents définitivement perdus pour l’histoire de l’homme, de même que les œuvres de l’art et de la littérature antiques détruites par des vainqueurs imbéciles el des fanatiques grossiers. Dans les colonies françaises par exemple, les indigènes, sous l’action « colonisatrice », perdent leur langage maternel. Des Indochinois viennent en France, ne connaissant pas un mot de la langue de leur pays. On leur a appris, dans des écoles françaises, que leurs ancêtres étaient les Gaulois aux longues moustaches, leur patrie, la France, leur langue, le français!...
Le catéchisme des missionnaires et l’alcool, dont la consommation est préconisée par les gouverneurs français, achèvent leur éducation européenne pour en faire des prolétaires. A Tahiti on n’aura plus, bientôt, que le souvenir de la magnifique langue indigène que certains ont comparé à l’ancien grec pour sa richesse et sa musique. Elle dénote chez ceux qui l’ont formée un véritable peuple d’artistes. Elle est peu à peu remplacée non par le vrai français, mais par le jargon stupide que des civilisateurs abrutis ont apporté dans le pays avec la Bible, l’alcool et les maladies sociales.
« Pour remplacer le magnifique vocabulaire exaltant les merveilles de la nature, le petit Tahitien d’aujourd’hui n’a que les mots « épatant », « rigolo » et « moche », tout comme le plus vulgaire des Parisiens, et, comme ce dernier, n’en connaît point d’autres. » (Lettres des Iles Paradis, Bohun Lynch, éditeur.)
C’est ainsi que la « civilisation » fabrique en série des prolétaires complets interchangeables qui parleront tous le même jargon prolétarien. Mais l’œuvre de désagrégation du langage se produit aussi chez les vainqueurs pour les mêmes raisons sociales. Nous le verrons au mot Langue.
Si tout peuple a son langage, tout individu a aussi le sien par la note particulière de son esprit ; mais plus la pensée est profonde en lui, plus son langage est insuffisant. Y a-t-il lieu de s’étonner de l’ignorance humaine devant les manifestations de pensée des animaux alors que les hommes sont si souvent incapables de se comprendre entre eux et surtout d’exprimer tout ce qui est en eux ? Pour parler exactement, on devrait dire que le langage n’est qu’un « essai d’expression de la pensée » en raison des états de conscience de l’individu « singulièrement plus nombreux et plus nuancés que les formes verbales destinées à les traduire » (Nouveau Larousse). On peut ajouter : en raison aussi de l’impuissance où sont tant d’individus, dans leur ignorance du langage, de trouver les mots qui leur permettraient de s’exprimer. Le langage verbal n’est donc qu’un moyen d’expression relatif même quand il a atteint sa perfection, comme dans certaines langues. Le geste, la physionomie, lui viennent heureusement en aide. Souvent, un simple geste est pour un auditoire, autrement éloquent que toutes les paroles. Souvent, des êtres habitués à une forme commune de pensée se comprennent mieux par un regard que par de longues phrases.
Un langage peut être vrai ou trompeur tout en étant éloquent et persuasif. La parole orale est plus trompeuse que la parole écrite parce qu’elle ne laisse pas de trace. Un orateur, pour obtenir un effet immédiat, ne craindra pas de tenir des propos qu’il niera le lendemain. Verba volant, scripto manent : les paroles s’envolent, les écrits restent. Le geste trompe moins que la voix et l’écriture. Il est plus impulsif, moins nuancé et surtout moins abstrait. Il n’est pas menteur et subtil comme les rhéteurs et les casuistes il n’a pas le coup de trompette des « gueules sonores ». Il est insuffisamment apte au double emploi qu’Ésope a donné aux langues et que Voltaire a défini ainsi :
« L’univers fut abruti par l’art même qui devait l’éclairer. L’alphabet fut l’origine de toutes les connaissances de l’homme et de toutes ses sottises. »
Mais il en est du langage comme de toutes choses. Voudrons-nous nous couper la langue parce qu’elle est capable de proférer des mensonges ? Non, pas plus que nous ne voulons voir s’éteindre le soleil parce qu’il éclaire des charognes. C’est à l’homme de faire meilleur usage du langage et de toutes les formes de la vie pour son véritable bien et celui de tous les hommes.
Les efforts de l’art humain ont été de perfectionner le langage pour lui faire produire l’expression la plus complète de la pensée avec le minimum de difficultés. Ces efforts se manifestent : pour le geste, dans la danse et la pantomime ; pour le langage sonore, dans l’éloquence et la musique ; pour le langage écrit, dans toutes les formes des lettres ou littérature.
L’étude du langage est du domaine de la linguistique et de la philologie. La première est « une science naturelle étudiant les éléments du langage » ; la seconde est « une science historique étudiant le langage formé » (J. Vinson. La Grande Encyclopédie).
« Le linguiste est au philologue ce que le naturaliste est au jardinier. » (Schleicher)
L’étude du langage comprend : celle de son mécanisme dans les signes qu’il emploie, dans leur production et leur interprétation ; celle de son origine, dans les recherches historiques, philologiques et métaphysiques ; celle de son rapport avec la pensée, ou étude psychologique et logique du langage. Les détails de cette triple étude sont considérables ; malgré ce, elle est loin d’être arrivée à des résultats définitifs. On en est encore réduit à des hypothèses sur bien des points.
« Peut-être l’étude comparative du langage de l’homme et de celui qu’on peut reconnaître, sous des apparences diverses, dans plusieurs espèces animales, l’anthropologie et la zoologie combinées, permettront d’arriver à des résultats nouveaux dans une étude qui jusqu’à ce jour ne relève guère que de la métaphysique. » (Darmesteter : La vie des mots)
Nous verrons au mot langue les résultats obtenus jusqu’à présent.
Les travaux sur le langage furent ignorés de l’antiquité et du moyen-âge. On trouve la première idée d’une étude comparée des diverses langues dans le Voyage autour du monde, d’Antonio Pigafetta (1519–1522), compagnon de Magellan qui recueillit les vocabulaires de plusieurs peuples et en donna des spécimens. La véritable science linguistique commença avec Leibniz qui préconisa la comparaison des langues entre elles. Suivant sa méthode, Lorenzo Hervas constitua une encyclopédie où l’oraison dominicale était traduite en 307 dialectes et où 63 mots d’usage étaient donnés en 164 langues (1778–1787). Le président Debrosses écrivit sa Formation mécanique des langues et principes physiques de l’étymologie (1765). Pallas publia un Vocabulaire comparée de plus de 200 langues d’Europe, d’Asie et d’Afrique ; Le Brigant, la Langue primitive conservée (1787). Dans son Mithridate, Adelung reproduisit le Pater en 500 idiomes (1806–1817). Son neveu, Frédéric, fit des travaux sur le sanscrit (1811–1830). Volney fit paraître son Alphabet européen appliqué aux langues asiatiques (1819) ; Klaproth, son Asie polyglotte (1823) ; Balbi, sa Classification des peuples d’après leurs langues (1826) ; Bopp, son Système complet de la langue sanscrite (1820), suivi d’une Grammaire et d’un Glossaire de la même langue (1829–1832), sa Grammaire comparée des langues indo-germaniques (1833–1852) et d’autres ouvrages de linguistique ; Eugène Burnouf, son Commentaire sur le Yaçna (1833) et d’autres travaux sur le zend, langue morte asiatique ; son cousin E.-L. Burnouf écrivit divers ouvrages sur le sanscrit (1859–1864) ; Ch. Nodier, ses Notions de linguistique (1834) ; Eichkoff, son Parallèle des langues de l’Europe et de l’Inde (1836) ; G. de Humboldt, sa dissertation sur le karvi (1836–1839) ; le Dr Forster, son Langage primitif tracé d’après les anciennes inscriptions des rochers du mont Sinaï (1851) ; Schleicher, Les Langues de l’Europe moderne (1852) ; Renan, De l’Origine du langage (1848–1853) et Histoire générale avec les systèmes comparés des langues sémitiques (1885) ; Max Muller, linguiste, orientaliste et mythologue allemand, créa toute une école qui vulgarisa l’étude scientifique du langage. Ses ouvrages principaux sur ce sujet sont les Leçons sur la Science du langage (1861), et les Nouvelles leçons (1867–1868). Il y eut encore les travaux de Geiger, Origine du langage et de la Raison (1869) ; de A. Caumont, La langue universelle de l’Humanité (1866) ; de S. Reinach, Manuel de philologie classique (1884) ; de P. Regnaud, Origine et philosophie du langage (1889) ; d’Henry, Antinomies linguistiques (1896) ; de Sweet, Histoire du langage (1900) ; et d’autres nombreux spécialisés suivant les différentes branches de la linguistique et de la philologie.
La linguistique et la philologie ont un vaste champ devant elles, la philologie en particulier. Platon, qui employa ce mot le premier, lui donna le sens de « amour de la parole » et « amour de la discussion ». Ce sens s’élargit ensuite ; il fut « l’amour des lettres », dans Isocrate, Aristote, Plutarque et chez les latins. La philologie fut l’humanisme, ou étude de l’antiquité classique, au temps de la Renaissance. Aujourd’hui, elle emprunte généralement « l’ensemble des études qui servent à connaître la vie des peuples, même avant leur entrée dans l’histoire » (Mondry Beaudouin, Grande Encyclopédie). M. S. Reinach, lui donnant un sens encore plus large, lui fait embrasser « l’étude de toutes les manifestations de l’esprit humain dans l’espace et dans le temps ».
En fait, la linguistique et la philologie ne sont pas encore bien constituées comme sciences du langage. Leurs méthodes sont indécises, de là le grand nombre de leurs entreprises et de leurs spécialités parfois contradictoires appelées : grammaire comparée, étymologie scientifique, phonologie, glossologie, idiomographie, philologie comparée, philologie ethnographique, archéologie, etc… L'archéologie, qui étudie l'antiquité dans ses monuments et dans les objets de l'art et de l'industrie, s'appelle l'épigraphie quand elle s'occupe des textes gravés sur les monuments, la paléographie quand elle examine les manuscrits, la critique verbale lorsqu'elle corrige leurs textes.
Etudier le langage, c’est en somme rechercher la vie des êtres dans leur évolution intellectuelle. Leibniz en a exprimé toute l’importance lorsqu’il a dit : « Je crois véritablement que les langues sont le meilleur miroir de l’esprit humain. »
Le langage de tous les êtres et de toutes les choses est le meilleur miroir de l’esprit universel. Aussi est-il de l’intérêt, sinon du devoir de l’homme de le connaître pour préparer ce qui sera l’esprit de demain.
— Edouard ROTHEN.
LANGUE
n. f.
Ce mot vient du latin lingua, qui a fait aussi langage, mais dont le radical signifie lécher, comme dans lingere.
En anatomie, la langue est un organe qui sert à la fois à la dégustation, à la déglutition, et à l’articulation de la voix. C’est cette dernière fonction de la langue qui a fait donner ce nom et celui de langage à la parole. Littré distingue ainsi les deux mots :
« La langue est la collection des moyens d’exprimer la pensée par la bouche ; le langage est l’emploi de ces moyens. »
Les langues sont « les formes immédiates de la pensée, les instruments créés par elle pour la traduire. Elles sont autant de miroirs où viennent se réfléchir les habitudes d’esprit et la psychologie des peuples » (Darmesteter). C’est par le développement de la pensée que les langues se transforment. Si la pensée s’enrichit, les langues s’enrichissent avec elle ; si elle régresse, elles régressent avec elle. Elles se modifient suivant les variations de la prononciation (altérations phonétiques), celles de la grammaire (changements analogiques), celles du lexique (mots qui disparaissent ou mots nouveaux, néologismes) qui sont créatrices ou destructrices. C’est par la culture de la pensée que les langues conservent leurs formes dans leur pureté ; mais il y a péril pour elles à s’immobiliser dans des formes comme il y a péril pour les peuples à s’immobiliser dans leur pensée. La condition de la langue comme de la pensée est dans la vie en développement incessant. La cristallisation est mortelle pour la pensée ; elle ne l’est pas moins pour ses organes.
Les moyens d’exprimer la pensée par la parole varient, comme les groupes d’individus, suivant le temps, les lieux, les mœurs, les événements politiques et sociaux, le degré de civilisation. On appelle généralement langue « l’expression de la pensée d’après les principes communs à toutes les grammaires » (Littré). Les langues partagent le destin de ceux qui les parlent. Certaines ont disparu avec les peuples qui les parlaient. D’autres ont laissé des traces mais ne sont plus parlées par des peuples ; ce sont des langues mortes. Les découvertes de l’archéologie étendent tous les jours la possibilité d’étude de ces langues, limitée pendant longtemps au grec et au latin.
Les langues vivantes sont celles actuellement en usage. On en compte de 900 à 1500 suivant qu’on s’en tient aux langues proprement dites ou qu’on y ajoute leurs variétés. Celles-ci sont, selon les cas, des idiomes, des dialectes ou des patois.
L’idiome est une langue d’un usage peu répandu, celle d’un petit peuple. Il est aussi la langue considérée dans ses particularités propres à chaque nation. Le dialecte est une variété d’une langue mère ou langue principale, qui est particulière à une région, surtout par la prononciation. Le patois est généralement la langue des paysans ; son caractère est ethnique, spécial à un territoire restreint. Il est le dialecte qui a végété dans une petite région ; il est un produit de la terre et à l’origine des langues. Le conglomérat des patois parlés par les petits groupes humains a formé les dialectes, puis les idiomes et les langues, parallèlement à la formation plus ou moins artificielle des provinces et des nations. Lorsque celles-ci perdent leurs langues en se transformant, le patois demeure le langage du terroir. Il est le fonds de la langue et reste immuablement attaché à la terre comme sa faune et sa flore. Ainsi, les différents patois parlés localement sur le territoire de la France ont formé, avec le mélange des éléments envahisseurs, deux langues qui étaient au moyen âge les dialectes d’oïl et d’oc. Les événements politiques ayant fait prédominer les provinces du Nord sur celles du Midi, les dialectes d’oïl formèrent la langue de la France tout entière et ceux d’oc furent réduits à la multiplicité de leurs idiomes locaux ou patois. En Alsace, la véritable langue du pays est le patois auquel la population est d’autant plus attachée que, périodiquement, la langue officielle change pour devenir française ou allemande selon les caprices de la guerre. Il est donc inexact de ne voir dans les patois que des survivances plus ou moins informes de langues disparues.
A côté des langues proprement dites, et en marge d’elles, il y a l’argot qui ne se distingue pas d’abord du jargon. Les deux sont, dans leur sens général, le langage spécial d’une profession. Il y a l’argot des soldats, des marins, du théâtre, comme il y a celui des maçons, des charpentiers, des forgerons. Il est probable qu’il a toujours existé comme langage de métier, autant pour se reconnaître et se comprendre entre gens de même travail que pour cacher le sens de leurs conversations aux étrangers qui voulaient se mêler à la corporation. En France, il serait né au XVème siècle, chez les merciers du Poitou qui exerçaient leur profession dans les foires. Certains de ces merciers, ayant fait de mauvaises affaires, se mêlèrent aux gueux et leur apprirent leur jargon. Il se répandit alors rapidement dans toute la « gueuserie » qui pullula à la suite de la guerre de Cent ans et des misères qu’elle engendra se recrutant parmi les « criminels de tout ordre échappés à la justice, les laboureurs ruinés et expropriés, les ouvriers paresseux ou sans ouvrage, les soldats maraudeurs ou déserteurs, les marchands ruinés ou fripons, les gens de métiers aventureux, charlatans, diseurs de bonne aventure, crieurs d’indulgences, ménétriers, baladins, histrions, jongleurs et faiseurs de tours, les déclassés, fils de famille prodigues on déshérités, les écoliers et les clercs rejetés de l’Université et de l’Eglise, etc... » (Auguste Vitu). C’est parmi ces derniers, déclassés écoliers et clercs, que Villon apprit l’argot et qu’il l’introduisit dans la littérature. Il était alors le langage spécial de la Cour des Miracles et allait être de plus en plus particulier au monde de la Gueuserie dont il serait l’unique langage. Le jargon ou argot des merciers ou mercelots a été recueilli d’abord dans un petit livre du temps intitulé : La vie généreuse des Mercelots, puis dans un autre plus important et plus répandu, qui montre son usage en dehors de la corporation des merciers : Le jargon ou le langage de l’argot réformé comme il est à présent en usage parmi les bons pauvres. Les auteurs de ces livres seraient Pachon de Ruby et son continuateur Ollivier Chereau. Divers auteurs ont employé l’argot et des spécialistes l’ont étudié : Francisque Michel (Dictionnaire d’argot 1856), Lorédan Larchey (Dictionnaire historique, étymologique et anecdotique de l’argot parisien 1860), Georges Delesalle (Dictionnaire argot-français et français-argot 1896). Auguste Vitu s’est particulièrement occupé du jargon du XVème siècle (1884). Balzac et Eugène Sue ont fait à l’argot une assez grande place dans leurs œuvres et Victor Hugo lui a consacré toute une étude dans Les Misérables. Il a montré remarquablement son véritable caractère et son rôle social.
Il a dit :
« Tous les métiers, toutes les professions, on pourrait presque ajouter tous les accidents de la hiérarchie sociale et toutes les formes de l’intelligence, ont leur argot. »
Et il a cité de nombreux exemples. Mais le véritable argot c’est « la langue de la misère qui se révolte et qui se décide à entrer en lutte contre l’ensemble des faits heureux et des droits régnants... C’est la langue qu’a parlé, en France par exemple depuis plus de quatre siècles, non seulement une misère, mais la misère, toute la misère humaine possible ». Et Victor Hugo dit fort justement, avec ce sens profond de l’humain qui était en lui :
« Si la langue qu’a parlé une nation ou une province est digne d’intérêt, il est une chose plus digne encore d’attention et d’étude, c’est la langue qu’a parlé une misère... Epouvantable langue crapaude qui va, vient, sautille, rampe, bave, et se meut monstrueusement dans cette immense brume grise faite de pluie, de nuit, de faim, de vice, de mensonge, d’injustice, de nudité, d’asphyxie et d’hiver, plein midi des misérables. »
L’état social a fait la misère ; la misère a fait son langage : l’argot. Il est, en bas de l’échelle sociale, ce qu’est, en haut, le jargon précieux, affecté, noble, académique, des privilégiés à qui il répugne mais qui profitent de la misère dont il est l’expression cynique et désespérée.
Le jargon est une corruption de la langue par quelqu’un qui la parle mal. Le langage français « petit nègre » qui s’est implanté depuis la guerre est du jargon, comme le « bich la mar » que parlent les indigènes dans les colonies du Pacifique. Il est aussi le langage particulier adopté dans certains milieux. Dans cette application il convient mieux que le mot argot qu’il y a lieu de laisser dans son farouche emploi de langue de la misère. Il y a les jargons des gens de justice, d’affaires, de sciences, de lettres, les jargons mondains, politiciens, administratifs, sportifs et, en général, de tous les milieux où la malfaisance sociale, ne portant pas la tare de la misère, fait figure d’honnêteté.
Enfin, à côté des langues qui sont les moyens d’expression naturels des hommes et se sont formées suivant leurs conditions d’existence, il y a des langues artificielles, ou plutôt des essais plus ou moins réussis de langues artificielles. On a eu le projet de langue bleue, créée de toutes pièces, de Léon Bollack, et le volapük, de l’abbé Schleyer, dont le vocabulaire était germanique. L’esperanto, l’ido, l’universel, et d’autres sont de ces langues qui connaîtront peut-être un meilleur destin, grâce à l’idée qui s répand dans l’Internationale Ouvrière de la nécessité d’une langue universelle permettant à tous les peuples de s’entendre entre eux.
Ce qu’on appelle langue verte est un langage qui tient à la fois du parler populaire et de l’argot. C’est, dans le français, un choix d’expressions pittoresques du vieux langage parlé avant la réforme académique de la langue. Les Anglais ont leur argot qui est le cant et leur langue verte, qui est le slang. Lachâtre a composé un Dictionnaire de la langue verte.
Les langues liturgiques sont celles employées par l’Eglise pour ses cérémonies et ses prières. Le latin est la langue liturgique des catholiques romains.
* * *
Quelle est l’origine des langues ? La question est la même que celle de l’origine du langage. Elle est intimement liée à celle de l’origine de l’homme.
Avant toute étude linguistique, les imposteurs avaient beau jeu pour prétendre qu’il y eut une seule langue, créée avec le premier homme et parlée spontanément par lui. De même ils racontèrent chez chaque peuple que sa langue était à l’origine du langage humain. Hérodote a rapporté l’histoire bouffonne de Psamméticus, roi d’Egypte, prétendant que le phrygien était la langue originelle parce que deux enfants auraient prononcé le mot beccos (pain) en venant au monde. Les commentateurs de la Bible présentent de leur côté l’hébreu comme la langue originelle, celle qu’Adam aurait parlée dans le paradis terrestre. Comme il n’est pas 1e religion antique qui n’ait à son origine l’histoire de ce paradis, celle de la Bible n’étant qu’un plagiat d’autres plus anciennes, il s’ensuit que chaque peuple religieux avait la prétention d’habiter le pays du paradis terrestre, de descendre du premier homme et de parler la langue qui fut la première.
La recherche scientifique met peu à peu à leur place toutes ces sornettes, mais, n’existerait-elle pas que le simple bon sens dirait avec Voltaire :
« Il n’y a pas eu plus de langue primitive, et d’alphabet primitif, que de chêne primitif et que d’herbe primitive. »
Cette recherche établit de plus en plus que l’homme apparut sur la Terre en des points différents et à des époques qui ne peuvent être précisées, mais qui varièrent selon que les milieux furent plus ou moins favorables à sa formation. Et cela concorde avec l’absence de véritables rapports entre certaines familles de langues pour démontrer qu’elles n’ont pu avoir une origine commune,
Leibniz commença l’étude comparée des langues qui devait conduire aux connaissances actuelles. La découverte du sanscrit, langue morte qui serait bien supérieure au latin et même au grec comme « plus flexible, plus composée et plus complète » (Le Brocquys), fit modifier l’ancienne méthode, appelée ethnographique, de classement de langues, et adopter celle de la morphologie et de la généalogie. Par elle, on est arrivé à présumer qu’il y a cinq ou six sources des langues et des peuples qui se sont répandus et mêlés sur la Terre entière. Le sanscrit, par exemple, serait la langue-mère de celles de l’Inde, de la Perse et de toutes les grandes branches du langage européen.
On divise aujourd’hui les langues parlées sur la Terre en trois grandes classes :
-
Les langues monosyllabiques ou isolantes, dont les racines sont employées comme des mots indépendants (Asie Orientale et Amérique Centrale).
-
Les langues agglutinantes, où plusieurs racines s’agglutinent pour former un mot dans lequel l’une d’elles conserve son indépendance radicale. Elles comprennent trois groupes appelés atomique, touranien, holophrastique ou polysynthétique et sont dispersées dans le monde, sauf en Europe.
-
Les langues à flexion où les racines fondues entre elles n’ont plus d’indépendance. Ce sont les langues indo-européennes et sémitiques.
Ces divisions seront-elles les bases solides des travaux linguistiques de l’avenir ou devront-elles être modifiées ? On ne peut le dire. La linguistique est une science bien jeune. Parmi les sciences biologiques, elle est une de celles qui ont encore le plus de choses à découvrir.
Nous ne ferons pas ici une étude des différentes langues, mais nous nous occuperons plus particulièrement du français.
LANGUE FRANÇAISE
Comme toutes les formes essentielles de la vie humaine, les langues ont des sources populaires.
« Il existe une relation intime entre la terre nourricière et le langage humain. Le langage des hommes est né du sillon ; il est d’origine rustique et, si les villes ont ajouté quelque chose à sa grâce, il tire toute sa force des campagnes où il est né... Notre langage sort des blés comme le chant de l’alouette... C’est le peuple qui a fait les langues. Platon disait : « Le peuple est, en matière de langue, un très excellent maître. » Platon disait vrai. Le peuple fait bien les langues. Il les fait imagées et claires, vives et frappantes. Si les savants les faisaient, elles seraient sourdes et lourdes. Mais, en revanche, le peuple ne se pique pas de régularité. Il n’a aucune idée de la méthode scientifique. L’instinct lui suffit. C’est avec l’instinct qu’on crée. Il n’y ajoute point la réflexion. Aussi les langues les plus sages et les plus savantes sont-elles tissues d’inexactitudes et de bizarreries. » (A. France : La Vie littéraire)
R. de Gourmont a dit :
« Les langues des métiers ont toujours été admirables ; celles des sciences sont hideuses : rien ne prouve mieux que la fonction linguistique est une fonction populaire. Un « ignorant absolu » ne peut pas plus se tromper linguistiquement qu’un oiseau qui chante ou qu’un chat qui miaule. Toutes les manières de « mal parler » qu’on relève dans le peuple proviennent d’en haut, un instinct de maladroite singerie portant les ignorants à imiter ceux qui croient savoir. »
C’est de la langue familière du peuple qu’est sortie la langue littéraire.
« La meilleure des deux est assurément la langue familière ; mais l’existence de l’autre est assurée par la tradition littéraire, par le travail perpétuel de l’imprimerie. Le désaccord est grand entre la langue littéraire et l’écriture : il est immense entre l’écriture et la langue familière. » (R. de Gourmont : Promenades philosophiques)
M. Nyrop a dit dans son Manuel phonétique du français parlé :
« La langue française écrite ne donne qu’une image très imparfaite de la langue française parlée. Il y a peu de langues où le désaccord entre l’écriture et la prononciation soit aussi profond, où il soit aussi difficile de conclure de l’une à l’autre... La langue parlée est eu voie d’évolution continuelle, tandis que la langue écrite reste immobile ou ne subit que des changements insignifiants ; elle ne nous indique pas comment on prononce le français de nos jours, mais comment on le prononçait il y a quelques siècles. »
Ce n’est qu’à partir du XIVème siècle qu’a existé une véritable langue française. Jusque-là, aucun des dialectes parlés dans le pays n’avait eu la prépondérance sur les autres. Godefroy a composé un Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXème au XVème siècle (1881). Avec le pouvoir grandissant des rois de l’Ile-de-France s’affirma la prépondérance du langage de cette province qui devint peu à peu la langue officielle de toute la France. Mais ce ne fut pas sans être soumise à des influences très nombreuses ; d’abord celles qui avaient agi sur la formation du langage d’Ile-de-France — sources autochtones mêlées d’invasions successives jusqu’à l’établissement définitif des Francs — ensuite celles incessantes des provinces, enfin celles des pays étrangers.
On dit, généralement, que le français est une langue latine. Si le latin, apporté par les invasions romaines et qui fut pendant plusieurs siècles dominant dans les Gaules, est entré pour une grande part dans la formation de la langue, il n’est pas un de ses éléments fondamentaux. La prononciation française, entre autre, n’est pas latine et, à cet égard, l’allemand, qui possède l’accent tonique et prononce ou la voyelle u, est plus latin que le français. Le besoin d’une expression claire correspondant au caractère français, fit abandonner l’inversion latine qu’on retrouve dans l’allemand, l’anglais, l’italien, l’espagnol. L’orthographe fut, jusqu’au XVème siècle, sous la dépendance de la prononciation. Toutes deux varièrent beaucoup. Par exemple, suivant la prononciation, homme s’écrivait au singulier : om, hom, hum, huom, huem, hoem, hon, hons, et au pluriel : home, homme, homme, homes, humes, etc. L’engouement pour le latin commença à fixer l’orthographe, mais souvent par des règles abusives comme celles de l’emploi de l’x. Ainsi, croix, noix, poix, voix, devraient s’écrire crois, nais, pois, vois, comme dans le vieux français, car ils ne viennent pas de crux, nux, pix, vox, mais de crucem, nucem, picem, vocem, et c’est le c qui était devenu un s. (R. de Gourmont). L’orthographe a été régularisée à partir du XVIIème siècle : « ce fut un grand bienfait pour la langue » (R. de Gourmont). Nous n’entrerons pas dans le détail des éléments qui ont formé le français et des transformations qu’il a subies ; nous renvoyons pour cela aux ouvrages des spécialistes : Recherches sur la langue française et ses dialectes (Fallot, 1839) ; Origine et formation de la langue française (Chevallet, 1850) ; Histoire de la langue française (Littré, 1863) ; Histoire de la langue française (Brunot, en cours de parution depuis 1905), etc…
La théorie du français langue latine est séduisante pour les partisans des doctrines de conservation sociale plus ou moins lettrés. On comprend qu’ils la soutiennent pour défendre un ordre de choses qui s’inspire encore sur tant de points de l’époque romaine. Le droit français entre autres est un prolongement du droit romain. Il est certain qu’on dut aux Romains le commencement d’une organisation sociale dans les Gaules comme dans tout leur empire. Au milieu des troubles causés par les incessantes invasions, ils établirent une sorte d’unité administrative qui, si elle est de valeur contestable politiquement, fit un bien immense au point de vue du développement économique et des conditions d’existence des populations. Il suffit d’indiquer, pour montrer l’importance de cette œuvre, que toutes les grandes villes et grandes routes sont d’anciennes cités et d’anciennes voies romaines. C’est des Romains que l’Eglise apprit cette discipline qui fit sa force durant ce moyen âge où la société fut livrée à tous les désordres. Plus que tout, la langue latine fut le moyen de cette unité administrative et de cette discipline religieuse. Mais elle ne s’imposa pas comme langue du pays. Elle se corrompit peu à peu au contact des idiomes populaires et c’est par leur mélange que se formèrent les différents dialectes de la langue appelée romane. Le véritable latin n’exista plus, même comme langue littéraire. C’est dans le latin barbare de leur époque que s’exprimèrent les écrivains du temps. Les écrits de Sidoine Apollinaire, et surtout de Salvien montrent l’état de dissolution où cette langue était tombée au Vème siècle. La décadence de la langue suivait celle de l’empire, résultat des rapports intimes qui unissent le langage des peuples à leur vie politique. La même langue barbare était celle des ecclésiastiques. A Rome même, dans l’entourage des papes, le latin fut si corrompu qu’au XIème siècle, le pape Urbain II chargea un chancelier de mettre en bon latin les ouvrages émanés du Saint-Siège depuis le VIIème siècle.
Le goût du latin et du grec classiques fut le signe de la Renaissance. Ils n’étaient plus, depuis longtemps, que des langues mortes. Le latin, langue liturgique romaine, s’était corrompu dans l’Eglise même, ses clercs n’étant pas plus lettrés que les laïques. Le grec avait été farouchement proscrit ; les progrès de l’humanisme furent longs à désarmer cette haine pour la langue des hommes libres de l’antiquité qui renaissait pour susciter de nouveaux hommes libres. L’enseignement, dans les écoles, du latin classique et surtout celui du grec, rencontrèrent plus d’un obstacle. L’Eglise ne voulait les admettre que dans les formes orthodoxes à sa convenance, enseignés par ces gens qui « laborieusement écorchaient la peau de ce povre latin », comme on disait alors. Rabelais a plaisamment raillé ces écorcheurs, qui prétendaient « pindariser », dans l’épisode de l’écolier limousin, au livre II de Pantagruel. Pour le grec, c’était pire. On ne l’admettait qu’adapté à la façon des goujats de Sorbonne qui avaient épluché, trituré, laminé Aristote pour en extraire la bonne scolastique. C’est seulement en 1458 que Grégoire Typhernas commença à Paris, avec l’autorisation de l’Université, des leçons publiques de grec. Il n’eut guère de succès, mais il suscita un grand scandale dans l’Eglise. Un siècle après, les prédicateurs protestaient encore en chaire contre l’enseignement public, au Collège royal, du grec que l’un d’eux, Noë Beda, appelait la langue des hérésies. Au XVIème siècle, en plein épanouissement de la Renaissance, on brûlait les livres grecs de Rabelais et François 1er, qui pindarisait à sa façon, laissait envoyer au bûcher Etienne Dolet pour avoir traduit deux dialogues grecs attribués à Platon et annoncé qu’il voulait publier une traduction complète de l’œuvre de ce « divin et supernaturel » philosophe.
Il n’est pas inutile d’insister sur tout cela lorsqu’on voit aujourd’hui les défenseurs des traditions de l’Eglise rompre des lances pour le grec, le latin, et aussi pour la langue des troubadours, le provençal, que l’Eglise a réduite au sort des patois du Midi en suscitant l’épouvantable guerre des Albigeois. Mais la question des « humanités » est-elle autre chose qu’un prétexte pour faire échec aux idées modernes de démocratie et de liberté ? Ce que défendent ces prétendus champions de l’esprit, ce sont les privilèges aristocratiques qu’ils veulent maintenir par tous les moyens et sous tous les masques. La défense des « humanités » séduit le snobisme intellectuel qui ne se donne pas la peine de regarder les mobiles intéressés et fort peu idéalistes qui inspirent ces bons apôtres. On proteste contre ce qu’on appelle « la destruction concertée de l’enseignement du grec » et M. Léon Daudet écrit :
« Tout le monde sait que la Renaissance est sortie de la revivescence de la langue grecque et des manuscrits grecs plus encore que du latin et des manuscrits latins. Mais déjà, avant la Renaissance, la Somme de saint Thomas d’Aquin avait rebrassé l’encyclopédie et la métaphysique d’Aristote. A l’aube de la pensée et de la philosophie françaises se tiennent Aristote et Platon, le disciple et le maître, dirigeant deux rais de lumière, d’ailleurs assez divergents, dans l’obscurité de l’esprit... Nous tenons, du latin, la rectitude, la rigueur, la concision, les qualités synthétiques ; du grec, la pénétration, la complexité, l’analyse, la nuance. Nous sommes redevables à l’un et à l’autre. Aveugler l’une ou l’autre source pour les générations à venir, est une imbécillité criminelle. »
Cette « imbécillité criminelle », l’Eglise et les rois — qui, dit-on, ont fait la France — l’ont poursuivie pendant quinze siècles. C’est malgré eux, et contre eux, que la Renaissance a fait revivre le grec mutilé par la barbarie chrétienne et a nettoyé le latin de la fange où cette barbarie l’avait plongé. Comme a dit par ailleurs le même M. Léon Daudet :
« L’immondice des cardinaux, des jésuites et des papes, et l’horrible despotisme catholique n’ont rien à voir aux splendeurs de l’art. » (Le Voyage de Shakespeare)
Aujourd’hui, les momies académiques et les élégances « bien pensantes » voudraient se servir du latin et du grec pour étouffer la vie nouvelle. Nous voyons mal ces héritiers de la cafardise religieuse et de l’inquisition, élevés parmi les moisissures séminaristes, éduqués selon une casuistique pour laquelle tout est vrai et rien n’est vrai, qui n’acceptent que des formes d’art et de vie avilies, émasculées, après avoir vainement cherché à détruire l’art et la vie ; nous voyons mal, disons-nous, ces oiseaux de ténèbres se présenter en défenseurs de la beauté antique qui était toute vie, toute lumière, toute liberté. Ceux qui ont coupé les ailes de la Victoire de Samothrace sont peu qualifiés pour juger ceux qui ne peuvent les lui rendre. Le moyen âge a accommodé — « rebrassé » dit M. L. Daudet — Aristote à la manière scolastique ; le néo-catholicisme actuel voudrait s’annexer de la même façon Platon qui fut déchiré et brûlé mille fois et n’est arrivé jusqu’à nous que grâce à la persévérance et à l’héroïsme de cet esprit de révolte et de liberté que l’Eglise n’a pu étouffer. C’est la condition d’existence de cette Eglise d’adorer ce qu’elle a brûlé : elle se perpétue ainsi dans le crime et sur des ruines.
Jusqu’à la Renaissance, le latin macaronique d’église fut la langue des travaux de l’esprit, travaux lourdement scolastiques qui étaient loin d’avoir hérité du génie d’un saint Jérôme et que d’épaisses gloses devaient expliquer quand elles ne les rendaient pas encore plus ténébreuses. Les « humanistes » ramenèrent le latin à sa beauté classique et le mirent à sa vraie place dans les écoles. En même temps à côté des jargons à l’usage de la fourberie ecclésiastique, ils employèrent la langue française pour être compris du peuple et lui faire entendre les vérités nouvelles. L’imprimerie commença à répandre une pensée claire et lucide pour tous. Jusque-là, la pensée écrite avait été livrée à la fantaisie des copistes ; « chacun donnait un nouveau tour et le gazouillis de son pays natal au manuscrit qu’il transcrivait » (Estienne Pasquier).
La langue s’est formée en France avec la littérature ; aussi, ne peut-on les séparer l’une de l’autre. Quelles qu’aient été les influences étrangères, elles ont gardé comme fonds le vieil esprit français, l’esprit du terroir qui est, à la littérature, ce que le patois, le dialecte, sont à la langue. Cet esprit est celui des vieilles chansons de geste, souvenirs des temps légendaires que tous les peuples en ont possédé. C’est celui de la poésie lyrique, des chansons populaires, des romans d’aventures auquel se mêlait souvent la grosse gaîté gauloise, parfois cruelle, des fabliaux. Il est, à la recherche d’une langue commune, dans l’œuvre de la foule des auteurs anonymes du moyen âge et dans celle des poètes connus dont la personnalité est plus celle de leur province, de leur dialecte, que la leur propre. Trouvères dans le Nord, troubadours dans le Midi, produisirent une œuvre considérable, en grande partie perdue, mais qui contribua puissamment par les échanges d’une région à l’autre, à préparer une unité de langage. Les Marie de France, Chrétien de Troyes, Villehardouin, Joinville, Rutebeuf, Guillaume de Lorris, Jean de Meung, Froissart, Eustache Deschamps, Charles d’Orléans, Coquillard, Villon, Commines, furent les précurseurs, ceux qui préparèrent le fonds, véritablement original, intrinsèque, de l’œuvre nationale qu’allaient commencer les écrivains de la Renaissance. Œuvre essentielle malgré l’obscurité où elle est demeurée longtemps, car c’est par elle qu’une langue spécifiquement française existe malgré toutes les déformations, les mutilations et les assauts des influences étrangères et savantes. C’est en elle que se trouve la « substantifique moelle » où, si souvent, les véritables écrivains français ont dû aller chercher ce que tant d’autres avaient trop oublié.
La Renaissance se forma en Italie :
« La tradition grecque, limon de science et de vice déposé sur l’Italie, fit éclore des fruits extraordinaires ; et cette fécondité contint bientôt en germe Rabelais et Marot, Montaigne et Bacon, Ronsard lui-même et tous les poètes burlesques de l’Allemagne au XVIème siècle ; elle renfermait le secret d’une inévitable crise, la semence de la réforme religieuse. » (Ph. Chasles)
La pensée et l’art italiens, en avance de trois siècles, en étaient à leur période classique et à la veille de leur déclin lorsque la France connut la Renaissance. L’Italie du XVème siècle était dans la situation de la France au XVIIIème. Ses savants, ses artistes, ses poètes, que les princes et les papes réunissaient à leur table, y apportaient l’esprit de Voltaire, de Diderot, de d’Alembert. La chevalerie française, à demi-barbare, qui fit avec les rois les guerres d’Italie, y apprit l’élégance, en ramena des artistes, et les poètes qui l’avaient accompagnée en rapportèrent les goûts poétiques et philosophiques de la cour somptueuse d’un Laurent de Médicis. Tout le XVème siècle français est plein de l’influence italienne. C’est le siècle où la langue et la littérature arrivèrent à une véritable unité, grâce à la multiplicité des travaux d’érudition, à la hardiesse des penseurs ct à la fécondité des écrivains.
La liberté de pensée qui bouillonnait dans les esprits imposa des nécessités nouvelles au langage qui devait devenir vivant pour la répandre. L’esprit de la Réforme lui fut d’une aide précieuse.
« Les pamphlets, les libellés, les livres de controverse, donnèrent de la force, de la clarté, de la souplesse au langage, instrument de défense et de victoire. » (Ph. Chasles)
On ignore généralement l’importance que ces écrits, et surtout les discours des sermonnaires, les harangues des orateurs de tous les partis, eurent dans la vie politique du XVIème et du XVIIème siècle, jusqu’au moment où l’absolutisme du pouvoir royal se fut rendu maître des agitations populaires. C’est au milieu de ces agitations que le langage se forma ; il eut toute leur exubérance, leur puissance et aussi leurs faiblesses. Il s’éleva à la plus haute éloquence pour exprimer les formes les plus belles et les plus généreuses de la pensée ; il s’abaissa aux plus dégradantes pour déverser dans des flots de boue les haines et les basses passions des partis. Il fut l’image de l’époque :
« Le vice paraît sans masque, on persécute de bonne foi, le crime est souvent sans remords. Soutenu par sa propre force, l’héroïsme se pare d’un éclat plus vif. De là, ce langage énergique, effréné, pédantesque, simple jusqu’à la bassesse, éloquent jusqu’au sublime : l’idiome gascon de Ronsard, les vives paroles de Montaigne, de Mornay, de Henri IV, et la railleuse invective de la satire Ménippée ; éléments pleins de sève et de force, qui assouplirent, animèrent et obscurcirent successivement notre langue. » (Ph. Chasles)
C’est la langue sans fard, luxuriante, splendide, qui appelle un chat un chat, qui fesse les cagots ; c’est la véritable langue romantique, celle de la vie dans son plein épanouissement magnifique et monstrueux comme une immense forêt. C’est la langue de Marot, Calvin, Rabelais, Amyot, l’Hôpital, La Boétie, Montaigne, Charron, d’Aubigné, les Etienne, de Thou.
Déjà, avec Villehardouin puis Joinville et Froissart, le génie de la langue française s’était dégagé par « l’ordre logique des phrases, la marche directe si favorable à la clarté, l’horreur de l’inversion, la simplicité dans l’arrangement des mots, la lucidité qui se prête aux définitions philosophiques comme à la grâce facile des relations sociales » (Ph. Chasles). Ce génie subit un premier assaut des imitateurs gréco-latins. Tout en épurant la scolastique, ils lui restaient fidèles au point de vouloir supprimer l’imprimerie. Homère. Virgile, Tacite, furent appelés à la rescousse d’Aristote pour faire la guerre à la langue au nom de l’érudition. Robert Estienne, Ramus, Meigret qui firent tant pour la langue, et notamment pour l’orthographe, furent leurs victimes. Joachim du Bellay voulut s’opposer à cet assaut, et surtout à ses excès, avec sa Défense et illustration de la langue française, mais il vint un peu tard. Il aimait sa langue et il en avait le sentiment, a dit R. de Gourmont, « à un degré qui ne se retrouvera plus et qui, à l’heure actuelle, est tombé très bas ». Il trouvait excellent qu’on apprît les langues anciennes, mais il voulait « qu’après les avoir apprises on ne déprisât pas la sienne ». Il avait le sens profond de tous les trésors qu’elle puisait dam le langage du peuple et demandait aux écrivains de fréquenter, autant que les savants, « toutes sortes d’ouvriers et gens mécaniques, comme mariniers, fondeurs, peintres, engraveurs et autres, savoir leurs inventions, les noms des matières, des outils, et les termes usités en leurs Arts et Métiers, pour en tirer de là ces belles comparaisons et vives descriptions de toutes choses ». Malherbe, qui devait commencer la réforme du « bon goût » n’en allait pas moins apprendre son français chez les gens du port, et cent ans plus tard, Du Marsais, que les fadeurs de la Cour ne pouvaient satisfaire, allait « chercher aux Halles des provisions de tropes ».
Du Bellay fonda avec Ronsard et cinq de leurs amis la Pléiade pour la défense du français ; mais ce groupe littéraire ne comprit pas les intentions de Du Bellay et il se lança dans toutes les exagérations de l’imitation des anciens. Ronsard lui-même n’y échappa pas. Il n’en fut pas moins un grand poète dont l’œuvre est demeurée, malgré des fortunes diverses, une des plus glorieuses de la poésie française. Le snobisme en fait aujourd’hui l’idole de gens qui ne l’ont jamais lu ; on l’a mis en effigie sur des timbres-poste et une promotion de la Légion d’honneur porte son nom !
L’esprit français triompha dans la langue des excès des imitateurs gréco-latins et sut profiter de ce qu’ils avaient apporté de bon, entre autres des mots et des formes nouveaux, pour rejeter les scories. Il brille avec un éclat tout particulier dans l’œuvre d’Amyot et celle de Montaigne. La langue de Montaigne est d’une richesse incomparable ; elle demeure comme un phare au-dessus du marécage où on s’enlise aujourd’hui. Amyot a une naïveté et une pureté que Montaigne a célébrées. La Boétie et Charron ont une correction qui annonce la réforme classique et les deux Estienne ainsi que de Thou ont exprimé les idées les plus grandes dans la plus belle langue latine. La vivacité de l’esprit français atteignit sa plus complète expression dans la satire politique, érudite et philosophique, dont la Ménippée, aussi poétique qu’éloquente, est le modèle, et dans les Mémoires, ceux de d’Aubigné en particulier. La Ménippée fut le dernier écho de la verve satirique de Rabelais.
C’est dans cette forêt débordante de vie, échevelée, enivrée de toutes les libertés de l’esprit, de tous les parfums de la pensée, forêt à la fois splendide et monstrueuse, que le « bon goût » allait porter la hache et manier le sécateur. La stabilité du pouvoir royal, préparée par Henri IV, allait faire dans la langue la même réforme que dans la société et lui donner ces formes de la convenance qui ne seraient trop souvent que la façade d’une société plus hypocrite sous ses manières élégantes et polies. On en vit d’abord la parodie, lorsque le goût italien amena l’épopée pastorale du genre de l’Astrée et les préciosités de l’Hôtel de Rambouillet que Molière a raillées dans les Précieuses Ridicules. Moins de cent ans devaient suffire pour montrer ce qu’il y avait d’odieux et de tragique sous ces formes brillantes et artificielles.
Fit sentir dans les vers une juste cadence,
D’un mot mis en sa place enseigna le pouvoir,
Et réduisit la muse aux règles du devoir.
Par ce sage écrivain la langue réparée
N’offrit plus rien de rude à l’oreille épurée.
C’est en ces termes que Boileau, « contrôleur général du Parnasse », comme l’a appelé Sainte-Beuve, a salué la réforme de Malherbe après avoir exécuté en dix-huit vers la vieille langue et la vieille littérature. Exécution qui fait sourire aujourd’hui mais qui établit pour deux siècles des règles tyranniques et fit reléguer au rang de « littérateurs de second ordre » ceux qui conservèrent dans leur langue et dans leurs œuvres des relations populaires. Ce n’était qu’un masque sous lequel le vice était plus sale et avait moins d’esprit. La prétendue majesté de Louis XIV ne l’empêchait pas de préférer les farces de Scaramouche aux comédies de Molière et les perruques, les canons, les rubans, dissimulaient la crasse de gens qui ne se lavaient plus. La Société était, dans cette « élite », comme le bon Monsieur Tartufe ; elle s’offusquait devant le corsage de Dorine mais elle participait aux messes noires de la Voisin et aux empoisonnements de la Brinvilliers.
La langue de Rabelais et de Montaigne, si franche et si libre d’allure, ne pouvait évidemment plaire à cette société. Elle fut laissée à qui allait :
Elle ne pouvait convenir pour dire :
Pauvre Boileau ! S’il y eut des Racine, des La Bruyère, des Bossuet, des Fénelon, pour le justifier devant la postérité, il lui arriva plus d’une fois d’abandonner le harnais d’historiographe du « Grand Roi » au magasin des accessoires solaires pour aller retrouver le véritable esprit et la joie de vivre au cabaret de la Pomme de Pin, parmi de joyeux compagnons à qui Mathurin Régnier avait transmis la vieille langue plus moqueuse, plus effrontée et plus vigoureuse. Les Théophile, les Tristan l’Ermite, les Dalibray, les Saint-Amant, la remettaient à leur tour à ces deux « hérétiques », La Fontaine et Molière, pour la rendre moins solennelle mais aussi parfaite que celle de Racine.
Malherbe était venu « accomplir cette réforme savante et sobre que Du Bellay avait annoncée, que tant d’écrivains effrénés avaient tentée maladroitement, et imposer enfin à la langue française une discipline empruntée aux langues savantes... Comme tous les réformateurs heureux, il vit la littérature marcher vers une élocution plus pure et des formes de style plus nettes ; il s’empara de cette occasion, poursuivit son entreprise avec une opiniâtre vigueur de bon sens, dégasconna, comme dit Balzac, la cour et la ville, et à force de tyranniser les mots et les syllabes, fonda les doctrines sévères auxquelles les talents français asservirent ensuite leur force » (Ph. Chasles). Mais la cour et la ville n’étaient pas toute la France ; elles-mêmes supportaient malaisément tant de convenances trop convenues, de distinction affectée, de noblesse empruntée et de solennité ridicule. Elles aussi déposaient volontiers tout cela au magasin des accessoires comme on enlevait sa perruque pour dormir. Aussi, la réforme de Malherbe, que continua Boileau, ne pouvait être qu’artificielle pour servir à une société conventionnelle qui ne durerait pas. Cette réforme rendit de grands services à la langue en l’épurant d’un mauvais goût trop évident : mais le meilleur de ses services fut d’être bientôt périmée. Boileau, devenu vieux, en constata lui-même la faillite lorsqu’il vit la poésie française réduite aux J.-P. Rousseau et aux Campistron. La Bruyère et Fénelon avaient déjà regretté « le vieux et rude langage du XVIème siècle ». La langue « féminisée par Racine et par Fénelon, n’eut plus de sexe chez Fontenelle ; malgré tout son esprit, elle fut quelque chose d’uni, de clair, de froid. Tout fut mesuré et compassé : point de cris, point de gestes, point d’accents ; ce fut une conversation à demi voix, dans un salon » (E. Despois). Le vernis du « bon goût » craqua de toute part : il ne resta de la réforme que ce qui avait apporté à la langue plus d’ordre, de clarté, de netteté, c’est-à-dire ce qui était commun à toute la l’ace et nullement l’apanage des seuls « gens de qualité ».
Louis XIV n’était pas mort qu’éclatait la « Querelle des anciens et des modernes ». Elle domina tout le XVIIIème siècle pour aboutir politiquement à la Révolution de 1789 et littérairement, trente ans plus tard, au romantisme.
La Révolution Française s’efforça de réaliser l’unité de la langue dans le pays. Si cette unité était faite en littérature et par les lettrés, elle ne l’était pas dans la vie sociale populaire. La plupart des petits paysans qui allaient à l’école étaient destinés à des fonctions ecclésiastiques et apprenaient plus de latin que de français. Bien que le français eût eu des grammairiens depuis le XVIème siècle, il n’était guère enseigné. C’est ce que remarquait Rollin vers 1730, en disant que peu de maîtres s’occupaient de cet enseignement par principes. Depuis, on s’en est peut-être trop occupé, entre autres dans des projets de réforme comme le Rapport de M. Paul Meyer sur la simplification de l’orthographe », publié en 1904. R. de Gourmont a dit à ce propos qu’il ne fallait pas traiter la langue française comme une sorte d’espéranto. « Il y a le point de vue esthétique », a-t-il dit, et il a donné d’excellentes raisons contre ce l’apport qui ne présentait pas une réforme mais une véritable démolition de la langue. Or, « il ne faut toucher qu’avec la plus grande précaution à des formes architecturales qui ont été consacrées par le temps et par une littérature goûtée du monde entier ». (Promenades philosophiques).
La langue littéraire française avait certainement atteint sa perfection au cours du XVIIIème siècle. Depuis, elle est allée en déclinant malgré les études sérieuses dont elle a été l’objet au XIXème siècle et les recherches entreprises dans l’ancienne langue. Ce courant sera-t-il arrêté et la langue se perfectionnera-t-elle encore ? C’est possible. Mais il faudrait pour cela les conditions de libre épanouissement d’une vie sociale qui ne serait plus soumise à la contrainte accablante de la société capitaliste. L’arbitraire de cette société, surtout depuis la guerre de 1914, a précipité la régression d’une façon caractéristique. Nous assistons, malgré les revendications pédantesques au nom des « humanités », à une véritable décomposition de la langue, avec l’envahissement du domaine intellectuel par des gens d’affaires et d’argent de plus en plus dépourvus de culture. Des directeurs de journaux, de théâtres, des éditeurs et même des académiciens sont complètement illettrés, réunissant autour d’eux des collaborateurs qui ne le sont pas moins. L’audace que procure l’argent et le puffisme de ceux qui le cherchent remplacent pour eux toute culture. La langue est soumise à cette dictature comme les autres formes de la vie sociale. Les gens d’affaires ont supprimé le goût comme le sabre a asservi la pensée et comme la Bourse règle l’heure à l’horloge des consciences. Il en résulte que les jargons les plus hétéroclites ont remplacé le langage de l’esprit. De là, cette quantité de mots nouveaux importés par le mercantilisme international, accueillis et répandus par les spécialités les plus déconcertantes. Ce ne sont plus les néologismes parfois heureux qui ont enrichi la langue. Ce sont des mots barbares, créés par l’ignorance illettrée, que les hommes de sport imposent à coups de poing, que les financiers cosmopolites fabriquent comme de la fausse monnaie (voir néologisme). La belle langue littéraire se dissout dans une boue saumâtre ; la langue populaire est souillée de tous les détritus des papiers publics. Le jargon, trouble comme les consciences, s’implante avec ses chausse-trapes, ses ambiguïtés, ses non-sens et contresens dans un monde où il ne s’agit plus que d’être dupeur pour ne pas être dupé. Boileau disait :
Il n’est plus rien qui se conçoive bien. Nous sommes dans ces temps qui faisaient dire à Montaigne :
« Quand les idées s’usent chez les peuples, leurs paroles deviennent hargneuses. »
A la barbarie des mots nouveaux s’ajoute la fantaisie cabotine de dames de théâtre en quête de formes nouvelles de publicité. Après avoir montré leurs dents, leurs jambes et tout le reste, piqué des crises religieuses, dansé devant le pape, perdu leurs perles et fait cambrioler leur appartement, certaines se mettent à réformer la prononciation. Des critiques appelés « distingués » approuvent celle qui prononce « courtinstant » au lieu de « courinstant ». Les spectateurs ne protestent pas. Demain ce sera la mode de dire « courtinstant » et les apaches qui fréquentent les journalistes diront « mortaux vaches ! » D’autre part, un nationalisme dont la hargne agressive eût exaspéré Montaigne, envahit de plus en plus des publications que leur caractère scientifique et pédagogique devrait maintenir à des hauteurs plus sereines. Pierre Larousse a laissé un Grand Dictionnaire universel du XIXème siècle qui est remarquable précisément par son souci d’objectivité et de vérité. Or voici un échantillon de ce qu’on lit dans les publications paraissant aujourd’hui sous son nom. C’est dans le Larousse Universel, en deux volumes, page 255 :
-
BOCHE. — Abrév. d’Alboche. Allemand. Synonyme populaire d’Allemand. Appellation familière et méprisante de tout ce qui est allemand, individu ou objet.
-
BOCHERIE. — Vilenie de boche, d’allemand. On dit aussi Bochonnerie.
-
BOCHIE. — Pays des Boches, ou Allemands.
-
BOCHISER. — Germaniser, espionner. Etre au service des Boches ou Allemands.
-
BOCHISME. — Idée ou coutume boche ou allemande.
L’Académie acceptera-t-elle un jour comme appartenant à la langue française de pareilles définitions ? En attendant, ceux qui tiennent boutique à l’enseigne de Larousse ont une singulière façon de continuer son œuvre et de posséder cette « entière indépendance d’esprit et de jugement », ce « quelque chose de l’esprit libre et audacieux des grands encyclopédistes du XVIIIème siècle » qu’ils lui ont reconnus dans le Nouveau Larousse Illustré.
Ainsi se précipite, en même temps que l’abaissement de l’esprit français, « cette constante dégradation de la langue française dont nous sommes les témoins impuissants » (R. de Gourmont). Doit-on s’étonner que le français perde de plus en plus son influence internationale ? L’anglais le remplace comme langue diplomatique. En Allemagne, en Autriche, en Russie, il n’est plus la langue de la culture intellectuelle, la belle langue qui répandit le goût français fait de clarté, d’ordre, de mesure, mais fut surtout le langage universel de la liberté. L’impérialisme capitaliste achève l’étranglement de la liberté ; le « langage poilu », le jargon des profiteurs de guerre et l’imbécillité nationaliste sont en train de porter en terre la langue française. Ce n’est pas ce qu’avaient rêvé ceux qui se sont fait tuer pour le Droit et la Liberté, et ceux qui sont morts pour la défense de Racine.
— Edouard ROTHEN.
LAPALISSADE
n. f. (de La Palice ou La Palisse, n. p.)
Vérité d’une évidence niaise dont s’adornent les écrits des auteurs médiocres, la conversation des pédants échauffés et des bavards dans l’embarras. Le journalisme en abuse comme aussi les orateurs vulgaires.
C’est un remplissage sans valeur et souvent de sottise éclatante, qui s’apparente à la chanson fameuse à laquelle La Palice a prêté son nom et qui se répand sur cinquante et un couplets. A l’origine, après la mort du capitaine « devant Pavie », la dite chanson tenait vraisemblablement tout entière dans le couplet connu :
Mort devant Pavie ;
Un quart d’heure avant sa mort,
Il était encore en vie.
L’auteur de cette oraison y témoignait sans doute de plus de naïveté que de malice, mais l’ébauche se prêtait à des développements drolatiques et chaque âge y ajouta, semble-t-il, quelque richesse. Le corps de la chanson, rajeunie et étendue, se composait, en effet, au XVIIIème siècle, avec La Monnoye, d’une douzaine de couplets. Mais sur le thème offert, les générations suivantes ont brodé et les chercheurs ont ainsi rassemblé plus de cinquante couplets. En voici, à titre de curiosité, quelques passages caractéristiques
Qu’il ne se couvrit la tête…
Sitôt qu’il fut son mari
Elle devint sont épouse…
Il n’eût pas eu son pareil
S’il eût été seul au monde…
Tout homme qui l’entendit
N’avait pas perdu l’ouïe…
Sitôt qu’il eut les yeux clos
A l’instant il n’y vit goutte…
Il mourut le vendredi,
Le dernier jour de son âge
S’il fût, mort le samedi,
Il eût vécu davantange…
C’est là, évidemment, une « littérature » de tout repos. Mais elle a le mérite d’être inoffensive… Et bien des délayages, en définitive, ne l'emportent sur elle que par la prétention, l'aigreur ou la perfide méchanceté…
LAPIDAIRE
(latin lapis, pierre)
Au sens primitif, l’adjectif lapidaire s’appliquait à ce qui concernait la taille des pierres : c’est à l’art du lapidaire que le diamant doit son éclat. Par style lapidaire, on entendait celui des inscriptions gravées sur la pierre ou le marbre. On peut trouver dans les inscriptions de précieuses indications pour l’histoire ; et des catalogues ou corpus ont été constitués pour réunir les plus importantes, dont l’authenticité n’apparaît pas douteuse, soit grecques, soit romaines, et de bien d’autres pays, et de toutes époques. Le livre étant moins répandu autrefois, c’est à l’aide des monuments surtout que l’on conservait le souvenir des événements fameux. Il va sans dire que la vérité, la flatterie et le mensonge inspirèrent nombre de ces inscriptions ; une critique très sévère est indispensable pour arriver à se rendre compte de leur sincérité. Certains érudits s’y emploient de leur mieux sans parvenir toujours à des résultats satisfaisants.
Comme les inscriptions sur marbre ou pierre étaient généralement brèves, concises, visant à dire beaucoup de choses en peu de mots, on a fini par appeler lapidaire tout style qui présentait des qualités du même genre. La langue latine, pour l’antiquité, l’anglais, parmi les langues modernes, sont particulièrement propres au style lapidaire. Les phrases frappées en médaille, nourries d’idées mais économes de mots, qui rendent un son plein, telles les pensées d’Epictète ou de Pascal, les vers de Lafontaine, par exemple, donnent une idée du style lapidaire. En général, les écrivains pêchent par l’excès contraire ; ils « allongent la sauce », délayent sans mesure, et leurs phrases étirées sont, aussi creuses que des bulles de savon. Mais les lecteurs stupides estimeront toujours plus un gros livre qu’un petit, car ils jugent d’après le format et l’apparence, plus que d’après le contenu. D’où le souci, chez les auteurs (plus souvent, de nos jours surtout, préoccupés de succès que de perfection), de s’attacher surtout à la quantité et d’entasser pages sur pages, ou tout au moins de se faire imprimer en lettres assez grosses pour qu’une courte nouvelle arrive au format et au volume d’un fort roman.
LAPIDATION
(voir supplices, tortures)
LARRON
n. m. (latin latero, compagnon, de laius, côté. C’était, jadis le soldat qui marche à côté du chef. Comme il arriva souvent que les soldats pillaient, détroussaient les passants, ceux qui les imitaient furent appelés Laterones ; de latera on a fait latro, voleur, larron)
Larron est une forme adoucie de voleur, comme larcin est un édulcoré de vol. Leur différence tient surtout, dans le langage courant, à des rapports de proportion. On appelle larron le voleur qui prend à la dérobée, furtivement. Et ce que l’on dit du vo1, en général, s’applique dans ce cas particulier. Cette épithète conviendrait aux commerçants, aux industriels, aux financiers, dont les vols quotidiens et méthodiques sont admis par le code, mais n’en restent moins patents. Ces vautours, d’une rapacité incroyable retiendront sur le salaire de l’ouvrier, majoreront les prix de leurs marchandises, émettront des actions sur des mines imaginaires pour faire passer subrepticement dans leurs coffres-forts l’argent gagné par le populaire. Mais quelle indignation secoue ces modèles de vertu dès qu’un pauvre diable s’avise de dérober quelques sous dans le tronc de Saint-Antoine-de-Padoue, ou quelques pommes chez le châtelain de l’endroit. « Que fait donc la police, pourquoi les tribunaux, vite la prison, à défaut du bagne ! », s’exclament ces prétendus disciples de Jésus. Ils oublient que d’après l’Evangile ce dernier fut crucifié entre deux larrons, et qu’à l’un d’eux il aurait même promis un trône au ciel. Mais de Jésus les bien-pensants se moquent comme de leur première chemise dès qu’il s’agit de mettre à l’abri l’argent extorqué selon des méthodes admises par le gendarme et le Parlement. De fameux larrons aussi nos parlementaires qui se gargarisent avec l’argent enlevé à leurs électeurs par le ministère du fisc. Et les prêtres qui troquent absolutions et indulgences contre des billets de Banque. Et les gens de justice : « advocatus et non latro, res miranda populo », — c’était un avocat, non un voleur, chose admirable aux yeux du peuple — disait la vieille chanson de saint Yves. Tout bien considéré le vulgaire et antique larron, qui chipait, de ci de là, quelques francs, fait piètre figure à côté du voleur honnête que les pouvoirs publics honorent et que les gendarmes protègent pour avoir subtilisé des millions.
LATENT
adj. (latin latens, de lateo, être caché on grec lêtho, lanthanô, de la racine sanscrite lud : couvrir, cacher)
Est latent, ce qui — existant déjà au moins dans ses causes — demeure caché et ne tombe pas sous les sens, ne se manifeste pas au dehors. Se dit particulièrement, en physique et en chimie, du calorique nécessaire à l’état d’un corps et qui ne devient appréciable au thermomètre que dans certaines circonstances : chaleur latente. Les corps gazeux abandonnent leur calorique latent lors de leur passage de l’état de vapeur à celui de liquide ; de même les liquides au moment de leur solidification... Souvent la maladie couve longtemps à l’état latent et se dérobe au diagnostic. Nous dédaignons les malaises précurseurs et les symptômes obscurs qui sont comme des mises en garde de la nature, et nous nous trouvons affaiblis et désarmés quand la crise éclate en coup de foudre. De même surgissent un jour brusquement les révolutions, dont le processus demeure invisible aux esprits superficiels et qui cheminaient ou paraissaient sommeiller, latentes, sous l’apparente adhésion au régime, une docilité de surface aux ordres des autorités : bien avant 1789, une désaffection latente s’était emparée du peuple et le détachait de la monarchie, le poussait confusément vers un affranchissement secrètement caressé...
Des calamités prochaines, des vices conséquents, des manifestations connexes sont latents dans des dispositions connues ; ils sont virtuellement réalisés sous certains états des esprits, des caractères ou des mœurs qui constituent leur terrain normal d’évolution et nous pourrions, ces derniers étant notoires et flagrants, discerner les signes avant-coureurs de maux, semble-t-il imprévisibles.
« L’intolérance est toujours latente dans les passions et dans l’ignorance humaine. » (C. Dolfus)
Dans la lassitude des foules et leur dégoût résigné, dans la frivolité des temps et une tendance accrue aux jouissances faciles et vaines, dans un détachement des affaires publiques qui s’accompagne d’une sorte de fatalisme, l’observateur découvre sans peine le berceau d’une dictature latente qu’un événement soudain portera au jour, souveraine.
Au point de vue individuel, il serait utile de connaître désirs et aptitudes latentes de ceux qui nous entourent, comme aussi ceux de l’enfant. Malgré des variations résultant de la volonté, du milieu, de circonstances imprévisibles, « certains traits du caractère, des modes particuliers de penser comme de faire se retrouvent identiques à toutes les phases de l’existence. Amour du risque ou nonchalance, désintéressement ou besoin d’amasser, tendance à se réjouir comme à s’attrister sont perceptibles chez l’enfant au berceau ; ils demeurent chez le vieillard à cheveux blancs ». Mais ces aptitudes latentes, c’est à l’aide d’une méthode positive et d’une façon strictement scientifique, comme on le demandait dans Métrique Morale, qu’il faudrait les étudier. Or, nous voyons malheureusement qu’à l’exclusion de quelques chercheurs consciencieux, mais dont on parle peu, ce sont les charlatans officiels ou les farceurs de l’occultisme et de la théosophie qui exploitent cette branche de la psychologie.
Au point de vue historique et social, la notion de cause latente est très importante aujourd’hui. Les révolutions sont de deux sortes : les unes lentes, ainsi la diffusion du christianisme ; les autres brusques, ainsi la révolution de 1789 et, sous nos yeux, celle de Russie. Mais si l’on observe de près, on s’aperçoit que les révolutions d’apparence les plus brusques exigèrent une préparation latente. Point d’effet sans cause, cette formule reste vraie en histoire comme en physique. Les causes peuvent être souterraines, échapper à l’observation superficielle, et n’apparaître à la lumière que lorsque se manifestent les effets, comme dans la maladie ; d’où un caractère de brusquerie qui surprendra l’homme non prévenu. Assurément la température mentale ambiante, une occasion imprévue, parfois précipitent un mouvement et lui donnent une ampleur subite ; mais disons-nous que ce mouvement dut naître au préalable, grâce à quelques individus, et que rien n’arrive qu’une action au moins souterraine n’ait d’abord préparé.
LATITUDES (et LONGITUDES)
Notre terre est une sphère légèrement aplatie de 1/298 à ses pôles dont le rayon équatorial est de 6.378 km 250, le rayon polaire de 6.356 km. 844 m, le rayon moyen 6.371 km 107 m et le diamètre conséquemment de 12.742 km. 214 m.
Le tour de notre globe est à l’équateur de 40.008 km ; au 30° parallèle, lat. du Caire : 34.744 km ; à Madrid 40° 24’ : 30.744 km ; au 50°, Paris 48° 50’ : 25.812 km 720 m ; à 60°, Leningrad 59° 57’ : 20.089 km 800 ; au 70°, Vadsoc (Norvège) : 13.748 km. 460 ; au 80° paral. (Océan Glacial), 6.982 km. 560.
Nous appelons axe du monde la ligne idéale inclinée de 23°, autour de laquelle la Terre accomplit son mouvement de rotation diurne, et pôles les deux points du globe auxquels aboutit cet axe. Nous appelons équateur le grand cercle de la sphère tracé à égale distance des deux pôles.
Nous appelons longitudes ou méridiens les 360 grands cercles de la sphère passant par les deux pôles et qui sont perpendiculaires à l’équateur.
Et nous désignons par le mot latitude les 360 petits cercles parallèles à l’équateur, tracés de là jusqu’aux pôles.
Nous comptons nos heures du méridien de Greenwich, près de Londres : 15 méridiens ou longitudes font une heure. Lorsqu’il est midi à Londres, il est environ 7 heures du matin à New-York, 4 heures du matin à San-Francisco ; 9 heures du soir au Japon, 3 heures de l’après-midi à l’Oural et 2 heures de l’après-midi à Leningrad.
— Frédéric STACKELBERG.
LATITUDE (et LONGITUDE)
n. f.
En astronomie, on appelle latitude l’angle que fait, avec le plan de l’écliptique, le rayon visuel mené à cet astre. La latitude géocentrique est l’angle sous lequel paraît, vue de la terre, la distance perpendiculaire du centre d’une planète à l’écliptique. La latitude héliocentrique est la distance angulaire d’un astre à l’écliptique, pour un observateur placé au centre du soleil. Géographiquement, la latitude d’un lieu est la distance de ce lieu à l’équateur. C’est l’angle formé dans le plan du méridien d’un point quelconque par le rayon de l’équateur et celui qui aboutit à ce point ou, en d’autres termes, la longueur de l’arc du méridien, intercepté entre la station et l’équateur, soit céleste, soit terrestre (latitude terrestre, latitude sidérale). La latitude s’obtient en prenant la hauteur du pôle au-dessus de l’horizon du point envisagé, car elle est toujours égale à cette hauteur. La latitude est boréale ou septentrionale quand elle marque une distance prise entre le pôle nord et l’équateur ; elle est dite australe ou méridionale quand elle appartient à l’autre hémisphère. Il s’ensuit de la définition précitée que tous les points du globe, situés sur un même parallèle, ont même latitude. Il existe plusieurs méthodes pour déterminer pratiquement les latitudes. Mentionnons les plus usuelles, sans nous étendre davantage :
-
par le double passage d’une étoile circumpolaire au méridien ;
-
par une seule hauteur méridienne, la déclinaison de l’astre étant connue ;
-
par la méthode de Dubourguet.
Astronomiquement, la longitude est la distance en degrés entre un astre rapporté à l’écliptique et le point équinoxial du printemps, ou, autrement : la longitude du point d’un astre est l’arc de l’écliptique compris entre le cercle de latitude de cet astre et le point d’intersection de l’écliptique et de l’équateur. La longitude astronomique se compte d’occident en orient, depuis le point équinoxial, où elle est 0 jusqu’à 360°. Comme nous l’avons vu pour la latitude, la longitude est géocentrique et héliocentrique. En géographie, c’est la distance du méridien d’un lieu au premier méridien, mesurée en degrés et divisions de degrés sur le parallèle du lieu. Pendant longtemps, on s’est servi du méridien de l’île de Fer, dans les Canaries, mais, aujourd’hui, chaque peuple a pris pour premier méridien celui qui passe par son observatoire. La longitude d’un lieu est dite orientale ou occidentale suivant que, par rapport au premier méridien, ce lieu est situé du côté où le soleil se « lève » ou du côté où il se « couche ». Elle se compte de 0 à 180°. De là il résulte que tous les points situés sur un même méridien et d’un même côté de l’axe terrestre ont la même longitude. La longitude d’un point de la terre est immédiatement donnée par la différence des heures que l’on compte en ce point et à l’Observatoire de Paris, par exemple, précisément au même instant. Cette différence, en vertu de la rotation de la terre, correspond, en effet, à un arc de 15 degrés pour une heure de temps moyen, 15 minutes de degré, pour une minute de temps et 15 secondes de degré pour une seconde de temps. La Connaissance des temps (publiée par le Bureau des longitudes) donne, plusieurs années à l’avance, les heures exactes que l’on comptera à l’Observatoire de Paris au moment même où l’on pourra observer certains phénomènes célestes. Au moyen de ces données, la détermination de la longitude d’un lieu revient à trouver l’heure en ce lieu au moment précis du phénomène et il faire la réduction des temps en arcs ; à défaut des indications du Bureau il faut avoir un chronomètre réglé sur le premier méridien et dont on connaisse bien la marche. Les phénomènes célestes qui servent à résoudre le problème des longitudes peuvent être une éclipse de lune, ou de satellite une occultation d’étoile, un fait quelconque d’une durée très courte, sinon instantanée. Les déterminations par ce moyen sont d’ailleurs délicates et nécessitent des instruments précis et des calculs compliqués. On possède heureusement d’autres méthodes, telle celle dite de Borda : elle revient toujours à comparer les heures comptées, dans deux lieux éloignés, au même instant ou plus exactement à des moments très peu différents.
C’est en connaissant à la fois la latitude et la longitude d’un lieu qu’on détermine la position de ce lien sur le globe et c’est pourquoi nous avons groupé ici ces deux mots connexes. Pour fixer cette position, il faut savoir :
-
sur quel parallèle se trouve ce lieu, ce point, c’est-à-dire en connaître la latitude ;
-
la place occupée par ce lieu sur le dit parallèle, c’est-à-dire la longitude.
Le mot latitude est employé, par extension, dans diverses acceptions. Il sert ainsi à désigner le climat, envisagé par rapport à sa latitude : on trouve l’être humain sous toutes les latitudes. Les « hautes latitudes » s’appliquent aux pays situés vers les pôles. Au figuré, on emploie dans divers sens, plus ou moins rattachés à l’étymologie (latitudo, largeur, expansion, limites reculées), le mot latitude. C’est ainsi l’espace ou la possibilité, la faculté d’entreprendre quelque chose, de faire appel à un plus grand nombre de facteurs, de s’étendre sur un sujet. « Vous avez toute latitude en cette affaire », dira-t-on à quelqu’un pour souligner la liberté qu’il a de faire intervenir tous les moyens d’action en son pouvoir. Chacun de nous a plus ou moins la latitude de réaliser ses projets : plus que d’autres il manque aux nécessiteux la latitude d’organiser leur existence selon leurs goûts. La latitude peut aller jusqu’au relâchement : donner trop de latitude à une proposition, à des principes qui exigent une certaine rigueur. Socialement, les franches coudées, le jeu normal des organes et des facultés, la disposition raisonnable d’eux-mêmes manquent, par suite dune organisation défectueuse, à la plupart des hommes. Et Sieyès manifestait une espérance que nous n’avons cessé de poursuivre lorsqu’ il disait : « Le meilleur régime social est celui dans lequel tous jouissent tranquillement de la plus grande latitude de liberté possible ».
LEADER
n. m. (se prononce : « lideur »)
Mot anglais (de to lead : conduire), passé dans le langage courant. Un de ces mots universellement usités.
Au parlement anglais, le « leader » est le membre de l’assemblée qui groupe autour de lui les hommes d’un même parti, d’une même opinion, qui poursuivent la réalisation d’un même programme. On distingue naturellement le leader du gouvernement de celui de l’opposition… Le leader est le personnage le plus en vue de son parti.
Par extension, on dénomme « leader » l’article principal, l’article de fond d’un journal. Aussi, le cheval qui, dans une course, mène le train, galope en tête des autres,
Dans un parti, il faut avoir bien soin de ne pas prendre le leader pour l’homme le plus sérieux, le plus cultivé, le plus savant. Très souvent, il n’est que le plus versatile, le plus creux, le plus ignorant. Sa « supériorité » réside dans l’habileté à se hisser à la première place par les moyens courants de la politique, à savoir : l’intrigue et le manque de conscience. Un verbe haut et redondant, une souplesse infatigable suffisent à faire d’un individu, le leader de son parti. Rares sont ceux qui s’imposent par le talent ou la conviction et dans les mouvements les plus jeunes et les plus enthousiastes — tel le socialisme — les Jaurès ou les Lénine sont des exceptions.
Presque tous les leaders politiques de notre époque ne furent et ne sont que d’incorrigibles bavards et de fieffés gredins. Et ils ont, de palinodies en trahisons, mené les masses au découragement quand ils ne les ont pas livrées, par leur double jeu, aux coups de leurs adversaires.
— A. LAPEYRE.
LEÇON
(latin lectio, de legere, lire)
Le mot leçon comporte des sens multiples. Il désigne, en particulier ce qu’expose le professeur et ce qu’apprend l’élève :
D’une façon plus générale il s’applique à tout enseignement, bon ou mauvais, joyeux ou pénible, donné par l’expérience et les événements, aussi bien que par les hommes. Telle la poule qui devrait pondre au temps voulu, le professeur doit accoucher d’une ou plusieurs leçons chaque jour. Très rapidement il emmagasine dont un cours appris une fois pour toutes et le débite ensuite quotidiennement, par tranches, avec la fidélité d’un phonographe enregistreur. Après trente ans, pas un mot n’est changé dans les leçons très savantes des professeurs de nos grands lycées ou dans celles des prétendues lumières de nos facultés. La chose est plus commune qu’on ne le pense ; et les pères sont parfois surpris de constater une similitude absolue entre les cours dictés à leurs fils et ceux qu’on leur dicta. Les savantasses, au cerveau fossilisé, sont incapables de quitter la routine où l’habitude les englua. Il est vrai qu’en préparant leur agrégation, ils s’habituèrent uniquement à pondre à heure fixe, selon une couleur bon teint et d’après les immuables règles des écoles. Prétention et sottise érudite résument tout le contenu d’un grand nombre de leçons faites dans l’enseignement secondaire et supérieur. Sans arriver jusque-là, les leçons de certains instituteurs primaires ne valent malheureusement guère mieux. Ils veulent singer leurs collègues du lycée ou de la Sorbonne, et s’installent d’emblée à un niveau qui dépasse l’esprit de l’enfant. Au lieu de procéder inductivement et de remonter des faits aux idées, des applications aux principes, ils procèdent déductivement et se perdent dans des considérations abstraites qui ne disent rien à l’esprit de l’élève. Ces pédagogues, bourrés de formules et de grands mots, croiraient déchoir en abaissant leur majesté jusqu’à la simplicité enfantine. Et naturellement, à tous les degrés de l’échelle universitaire, ces leçons visent à renforcer les préjugés de l’époque et du pays. Ceux qui voudraient qu’on aère la vieille maison bâtie par Bonaparte (tel le groupement de La Fraternité Universitaire), peuvent s’attendre à une hostilité générale. Respecter la routine, faire ce qu’on faisait avant, ne point troubler le repos des maîtres de l’heure, voila l’immuable consigne des autorités académiques.
Mauvaises pour l’éducateur-phonographe, les leçons, telles qu’on les entend d’ordinaire, ne le sont pas moins pour l’élève (Voir éducation, enfant, pédagogie, etc.). Réduit au rôle de barrique où l’on verse sans répit les liquides les plus divers, le malheureux absorbe vers, prose, chiffres et nomenclatures. Une science expérimentale et attrayante comme la géographie deviendra un froid catalogue de noms propres. Car on songe pour lui aux diplômes, dont la conquête, but suprême de l’école, fait oublier la véritable instruction. Et l’on sait combien est tyrannique, surtout en France, la manie des parchemins, qui se succèdent, innombrables, du certificat d’études au doctorat et à l’agrégation. Sur un signal, il faudra donc que l’élève dévide le rouleau de son savoir machinalement, sans réflexion, peu importe ; dans ce genre d’exercice, l’audace et la faconde remplacent avantageusement la raison. Des heures entières se passeront à ronronner des leçons. Dans le primaire, l’enfant aura reçu du maître une nourriture intellectuelle mal digérée qu’à heure fixe il devra rendre. Au lycée, puis dans les universités, le jeune homme, transformé en machine à écrire, prendra textuellement un cours que, le jour de l’examen, il devra redire. Chacun sait que maints barbons universitaires se moquent des capacités réelles du sujet ou de son savoir vrai, mais se montrent impitoyables pour tout candidat qui s’écarte tant soit peu de ce qu’il leur plut de dire. En savoir trop ou apprendre d’une façon non réglementaire devient alors plus dangereux que de n’en savoir pas assez. Bien compris, les exercices de mémoire auraient pourtant leur utilité, comme seraient également utiles les exposés d’une question ou d’une doctrine par des hommes compétents, qui viseraient à faire comprendre et non à éblouir.
Bien au-dessus des leçons données dans les écoles, il faut placer celles que chacun de nous reçoit de l’expérience et de la vie. A l’époque bienheureuse de l’adolescence ; « pour cueillir les fruits d’or, entrevus dans des rêves enchantés, il suffit d’étendre la main à ce qu’il semble. Et l’on regarde avec quelque dédain le troupeau des malchanceux, des impuissants : une voix intérieure promet la victoire, garantit une carrière exempte des déboires fatals aux anciens ». Mais chez le grand nombre une dure expérience dissipe l’erreur avec brutalité. Les échecs succèdent aux échecs, l’un après l’autre s’évanouissent tous les espoirs ; chefs, camarades, prétendus amis, se révèlent vos adversaires, et la tâche professionnelle vous abrutit chaque jour un peu plus. Tirer de l’existence la leçon qu’elle comporte, voilà pour chacun la tâche urgente. Si la leçon est douloureuse ne perdons point notre temps en regrets inutiles : arrière le remords qui paralyse, il convient seulement aux timorés ou aux enfants. Une mer de larmes ne saurait rien changer à ce qui fut ; examinons le passé, non pour des pleurnicheries sans conséquence, mais pour préparer l’avenir. C’est une force de reconnaître sa propre faiblesse et la cause de nos échecs ou de nos malheurs. Point d’humilité soi-disant chrétienne, mais l’impartialité à l’égard de nous-mêmes comme à l’égard d’autrui. Et que la joie ou le succès ne détermine pas une fatale ivresse, génératrice d’un réveil cuisant. Il n’est ni possible, ni désirable de devenir insensible à tous les événements ; par contre une analyse objective, une critique impersonnelle de la situation doit rester notre base d’action. A ce point de vue l’expérience d’autrui peut aussi nous fournir de profitables leçons. Pourquoi s’obstiner sur les routes traditionnelles qui conduisent à des impasses manifestes ; pour qui sait réfléchir, l’histoire inflige un démenti aux doctrines religieuses et morales des peuples chrétiens ; elle montre aussi la vanité des espérances politiques qui bercent depuis quelque temps la misère humaine. Liberté et entraide apparaissent comme les éléments essentiels d’une fraternité qui se refuse à être une duperie, lorsqu’on examine l’expérience universelle des siècles.
* * *
Rares furent les grands vulgarisateurs qui, du haut des chaires officielles, laissèrent tomber, au grand dam des préjugés l’assemblés, des leçons audacieuses et originales, mues par la sincérité et non par la mécanique. Les Michelet et les Quinet, au Collège de France, animaient leurs leçons d’un vivant esprit démocratique, là où l’enseignement traditionnel déroule de sèches et mornes sentences.
« Cette leçon vaut bien un fromage sans doute », fait dire La Fontaine au renard madré. Et il entend ainsi nous montrer le prix d’une expérience dont nous supportons les dépens. La vie nous donne, en effet, de cruelles et coûteuses leçons, mais l’adversité, comme l’exemple, sont rarement, pour les humains oublieux, des leçons profitables. Pour que leurs errements, comme les fautes d’autrui, comme les dures secousses du sort, leur servent de guides et les gardent dans l’avenir, il faut qu’intervienne un contrôle judicieux, dont la plupart ignore l’exercice. Seules les natures perspicaces et capables de balancer les aléas de leurs actes sont promptes à tirer parti des indications de l’expérience et d’apprécier les fruits des leçons rencontrées. Peut-on dire qu’au peuple trompé, pressuré, saigné à blanc, ont servi les leçons terribles de la guerre et qu’il a cessé ne se laisser conduire aux mêmes cataclysmes, où risque de sombrer l’humanité.
Les leçons qu’une culture basée sur la mnémotechnie prodigue à toutes les échelles de l’enseignement révèlent avec une insistance qui pourrait éclairer des esprits moins fermés aux leçons quotidiennes, à quel point la mémoire est incapable de supplier à l’intellection dans l’acquisition du savoir. Et il y a longtemps que Du Rozoir a dit (et la pratique scolaire en fait en vain jaillir l’évidence) que « dans les classes, les élèves qui apprennent le plus facilement par cœur leurs leçons ne sont pas toujours ceux qui ont l’intelligence la plus élevée ». Mais le maître, aussi bien que l’élève, est plus accoutumé à apprendre et à réciter des leçons qu’à mettre en jeu son jugement. Et la stérilité des leçons, leur impuissance à ouvrir l’esprit et à former le caractère ressortent avec force des habitudes mentales communes à la progéniture et à ses mentors et de la voie invariable dans laquelle piétine leur pauvre pensée répéteuse.
LÉGALITÉ
n. f. (latin legalitas de legalis, rad. lex : loi)
Ce mot désigne la qualité de ce qui est conforme aux lois, précise le caractère d’un acte d’une mesure d’une intervention de la justice ou du pouvoir. Quand les lois répressives leur apparaissent insuffisantes et ne leur fournissent plus les armes appropriées à la défense des intérêts propres aux bénéficiaires de l’Etat les gouvernants, toujours si prompts à invoquer la légalité qui les sert, ne se font aucun scrupule de verser dans l’illégalité et d’y puiser leurs instruments de protection et de réaction. Le halo légaliste qui flotte autour des actes publics et remplace, pour la plupart des gens, la moralité des lois naturelles, mises au point par la raison, est dispersé, à cette occasion, comme une bulle importune par les gardiens de la religion de la Loi Inconséquence dangereuse, cependant, car elle ruine peu à peu le prestige des croyances sur lesquelles s’appuie l’autorité des maîtres, désagrège l’armature regardée jusque-là comme la « justification » du régime et tend à faire apparaître comme légitimes les ripostes adverses lorsqu’elles frappent à leur tour la légalité. A travers l’assemblage du légalisme capitaliste, la mobilisation, par un Briand, des cheminots grévistes, les décrets-lois d’un Poincaré, la suspension, au préjudice des partis et des mouvements d’avant-garde, des garanties consacrées en matière de presse et de réunion sont des déchirures de coup d’Etat et, par la brèche, tôt ou tard, si ne s’installe à leur faveur une dictature au reste passagère, pénétrera la révolution...
Empruntons au Larousse quelques rappels historiques sur l’essence et le caractère d’une légalité honnie, à travers les âges, par tous les esprits libres et notons des jugements peu suspects de partialité :
« La légalité est une formule souvent arbitraire, destinée à régler les rapports des citoyens entre eux. Elle se distingue à la fois de la loi naturelle, donnée de la conscience et du droit positif, en ce qu’au point de vue politique on n’a pas pour l’établir à discuter le droit en lui-même, mais à démontrer qu’il est formulé de telle ou telle manière dans la législation en vigueur. Dans tous les siècles la légalité a été en butte aux invectives des philosophes. Au fait, la légalité officielle a toujours été l’écho des passions, des préjugés, des intérêts et des partis. Ce sont d’ordinaire les puissants qui règlent les actes de la communauté et ils obéissent généralement à des mobiles personnels.
Voltaire fait parler en ces termes le Dieu dont la légalité exprime la volonté :
« J’ordonne aux nègres et aux Cafres d’aller tout nus et de manger des insectes. J’ordonne aux Samoyèdes de se nourrir de peaux de rangifères et d’en manger la chair, tout insipide qu’elle est, avec du poisson séché et puant, le tout sans sel. Les Tartares du Tibet croiront tout ce que leur dira le dalaï-lama et les Japonais croiront tout ce que leur dira le daïri. Les Arabes ne mangeront point de cochon et les Westphaliens ne se nourriront que de cochon. Je vais tirer une ligne du mont Caucase à l’Egypte et de l’Egypte au mont Atlas : tous ceux qui habiteront à l’Orient de cette ligne pourront épouser plusieurs femmes ; ceux qui seront à l’Occident n’en auront qu’une. Si, vers le golfe Adriatique, depuis Zara jusque vers les marais du Rhin et de la Meuse, ou vers le mont Jura, ou même dans l’île d’Albion, ou chez les Sarmates ou les Scandinaves, quelqu’un s’avise de vouloir rendre un seul homme despotique ou de prétendre lui-même à l’être, qu’on lui coupe le cou au plus vite, en attendant que la destinée et moi, nous en ayons autrement ordonné. Si quelqu’un a l’insolence et la démence de vouloir rétablir une grande assemblée d’hommes libres sur le Manzanares ou sur le Propontide, qu’il soit empalé ou tiré à quatre chevaux. Quiconque produira ses comptes suivant une certaine règle d’arithmétique, à Constantinople, au grand Caire, à Tafilelt, à Delhi, à Andrinople, sera sur-le-champ empalé sans forme de procès ; et quiconque osera compter suivant une autre règle à Rome, à Lisbonne, à Madrid, en Champagne, en Picardie et vers le Danube, depuis Ulm jusqu’à Belgrade, sera brûlé dévotement pendant qu’on lui chantera des miserere. Ce qui sera juste le long de la Loire sera injuste sur le bord de la Tamise ; car mes lois sont universelles, etc. »
Le tableau est malheureusement exact.
Nous avons dit plus haut que la légalité est surtout l’expression des passions et des préjugés de chaque siècle. L’intérêt de ces passions et de ces préjugés peut seul justifier cet état de choses qui parait devoir être indéfini. Il se rapporte à l’état particulier des mœurs de chaque pays, où il est un élément de nationalité. Si toutes les nations avaient les mêmes mœurs et les mêmes lois positives, la terre ne serait qu’une vaste république. Pufendorf cherche à expliquer la dissemblance profonde de la légalité dans chaque région et dans chaque siècle :
« Ce sont, dit-il, en parlant des points de vue particuliers de la législation positive, certains modes que les êtres intelligents attachent aux choses naturelles ou aux mouvements physiques, en vue de diriger ou de restreindre la liberté des actions volontaires de l’homme, pour mettre quelque ordre, quelque convenance et quelque beauté dans 1a vie humaine. »
Ainsi, le besoin d’ordre justifie toutes les fantaisies du législateur. Autant avouer que la justice n’existe pas et que le droit n’est qu’une codification de la volonté personnelle de quiconque a le pouvoir de mener les hommes à sa guise...
Cet auteur n’ose appeler les choses par leur nom et convenir que la légalité officielle de chaque pays et de chaque époque s’appuie sur les passions et les préjugés en vogue, en d’autres termes sur l’opinion. Il n’y a pas deux cents ans qu’à chaque déclaration de guerre le héraut en cotte de mailles et à manches pendantes proclamait publiquement qu’il était enjoint à chacun de « courre » sus à tous les sujets du prince ennemi (les injonctions d’aujourd’hui , de chaque côté des frontières, ont seulement changé de forme et de ton et modifié leur apparat : elles font, comme jadis, un devoir aux nationaux d’exterminer quiconque « a commis le crime de naître » au delà des lignes fantaisistes qui séparent des peuples qu’aucun différend ne divise).
Sous le régime féodal, la légalité se prêtait à des horreurs variées. Mais la centralisation monarchique fit de la légalité un joug peut-être encore plus lourd à porter. Quand les légistes des rois, sous prétexte de droit romain, eurent remis en vigueur le système fiscal inauguré dans l’ancien monde, l’Occident se couvrit d’officiers judiciaires chargés soi-disant de faire respecter la justice et, en réalité, de vivre aux dépens de tout le monde. Il n’y eut plus que des huissiers, des avoués, des notaires, des tribunaux ; une bureaucratie envahissante s’implanta peu à peu dans les mœurs. Le mal était déjà grand à la fin du XVIème siècle, et Sully le déplore dans ses Mémoires :
« Ces officiers de toute espèce, dit-il, dont le barreau et la finance abondent et dont la licence aussi bien que l’excessive quantité sont des certificats sans réplique des malheurs arrivés à un Etat, sont aussi les avant-coureurs de sa ruine. »
Cette situation désastreuse alla empirant en France durant le XVIIème et le XVIIIème siècle. Elle fut une des causes de la Révolution française. Le XIXème siècle n’est pas exempt de cette lèpre de la légalité… « La légalité nous tue, disait un ministre de la monarchie de Juillet. Le fait est que plus on avance, plus la chose se complique, et que le moment peut venir où le réseau des lois positives sera devenu tellement inextricable que la société sera obligée, sous peine de mort, de se débarrasser de ce poids étouffant ». »
C’est là un réquisitoire précis et caractéristique dans sa sévérité modérée. Et c’est en vain qu’essaient de le redresser (par cette méthode de juste milieu qui est une concession à l’ambiance) des considérations sur les garanties d’équité indispensables qu’offre une légalité en concordance stricte avec la loi, et l’assurance, quelque peu dissonante après l’évocation de ses méfaits séculaires, que le mal de la légalité nous garde de l’arbitraire. Comme si l’arbitraire codifié épousait, sous le masque, les vertus de la justice et que nous dussions bénir la tyrannie qui invoque la sauvegarde de nos libertés ! Tout en reconnaissant, comme il convient, les différences de la légalité d’aujourd’hui avec celle du moyen âge, l’une plus brutale, l’autre plus envahissante — différences acquises grâce aux dénonciations persévérantes de la pensée inasservie et aux conquêtes douloureuses d’hommes courageux — tout en appréciant les adoucissements, plus réels dans la forme que dans le fond, arrachés à cette tourmenteuse des peuples qu’est la légalité, nous abandonnerons ici les légalistes quand même à leurs espérances inlassées (plusieurs milliers d’années d’expérience probante n’aboutiraient-elles, après une analyse à vif, qu’à cet acte de confiance obstiné) d’une légalité bonne en définitive. Nous la regardons comme un appareil néfaste, paralysant la marche de l’humanité dans un réseau de chaînes séculaires, et envisageons sa disparition comme une délivrance. Les hommes n’auraient pas eu si longtemps à batailler — la lutte dure encore — pour la « légalité meilleure » (une légalité que les dangers courus par le conservatisme fait, à toute période critique, se resserrer comme un étau sur les opposants) si les sociétés s’étaient délibérément débarrassées de ce fléau. Le décompte des services qu’on peut lui attribuer — car les institutions et les mœurs les plus oppressives ne sont jamais invariablement unilatérales et laissent toujours filtrer quelques menus bienfaits montre avec plus d’évidence quelle somme de tracasseries malfaisantes et de malheurs sérieux la légalité a accumulés sous prétexte de protection. Combien illusoire et précaire fut le secours apporté par elle, à son corps défendant, à la véritable équité ! Avec les lois « multipliées, injustes, inutiles, obscures », nous répudions la légalité « pénible, inique, tracassière et incertaine » qui lui fait cortège. Nous nous rappelons le mot de Tocqueville et retenons que si les légistes invoquent souvent la liberté « ils placent la légalité bien au-dessus ». Nous constatons que, sous le prétexte de canaliser « harmonieusement » la vie sociale, la légalité nous étouffe ; plus encore, comme disait Viennet, que « la légalité nous tue ! »
— LANARQUE.
LÉGALITÉ
Des lois, souvent mal connues mais inéluctables et contraignantes, président à l’écoulement des phénomènes soit physiques soit vitaux ; une nécessité interne relie, dans un ordre fatal, les causes et les effets. Pour commander à la nature, l’homme commence par lui obéir ; le réseau serré d’un déterminisme inflexible retient l’universalité des faits étudiés par le savant. A + 100 degrés l’eau bout, à — 1 elle se congèle sous la pression et dans les conditions ordinaires ; tout corps abandonné à lui-même tombe ; l’inoculation du microbe diphtérique provoque des effets connus. Dans les prétendus miracles que les religions diverses, du catholicisme à la théosophie, invoquent, il faut voir des phénomènes rares mais parfaitement naturels ; quand n ne s’agit point de pures supercheries. Ainsi des règles fixées selon un ordre toujours identique àlui-même, contre lequel nos vouloirs se brisent commandent dans le monde physique en dernier ressort. L’association, qu’elle soit humaine ou même simplement animale, est-elle soumise pareillement à des lois inéluctables engendrées par la nature et qui contraignent du dedans ? Certains le pensent, d’autres le nient ; la sociologie commence seulement à balbutier son alphabet et chacun peut encore la faire parler comme il veut. Pour Schæffle et Spencer les sociétés sont des organismes véritables soumis à toutes les lois biologiques. Tarde, au contraire, ne voit dans les événements sociaux que des phénomènes psychologiques commandés par la loi mentale d’imitation ; Dürkheim insiste sur ce fait que l’homme vivant en société possède des manières de penser, de sentir, d’agir, qu’il n’aurait pas s’il restait isolé. Préoccupés de garantir les intérêts des chefs et de l’aristocratie, nombre de sociologues visent, consciemment ou non, à légitimer l’état de chose actuel, à soutenir les prétentions des capitalistes et de l’autorité, à présenter comme naturels des faits qui résultent de l’arbitraire humain, à déclarer fatales les plus artificielles créations des privilégiés.
Au premier rang des faits sociaux, qui dépendent de vouloirs humains, se place l’ensemble des prescriptions promulguées par les gouvernants. Imitation grossière de ce qu’offre la nature, la loi décrétée par les chefs relie arbitrairement une manière d’être ou d’agir à des conséquences qu’elle ne comporte pas naturellement : au délit elle associera l’amende, la prison ; au crime la réclusion, le bagne, la mort. Et l’intérêt des grands sert de norme souveraine lorsqu’on dresse le catalogue des peines infligées aux contrevenants ! Rien ici de la fatalité interne des lois physiques ; la contrainte s’exerce du dehors, par le soin du gendarme et des agents de l’autorité ; elle disparaît dès qu’ils sont absents. Mais, pour en imposer à la naïveté populaire, les juristes identifient volontiers loi scientifique et loi sociale.
« Lato sensu, écrit Baudry-Lacantinerie, le mot loi désigne toute règle qui s’impose. La matière a ses lois, les animaux ont leurs lois, l’homme a ses lois. Dans l’ordre des relations juridiques, la loi, en ce sens est large et synonyme de règle de droit. Les lois sont les règles de conduite obligatoires, dont l’ensemble constitue le droit. »
Le même, il est vrai, a dû reconnaître, peu avant, que le droit « est l’ensemble des règles, dont l’observation est assurée par voie de contrainte extérieure à un moment et dans un pays donnés ». N’est-ce pas avouer que les lois promulguées par nos législateurs n’ont que le nom de commun avec les lois scientifiques ? N’est-ce pas reconnaître aussi leur caractère artificiel, puisqu’elles existent seulement en vertu d’une contrainte exercée par d’autres hommes ? Un coup d’œil sur l’histoire des législations, chez les divers peuples, depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, suffirait à nous en convaincre. Ici on récompense ce qu’on punit ailleurs ; ce qui fut bien hier devient mal aujourd’hui. Et les institutions les plus fondamentales des états modernes : famille, propriété, impôt, armée, choix des chefs, n’échappent ni à ces changements ni à ces contradictions. De même que l’on modifie à volonté les règles du jeu de cartes, de même les autorités ont donné force de lois aux prescriptions les plus opposées, ne respectant pas toujours la nature. On croit rêver à la lecture des monstruosités admises par les codes, tant anciens que modernes, et religieusement pratiquées par des millions d’hommes.
Mais comment prit naissance cette légalité, faux pastiche du déterminisme physique ? Ses débuts coïncident avec l’avènement de la ruse, de l’habileté si l’on préfère, comme maîtresse du monde.
« Aux premiers temps de l’humanité, ai-je écrit dans Pour l’Ere du Cœur, l’énergie corporelle fut souveraine ; certaines sociétés animales, asservies aux caprices du plus vigoureux, en fournissent des exemples. Les tarpans, chevaux sauvages d’Asie, vivent par groupes de plusieurs centaines, sous la conduite d’un mâle qui expulse impitoyablement les gêneurs. Dans des troupeaux de bovidés, on a vu des jeunes chasser le maître devenu vieux, puis surpris à leur tour et tués. Chez les peuples arriérés, et même chez nous, une stature dépassant la normale, une musculature puissante, la souplesse des mouvements, l’endurance à la fatigue continuent de désigner un homme à l’admiration générale. Mais presque partout le cerveau a vaincu le muscle, l’adresse a domestiqué la force. De bonne heure, hiérophantes et magiciens fabriquèrent, à l’usage des masses crédules, des mythes sacrés, des conventions sociales, capables d’assurer le pouvoir à un homme, à une famille, à une caste. »
La légalité fut un des moyens essentiels utilisés par les maîtres habiles afin d’asseoir définitivement leur domination. D’origine théocratique, elle apparaît au début comme une émanation directe de la volonté divine. A Rome, la loi des Douze Tables enveloppe le droit dans un ensemble de formules sacramentelles, de rites immuables ; c’est un recueil mystérieux dont les patriciens, postérité des dieux, ont seuls le secret et qu’ils peuvent seuls interpréter. Comme les obligations religieuses le droit (fatum) résulte de prescriptions célestes ; Dieu même intervient par l’entremise du magistrat, le tribunal est un temple, le supplice une immolation. D’où le caractère de fatalité inéluctable, de destin irrémissible que présente la loi romaine primitive. Avec des variantes résultant du milieu, la législation des Hébreux et celles de tous les peuples anciens offre le même aspect théocratique. Si Moïse n’est que l’envoyé du Très-Haut, dans bien des cas le maître, créateur ou interprète du droit, fut dieu personnellement. Le Pharaon en Egypte, l’Empereur à Rome, l’Inca au Pérou, le Roi au Mexique étaient des dieux vivants, comme le Mikado l’est encore au Japon. Plus tard, surtout après le triomphe du christianisme en Occident, beaucoup de souverains perdirent leur divinité pour devenir les représentants officiels et patentés du Père Tout-Puissant. Une vertu céleste continua d’habiter en eux ; et Louis XIV, orgueilleux autant que médiocre, croyait encore participer à la connaissance et à la puissance divines, encouragé, il faut le dire, par Bossuet, cet aigle aux ailes aujourd’hui mitées, dont les interminables phrases masquent mal l’absence de raisonnement profond.
De la sorte les ordres du roi, tout en émanant d’un homme, ne cessaient pas d’être des commandements divins ; obéir aux chefs, c’était, comme autrefois, se soumettre au Maître des cieux. Depuis, le pape a poussé l’audace jusqu’à se prétendre infaillible ; s’il n’est pas une incarnation nouvelle du Verbe, du moins le Saint-Esprit parle directement par sa bouche. Mais, devant la marée montante de l’incrédulité, le droit démocratique se substitue un peu partout au droit divin. Les chefs ne disent plus : « Tel est la volonté de Notre-Seigneur Jésus-Christ », ni même : « Tel est notre bon plaisir », mais ils parlent au nom de l’intérêt national dont ils s’affirment les représentants. La patrie, le devoir, l’honneur et vingt autres dieux, d’allure populaire, voire républicaine, ont remplacé le vieux Jahveh défunt. C’est d’eux, assure-t-on, et de la volonté des électeurs que s’inspire la légalité moderne. Si l’on vous brime et vous condamne, aujourd’hui, c’est au nom du peuple souverain ; si une injuste loi attente à votre liberté, c’est qu’ainsi l’a voulu la sacro-sainte majorité. Il est vrai que l’aristocratie capitaliste est experte dans l’art de faire parler à sa guise cette prétendue majorité et que la sottise populaire ne semble pas avoir sensiblement diminué depuis que tout citoyen est électeur. A l’heure actuelle la légalité s’avère le moyen préféré des forts pour satisfaire impunément, au détriment des faibles, leur volonté de jouissance et de puissance. En coulant les individus dans un moule identique, elle a rendu possible la centralisation étatiste dont nous sommes victimes sous la république comme nos pères l’étaient sous les rois. Seuls comptent en France les bureaux parisiens ; grâce à un travail d’asservissement déjà fort avancé sous Richelieu, complété par la Révolution, puis par Bonaparte, le reste du pays n’est qu’un fief, une vache à lait que l’on veut traire jusqu’à épuisement. En inspirant programmes et méthodes scolaires la même légalité conduit l’éducateur à tuer l’individualité créatrice chez les enfants qu’on lui confie. De tout fonctionnaire elle tend, d’ailleurs, à faire un rouage dépourvu de conscience, une simple pièce de la machine gouvernementale, docile à l’impulsion venue d’en haut, impitoyable pour les subordonnés d’en bas. C’est elle encore qui met la force armée à la disposition du patron mécontent de ses ouvriers. Forgée par les riches elle livre toutes les ressources économiques à la bourgeoisie ; sous le nom de profit commercial elle légitime les vols quotidiens du financier, de l’industriel, du négociant. En vertu du droit d’héritage elle permet à des paresseux de vivre dans un luxe inouï sans faire œuvre utile de leurs dix doigts ; mais elle condamne à mourir de faim le malheureux tâcheron qui ne travaille pas pour cause de vieillesse ou de maladie. Enfin c’est elle qui vous oblige à tuer vos semblables quand il plaît au chef d’Etat de déclarer la guerre. Il faudrait des volumes pour énumérer les crimes commis, chaque jour, au nom de la légalité. Le citoyen moderne lui doit d’être habituellement une marionnette, taillée sur un modèle uniforme, et dont les exploiteurs tirent à volonté les ficelles. Pourtant les partis avancés rêvent, en général, de renforcer l’étatisme et de forger un réseau de lois qui ligotent encore plus étroitement l’individu. Avec Auguste Comte ils semblent admettre que l’homme compte seulement en tant que membre d’une collectivité, qu’il n’a aucun droit par lui-même mais de nombreux devoirs, et que ses droits découlent exclusivement de la fonction sociale qu’il remplit. Ils ne songent à détruire la légalité ancienne que pour en établir une autre « plus juste » qui soit au service de la classe laborieuse ; d’où l’idée de dictature prolétarienne chère au communisme, d’où la tendance ordinaire des socialistes à fortifier l’autorité. Pour eux la révolte n’est qu’un moyen ; plusieurs mêmes, les réformistes, voudraient une continuité évolutive, non une brusque coupure, entre la législation capitaliste et la législation ouvrière. Bolchévisme à rebours, orienté vers la conservation sociale, le fascisme veut lui aussi mettre l’individu en tutelle au profit de l’Etat.
Lénine mérite d’être admiré ; et la Révolution Russe, malgré ses fautes, marquera une étape importante de l’éternel devenir humain. Pas plus qu’aucune autre elle n’est définitive ; l’instinct de liberté demandera satisfaction à son tour. « Assurer à chacun le plein épanouissement de sa personnalité, dans l’ensemble harmonieux d’une cité devenue fraternelle pour tous », voilà ce que je réclamais dans La Cité Fraternelle. De même que le bonheur me semble la norme suprême de l’activité individuelle, de même la fraternité me paraît le vrai fondement de l’association. Mais une fraternité qui ne soit ni faiblesse ni duperie comme fut celle des prêtres, comme est encore celle de nos républicains hypocrites, une fraternité qui implique disparition des hiérarchies sociales et liberté. « Trop de profiteurs sans scrupules ont caché sous un masque d’hypocrite charité leurs usurières exploitations ; il est temps, pour le bien général, que l’on cesse d’associer la sottise et la bonté ». Naturellement cela répugne à ceux qui n’ont le mot fraternité à la bouche que pour mieux tromper le public imbécile.
— L. BARBEDETTE.
LÉGENDE
(latin legenda, choses à lire, de legere, lire)
On désignait ainsi, à l’origine, les versets incorporés aux leçons des matines, puis le nom en fut étendu aux récits de la vie des prophètes, des martyrs et des saints qu’on devait lire dans les réfectoires des communautés (quia legendæ errant). « Quand on n’avait pas, dit l’historien Fleury, les actes d’un saint pour lire au jour de sa fête, on en composait les plus plausibles et les plus merveilleux qu’on pouvait ». Ces récits se perpétuaient à la manière des chants primitifs et populaires.
« Il se formait ainsi, autour des hommes dont le christianisme avait fait ses héros, un ensemble de faits côtoyant ou épousant le surnaturel, que personne sans doute n’avait inventé tout d’une pièce, mais qui était peu à peu amplifiée par la tendance involontaire des imaginations à dénaturer et à embellir la tradition ... » (Lachâtre)
On a entrevu (aux mots fable, histoire, on verra au mot mythologie) les rapports de la légende avec la fable et la mythologie d’une part et, d’autre part, avec l’histoire. La légende, en effet, récit merveilleux, bien antérieure dans sa forme au christianisme — qui, avec son sens des foules, en saisit de bonne heure la puissance et en tira un prodigieux parti — participe de toutes les créations ou des amplifications imaginatives qui enivrèrent, durant des siècles, l’humanité et qui continuent à ravir, pour le plus long appesantissement des religions et de tous les empires basés sur la superstition, les masses crédules pt superficielles. La légende répond à ce besoin, qu’ont les faibles, impuissants à se redresser dans la vie, de s’évader des contingences vers des mondes imaginaires et d’opposer, au terre-à-terre d’une existence douloureuse et sans beauté, l’idéal flottant de paradis mystiques et compensateurs, encortégé d’équipées chimériques et de prouesses invraisemblables, pêle-mêle avec les vérités altérées du passé.
Si la légende peut provenir tout entière de la fantaisie créatrice de quelque imaginatif plus ou moins en communion avec les masses populaires, elle peut aussi sourdre dans l’inconscience de ces masses elles-mêmes et s’y propager. Les peuples enfants (et les petits des hommes en apportent le goût inné), séculairement avides de peintures saisissantes et d’évocations grandioses, toujours prompts à savourer sans contrôle les apports des charmeurs de foules et à se confier au mirage des Olympes anthropomorphistes, ont chéri de tout temps les légendes des bateleurs profanes et des magiciens religieux. « De là toutes les légendes qui encombrent les origines de l’histoire hébraïque, égyptienne, grecque, romaine, etc. L’histoire primitive n’est guère qu’une succession de légendes transmises, d’âge en âge, et auxquelles chaque siècle ajoute ou retranche ». Les mythes poétiques du Nord (Sagas), en France les chansons de geste et les romans de chevalerie sont de fond ou d’allure légendaire.
« Les Védas sont le recueil de légendes aryennes et, par conséquent, le plus ancien de tous ; presque toutes ces légendes sont cosmogoniques. De même, pour la Perse, le Zend-Avesta. La mythologie égyptienne, celle des Grecs et celle des Romains sont entièrement fondées sur des légendes, et chaque dieu, chaque demi-dieu, chaque héros a la sienne, et même les siennes, car ceux qui n’en ont qu’une seule sont bien peu nombreux. C’est ce qui fait qu’il est difficile de concilier tant de traditions diverses. Le christianisme, dont une partie au moins est fondée sur la crédulité robuste des masses, trouvait donc le terrain bien préparé par l’antiquité pour semer et faire fleurir, à son tour, la légende. Tous les recueils des vies des saints, qu’ils portent ou non le titre de légendes, en sont farcis, et l’on appelle plus souvent encore leurs auteurs des légendaires que des hagiographes ... » (Larousse)
Pour donner un exemple suggestif de ce que les légendes peuvent, sur les âges, emporter d’absurdités monumentales, citons au passage cette légende des « onze mille vierges de Cologne », due à la méprise inepte d’un copiste.
« Sainte Ursule ayant été martyrisée, ce qui n’est même pas bien sûr, avec sa suivante Undecimilla, le copiste crut comprendre qu’elle avait été menée au supplice avec ses onze mille suivantes, qui toutes, naturellement, étaient vierges. Cette bévue énorme fut si bien prise au mot, que l’on montre encore aujourd’hui les onze mille reliques ... »
Obstacle au refoulement déjà difficile des préjugés religieux, dangereuse pour les progrès si lents de la raison, la légende ne l’est pas moins pour la marche des connaissances historiques. De toutes pièces inventées, ou considérablement grossies, les aventures qui constituent le fond des légendes populaires — connue des narrations sacrées -, enregistrées ou non par les écrivains successifs, sont aussi, nous l’avons aperçu, le milieu mouvant de l’histoire qui baigne avec elles dans l’irréel et l’hypothétique. Seules valent d’être recherchés, et retenus comme appoint véridique, dans la vie des saints ou des héros légendaires, dans les épopées glorieuses ou burlesques, les exploits épiques ou les interventions miraculeuses, les détails et les traits (qui sont l’accessoire du récit) par quoi se révèlent les mœurs d’une époque et qui n’ont servi au chroniqueur que de cadre et d’enjolivement, lui ont même souvent échappé par mégarde. A ce point de vue « l’école historique moderne a su tirer un excellent parti du recueil des Bollandistes et des récits des anciens hagiographes ». Et c’est en ce sens que Voltaire disait :
« Il n’y a pas jusqu’aux légendes qui ne puissent nous apprendre à connaître les mœurs de nos nations. »
Mais c’est assez dire avec quelle prudence les chercheurs d’authenticité doivent s’engager dans ce dédale aux richesses chatoyantes qui dansent sous le regard comme des feux-follets et s’évanouissent à mesure qu’on veut en saisir la substance ; et que de fois ils passeront au crible critique la manne légendaire, aux abords partout séduisants. Si tant est, comme dit Renan, qu’ « il n’est pas de grande fondation qui ne repose sur une légende et que le seul coupable, en pareil cas, soit l’humanité, qui veut être trompée » le sage et le savant, qui ne se satisfont d’apparence, ne peuvent en accepter, comme aurait dit Ibsen, la paix au prix d’un mensonge. Et des investigations besogneuses, sans cesse déçues et maintes fois reprises, leur seront nécessaires pour asseoir dans les temps disparus quelques certitudes provisoires!...
Au moyen âge, quand florissait le règne d’une thaumaturgie à l’apogée de sa fécondité, et qu’erraient, à travers les manoirs écrasés d’ennui, les troubadours porteurs de rires, de chants historiés, de contes et de récits rythmés, la légende envahit littéralement tous les domaines. En dehors des saints et des bienheureux aux attitudes surhumaines et aux miracles multipliés, les princes aventureux, les preux chevaleresques et les guerriers nimbés de bravoure nourrissaient la légende de leurs prouesses brutales. Un halo d’audace, de maîtrise et de vigueur physique exceptionnelles leur faisait une renommée sans exemple et ils passaient, de la bouche déjà grisée des narrateurs aux propos rebondissants du vulgaire, comme parés d’une cuirasse magique et chevauchant l’invulnérable. Il suffit de rappeler ce que la légende a fait de Charlemagne, de ses douze pairs, de Roncevaux, d’Ogier le Danois, de Roland le paladin, d’Ollivier et de tant d’autres plus légendaires qu’historiques, si tant est que l’histoire s’affirme un jour en science exacte et puisse bâtir sur un roc où les remous de la tradition ne viennent ressaisir ses conquêtes. Des légendes particulières attachées aux Robert le Diable, aux Mélusine, à la Reine Pédauque, etc., compliquaient l’écheveau des données errantes du populaire, étendaient la zone maîtresse des croyances. Pris à ces fictions familières qui, dans une atmosphère saturée d’invraisemblable, les pénétraient à vif, nos pères renonçaient à faire la part intelligente du possible et finissaient par délivrer brevet de vie à leurs inventions fabuleuses. Délassements inoffensifs, réjouissances aux éclats fugitifs, papillons fols au seuil des âmes, diront certains, enchantés seulement du tableau. Sans doute, pour maintes histoires privées, qui tenaient plus de la littérature et du spectacle, de la poésie ou de la farce qu’elles ne visaient au document durable et à la culture sérieuse. Mais, dans un monde de crédulité, ouvert à tous les courants de la foi, où l’absurde était souverain, elles garantissaient l’emprise de l’erreur et servaient de tremplin aux trompeurs intéressés des hommes.
Des légendes à foison répandues, bon nombre au reste s’attachaient en propre à l’histoire. Elles retraçaient les hauts faits des chefs et des grands, les entreprises des conquérants, les campagnes des rois. Et, en l’exaltant, elles déformaient, des uns et des autres, le caractère, défiguraient, pour les embellir, les situations dans l’emportement de l’admiration, au souffle du dithyrambe les exploits les plus minces s’enflaient en prodiges, et gestes et personnes, naïvement boursouflés, devenaient méconnaissables. Autant que les assertions des livres sacrés, pour l’exégète, les conflits et les fragments héroïques, les étapes supposées des groupes humains, pour l’historien, s’adornent, à travers la légende, des couleurs de la féérie et posent, devant l’esprit averti, toutes les perplexités du doute. Emportée par les voies littéraires et campée sur l’écrit, après de folles chevauchées orales, la légende sert la faconde capricante des écrivains à la faveur des attachements invétérés du public. Elle trouble une pensée farcie d’idées désorbitées et de lieux communs généraux, empêtrée dans les détours et livrée aux vagues oratoires qui s’efforcent durement à la rectitude et à l’équilibre. Elle envahit toutes les formes d’expression, pénètre le dire et le style, sort des cadres imagés de la poésie et de l’art, où sa part d’influence, moins nocive et en principe reconnue, peutêtre aussi délimitée, pour établir son règne jusque sur la science par d’habiles « arrangements » et des dogmes têtus, des expériences faussées d’occlusions mystiques, des divagations teintées de magie ou d’occultisme...
Qu’on ne regarde pas la légende comme une lointaine visiteuse dont le souvenir seul l’amène jusqu’à nous quelques méfaits éteints. Tout près, les annales de la Révolution française fourmillent de ses amplifications. Le XIXème siècle n’a-t-il pas vu, à quelques années des événements et dans l’enthousiasme des survivants médusés, la légende impériale faire du « Corse à cheveux plats » un nouveau Sabaoth ? Ecrivains et poètes du premier romantisme — Hugo en tête — n’ont-ils pas, dès la troisième décade, magnifié le soudard qui traîna jusqu’à l’Oural ses bottes ensanglantées ? Et n’est-ce pas l’apothéose du « Grand » (prestigieux Prométhée dont « le vautour Angleterre », sur son rocher d’exil « rongea le cœur » invaincu) qui valut à la France le neveu Bonaparte, fantoche défait au prix du cancer alsacien ? Est-il besoin de plonger dans l’autre siècle pour voir à l’œuvre, dans les champs falsifiés de l’histoire la légende aux ailes de nuit ? Qui, hormis quelques pionniers épars, des douteurs obstinés, des dissecteurs patients promène, à travers « la Grande Guerre » (supercherie si proche), la torche des vérités édificatrices ?
Autour des tumulus à peine affaissés, parmi les mobiles à point obscurcis, voltigent, grâce au secours des rescapés complices, les évocations erronées, s’amalgament, faisceau dénaturant, les stratégies truquées, les heureux à-propos, les faits d’armes propices, s’accréditent, comme invinciblement, les « causes » mensongères autour desquelles veillent de criminelles connivences. Sur les clartés lapidées, devant nos regards terrifiés de son envergure, s’essore ainsi et s’affermît la « grande parade », légende perfide, semence de carnage, pâture morbide du monde !
Depuis les prémices des échanges humains, la légende paralyse et fait se fourvoyer la vérité. Son baume anesthésiant retombe sur les simples en coulées de souffrance, en ténèbres sur les civilisations. Méfions-nous de ses lutins dansant au bord de nos veilles, de ses fantasmagories grisantes ou consolatrices, de ses on-dit pleins de traîtrises, des chars de triomphe abusants qu’elle ramène du passé.
Ses enchantements, qui enveloppèrent nos berceaux d’enfants, prolongent, adultes, nos périls. Sur les chemins qui montent au savoir ses séductions sont des pièges. Pernicieuse est, partout, pour qui s’y livre, la sécurité de ses joies. Il n’y aura de quiétude lucide (j’entends ici la paix en laquelle viennent mourir tous les maux évitables) dans l’univers pensant, que si les hommes, gardés enfin du récit, sceptiques à l’égard des rumeurs d’histoire, goûtent en la légende le charme seul des belles musiques qui scandent les reposantes rêveries, aux soirs lourds d’efforts véridiques...
* * *
Des légendes écrites les plus fameuses, signalons : Le Martyrologe de Saint-Jérôme, source favorite des écrivains grecs ; les compilations de Simon le Métaphraste, dont l’Eglise continue à fêter tant de pieux ermites et de saints imaginaires ; La Légende dorée (proprement « légende d’or » : legenda aurea), vaste recueil de la Vie des Saints, publiée en latin par J. de Voragine et réimprimée plus de 50 fois pendant les XVème et XVIème siècles. (La Bibliothèque Nationale en possède neuf manuscrits). Attaquée de bonne heure, pour sa fantaisie, par les catholiques eux-mêmes, cet ouvrage est aujourd’hui en défaveur. Citons encore, parmi les recueils hagiographiques, les Acta Martyrum de dom Ruinart, les vitæ Patum et Fasti sanctorum du P. Rosweid, les Acta Sanctorum de Dollandus et de son école, etc.
Notons, parmi les légendes populaires, celles du Juif Errant, de Geneviève de Brabant, la Légende des Quatre Fils Aymon et de leur cousin Maugis, etc. Parmi les légendes primitives, mentionnons les Légendes Indiennes, recueillies par C. Mathews (1854) chez les peuplades sauvages de l’Amérique. Elles nous montrent, dans un état de société déjà remarquable, des hommes industrieux, libres, serviables et doux, naïfs et modérément superstitieux, très différents des guerriers scalpeurs que les Cooper, les Aymar, les Mayne-Reid ont présenté au public européen...
Maints ouvrages portent d’ailleurs ce titre de légende et en renferment plus ou moins l’esprit. Dans La Légende Celtique et la poésie des cloitres (1859), H. de La Villemarqué s’est proposé d’étudier « les traditions orales, poétiques, religieuses, symboliques, historiques qui se sont développées à part dans l’Eglise d’Irlande, de Cambrie, d’Ecosse et d’Armorique ». Les Légendes et Croyances de l’antiquité (A. Maury, 1863), ouvrage scrupuleux et érudit, sont des Essais qui ont pour but « d’éclairer l’histoire des religions de l’Occident à l’aide de celles de l’Orient ». L’auteur y étudie avec sagacité le naturalisme des Aryas et regarde les religions aryennes comme le fond commun de toutes les religions indoeuropéennes (judéo-chrétienne y comprise). Il montre la part considérable de la légende dans la formation des cultes consacrés à la divinité. Citons encore, dans un ordre davantage littéraire, la Légende de Montrose, de Walter Scott et surtout la Légende des Siècles (de Victor Hugo) où l’auteur a tenté, dans un lyrisme souvent heureux et en larges fresques poétiques dont plusieurs sont des chefs-d’œuvre, « d’exprimer — ce sont ses termes — l’humanité dans une espèce d’œuvre cyclique, de la peindre successivement et simultanément sous tous ses aspects : histoire, philosophie, religion, science, lesquels se résument en un seul et immense mouvement d’ascension vers la lumière ; de faire apparaître dans une sorte de miroir sombre et clair, cette grande figure une et multiple, lugubre et rayonnante, fatale et sacrée : l’homme... ».
Parmi les légendes qui peuvent concourir à la formation de l’histoire, de la numismatique, etc., sont les inscriptions placées sur les monnaies, médailles, etc. D’abord brèves, puis plus explicites, « elles renfermèrent les noms et les titres honorifiques des divinités locales, des magistrats, des rois, quelques notions topographiques, etc. Les pièces consulaires romaines offrent les légendes les plus curieuses sur les principales familles de Rome, sur les hauts faits qui les avaient illustrées et sur les traditions auxquelles elles faisaient remonter leur origine. A ces factums généalogiques d’une aristocratie qui fut bientôt nivelée par le despotisme, succédèrent, après l’établissement du gouvernement impérial, les formules adulatrices de l’esclavage. Les légendes monétaires ne contiennent plus alors d’intéressant que les faits et les dates... Les légendes qui nous sont restées en langue celtibérienne, osque, samnite, étrusque, nous sont inconnues ; on explique même difficilement celles en caractères persans et sassanides » (Lachâtre). Les légendes des jetons (XVème à XVIIème siècle), répandues dans les provinces, sont des inscriptions plus soumises encore aux caprices des temps : la galanterie elle-même s’y réfugiait, parmi les rappels bibliques et l’histoire. On trouve à la Galerie du Louvre un jeton figurant Charles IX, avec l’inscription : Pietate et justitiâ. On ne pouvait trouver, pour l’ordonnateur de la Saint-Barthélemy, plus flatteuse légende et qui donne mieux la mesure de tels documents. La proclamation dont s’enorgueillissent, en France, les républiques successives et qui pare encore de nos jours monuments et médailles, pièces et assignats, est d’une aussi riche ironie. « Liberté, Egalité, Fraternité ! », attributs officiels du régime, appartiennent en effet à la pure légende ; et la monnaie qui les porte est un socle digne de servir d’assise à l’histoire de ce temps.
— S. M. S.
LÉGENDE
Tout récit où l’histoire est déformée par la tradition peut être appelée légendaire, qu’il s’agisse de narrer des actions guerrières, les hauts faits d’un chef d’Etat, les vertus d’un prétendu saint ou les gestes d’un quelconque bipède que l’on trouve avantageux d’ériger en idole après sa mort. Par l’élément historique, parfois minime, parfois considérable, qu’elle comporte, la légende se distingue de la mythologie el de la fable dont Stephen Mac Say a donné une étude pénétrante. On sait combien néfastes les récits militaires qui déforment intentionnellement ce qui concerne la guerre, cette plaie hideuse du genre humain. Les généraux à la Foch, à la Joffre, à la Mangin, les gradés canailles qui cimentèrent leur gloire avec le sang du simple troupier, y deviennent des héros, des demi-dieux exempts des faiblesses ordinaires ; leurs fautes sont passées sous silence et leurs plus douteuses entreprises sont érigées en action d’éclat. Ce travail d’embellissement, poursuivi sous nos yeux par les écrivains patriotards, soucieux d’obtenir le ruban rouge ou un fauteuil à l’Académie, nous renseigne sur la sincérité des louanges décernées depuis des siècles à la vertu guerrière. Même remarque concernant les prétendus mérites des chefs d’Etat à la Napoléon ou à la Poincaré ; grâce à d’habiles subterfuges de style, ces criminels ambitieux passent pour des bienfaiteurs de leur époque.
Mais c’est dans le domaine religieux que la légende revêt les proportions les plus fantastiques. Pour tromper les âmes simples, les prêtres ne reculent devant aucune exagération ; d’un malfaiteur public ils réussissent à faire un saint et dans les songes creux de malheureuses hystériques, ils trouvent moyen de découvrir le doigt de Dieu. Rien ne les arrête. Après avoir brûlé comme sorcière la pucelle d’Orléans, ils sont parvenus à faire admettre qu’elle était inspirée par le ciel. Parmi les saints du calendrier, soi-disant faiseurs de miracles, se trouvent des fous sanguinaires ; et pour édifier les dévots on fabrique miracles, grâces, faveurs célestes et l’on falsifie la vie du bienheureux devenu populaire. Saint François d’Assise s’est vu attribuer un pouvoir presque divin par des biographes dédaigneux de l’histoire et soucieux seulement de glorifier cette victime du mysticisme outré. Saint Martin de Tours devint célèbre grâce aux fables répandues à son sujet par les écrivains ecclésiastiques. On pourrait multiplier les exemples à l’infini, car dans les pays catholiques, chaque région, chaque bourgade possède sa relique de saint ou son lieu de pèlerinage. Au moyen âge surtout, alors que l’esprit critique n’existait plus, on se gargarisait des plus absurdes légendes ; les apparitions du diable ou de la Vierge étaient quotidiennes, les femmes se croyaient la proie des lutins, les moines conversaient avec des revenants ; entre la terre et l’au-delà les limites n’étaient pas nettes et les échanges étaient constants. Lorsque l’Eglise eut inventé le purgatoire et que le clergé vendit des messes à l’intention des défunts, les apparitions d’âmes qui réclamaient des prières devinrent nombreuses ; personne ne pourra dire quelle inestimable source de richesses, pour les moines, s’avéra cette innovation.
Les Evangiles eux-mêmes sont d’ailleurs, pour le moins, des écrits légendaires. De nombreux exégètes ne voient plus en Jésus (voir ce mot), qu’un mythe, qu’une création subjective de l’esprit halluciné des premiers chrétiens. Même ceux qui admettent son existence réelle doivent convenir que les écrits sacrés du Nouveau Testament contiennent une multitude de fables ineptes et qu’il serait vain de vouloir identifier le Jésus de la légende avec le Jésus de l’histoire. Mais lues sur un ton doucereux, avec des allures dévotes, les mensongères légendes chrétiennes, qu’elles datent d’hier ou de plusieurs siècles, déforment les cerveaux enfantins et les obnubilent parfois pour le reste de leur existence. Travail d’autant plus facile que l’esprit qui s’ouvre, par atavisme sans doute, est naturellement avide de merveilleux, épris de fantastique. Les religions, qui répondent à l’enfance de l’humanité, sont adaptées à la faiblesse des jeunes cerveaux ; aussi l’Eglise veut-elle s’en emparer à tout prix avant que la réflexion devenue plus forte permette de contrôler ses affirmations. On connait le mot d’un prêtre, rapporté par L. Barbedette :
« Donnez-moi l’enfant jusqu’à l’âge de sept ans, et il demeurera l’enfant de l’Eglise pour le reste de son existence. »
C’est à l’aide de légendes et de mensonges que ce prêtre enfonçait dans l’âme de ses élèves, les idées et les tendances chères aux Serfs du Vatican, dont parle Bontemps. Et parmi les dévotes, qui passent leurs journées à marmotter des prières, beaucoup sont plus impressionnées par les récits d’apparitions ou les vies de saints que par l’explication théologique du credo. Nous ne nions pas que certaines légendes présentent un caractère poétique et littéraire marqué ; elles ne peuvent faire oublier les maux sans nombre causés par l’amas de récits frauduleux qui entretiennent la religion dans les cerveaux faibles et les imaginations ardentes. Quand les hommes auront déserté définitivement les temples, quand les prêtres ne trouveront plus à qui vendre leurs drogues empoisonnées, les légendes, rendues inoffensives, pourront, quelquefois, être lues avec intérêt. On le constate déjà lorsqu’il s’agit de religions disparues ou étrangères à nos contrées ; mais tant que l’idole est debout et que les adorateurs ne manquent pas, il convient d’attaquer sans ménagement les légendes dont elle se pare. Rendons cette justice à l’époque moderne que les démolisseurs de fausses gloires religieuses, guerrières et autres, sont plus nombreux qu’autrefois. « Diffuser l’esprit critique c’est contribuer au bonheur tant des collectivités que des individus ». Là git pour les hommes le grand moyen de libération.
A côté des légendes intentionnellement fabriquées par les larbins de l’Eglise ou des classes possédantes, d’autres naissent spontanément de la naïveté populaire. Une déformation instinctive s’opère de toute action un peu lointaine dans le temps ou dans l’espace. Les vieillards voient leurs années d’enfance sous un aspect ensoleillé qu’elles n’eurent pas toujours et ceux qui reviennent de contrées perdues, dans un autre hémisphère, finissent aisément par imaginer qu’ils accomplirent là-bas des prouesses inégalées. On conçoit que l’exagération ne connaisse plus de limites lorsqu’il s’agit d’hommes morts depuis longtemps ou d’actions d’éclat qui s’accomplirent voici plusieurs siècles. Lorsqu’une nouvelle même véridique a passé par dix bouches, elle devient souvent méconnaissable ; comment un récit transmis de générations en générations, depuis un temps immémorial, pourrait-il contenir une forte dose d’exactitude ! Les historiens savent combien il faut se méfier des traditions orales et des dires populaires ; impossible d’ordinaire d’en tirer quelque renseignement précis sur le héros ou l’action qu’ils prétendent l’appeler ; ils nous renseignent seulement sur la mentalité du milieu qui les vit éclore. Aussi ne peut-on faire état des légendes populaires lorsqu’il s’agit de vérité ; elles aussi sont menteuses, même lorsqu’elles paraissent touchantes et belles.
— L. B.
LEGISLATEUR (TRICE)
n. et adj. (latin legislator, de lex, legis, loi et fero, sup. latum, je porte)
Celui qui fait, qui porte, qui donne la loi à un peuple. Parmi les législateurs antiques, dont la gloire apporte jusqu’à nous les vertus souvent légendaires, rappelons : Osiris chez les Egyptiens, Moïse chez les Juifs, Zoroastre chez le peuple zend, Confucius chez les Chinois, Minos en Crète, Zaleucus chez les Locriens, Lycurgue à Lacédémone, Solon à Athènes, Romulus et Numa à Rome, etc. Plus près de nous les Justinien, les Mahomet, les Charlemagne, les Jaroslaf de Russie, Louis IX, Charles IV, Cromwell, Louis XIV, la Constituante, la Convention, Napoléon 1er sont regardés, à des titres divers, comme des législateurs dont l’histoire enregistre les noms pour la postérité... Ils ont tous, plus ou moins, invoqué la justice et prétendu l’introduire dans leurs œuvres. Un regard sur les tables qu’ils ont laissées montre la fragilité de telles espérances. Et il apparaît, à côté des contradictions sur le principe même de leurs actes, combien précaires, iniques, et finalement en désaccord avec les mœurs du temps ou le bien même des hommes, sont les règles que les arbitres des peuples — sages ou despotes — essaient de fixer dans le cadre rigide des lois...
On appelle aussi législateur : personne qui trace les règles d’une science, d’un art : le législateur du Parnasse. — N. m. Pouvoir public qui a mission de faire des lois. — La loi en général : le législateur a voulu que ... — Chacun des membres de ce pouvoir.
Quand la société est régie par la caste sacerdotale, la loi est proclamée au nom de Dieu. Dieu est le législateur par excellence, sa loi est éternelle et absolue. Nul ne peut la transgresser sans que la punition s’ensuive. Or, les actes mauvais et condamnés par la loi divine ont parfois des conséquences heureuses, bonnes pour le transgresseur. Il faut donc, de toute évidence que la justice soit rendue en d’autres lieux et époques que ceux où vit le jugé. D’où nécessité de créer un ciel et un enfer, corrigés d’ailleurs par un purgatoire. Nécessité également de donner à l’homme une âme immortelle, sur laquelle s’exercera la justice de Dieu, après la mort. Ce n’est pas par hasard que les religions appuient leur morale, leur loi sur un Dieu législateur, une âme éternelle qui reçoit la loi, obéit ou désobéit, appelle un monde adéquat où la justice distribue punitions ou récompenses. Tant que les hommes « croient » la règle, ne l’examinent pas, la domination du sacerdoce est assurée, l’ordre règne.
Mais l’examen est le propre de l’homme. Vient un moment où la règle est soumise à la critique. Pour empêcher cet examen, la crainte d’un lieu de souffrances éternelles n’est plus suffisante, la caste sacerdotale fait appel à la caste des guerriers. Le chef des guerriers, le Prince, sera législateur pour la société ; mais Prince de « droit divin », il est législateur de « droit divin ».
La loi est sauvegardée par la force. Tout examen est longtemps rendu impossible par l’inquisition. Il faut que des prêtres, des princes et des grands, gênés par la loi, l’attaquent eux-mêmes dans les principes, à savoir : la réalité du législateur, pour que le prince, oubliant sur quelles bases repose l’ordre social de son temps, puisse dire : l’Etat, c’est moi !
Quand la loi n’apparaît plus comme divine, quand le législateur n’est plus qu’un homme ou une caste, l’examen se donne libre cours ; on peut transgresser la loi — pourvu que le législateur ne le sache pas. Le mal n’est plus dans la désobéissance, mais dans la faiblesse du révolté. Tout est bien pourvu que l’on soit fort. Mais la force est par définition : changement, mouvement, l’ordre social est dès lors instable et les révolutions ne tardent pas à faire sentir aux sociétés la nécessité de changer la règle.
L’accession au pouvoir des classes bourgeoises nous donne une autre catégorie de législateurs. La loi est encore l’expression de la force de la classe possédante. Mais le législateur tient compte de l’esprit de libre-examen des classes pauvres ou prolétariennes. La force seule est trop instable et partant, l’ordre. La force est masquée de sophisme et s’appelle : suffrage universel, volonté générale, intérêt général, loi des majorités. Le législateur, roi constitutionnel, parlement, etc..., fait la loi, établit la règle au nom de la majorité des individus. Ainsi chacun est censé être son propre législateur et la loi doit représenter la volonté de celui qui lui doit obéissance. De ce fait, s’il en était réellement ainsi, l’ordre serait indestructible.
Et cependant, le législateur opère de telle manière que la démocratie connait aussi les révoltes et les révolutions. C’est que la somme des volontés particulières qui est censée donner la règle n’est pas du tout en accord avec la volonté de chaque particulier. D’autre part, la manière dont s’établit la loi, dont se délègue le pouvoir, la souveraineté, au législateur, met un obstacle absolument infranchissable à l’instauration de l’ordre social définitif (Voir Suffrage universel).
Ainsi : Théocratie, Royauté de droit divin, Démocratie, sont incapables de créer l’ordre par la loi. D’autres législateurs peuvent-ils obtenir ce résultat, ou la loi, l’autorité, ne sont-elles génératrices que de misère et de désordres ? (Voir Loi, Autorité, Légalité, Législation, Justice, etc.)
— A. LAPEYRE.
LEGISLATIF (IVE)
adj.
Qui a le pouvoir de faire, qui fait des lois : Assemblée législative. Qui a rapport à la loi, à la confection des lois, qui en partage la nature ou le caractère : actes, mesures législatifs. Qui a droit de faire des lois : pouvoir législatif.
« Les grands feudataires de la couronne exerçaient avec le roi le pouvoir législatif et constitutif pour les grandes sanctions de l’Etat. » (Saint-Simon)
« Le corps législatif ne doit point s’assembler lui-même, car un corps n’est censé avoir de volonté que lorsqu’il est assemblé... » (Montesquieu)
C’est vers une détente de la tyrannie législative que tendait Royer-Collard lorsqu’il disait :
« Il n’y a de nations politiquement libres que celles qui participent sans relâche et au pouvoir législatif et au pouvoir judiciaire. »
Et Proudhon cherchait le fondement de la capacité législative ailleurs que dans l’arbitraire de la naissance et du règne, la suprématie du cens ou la fantaisie du suffrage, qui proclamait que « la puissance législative n’appartient qu’à la raison, méthodiquement reconnue et démontrée »... (Voir législateur, loi, etc.)
Assemblée législative. — Fut élue pour deux ans, en vertu de la Constitution de 1791, mais ne siégea même pas une année : du 1er octobre 1791 au 20 septembre 1792. Son histoire fut marquée par deux faits essentiels : la déclaration de la guerre à l’Autriche, le 20 avril 1792, laquelle détermina la suspension de Louis XVI (imposée par l’insurrection parisienne du 10 août 1792), prélude de l’abolition de la royauté. La suspension du roi, après sa tentative de fuite à Varennes et son emprisonnement au Temple, plaça l’assemblée devant des problèmes pour lesquels elle se sentait insuffisamment armée. Elle se sépara, cédant la place à la Convention.
Assemblée législative. — Elue le 13 mai 1849. Donna une majorité réactionnaire dite : du Parti de l’Ordre. En outre, un mois après, quelques-uns des députés républicains (33) furent emprisonnés. Aussi la législative s’employa-t-elle à restreindre les libertés conquises en 1848, et à préparer le retour de l’Empire. Elle vota notamment la « Loi Falloux » sur l’enseignement, accordant des droits exorbitants aux catholiques. Il faut noter que le « républicain » Thiers, le futur assassin de la Commune, était un des chefs de ce parti de l’ordre. La législative vota également le suffrage restreint.
L’Assemblée fut dissoute par le coup d’Etat du 2 décembre.
Corps législatif. — Corps politique constitué en 1852 et dissous le 4 septembre 1870.
LEGISLATION
n. f. (latin législatio, de lex, legis, loi et latus, porté)
Au sens ordinaire du mot, on entend par législation un ensemble de lois en vigueur à une époque et dans un pays donnés ; ainsi l’on parle de législation ancienne et moderne, française, russe, américaine, de législation des loyers, commerciale, industrielle, etc. La fabrication des lois et règlements, conséquence du pouvoir de commander que s’arrogent les gouvernants, suivit l’institution de conseils d’anciens, puis de chefs, dans les tribus primitives mais longtemps la volonté des maîtres ne fut pas codifiée de façon durable et systématique. Aujourd’hui d’innombrables prescriptions règlementent, jusque dans le détail, les moindres actions des « libres » citoyens d’Europe et d’Amérique ; d’où l’énorme développement de législations qui sans cesse empiètent sur le domaine déjà si restreint de l’indépendance individuelle. En Grèce, Lycurgue donna à Sparte des institutions imitées de celles de Crète ; impitoyables pour l’esclave et l’enfant, dures pour tous, elles visaient seulement à former des soldats. Plus humaines, celles que les Athéniens reçurent de Solon se modifièrent peu à peu ; le peuple possédait le pouvoir législatif eu principe avec de nombreuses restrictions dans la pratique. Mais c’est à Rome que les deux notions corrélatives d’état et de loi devaient acquérir leur plein développement ; acceptées avec empressement par les despotes, elles se sont acclimatées depuis chez la généralité des peuples. Le droit romain fut complètement codifié sous l’empereur Justinien, au XIème siècle de notre ère, par des jurisconsultes qui réunirent les prescriptions édictées aux époques antérieures ; déjà, au milieu du IIIème siècle, sous le règne des Sévères, il présentait ses lignes essentielles. Coutume, loi, édits du préteur constituaient sa triple source. Ensemble de règles écrites et transmises par la tradition, la coutume des ancêtres (mos majorum) était respectée autant que la loi écrite par les Romains ; toutefois elle avait pour sanction la colère des dieux ; non des châtiments infligés par le magistrat. La loi (lex) désignait à l’origine les engagements réciproques pris, les uns envers les autres, par les citoyens. C’était du Vème siècle avant notre ère que datait la Loi des Douze Tables, la première encore toute imprégnée d’esprit théocratique ; elles devinrent innombrables. Si le pouvoir législatif appartenait au peuple, il ne pouvait l’exercer qu’avec la coopération d’un magistrat. Quant aux Edits du préteur, malgré leur caractère transitoire, ils tinrent une place considérable dans la législation romaine. Lorsqu’il entrait en charge, le chef suprême de la justice, le préteur urbain, faisait connaître les principes qui le guideraient dans la rédaction de ses arrêts ; sans pouvoir contredire formellement la loi, il était libre d’innover et d’interpréter à sa façon. En droit son édit ne lui survivait pas, cessant d’être applicable lorsqu’il sortait de charge, au bout d’un an ; en fait, les édits successifs se complétèrent en général, loin de se détruire, et leur ensemble fit partie intégrante du droit. A Rome la connaissance des lois fut toujours en honneur ; mais c’est durant les trois premiers siècles de l’Empire que la jurisprudence atteignit son développement maximum avec Labéon, Julianus, Gaïus, Papien, Ulpien, Paul. Ces juristes consacrèrent la toute-puissance du prince ; dans l’Etat, tout sujet, disaient-ils, devait obéir aveuglément au maître. Naturellement les empereurs chrétiens ne répudièrent pas ces idées ; en 426, la Loi des Citations, rendue sous Théodose II et Valentinien III, décida même que les écrits de Papinien, Paul, Gaïus, Ulpier, Modestin auraient force de loi ; en cas de partage on prendrait l’opinion qui avait pour elle le plus grand nombre de ces jurisconsultes, et si les suffrages se répartissaient en fraction égales, celle de Papinien. Le catholicisme, qui calqua sa constitution sur celle de, l’empire, devait verser également dans les idées centralisatrices et autoritaires, inspirées du droit romain. Grâce à lui le Corpus juris civilis publié sous Justinien, et qui réunissait toutes les lois antérieures ou de l’époque dans divers ouvrages : Code, Novelles, Institutes, Pandectes continua d’être enseigné dans les Universités, au moyen âge. On connaît le rôle joué, en France, par les légistes dans l’établissement de la monarchie absolue ; la tradition qu’ils ont créée subsiste. Maintes fois le personnel gouvernemental a changé ; aux Capétiens ont succédé les Bonapartes, ainsi que des ministres et présidents républicains ; les tendances autoritaires et centralisatrices ont persisté sous tous les régimes successifs. Un Richelieu, un Robespierre, un Napoléon, un Clémenceau professaient des idées différentes ; ils se ressemblent étrangement, dès qu’on observe leur caractère et leurs procédés de gouvernement.
Au point de vue législatif, l’ancienne France comprenait des pays de coutume et des pays de droit écrit ; les premiers étant situés au nord dans l’ensemble, les seconds au midi. Fondé sur l’usage, le droit coutumier variait de province à province et même de localité à localité. On évaluait à plus de trois cent-soixante le nombre des coutumes, soit générales, soit spéciales : les premières, une soixantaine, régissaient une portion considérable de territoire, les autres se restreignaient parfois à une ville ou même à un village. Ce qui faisait dire à Voltaire que, chez nous, le voyageur changeait de lois presque aussi souvent que de chevaux. Quand le juge ignorait la coutume et que les parties n’étaient pas d’accord à son sujet, on l’établissait, grâce à la déposition de deux turbes ou groupes de dix témoins : avant la rédaction écrite des coutumes, faite à la suite de l’ordonnance de Montil-les-Tours par Charles VII, en 1453. Le droit romain servait de base à la législation, en pays de droit écrit ; mais les usages locaux et la jurisprudence des parlements l’avaient modifié plus ou moins profondément. En Bourgogne, en Franche-Comté, par exemple, il n’avait force de loi que sur les points non réglés par la coutume. Les ordonnances royales, applicables en principe à tout le pays, furent un élément d’uniformité ; néanmoins certaines restèrent sans force, dans l’une ou l’autre région, par suite du refus d’enregistrement des parlements locaux. Au droit ancien succéda le droit révolutionnaire, collection des lois faites par la Constituante, la Législative, la Convention, le Directoire et le Consulat, du moins à ses débuts. Son ère s’ouvre le17 juin 1789 et se clôt le 15 mars 1803 ; il s’inspirait des principes consacrés par la Révolution et visait à soumettre le pays à une législation uniforme. « Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume » dit un article de la Constitution de 1791 ; mais les assemblées révolutionnaires successives échouèrent dans cette entreprise. A côté des lois qu’elles édictèrent et qui furent appliquées sur l’ensemble du territoire, le droit ancien subsista avec son infinie variété pour tous les points non réglementés par les nouveaux législateurs. C’est de la rédaction du code civil, commencée en 1800 et terminée en 1804, que date le début de la législation actuellement appliquée en France. Un arrêté des consuls du 24 thermidor, an VIII, nomma une commission de quatre membres : Tronchet, Portalis, Bigot-Préameneu, Malleville, chargée d’établir les projets primitifs. Projets que l’on modifia d’après les observations de la cour de cassation et des tribunaux d’appel, pour les transformer en lois suivant les formes admises par la Constitution de l’an VIII, alors en vigueur. Rejeté une première fois par le corps législatif, à la suite d’un vœu défavorable du tribunat, le premier projet aboutit néanmoins, grâce à Bonaparte, qui tenait absolument à son adoption. Trente-six lois furent ainsi promulguées successivement, puis, en exécution de la loi du 21 mars 1804, réunies en un seul corps pour former le code civil. Ce code (voir ce mot), était divisé en trois livres : le premier, intitulé Des personnes ; le second, Des biens et des différentes modifications de la propriété ; le troisième, Des différentes manières dont on acquiert la propriété. Il comprenait trente-six titres, en tout, correspondant aux trente-six lois primitivement votées, et chacun se subdivisait en chapitres, sections et paragraphes. Une première édition officielle en fut donnée en 1804 ; une deuxième fut décrétée par la loi du 3 septembre 1807, sous le nom de code Napoléon ; une troisième, en harmonie avec le gouvernement de la royauté, résulta d’une ordonnance de Louis XVIII, du 30 août 1816. Ce fut la dernière édition officielle, celle qui continue d’être en vigueur sous la troisième république. Naturellement le code civil, qui marquait cependant un progrès sur la législation antérieure, a consacré toutes les iniquités dont nous souffrons ; il a garanti les propriétaires contre les plus équitables réclamations, placé la femme en tutelle par rapport au mari, méconnu les droits de l’enfant naturel, assuré le triomphe définitif du veau d’or. Son complément, le code de procédure civile, fut voté en 1806, et devint obligatoire à partir du 1er janvier 1807 ; le code de commerce, voté en 1807, devint obligatoire l’année suivante. Code pénal et code d’instruction criminelle datent, le second de 1809, et le premier de 1810 ; ils n’entrèrent en vigueur qu’en 1811 ; on y trouve la liste des infractions, les règles relatives à leur poursuite et les pénalités qui les frappent. D’autres codes ont paru depuis : forestier, de justice militaire, rural, du travail et de la prévoyance sociale.
A côté du code il y a place, dans la législation, pour des lois qui le complètent ou qui l’abrogent ; leur nombre est tel qu’un seul individu ne parviendrait pas à les connaître toutes, même en étudiant sa vie entière. On voit combien plaisante la règle qui déclare :
« Nul n’est censé ignorer la loi. »
Cette dernière consiste dans la déclaration expresse d’une autorité compétente, d’après la Constitution, et qui règle d’une manière générale une série indéfinie de relations juridiques. Autrefois confondus dans les mains d’un monarque absolu, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont, d’ordinaire, confiés à des organes différents chez les peuples modernes. Montesquieu voyait dans cette séparation des pouvoirs une garantie contre l’arbitraire gouvernemental ; nous constatons, hélas, quotidiennement qu’elle n’arrête ni les ministres ni les juges dans leur lutte contre les esprits indépendants. Certaines autorités administratives disposent d’ailleurs du pouvoir réglementaire qui s’appellerait plus exactement pouvoir législatif ; enfin les actes gouvernementaux prennent parfois le titre significatif de décrets-lois. Œuvre de l’Assemblée Nationale, les lois constitutionnelles sont votées et abrogées par elle seule, en France ; le pouvoir législatif ordinaire appartient au Sénat et à la Chambre des députés. Sauf en ce qui concerne les finances, un projet de loi peut être présenté en premier lieu devant l’une ou l’autre Assemblée indifféremment ; mais les deux doivent le voter en termes concordants pour qu’il obtienne force légale. Pour devenir exécutoire la loi doit être promulguée par le président de la République ; il est d’ailleurs obligé de le faire et peut seulement exiger une nouvelle délibération des Chambres. Cette promulgation est portée à la connaissance du public par l’insertion au Journal officiel ou au Bulletin des Lois ; après expiration d’un délai prétendu suffisant pour que ces recueils parviennent aux mains des particuliers, la loi est désormais obligatoire. Elle sera abrogée, soit d’une façon expresse par une déclaration du législateur, soit d’une façon tacite lorsqu’elle s’avère incompatible avec une loi plus récente. Quant au pouvoir réglementaire, il est exercé par le maire dans sa commune, par le préfet flans son département, par le président de la République sur l’ensemble du territoire.
La coutume n’occupe qu’une place très effacée dans notre législation ; elle ne crée de règles nouvelles que dans un domaine restreint, lorsqu’il s’agit de matières où l’on doit tenir compte de la diversité locale, et dans l’interprétation des conventions où les parties ne s’exprimèrent pas clairement. Mais l’ensemble des codes et des lois, décrétés par les gouvernements successifs, constitue un réseau aux mailles si serrées que l’individu est littéralement étouffé par ce monstrueux appareil. Après une période où la liberté fut, sinon bien comprise, du moins très prônée, l’Etat est redevenu le dieu par excellence, le Souverain bien ; l’individu n’existe qu’engrené, qu’intégré dans lui, son âme particulière ne doit être qu’un reflet de l’âme collective. Non seulement l’Etat peut faire tout ce qu’il veut, mais il doit tout faire et tout penser ; c’est la société qui nous permet de devenir ce que nous sommes, des êtres instruits et civilisés, des hommes non des animaux, disait en substance Auguste Comte, aussi n’avons-nous à son égard que des devoirs, alors qu’elle dispose contre nous de tous les droits. A la société obéissons donc, passivement, aveuglément, comme les membres obéissent au cerveau qui les commande et les dirige ; car l’individu n’est qu’une abstraction, seules existent les collectivités ! Izoulet fera même de ces dernières des animaux à part, les hyperzoaires ; et Durkheim, remplaçant le vieux Jahveh par l’Etat, proclamera que seul est moral ce qui est social. Naturellement les chefs deviennent les pontifes du nouveau dieu, et, comme ceux de Jésus, ils exigent le respect des multitudes prosternées. Inutile d’ajouter que les fidèles du culte sociologique se recrutent, en général, parmi les bien-casés ou parmi ceux qui espèrent l’être ; Durkheim trônait en Sorbonne, dictateur accrédité par la république pour la nomination des professeurs de philosophie dans les facultés. Cette superstition étatiste, elle est à la base du fascisme ; et, malheureusement aussi, du bolchévisme russe, que nous défendons bien volontiers contre les critiques intéressées du capitalisme, mais dont le mépris pour la liberté des individus ne cadre point avec l’idéal d’humaine fraternité, qui est nôtre. Elle constitue le côté faible des doctrines socialistes admises par beaucoup aujourd’hui ; le législateur n’a point la toute-puissance qu’on lui prête, et c’est méconnaître la valeur des individus, de les réduire au rôle de rouages impersonnels dans une administration devenue mécanique.
Très instructives à ce sujet paraissent les institutions du vieux Pérou ; elles réalisèrent, sous des formes primitives assurément, un état social que nos capitalistes déclarent impossible et qui pourtant subsista, dans ce pays, jusqu’à l’arrivée des Espagnols. Pris en tutelle de la naissance à la mort, par un état despotique mais tutélaire, l’individu était à l’abri des accidents et du besoin, à condition d’obéir et de travailler. On ne l’accablait point, n’exigeant, même dans les mines, qu’un travail proportionnel à ses forces. Le sol, propriété de l’Inca, vivante incarnation de l’Etat, était divisé en trois parts, l’une pour les prêtres, l’autre pour l’Inca, la troisième, répartie chaque année en lots de même valeur, pour le peuple qui cultivait l’ensemble. Marié obligatoirement avec une parente, à l’âge de vingt ans, le jeune homme obtenait un lot qui grandissait ou diminuait avec le nombre des enfants. Défense de changer de séjour ou d’abandonner la profession héritée des parents ; on devait aider ses voisins et prendre part aux travaux d’utilité publique. Les ouvriers réquisitionnés par l’Etat étaient entretenus à ses frais ; les femmes tissaient des vêtements chauds pour les montagnards et d’autres plus légers pour les habitants des plaines. Crime capital, l’oisiveté n’était pas tolérée même chez les enfants ; les vieillards impotents entretenus par la collectivité, s’occupaient à de menues besognes. On n’abandonnait ni les infirmes, ni les veuves ; de grands dépôts de provisions garantissaient le peuple contre la famine ; des jours de fête bien répartis permettaient un repos suffisant. La loi de l’offre et de la demande était inconnue, il n’y avait ni impôts, ni commerce. A la base, la population était répartie en groupes de dix, surveillés par un dizainier ; cinq dizaines donnaient une cinquantaine, deux cinquantaines une centaine, puis venaient des groupes de cinq cents et mille habitants, tous dotés d’un surveillant responsable. Des districts cantonaux de dix mille âmes avaient à leur tête des parents de l’Inca ; enfin la capitale, Cuzco, était divisée en quatre sections, orientées d’après les points cardinaux, et répondant à des circonscriptions qui englobaient l’ensemble de l’empire ; les quatre vice-rois chargés de leur administration formaient le conseil de l’Inca. Tout aboutissait au gouvernement central et tout en émanait ; le Pérou n’était qu’une immense usine surveillée par des contremaîtres ; aucune place, nulle part, pour la liberté individuelle. Le Mexique avait eu une organisation analogue, de nombreux vestiges l’attestaient ; mais l’avidité des rois, puis des nobles, lorsque le régime féodal eut succédé à la centralisation monarchique, finit par écraser les petits. Un fisc impitoyable vendait comme esclaves ceux qui ne pouvaient lui donner satisfaction ; les corvées devinrent excessives, le travail quotidien épuisant. Néanmoins une part des taxes en nature servait encore à l’entretien des vieillards et des pauvres. Ajoutons qu’au Paraguay les Jésuites imitèrent avec succès les institutions péruviennes ; mais, remplissant le rôle de l’Inca, ils en tirèrent d’énormes richesses pour leur congrégation. Une telle organisation n’est possible que chez des peuples jeunes, qui ignorent tout de la liberté ; la vie régulière, le confort qu’elle procure, ne sont point désirables, lorsqu’elles ont pour complément obligatoire une chaîne et un collier. Simples troupeaux que l’on parque et pousse à volonté, que l’on ménage parfois pour en tirer un plus grand profit, les peuples ne sont alors que des amas grégaires de bêtes domestiquées. Dépourvus d’initiative, habitués à obéir, Péruviens et Mexicains furent une proie facile pour les aventuriers venus d’Europe. Souhaitons que la Russie fasse une place suffisante à l’individualisme pour ne point subir le même sort ; et que ses guides, poussant au delà du marxisme, préparent l’avènement d’une ère de liberté. Sa législation contient des innovations heureuses ; rendons-lui justice, sans oublier que l’étape qu’elle représente, dans le devenir humain, doit nécessairement être dépassée. Comme celle de France et des autres pays, elle a d’ailleurs le tort de répondre seulement aux desiderata des dirigeants, rouges en Russie, roses en Angleterre, blancs en Italie, mais tous persuadés que le populaire leur doit obéissance. Fausse croyance, qui fonde leur empire, mais que dément la raison. Puisse un jour l’humanité devenue sage reléguer, au musée des antiquailles, l’attirail des lois immondes qui la ligotent depuis si longtemps.
-L. BARBEDETTE
QUELQUES OUVRAGES TRAITANT DE LA LÉGISLATION :
-
De la législation ou Principe des lois (abbé de Mably, 1776, un des précurseurs de la Révolution). Il voulait que la législation s’inspirât de l’égalité naturelle. Pour lui la propriété n’est point la cause de la réunion des hommes en société ; la nature les invitait à la communauté des biens, et la communauté des biens fut la condition des premières sociétés humaines. Il s’attaquait à l’avarice et à l’ambition comme étant les plus grands obstacles à l’équité et rappelait qu’ « on fait trop peu d’attention aux intérêts de cette multitude qu’on appelle la populace ». Selon lui des lois véritablement utiles s’affermiraient avec le temps, à l’encontre de celles qui consacrent le caprice ou le préjugé, « si la puissance législative ne concourait elle-même à les affaiblir par sa mauvaise conduite ». Mais la hardiesse théorique de Mably se fond, dans la pratique, en mesures timides et contradictoires, en vagues exhortations au législateur.
-
De la science de la législation (Filangeri, 1780) vaste ouvrage inachevé, qui traite des règles générales de la législation et des lois politiques et économiques, dans un esprit libéral et positif. Il se rencontre souvent avec Montesquieu (Voir loi : Esprit des lois).
-
Législation primitive, etc. (de Bonald, 1802). Le chef de l’école théologique au XIXème siècle a écrit en épigraphe : « Un peuple qui a perdu ses mœurs en voulant se donner des lois écrites s’est imposé la nécessité de tout écrire, et même les mœurs ». Parmi des aperçus sur la philosophie et le droit, il essaie de fixer, en Dieu, la souveraineté générale et aboutit à accorder au clergé la prépondérance dans le gouvernement des choses d’ici-bas.
-
Traité de Législation (Ch. Comte, 1826), dans lequel l’auteur, procédant analytiquement, s’attache à rechercher « quelles sont les causes qui font prospérer ou dépérir un peuple, ou qui le rendent stationnaire ». Il fait la démarcation entre les actions qui ont leur sanction intérieure de plaisir ou de peine et celles qui sont du ressort de la législation et, avec Bentham, dont il admet le principe de l’utilité, réduit, au profit de la morale, le domaine de la législation. « L’inégalité entre les individus, dont un peuple se compose, conclut-il dans son 4ème livre, est une loi de leur nature ; il faut, autant qu’il est possible, éclairer les hommes sur les causes et les conséquences de leurs actions ; mais la position la plus favorable à tous les genres de progrès est celle où chacun porte les peines de ses vices, et où nul ne peut ravir à un autre le fruit de ses vertus ou de ses travaux ».
-
Traités de Législation civile et pénale (d’après les manuscrits de J. Bentham par E. Dumont, 1830). Y sont étudiés les principes généraux de la législation, des codes civil et pénal, la promulgation et la raison des lois, l’influence des temps et des lieux en matière de législation, avec une vue générale d’un corps complet des lois. Bentham fixe les buts de la législation et délimite ses immixtions. Il y introduit son calcul des biens et des maux qui donne aussi, en matière pénale, le caractère du délit. Le principe de l’utilité ou de l’intérêt bien entendu, qui sert de base à sa morale (voir ce mot) s’applique aussi à la législation. L’auteur, par généralisation systématique, lui accorde quant au problème de la propriété, par exemple, un critérium abusif et justifie par lui l’iniquité : « Oter arbitrairement à celui qui possède pour donner à celui qui ne possède pas, dit-il, ce serait créer une perte d’un côté et un gain de l’autre ; mais la valeur du plaisir n’égale pas la valeur de la peine ».
-
Histoire de la Législation française depuis Hugues Capet (G. Schæffner, 1850), tableau érudit de l’état législatif de la France et de ses provinces, féodalité, royauté, etc, puis examen des sources du droit, de la procédure, etc., jusqu’aux codes de l’époque impériale.
LEGISTE
n. m. (de lex, legis, loi)
Celui qui connaît, qui étudie des lois. « De leur application aux lois dont ils se firent un métier, ils furent appelés légistes » dit Saint-Simon. La multiplication des légistes atteste l’importance de l’appareil législatif, son étendue, sa complexité. Elle souligne quelle place occupent dans les sociétés humaines ces constructions superfétatoires, et nocives au surplus, que sont les législations successives. « Il n’y a pas, disait Piron, de marque plus certaine de la mauvaise constitution des cités que d’y voir beaucoup de légistes et de médecins ». En effet, comme l’hygiène à l’individu, une ordonnance logique manque au corps social, et tous deux réclament la charge de soins qui les tuent...
Les légistes ont joué un grand rôle dans l’affermissement du pouvoir royal. Ils en ont, par leurs justifications, légitimé le principe et consolidé les assises. Imitant les glossateurs de l’Ecole de Bologne qui, à ceux de l’ancienne Rome, assimilèrent les empereurs d’Allemagne, les légistes appliquèrent, chez nous, les mêmes textes au roi de France « empereur dans son royaume » Ils détournèrent au profit du roi, « souverain fieffeux », certaines prérogatives féodales, en firent le représentant de l’intérêt supérieur du bien public... Autant par leur habileté que par le prestige des armes, du domaine et de la hiérarchie, l’autorité royale se trouva reconstituée vers la fin du XVème siècle. Il n’y manquait plus que la couronne de « droit divin » que lui réservait l’Eglise.
LÉGITIME
adj. (latin legitimus, de legis, loi)
Qui a les qualités, les conditions requises par la loi ; qui est fait conformément aux prescriptions des lois (voir loi). Ceux qui emploient ce terme y enferment souvent le sens de juste.
Chateaubriand dit :
« Il n’y a point de pouvoir légitime sans liberté. »
Il conçoit ainsi un pouvoir qui s’exerce seulement sur ceux qui l’acceptent librement. Or tout pouvoir s’impose à quelqu’un, au nom de quelqu’un ou de quelque chose. S’il y avait — pour celui à qui on impose quelque chose — réellement liberté, il n’y aurait pas de pouvoir, ou seulement, en l’occurrence, un emploi abusif du terme. D’ailleurs, liberté suppose connaissance et conscience. En présence de ces deux facteurs se dessine justement la contestation de la légitimité du pouvoir. La reconnaissance du pouvoir et l’appui qui lui est donné s’entourent seulement des apparences de la liberté. De telles confusions ne sont au fond possibles que parce qu’on assimile, à tort, la loi à la justice.
Quand Taine dit : « Nulle autorité n’est légitime que par le consentement du public », s’il prend le public en bloc il peut certes s’exprimer ainsi, à la condition d’ailleurs d’identifier lui aussi légale et légitime et d’accorder à l’autorité des vertus de fait, sinon un blanc-seing de droit. Mais s’il entend : les individus composant le public, cette assertion s’effrite à l’analyse. D’une part, Taine, comme Chateaubriand, se contente ici de la fausse harmonie de l’acquiescement passif qui revêt parfois les dehors du vouloir éclairé. Et consentement ne peut être justification. Il est d’autre part évident qu’il y aura toujours, en fait, une minorité pour ne pas accepter cette autorité et, en justice, des arguments pour la condamner, d’où il appert qu’il n’y a pas, sur le terrain de l’équité et de la raison, d’autorité légitime. Trop souvent nous voyons comme disait Lamartine, « les forfaits couronnés devenus légitimes ». La force est par excellence celle qui légitime, et les préjugés et la peur soutiennent son empire. Chateaubriand, Taine et tant d’autres auraient pu méditer cette pensée de Boiste :
« C’est tuer la justice avec son glaive que de dire : ce qui est établi est légitime ; il n’y a de légitime que ce qui est juste... »
Légitime se dit de l’union conjugale consacrée par la loi, et des enfants qui naissent de cette union : mari, époux légitime, fils légitime (voir mariage, union libre, etc.).
On voit ici, ce que le « légitime » a à voir avec la raison, la logique ou la liberté, ou le libre consentement public. Un homme et une femme sont unis par leur amour et leur estime réciproques ; leur cerveau a les mêmes aspirations, leur chair appelle leur chair. Tout simplement, ils vivent l’un près de l’autre : leur union est illégitime.
Mais le bonhomme est vieux, usé, pourri de vices, esprit vil et cœur de pierre. Il a des « sous ». Elle, est jeune, belle, mais pauvre ; ou bien elle a des besoins que sa fortune ne lui permet pas de satisfaire. Pour ses « biens » elle épouse le vieux, accepte ses caresses, lui vend son corps et son geste d’amour. Seulement, elle a pris une garantie, elle s’est mariée ; elle a été se faire inscrire à la mairie. Elle n’est pas en carte, mais en livret, le livret de mariage. Sans cette inscription, elle n’est qu’une « fille de joie » et il n’est qu’un « vieux marcheur » ; leur union est illégitime et sévèrement jugée. Par contre, s’ils légalisent leur vie commune, leurs rapports fussent-ils monstrueux, disparate leur accouplement, leur liaison entachée de tares évidentes, leur union est légitime, la morale estompe leurs vices, la loi protège leurs « amours »...
Mais, du contact de ces deux êtres, des enfants sont nés. Pauvres petits êtres souvent indésirés que l’ignorance des parents a seule jetés dans la vie.
L’enfant de l’amour, appelé du fond de l’instinct, le fruit d’une tendresse réciproque, procréé dans les meilleures conditions de santé morale et physique : enfant illégitime, bâtard. Dès sa naissance, il est marqué au front : de père inconnu.
L’enfant du plus sordide marché, celui du deuxième couple, la société le reçoit avec tous les honneurs ; il est : l’entant légitime. Celui-ci a un père et il portera son nom. Comme si l’enfant, quelle que soit sa naissance, n’avait pas toujours un père et une mère ! Vieux relents de christianisme qui empoisonnent encore le vingtième siècle...
De grands esprits, des penseurs généreux, ont proposé de rayer des lois « le péché originel » en faisant tous les enfants égaux et en leur donnant le nom de leur mère. Des cœurs se sont émus, d’autres se sont révoltés ; et contre la loi, en dehors des lois, la grande cause humaine de l’amour libre et de la libre maternité est partout entendue et sonnera bientôt le glas du mariage, cette prostitution officielle. Il n’y aura plus alors d’enfants légitimes ou illégitimes, mais des amants et des enfants aimés.
-
Qui se fait régulièrement et naturellement : Tirer des conséquences légitimes des faits allégués ...
-
Juste, permis, licite, fondé en raison : Une colère légitime, un légitime espoir.
Quand les dictionnaires, pour définir un mot, accolent : juste à : « permis, licite, fondé en raison », sans souligner l’abus du langage courant, on ne sait ce qu’il faut admirer le plus de leur manque d’esprit critique ou de leur servilisme vis-à-vis du pouvoir et des grands. En effet, si, en théorie, le licite, le permis, doit être toujours juste et fondé en raison, dans la pratique, ce qui est licite, permis, est toujours injuste envers quelqu’un, irraisonnable. Le prouvent d’ailleurs ces citations du Larousse :
Ce qui semblait d’abord ne se pouvoir sans crime. (CORNEILLE)
Quiconque a pu franchir les bornes légitimes
Peut violer enfin les droits les plus sacrés. (RACINE)
La vertu n’exclut point une ardeur légitime
Quel cœur est innocent si l’amour est un crime. (GRESSET)
-
En politique : Se dit en France des princes de la famille des Bourbons, que leurs partisans — légitimistes — considèrent comme ayant droit au gouvernement de la France. Avec les Orléanistes et les Bonapartistes, les légitimistes parlent encore le vieux langage des siècles écoulés. Paix à leurs cendres !
-
En jurisprudence : légitime défense, droit de se défendre contre un agresseur, sans égard aux conséquences qui peuvent en résulter pour ce dernier.
-
Pathologie : Se dit des maladies qui suivent le cours normal, prévu dans les traités médicaux : fièvre légitime.
-
Subst. masc. : Ce qui est légitime. « Dans les sociétés bien constituées, le légitime se confond avec le légal, et la loi locale avec la loi générale » (de Bonald). Dans les sociétés bien constituées, c’est le légal qui devrait se confondre avec le légitime, mais nous savons que jamais le légal ne peut être : le juste.
-
Subst. fém. : Portion que la loi donne à certains héritiers présomptifs dans des biens qu’ils auraient recueillis en totalité, sans les dispositions faites par le défunt à leur préjudice : Légitime des descendants, des ascendants. Ce terme du vieux droit français n’est plus guère usité et est remplacé par : réserve.
— A. LAPEYRE
LÉGUMISTE
(Voir végétarisme, végétalisme, etc.)
LÉNINISME
(Voir bolchevisme, communisme, marxisme, socialisme, soviets, etc.)
LÉNITIF (IVE)
adj. (lat. lenitivus, de lenire, adoucir)
Un lénitif est ce qui calme et adoucit, ainsi le miel par exemple. Ce terme fort utilisé en médecine s’applique dans le langage courant, à tout ce qui pacifie, tout ce qui atténue les différends, amoindrit les susceptibilités ou met du baume sur les plaies soit physiques, soit morales. Certaines personnes exercent naturellement une influence lénitive comme d’autres, sans même s’en rendre compte : blessent et irritent quiconque les approche. On recherche les premières, on fuit les secondes, vrais buissons épineux dont les fleurs mêmes sont entourées de piquants. Néanmoins gardons-nous des chattemites dont les gants de velours cachent des griffes bien aiguisées ; un ami, dont la franchise est brutale et déplaisante, vaut mieux qu’un flatteur qui, vous voyant côtoyer un gouffre, se garde de vous avertir. Eviter à autrui toute douleur inutile, mais sans vaine faiblesse et sans craindre la lutte lorsqu’elle est nécessaire, voilà probablement la meilleure attitude.
Comment n’être pas révolté par l’hypocrisie doucereuse du prêtre qui, par calcul, fait sienne la maxime de saint François de Sales : « On prend plus de mouches avec du miel qu’avec du vinaigre ». Assurément, les croyants sont des mouches de la plus sotte espèce généralement, et n’ayant aucun des mérites de l’abeille ; nous comprenons que le clergé les exploite, mais il nous répugne que ce même clergé place son exploitation sous l’enseigne du crucifié Jésus. Et notre indignation atteint son comble quand nous voyons les prêtres dresser des listes noires, qui seront communiquées discrètement aux patrons, aux propriétaires, aux politiciens bien pensants, à l’ombre du confessionnal, en persuadant les faibles d’esprit qu’ils iront rôtir en enfer s’ils ne dénoncent les mécréants. Pascal a flétri, dans les Provinciales, les procédés utilisés par les Jésuites afin de capter la confiance des souverains. Un père La Chaise n’hésitait pas à fournir de maîtresses Louis XIV, son royal pénitent, et presque tous les confesseurs des rois firent de même. Dieu, à les entendre, donnait toute licence aux têtes couronnées à condition qu’elles se laissent conduire par les disciples de Loyola. Défions-nous donc des gens qui, selon le proverbe populaire, sont trop polis pour être honnêtes. Ne soyons pas grincheux ; ne soyons pas flatteurs non plus. Ajoutons que les premiers sont plus nombreux que les seconds, en général, dans les milieux d’avant-garde.
LÉONIN(INE)
adj. (latin leoninus, de leo, lion)
Qui a rapport, qui appartient au lion, qui est de sa nature ou lui ressemble par quelque trait, par son caractère ou ses qualités : rugissements léonins ; tête, vigueur, mœurs léonines. En jurisprudence, signifie abusif, fondé sur le seul droit de la force. Se dit d’un partage, d’un marché où quelque stipulation réserve à une ou à plusieurs personnes favorisées la part du lion (allusion à l’apologie des animaux vivant en société avec le lion). Cette expression n’est guère usitée que dans les locutions : société léonine, contrat léonin, part léonine, que la clause ou les conditions visées soient formulées ou seulement tacites.
Ce sont justement ces acceptions qui nous incitent à nous étendre ici davantage. En effet, ce n’est pas seulement au point de vue individuel que se pratiquent dans la plupart des cas, les contrats, les marchés, les partages léonins, mais c’est encore au point de vue collectif. L’organisation actuelle de la société n’est-elle pas basée sur l’accaparement léonin des richesses de la terre par une classe d’individus aux dépens d’une autre classe ?
C’est le contrat social qui est véritablement un contrat léonin. Tout le système de la propriété reposant sur l’exploitation de l’homme par l’homme s’apparente en son esprit avec, çà et là, des formes insidieuses, au raisonnement brutal du roi des animaux s’arrogeant, de par sa force, le droit à la proie la plus belle, au plus riche butin.
Il a donc fallu qu’à quelque moment, appuyés sur la ruse ou la brutalité, des hommes s’affublassent de la peau du lion pour persuader aux autres bêtes humaines qu’elles devaient s’incliner, trouver même équitable ce marché de maître à serviteur, un contrat de dupes. Mais à aucune époque les intéressés — esclaves, serfs, prolétaires — n’ont pu consentir en connaissance de cause et en toute liberté les conditions de travail et de vie qui comportent ce caractère léonin. Les nécessités vitales, compliquées de faiblesse et d’ignorance, l’absence d’une cohésion intelligente qui seule leur eût permis de résister à des empiètements tyranniques, leur ont fait à travers le temps une sorte d’obligation d’accepter des clauses qui consacrent leur infériorité. D’autre part la bourgeoisie, groupe social actuellement bénéficiaire de ce contrat, s’efforce d’en justifier l’existence, de l’abriter sous des principes moraux, de lui donner une armature légale inébranlable. Et c’est à en discuter la valeur, à en contester le principe, à en dénoncer l’arbitraire, à mettre en relief sa nocivité que visent les critiques socialistes, communistes, anarchistes.
Des utopistes ont opposé à ce système choquant par trop les principes les plus simples de liberté, d’égalité et de fraternité des systèmes plus en accord avec la justice sociale, sans parvenir à changer quoi que ce soit dans le désordre actuel des choses et dans le désaccord perpétuel des hommes entre eux. C’est qu’il est aussi difficile de faire admettre à un parasite, à un bénéficiaire de « l’ordre » social actuel, l’illégitimité de sa situation favorisée, qu’il est malaisé de faire lâcher prise au lion, campé sur son butin sanglant. Tout possédant, conscient ou non de la frustration qui est la base de son bien quand ce bien est le résultat du travail de ses semblables, défend ce bien férocement. L’accapareur, le profiteur, l’exploiteur, en un mot le voleur du bien d’autrui, s’appuyant sur « le Droit, la Légalité, la Justice », repousse tout raisonnement et se cramponne à son morceau de roi. Il crie « à la garde ! » si on conteste le bien-fondé de ses prétentions à la propriété qu’une législation millénaire a habilement consacrées.
Avant la Révolution du Tiers-Etat, ce qu’avaient monopolisé Roi, Nobles, Clergé, était de toute évidence privilège et accaparement. Et la révolte des spoliés consignant dans les Droits de l’Homme une reprise solennelle, était venue à point pour remettre les choses en place. Cela le bourgeois, héritier de 89, l’admet. Mais nanti à son tour de ce qui fut justement arraché à l’Ancien Régime, il n’admet pas qu’on lui dise aujourd’hui que sa classe doit rendre aussi ce qui ne lui appartient pas. Il ne veut pas croire (ou il feint d’ignorer) que la fortune acquise l’est toujours aux dépens du pauvre et que nul ne peut jouir de l’oisiveté sans que ce soit aux frais des besogneux.
Les « Lions » de la société actuelle devront tôt ou tard, bon gré mal gré, se rendre à l’évidence et accepter la résiliation du contrat léonin dont ils bénéficient. Les autres animaux que sont les producteurs exploités ne seront pas toujours obtus et résignés... Déjà, n’ont-ils pas osé discuter leur état. Il ne faudra qu’un sursaut de révolte collective comme en sont capables les travailleurs quand ils sont organisés et qu’ils ne suivent pas de mauvais bergers, pour arracher le contrat, le détruire et imposer une forme nouvelle de société basée sur la production équitablement organisée pour les besoins de tous.
— G. Y.
LETTRE
n. f.
L’étymologie de ce mot est incertaine. Il viendrait de littera (caractère d’écriture), de lictera (du radical sanscrit likh, graver, écrire), de linea (ligne) ou de linere, litum (enduire). Il désigne chacun des caractères qui composent l’alphabet dans sa forme, sa dimension, sa couleur, chez ceux qui emploient ce mode d’écriture pour la représentation du langage articulé. L’emploi des lettres, pour écrire les mots, est guidé par 1’orthographe.
« Otez de notre écriture les lettres que nous ne prononçons pas, vous introduirez un chaos en l’ordre de notre grammaire, et ferez perdre la connaissance de l’origine de la plus grande partie de nos mots. » (Livet)
Les caractères employés pour l’écriture du langage musical sont appelés notes.
Le mot lettre désigne aussi ce qui a un sens littéral, étroit, renfermé dans un texte. Considérer une chose au pied de la lettre, c’est la voir exactement dans le sens rigoureux du mot. Juger selon la lettre, c’est s’en tenir à ce qui est écrit. Aider à la lettre, c’est interpréter en expliquant le sens. Ajouter à la lettre, c’est élargir le sens et aller au-delà. Suivant les circonstances, il convient de préférer l’esprit à la lettre. « La lettre tue et l’esprit donne la vie », a dit saint Paul, interprétant la prétendue loi divine ; mais lettre et esprit ont été si souvent falsifiés, surtout sur les questions divines et dans les buts les plus contradictoires bons et mauvais, qu’il est impossible de s’y reconnaître. Comme l’a dit Voltaire à propos de l’emploi des signes du langage :
« L’univers fut abruti par l’art même qui devait l’éclairer. »
L’incertitude de l’étymologie du mot lettre est d’autant plus singulière que ce mot suppose en certains cas une absolue précision. Ce qui est non moins singulier, c’est que les hommes n’ont pas trouvé de nom à la réunion des lettres ou caractères du langage.
« Comment s’est-il pu faire, a dit Voltaire, qu’on manque de termes pour exprimer la porte de toutes les sciences ? La connaissance des nombres, l’art de compter, ne s’appelle point : Un-deux. ».
Les Grecs ont dit : alpha, bêta, etc... et du son des deux premières lettres de leur langue on a fait alphabet. Nous disons : l’a. b. c. Certains allant jusqu’à d ont fait abécédaire. On peut aller ainsi jusqu’à l’oméga des Grecs qui est le z français. A défaut d’un mot ayant un sens, on a appelé alphabet la réunion des lettres d’une langue disposée suivant une énumération conventionnelle. L’alphabet est la première partie de la grammaire ; la connaissance des lettres qui le composent est l’élément essentiel de celle du langage.
Les lettres, ou signes du langage d’après l’énumération alphabétique, auraient été trouvées par les Phéniciens qui les auraient transmises aux Grecs. Du grec est dérivé l’alphabet des latins employé aujourd’hui par leurs descendants (France, Espagne, Portugal, Italie, Roumanie), par les Scandinaves, les Germaniques et quelques autres peuples dont les langues sont étrangères à la famille indo-européenne. Les Hébreux avaient reçu aussi des Phéniciens leur alphabet. Ils le transformèrent peu à peu pour composer l’araméen. L’ancien alphabet phénicien n’a été conservé chez eux que par les Samaritains, d’où son appellation actuelle d’alphabet samaritain. L’Inde possède des alphabets. Ils sont dérivés de l’araméen et du grec par l’indo-bactrien. La Perse a un alphabet sorti de même de l’araméen, où sont conservées des traces égyptiennes. L’araméen a également produit les variétés arabes. D’autres très nombreux alphabets se sont formés sous des influences plus ou moins obscures et mélangées. Il n’y en aurait pas moins de cinquante-sept pour écrire les seules langues turques.
La parenté des signes de l’écriture ne comporte nullement celle du langage : mais comme les hommes ne peuvent émettre, quelle que soit leur langue, qu’un nombre déterminé de sons, il en résulte que les mêmes signes pourraient, à peu de choses près, servir aux besoins de toutes les langues. L’alphabet a rendu extrêmement aisée l’expression écrite du langage en réduisant ses signes à vingt-deux lettres dans l’italien, vingt-quatre dans le grec, vingt-cinq dans le latin, vingt-six dans le français, l’anglais et l’allemand, vingt-sept dans l’espagnol. Les peuples qui n’ont pas d’alphabet et ont des signes pour chaque mot, ont une écriture extrêmement compliquée, dont la vulgarisation est à peu près impossible. C’est ainsi que ces signes dépasseraient chez les Chinois le nombre de quatre-vingt mille ! Dans l’ancienne Egypte, il y avait autant d’écritures que de castes. On comprend les difficultés linguistiques qu’il y a pour s’entendre, non seulement entre ces peuples, mais aussi entre gens du même peuple.
Les lettres ont des formes très variées dans l’écriture.
On les a beaucoup réduites depuis l’invention de l’imprimerie et l’usage courant de l’écriture développé par l’instruction. Mais aux temps où les livres n’existaient qu’en manuscrits, c’était un art important, chez leurs copistes, de multiplier la variété des lettres et de leurs ornementations. Il y avait les lettres armoriées, les lettres en broderie, les lettres capitulaires, les lettres en chaînettes, en treillis ou en mailles, les lettres tressées, entrelacées, enclavées ou éparses, les lettres de forme, de marqueterie ; les lettres onciales, les plus anciennes, qui remontent au temps des premiers Ptolémée ; les bénéventines, les pisanes, les lettres perlées, ponctuées, solides, tondues, barbues, tourneuses, tranchées, et une foule d’autres oubliées. Aujourd’hui, l’imprimerie emploie les lettres majuscules, capitales, ornées, blanches, grises, tranchées, à queue, etc... Les lettres de l’écriture alphabétique ont des formes diverses propres à chaque peuple. La forme la plus courante en Europe est celle de l’écriture latine. Les Allemands ont encore la forme gothique qu’ils abandonnent peu à peu après les Scandinaves. Il y a en outre les écritures arabe, grecque, russe, asiatiques.
On appelle encore lettre une communication par écrit adressée dans certaines circonstances à des personnes éloignées : lettre de faire-part, de condoléances, d’introduction, de recommandation, circulaire, etc... Dans le commerce, on fait usage de la lettre de change, la lettre de crédit, la lettre de gage, la lettre d’avis, la lettre de voiture, la lettre d’offre de service, etc...
La lettre est aussi la correspondance particulière entre personnes, sous forme d’épître, de missive. Elle est le genre épistolaire dans les Belles-Lettres (Voir ce mot).
Sous l’ancien régime d’avant 1789, un très grand nombre d’actes législatifs, de jurisprudence et de chancellerie, étaient appelés lettres royaux (de l’ancien pluriel royaux qui était le même pour le masculin royal et pour le féminin royale). Il y avait, entre autres, les lettres de cachet qui servaient à différents usages, mais surtout à envoyer les gens en prison, sans jugement, selon le bon plaisir des monarques ou de leurs favoris. Saint-Foix, montrant que les inventions malfaisantes ont été dues souvent à des gens d’église, a écrit dans ses Essais historiques sur Paris : « Un moine inventa la poudre à canon ; un évêque les bombes ; un capucin, le père Joseph, imagina les espions soudoyés par la police et les lettres de cachet ». Voltaire déplorait, que tant d’assassinats religieux et tant de lettres de cachet fussent le partage d’un peuple, celui de France, si renommé pour la danse et l’opéra-comique. Diderot a dit qu’on a pu compter quatre-vingt mille de ces lettres « décernées contre les plus honnêtes gens de l’Etat sous le plus doux des ministères ». D’après l’historien Montgaillard, on en lança plus de 150.000 pendant le règne de Louis XV. Michelet a dit qu’alors : « l’essence et la vie du gouvernement étaient la lettre de cachet ». Bien qu’abolies solennellement par la Révolution française, les lettres de cachet existent toujours sous des formes déguisées. En démocratie comme au temps de Mme de Maintenon, « on est persuadé qu’elles sont nécessaires » ! (Voir : Liberté individuelle)
— Edouard ROTHEN
LETTRES (BELLES-)
On dit aussi les Lettres. Elles sont la littérature et, particulièrement, la grammaire, l’éloquence, la poésie. Ce sont les « arts de la parole » et valent par l’expression que l’art fait prendre aux mots. Cette expression s’inspire des sentiments plus que de la clarté et de la précision nécessaires aux sciences. Lorsqu’une part de sentiment se mêle aux sciences, elle les fait appartenir aux lettres. L’histoire, la philosophie, la linguistique sont à la fois des sciences et des lettres. Pendant que les sciences recherchent des connaissances nouvelles, les lettres s’occupent de répandre des connaissances acquises. Elles forment le jugement des hommes, leur servent à l’exprimer. Leur objet est tout intellectuel et moral ; celui des sciences est tout expérimental.
Avoir des lettres, c’est posséder les connaissances que procure l’étude des livres. Descartes a dit :
« J’ai été nourri aux lettres dès mon enfance, et, pour ce qu’on me persuadait que par leur moyen on pouvait acquérir une connaissance claire et assurée de tout ce qui est utile à la vie, j’avais un extrême désir de les apprendre. »
En littérature, on appelle genre épistolaire la correspondance littéraire. On dit que ce genre est le plus répandu parce que « tout le monde écrit des lettres ». C’est comme si on disait que tous ceux qui « mettent la main à la plume » font de la littérature. Leur étonnement serait aussi légitime que celui de Monsieur Jourdain apprenant qu’il faisait de la prose lorsqu’il disait :
« Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit. » (Molière : Le Bourgeois gentilhomme.)
Pour être de la littérature, la correspondance doit avoir les qualités de l’art de la parole tant par l’emploi de la langue que par le choix des expressions et des sentiments. Le genre épistolaire réclame en particulier du naturel, du tact et de la concision. Plus qu’en tout autre genre, la concision est, dans la correspondance, l’art de bien écrire, c’est-à-dire d’énoncer clairement ce qu’on a bien conçu. Il y faut plus de temps que pour écrire longuement et obscurément. Pascal terminait ainsi une de ses lettres :
« Je n’ai fait cette lettre-ci plus longue que parce que je n’ai pas eu le loisir de la faire plus courte. »
La clarté et l’aisance de la pensée, l’élégance de l’esprit, sont nécessaires dans la correspondance autant que dans la conversation. La lourdeur pédante y est aussi mal venue que l’affectation précieuse. Les deux se rencontrent souvent dans les Lettres des XVIIème et XVIIIème siècles, bien qu’ils aient été la période la plus brillante de la littérature épistolaire. Malebranche remarquait qu’ « il n’y a rien de plus ennuyeux et de plus désagréable que de philosopher par lettres », Voltaire disait :
« D’ordinaire, les savants écrivent mal les lettres familières comme les danseurs font mal la révérence. »
On n’en « pédantisait » et on n’en « philosophait » pas moins par lettre. La correspondance, facilitée par le service des postes que Richelieu avait organisé pour les particuliers, était devenue à la mode et permettait à tout le monde d’être littérateur. Quelle joie n’était-ce pas pour les Sévigné de raconter à leurs filles éloignées en province, et par elles à la « bonne société » de leur ville, des histoires de cour dont la nouvelle ne mettait plus que huit jours pour parvenir jusqu’à Marseille ! Les commérages aristocratiques de Paris et de Versailles couraient sur toutes les routes de France. Dans les petits billets comme dans les longues épîtres, on dissertait de tout : amours, potins et scandales de la cour et de la ville, littérature, religion, philosophie, sciences, etc.... Les Lettres de Mme de Sévigné et de Voltaire sont les modèles du genre épistolaire des deux siècles. Elles caractérisent le ton du badinage qu’on prenait devant tous les événements, les plus graves comme les plus insignifiants. Plus que jamais, en ce temps-là, le plaisir de dire un bon mot et d’avoir une réputation de bel esprit l’emportait sur toute autre considération. N’entendait-on pas Louis XV lui-même dire après la bataille de Rosbach où le prince de Soubise avait été battu :
« Tiens, ce pauvre Soubise ! Eh bien, il ne lui manque plus que d’être content. »
Louis XV, lui, était content de toutes les façons et il lui importait peu que la France fût ruinée par la guerre. Dans ces temps « aimables », où toutes les affaires de l’Etat tournaient à la galanterie, ce furent surtout les femmes qui illustrèrent le genre épistolaire. Ce furent avec Mme de Sévigné, Mmes de Scudéry, de Sablé, Ninon de Lenclos, de Lafayette, la présidente Ferrand, de Maintenon, du Châtelet, d’Epinay, Necker, et un grand nombre d’autres. Toutes les femmes de la cour écrivirent durant ces deux siècles, soit des Lettres, soit des Mémoires, dans le ton des « précieuses » d’abord, dans celui des « philosophes » ensuite. M. Jean Lemoine a publié en 1911–1913 les Lettres sur la Cour de Louis XIV, par le marquis de Saint-Maurice.
Au XIXème siècle, la vie nouvelle a tué peu à peu le genre épistolaire. La rapidité des communications, le télégraphe, le téléphone, les journaux qui concentrent et répandent les nouvelles du monde entier en quelques heures, ont supprimé les principaux motifs de correspondance. On est de plus en plus pressé, on a de moins en moins le temps d’écrire et surtout de bien écrire pour un échange désintéressé d’idées, pour le plaisir, et on écrit comme on vit, fiévreusement, en courant ; cinq mots sur une carte postale, illustrée d’un monument ou d’un paysage qu’on n’a pas eu le temps de regarder et sur lequel on a l’opinion interchangeable de tous les acheteurs de la carte postale. La lettre n’est plus qu’une forme employée par les littérateurs comme le roman, la nouvelle, et encore est-elle bien délaissée. La correspondance des hommes notoires n’intéresse plus que pour les renseignements historiques ou biographiques qu’elle fournit, comme document et témoignage.
Bien des écrivains ne se sont fait connaître ou n’ont révélé leur véritable caractère que par leur correspondance. Le nom de Mlle Aïssé serait demeuré inconnu sans ses Lettres Portugaises. L’impersonnalité des œuvres de Flaubert aurait toujours laissé ignorer l’auteur et sa vie si sa Correspondance n’avait montré l’homme qu’il fut. A ce point de vue les lettres des hommes du XIXème siècle, plus personnelles, plus intimes, sont plus caractéristiques que dans les siècles précédents où l’on écrivait moins pour ses correspondants que pour le public.
On dut écrire beaucoup de lettres dans l’antiquité, mais il en est peu resté. Celles qui ont été conservées n’en ont que plus de valeur. Beaucoup sont malheureusement apocryphes ; on en a attribué faussement à Socrate, Diogène, Cratès, Pythagore, Eschine et d’autres. Parmi les Lettres tenues pour authentiques, les plus importantes sont celles de Cicéron, de Sénèque, de Pline. Elles nous renseignent sur l’histoire et les mœurs de leur époque. Les Lettres d’Aleiphron renferment des détails curieux sur les différentes classes d’Athènes, celle des courtisanes en particulier. On a conservé, du IVème siècle, les Aristaneli epistolæ qui dépeignent la vie galante de ce siècle. Les Lettres de Synésius, de Libanius, de Symmaque, sont des documents importants sur les débuts du christianisme. Celles de Libanius contiennent de violentes accusations contre le vandalisme chrétien. Celles d’Ausone font connaître la vie de l’homme de lettres au IVème siècle. Celles de Sidoine Apollinaire présentent un tableau de la société gallo-romaine du Vème siècle. Il est resté des lettres d’empereurs romains, de Marc-Aurèle, de Trajan et surtout de Julien, dont l’édition complète et exacte n’a été produite qu’en 1924 par la « Collection des Universités de France ». Les lettres ont été la première forme de la littérature chrétienne. Elle a atteint immédiatement, avec celles de saint Cyprien et de saint Jérôme, une hauteur qu’elle n’a plus connue depuis. Saint Jérôme, en particulier, domine les temps troublés et barbares des premiers siècles du christianisme. Il en est peut-être le plus grand génie, sinon l’unique. Il a donné au christianisme la seule formule qui lui mérite de laisser un souvenir dans l’histoire des hommes, et cette beauté que des millions de parasites qu’il a fait vivre à travers les siècles ont traînée dans la boue mais n’ont pas réussi à effacer.
Après saint Jérôme, l’ignorance et la barbarie intellectuelle qui s’installèrent dans les mœurs supprimèrent généralement la correspondance ou la rendirent sans intérêt littéraire. Il faut arriver au XIIème siècle pour retrouver une véritable éloquence épistolaire. Les Lettres d’Abélard et d’Héloïse, de Suger, de saint Bernard, de Jean de Salisbury, de Pierre le Vénérable, de Pierre de Blois, sont celles de vrais érudits et pleines de l’effervescence d’une pensée trop longtemps comprimée. Cette effervescence se renouvela avec la Renaissance, particulièrement en Italie. Petris de Vincis et le Dante ont laissé des lettres politiques et littéraires. Les papes et les princes italiens, devenus des lettrés, avaient d’illustres correspondants. Souvent l’Arétin, « condottiere de lettres », écrivit pour eux ou contre eux. Léon X, Julien de Médicis, Lucrèce Borgia, correspondaient avec Bembo, Raphaël et Bibienne.
La Renaissance vit en France les lettres de Rabelais, de Calvin, de la reine de Navarre. En Allemagne, celles de Jean Hus que préfaça Luther. En Espagne, celles passionnément mystiques de Thérèse d’Avila.
Par la suite, les lettres se multiplièrent. Leurs auteurs et leurs sujets furent des plus divers. En France, on a la correspondance de Marie Stuart, Etienne Pasquier, Malherbe, Descartes, Voiture, Balzac, Gui Patin ; celle des littérateurs du XVIIème siècle, des philosophes du XVIIIème. Le développement des idées philosophiques fut dû surtout aux très nombreuses lettres que les encyclopédistes Voltaire, J.-J. Rousseau, Diderot, d’Alembert, Grimm, etc., échangèrent avec les plus grands personnages d’Europe.
Les hommes de la Révolution ont laissé peu de lettres. Ils ont plutôt écrit des Mémoires, quand les événements leur en ont laissé le temps. Les lettres de Mme Roland, publiées sous le titre : Lettres de Mademoiselle Philipon aux demoiselles Cannet et antérieures à la Révolution, sont dignes de ses Mémoires par le style et la noblesse des sentiments. M. G. Michon a édité, en 1924 et en 1926, la correspondance de Barnave et celle de Maximilien et Augustin Robespierre. Dans les correspondances du XIXème siècle, les lettres d’Edgar Quinet, de Michelet, de Carlyle, de Tolstoï et d’Elisée Reclus sont parmi les plus belles par l’élévation de la pensée.
En Allemagne sont remarquables les lettres de Herder, de Gœthe et de Schiller, de J. de Muller, de Humboldt.
En Angleterre, la correspondance est surtout politique et historique. On a celle, classique, de Bolingbroke, Chesterfield, Talbot, Franklin, Cromwell, Hyde, lady Montagne. Ensuite, les lettres de Thomas Moore, Hume, l’acteur Garrick, Horace Walpole, etc... Celles de lord Byron ont été traduites en français en 1911.
De nombreux ouvrages ont été écrits sous forme de lettres, tels les Epitres des hommes obscurs, d’Ulrich Von Hutten, traduites par L. Tailhade ; les Provinciales, de Pascal ; les Lettres spirituelles, de Bossuet et de Fénelon ; les Lettres persanes, de Montesquieu ; les Lettres anglaises, de Voltaire ; les Lettres sur la musique et la Nouvelle Héloïse, de J.-J. Rousseau ; les Lettres d’Italie, du président de Brosses ; les Lettres de Jacopo Ortis, d’Ugo Foscolo ; les Liaisons dangereuses, de Laclos ; les Lettres d’une inconnue, de Prosper Mérimée, etc...
— Edouard ROTHEN
LETTRES (GENS de)
Les gens de lettres, hommes et femmes, sont par définition les personnes « livrées à la culture des lettres » (Littré), celles « qui s’occupent de littérature, qui publient des ouvrages littéraires » (Larousse). Ce sont les littérateurs qui composent des ouvrages ou qui étudient ceux des autres. Mais, depuis que la littérature est devenue une industrie, le titre a été étendu à des gens vivant des besognes les plus singulières. Duclos disait déjà, au XVIIIème siècle :
« Les lettres ne donnent pas précisément un état ; mais elles en tiennent lieu à ceux qui n’en ont pas d’autre. »
Elles sont arrivées à fournir un état surtout à des gens qui n’ont aucun rapport avec elles ou qui n’en ont que pour les déshonorer.
Sur l’homme de lettres véritable, Duclos disait :
« Ce qui constitue l’homme de lettres n’est pas une vaine affiche, ou la privation de tout autre titre ; mais l’étude, l’application et la réflexion. »
Voltaire ne reconnaissait comme hommes de lettres que les lettrés. Il disait :
« Les gens de lettres qui ont rendu le plus de service au petit nombre d’êtres pensants répandus dans le monde sont les lettrés isolés, les vrais savants renfermés dans leur cabinet, qui n’ont ni argumenté sur les bancs des universités, ni dit les choses à moitié dans les académies ; et ceux-là ont presque tous été persécutés. »
Par contre :
« Faites des odes à la louange de monseigneur Superbus Fadus, des madrigaux pour sa maîtresse ; dédiez à son portier un livre de géographie, vous serez bien reçu, mais vous ne serez pas un véritable homme de lettres. »
Voltaire refusait aussi ce titre à celui qui « avec peu de connaissances ne cultive qu’un seul genre », et il ajoutait :
« Celui qui n’ayant lu que des romans ne fera que des romans ; celui qui, sans aucune littérature, aura composé au hasard quelques pièces de théâtre, qui dépourvu de science aura fait quelques sermons, ne sera pas compté parmi les gens de lettres. »
Il voyait dans l’homme de lettres le grammairien antique, dont les connaissances ne s’étendaient pas seulement à la grammaire mais embrassaient toutes les belles-lettres et même les sciences. On comprend que les voyant ainsi, il ait attribué aux gens de lettres les progrès de l’esprit humain, le développement de l’instruction, la destruction des préjugés et des superstitions. Ils étaient, à ses yeux, de son vivant, les philosophes encyclopédistes et il en séparait les « beaux esprits » dont la valeur est faite de qualité brillante plus que de connaissances.
Aujourd’hui, l’homme de lettre est devenu, comme « l’honnête homme », un personnage indéfini. Sa profession est non seulement celle des « plumitifs » de toutes sortes, mais elle s’apparente, en ce qu’elle est aussi vague et aussi louche, à celles d’ « agent d’affaires », de « chargé de mission », d’ « attaché à n’importe qui et n’importe quoi ». Elle s’agglomère particulièrement au journalisme et par lui à tous ceux qui en vivent. Si le publiciste — qui écrit sur le droit et la sociologie — a encore quelques rapports avec les lettres, le journaliste n’en peut avoir sans risquer de perdre son emploi où de n’y trouver qu’une vie misérable. La plupart des journalistes n’écrivent pas ; ils en seraient bien empêchés, et ce n’est pas leur fonction. La meilleure garantie de réussite dans cette profession est d’être illettré. L’homme de lettres qui s’y égare et qui ne rompt pas avec toute littérature, y demeure en situation inférieure et suspecte, même s’il occupe l’emploi de directeur de journal, la littérature qui se fait dans ces boutiques étant toujours subordonnée à des intérêts commerciaux qui lui sont contraires et ne se distinguent pas de ceux d’une entreprise de maçonnerie, d’une exploitation de tramways ou d’une maison de tolérance. La valeur d’un journal se juge non à la qualité de sa littérature, mais à son tirage, au cours de ses actions, à l’importance de sa participation aux fonds secrets et au rendement de sa publicité. Le métier d’homme de lettres est, grâce au journalisme, une fin pour une foule, d’aventuriers, d’escrocs, de banqueroutiers, venus de tous les milieux sociaux. Sortis de prison ou ayant réussi à y échapper, ils installent une de ces cavernes où se fabrique l’opinion sous le titre le plus ronflant qu’ils peuvent trouver et les affamés ne manquent pas pour y faire toutes les besognes. L. Tailhade a dit :
« Les jeunes hommes qui n’ont pas d’assez bonnes façons pour être valets de chambre et qui ont les mollets trop exigus pour devenir valets de pied se « mettent » journalistes. A condition d’ignorer le français, de n’avoir pas de scrupules, de ne posséder ni cœur, ni esprit, ni rognons, il n’est pas malaisé de conquérir là-dedans une soupe quotidienne. »
Grâce au journalisme, la profession d’homme de lettres va de l’Académie aux salons où M. Philibert arbore les palmes académiques au milieu de ses pensionnaires. M. Lechat, devenu directeur de journal, appelle un Anatole France :
« Mon cher confrère!... »
Les lettres font l’ornement des plus illettrés comme la légion d’honneur fait celui des plus tarés. Les deux vont d’ailleurs de plus en plus ensemble, les lettres aristocratisant la Légion d’honneur et la légion d’honneur démocratisant les lettres.
Lars et Corydon apportent au métier des lettres les aspects les plus imprévus. A côté des « bas-bleus », des « Centaures de la civilisation » (Chapus), des « Amazones », (Han Ryner), qui ne sont pas complètement dépourvues de littérature, il y a les dames de la galanterie active et retraitée. Aux temps de l’anarchisme intellectuel qui fleurissait au Jardin de Bérénice, il y avait les femmes botticellesques, échappées des brasseries et des ateliers, qui avaient appris l’esthétique en couchant, disaient-elles, avec Verlaine. On ne compte plus aujourd’hui celles qui sont deux fois de lettres, leurs amants les ayant enlevées à la machine à écrire pour les lancer au cinéma. Les retraitées prétendent continuer les traditions littéraires des Ninon de Lenclos et des Maintenon en publiant leurs Mémoires ; elles en confient la rédaction à des professionnels spéciaux qui ont appris à écrire en vidant leurs seaux de toilette.
De plus en plus, la caractéristique de la profession des lettres est d’être occupée par des illettrés. Déjà, dans son Vicaire de Wakefield, Goldsmith écrivait ceci :
« Que dites-vous de débuter par être auteur, comme moi ? Vous avez lu dans les livres que les hommes de génie meurent de faim à ce métier ; mais je puis vous montrer par la ville une quarantaine de sots qui en vivent grassement ; tous honnêtes gens, trottant dans l’ornière d’un pas égal et lourd, écrivant de l’histoire et de la politique, et fort prônés ! Des hommes, Monsieur, qui, s’ils fussent nés savetiers, auraient toute leur vie raccommodé de vieux souliers sans jamais en faire un. »
Goldsmith ne soupçonnait pas l’immense variété de types que le progrès scientifique, à défaut du progrès social, et que l’instruction bourgeoisement distribuée, amèneraient à la profession des lettres. C’est ainsi qu’on a cette classe toute spéciale de ceux qui pillent les autres et, en particulier, travaillent dans le cinéma à désosser, vider de leur substance, tripatouiller, ridiculiser les œuvres dont ils s’emparent et de préférence les chefs-d’œuvre en raison de la célébrité qui leur est attachée.
On a vu de tout temps des rapetasseurs tirer, pour le roman-feuilleton, des Mignon et des Roméo et Juliette des œuvres de Gœthe et de Shakespeare, découper en tranches pour le théâtre des Madame Bovary, « corriger » Racine et Molière à l’usage des séminaires ; mais jamais on n’avait vu « adapter » sur une si vaste échelle en récrivant les textes, en changeant les caractères et les situations, en se livrant au pillage littéraire le plus éhonté avec une triomphale impudence (voir Tripatouillage). C’est devenu une industrie universelle, et les sociétés de gens de lettres, les syndicats d’écrivains protègent ça!... Poursuivis par la haine des pontifes et des ratés, les vrais hommes de lettres, les plus grands : Hugo, Balzac, Baudelaire, Stendhal, Flaubert, Zola, Becque, Mirbeau ; les plus purs : P.-L. Courrier, Tillier, Vallès, Cladel, Villiers de l’Isle-Adam, Gérard de Nerval, Verlaine, Ch.-L. Philippe et cent autres proscrits des lettres, sont livrés en pâture aux goujats qui gâchent le mortier de la sottise souveraine. Un parvenu littéraire, M. Clément Vautel, a écrit dans un article contre H. Becque :
« Le travail qui fait vivre est toujours honorable. »
M. Vautel a évidemment besoin d’être indulgent pour son propre travail ; mais le cambrioleur, le pickpocket, le souteneur, vivent aussi de leur « travail » qui n’est pas, entre parenthèses, moins « honorable » que celui des pirates de la littérature, et il est plus dangereux. Dans sa haine du génie et de la pauvreté, M. Vautel n’a pas vu qu’il apportait l’adhésion la plus intégrale à l’illégalisme. A moins que l’illégalisme n’en soit plus lorsqu’il a pignon sur rue, de même que « le crime heureux fut juste et cessa d’être crime », comme l’a constaté Boileau. Dans une société où leur travail est « honorable », il est normal qu’un Becque ne laisse que des dettes à ses héritiers et qu’un Deubel en soit réduit à se jeter à la Seine.
Il faut donc distinguer parmi les gens de lettres, d’abord, ceux qui méritent véritablement ce titre par leurs connaissances : ce sont les lettrés. Ensuite, ceux qui servent les lettres par amour pour elles et n’en font un métier ou qui, s’ils en vivent, le font avec dignité et avec le respect de la pensée qu’ils ont l’honneur de servir. Car, quoi qu’en puissent dire les « prolétaires des lettres » qui gémissent à jet continu sur les « duretés de la vie littéraire » et importunent le monde de revendications saugrenues, personne n’est obligé de se faire écrivain. Si on ne voit pas dans l’art, comme dans les idées, un apostolat, si on n’est pas prêt à se dévouer à eux avec un amour absolument désintéressé, on sera plus utile à soi-même et à la société en se faisant maçon ou laboureur. J.-J. Rousseau écrivait à M. de Malesherbes :
« Vos gens de lettres ont beau crier qu’un homme seul est inutile à tout le monde et ne remplit pas ses devoirs envers la société ; j’estime, moi, que les paysans de Montmorency sont des membres plus utiles de la société que tous ces tas de désœuvrés payés de la graisse du peuple pour aller six fois la semaine bavarder dans une académie, et je suis plus content de pouvoir, dans l’occasion, faire quelque plaisir à mes pauvres voisins que d’aider à parvenir à ces foules de petits intrigants dont Paris est plein, qui tous aspirent à l’honneur d’être des fripons en place et que, pour le bien public comme pour le leur, on devrait tous envoyer labourer la terre dans leurs provinces. »
Seuls, ceux qui servent l’art et les idées avec désintéressement peuvent leur apporter cette liberté qui est leur première condition. Ceux qui en vivent s’en servent plus qu’ils ne les servent, et cela en raison directe du profit qu’ils en attendent. De là cette dualité des fonctions des gens de lettres comme de tous les artistes ou propagandistes. Il arrive que l’artiste sert l’art tout en rencontrant la faveur publique ; c’est exceptionnel, tant le goût public et l’intérêt de ceux qui le dirigent sont étrangers à l’art. M. M. Barrès disait : « La littérature donne parfois tout ce qu’elle a de plus beau au monde, elle ne donne jamais le pain et l’abri à ceux qui les demandent ; c’est tout ou rien ». Presque toujours l’artiste dessert l’art pour gagner la faveur publique ; il en résulte la corruption et l’asservissement de l’art livré à des charlatans qui n’ont de l’artiste que le titre. D’après Voltaire, le public de son temps se composait de 40 à 50 personnes pour un livre sérieux, de 400 à 500 pour un ouvrage plaisant, de 1.100 à 1.200 pour une pièce de théâtre. Aujourd’hui le nombre est resté à peu près le même pour l’ouvrage sérieux, livre ou pièce, c’est-à-dire pour la littérature et le théâtre qui sont de la pensée et de l’art. Le nombre a décuplé pour la gaudriole livresque et théâtrale. Jean-Jacques Rousseau disait :
« J’ai toujours senti que l’état d’auteur n’était et ne pouvait être illustre et respectable qu’autant qu’il n’était pas un métier. »
Et Flaubert :
« Il n’y a rien de plus vil sur la terre qu’un mauvais artiste. Faire de l’art pour gagner de l’argent, flatter le public, débiter des bouffonneries joviales ou lugubres en vue du bruit ou des monacos, c’est là la plus ignoble des professions. »
L’art, comme la religion, a ses apôtres et ses martyrs, mais il a surtout sa multitude de boutiquiers simoniaques qui en font des falsifications et un commerce impudent.
« Les lettres, pour qui en est digne, ne sont pas un métier, mais la vocation impérieuse de manifester sa pensée, avec la jouissance de lui donner sa forme la plus parfaite. » (G. d’Avenel)
L’honneur de l’écrivain est d’être indépendant, de ne travailler à composer son œuvre que dans l’absolue liberté de sa pensée. On n’est pas indépendant lorsqu’on aspire à la richesse, à des décorations, à l’Académie. M. H. Rosny ainé se plaignait un jour qu’on décorait les littérateurs au compte-gouttes. Croit-il que les littérateurs ont encore trop de véritable dignité ? « Les honneurs déshonorent », disait Flaubert, et M. Gaston Chérau, qui refusa la Légion d’honneur, a écrit :
« A voir l’usage qu’on a fait depuis longtemps de la Légion d’honneur, j’ai pensé que si un jour on me proposait de me comprendre dans une promotion, je refuserais l’honneur qu’on me ferait de me placer près de certains anciens, dans la compagnie de gens qui ne doivent leur ruban qu’à l’intrigue. »
Mme Suzanne Després a répondu : « Garde ta mercerie ! » au ministre, M. Herriot, qui voulait la décorer. Mais pour certains qui se respectent et ont le respect de leur pensée, combien qui ne sont, bassement, que des valets ! On lit tous les jours des choses comme ceci dans des journaux où les gens de lettres mettent leur plume à l’encan :
« L’administration des Finances obtiendra des écrivains ce qu’elle voudra, surtout si elle les traite, ce dont on ne veut pas douter, avec les égards dus à ceux qui dirigent l’opinion et qui sont naturellement des auxiliaires précieux pour le gouvernement dans toutes les initiatives et mesures d’ordre financier. » (Comœdia, 30 juillet 1925)
Et ceux qui écrivent ces choses s’indignent, au nom de la morale, contre la prostitution qui s’étale effrontément et fait une publicité tapageuse!...
Stendhal voulait qu’un homme de lettres se contentât de six mille francs de revenu par an. En vingt-deux ans, ses œuvres ne lui rapportèrent pas dix mille francs. On gagne plus aujourd’hui en écrivant plus mal. Ces cinq cents francs par mois qui auraient suffi à Stendhal en font deux mille cinq cents de nos jours. Beaucoup qui savent rester libres ne les gagnent pas. Mais comment les hommes de lettres qui désirent la vie de « palace » s’en contenteraient-ils ? On comprend qu’ils préfèrent rester avec la bourgeoisie bien que, disent-ils, « ils n’en sont pas plus fiers pour ça ». Elle les nourrit mieux que ne ferait la révolution. Ils n’en gémissent pas moins sur la situation précaire des écrivains et des artistes. Ils y trouvent l’occasion de dénigrer la « démocratie béotienne » et d’épancher leur aristocratisme en rappelant les temps où « les rois protégeaient les lettres et les arts », ce qui n’est pas une des moindres mystifications de l’histoire (Voir Plutarquisme). Ils plaignent le sort de cette « pauvre et sublime noblesse », réduite à « apprivoiser le manant » depuis que ce vilain bougre a mis dans sa caboche de ne plus se laisser rosser, estropier et piller par elle, et à cultiver littérairement « l’art d’être pauvre » lorsque les héritiers des marchands de cochons de Chicago en ont assez d’entretenir son parasitisme armorié. Ils vont même jusqu’à trouver préférable à la condition d’écrivain celle des ouvriers de l’usine et des champs qui gagnent de « hauts salaires ». Que ne vont-ils à l’atelier et à la moisson les gens de lettres que leur état ne nourrit pas ? Mais on préfère les petits métiers des bars et des dancings, parmi les « gigolos » non seulement sans profession mais aussi sans sexe qui font l’ornement de ces établissements essentiellement moralisateurs ; ceux des journaux et de toutes les boîtes à potins et à scandales, ceux de flagorneur, d’écornifleur, de maître-chanteur, et nombre d’autres qui sont plus d’aventure que de lettres. C’est moins fatigant, mais est-ce plus digne ? M. Forain, de l’Institut, a représenté dans un dessin célèbre un ouvrier soulevant une « demoiselle » et disant à un valet de grande maison :
« Hein ! C’est plus lourd qu’un pot de chambre. »
Oui, mais c’est encore bien plus lourd qu’une plume vénale. Un valet de chambre ne vend que les services de ses mains ; dans l’impassibilité de sa fonction, il peut garder sa pensée intacte et rester un homme. Un valet de plume vend sa pensée et sa conscience ; il s’oblige à toutes les grimaces et n’est plus rien. Entre vider le pot de chambre de M. Lechat ou être son collaborateur, son « cher confrère », la question ne se pose pas lorsqu’on possède encore un peu de dignité. On choisit le pot de chambre. « Quelque infâme que soit, pour tout le monde, la vénalité, pour un écrivain elle l’est encore davantage », disait Claude Tillier. « Qui m’appartiendra donc si ma pensée n’est pas à moi ? » demandait L.-Sébastien Mercier. Il y a deux mille ans que l’Evangile dit :
« À quoi vous servirait de gagner le monde si vous veniez à perdre votre âme ? »
Depuis deux mille ans les « vendus » répondent en ricanant :
« À en acheter une autre. »
Et les boutiquiers de l’Evangile les entretiennent dans ce sentiment. Mais ils savent bien que l’âme, c’est-à-dire la liberté de la pensée, la dignité de l’individu, ne se perd pas impunément. Il faut bien qu’ils s’en aperçoivent lorsqu’après une vie de servilité, devant le néant de leur existence et en présence de la mort, ils demandent avec épouvante à un prêtre de leur rendre leur innocence première. Ceux qui ont défendu leur âme et bien accompli leur vie n’ont pas besoin de cette fallacieuse intervention d’un sorcier pour conserver une auguste sérénité à leur dernière heure.
On a entendu M. Maurice Rostand, qui mène une vie de cabotin élégant dans tous les lupanars à la mode, se plaindre que « la République n’avait rien fait pour sa famille ! » La République fit moins encore pour un Vallès, un Villiers de l’Isle-Adam, un Verlaine, un Deubel et tant d’autres, qui auraient mérité autrement que la famille Rostand qu’elle s’occupât d’eux, mais qui ne lui demandèrent rien, sachant qu’elle était incapable de leur donner la seule chose qu’ils désiraient : la gloire. M. Maurice Rostand ne comprendra jamais ce mot sublime de Villiers de l’Isle-Adam :
« Celui qui, en naissant, ne porte pas dans sa poitrine sa propre gloire, ne connaîtra jamais la signification réelle de ce mot. »
La mendicité auprès des puissants et des riches révèle une bassesse de caractère qui ne peut ennoblir l’œuvre d’art. Si « ingrat » qu’ait été le « mendiant » Léon Bloy, son œuvre n’a pas gagné à sa mendicité. C’est Huysmans qui avait raison lorsqu’il écrivait sur L. Bloy :
« Il a peut-être raison. Il croit que les gens riches sont uniquement créés et mis au monde pour aider les artistes. Il est d’accord avec ceux du XVIIème siècle qui mettaient leur orgueil à tirer, de leurs protecteurs, les plus larges subsides. Chacun son goût ! Je ne blâme pas ceux qui attendent tout des mécènes. Moi j’aime mieux me suffire avec mes appointements, aussi maigres soient-ils. »
J.-B. Rousseau a dit :
Des présents que nous font les cieux.
Jamais les mécènes n’ont fait un homme de génie. S’ils ont aidé parfois le génie, ils n’ont fait que des courtisans plus ou moins avilis par l’enchaînement de leur liberté. Napoléon aurait voulu faire un Corneille par ses libéralités ; il n’a fait que des Luce de Lancival. Le génie a besoin d’indépendance plus que d’argent ; il a été souvent écrasé par la privation de la liberté, il ne l’a jamais été par l’infortune. La « servitude volontaire » est la pire de toutes quand elle est celle de l’esprit. On peut être esclave, torturé, emprisonné et demeurer un Diogène, un Galilée, un Blanqui. On peut être comblé de richesses, d’honneurs, et n’être qu’un valet de plume, valet plus méprisable que celui qui vide des pots de chambre car on n’a pas l’excuse de la faim. Des hommes n’ont fait qu’une œuvre médiocre ; ils sont au-dessus de tous les mépris parce qu’ils gardèrent leur indépendance d’individus et d’artistes. Ducis fut un des rares hommes de lettres qui refusèrent de se laisser acheter par Napoléon. Il préféra « porter des haillons que des chaînes », celles-ci fussent-elles dorées. L’orientaliste Anquetil résista lui aussi aux séductions impériales. Il n’avait que cinq sous par jour de revenu et trouvait moyen d’en donner deux à plus pauvre que lui. Lorsqu’on lui disait :
« Louez l’empereur, comme tant d’autres ; vous avez besoin de lui pour vivre. »
Il répondait :
« Je n’en ai pas besoin pour mourir. »
Béranger refusa même les faveurs de ses amis politiques arrivés au pouvoir en 1848, et il put dire fièrement :
« A aucune époque de ma vie de chansonnier, je ne donnais droit à personne de me dire : Fais ou ne fais pas ceci ; va ou ne va pas jusque là. »
Tout le tapage que font les gens de lettres au nom de leur « dignité », lorsqu’ils se plaignent de leur condition, sonne aussi faux aux oreilles que ces cloches de couvents qui chantent, disait P.- L. Courier :
« Donnez, donnez, donnez ! »
Les gens de lettres qui ont une dignité, ceux qui forment la véritable élite, savent qu’il n’y a rien à gagner d’honorable pour eux et pour leur œuvre dans le bruit de la « foire sur la place » où paradent les histrions et où l’on fait les poches aux badauds. Roucher nourrissait sa sensibilité dans la retraite. Il disait :
« J’avoue que je suis encore à concevoir comment on a pu conseiller aux gens de lettres de se répandre dans le monde... ils y mettent beaucoup et n’en rapportent rien. Comment veut-on que le nombre des grandes idées s’augmente dans des cercles où presque personne ne pense faute d’idées ; que le jugement devienne plus solide au milieu de la frivolité?... Ce qu’on perd surtout dans le monde, c’est la sensibilité qui fait peut-être tout le génie des grands poètes. Elle s’évapore, pour ainsi dire, au milieu de la dissipation. »
Ce qu’ils donnent surtout dans le monde c’est l’étalage de leur vanité, le spectacle de leurs querelles. Ces « cerveaux de la nation », ces « éducateurs de la démocratie », ces surhommes de qui la tête est voisine du ciel ; comme celle du chêne de La Fontaine, ont les mêmes appétits que les bruyants tire-laines de la Bourse, les grippe-suffrages des réunions électorales. Bien qu’à la façon des héros d’Homère ils revêtent la chlamyde et chaussent les cothurnes pour « s’engueuler » académiquement, ils le font parfois dans des termes à faire rougir Mme Angot. De tout temps le monde a été occupé de leurs querelles. Sans avoir pour cela plus de courage, ils ont l’épiderme extrêmement sensible. En outre, ils résistent difficilement au plaisir de faire un bon mot, d’être « rosses » même contre le meilleur de leurs amis. Volontiers, ils :
Mais tous n’ont pas l’esprit qui animait les escarmouches des Voltaire et des Piron. Roucher disait :
« Je suis désolé du spectacle qu’offrent les gens de lettres qui se déchirent entre eux. Les écrivains estimables par leur conduite et leurs talents devraient faire une association pour se défendre. J’ai l’âme flétrie en voyant la haine et les partis déchirer les succès et les membres les plus éclairés de l’humanité devenir des tigres en cultivant tout ce qui devrait adoucir les mœurs. »
Huysmans avait les raisons suivantes de les éviter :
« Fréquenter ces trabans de l’écriture et rester propre, c’est impossible. Il faut choisir : eux ou de braves gens ; médire ou se taire ; car leur spécialité est de vous élaguer toute idée charitable, c’est de vous guérir surtout de l’amitié, en un clin d’œil. »
Ignorance, servilisme, puffisme ; voilà ce que nous représentent trop souvent les gens de lettres. Il n’y aurait qu’à hausser les épaules, et garder devant eux ce silence qu’ils redoutent tant, s’ils n’avaient une part si directe et si lourde de responsabilité à l’organisation de l’exploitation humaine, par l’influence qu’ils exercent sur la vie sociale, surtout, depuis la Création et le développement de la presse (voir ce mot) qui leur a permis de donner leur avis sur toutes les questions publiques et d’exercer, on peut dire, une véritable dictature sur l’opinion. C’est d’eux que se servent les maîtres du monde chaque fois qu’ils ont un mauvais coup à accomplir contre les peuples, une guerre à préparer, une escroquerie à lancer, un poison à débiter en pilules ou en bouteilles. Ils sont les intermédiaires de tous les malfaiteurs qui exploitent la confiance publique, de tous les coquins qui s’engraissent de la naïveté des foules. Plus les mauvais coups sont importants plus la gendelettrerie haut placée y participe au lieu de s’y opposer. Les grands pontifes de la corporation sont comme ces ministres du roi de France qui, disait Barbier, « ne devaient friponner que dans le grand, quand c’était leur caractère ». A l’occasion de la guerre de 1914, on a vu comment, dans tous les pays, les « grands intellectuels » se sont faits les Tyrtées de l’ignoble boucherie. M. Bergson est descendu des hauteurs philosophiques pour préfacer un livre de guerre du ministre Viviani. Dans l’indignité de leur avilissement, ils prétendirent accabler de leur mépris un Romain Rolland demeuré courageusement « au-dessus de la mêlée » ; eux, à côté, présidaient à l’assassinat de millions d’hommes les plus obscurs. On les a vus remplir tous les emplois, les plus ténébreux et les plus honteux, pourvu qu’ils fussent « loin des balles ». Ils ont pullulé dans les services de la censure, de l’espionnage, du « moral », partout où le mensonge et la délation étaient devenus des exercices patriotiques. Ayant abondamment profité de la guerre, ils exploitent encore la « gloire » de ceux d’entre eux qu’ils ont eu l’inconscience et la lâcheté de faire tuer, et ils préparent les prochaines hécatombes en refusant d’établir publiquement les véritables responsabilités de la « dernière », en entretenant les haines nationales qui séparent les peuples. G. Demartial a montré « Comment on mobilisa les consciences », en 1914, les consciences sorbonistes, académiques, journalistiques. Dans un livre d’une portée plus vaste, La Trahison des clercs, M. Julien Benda a étudié le processus de barbarie intellectuelle et de décrépitude morale qui aboutit à cette mobilisation des gens de savoir et de pensée, religieux ou laïques, savants ou artistes, traîtres à l’esprit humain.
Dans la Grèce antique, celle qui fut grande et qui répandit sur le monde un rayonnement impérissable, les lettres n’étaient pas un métier et personne n’en vivait. Des magistrats, généraux, hommes d’Etat, de simples artisans étaient poètes, écrivains, orateurs, philosophes, historiens et ne recherchaient que la gloire : Prœter laudem, nullius avari, comme a dit Horace. Sophocle fut amiral ; Cléanthe, poète stoïcien, fut porteur d’eau chez un jardinier. On ne faisait pas plus profession de génie que de vertu et le travail était honoré dans toutes les classes, selon la loi de Solon voulant que tout citoyen eût un métier. L’homme de lettres ne réclamait pas une existence privilégiée ; il n’aspirait pas à vivre en escargot dans une « tour d’ivoire », d’où il ne sortirait « que pour se présenter à la caisse des pensions les jours d’émargements » (E. Despois), pas davantage au parasitisme cabotin des « hommes du jour ». Il n’avait pas encore découvert sa place parmi « les lis qui ne travaillent ni ne filent » de l’Evangile. Il méprisait le frelon qui dévore, sans rien faire, le miel des abeilles et, avec Hésiode, il le vouait à « la haine des hommes et des dieux ». Il était l’homme complet, le citoyen qui servait la cité de toutes les ressources de son intelligence et de son activité. Le repas gratuit du Prytanée et la place d’honneur dans les assemblées étaient réservés à la fois au plus grand poète et au meilleur artisan. Pas plus que l’artisan, le poète ne résignait sa dignité pour geindre sur sa misère ; il ne réclamait pas alors de propriété littéraire. Thucydide offrait « l’éternelle propriété » de son œuvre à la postérité. La plus grande époque d’art et de pensée de l’humanité, celle de Périclès, ne fut pas le protectorat d’un tyran sur des flagorneurs, comme le furent celles d’Auguste, de Louis XIV, de Napoléon 1er. Périclès n’eut qu’un protégé, Anaxagore, et l’aventure réussit aussi mal à l’un qu’à l’autre. Les artistes et les poètes étaient libres, ne subissant pas plus les lois d’un Aristote que les caprices d’un Louis XIV et de sa cour ; leur seul juge était le peuple, l’assemblée tout entière de la cité. On a évalué à 17 millions de livres françaises les sommes qui furent dépensées pour les monuments d’Athènes au temps de Périclès. Ces monuments étaient au peuple, élevés pour sa gloire et pour sa joie ; ils n’étaient pas comme un Versailles l’image orgueilleuse de son écrasement et de sa misère. Il en fut ainsi tant que dura la liberté d’Athènes ; les gens de lettres, parmi tous les citoyens, goûtaient et défendaient cette liberté. Les choses changèrent lorsque l’esprit de conquête et d’enrichissement amena l’esclavage et la corruption. On vit alors paraître les rhéteurs et les sophistes qui mirent leur plume au service des puissants et amenèrent, avec l’asservissement de la pensée, la décadence littéraire.
Le caractère prétorien de la puissance romaine empêcha la formation de véritables artistes. Le seul grand poète qui naquit à Rome, Lucrèce, fut plus grec que romain, admirant tout ce que détestait sa patrie et particulièrement la paix ! Rome n’aimait pas les lettres et méprisait comme étrangers (hostis, ennemis) et esclaves ceux qui les pratiquaient. Elle n’offrait aucune sécurité aux étrangers s’ils n’étaient pas protégés par des grands à qui ils s’attachaient. Ainsi s’établirent pour les gens de lettres les rapports de protégés (clientis) et de protecteurs (patronus). Même nés libres, ils se pliaient à cette domesticité. On doit attribuer à ces conditions serviles « la bassesse dont les plus grands écrivains et les meilleurs poètes latins n’ont laissé que de trop honteux monuments » (Larousse). Térence, protégé de Scipion, se vit contester sa gloire par son protecteur qui s’attribuait volontiers ses œuvres et finalement le laissa mourir de faim. Ennius, quoique homme libre, s’attacha à Scipion et lui rendit l’hommage du « bon client » soumis au « bon patron ». Horace, dont on vante l’esprit indépendant, pratiqua « l’art de flatter délicatement ». Mécène, à qui il disait :
« Mets-moi au nombre des poètes lyriques et mon front superbe ira toucher les cieux ! »
Virgile, que la guerre avait dépossédé de ses biens, chanta la gloire d’Octave et le proclama un dieu lorsqu’il lui eut fait rendre ses propriétés. Avec Horace, il flatta la mégalomanie d’Auguste ; ils assurèrent ainsi leur sécurité et cette indépendance qui leur permit de vivre à l’écart de Rome. En ce temps-là, seul le théâtre pouvait fournir aux poètes des moyens d’indépendance dans l’exercice de leur profession. On connut alors des « droits d’auteur » supérieurs à ceux que touchèrent Corneille et Racine. Térence eût pu vivre de leur produit. Plaute, qui avait tourné la meule d’un moulin à farine avant ses succès d’auteur, réalisa au théâtre une véritable fortune ; il la gaspilla et dut se remettre à travailler de ses mains. Les satiristes latins se sont bien vengés de la servilité où ils étaient tenus, bien qu’ils l’acceptaient parfois trop complaisamment, tel Martial « gueusant un écu pour un madrigal à l’adresse de Domitien ». Les plus grands : Perse, Lucain, Sénèque, Juvénal, Tacite, Suétone, etc..., résistaient mal parmi la tourbe des rhéteurs qui faisaient bassement leur cour aux Caligula et aux Néron et les flétrissaient après leur mort. Leur procédé est dépeint dans ces deux vers de Joseph Chénier :
Et soyons aux gages des autres.
Les empereurs avaient trop besoin de flagorneurs pour ne pas employer à leur égard toutes les séductions et, au besoin, toutes les violences. Le stoïcien Pœtus Thraséa fut peut-être le seul qui resta digne. La profession d’homme de lettres permettait alors d’arriver aux fonctions publiques ; elles rapportaient d’autant plus qu’elles réclamaient moins de vertu. Quintilien, qui fut consul, fut aussi nommé professeur d’éloquence par Domitien, qui lui alloua 100.000 sesterces (22.500 francs) d’appointements. Plus les gens de lettres arrivaient à la richesse et aux honneurs, plus la littérature s’affaiblissait pour s’éteindre dans des œuvres méprisables. C’est ce qui s’est produit à toutes les époques où les écrivains, abdiquant leur liberté, se sont faits les domestiques du pouvoir et les complices de la tyrannie.
La décadence latine se prolongeant dans le moyen âge avec les invasions barbares, et les travaux de la pensée étant rejetés officiellement par l’Eglise, cette époque ne connut guère les gens de lettres jusqu’à la pré-Renaissance. Il y eut alors les lettrés qui, dans une solitude prudente, réapprirent l’œuvre de la pensée humaine et préparèrent la Renaissance. En même temps parurent les poètes, trouvères et troubadours, amateurs aristocratiques ou professionnels populaires, ceux-ci plus ou moins jongleurs, ménestrels, saltimbanques, coquillards, trucheurs, coupeurs de bourses, crocheteurs, truands, goliards, vauriens amateurs de repues-franches, chevaliers de la Guille, arquins, etc... Déjà ils se plaignaient que le métier ne nourrissait pas son homme. « A gens de lettres honneurs sans richesses », disait un proverbe du temps. Si certains réussissaient, comme ce chevalier carcassonnais qui put acquérir la seigneurie de Myrevaux « au moyen de sa riche et belle poésie », ou menaient une douce vie dans les châteaux et les couvents, beaucoup étaient gueux, par indépendance de caractère, par malchance ou par débauche. Rutebeuf, qui a dit le plus éloquemment les misères de son temps, les a subies plus que quiconque. Il est le type du poète des gueux, Villon est celui des « mauvais garçons ». Si certains ménestrels recevaient 11.000 francs pour avoir joué au couronnement de Saint Louis, ou touchaient 5.700 francs d’appointements par an du comte de Roussillon, d’autres se plaignaient d’être pauvres comme Job, et le poète Deschamps avait toutes les peines à obtenir une houppelande du duc de Bourbon et un cheval du duc de Bar.
La Renaissance vit reparaître les gens de lettres plus ou moins attachés à des protecteurs. L’indépendance de Dante, de Pétrarque, de Rabelais, de Bonaventure des Périers, d’Erasme, et d’autres parmi lesquels les écrivains qui propagèrent la Réforme, fut pleine de périls. Pour ne pas écrire contre leur pensée, ils durent la déguiser, lui donner des formes allégoriques. C’est d’eux que Pascal a dit : « Vous cherchez un écrivain et vous trouvez un homme ». L’homme se cachait moins chez ceux qui vivaient de faveurs princières, tels Ronsard et Marot à la cour de France, Le Tasse et l’Arétin auprès des cours italiennes. Ronsard vivait en grand seigneur ; il avait des pensions, une cure, deux abbayes, plusieurs prieurés, bien qu’il fut parfois fort dur pour les gens d’église. Marot, secrétaire de Marguerite de Valois, puis valet de chambre du roi, tirait 4.000 francs d’appointements de cet emploi. François 1er lui avait donné une maison au faubourg Saint-Germain et il avait reçu 13.000 francs de Charles-Quint pour sa traduction en vers des trente premiers psaumes. Mellin de Saint-Gellais détenait plusieurs charges importantes. Desportes tirait 50.000 francs de rente de ses bénéfices. Dorat, Budé, Baïf étaient aussi de grands seigneurs. Par contre, Rabelais fut très pauvrement pourvu et ses œuvres, malgré leur succès, ne lui rapportèrent rien. Pas plus que Mathurin Régnier, cinquante ans après lui, il ne savait « sucrer sa moutarde » pour plaire aux grands. Régnier, qui eût pu devenir riche et important en héritant de la fortune et de la situation de son oncle Desportes, était un indiscipliné, disant :
Il demeura parmi les poètes pauvres dont il a dit :
Nous n’eusmes sur le dos jamais un bon manteau.
Aussi, lorsque l’on voit un homme par la rue,
Dont le rabat est sale et la chausse rompue,
Ses grégues aux genoux, au coude son pourpoint,
Qui soit de pauvre mine, et qui soit mal en point,
Sans demander son nom, on le peut reconnaître :
Car si ce n’est un poète, au moins il le veut estre.
Tant que les gens de lettres furent peu nombreux, la besogne fut facile à ceux qui vivaient des faveurs des grands. Leur multiplication et la concurrence qui en résulta les obligèrent à outrer leurs flagorneries. Au XVIIème siècle ils atteignirent à une servilité qui devint, dit Larousse, une « plaie sociale ». Le besoin de domination, de flatterie, d’une royauté de plus en plus absolue encouragea, à côté des gens de lettres, le pullulement et la bassesse de plumitifs parmi lesquels les vrais lettrés furent de moins en moins nombreux. La servilité fut d’ailleurs la caractéristique des mœurs du temps et atteignit son maximum sous Louis XIV. Elle passait bien avant le talent, quoi qu’on ait voulu dire en l’honneur de « Louis le Grand ». Louvois, son plus grand ministre, fut un des plus exécrables que la France ait eus ; bien peu lui ont fait autant de mal, mais il était un parfait courtisan. Enrégimentés dans les académies, gens de lettres et artistes furent surtout des courtisans ; aussi les plus plats furent les plus favorisés, tels les Colletet, Scudéry, Clavelet, auteur d’une Lettre contre le sieur Corneille prétendu auteur du Cid, l’abbé Cassagne, chapelain et nombre d’autres. Chapelain, lui, se donnait modestement le titre de « plus grand poète français », mais que Boileau « décoiffa » si justement, était aussi avare que riche. Sa Pucelle lui avait procuré une vingtaine de mille francs d’éditions et une pension de 2.000 livres de la famille de Longueville en récompense des éloges décernés à Dunois, ancêtre de la maison. Une pension royale de 3.000 1ivres lui fut payée jusqu’à sa mort. C’est lui qui appelait Corneille : « poète mercenaire », parce que Corneille prétendait tirer des droits d’auteur de ses œuvres et vivre de sa plume. On fit à Corneille la réputation d’un accapareur. Or, sans être tombé dans la misère dont on a parlé, il ne tira jamais de son œuvre qu’un revenu médiocre et ne reçut qu’une pension de 2.000 livres qui lui fut retirée dix ans avant sa mort. Il était plus pauvre à la fin de sa vie qu’au début de sa carrière. Chapelain, lui, laissa une fortune d’un million et demi. Voiture s’était assuré 75.000 francs de rentes. Guez de Balzac n’était pas moins favorisé. De médiocres et souvent ridicules auteurs, qui furent, pour la plupart, les premiers académiciens, les Colomby, Gombauld, Godeau, Porchères-Laugier, Saumaise, Dupuy, Conrart, Le Clerc, l’abbé Pure, Boyer, le père Lecointe, Godefroi, Huet de Caen, Charpentier, Sorbière, Cottin, Ogier, Vallier et maints autres, Dauvrier, « savant ès-lettres humaines », mais dont les œuvres sont à jamais oubliées ; recevaient des pensions de 10.000 à 30.000 francs. A côté des faveurs dont jouissaient ces « grands hommes », La Fontaine n’avait que 3.250 francs de Fouquet. Boileau et Racine, tant qu’ils ne furent que poètes, n’atteignirent qu’à 4.000 francs. Ils ne participèrent véritablement aux faveurs que lorsqu’ils furent nommés historiographes du roi. Molière n’eut pas une pension plus élevée, mais il gagna une fortune au théâtre. Les pensions royales, médiocres quoi qu’on en ait dit, car elles ne dépassèrent pas pour les gens de lettres 400.000 francs par an, étaient parfois fastueusement complétées par les largesses des princes et des financiers qui puisaient scandaleusement dans les caisses de l’Etat pour des pensions cent fois supérieures. Les bénéfices ecclésiastiques allaient aussi largement aux gens de lettres. Au XVIIIème siècle, ces gens furent nombreux parmi les abbés de cour que la galanterie occupait plus que la religion. Ils vivaient de ces bénéfices en même temps que des subsides qu’ils tiraient des comédiennes dont ils étaient les greluchons, et l’on disait :
Voltaire jouissait d’une très grosse fortune due à des spéculations financières étrangères aux lettres. Il pouvait être ainsi un grand seigneur de la littérature généreux pour ses confrères. S’il affamait le peuple en participant au pacte de famine, il ne faisait pas payer ses écrits. Il travaillait ainsi doublement pour la Révolution. J.-J. Rousseau, dont on a raillé la prétendue âpreté au gain parce qu’il se défendit contre ses éditeurs ne leur demandait qu’une rente viagère de 3.600 francs, ce qu’il lui fallait strictement pour vivre. Il n’en obtint que 1.400. Les vingt-deux éditions que l’Esprit des Lois eut en dix-huit mois ne furent guère productives pour Montesquieu. Gil Blas et Manon Lescaut rapportèrent bien peu à Le Sage et à Prévost. Condillac ne vendit que 675 francs l’Essai sur les connaissances humaines. La traduction des Géorgiques produisit seulement 900 fr. pour Delille, et Bernardin de Saint Pierre fut très heureux de vendre son Voyage à l’Ile de France 2.250 francs. Dans le même temps, les éditeurs de l’Encyclopédie s’enrichissaient aux dépens de ses rédacteurs, et l’Almanach Royal procurait 65.000 francs de rente à l’éditeur Lebreton (Voir Livre).
Ce fut au XVIIIème siècle que les hommes de lettres, entrant directement en rapports avec le public, sans passer par des intermédiaires protecteurs, commencèrent à avoir une situation indépendante et à exercer une action sociale véritable. Les Encyclopédistes, en répandant la profession d’hommes de lettres lui firent prendre, sur l’opinion publique, une influence qui ne devait cesser de grandir. Certes, il ne faut pas s’exagérer leur indépendance. Il y eut beaucoup de courtisans parmi les écrivains du XVIIIème siècle. Il ne faut pas s’exagérer non plus leur servilité d’après leurs manifestations littéraires. A cette époque de fausses apparences, où rien ne se disait et ne se faisait simplement et où l’on enrubannait la nature, l’habitude de l’hyperbole, du grand, du noble, faisait perdre le sens des réalités et rendait excessive l’expression des sentiments. On l’a vu pendant la Révolution, où l’on fut plus romain que ne le furent jamais les Romains. Lorsque, par exemple, Duclos appelait Louis XV : « héros supérieur à la gloire même », l’exagération manifeste de ces mots en faisait une raillerie que seule le vaniteux monarque à qui ils étaient adressés pouvait prendre au sérieux. On ne pouvait, à cette occasion, taxer Duclos de flagornerie alors qu’il donna si souvent des preuves d’indépendance. L’intéressant est dans l’importance que les gens de lettres avaient prise. Ils occupèrent tellement le public qu’ils firent œuvre féconde en développant les idées qui étaient dans l’air et naissaient de l’état de la société. Elles les portaient, on peut dire, malgré eux. Un Beaumarchais, entre autres, ne se doutait nullement de la portée révolutionnaire de ses pamphlets et de son Mariage de Figaro. Ils auraient été peut-être épouvantés s’ils avaient prévu l’aboutissement de leurs écrits dans les événements de 1789–93. Leur influence était si irrésistible qu’elle faisait désirer et surtout préparer la Révolution par ceux-là mêmes qui devaient en être les victimes. L’homme de lettres, échappant à la tutelle du pouvoir et tirant un profit légitime du travail de sa plume, pouvait devenir l’animateur d’un nouveau monde. Il était de toute façon une force redoutable. Comme disait alors Duclos :
« Les hommes puissants n’aiment pas les gens de lettres ; ils nous craignent comme les voleurs craignent les réverbères. »
Malheureusement, les gens de lettres sont corruptibles, autant sinon plus que quelconque, et pour un Rousseau ou un Proudhon, qui préférèrent copier de la musique ou se faire imprimeur afin de conserver l’indépendance de leur pensée, des centaines d’autres la vendent pour en vivre le mieux possible. C’est ainsi que les réverbères sont éteints par les voleurs pour la réussite de leurs mauvais coups. Le mal n’a fait qu’empirer durant le XIXème siècle, et depuis, malgré le perfectionnement des réverbères. Sous Napoléon 1er, mégalomane encore plus excité que Louis XIV, tyran encore plus ennemi de la liberté et plus corrupteur, presque tous se laissèrent acheter, hors les seuls qui marquèrent l’époque de quelque lustre littéraire.
Jamais les écrivains n’ont gagné autant d’argent qu’aujourd’hui ; jamais ils n’ont tant gémi sur leur sort. C’est qu’ils sont en France plus de six mille romanciers. Il y a autant d’auteurs dramatiques et on ne sait combien travaillent dans les autres genres. Alphonse Karr constatait, aux environs de 1848, que la littérature commençait à manger. Que dirait-il s’il la voyait si confortablement installée à la table des profiteurs de la Grande Guerre ? En réalité, comme de tout temps, ce sont les plus médiocres, mais les plus hardis, les moins scrupuleux qui, généralement, connaissent les plus gros tirages et gagnent le plus d’argent. Alors que Chapelain tirait 2.000 livres de la première édition de sa Pucelle, Boileau n’en avait que 600 de celle du Lutrin et Racine 200 de celle d’Andromaque. La Bruyère ne recevait pas un sou pour les Caractères, mais cet ouvrage procurait cent mille francs de dot à la fille de son éditeur Michallet. Si Chateaubriand vendit le privilège de ses publications 550.000 francs, Thiers réalisa, avec son Histoire du Consulat et de l’Empire, plus d’un million. Stendhal retira exactement 9.260 francs de ses œuvres. George Sand vendit 600 francs son Indiana et Madame Bovary fut payée à Flaubert 400 francs pour dix ans d’édition après dix ans de travail. Dans le même temps, Castil-Blaze tirait mille écus de chaque vers de son Robin des Bois, Alexandre Dumas un centime de chaque lettre de son roman le San Félice et Richebourg, pour qui Victor Hugo était « indigne de l’Académie Française », gagnait un million et demi avec ses infâmes feuilletons. Pendant que les Scribe, Dumas fils, Sardou et tous ceux qui ont « déshonoré » le théâtre de France, selon le mot de Villiers de l’Isle-Adam, sont devenus millionnaires, Henri Becque a vécu dans une gêne constante. Des écrivains qui ne servent que l’art, des poètes qui n’accordent pas leur luth au ton du snobisme, meurent toujours de faim, mais on n’a jamais vu tant de gros tirages et tant d’insanités triomphantes. Les cabotins des lettres arrivent à gagner autant qu’un fort ténor un boxeur, un toréador, une danseuse nègre, une « gueule photogénique » de cinéma, et ces messieurs continuent à se plaindre!...
Plus que quiconque, l’homme de lettres est la proie de cette maladie de la personnalité qui crée l’histrionisme et qui a besoin, disait Barbey d’Aurevilly, « d’espaliers pour sa vanité ». Cette maladie a pris aujourd’hui une telle intensité qu’elle fait souvent des gens de lettres les plus encombrants et les plus ridicules des cabotins. Les « m’as-tu lu » en sont arrivés à dépasser les « m’as-tu vu ». Une lourde responsabilité pèse à ce sujet sur la mémoire de deux écrivains, les frères Goncourt. Leur fortune leur aurait permis, encore mieux qu’à un Flaubert, de conserver à la dignité de l’homme de lettres toute son intégrité ; mais l’aveuglement de leur vanité était plus forte que la clairvoyance de leurs scrupules. Ils l’ont révélé en écrivant dans leur Journal :
« Notre plaie, au fond, c’est l’ambition littéraire insatiable et ulcérée, et ce sont toutes les amertumes de cette vanité des lettres où le journal qui ne parle pas de vous vous blesse et celui qui parle de vous vous désespère. »
Ils souffraient du silence organisé « contre tous ceux qui veulent manger au gâteau de la publicité » ; ils voulurent assurer une publicité posthume moins à leur œuvre qu’à leur nom, et c’est à elle qu’ils consacrèrent leur fortune en fondant l’Académie et le Prix Goncourt. Ils n’ont réussi qu’à déterminer le courant de la plus malfaisante et scandaleuse exploitation littéraire qu’on ait jamais vue. Non seulement leur œuvre n’y a rien gagné, mais leur nom est de plus en plus compromis dans des aventures dont le moins qu’on puisse dire est qu’elles sont loin de relever la dignité des gens de lettres. Le besoin qu’on parle d’eux est tel pour les gens de lettres que certains, ce fut le cas de Léon Bloy, préfèrent les injures au silence. Ils sont comme les femmes à qui les coups sont plus agréables que l’indifférence de leurs maris. Il y a dans ce besoin une sorte de sadisme qui s’apparente à celui de tous les individus que pousse l’ambition de paraître (voir ce mot) et qui les conduit aux pires excentricités, parfois jusqu’au crime. Que n’a pas fait contre l’humanité la mégalomanie de ses maîtres l’entraînant dans des guerres et la condamnant à toutes les misères ! Si ce besoin de la vanité ne conduit pas les gens de lettres jusqu’au crime, il leur fait perdre trop souvent toute fierté, tout sens du ridicule, tout scrupule et toute pudeur. Entre confrères, ils échangent publiquement la casse et le séné et, comme leurs travaux ne suffiraient pas à des motifs de congratulations assez fréquentes, ils entretiennent les badauds qui font leur clientèle de leurs histoires ménagères, de leurs amours, leurs maladies, leurs voyages, leurs chiens, le nombre de leurs maîtresses, la couleur de leurs chaussettes et la circonférence du bas de leur pantalon. Ils en attendent une notoriété qui est peut-être une condition de vie pour certains mais qui n’est, à coup sûr, d’aucun profit pour les lettres. Il en est parmi eux qui se disent « stendhaliens » ; que n’ont-ils les sentiments de Stendhal lorsqu’il disait :
« Mes compositions m’ont toujours inspiré la même pudeur que mes amours. Rien ne m’eût été plus pénible que d’en entendre parler. »
Il n’y a 1à rien de pénible pour eux ; au contraire, Gobineau écrivait à un ami : « Mon Don Juan va paraîtra dans quinze jours au plus tard... Pas un mot d’annonce et de réclame ne sera mis par moi dans les journaux ; je n’en donnerai même pas un exemplaire à La Quotidienne, sinon par politesse à deux ou trois rédacteurs, avec prière de ne rien écrire sur mon livre. J’ai l’horreur de ce tripotage des journaux autour d’une œuvre d’art qui, à mon sens, ne saurait être jamais trop pudique ou trop orgueilleuse, comme tu voudras... Je crois qu’on ne fait sérieusement toute œuvre d’art qu’avec des sentiments détachés du monde et du désir de succès ». Les Gobineau sont de plus en plus rares. Un ministre, M. Léon Bérard, un jour qu’il discourait sur le musicien César Franck, s’étonnait de « l’étrange application » qu’il mit à ne pas faire parler de lui. On ne peut comprendre une telle application chez les affamés de publicité, chez les artistes et les gens de lettres en particulier. C’est tout juste si on ne l’accuse pas de dissimuler une monstruosité congénitale ou des vices contre nature. Comment des gens dont toute l’ambition est d’entretenir autour d’eux le bruit et l’adulation pourraient-ils admettre la discrétion de ceux qui fuient ces satisfactions aussi vaines que grossières ? C’est faire injure à leur vanité que de ne pas la partager.
Ch.-L. Philippe a écrit à propos du Prix Goncourt :
« N’êtes-vous pas d’avis que nous devrions tous nous unir et faire quelque chose pour nous défendre contre l’Académie Goncourt, qui nous fait à tous le plus grand tort ? Nous devrions nous voir. Il ne s’agit plus aujourd’hui, pour les écrivains, d’avoir du talent, mais d’avoir le Prix Goncourt. »
Or, les prix littéraires se sont multipliés depuis le Prix Goncourt. Des éditeurs ont vu quel moyen de réclame ils constitueraient auprès de la foule qui suit le snobisme. Mme Rachilde a dépeint ainsi la situation : « Si on connaissait comme moi — qui entends les cris et les réclamations des jeunes gens dupés — le fond vaseux que remue la trombe des prix littéraires, on serait absolument épouvanté du résultat obtenu. Ah ! Que ne les a-t-on laissés œuvrer en silence ! Et leurs éditeurs, crocodiles versant des larmes d’attendrissement quand ils n’ont pas édité... l’autre ! Quelle poussée de furoncles ! Quelle ruée de névroses et quelle mêlée de bandits au coin du bois sacré ! » Les éditeurs ont constitué des « écuries » d’auteurs qui sont leurs « poulains » et qu’ils font « courir ». C’est à celui qui arrivera le premier au poteau. Sur ce « turf » d’un nouveau genre, tous les maquillages, toutes les intrigues, tous les chantages, toutes les filouteries se pratiquent au nom de la littérature. On lance des « favoris », il y a des « handicaps » et des « outsiders » l’emportent pour la joie ou la colère des « parieurs ». Un bluff cynique est organisé. Des prospectus vantent des « chefs-d’œuvre » qui sont encore dans les limbes ; les « génies » poussent comme les mauvaises herbes et encombrent la littérature de leur chiendent. Dans cette époque extraordinaire où nous vivons, les gens « unique au monde » sont plus nombreux que les simples mortels qui sont comme tout le monde, et ce n’est pas un des moindres miracles de la démocratie. Des sociétés en commandite se forment pour le lancement d’un « producteur » littéraire. On met des écrivains en « actions ». Les boutiques rivales se font la concurrence la plus déloyale. La littérature industrialisée se fabrique en série et se vend comme les produits interchangeables de la mécanique et de la pharmacie. Elle parcourt les routes et le ciel à des centaines de kilomètres à l’heure. Elle salit les paysages de ses poteaux réclames. Elle est taylorisée, stabilisée, revalorisée, rationalisée, contingentée, positionnée, compartimentée, stockée, warrantée suivant le jargon du jour et suivant toutes les formules que les mercantis, triomphants dans tous les domaines, ont inventées pour exploiter le travail humain et piper la clientèle.
Les jeunes gens de lettres, emportés dans ce mouvement qui leur vide le cerveau, le cœur et les entrailles, sont, disent-ils, « pour l’action ». Ils agissent suivant le courant du jour qui soumet un monde de plus en plus détraqué à l’exploitation capitaliste, à la dictature prétorienne, à la pourriture politicienne et au gâtisme néo-catholique. Il leur faut des réalisations. Leurs syndicats veulent « réunir tous les moyens pratiques destinés à les imposer à l’attention de l’opinion et des pouvoirs publics ». Dans l’industrie usinière, où l’on pratique l’exploitation du « matériel humain » suivant les méthodes américaines adoptées par le « collaborationnisme » syndicaliste, on n’accepte déjà plus de travailleurs au-dessus de quarante ans. Les vieux ouvriers n’ont plus qu’à « débarrasser le plancher » devant les jeunes qui les poussent. Dans l’industrie littéraire il en est de même. Un des « capitaines » actuels de cette industrie, M. Mauriac, a écrit : « Qu’attendre d’un homme de cinquante ans ? Nous ne nous y intéressons que par politesse et nécessité ». La politesse est encore superflue, elle n’est plus que l’hypocrisie du muflisme (voir ce mot).
Voilà les « réalisations » de la « jeune industrie littéraire ». La plupart de ces messieurs ont vu leurs pères à l’œuvre, dans la cynique curée des profits de guerre ; ils ont été à bonne école. Faire une œuvre d’art est aujourd’hui « une perte de temps, une erreur », et M. de Montherlant, qui dit cela, ajoute :
« Balzac, Flaubert, nobles poussahs, vrillés à vos tables, vous avez manqué la vie. »
Eux, paraît-il, ne la manquent pas, surtout lorsqu’ils tirent sur celle des autres. Réussir la vie, c’est être un « as » dans une des formes infinies d’escroqueries qui font la vie sociale. C’est bousculer, piller, être sans pitié et sans scrupules, c’est avoir du tempérament au lieu de conscience, de l’estomac au lieu de cœur ; c’est savoir vaincre la raison par la brutalité, l’argument par le coup de poing. On verra ce qu’elle aura été « leur vie » lorsqu’ils auront cinquante ans, si d’ici là ils n’ont pas fait la justicière culbute avec le vieux monde tourneboulé. Car ce n’est pas la première fois qu’on voit l’insolence d’une époque où la dictature du sabre, la fourberie politicienne, religieuse et mercantile, la stupidité de l’argent, s’imposent à toutes les formes de la vie et écrasent la pensée. On les a déjà vues ces choses dans le passé, et chaque fois elles se sont écroulées sur les « surhommes » qui les avaient produites, elles ont mis au tombeau les prétendues civilisations où elles s’étaient manifestées.
Les hommes qui sont ou veulent être d’action devraient méditer cette grande pensée de Gœthe :
« Agir est facile, penser est difficile, agir selon sa pensée est encore plus difficile. »
Il est toujours facile de faire des gestes sans conscience, des gestes d’hurluberlu ou d’automate ; on n’a qu’à suivre le troupeau qui va aux urnes, à la messe, à l’abattoir. Il est moins facile de penser, surtout par soi-même, d’observer, de réfléchir, d’apprendre à donner personnellement une direction intelligente à ses actes. Et il est plus difficile d’accorder des actes avec sa pensée parce qu’il faut marcher à l’encontre du troupeau qui ne pense pas lutter contre ceux qui font fonction de penser pour lui et contre lui. Si chaque individu apprenait à penser avant d’agir, il accomplirait moins d’actes stupides et malfaisants dus à l’habitude, l’ignorance, l’obéissance passive. Il comprendrait que la véritable action, productrice de bien-être et de bonheur, est en dehors de ceux qui agissent sans penser ou en pensant d’après les autres. Si chacun pensait ainsi, il lui deviendrait plus facile d’agir selon sa pensée, car il trouverait dans celle solidaire des autres la volonté du bien-être et du bonheur de tous.
« La grandeur des actions humaines se mesure à l’inspiration qui les a fait naître », a dit Pasteur. Ce n’est pas pour rien que la religion interdit à l’homme de penser et de discuter, qu’elle exige une obéissance aveugle perende ac cadaver. Ce n’est pas pour rien non plus que la même soumission est imposée dans l’armée. Un roi de Prusse disait, à la vue de ses soldats alignés :
« Heureusement qu’ils ne pensent pas!... »
C’est parce que religieux et soldats ne pensent pas qu’il est si difficile à ceux qui pensent d’agir selon leur pensée. Le jour où ils seraient capables de penser, ils comprendraient la malfaisance de leur rôle contre la pensée qui veut agir et ils rendraient l’action de cette pensée facile en jetant leurs souquenilles et leurs armes aux orties pour travailler avec elle à l’œuvre de libération humaine. Les gens de lettres ne peuvent trouver cette libération que dans la forme indiquée par Panaït Istrati, disant : « Fi de l’art payé ! L’art, cri du cœur, élan pur et généreux, la société l’offense en en faisant un objet mercantile... Lorsque chacun, comme il se doit, aura du pain et un logis, lorsque chacun, comme il se doit, travaillera quatre heures par jour à un travail bien rétribué alors on connaîtra les vrais artistes, ceux qui écrivent, peignent, sculptent, composent, non pour le besoin de leur ventre, mais parce que l’art est en eux ». Il en sera ainsi le jour où, ayant appris eux aussi à penser, les gens de lettres agiront selon leur pensée. Ils apporteront alors aux lettres, non les grâces flétries et maquillées du putanat intellectuel, mais la véritable gloire.
— Edouard ROTHEN
LETTRES (SOCIÉTÉ DES GENS DE)
La fondation de cette société date de 1838 et avait été précédée de celle de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, en 1829. Les deux ont pour objet d’assurer aux auteurs la propriété de leurs œuvres, de percevoir leurs droits de représentation et de reproduction. Elles sont aussi des organisations de secours mutuels pour venir en aide à leurs membres et leur procurer une pension de retraite.
Dans un état social où l’art est détourné de sa véritable destination et considéré comme une marchandise soumise à la façon de toute autre à la loi de l’offre et de la demande, il paraît normal que ceux qui le produisent défendent leurs intérêts professionnels et veuillent s’assurer par lui la sécurité de leurs vieux jours ainsi que des boutiquiers ou des ouvriers. Il n’y aurait rien à redire dès lors à l’existence de ces sociétés si elles se cantonnaient dans les buts qu’elles se sont donnés. Mais elles sortent parfois de leur rôle pour des manifestations regrettables qui montrent trop leur défaut d’indépendance en face des puissances officielles et leur état de sujétion aux dispensateurs de finance et de notoriété. Elles aggravent ainsi la situation de l’art au lieu de la relever.
La Société des Gens de Lettres, comme l’Académie, prend trop souvent un parti peu reluisant pour elle dans les cas où l’honneur de la pensée en général, celui des lettres en particulier, exigerait plutôt le parti contraire, tout au moins l’abstention et le silence, Elle est trop préoccupée de flatter le pouvoir, de considérer le faux mérite à la place du vrai, de favoriser l’arriviste aux dépens du véritable artiste et de lancer le coup de pied de l’âne au lion malade.
Si elle ne suivit pas le grotesque Xavier de Montépin demandant la radiation de Victor Hugo parce qu’il avait offert l’hospitalité aux proscrits de la Commune elle renia ceux de ses membres qui furent de ces proscrits : Razone, Paschal Grousset, Félix Pyat, Jules Vallès. Elle prit parti à sa façon, celle du pouvoir, dans l’affaire Dreyfus en examinant s’il n’y avait pas lieu de chasser Zola de son sein. Pudiquement, elle laissa coller un pain à cacheter à l’endroit de la Légion d’honneur sur le portrait de l’auteur de : J’accuse!... Séverine a raconté ces choses et elle les a complétées par un jugement de Vallès où il a flétri comme il convient tant de domestiques et de tripoteurs de lettres au milieu desquels se trouvent de trop rares consciences. Nous en extrayons ces lignes à propos de sa réintégration dans la Société des Gens de Lettres, lorsqu’après l’amnistie officielle la Société ne risquait plus d’indisposer contre elle les dispensateurs de croix, et de faveurs. Elles complètent ce que nous avons écrit au sujet des gens de lettres : « ...Vallès a été réintégré dans les cadres, Grousset le serait fin courant, s’il y tenait, et ils verraient accourir à eux, la lèvre souriante, ceux qui s’écartaient jadis en criant : Raca !
C’est pour cela que je n’ai point pris aujourd’hui le chemin de la rue Geoffroy-Marie. Il est dur de refuser la main à de certaines gens ; plus dur encore de l’accepter de certaines autres. Il y a des offres de raccommodement qui font rougir pour qui les tente. C’est celui-là même souvent qui fêla le verre du camarade exilé et cracha dedans. Il a beau, maintenant, essuyer du doigt et de la langue le verre rapiécé, je ne veux pas de ce verre-là pour trinquer... On est fier d’avoir excité tant d’envies, d’avoir provoqué tant de haines ! Il s’y mêle de la gaieté. Ceux qui ont commis une lâcheté doivent garder cela comme de la vermine sur la peau, comme les poux dans la couture des culottes. Ils se cachent pour se gratter, mais on sent tout de même qu’ils ont le derrière en feu. Allons ! Mieux vaut avoir été visé à la tête et avoir trainé une croix pesante sur un grand Calvaire »... Oh ! oui ! comme concluait Séverine.
— Edouard ROTHEN
LEVIER
n. m. (rad. lever)
La valeur du travail étant égale au produit de la force par le déplacement, on a cherché, à l’aide de machines simples, à transmettre l’action des forces de manière à rendre le travail plus aisé. Le levier, qui suppose essentiellement un point d’appui, une puissance et une résistance, est la principale de ces machines simples. On en distingue de trois genres, selon la disposition des éléments. Son importance est considérable en mécanique, qu’il s’agisse d’appareils primitifs ou d’appareils très compliqués ; les organismes vivants comportent eux aussi tout un ensemble de leviers.
Du domaine physique, le terme levier est passé dans le domaine moral où il désigne l’adjuvant fondamental, le ressort essentiel d’une entreprise ou d’une affaire....
On connaît l’exhortation fameuse de Danton : « Quoi ! Vous avez une nation entière pour levier, la raison pour point d’appui, et vous n’avez pas encore soulevé le monde ? » L’inspiration, l’enthousiasme le sentiment, sont les puissants leviers des œuvres d’art et des actions généreuses : talents et vertus y trouvent, avec l’élan, des possibilités de réalisation et une puissance de pénétration multipliées... Ceux-là qui virent les jours naissants de la démocratie, et mirent en elles d’ardentes et loyales espérances, seraient aujourd’hui navrés de ses déviations et de ses chutes, du ravalement de son idéal à un étal grouillant d’affaires et d’exhibitions vaniteuses. Ils y verraient le peuple, levier primaire et qui devait sortir grandi, magnifié par son effort, redevenu l’inconscient pavois de castes nouvelles. Ils rediraient avec quelque mélancolie la proclamation, riche de promesses, mais qu’un demi-siècle a suffi pour jeter au tombeau, d’Anatole de La Forge : « La démocratie que nous servons n’a qu’un levier, le travail ; qu’un but, la liberté ». Ils trouveraient, sur le travail toujours enchaîné, la jouissance triomphante du parasite, encore roi !
La presse est devenue à notre époque le levier permettant de soulever l’opinion ; et ce levier malheureusement est réservé, dans l’ensemble, aux entreprises de réaction. L’église, l’école, les divers moyens de diffusion de la pensée en sont d’autres, aux mains de nos adversaires. Car l’or est devenu l’objet des convoitises universelles, et ceux qui le possèdent en abondance sont les vrais maîtres du monde contemporain. La chose est manifeste en Amérique où le confort matériel et la religiosité de mode cachent mal la royauté des milliardaires ; elle n’est pas moins certaine en Europe où elle se colore de patriotisme, de moralité et de mille prétextes inventés par les larbins des puissants. Aucun des leviers du monde actuel n’est entre les mains d’esprits libérés ; ces derniers n’ont pour eux que la justice et la vérité, choses de peu de valeur aux yeux de nos potentats, mais qui possèdent assez de force latente espérons-le, pour vaincre les tortionnaires du genre humain dans un avenir lointain ou proche.
LIBELLE
n. m. (latin libellus ; diminutif de liber, livre)
On appelle ainsi un petit écrit, injurieux et diffamatoire. Cette caractéristique le distingue du pamphlet (voir ce mot) dont il n’a ni le désintéressement, ni l’envergure. Le libelle est toujours dirigé contre les personnes dont il attaque la vie privée, et il vise au scandale et à la déconsidération. Les Romains lui donnaient déjà ce sens que notre langue a conservé : il continue en effet à être pris en mauvaise part, et les qualités littéraires dont il peut s’orner, sa valeur satirique ne changent rien à son caractère et à la réprobation qui, d’ordinaire, l’accompagne.
« Ce mot a un peu varié depuis le latin, où il signifiait communément petit écrit ; le libellus famosus, de Suétone ne signifie proprement qu’ « une brochure qui a fait du bruit ». Tous les petits écrits ne sont pas essentiellement méchants et tous les écrits méchants ne sont pas essentiellement petits... Ces mots : « un gros libelle », qu’on a souvent occasion d’employer, sont un solécisme étymologique, mais bien consacré par la langue ... » (Ch. Nodier)
Depuis longtemps, les écrivains courageux et propres ont fustigé les faiseurs de libelles. Voltaire disait :
« La vie d’un forçat est préférable à celle d’un faiseur de libelles ; car l’un peut avoir été injustement condamné aux galères, et l’autre les mérite. »
Benjamin Constant voyait leur multiplication dans la condition de servitude où était tenue la presse :
« C’est l’esclavage de la presse qui produit les libelles et qui assure leur succès. »
Et encore :
« Plus on aime la liberté de la presse, plus on méprise les libellistes ... »
Mais l’amour-propre irritable des écrivains leur faisait assimiler parfois à la légère aux libellistes des critiques malins qui, lançant ouvertement leurs pointes, ne fuyaient pas la discussion, favorisaient même la riposte. D’autre part, les compressions de la pensée, plus pénibles encore sous l’ancien régime, et qui obligeaient à se cacher les écrivains audacieux, provoquaient ces aigres élans, exacerbés dans la concentration. Et l’atmosphère expliquait le pullulement du libelle si elle ne justifiait pas ses moyens. Le clergé n’était pas le dernier à user de ses flèches et le P. Garasse est demeuré le type des libellistes cléricaux...
Les législations antiques poursuivaient les libelles avec sévérité. La loi des Douze-Tables à Rome, les assimilait aux délits punissables des derniers supplices. Tibère en fit un crime de lèse-majesté... Avant la Révolution, en France, des peines sévères atteignaient les libelles. Un édit de 1561 proclame :
« Voulons que tous imprimeurs, semeurs et vendeurs de placards et libelles diffamatoires soient punis pour la première fois du fouet et pour la seconde fois de la vie. »
Les libelles, néanmoins, foisonnaient à cette époque et leur vogue s’étendit jusqu’à la fin de la Fronde. Citons, comme exemples de châtiments infligés, celui qui frappa Chavigny, auteur du Cochon mitré, libelle dirigé en 1689, contre l’archevêque Le Tellier : arrêté, il fut, pendant trente ans, enfermé au mont Saint-Michel dans une cage de fer. En 1694, un imprimeur et un relieur furent pendus en place de Grève pour avoir imprimé et vulgarisé des libelles contre Louis XIV à l’occasion de son mariage avec Mme de Maintenon. Le XVIIIème siècle eut aussi de nombreux auteurs de libelles, malgré les lettres de cachets et la rigueur des lois. Les Fréron, les La Baumelle, les Linguet lui donnèrent même par leur talent une certaine célébrité. De nos jours, le libelle est passible des peines prévues pour la diffamation. Dans une humanité où l’hostilité et l’entredéchirement n’ont pas cessé d’illustrer les mœurs le libelle a la vie dure, comme la calomnie elle-même. L’envie, la haine, les passions, l’esprit de dénigrement, les rivalités et les rancunes politiques y cherchent toujours leur assouvissement. Et l’anonymat dont il use le plus souvent, s’il sert sa méchanceté et favorise ses desseins, ne grandit pas le libelle, arme perfide.
La théologie appelait libelles des martyrs, la requête par laquelle des martyrs, ayant souffert pour leur foi, suppliaient l’évêque de remettre au pécheur une partie de la peine qu’il devait subir. Par libelles, elle désignait aussi les certificats, attestant qu’ils avaient sacrifié aux dieux, à l’aide desquels certains chrétiens se mettaient à l’abri des persécutions. Ce nom s’étend aux ouvrages hérétiques écrits sur quelque matière relative à la foi catholique : libelle d’Arius, de Pélage, etc. Il s’applique même à tout acte, signifié par écrit, en matière ecclésiastique : libelle d’excommunication, d’absolution, de pénitence, etc.
En jurisprudence, le droit ancien donnait à libelle le sens de requête, de signification. On disait libelle de fidélité, serment écrit de fidélité ; libelle de proclamation : action intentée en justice pour obtenir réparation ; libelle de divorce, dans les pays de droit romain, pour l’acte par lequel un époux annonçait à l’autre son intention de divorcer, etc.
— L.
LIBERALISME
n. m. (du latin liberalis)
Idées généreuses, tendance bienveillante au bonheur de toutes les classes de la société ; doctrine favorable aux libertés politiques, ensemble des opinions libérales, attachement aux idées libérales.
« Les souverains sont persuadés que le libéralisme est un masque pour conspirer contre les autorités légitimes. » (FOURIER)
Ensemble de ceux qui professent des idées libérales :
« Le libéralisme fera un pas et arrivera à la démocratie. »
Le libéral — à l’origine — était celui qui réclamait le progrès par la liberté et s’opposait à l’autorité plus ou moins absolue de la Royauté ou de l’Eglise.
Après la lassitude et l’épuisement qui suivirent la grande tourmente révolutionnaire et ramenèrent le despotisme de l’Empire, les principes de liberté proclamés en 1789, appliqués et suspendus alternativement pendant la Révolution, avaient disparu de la vie nationale. Eteinte la grande voix des précurseurs de la fin du siècle passé, noyées dans le sang les énergies créatrices qu’avait galvanisées une période de dévouement sans exemple à la cause du bien public, subjugués sous la crainte les esprits libres survivants, les publicistes rivés au silence, il fallut la chute de l’Empire pour délivrer les forces de liberté terrées ou assoupies et rendre son cours au grand mouvement qui avait tenté d’affranchir le monde et sur lequel un homme avait traîné ses bottes malfaisantes de conquérant...
Le parti libéral acquit toute son importance dans la première moitié du XIXème siècle, quand la Restauration ramena en France l’ancienne noblesse, avide de pouvoir, de richesses et de vengeance.
« La nation, qui se sentait jeune et forte, lutta courageusement contre ceux qui voulaient l’envelopper dans les haillons d’un régime décrépit. En face du parti théocratique et féodal de la cour, on vit s’élever un parti qui prit pour devise la liberté et reçut de ses ennemis mêmes le nom de libéralisme. » (Lachàtre)
Chansons d’abord, épigrammes, sociétés secrètes, inspirées du « carbonarisme » italien, courant d’opinion alimenté intellectuellement par les philosophes et les historiens sympathiques (les Guizot, les Villemain, les Cousin), lutte ouverte à la Chambre même contre le parti du pouvoir, telles furent les multiples formes de l’activité du nouveau parti. Guidés par des chefs valeureux, savants, éloquents, s’exprimant du haut des tribunes et par l’organe d’une presse brillante et combative, les libéraux furent le parti qui sut acquérir le plus de prestige et sauver quelques parcelles du patrimoine si meurtri de la Révolution.
Ils n’avaient que 6 députés à la Chambre de 1815, mais leur action s’appuyait sur la bourgeoisie commerçante et industrielle, et sur le peuple cherchant encore sa voix vers la liberté et l’égalité économique. Les ordonnances du 5 septembre 1816, brisèrent la Chambre ardente, d’où une nouvelle loi électorale plus large. Les chefs de l’opposition prennent alors le titre d’ « indépendants ». Ce sont : Le général Foy, qui avait servi sous l’Empire ; Benjamin Constant ; La Fayette, le père du libéralisme ; Dupont de l’Eure ; Casimir Périer ; Emile Jordan ; Royer-Collard ; le banquier Laffitte, etc.
De brillants avocats (Dupin, Mauguin, Barthe, Berville, etc.) défendaient avec éclat les causes politiques. Des brochures véhiculaient les théories que les journaux, enchaînés par la censure, n’osaient imprimer. On revenait aux philosophes du XVIIIème siècle, on publiait de nouveau leurs œuvres. Pamphlets, livres, publications frondeuses trouvaient leur chemin dans un terrain propice. Le passage, après la mort de Louis XVIII, des rênes de l’Etat aux mains des ultra-royalistes, travaillés de leur côté par la Congrégation, accrut la popularité de l’opposition et précipita ses progrès. Déjà, à la Chambre, où ses forces grandissaient, le libéralisme s’appuyait sur des fractions influentes de la bourgeoisie et de la banque. La presse, le barreau, des hommes remuants des professions libérales et du monde des affaires, une jeunesse ardente, soutenaient activement ses campagnes.
Les chefs du parti libéral sentirent bientôt que, prises aux espérances de leurs diatribes enflammées, attirées dans le remous de leur mouvement passionné, des masses impatientes, agitées par des revendications inattendues, menaçaient de les entraîner au-delà de leurs buts modérés. Leurs aspirations n’avaient rien de révolutionnaire et un Martignac put un instant canaliser leurs vœux dans les cadres de la dynastie régnante. Une monarchie mitigée de libéralisme et faisant à la bourgeoisie sa part d’influence eût satisfait des intérêts qui redoutaient les perturbations des grandes vagues populaires. Leurs troupes cependant, accentuant, dépassant la portée d’une opposition parlementaire déjà vigoureuse, avancèrent leur évolution. Le libéralisme trouva dans le peuple un élément de victoire définitive aux « trois glorieuses de 1830 ». Les libéraux furent maîtres du pouvoir...
Ils y devinrent ce que leur position fait invariablement de ceux qui règnent sur les peuples. « Ils renièrent leur passé et, comme ils devaient à leur tour profiter des abus, ils mirent toute leur adresse à les maintenir ». Majorité, les opposants d’hier devinrent les pires conservateurs. Ils reprirent le sillage de la Restauration, écartant et frappant ceux qui réclamaient le prix de quinze ans de lutte et des sacrifices de juillet appuyant de leurs lois et de leur propagande l’état de choses établi. C’est l’heure où le socialisme élabore ses théories sociales, s’attaquant à la base même de l’ordre : la propriété individuelle. Et les masses déçues reporteront vers lui leurs espoirs...
Les économistes libéraux, dans tous leurs ouvrages d’Economie Politique, s’appliquent à disqualifier le socialisme, à soutenir le bien-fondé de l’ordre actuel.
« Sa doctrine (Ecole libérale) est fort simple et peut se résumer de la façon suivante :
Les sociétés humaines sont gouvernées par des lois naturelles que nous ne pourrions point changer, quand même nous le voudrions, parce que ce n’est pas nous qui les avons faites, et que du reste nous n’avons point intérêt à modifier, quand même nous le pourrions, parce qu’elles sont bonnes ou du moins les meilleures possibles. Le rôle de l’économiste se borne à découvrir le jeu de ces lois naturelles et le rôle des hommes et des gouvernements est de s’appliquer à régler leur conduite d’après elle.
Ces lois ne sont point contraires à la liberté humaine : elles sont au contraire l’expression de rapports qui s’établissent spontanément entre les hommes vivant en société, partout où ces hommes sont laissés à eux-mêmes et libres d’agir suivant leurs intérêts. En ce cas il s’établit entre ces intérêts individuels, antagoniques en apparence, une harmonie qui constitue précisément l’ordre naturel et qui est de beaucoup supérieure à toute combinaison artificielle que l’on pourrait imaginer.
Le rôle du législateur, s’il veut assurer l’ordre social et le progrès, se borne donc à développer autant que possible ces initiatives individuelles, à écarter tout ce qui pourrait les gêner, à les empêcher de se porter préjudice les unes aux autres, et par conséquent l’intervention de l’autorité doit se réduire à ce minimum indispensable à la sécurité de chacun et à la sécurité de tous, en un mot à laisser-faire. » Ch. GIDE (Ec. Pol.)
La Révolution de 1789 avait brisé le servage et le pouvoir absolu des rois. Elle avait donné tout ce qu’elle pouvait donner. Les principes qu’elle avait jetés de par le monde pouvaient germer, la Révolution leur demeurerait étrangère. Le peuple avait cru trouver plus de liberté, plus de bien-être, plus d’égalité ; or, cela s’était traduit dans les faits par la liberté absolue d’exploitation, par l’enrichissement rapide de la bourgeoisie, par la naissance d’un prolétariat miséreux moralement et matériellement.
Les grands courants qui avaient soulevé le peuple, socialistes dans leur essence, étaient déjà bien indiqués dans la conspiration de Babeuf.
« Une réforme est toujours un compromis avec le passé, elle se borne à le modifier plus ou moins ; tandis qu’une révolution plante toujours un jalon pour l’avenir : si petit qu’il soit, le progrès accompli par la voie révolutionnaire est une promesse d’autre progrès. L’une se retourne en arrière, l’autre regarde en avant et dépasse son siècle. Toute l’histoire est là pour le prouver, et c’est précisément ce qui arriva lors de la Révolution de 1789–93.
Si bourgeoise que fut cette révolution quant à ses résultats, c’est elle qui féconda le germe du communisme et de l’Anarchie au sein de la société moderne. Ceux qui veulent nous faire croire aujourd’hui que la Révolution n’avait d’autre but que d’abolir les derniers vestiges du féodalisme et de restreindre l’autorité royale, font preuve d’ignorance ou de mauvaise foi. Un peuple entier ne se soulève pas pour si peu de chose : il ne se met pas en révolte ouverte pendant quatre ans, avec le seul but d’abolir une institution moribonde ou de changer de gouvernement. Pour qu’une révolution aussi considérable que celle du siècle passé vienne à éclater, il faut qu’un flot d’idées nouvelles circule dans les masses, qu’un monde nouveau se dessine dans les esprits, basé sur des rapports nouveaux, une morale nouvelle, une vie nouvelle. » (P. KROPOTKINE : Un siècle d’attente)
Avec Robert Owen, Fourier, Saint-Simon, etc., le socialisme s’inscrit en lettres d’or au fronton du XIXème siècle (Voir Familistère). Les libéraux au pouvoir, maintiennent le suffrage restreint, s’essayent à consolider l’œuvre de la Révolution bourgeoise. Mais le peuple conscient de la duperie du nouvel ordre social, affirme de plus en plus son désir de justice distributive des richesses et de la liberté ; il se soulève en 1848 et chasse Louis-Philippe, roi libéral.
Un instant débordés, les libéraux se reprennent, font alliance avec la réaction et les Jésuites, et en juin massacrent les ouvriers parisiens, qui demandaient du pain, les ateliers nationaux venant d’être fermés par ordre du gouvernement libéral. Le général Cavaignac « républicain libéral », dont la mère était pénitente du Jésuite fameux, le R. P. de Ravignan, se chargea de cette odieuse répression.
A genoux devant l’Empire, les libéraux n’acceptèrent la République que lorsqu’ils furent assurés que leurs privilèges ne seraient pas touchés. C’est eux, avec Thiers, de sinistre mémoire, qui écrasèrent la Commune, en 1871, et massacrèrent 35.000 hommes, femmes et enfants.
Harcelés par les diverses écoles socialistes, syndicalistes et anarchistes, les libéraux ne se distinguent plus des autres écoles de conservation sociale. Le temps a passé d’ailleurs des solutions ambiguës du libéralisme. Les préoccupations superficielles des monarchies constitutionnelles, voire des républiques démocratiques, aux retours décevants, les aspirations politiques, même teintées de socialisme utopique, se sont, dans le sang vain des émeutes et les tentatives avortées révélées insuffisantes. La générosité du sentiment, jugulée par la hiérarchie tenace des conditions, s’est avérée impuissante à asseoir, par ses propres moyens, l’équité au conseil des peuples. Un souci plus profond, davantage averti — au contact de l’industrialisme — des maux qui rongent la société, va porter vers l’économie sociale l’attention des philosophes et des économistes. Et la sociologie fera ses premières études, sondera les causes du déséquilibre général, lancera ses premiers manifestes, proposera aux penseurs désintéressés et aux victimes permanentes du travail, la révision des valeurs sociales et le bouleversement d’une économie faussée à la base... Le libéralisme appartient au passé incapable et timide : il n’a plus qu’à mourir !
« Tout a été essayé, et tout a échoué. C’est alors que renaît dans les esprits cette philosophie du XVIIIème siècle — germée dans les masses, énoncées par les penseurs anglais et français, essayée dans ses ébauches d’application par la France de 1793 — et qui, se développant depuis, s’élargissant, gagnant en profondeur, s’appelle aujourd’hui le communisme anarchiste.
Ses principes sont bien simples : — Ne cherchez pas à baser votre bien-être et votre liberté sur la domination d’autrui ; en maîtrisant les autres, vous ne serez jamais libre vous-mêmes. Augmentez vos forces productives en étudiant la nature : ses forces mises au service de l’homme sont mille fois supérieures à celles de toute l’espèce humaine. Affranchissez l’individu ; car, sans la liberté de l’individu, il n’est point de société libre. N’ayez confiance, pour vous émanciper, en aucune aide spirituelle ou temporelle : aidez-vous vous-mêmes. Et, pour y arriver, débarrassez-vous au plus tôt de tous vos préjugés religieux et politiques. Soyez hommes libres, et ayez confiance en la nature de l’homme libre : ses plus grands vices lui viennent du pouvoir qu’il exerce sur ses semblables ou du pouvoir qu’il subit. » (Kropotkine, Un siècle d’attente)
L’Etat, qu’il soit de « droit divin » ou issu des majorités, est toujours le mécanisme d’oppression de la classe possédante. Il n’a d’autre but que de garantir l’exploitation des richesses et des individus par ceux qui se sont approprié le sol et les instruments de travail.
La liberté du pauvre, du prolétaire, n’est que la liberté de crever de faim. L’égalité devant la loi n’est que la puissance policière et armée au service des possédants, ceux-ci faisant seuls les lois.
L’économie politique (V. Leroy-Beaulieu, Bastiat, etc.) étudiait les phénomènes de la production des richesses et de leur répartition en partant de ces prémisses « libérales » que cela est de droit naturel, que cela est très bien, et qu’il n’y a qu’à « laisser-faire » ; devant l’absurdité de ces méthodes et le néant des résultats devant le paupérisme moral et matériel persistant la science sociale est née, qui ne se contente pas d’étudier les phénomènes sociaux, mais qui en dénonce les erreurs et propose une nouvelle économie plus rationnelle, plus humaine, tendant à réaliser les aspirations vers le bonheur, qui propulsent l’effort des individus.
Contre le nationalisme des libéraux, la science sociale dresse l’internationalisme, l’antipatriotisme, faisant ainsi disparaître les guerres et annulant la grande dispute des « protectionnistes et libre-échangistes ». Face à l’appropriation individuelle du sol et des instruments de travail, source de privilège et d’oppression, elle propose l’appropriation collective du sol et des instruments de travail, laissant au producteur la libre disposition de ses produits. A la réglementation politique des nations, à l’Etat, elle entend substituer le libre contrat des individus, l’association. Enfin, aux vieilles métaphysiques, elle oppose la libre recherche des cerveaux dans tous les domaines : la science.
« La civilisation qui naquit en Europe après la chute des civilisations imprégnées du despotisme asiatique, a mis quinze cents ans pour se débarrasser des entraves que l’Orient lui a laissées.
Non seulement elle eut à repousser les invasions armées de l’Orient, à arrêter le flot des Huns, des Mongols, des Turcs et des Arabes qui envahissaient ses plaines et ses presqu’îles, elle eut aussi à combattre les conceptions politiques de l’Orient, sa philosophie, sa religion. Et, dès qu’elle commença à s’en affranchir, elle créa d’un bloc cette science moderne qui lui permit en un siècle de changer la face du monde, de centupler ses forces, de trouver la richesse dans le sol, de contempler l’univers sans crainte. Elle a brûlé les fétiches importés de l’Orient : Dieu, gouvernement, propriété privée, loi imposée, morale extérieure. La pensée affranchie ne les reconnaît plus.
Reste maintenant à les brûler en réalité, après les avoir brûlés en effigie. Reste à démolir cet échafaudage qui étouffait la pensée, qui empêche encore l’homme de marcher à la liberté. Et ce problème, l’histoire nous l’a imposé, nous, hommes de la fin du XIXème siècle.
Les siècles ont travaillé pour nous. Forts de leur expérience, nous pouvons, nous devons, nous montrer à la hauteur de notre tâche historique. » (Kropotkine, op. c.)
— A. LAPEYRE
LIBERTÉ
n. f. (latin libertas, de liber, libre)
DÉFINITIONS, ACCEPTIONS
Etat, condition d’une personne qui n’est pas la propriété de quelqu’un, d’un maître.
« La liberté des personnes a déterminé la chute du régime féodal. » (Proudhon)
Etat d’un peuple ou, plus exactement, jusqu’à nos jours, d’un Etat qui ne subit pas la domination étrangère.
« Un millier de Grecs combattant pour la liberté, triomphèrent d’un million de Perses. » (Vergniaud)
Etat de qui n’est pas captif, prisonnier : donner la liberté à un oiseau, rendre la liberté à un condamné, le libérer. Faculté d’agir qui n’est entravée ni par une autorité arbitraire ni par des lois tyranniques : c’est le sens courant du mot liberté dans le domaine politique. Nous verrons, nous avons vu déjà qu’il n’y a pas d’autorité sans arbitraire, de lois sans tyrannie, et que la liberté politique est un leurre au sein des systèmes qui demandent à ces principes et à ces formes leur justification et leur stabilité. Nous verrons aussi qu’il n’y a pas de liberté politique sans liberté sociale et sans liberté individuelle (voir ces mots) que la liberté, pour des hommes vivant en société, est un tout connexe et qu’il est vain de proclamer pour l’individu une liberté et des droits si les conditions qui les permettent ne sont pas réalisées ; si le milieu social ne leur en garantit la possibilité de fait et ne leur en assure l’exercice :
« L’empire de la raison publique est le vrai fondement de la liberté. » (J.-J. Rousseau)
« La liberté d’agir sans nuire ne peut être restreinte que par des lois tyranniques. » (Turgot)
« L’esprit soldatesque est la gangrène de la liberté. » (X. de Maistre)
« L’esprit public, qu’on attend pour permettre la liberté, ne saurait résulter que de cette liberté même. » (Mme de Staël)
« La plupart des peuples ont des libertés, mais peu jouissent de la liberté. » (Ch. Comte)
« La liberté est le pain que les peuples doivent gagner à la sueur de leur front. » (Lamennais)
« La liberté serait un mot si l’on gardait des mœurs d’esclaves. » (Michelet)
Faculté spéciale d’accomplir des actes d’une certaine nature : liberté de la presse, des transactions, etc...
« La liberté de l’enseignement est une garantie nécessaire de la liberté de conscience. » (Vacherot)
Absence d’entraves, de contrainte.
« Le sexe aime à jouir d’un peu de liberté : on le retient fort mal avec l’austérité. » (Molière)
Indépendance de position, loisir : mes travaux ne me laissent pas assez de liberté. Absence d’obstacle qui gêne les mouvements : un ressort qui ne joue pas avec la liberté nécessaire. Franc parler, propos, action hardis ou d’une excessive familiarité : prendre avec quelqu’un des libertés. Faculté de l’âme par laquelle elle se détermine par son propre mouvement ; liberté est ici synonyme de libre-arbitre.
« La liberté est l’antagoniste de tout ce qui est fatal. » (Proudhon)
« La liberté n’est que l’intelligence qui juge, qui délibère, qui choisit. » (Flourens)
« La liberté de l’homme n’est que le pouvoir de vouloir, ce n’est pas la faculté d’agir. » (A. Garnier)
Liberté naturelle, celle que l’homme possède de par sa nature, son origine, selon la thèse de certains philosophes.
« La liberté sort du droit de nature : l’homme est né libre. » (Chateaubriand)
Liberté morale, celle qui est la base, la condition de la moralité : d’après Kant, pour satisfaire à l’obligation morale, la liberté est nécessaire. Liberté individuelle : garantie du citoyen de ne pas être inquiété quand ses actes sont en accord avec les lois du pays ; au-delà de ce droit commence l’arbitraire que les gouvernants, gardiens officiels de la légalité, ne se font pas faute d’introduire dans les limites mêmes des lois quand ils jugent celles-ci insuffisantes pour leurs desseins : la liberté individuelle est encore aujourd’hui à la merci de la « légalité » souveraine du bon plaisir de nos maîtres. Liberté de conscience, des cultes, etc..., absence de contrainte dans le domaine des croyances, droit de pratiquer les rites de sa religion préférée, etc...
« La liberté de conscience, comme celle d’écrire, comme celle de commercer a eu son berceau en Hollande » (E. Laboulaye).
Liberté d’esprit : affranchissement des préoccupations qui gênent les fonctions de l’intelligence..., etc.
— L.
LIBERTÉ (PHILOSOPHIE)
Voir déterminisme et libre-arbitre, volonté, etc.
OUVRAGES A CONSULTER :
Philosophie de la liberté (Sécrétan) ; Système de logique, etc. (Stuart Mill) ; La liberté (Jules Simon) ; L’homme est-il libre ? (Renard) ; Essai sur le libre-arbitre (Schopenhauer) ; La solidarité morale (Marion) ; Justice et liberté (Goblot) ; Psychologie, Essais de critique générale (Renouvier) ; Leçons de psychologie (Rabier) ; Raison pratique (Kant) ; Critique philosophique (Pillon) ; Morale d’Epicure, etc. (Guyau) ; Les données immédiates de la conscience (Bergson) ; La morale (Duprat) ; Volonté et liberté (Lutoslawski) ; Le libre-arbitre (Naville) ; etc... Ainsi que les ouvrages mentionnés à déterminisme et volonté.
LIBERTÉ
Le problème de la liberté est un des problèmes les plus difficiles à résoudre parce qu’il essaie de concilier la liberté de penser et de vouloir qui nous paraît absolue avec le déterminisme objectif qui paraît également absolu.
La liberté pourrait se définir ainsi : possibilité pour l’individu de réaliser totalement son déterminisme. Ce déterminisme ne se précise à notre entendement que par des pensées et des vouloirs, lesquels se traduisent et s’extériorisent par des actes modifiant le milieu conformément à notre volonté. Si le jeu de notre pensée, si nos réflexions, nos préférences, nos choix, nos jugements peuvent s’exercer en nous sans aucune limite apparente et nous donner l’impression d’une liberté intérieure absolue, la réalisation objective de nos volontés rencontre au contraire des obstacles nombreux réduisant considérablement notre liberté d’action. Cette résistance extérieure contraignant notre volonté, entravant notre action, constitue la limite même de notre liberté et par conséquent sa cessation.
Ainsi donc, d’une part, nous avons conscience d’une liberté intérieure absolue ; de l’autre, nous avons également conscience que cette liberté se heurte à des difficultés s’opposant à son épanouissement... Pour concilier ces deux aspects du problème il est nécessaire de les étudier séparément, à seule fin de connaître la réalité même du moi volontaire, son origine, sa formation, ses attributs, ses manifestations ; ensuite d’analyser les causes extérieures restreignant son expansion.
L’analyse introspective ne nous renseigne point sur la formation de notre moi. Nos plus lointains souvenirs se perdent dans l’inconscience du premier âge. L’étude objective nous permet au contraire de suivre la formation des êtres s’engendrant les uns les autres et de reconnaître quelques principes généraux s’appliquant à la détermination des phénomènes vitaux. C’est ainsi que l’observation nous montre l’hérédité et l’éducation jouant un grand rôle dans la formation des individus. Chaque espèce animale se reproduit suivant son type moyen et, comme l’on dit judicieusement, les chiens ne font pas des chats. Si les caractères physiques généraux des parents se reproduisent dans les enfants, les caractères psychiques s’y retrouvent également, quoique la fécondation croisée, mêlant l’hérédité du père et de la mère, crée un être nouveau différant quelque peu de ses parents. Mais il est facile de comprendre que le moi de l’enfant est inévitablement la conséquence des innombrables croisements ancestraux l’ayant précédé et qu’il ne peut pas plus choisir son caractère que la couleur de ses cheveux. Il est un produit, un résultat. Il en est de même de l’éducation. Subissant l’influence du milieu, il réagit contre ce milieu suivant ses facultés naturelles et héréditaires et toutes ses perceptions, ses souvenirs, actions et réactions subies dans l’espace et dans le temps constituent sa personnalité...
Le moi n’est donc pas quelque chose d’immuable, d’éternel, d’absolu, ni de sacré. Il est une forme physiologique et psychique momentanée de l’être sans cesse soumis aux lois de l’évolution et ses manifestations ne sont que l’expression de son acquis héréditaire et éducatif. Formuler une volonté, c’est traduire une réaction esquissée probablement par un ancêtre lointain, complétée par une éducation subie suivant les hasards de la vie. S’accepter tel que l’on est, réaliser ses vouloirs sans réflexions profondes c’est peut-être obéir à la tyrannie d’un ancêtre, ou se courber sous une éducation mystique ou malfaisante qui nous a déformés.
Nous voyons donc que la conscience de notre liberté ne signifie rien, car le dément se croit aussi libre que l’homme sain. C’est le jugement, la raison, l’évaluation exacte des choses qui doivent seulement nous guider et non pas notre fantaisie et notre bon plaisir ; lesquels d’ailleurs peuvent être complètement opposés à notre bonheur véritable et à la conservation même de notre vie. La liberté pourrait alors s’exprimer comme la possibilité d’agir selon notre raison.
Même en ce cas les obstacles à notre déterminisme raisonné subsisteront et nous pouvons les étudier suivant leurs aspects différents ; soit que ces obstacles soient naturels ; soit qu’ils soient sociaux ; soit enfin qu’ils proviennent de notre nature même, d’une erreur de jugement. Les obstacles naturels sont constitués par toutes les lois naturelles inévitables dont l’homme triomphe parfois par leur connaissance et leur compréhension. Ce n’est que par l’étude des propriétés de la substance et de l’énergie ; c’est en se pliant aux nécessités objectives en harmonie avec les phénomènes vitaux que l’homme atteindra son maximum de puissance et de joie et non en suivant irrésistiblement ses penchants, produits lointains de l’ignorance et de l’animalité.
Les obstacles sociaux peuvent s’analyser au double point de vue présent et futur. Présentement les préjugés, les habitudes, les mœurs, les coutumes, les traditions, les lois, fruits mauvais de l’ignorance passée, constituent des entraves considérables à une liberté raisonnée. Nous devons détruire ces causes malfaisantes éternellement opposées à toute amélioration de la vie humaine. Mais toute société quelle qu’elle soit ne peut se réaliser qu’avec une certaine harmonie, un rythme, une coordination de l’activité humaine, assurant la cohésion des efforts et non leur dispersion. L’examen impartial des difficultés d’organisation sociale démontre les nécessités inéluctables inhérentes à toutes associations, à toutes collectivités et les obligations individuelles résultant du fait même de l’association. La conception religieuse et métaphysique de la liberté développe malheureusement dans l’esprit des humains une conception tendant à représenter la vie sociale comme une contrainte s’opposant à la liberté individuelle. C’est supposer, bien gratuitement, que l’homme est naturellement libre et que sans la dite société il le serait vraiment. Il suffit d’observer le fonctionnement du corps humain pour voir que ce corps est soumis à des nécessités physiologiques que notre caprice peut déséquilibrer, ou vouloir ignorer, mais que la sagesse nous conseille de satisfaire raisonnablement. Nous ne sommes pas libres, si nous voulons vivre dans la joie, de nous rendre malade, de nous faire du mal et d’en faire aux autres. Nous ne devons vouloir et désirer que ce que notre raison nous montre comme convenant à notre volonté d’harmonie.
Il en est de même au point de vue social. Si la vie collective présente des avantages et s’impose par la nécessité de lutter contre les forces naturelles ; si l’homme augmente ainsi sa puissance et ses loisirs, il n’est pas raisonnable de dire qu’elle est une contrainte puisqu’au contraire elle est une moindre contrainte que l’état naturel où l’homme est infiniment plus absorbé par la lutte pour la vie. L’association étant utile et nécessaire à l’homme nous devons conclure qu’elle augmente sa puissance d’action individuelle au lieu de la diminuer. Tout le reste est du mysticisme.
Cela ne veut pas dire que toutes les formes sociales soient bonnes. L’ignorance et la bestialité pèsent encore sur l’humanité et le passé héréditaire et traditionnel nous étreint de toutes parts. Les formes autoritaires actuelles nécessitées par les luttes d’autrefois s’opposent à la transformation des humains, à leur évolution progressive vers l’entente harmonieuse et fraternelle. Les meilleures formes sociales seront données par l’expérience, aidée par l’observation et le bon sens de chacun. C’est en laissant les individus se grouper selon leurs conceptions particulières, s’isoler même si cela leur convient, après partage du bien collectif et de l’héritage social, que les meilleures sociétés se réaliseront.
Ce n’est, il est vrai, que de l’empirisme social, mais cet empirisme est infiniment moins dangereux que de fausses sciences sociales, fabriquées artificiellement sur de courtes durées, selon des états sociaux transitoires et trompeurs. La vraie science sociale ne se créera que sur l’observation même de la vie ; sur les manifestations profondes de l’activité humaine, par l’étude des conditions subjectives et objectives favorisant le développement des individus. Il est alors probable que la notion métaphysique de la liberté disparaîtra ; que le bon plaisir tyrannique cessera pour faire place à un concept plus exact et plus fécond pour la vie individuelle et sociale : la volonté d’harmonie. Volonté d’harmonie individuelle : coordination raisonnée des pensées et des gestes individuels pour la réalisation de sa vie dans la joie. Volonté d’harmonie sociale : coordination raisonnée des gestes sociaux pour réaliser le bien-être et la fraternité.
Ainsi notre volonté d’action et les résistances objectives se trouveront conciliées par notre raison, par notre volonté d’harmonie. Mais n’oublions pas que toute volonté extérieure contraignant cette volonté d’harmonie est une tyrannie ; que la seule détermination de l’homme doit être sa propre raison et que rien de durable et de bon ne se construit sur la violence destructrice de toute raison.
— IXIGREC
LIBERTÉ
Faculté de faire ce que l’on veut, et de se refuser à faire ce que l’on ne veut pas, sans que soient opposés, à la manifestation de la volonté, un obstacle ou une sanction quelconques.
La liberté de l’homme au sein de la nature est très limitée — si tant est qu’elle ne soit point complètement une illusion provenant de l’ignorance où nous sommes des causes déterminantes de la plupart de nos actions. Nous sommes obligés de compter avec les lois naturelles et de nous adapter à leurs exigences, sous peine de souffrance, de maladie, et de mort. Les influences de l’hérédité et du milieu dans lequel nous avons été appelés à vivre, pèsent très lourdement sur notre constitution anatomique et physiologique, et sur nos caractéristiques intellectuelles. Nous ne pouvons supprimer le vieillissement consécutif à l’usure de nos organes. Il ne nous est pas loisible d’échapper au trépas final, quels que soient les efforts que nous ayons faits pour en retarder la venue. Enfin, le souci de nous assurer — non pas même le confort et les plaisirs auxquels nous sommes profondément attachés — mais simplement le minimum de ce qui est nécessaire pour nous alimenter et nous couvrir, nous contraint à des tâches journalières souvent pénibles, dangereuses ou rebutantes, qu’il nous faut assumer sans trêve si nous voulons conserver les avantages acquis par nous dans la lutte pour l’existence.
La liberté de l’homme au sein de la société humaine n’est, dans la plupart des cas, pas beaucoup plus avantagée. Durant la première enfance, notre faiblesse physique, et notre manque de jugement, nous placent sous la domination des personnes adultes de notre entourage. Un peu plus tard, lorsque notre intelligence s’éveille, c’est pour se heurter aux limites étroites imposées par le catéchisme et les programmes scolaires qui, loin de favoriser le talent personnel et les initiatives, semblent trop souvent vouloir les décourager à jamais. Puis c’est le régiment qui s’efforce, par ses méthodes, de briser les volontés individuelles, et d’amener le jeune soldat à une obéissance passive de tous les instants, « sans hésitation ni murmure ». Et voici qu’au moment où, ayant dépassé sa majorité, l’être humain semble devoir être libéré de la plupart de ses chaînes, d’autres servitudes s’annoncent. La pauvreté et l’autorité paternelle lui interdisent fréquemment de s’unir sous le signe heureux de l’amour partagé. Si la fortune ne lui a pas souri, il lui faut renoncer à la plupart des libertés accordées par les lois, renoncer presque totalement à vivre selon ses aspirations, s’atteler, de longues heures durant, à des travaux peu attrayants et mal payés, en attendant que la vieillesse, lui ayant progressivement fait perdre ses énergies pour le combat, fasse de lui définitivement un vaincu à la merci de tout le monde.
D’aucuns, en présence de telles constatations, paraissent surpris que l’on puisse encore, les admettant avec leurs conséquences, parler de libre-pensée, de libre examen, ou de système sociaux se réclamant de la liberté. C’est qu’ils ne font, souvent à dessein, qu’une seule et même chose du problème philosophique de la liberté par rapport au déterminisme, et du problème de la liberté personnelle dans l’état de société, alors qu’il s’agit de considérations sur deux plans bien différents. Alors que le premier a pour objet de rechercher si la cause de nos actions est dans un attribut de notre être spirituel : le libre choix, ou bien dans des circonstances extérieures à notre individu, le second a pour objet de supprimer le plus possible les entraves à la satisfaction de nos besoins raisonnables, comme de nos aspirations intellectuelles et sentimentales, que leur origine soit, ou non, dans le déterminisme ou le libre choix.
L’expérience démontre, d’ailleurs, que rechercher à ce dernier problème une solution toujours plus étendue n’est nullement utopique. Nous nous libérons un peu plus des contraintes naturelles chaque fois qu’une découverte scientifique appliquée à l’industrie, à l’hygiène, ou à la médecine, vient faciliter la production, réduire l’obstacle des distances, augmenter notre sécurité, ou nous prémunir contre la maladie... A mesure que s’accroît sa connaissance, l’homme, jadis jouet des forces physiques aveugles, et qui les avait divinisées, apprend à exercer sur elles sa puissance et à les faire servir, dociles esclaves, à son utilité. Nous pouvons prévoir le temps, historiquement proche, où une humanité d’ingénieurs, d’artistes, de techniciens et de savants avec très peu d’efforts musculaires, et une durée de travail extrêmement réduite, sera à même de fournir à la collectivité le bien-être, et même le luxe : tout ce qui peut contribuer à intensifier l’existence, et à la rendre digne d’être vécue.
Il en est à peu près de même pour ce qui concerne les mœurs et coutumes, ou la législation, bien que, sous ce rapport, le progrès soit demeuré très retardataire sur ce qu’il a été dans le domaine des sciences appliquées. Quoi qu’en disent certains pessimistes, nous sommes assez loin des époques où le père de famille pouvait disposer de la vie de son fils, et le maître faire fouetter son esclave ; où l’on pouvait être mis à la torture, pour n’avoir point salué une procession, ou bien avoir soutenu une thèse scientifique non reconnue par l’Eglise. Malgré certains accidents de la vie politique des nations, la tendance générale de la civilisation est vers la liberté. On vise à débarrasser les rapports sociaux des complications inutiles, à laisser l’individu faire ce qui lui convient dans sa vie privée, et même dans ses manifestations publiques, tant qu’il n’attaque point les fondements mêmes de l’ordre établi. L’abandon des superstitions religieuses, le développement de l’instruction rationnelle, l’adoption d’une morale biologique basée sur les meilleures conditions d’une vie normale, et les avantages de l’entraide, permettraient de franchir avec rapidité les étapes.
Une humanité définitivement pacifiée, vivant en harmonie parfaite, sans qu’aucun de ses membres use de licences condamnables à l’égard de l’ensemble, sans que, par conséquent, la collectivité se trouve jamais dans la nécessité vitale de réagir par la violence contre des éléments de désagrégation et de mort, tel apparaît le résultat final de cette évolution, si l’on considère que le progrès étant indéfini, il n’est pas de motif de fixer à l’avance une barrière à l’acheminement humain dans un domaine quelconque... Cependant un tel résultat suppose, pour être atteint, non pas seulement la disparition de certaines formes transitoires de tyrannie capitaliste, militariste, cultuelle, ou autre, mais encore la généralisation d’un état de conscience, et d’habitudes de discipline personnelle stricte, dont actuellement très peu d’humains sont capables de donner l’exemple. La disparition de l’autorité dans la cité universelle, suppose, en effet, la disparition préalable des compétitions de toute nature qui lui ont donné et lui donnent inévitablement naissance, sous les aspects et avec les caractères les plus différents, dans les circonstances les plus diverses de la vie, au service des idéologies, comme des besoins économiques, les plus opposées, qu’il s’agisse comme moyens de la police d’Etat, ou du lynchage anonyme et spontané.
Le but immédiat n’en demeure pas moins intéressant : tendre sans cesse à réaliser pour tous et pour chacun le maximum de liberté individuelle compatible avec les nécessités de l’association, et les possibilités sociales obtenues. Ceci, tout en se souvenant, d’après la formule célèbre que, toutes choses égales d’ailleurs, les orages de la liberté sont d’ordinaire préférables à la trompeuse sécurité de la contrainte.
— Jean MARESTAN
LIBERTÉ
Le fait d’être libre, de ne dépendre de personne au point de vue physique, intellectuel et moral : la liberté est un idéal qui est loin d’être atteint.
Ce serait une erreur de chercher la liberté en arrière de nous dans la vie primitive. L’homme sauvage vit en troupes et de ce fait il est asservi. Des croyances superstitieuses en outre (totems, tabous, etc.) assujettissent son esprit ; il ne peut pas faire tel geste, manger telle chose, etc.
Dans la société actuelle les pauvres, qui forment la grande majorité des humains, ont très peu de liberté. Ils doivent sacrifier à la conquête du pain de chaque jour la plus grande part de leur temps. En outre les pauvres qui sont en général ignorants sont remplis de préjugés qui achèvent de les rendre esclaves. Chacun vit comme on lui a appris à vivre et comme vit son entourage. L’idée ne lui vient même pas de vivre autrement ce qui fait que, en quelque sorte, on pourrait le déclarer libre puisqu’il n’a pas de désirs.
En un sens, le riche est plus libre ; c’est pour cela qu’on appelle situations indépendantes celles que confère la fortune. Avec beaucoup d’argent on fait ce qu’on veut, on va où on veut. Néanmoins il ne faudrait pas croire que le riche soit en possession de la liberté absolue. Par son éducation et ses mœurs il est prisonnier de son milieu. Même quand il les réprouve, il se soumet à ses pratiques et à ses habitudes pour conserver une bonne réputation.
Car tous les milieux sont tyranniques. L’individu est dépendant jusque dans son vêtement pour lequel il doit suivre la mode, sous peine de passer pour un personnage ridicule, voire pour un fou.
La liberté de penser est aussi très relative, on est contraint de penser — ou de feindre de penser — comme son entourage autrement on n’est pas compris. L’individu — s’il entend demeurer dans la « normale » admise et comprise — ne peut innover que sur des points très restreints, pour lesquels il devra encore s’expliquer pour tâcher de convaincre. Celui qui est par trop différent des autres est qualifié original, ce qui se prend en mauvaise part ; on ne l’aime pas et on fuit sa compagnie.
On peut donc dire qu’il n’y a de liberté nulle part.
Cette tyrannie du milieu est-elle un bien ou un mal ? Elle est à la fois l’un et l’autre. Elle est un bien pour les intelligences inférieures qui trouvent la vie toute préparée et qui seraient tout à fait désemparés si elles devaient l’ordonner elles-mêmes. Mais pour les intelligences supérieures, la tyrannie grégaire est un mal, car elle les force à se mettre à un niveau commun qui leur est inférieur. L’homme de génie, et même plus simplement l’homme supérieur, sont incompris et détestés ; à moins que le succès et la fortune ne fassent pardonner leur originalité.
Les sociétés de l’avenir, plus raisonnables que les nôtres, donneront plus de liberté à l’individu. On comprendra qu’il faut permettre et même admettre tout ce qui n’est pas nuisible à autrui. Ainsi la liberté du costume. Il n’y a aucune raison pour uniformiser la façon de s’habiller ; chacun devrait se vêtir selon sa fantaisie et ses goûts. De même pour la liberté des idées, l’individu a le droit de penser ce qui lui plaît et d’exprimer sa pensée. Il est faux d’admettre la culpabilité morale, du moment qu’il n’y a pas ordre formel donné à un être faible, enfant ou déséquilibré mental. L’adulte est mal fondé à rejeter sur une tierce personne la responsabilité d’un acte, il pouvait ne pas se laisser influencer, Les lois seront, elles aussi, de moins en moins oppressives.
L’arsenal de la légalité actuelle sert avant tout à maintenir les déshérités dans la résignation à leur sort. Le communisme qui supprimera les classes sociales et rendra le travail léger à porter permettra d’accroître dans une large mesure la liberté de l’individu.
— Doctoresse PELLETIER
LIBERTÉ
Ce mot est si souvent employé dans tous les milieux qu’il semble que tout le monde soit d’accord sur sa signification. Il n’en est rien : individu, groupement ou organisation, classe sociale, tous parlant de liberté, ne comprennent par là que leur liberté propre, trop souvent assimilée à un « bon plaisir » ridicule. On arrive ainsi à fabriquer toute une série de libertés au nom desquelles on asservit les êtres humains. Pour citer quelques exemples frappants, rappellerai-je que c’est surtout au nom de la liberté qu’on a fait, dernièrement, massacrer des millions d’hommes de tous les pays ? C’est au nom de la liberté de conscience que les porteurs de goupillons réclament à cor et à cri le droit d’abrutir les foules ignorantes pour arriver plus facilement à leurs fins d’asservissement et de domination. C’est au nom de la liberté du travail que le patron d’usine fait appel à la police et à la force armée pour maintenir, et parfois massacrer, les ouvriers qui réclament le droit à une existence meilleure. C’est au nom de la liberté commerciale que les mercantis de toutes sortes réclament le droit de rançonner le producteur et le consommateur, de les empoisonner au besoin avec des produits frelatés. C’est au nom de la liberté, de la justice et de l’ordre que, tous les jours, on construit des prisons et qu’on y enferme des malheureux, que l’on construit des engins de meurtre et... que l’on s’en sert ! C’est au nom de la liberté que... Mais je n’en finirais pas si je voulais énumérer tout ce qui se fait au nom de la liberté pour opprimer les hommes.
Le mot de liberté est donc, comme tant d’autres, détourné de son sens et utilisé à l’encontre de son caractère par les pires ennemis de la liberté. Devons-nous en conclure, comme certaines écoles communistes, que la liberté n’est qu’un mythe et que nous devons faire abandon de ce caprice imaginatif ?
Efforçons-nous de voir ce qu’il faut entendre par liberté. La définition donnée par Larousse me paraît assez juste dans sa brièveté : « La liberté est le pouvoir d’agir ou de ne pas agir, de choisir ». En dehors du pouvoir, de la faculté d’agir ou de ne pas agir, il n’y a pas de liberté. Un paralytique n’a pas plus la liberté de marcher qu’un homme aux yeux bandés. C’est ainsi que dans notre société, on peut sans crainte nous accorder une foule de libertés... après nous avoir enlevé le pouvoir d’en jouir. Aucune loi ne défend au travailleur de visiter les sites agréables, de goûter les merveilles de la nature et celles de l’art, de se reposer lorsqu’il est fatigué, de vivre dans le confort et l’aisance, mais comme il ne possède pas la liberté économique, il est astreint, pour assurer sa subsistance et celle des siens, à de longues journées d’un travail assidu et régulier qui lui enlève précisément la possibilité de jouir des libertés qu’on lui reconnaît.
Si donc la liberté n’est que le droit, elle est inopérante, c’est comme si elle n’existait pas : elle n’existe pas. Pour qu’elle devienne efficace, réelle, il faut qu’elle devienne le pouvoir. Nous n’avons nul besoin de liberté pour ce que nous ne pouvons pas faire. Prétendre nous l’accorder, c’est se moquer de nous, de même que c’est se moquer de lui que d’accorder au paralytique le droit de courir ou au moribond le droit de vivre.
La liberté est donc le pouvoir d’agir — ou de ne pas agir, de choisir. Et encore le pouvoir de ne pas agir est très limité pour tout être vivant. Il faut qu’il agisse, il ne peut s’en empêcher. Et dès qu’il agit, il ne peut plus choisir son action. Ainsi définie, la liberté est l’apanage exclusif des êtres vivants qui, seuls, ont le pouvoir d’agir par eux-mêmes, mieux, elle se confond avec la vie, elle est la vie elle-même. La vie devient alors inséparable de la liberté et inconcevable sans elle.
Mais le pouvoir d’agir, la faculté d’agir, étant limités pour tout être vivant, la liberté est aussi limitée elle-même : il n’y a pas de liberté absolue, il ne peut pas y avoir de liberté absolue pour personne. La liberté absolue supposerait un pouvoir personnel sans bornes et s’il en est qui ont cherché, s’il en est qui cherchent encore à réaliser ce rêve pour eux-mêmes, en utilisant pour leurs propres fins le pouvoir d’agir des autres ils ne sont jamais arrivés, ils n’arriveront jamais à leur but qui s’éloigne d’ailleurs à mesure qu’ils croient l’approcher. Même aux époques les plus sombres de l’histoire des peuples, jamais personne n’a pu connaître le pouvoir absolu et les plus grands monarques devaient encore compter non seulement avec leurs propres possibilités, mais même avec leurs sujets. Il restait pour eux des limites qu’ils ne pouvaient dépasser sans risquer de perdre leur couronne ou leur tête.
La liberté absolue, ou pouvoir absolu, suppose donc la toute-puissance que les hommes, ne pouvant l’atteindre, ont voulu donner à leurs dieux. Et ces dieux n’ont jamais pu manifester aux hommes autre chose que... leur impuissance ! La liberté absolue est donc une impossibilité, une absurdité. Notre liberté se trouve limitée par notre pouvoir d’agir et ne peut aller plus loin. La formule connue : « Fais ce que tu veux » ne peut entrer dans le domaine de la réalité qu’à la condition de ne vouloir que ce que l’on peut. Dès que nous voulons la dépasser pour des fins qui nous sont propres, nous empiétons sur le pouvoir d’agir des autres, sur leur liberté, nous faisons acte d’autorité. Et c’est ainsi que l’autorité se trouve être fille de la liberté ! J’admets qu’elle n’en est qu’une excroissance, mais elle n’en est pas moins produite par elle. C’est pour grandir sa liberté, son pouvoir d’agir, que l’ambitieux, l’orgueilleux, empiète sur la liberté, le pouvoir d’agir de ses semblables, qu’il veut les faire servir à ses desseins, etc. Voilà précisément où nous conduit l’excès en toutes choses, la recherche de l’absolu, alors que tout est relatif. Et voilà aussi pourquoi le mot de liberté peut donner lieu à des interprétations contradictoires et servir à l’étranglement de la liberté des autres !
Mais il n’en subsiste pas moins une question très épineuse, un problème délicat, pour ne pas dire presque insoluble, c’est lorsqu’il s’agit de délimiter où doit socialement finir la liberté de l’un et où doit commencer celle de l’autre. Je pose la question, mais n’ai pas la prétention de la résoudre. Celui qui trouvera une solution pratique de ce problème aura résolu la question sociale qui est à l’ordre du jour depuis l’origine des sociétés.
En dehors des cas bien définis, où l’individu exerce sa liberté sans aucune contrainte et sans empiètement sur autrui, et de ceux où il fait ou cherche à faire nettement acte d’autorité sur d’autres individus en les contraignant à agir pour ses buts à lui, il y a de multiples actions mal définies et telles que celui qui agit les peut considérer comme l’exercice de sa propre liberté, mais que ses voisins regardent comme une atteinte à la leur. De là naissent souvent des conflits entre individus, même ayant une conception à peu près semblable de l’exercice de la liberté. Il est très difficile de trouver une limite précise, incontestable entre le jour et la nuit si l’on ne voit pas le coucher du soleil ou si on ne veut pas le prendre pour base, mais il est encore bien plus difficile de trouver le moment précis où la liberté devient autorité. Ce ne sera que lorsque les êtres humains auront acquis assez de sociabilité pour reconnaître aux autres les mêmes droits qu’ils revendiquent pour eux-mêmes, qu’ils arriveront à éviter ces heurts et préféreront laisser entre leur liberté et celle de leurs voisins une zone neutre — une marge de tolérance et de sagesse -qu’ils n’occuperont qu’après entente et momentanément. Dans certains cas, les limites entre la liberté de plusieurs individus sont réglées par ce qu’on appelle la politesse, lorsque celle-ci n’est pas une feinte hypocrite. Par exemple, avant de prendre certaines libertés, on demande aux voisins si cela ne les incommode pas. Et lorsqu’on omet cette précaution, les intéressés sont fondés à vous prier courtoisement d’éviter ce qui leur cause une gêne. Il est absolument indispensable que celui qui veut vivre en société, qui ne peut vivre qu’en société, acquière des habitudes de sociabilité.
Dans la pratique courante, il n’y a guère que des questions secondaires qui reçoivent cette solution. Il existe donc toujours entre les êtres humains, quand il s’agit de liberté, de nombreux points délicats, contestés et litigieux, chacun voulant pour soi l’exercice entier de la liberté, sans se rendre bien compte lorsqu’il porte atteinte à celle de son semblable. Si donc la part raisonnable de chaque individu est déjà difficile à délimiter entre hommes ayant la même conception de la liberté, elle l’est davantage, à plus forte raison, entre personnes qui pensent différemment sur ce sujet, lorsqu’il s’agit de gens, en particulier, qui entendent ramener à eux tous les avantages de la liberté. Pour augmenter, grandir leur pouvoir d’agir, nombreux sont ceux d’ailleurs qui tentent de sortir des cadres de leur liberté propre. A ces premiers pas imprudents, aux premières incursions arbitraires, se rattachent les premières manifestations de préjudiciable autorité pour celui qui accepte, de gré ou non, les empiètements antisociaux. La plupart du temps, pour des raisons complexes de naissance, de milieu, de circonstances, de bonté passive, de faiblesse, de crainte, etc., cette autorité est acceptée par celui qu’elle atteint. Il s’y résigne tantôt bénévolement, tantôt parce qu’il se sent pris sous l’étreinte de la force et qu’il renonce à entamer une lutte où il craint d’être vaincu. Il efface même ses velléités de résistance, laissant le champ sans obstacle pour la récidive, donnant à l’acte nocif l’aspect dangereux d’un débordement légitime, à son abdication le caractère d’une soumission naturelle...
Vient un moment où cette autorité directe d’un ou de plusieurs individus sur leurs semblables apparaît trop brutale, trop dégradante, trop immorale, ou même elle lèse vitalement ses victimes. On arrive alors à l’abolir grâce à des coalitions circonstanciées. Mais ce progrès favorise, mais ces concertations prennent souvent pour appui une autre forme d’autorité qui paraît donner quelques garanties à ceux qui subissaient la première. Cette autorité leur apparait moins nocive parce qu’au-dessus des hommes, semble-t-il, et s’appliquant à tous, et d’apparence propre à servir le bien général ; c’est l’autorité sociale. Et cette autorité a pu se faire accepter et même demander par les humains, parce qu’elle supprime cette zone neutre, dont je parlais tout à l’heure, qui se trouve placée entre la liberté de chaque individu. Elle arrive ainsi à éviter ou enrayer ces multiples conflits entre gens qui ne veulent pas s’entendre et se chicanent souvent pour des riens. Voilà bien la solution. Deux individus se contestant un droit quelconque font appel à une autorité au-dessus d’eux qui ne tarde pas à les mettre d’accord en leur enlevant à chacun le droit contesté et d’autres ensuite. C’est « l’huître et les plaideurs ». C’est ce qu’on appelle instituer le règne de l’ordre...
L’autorité — voir ce mot — a toujours revêtu deux aspects différents, mais tous deux indispensables à son maintien : l’autorité physique, matérielle, et l’autorité morale. Une partie des individus sont maintenus dans leur condition par la première, une autre partie par la seconde et le reste de l’humanité a, ou croit avoir, intérêt au maintien de ces deux aspects de l’autorité. Ce sont ces conditions qui font durer celle-ci depuis l’origine de l’histoire. L’autorité physique fut fondée par le brigand et est maintenant représentée par le gendarme, le policier et le militaire. L’autorité morale avait sa base dans les croyances et les religions monothéistes ou polythéistes (voir ces mots), avec leurs dieux uniques ou multiples auxquels seuls les gens simples demeurent encore attachés, mais qui sont remplacés, comme exerçant sur les masses une discipline favorable, par des entités métaphysiques ou sociales tout aussi fantomatiques que les anciens dieux, mais aussi puissants qu’ils l’étaient et qui sont le Bien, le Devoir, l’Opinion, l’Honneur, la Patrie, etc...
* * *
Je ne veux pas approfondir ici la question de la liberté au point de vue biologique et physiologique ; mais ici comme en sociologie nous ne possédons qu’une liberté relative, celle qui se confond avec la vie, qui en est la manifestation. Mais du fait que là aussi la liberté ne peut être totale, certains voudraient en déduire qu’elle n’est qu’une illusion. L’être vivant ne serait qu’une machine, qu’un automate, un jouet de la nature ayant l’illusion de la liberté et de la volonté, mais dont tous les actes seraient rigoureusement déterminés par des causes et des circonstances indépendantes de lui. Certes, je ne conteste pas plus l’importance du déterminisme biologique que celle du déterminisme social. L’individu est le produit de l’hérédité, du milieu, de l’éducation etc..., et ses actes sont en l’apport avec tous ces facteurs. Mais sommes-nous plus fondés à croire au déterminisme absolu qu’à la liberté absolue ?
Le déterminisme absolu serait le pur fatalisme. Il nous ferait envisager tous les événements naturels et sociaux, ainsi que tous les plus petits détails de notre vie individuelle avec une passivité complète et nous n’aurions, comme le musulman, que cette explication décourageante, article de foi et justification d’inertie :
« C’était écrit, cela devait arriver. »
La science, les données actuelles sur la nature de notre être ne paraissent pas encore avoir donné force de vérité à ces thèses destructrices de la personnalité et il nous semble, si nous faisons jouer certains éléments internes de choix et de décision, les déterminants volontaires et psychiques, qu’il reste assez de place à l’influence propre de l’être pour prononcer encore le mot de liberté. Notre liberté ne serait qu’une apparence s’il existait un Dieu tout-puissant et omniscient comme l’enseignent les religions, mais si Dieu n’existe pas, comme disait Bakounine, qui est-ce qui empêche la liberté de l’homme, si ce n’est l’autorité d’autres hommes ?
Je sais : l’homme qui agit est déterminé dans ses actes par la pression du milieu extérieur et par cette portion de son milieu intérieur qu’il a héritée de ses ancêtres et n’a pu modifier ; quand il veut quelque chose, sa volonté est déterminée par des circonstances qu’il n’a pas toujours créées lui-même. Mais parce qu’il n’est pas lui aussi, dans sa sphère, créateur unique et tout-puissant, cela veut-il dire qu’il n’ait pas de domaine propre et qu’il ne possède aucune liberté ? Certes, si être libre consiste à pouvoir s’abstraire totalement de l’ambiance, à se détacher pour ainsi dire du milieu qui nous entoure, des conditions et obligations de la substance qui nous compose pour pouvoir agir sur les choses sans qu’elles ne puissent agir sur nous, nous connaissons assez l’étendue de notre faiblesse pour nous réclamer de cette liberté-là ! Mais, d’autre part, si l’homme et tous les êtres vivants subissent sans réaction possible l’emprise maîtresse de leurs milieux, si leur liberté n’est qu’apparence, il faut en conclure que la vie elle-même n’est qu’une illusion, et que, malgré notre faculté de mouvement, malgré nos sens, malgré notre cerveau, nous ne sommes que de la matière inconsciente à l’état de somnambulisme ! Cela est si vrai que la liberté — ou l’illusion de la liberté, si ce n’est qu’un mirage — nous apparaît comme la caractéristique de la vie organique tout au moins ; son embryon est le point de départ entre la matière inerte et la matière dite « vivante » ; elle se développe et grandit avec cet état pour disparaître avec lui. Et l’on peut ajouter que lorsque l’idée de liberté -relative bien entendu — aura disparu du cerveau de l’humanité, celle-ci ne survivra pas longtemps... En attendant que la science nous ait apporté des preuves improbables, nous nous efforcerons de conserver, d’embellir, d’agrandir la vie — ou l’illusion de la vie — et la liberté — ou l’illusion de la liberté !
Pour bien étudier la liberté, faculté exclusive, — semble-t-il — des êtres vivants, il faut voir quels services ils lui demandent, quels bien ils en attendent. Nous ne tarderons pas à constater qu’ils l’emploient d’abord — et presque toujours, à moins d’anomalies déformantes -à conserver la vie, et ensuite à la développer, la grandir. Pour vivre, ils ont des besoins à satisfaire et c’est de servir l’assouvissement des besoins les plus impérieux qu’ils demandent à leur liberté. Mettez un bœuf au milieu du désert où il ne trouvera aucune nourriture, et montrez-lui alors une étable avec un râtelier garni de foin. Dès qu’il aura faim, il entrera de lui-même à l’étable et préférera se laisser enfermer que de périr. Certes, il souffrira de la captivité, car sa faim satisfaite, il a d’autres besoins. Mais enfermez-le dans un pré assez vaste pour le nourrir, où il trouvera de l’herbe à volonté et une certaine partie d’espace à franchir, il ne s’apercevra même pas que son parcours est limité, surtout s’il a des compagnons. Ne sommes-nous pas tous enfermés dans les limites de notre possibilité ? Et cela quelque rang que nous occupions dans l’échelle sociale ? Mais si les bornes de notre horizon sont assez éloignées pour que nous ne puissions les toucher, pour qu’il n’y ait pas pour nous, vitalement, nécessité à les atteindre, nous en inférons, de ce que nous ne rencontrons pas l’obstacle, à notre liberté. On peut donc dire que, lorsque l’être vivant n’est pas contraint d’agir contre sa volonté, le maximum de liberté consiste pour lui dans la possibilité de satisfaire tous ses besoins et de jouir pleinement de l’existence.
La liberté qui n’a pas à la base les moyens de répondre aux exigences des besoins élémentaires, de ceux là vers lesquels nous guide notre instinct, ne peut avoir de signification pour l’être humain. Aussi doit-elle nécessairement, pour être efficace, accompagner les transformations des besoins de l’homme aux divers âges de l’humanité. Nos besoins ne sont plus les mêmes que ceux de nos ancêtres. La possibilité de vivre comme ils ont vécu ne constituerait pas plus une liberté pour nous que n’en aurait constituée pour eux la possibilité d’existence qui nous satisferait aujourd’hui, laquelle, à son tour, ne pourra plus satisfaire nos descendants dans un certain nombre d’années ou dans quelques siècles.
En nous plaçant au point de vue social qui surtout nous intéresse ici, la question de la liberté est un problème infiniment complexe et difficile à résoudre, à cause de la diversité des goûts, des tempéraments, des caractères et des aptitudes individuelles. Nous avons vu plus haut que la liberté individuelle poussée à l’excès arrive à se transformer en autorité contre d’autres individus. Or, précisément, l’autorité est la fin de la liberté pour ceux qui la subissent. Il s’agit donc de trouver le point précis où doit s’arrêter la liberté pour ne pas devenir autorité.
Certains répondent :
« Là où commence la liberté du voisin. »
Je dis :
Non, car la liberté du voisin commence à la possibilité de satisfaire ses plus impérieux besoins et ce n’est qu’exceptionnellement qu’il y a contestation à cet endroit. C’est au contraire là où finit la liberté du voisin. Et si, ni le voisin, ni nous-mêmes ne voulons assigner de limites à notre liberté, il y aura conflit avec, pour corollaire, l’instauration probable de l’autorité du plus fort.
D’autre part, si quelqu’un en laisse bénévolement un autre entamer quelque peu sa propre liberté, l’intrus ne tardera pas à aller plus loin et à faire sentir également son autorité. Si la jouissance de la liberté pose devant l’aventureux un cas de conscience que la raison doit éclairer et qui le retient au seuil du domaine que l’autre ne défend pas, elle fait à tout homme obligation de connaître l’étendue de son bien et de ne point permettre qu’il soit foulé. Qu’à celui qui veut trop la raison ne dicte la retenue et n’établisse la mesure et c’est devant la carence du faible ou de l’ignorant, la prise de possession de la force avec son cortège d’injustices...
En effet, dans les deux cas envisagés ci-dessus, nous voyons l’abus de liberté se transformer en autorité et pourtant nous l’avons vu, la liberté est indispensable à l’être humain et c’est elle seule qui peut lui permettre de vivre une existence digne d’être vécue. Comment donc arriver pour nous et les autres à connaître la norme et à la faire volontairement, librement, accepter par tous ? Les anarchistes, qui ont fait de la liberté la base de leur doctrine s’essaient depuis des années déjà à solutionner la question ; ils devront y travailler encore longtemps, je crois, avant d’avoir trouvé les données de l’équilibre qu’elle exige. Il ne saurait être question de liberté sans frein comme certains pourraient le croire et le proclamer. Il s’agit d’assurer à chacun le maximum de liberté qui se confondra avec le maximum de bien-être. Comme ce problème comporte surtout, pour chaque individu, la possibilité de satisfaire ses besoins, il s’agit de rendre cette possibilité compatible avec la même possibilité pour autrui. Pour cela nous pouvons envisager trois cas différents :
-
Nos besoins et nos goûts sont trop différents pour se heurter. Les difficultés sont d’elles-mêmes résolues et nous pouvons sans nous nuire, jouir réciproquement de notre liberté.
-
Nos besoins, nos goûts, nos désirs sont à peu près semblables, portent sur les mêmes objets. Deux solutions sont à envisager : la lutte entre nous — avec tous ses aléas — pour conquérir les objets convoités, ou l’entraide, l’association — avec tous ses bienfaits — pour les produire en quantité suffisante pour tous avec, comme base de répartition, l’égalité pour tous les membres tant que la production reste en-dessous des besoins.
-
Nos besoins, nos goûts, nos désirs sont opposés et s’excluent mutuellement. Il y a impossibilité de satisfaire les uns et les autres. Voilà précisément les circonstances où l’abandon raisonné — à charge de revanche — de l’une des satisfactions escomptées peut garantir une paix précieuse au premier chef. Impérieuse est, d’ailleurs l’élimination, sans remplacement, de desiderata abusifs, de désirs violents, de prétentions absurdes. Par exemple si j’éprouve le besoin ou le caprice de me battre avec mon voisin pacifique, il n’y a plus de liberté pour lui de ce côté tant qu’il n’aura pas trouvé le moyen de me désarmer, de transformer mes instincts belliqueux en instinct de sociabilité. Ou alors, malgré lui, il doit se défendre contre mes prétentions ou se soumettre à ma domination ; quelquefois, il fera les deux. Mais on ne cherche à dominer, à soumettre, à exploiter que ceux que l’on considère comme inférieurs à soi, que ceux qu’on ne veut pas tenir pour ses égaux, Aussi la doctrine anarchiste qui n’admet pas d’archies, de chefs, de supériorité oppressive, ni au point de vue social, ni au point de vue individuel, réserve, par ses résistances, la voie à la liberté, comme la doctrine libertaire la prépare par ses aspirations ; elles se rencontrent sur le terrain commun de l’égalité potentielle des individus, avec le critérium d’une mesure rationnelle, elles tendent à faire de la liberté possible une réalité sociale.
Comment donc pourrons-nous organiser la liberté dans une société anarchiste ? On a vu plus haut qu’il ne s’agit pas de proclamer à la cantonade le « fais ce que veux » dont les sages de l’Abbaye de Thélème ne prenaient d’ailleurs que la dose raisonnable. La liberté absolue est une impossibilité pour l’homme social comme pour l’homme seul et il faut tenir compte de la présence d’autrui, de la liberté de chacun si nous ne voulons retomber à l’écrasement du faible et aux tyrannies de la force. Comme la liberté essentielle réside dans la satisfaction des besoins primordiaux, il faut d’abord organiser la production des choses nécessaires en tenant compte des besoins actuels avec le maximum de liberté pour tous. La production nécessitant une certaine somme de travail, il est donc normal que tout groupe de production (Voir ce mot, voir aussi communisme, familistère, socialisme, etc.) réclame sa part de travail à qui lui réclame sa part de produits. Ce n’est que la conséquence d’une loi naturelle inéluctable. Celui qui ne peut se contenter des produits sauvages du sol doit apporter sa part de travail à leur transformation pour pouvoir jouir des produits du travail humain. La production pourra être soit collective, soit individuelle, suivant les goûts de chacun et suivant aussi les nécessités de cette production. L’essentiel est qu’elle soit organisée par les producteurs eux-mêmes et ne serve pas, comme de nos jours, à l’enrichissement de leurs maitres et à la consécration de leur servitude.
Il est évident que de même qu’aujourd’hui, le cultivateur qui veut faire pousser du blé ou des pommes de terre doit mettre la semence en terre au moment voulu et par là-même s’astreindre à une méthode, une discipline inévitables, de même le groupe de production ou le producteur individuel devront s’organiser de telle sorte que la production soit assurée, et demander à ses membres, une fois les principes et les règles de l’organisation adoptés, de les observer. Que l’on veuille ensemencer un champ, construire une maison, extraire du charbon, fondre du minerai, voyager en chemin de fer ou organiser une fête, il faut que chacun de ceux qui ont promis d’assurer un rôle dans l’organisation du travail ou du plaisir, après avoir accepté les nécessités de la situation, choisi suivant ses goûts et ses aptitudes, remplisse la fonction qui lui revient et en ait la responsabilité. Sans cela, il n’y a pas de production intelligente et, partant, pas de satisfaction possible pour les hommes dans la vie aux communes possibilités que nous essayons d’établir.
Lorsque l’anarchisme aura fortement implanté ses principes dans l’esprit et le cœur du peuple, lorsqu’il aura acquis assez de puissance, surtout morale, pour transformer la société, il réalisera l’égalité, non pas devant la loi mais devant la vie, et chaque individu se trouvera placé devant les mêmes possibilités d’existence. Plus de patrons arrogants, de chefs, ni de supérieurs devant lesquels il faut toujours plier pour ne pas perdre son gagne-pain, plus personne pouvant disposer ainsi de la vie ou tout au moins de presque toute la liberté d’autres hommes. Certes, je le répète, nous n’aurons pas, en société, cette liberté illimitée qui d’ailleurs n’existe nulle part dans l’état de nature. L’oiseau qui vole si librement dans les airs à ce qu’il nous semble, est cependant obligé de se lancer à la poursuite de sa nourriture : elle ne lui tombe plus dans le bec pendant qu’il chante sur la branche. Le propagandiste anarchiste qui dit à chaque individu : « Nul ne peut agir à tes lieu et place pour te libérer, c’est toi-même qui dois organiser ton mode de vie », s’inspire bien des principes ci-dessus en montrant à l’être humain qu’il sait faire un effort personnel pour obtenir ce qu’il espère. L’organisation anarchiste de la production n’est que l’application du même principe dans ce domaine.
D’ailleurs, la multiplicité des groupes de production, la facilité de choisir son groupe et d’en changer sans risquer de subir la misère, la facilité de produire isolément pour celui qui le voudra, en permettant à chacun de choisir le genre de discipline qui lui conviendra le mieux, nous donnera le maximum de liberté. Lorsqu’aucun être humain ne sera plus à la merci d’un employeur, d’une administration, d’une clientèle, d’une classe, ni des convenances pour assurer son existence et jouir pleinement de la vie, il goûtera réellement la liberté.
Peut-on, maintenant, parler de liberté lorsque nous n’avons même pas le droit à l’existence, que nos maîtres peuvent nous l’enlever quand cela leur fait plaisir ? La condition de l’homme d’aujourd’hui, du moins de celui qui ne possède pas, n’est guère meilleure que celle de l’esclave d’autrefois, malgré tout ce qu’on chante sur la civilisation et le progrès, et nous pouvons répéter avec le poète ces tristes vers :
La pauvreté, c’est l’esclavage.
Mais le jour où nous aurons réalisé l’égalité économique et sociale, où nous aurons fait disparaître des cerveaux humains la croyance à la supériorité d’individus faits pour commander et gouverner, le jour où les hommes naîtront et vivront réellement dans l’égalité devant le bien-être qui ne sera plus réservé à une partie seulement de l’humanité, nous aurons solutionné la question de la liberté sociale. Cette liberté sera relative, c’est entendu mais assez vaste pour nous suffire. Nous serons libres en ce sens que notre existence, notre condition de vie ne dépendront que de nous, de notre effort, de notre activité. Nous pourrons ce que nous voudrons parce que nous ne voudrons que ce que nous pourrons. Nous n’avons que faire de l’impossible liberté absolue, et s’il est des chasseurs de chimères qui veulent tenter de réaliser pour eux cette absurdité qui nous a valu des siècles d’esclavage et de souffrance, nous leur dirons : Non, restez, comme nous, des hommes, des hommes avec leurs imperfections, leurs faiblesses, leurs erreurs, leurs besoins, mais des hommes semblables en cela à d’autres hommes ; différents seulement, en plus ou en moins, de certaines qualités ou de certains défauts, de certaines capacités, mais ayant tous, vous plus que les autres peut-être, besoin de l’association et de la solidarité humaines. Nous ne voulons plus ni d’inspirés, ni de prophètes, ni d’anges, ni de surhommes, ni de dieux, ni de demi-dieux. Leur règne — si gros de peines pour la majorité des hommes — a assez duré. Ce fut le règne de l’autorité.
— E. COTTE
LIBERTÉ (LIBERTÉ DE CHOIX)
Qu’est-ce que la liberté ? La question n’est pas si facile à résoudre qu’à poser. Le Dictionnaire encyclopédique Larousse fournit de la liberté, entre autres définitions, celle-ci :
« Faculté d’agir qui n’est gênée ni par une autorité arbitraire, ni par des lois tyranniques. »
Il ne s’agit là que de la liberté politique, bien entendu, mais qu’il s’agisse de la liberté politique ou de la liberté morale, toute définition de la liberté est nécessairement négative. On n’est pas libre, en effet, de faire tout ce qu’on veut : même si l’on supposait anéantis ou surmontés tous les obstacles s’opposant à la fantaisie on au caprice, il y a des conditions biologiques dont l’individu ne peut pas s’évader.
Entendue au point de vue individualiste anarchiste, la liberté est un état où un individu ne peut pas être davantage forcé à faire ce qui ne lui plaît pas que contraint à ne pas faire ce qui lui plaît. Autrement dit, pour l’individualiste anarchiste, il y a autorité ou tyrannie chaque fois qu’on est obligé d’accomplir un acte indésiré ou qu’on est empêché d’effectuer une action désirée.
Les individualistes réclamant, revendiquant la pratique de leur conception de la liberté pour tout le monde, il s’ensuit que, pour eux, la liberté de chacun est inévitablement limitée par l’exercice de la liberté d’autrui. C’est le principe de « l’égale liberté » ou de la « réciprocité en matière de liberté ».
De sorte que, toute autorité est arbitraire ou tyrannique qui interdit à l’individu ou à l’association de faire ou ne pas faire, alors même que cette action ou cette inaction n’empièterait pas sur la façon de se comporter d’autrui.
Il n’y a pas de loi ou d’autorité qui ne soit arbitraire ou tyrannique, leur raison d’être étant d’intervenir dans l’action ou l’inaction de l’administré ou du citoyen, même quand ce dernier n’entend en aucune façon forcer autrui à faire ou ne pas faire comme lui.
C’est ainsi que l’Etat, forme concrète de l’autorité, puisqu’en possession des moyens de sanction, intervient dans la liberté de la presse, la liberté de parole, la liberté de réunion, la liberté d’association, la liberté de proposer ou d’expérimenter certains modes de vie, certains systèmes d’éducation — la liberté de critiquer certains préjugés, certaines entités, institutions sociales ou politiques. Il suffit que l’Etat juge que l’exercice d’une liberté donnée nuit à son existence, à sa morale, à son enseignement pour imposer silence à qui veut s’exprimer ou réaliser au nom de cette liberté.
Ainsi, en France, on ne peut pas, sous peine d’emprisonnement, recommander l’abstention du service militaire, conseiller le refus de paiement de tel impôt, vendre les moyens d’éviter la grossesse, faire publiquement un cours d’érotisme pratique. Cependant, ceux qui accomplissent ces actions ne songent nullement à imposer leurs conseils, à contraindre qui que ce soit à venir les entendre.
Et la loi est tellement arbitraire qu’il y a des pays où on considère comme un délit de blasphémer (même en Italie), de danser le dimanche (certains Etats de l’Amérique du Nord), de manquer de respect à la Sainte Vierge (Espagne), actions qui se peuvent faire en France et ailleurs. Par contre, en Russie soviétique, on peut colporter dans les rues et annoncer à pleins poumons des brochures anticonceptionnelles, ce qui serait sévèrement réprimé en France, en Belgique, en Suisse, etc.
La liberté d’expression, d’expérimentation, de réalisation s’entend, pour les individualistes-anarchistes, hors de tout recours au dol, à la fraude, au mensonge, etc., mais ils se considèrent en état de légitime défense à l’égard de tout individu ou milieu qui refuse de traiter avec eux, après discussion loyale, sur la base du principe de l’égale liberté.
Le problème de la liberté présente bien d’autres aspects et je ne veux qu’effleurer ici son côté philosophique. Je ne sache pas que personne, scientiste ou philosophe, ait encore résolu le redoutable problème de « la liberté de l’homme ». L’homme est-il libre ? Combien ont échoué sur cet écueil ? Si l’homme est le résultat de la lignée longue et enchevêtrée de ses ancêtres, d’une part ; si, d’autre part, il est le produit de son ambiance tellurique — il n’est pas libre, il ne peut pas choisir, il est déterminé. L’hérédité et l’environnement ne sont pas tout cependant. Il est évident que l’unité humaine peut acquérir de nouvelles connaissances, faire des expériences qu’ignoraient ses antécédents ou que n’a jamais tentées son milieu. Ces connaissances, ces expériences peuvent l’amener à réfléchir, à modifier son mode de vivre, sa conception de la vie, à construire une éthique « autre », à être enfin une personnalité quelque peu différente de celle qu’il aurait été sans ces acquis nouveaux. Ce déterminisme nouveau et personnel (ce peut être un déterminisme d’association) peut logiquement dans certains cas, dans un grand nombre de cas peut-être, s’opposer au déterminisme social ou moral d’un ensemble, d’une époque. Cela explique les effets, l’influence que peuvent avoir une éducation, une propagande. Il peut y avoir conflit, lutte entre le déterminisme nouveau d’un individu, d’un groupe et le déterminisme coutumier du milieu où évolue cet individu ou ce groupe, etc. Bien entendu, cette opposition, ce combat ont lieu au-dedans des limites du déterminisme humain général, elles ne présentent rien d’extranaturel. C’est dans cette bataille constante entre le déterminisme particulier, pour restreint qu’il soit, et le déterminisme global, malgré sa puissance, que j’aperçois la possibilité de choisir une conception de vie de préférence à une autre, voire de se créer une ligne de conduite « différente ».
Dans la pratique les hommes vivent sur l’illusion de la liberté. Celui qui peut aller çà et là, marcher, parler, courir, se mouvoir se dit libre par rapport à l’être astreint à la réclusion dans un bâtiment dont on ne peut sortir ni la nuit, ni le jour, soumis à l’observation de règlements restrictifs des mouvements individuels. L’homme qui n’est assujetti qu’à un nombre restreint d’obligations s’affirme indépendant par rapport à celui qui est l’esclave d’un grand nombre d’engagements. Et tout n’est pas qu’illusion dans cette appréciation relative de la liberté.
A un autre point de vue, on peut considérer les anarchistes comme une espèce d’humains que la réflexion a menés à considérer que la liberté, même avec les excès qu’elle implique, vaut mieux, d’une façon générale, que l’autorité, même avec les bienfaits qu’elle comporte. — E. ARMAND
LIBERTÉ (et ORGANISATION)
Ainsi que les êtres physiquement mal équipés pour la lutte, l’homme est doué d’instinct grégaire ; il n’a jamais vécu à l’état d’isolement. Que nos observations portent sur les primitifs encore existants ou même sur le monde préhistorique, toujours nous voyons l’homme associé à ses semblables pour former des groupes plus ou moins volumineux et complexes, hordes, clans, tribus, nations. Chez les espèces démunies d’armes offensives, telles que les herbivores, le besoin de s’unir pour la défense refoule toute autre tendance ; il en eût été de même chez l’homme si son énorme développement cérébral n’eut fait de lui une créature d’exception dans la série animale, un être anormal dont l’équilibre est éminemment instable.
Avant d’avoir été enrichie par une longue expérience, d’avoir procuré aux hommes le moyen de dominer et de transformer la nature hostile, l’intelligence était plutôt pour eux une cause de faiblesse qu’un fondement de puissance. Il importait de contenir son activité car les notions qu’elle apportait sur le monde, la variété des impressions qu’elle recueillait, les inquiétudes mêmes qu’elle éprouvait étaient dans une certaine mesure personnelles et tendaient à différencier les esprits, à les individualiser, à dissocier le troupeau. Un conflit s’élevait fatalement entre l’appétit naissant de liberté et l’instinct grégaire. Pendant une longue période, il fut indispensable que ce dernier prévale ; c’est un point que Bagehot, dans ses Lois scientifiques du développement des nations, a jadis mis en lumière. Rites et pratiques singulières qui offusquent aujourd’hui notre raison avaient alors leur justification dans la nécessité de maintenir un conformisme vital aussi bien pour le groupe que pour l’individu.
Cependant la tendance à l’individualisation ne pouvait être indéfiniment comprimée, car dès qu’un groupe avait réussi à la faire coexister avec des liens de solidarité moins étroits, et cela devenait possible lorsque l’isolement, l’abondance fortuite des ressources lui assuraient des conditions d’existence moins précaires, ce groupe différencié, stimulé par les initiatives particulières, capable de progrès, s’assurait une supériorité incontestable sur des rivaux attardés. Une structure sociale basée non plus seulement sur l’instinct, sur la peur, sur l’autorité, mais sur le consentement, si restreint et si peu conscient soit-il, caractérise le passage de la société grégaire à l’organisation sociale.
Ce passage ne pouvait d’ailleurs être que progressif ; mais l’histoire, si nous avions le loisir de la commenter nous montrerait que le niveau de la civilisation s’élève dans la mesure où prédomine l’hétérogénéité sur l’homogénéité (contrairement à ce que pensait Spencer, le sens des transformations du monde inorganique est tout différent), l’individu sur le groupe, « le gouvernement de chacun par chacun, sur le gouvernement de chacun par tous », comme disait Proudhon, l’organisation volontaire sur l’Etat souverain, la liberté sur l’autorité.
L’organisation sociale, loin d’être exclusive de la liberté en est au contraire la condition même ; toutes deux progressent de conserve. Cependant cette proposition rencontre des résistances de deux côtés : de la part de ceux qui se font une idée fausse de la liberté et de la part de ceux qui regardent comme définitives des formes transitoires de l’organisation.
* * *
Gravés dans notre innéité, des vestiges de la religiosité ancestrale nous portent à sentir en nous un principe d’action dont les relations avec le milieu nous paraissent arbitraires, car leur chaîne se prolonge au loin dans le temps. Cependant, notre raison se refuse â concevoir une âme sans support matériel, sans rapports constants avec le monde où elle se manifeste, la liberté n’est pas un absolu ; le sentiment de la liberté n’est que le reflet intérieur d’un état d’équilibre mobile.
« Si on explique que le sentiment de la liberté est simplement une autre expression du fait que la chaîne causale est à l’intérieur de notre conscience, et que nous sentons les événements comme si nous en déterminions nous-mêmes le cours, contre cette conception il n’y a rien à objecter. » (Ostwald)
L’homme est lié à ce qui l’environne, il y a action et réaction réciproques. Nous nous sentons libres quand les deux tendances sont en harmonie et cette conciliation dont nous pouvons être les artisans est la première condition de la liberté.
Il y en a une autre. Au point de vue biologique on a pu dire très justement :
« La liberté consiste en une aptitude plus ou moins limitée des organismes les plus élevés à empêcher les actes instinctifs et non rationnels et à régler leur comportement sur les enseignements de l’expérience passée. » (Conklin)
Cette chaîne causale, ce flux de force qui a une partie de son cours en nous, nous ne les laissons pas s’extérioriser aussitôt, nous les composons avec d’autres, nous les emmagasinons pour dépenser l’énergie qu’elles représentent seulement au moment opportun. A cette organisation interne correspondent le besoin et le pouvoir d’organiser et d’approprier le milieu qui nous entoure.
Céder, sans considération de ce qui peut en résulter pour soi et pour autrui aux sollicitations du dehors ou de la vie végétative, s’abandonner sans faire intervenir le jugement aux suggestions de l’imagination, c’est abdiquer sa liberté. Au contraire, user du pouvoir de résister aux impulsions irréfléchies, de réfréner ou de détourner des réactions instinctives, savoir rectifier nos habitudes, discipliner nos gestes, organiser la société afin de substituer l’harmonie des actes à leur conflit, voilà le fondement de la liberté, mais voilà aussi autant d’obstacles à l’essor capricieux des volontés individuelles.
Nous ne devons donc pas confondre dans une même réprobation les limites qu’impose à nos actes notre nature humaine et celles que prétend leur opposer la volonté arbitraire des hommes. Mais les règles qui établissent l’ordre doivent découler de l’expérience et être sanctionnées par la raison de ceux qui sont appelés à s’y conformer. Sont-elles rédigées ? Que leur texte, plutôt que de formuler des injonctions, fournisse des enseignements sur la conduite à tenir. Les clauses communes stipulant les justes conditions des relations sociales envisagées dans leur généralité doivent également faire place aux contrats exprimant l’accord des volontés particulières.
C’est à tort que le sociologue Tarde voyait dans le contrat un renoncement à la liberté :
« Au moment où l’on me dit que ma propre volonté m’oblige, cette volonté n’est plus ; elle m’est devenue étrangère, en sorte que c’est exactement comme si je recevais un ordre d’autrui. »
C’est réclamer le droit à l’inconstance. À ce compte les plus libres des hommes seraient des aliénés. C’est nier la caractéristique essentielle de tout être vivant, la tendance à persister dans son être, c’est-à-dire à maintenir la constance de sa personnalité. Et lorsque l’on admet la rupture de certains contrats, ce n’est pas sur l’instabilité des volontés que l’on se base, mais sur le fait que celles-ci ne sont pas encore solidement constituées (cas des mineurs), ou sont dégradées (aliénés) ou bien viciées par l’ignorance ou la contrainte (cas du dol ou des événements imprévisibles).
Ainsi la liberté ne paraît nullement incompatible avec l’organisation du milieu naturel et social au sein duquel l’homme vit, non plus qu’avec les engagements qu’il lui convient de souscrire avec des égaux. Il faut seulement que les volontés soient éclairées et pour cela que règles organiques ou pactes particuliers ne se rapportent qu’à des objets, des actes, des protestations, des buts nettement spécifiés et sans complexité.
* * *
Que vaudrait pourtant cette conception d’une organisation compatible avec la liberté individuelle si le sens dans lequel évoluent nos sociétés en interdisait la réalisation ? Or, c’est précisément ce que prétendent les juristes réalistes qui se réclament des doctrines de Durkheim.
Cette école émet des idées qui, à première vue, sont faites pour nous séduire. Elle nie la souveraineté de l’Etat. Droit divin des rois et droit divin des peuples, comme le disait Auguste Comte, seraient également illusoires. Mais si la souveraineté de l’Etat est inexistante, la souveraineté de l’individu, ou son autonomie, dans laquelle les principes de 89 voyaient le contrepoids de la première, n’a pas davantage de réalité. L’homme n’échappe à la domination de l’Etat que pour tomber dans la sujétion de groupements, pour la plupart économiques, exerçant une fonction sociale.
« L’homme n’a pas de droits, la collectivité n’en a pas davantage. Parler des droits de l’individu, des droits de la société, dire qu’il faut concilier les droits de l’individu avec ceux de la société, c’est parler de choses qui n’existent pas. Mais tout individu a, dans la société, une certaine fonction à remplir, une certaine besogne à exécuter. Il ne peut pas ne pas remplir cette fonction, ne pas exécuter cette besogne, parce que de son abstention résulterait un désordre ou tout au moins un préjudice social. » (Duguit)
Chose grave, l’inégalité sociale est consacrée, les fonctions sont hiérarchisées. Les nations modernes tendent « à se donner une organisation fondée sur la coordination et la hiérarchisation des classes professionnelles ».
« La Révolution pensait que, dans une société vraiment libre et vraiment nationale, il ne devait pas y avoir, il ne pouvait pas y avoir de classes sociales, mais seulement des individus libres et égaux. C’était une erreur. Il n’y a pas de société, il ne peut y avoir de société, où il n’y a pas de division du travail. »
Si des déclassements sont fréquents, si beaucoup d’individus sont sur la frontière qui sépare deux classes voisines, celles-ci n’en sont pas moins une réalité inéluctable, elles sont « des groupements d’individus appartenant à une même société nationale, mais entre lesquels existe une interdépendance particulièrement étroite, parce qu’ils accomplissent une besogne de même ordre dans la division du travail social » (Duguit).
Ces groupements ou Syndicats de classes coordonneraient leur action pour arriver à l’harmonisation de l’ensemble de l’Economie. Mais, on nous l’a dit, cette coordination serait une hiérarchisation... Et quelle hiérarchisation ? On a beau dire que les classes toutes également utiles sont égales en droit. Mais en fait ? Nos juristes admettent l’existence de la classe capitaliste qui a pour « mission de réunir les capitaux et de les mettre à la disposition des entreprises », et qui de ce fait aura la haute main sur toute la production, et même sur toute la vie sociale, car, que nos sociologues l’avouent ou non, confier la fonction de concentration et d’affectation des capitaux, et non pas la simple tâche de leur gestion à des individus associés ou non, c’est non seulement les rendre maîtres de tous les ressorts de l’industrie, c’est encore les mettre à même d’étendre au domaine civique le pouvoir exorbitant qui leur serait concédé dans la sphère économique.
Cependant une vue superficielle de nos sociétés semble donner raison à l’école réaliste. Qu’il s’agisse de syndicats, trusts, cartels patronaux ou de syndicats ouvriers, la personnalité de l’adhérent subit des contraintes. Mais cela tient principalement à ce que, de nos jours, les associations sont des formations de combat exigeant une discipline plus stricte que le demanderait une société pacifiée.
Lorsque, déduisant les conséquences de la division du travail, nos docteurs prétendent que « le groupe syndical tend naturellement à réduire l’action isolée de l’individu, sinon à l’annihiler », ne confondent-ils pas le groupe syndical, organe de lutte, avec le groupe coopérateur formé en vue de la réalisation d’une œuvre voulue et poursuivie en commun accord ? Quand on considère la division du travail, on remarque d’ailleurs que le lien coactif est plutôt entre les groupes sériés exécutant des travaux parcellaires qu’entre les membres des groupes accomplissant des travaux similaires. L’ensemble des premiers a une structure fixe ; les seconds sont interchangeables. Si l’Ecole réaliste attribue une valeur absolue à des prétentions autoritaires qui ne sont que des déviations contingentes afférentes à une période de déséquilibre, n’est-ce pas parce qu’elle cède aussi à des préjugés animistes, parce qu’elle considère l’homme comme un être spirituel, entité indivisible ? Or l’homme psychique inséparable de l’homme physique est un être composite. Sans entrer dans des considérations biologiques, on doit penser que ses caractères de toute nature, s’ils ne sont pas absolument indépendants les uns des autres, ont une existence distincte et une activité qui leur est propre. Donner l’exclusivité à l’une de celles-ci c’est étouffer les autres, amoindrir l’ensemble. Si l’homme se laisse absorber tout entier par un groupe, il est certain que nombre de ses activités seront réfrénées et que sa personnalité sera tronquée. S’il n’associe, au contraire, avec d’autres animés d’un même vouloir, poursuivant un but défini, qu’une seule de ses facultés, il acquiert plus de puissance pour réaliser son désir, sans renoncer le moins du monde à l’exercice de ses autres dons naturels. Loin de diminuer sa valeur, il pourra la hausser à un niveau qu’il n’aurait pu atteindre en restant isolé. Il va sans dire qu’il ne s’agit là que de poser un principe dont l’application dans nos sociétés si complexes demandera maintes études : l’instruction intégrale, l’orientation professionnelle, la multiplicité des emplois, l’utilisation des loisirs...
La volonté de délimiter étroitement la portion de lui-même que l’homme engage dans chaque section de l’atelier social est sommairement indiquée dans la charte d’Amiens. L’adhésion au syndicat n’est tout d’abord envisagée qu’en qualité de travailleur salarié d’une catégorie déterminée ; à mesure que le groupe s’élargit, s’incorpore à d’autres plus compréhensifs, le lien se relâche, les devoirs sont plus discutés. Enfin la liberté devient entière pour tout ce qui est étranger à l’action professionnelle.
La même tendance au maintien de l’autonomie se retrouve dans des groupements économiques autres que ceux de la classe ouvrière. Les entreprises capitalistes n’imposent à leurs propriétaires ou dirigeants d’autres obligations que celles qui concourent à atteindre le but des associations. Assurément les nécessités de la lutte les incitent à une certaine conformité intellectuelle et sentimentale, mais cette uniformité n’empêche pas de grandes divergences de principes et de conduite.
Aux formes d’organisation qui laissent à l’homme la faculté de participer au fonctionnement d’autant de groupes spécialisés que le comportent ses tendances et ses aptitudes, son instinct de sociabilité, on peut donner le nom de fédéralisme fonctionnel, dont le fédéralisme territorial n’est qu’un aspect particulier. Ce fédéralisme rend possible la conciliation de l’organisation et de la liberté.
— G. GOUJON
LIBERTÉ POLITIQUE (et AUTORITÉ)
« Deux faits antagonistes dominent la politique humaine et la résument tout entière : les nécessités sociales et les droits individuels ou, en termes plus précis, l’autorité et la liberté. » (Larousse)
Inexacte est ainsi une définition qui enferme les nécessités sociales dans une autorité nécessaire et paraît les identifier. Des deux écoles qui, aux pôles opposés, se disputent l’influence en matière politique, l’une, l’anarchie, négatrice de l’autorité — voir ce mot — ne répudie pas la discipline sociale consentie et n’a jamais fait résider l’harmonie de la société dans l’entrechoquement de fantaisies individuelles qui sont, elle le sait, le chemin familier de la tyrannie. Elle reconnaît au contraire les bienfaits de l’entente entre les hommes et l’utilité du renoncement à des « libertés » excessives pour garantir une liberté individuelle équitable et qui dure ; elle fait appel à l’entraide pour réduire l’empire des nécessités inéluctables qui, chaotiquement ou autoritairement assurées, briment, pour le seul profit de quelques-uns, la majorité des individus et empêchent leur liberté de s’épanouir. C’est en cherchant, hors de la contrainte autoritaire et de son cortège d’abus, la satisfaction des nécessités sociales qu’elle espère délivrer pour chacun la plus grande somme d’effective liberté. L’autre, le despotisme, doctrine paradoxale de la force, entend opérer la délivrance par la compression et confond le silence des peuples jugulés avec la paix heureuse des multitudes satisfaites. Il entend réduire l’homme à la passivité des choses et regarde comme un péril social — disons un trouble-règne — toute aspiration vers la liberté. Il n’a besoin que d’acceptation et prétend faire, contre elles-mêmes, le bonheur des masses... Aussi est-ce aujourd’hui dans les forces du peuple, demain dans les énergies conjuguées de l’humanité tout entière et dans leur jeu à la fois libre et sagace que nous cherchons les ressources propres à l’accomplissement des « nécessités sociales ». Comme nous y cherchons le rempart contre une autorité séculaire, toujours à l’affût de formes rajeunies d’oppression, plus que jamais parées des dehors de la générosité. Et que notre vigilance s’exerce à mettre sur pied des institutions de nature à en écarter l’emprise et à en prévenir le retour...
Larousse, esprit perspicace et passionné d’exactitude, reconnaît d’ailleurs que dans la lutte qui met aux prises les deux principes, l’autorité, jusque-là victorieuse, a toujours fait peser sur les hommes son fardeau malfaisant et il oriente ses espérances vers la liberté. Si son attention avait été davantage portée vers les maux qui découlent du despotisme social, il aurait constaté que les nécessités inhérentes à la vie en société et qui, plus encore dans les temps modernes, avec les besoins accrus, exigent la tâche concertée de tous, n’ont jamais été, sous le signe d’un privilège qui n’a pas désarmé, intelligemment satisfaites. Il apercevrait qu’une coordination logique des efforts en réduirait pour l’humanité l’assujettissement, en même temps qu’une juste distribution de ses avantages procurerait à tous les hommes, admis enfin, avec des droits égaux, au « banquet de la vie », une jouissance à la fois libre et méritée. Et ce scrupuleux publiciste eût cessé, nous le pensons, de demander la vérité à un compromis et de partager à titre égal entre la liberté et l’autorité, sa sollicitude. Il eût laissé ce soin aux Etats, qui ne font semblant de s’intéresser sympathiquement à la liberté — danger pour qui commande — que pour mieux masquer leurs entreprises de domination et, l’étouffant sous leurs embrassades hypocrites, s’emploient à anéantir dans l’œuf toute velléité d’indépendance...
« La liberté, qui n’a pour elle que le droit, est presque toujours victime sur la terre de l’autorité, qui dispose ordinairement de la force et qui possède la ruse. La liberté, reconnue par tous les politiques modernes dignes de ce nom comme un droit primordial de l’espèce humaine, n’a presque jamais existé ici-bas. Limite naturelle de l’autorité, elle s’est toujours offerte aux gouvernements comme un obstacle à leur ambition, une gêne intolérable à leur action... Il est donc naturel à tout gouvernement d’écarter de son chemin la liberté. » (Larousse)
Mais, après ce clair aveu et cette dénonciation, il ne voit encore dans la liberté qu’ « une digue contre les abus du pouvoir » (cette autorité pour lui « représentative de l’intérêt public »), non le milieu propre à en rendre l’appareil inutile, à débarrasser les individus de ses interventions paralysantes, habilement baptisées protectrices. Il n’aperçoit de l’anarchie que ses revendications utopiques, non les principes d’une organisation rationnelle de la liberté, partie enfin de la cellule jusque-là méprisée, apte à élever enfin les hommes vers la vie. D’une société avant tout économique, il n’a pas entrevu (la doctrine est trop jeune à l’époque) les groupements humains associés sur la base de leurs besoins et fédérant leurs efforts, affranchissant l’édifice social de ce dôme superfétatoire, l’Etat (voir ce mot), regardé jusque-là comme la clef de voûte de la société (voir les autres articles sur liberté et les mots anarchie, communisme, organisation, société, etc. où cet aspect de la question est plus particulièrement traité). Mais il sent confusément que c’est du côté de la liberté que viendra la solution attendue et que c’est elle qu’il convient de « défendre courageusement ». L’autorité, toujours portée à l’exagération, « saura bien, dit-il, se défendre elle-même, car elle n’est nullement habituée à jouer le rôle de victime ». Et déjà il s’oppose aux libéraux, indifférents à la forme d’un gouvernement qu’ils espèrent un jour dominer, attaque le pouvoir monarchique, lequel « préoccupé de sa durée éternelle, a pour tendance forcée d’assurer l’avenir et de faciliter le présent en étouffant toute opposition, c’est-à-dire la liberté ». Puis il s’aperçoit — et il n’est pas fort de notre expérience de cinquante ans de ploutocratisme « républicain », il n’a qu’entrevu, à peine échappée des mains de l’Empire et toute enluminée d’espérances, la belle fille que devaient pétrir les aventuriers de la politique alliés aux magnats de l’industrie et aux flibustiers de la banque — il pressent qu’un gouvernement, même démocratique, pourra être tyrannique, mais à un moindre degré et croit-il, sur un plus petit nombre de gens. La démocratie, malgré ses fautes passagères, ses lenteurs, ses traîtrises possibles, lui paraît renfermer le germe impérissable de la liberté naissante. Il n’a pas vu à l’œuvre le despotisme aux appétits multiples, ramassant, en quelques têtes souveraines, une autorité capable , en tenant les foules sous le charme d’habiles promesses, en les abusant par le mirage d’un « contrôle » et d’une « participation » appelée « suffrage universel » — voir ce mot — il n’a pas vu l’hydre vivace renaissant de ses cendres. Et il n’a pu, dégageant de constatations séculaires la leçon décisive, faire remonter jusqu’à l’Etat — incarnation politique de l’autorité — la cause d’un mal toujours renouvelé. Cette « liberté nécessaire » dont il admet enfin qu’elle est « la vraie base de l’ordre social » il ne sait pas que, dans le même cadre hiérarchisé, elle demeure, aujourd’hui comme hier, à la merci des ambitieux qui la faussent et des grands qui la déchirent...
Mais tournons-nous avec lui vers le passé, interrogeant les formules « absolues ou insuffisantes » qui, donnant à la liberté des caractères contradictoires, n’ont pu ni pénétrer ses vertus profondes, ni la faire sagement aimer, ni assurer son accès dans les mœurs, ni la défendre contre ses ravisseurs aux aguets... Il dit :
« Il y a un millier d’années, Alcuin croyait avoir défini la liberté par ces deux mots : innocentia vitæ. Mais Alcuin enseignait plutôt la morale que la politique et son illustre élève, tout entier, comme tant d’autres monarques, au soin de satisfaire son ambition et d’asseoir sa dynastie, n’avait guère le temps de se préoccuper de liberté. Cependant l’innocente devise métaphysique du précepteur de Charlemagne a traversé les siècles ; on la retrouve en substance, chez les puritains de la Nouvelle-Angleterre, qui, dans la loi de l’Etat de Massachusetts — le même qui vient de rencontrer une « justice » pour martyriser d’abord, pour assassiner ensuite deux innocents magnifiques de grandeur morale, et une constitution pour couvrir ce crime de peur, de caste et d’Etat — donnent cette autre définition de la liberté :
« Le droit de faire sans crainte tout ce qui est juste et bon. »
Pour mieux faire ressortir l’esprit de cette maxime, nous y ajouterons un court passage de Vinthrop, l’un des législateurs gouverneurs de cet Etat.
Ne nous trompons pas sur ce que nous devons entendre par notre indépendance. Il y a, en effet, une sorte de liberté corrompue, dont l’usage est commun aux animaux comme à l’homme et qui consiste à faire tout ce qui plaît. Cette liberté est ennemie de toute autorité. Elle souffre impatiemment toutes les règles, et, par elle, nous devenons inférieurs à nous- mêmes. Elle est l’ennemie de la vérité et de la paix et Dieu a cru devoir s’élever contre elle. Mais il est une liberté civile et morale qui trouve sa force dans l’union et que la mission du pouvoir lui-même est de protéger : c’est la liberté de faire sans crainte tout ce qui est juste et bon. Cette sainte liberté, nous devons la défendre dans tous les hasards et exposer pour elle notre vie, s’il le faut. »
Evidemment, les lois qui vont découler d’un pareil préambule pencheront plutôt vers l’intolérance que vers la liberté. Cette distinction de la liberté corrompue et de la liberté sainte ne serait pas désavouée par les docteurs de l’Eglise catholique qui, de leur côté, proclament la liberté de la vérité et proscrivent la liberté de l’erreur. Il va sans dire que, selon eux, la vérité est exclusivement dans leurs prédications et qu’eux seuls doivent être libres. Ils réclament, eux aussi, la liberté du bien, et comme ils se réservent le droit de définir le bien, ils ne demandent et n’approuvent que leur propre liberté. C’est ainsi que Rome a toujours compris la liberté. Personne n’a oublié, en France, l’ardeur que mirent autrefois les catholiques à réclamer la liberté de l’enseignement, ce qui voulait dire, dans leur bouche, le droit exclusif d’enseigner réservé aux évêques et aux frères ignorantins. Veuillot n’écrivait-il pas : « Je vous réclame la liberté au nom de vos principes et je vous la refuse au nom des miens », révélant dans cette apostrophe cynique l’insatiable autorité de l’Eglise.
« Non, nous ne saurions nous accommoder d’une prétendue liberté, sainte ou non, qui punirait de peines sévères le blasphème et défendrait même, au besoin, de voyager le dimanche... Si le mal n’est que la violation des droits légitimes, nous ne reconnaissons à personne la liberté de le commettre ; si c’est une atteinte aux lois de l’Eglise ou d’un décalogue, nous refusons à tout le monde le droit de l’empêcher. C’est ce droit de définir et de prescrire le bien moral et religieux qui, usurpé par l’Etat, a conduit Socrate à la ciguë et Jésus sur la croix. »
Et c’est le même « droit » à définir le bien politique, à incorporer le bien humain dans le bien national qui, tourné vers le maintien de superstitions favorables au régime, conduit aujourd’hui les bénéficiaires de l’Etat à hisser devant les peuples des déités tabou, à créer des crimes de lèse-patrie, de lèse-armée, demain de lèse-autorité, contre ceux qui contestent leur prestige usurpé à un appareil monstrueux, à des entités néfastes à point magnifiés pour anéantir en leur nom, les libertés et les vies... Larousse dit encore :
« La liberté a nécessairement deux termes, en supprimer un, c’est tomber dans la niaiserie. »
Et c’est nier en fait la liberté elle-même.
« Affirmer la liberté du bien et refuser la liberté du mal, c’est dire qu’on a la liberté de faire et non pas celle de s’abstenir ; par exemple, la liberté d’aller à la messe, mais non pas celle de rester chez soi pendant l’office. »
C’est en réalité l’injonction déguisée, c’est l’apparence du « libre choix » derrière lequel les Eglises et les rois, les tenants de la démocratie ou les dictateurs du prolétariat — l’Etat en un mot — abritent une suprématie inamovible, c’est la « liberté » du citoyen abusé par l’éducation, prisonnier de l’économie, qui « choisit » les candidats que la presse et les maîtres lui désignent.
« Presque partout l’antiquité était régie par le principe de l’autorité à outrance, incarné soit dans un homme, soit dans une caste privilégiée. L’Asie tout entière était livrée aux caprices du despotisme et la volonté du prince y tenait lieu de législation. »
Les institutions monarchiques de l’Egypte, quoique plus savantes, étaient non moins absolutistes. Dans les sociétés du temps, même les plus glorieuses, « l’esclavage civil et domestique faisait partie nécessaire de la constitution même ». Un des beaux génies de la Grèce, Platon, méconnaît le caractère sacré de la femme et son égalité naturelle avec l’homme ; Aristote admet la légitimité de l’esclavage. « Nous ne parlerons pas de Sparte où personne n’était libre, où la raison d’Etat écrasait tellement les volontés individuelles que les citoyens les plus fiers n’auraient pas plus réussi à s’y soustraire que les ilotes esclaves. Qu’est-ce que les lois de Minos, sinon la volonté divine ou plutôt la fatalité en action ? Sur une population de deux cent mille âmes, Athènes comptait de quinze à vingt mille citoyens qui se disaient libres et qui l’étaient en effet », mais à qui il manquait une notion claire et logique de la liberté. A Rome, enfin, la liberté n’a jamais existé, ni dans les lois, ni dans les mœurs », les institutions qui consacrent « l’existence d’une classe privilégiée étant incompatibles avec la liberté »...
« Pouvaient seuls se dire libres, au moyen âge, et l’étaient » si l’on veut — de cette « liberté » assise sur la misère et l’accablement — « les possesseurs de fiefs qui ne relevaient d’autrui ni de personne et écrasaient toutes les volontés au-dessous d’eux. Mais, à part ce petit nombre de privilégiés, la masse des populations ne possédait aucun droit sérieux et subissait le joug d’un demi esclavage ». L’affranchissement des serfs, dont aucune législation ne garantissait la condition nouvelle demeurait quasi-nominal parmi des droits précaires dont rien ne garantissait l’exercice ni la durée.
« Une sorte de liberté relative apparaît au XIIème siècle, lors de l’émancipation des communes. C’est à cette époque que commence à se dégager la double notion de la liberté individuelle et de la souveraineté collective. Mais l’affranchissement partiel du peuple et de la bourgeoisie, qui fut, pour une monarchie en voie d’affermissement, un simple moyen de gouvernement, fut pour la nation une semence de liberté qui devait germer plus tard et donner des fruits inattendus. Les empires s’écroulent et les principes demeurent. A l’état latent ou virtuel, ils sont encore assez puissants pour effrayer les despotes sur leur trône et charger la mine des révolutions... »
Principes ou besoins, mais soif impérieuse et croissante, nous les voyons, en effet, menacer encore de nos jours l’encerclement des défenses...
Alors que les pères de la démocratie — philosophes, hommes d’action — qui jetèrent dans l’enthousiasme les premiers jalons d’une « république de progrès et d’évolution » croyaient avoir confié à une solide et définitive armature le dépôt précieux de « la liberté du monde née en 1789 » ; tandis qu’un à un, ces esprits généreux mouraient dans la foi d’une montée pacifique des idées de libération et des institutions de liberté, le dur étau des contraintes sociales, à peine adouci d’illusions politiques, se resserrait autour des masses déshéritées de la nation. Et « ces classes privilégiées dont l’existence est incompatible avec la liberté » réassujettissaient, dans les matérialités de la vie, un royaume que n’avaient point extirpé les proclamations. La souveraineté de la richesse, dont le char de l’Etat véhiculait la « légitimité », affermissait sa griffe dans la chair séculairement meurtrie du prolétaire et présidait à une nouvelle étape de la souffrance invétérée du peuple et de sa faim inapaisée. Le désaccord entre la jouissance et l’effort s’accusait dans les facilités d’une production industrialisée qui tire, au maximum, des bienfaits pour une couche unilatérale... D’un côté, la reconstitution patente, grosse de menaces, sur les ruines de la féodalité, d’une caste dont la propriété individuelle, inconsidérément départie, avait servi le développement. Et l’accaparement, foncier d’abord, puis industriel et financier (conséquence d’une capacité d’achat qu’amplifient encore l’héritage et les gains démesurés, le jeu parasitaire d’actions favorisées, de dividendes princiers, d’intérêts frôlant l’usure), qui porte toujours plus les biens entre des mains puissantes. De l’autre, un prolétariat réduit à la portion vitale et canalisé dans l’impasse du salariat, malgré quelques échappées abusantes, qui voit arracher de ses mains besogneuses des avantages normaux et se l’amener à des affirmations ces droits que la Révolution de 1789 avait posé devant son activité courageuse. Une classe qui sent confusément, lorsqu’elle ne le comprend encore, qu’elle est frustrée des bénéfices du travail au profit d’une autre omnipotente. Et de nouveau, pour une croisade moins superficielle et qui vise à déraciner le mal, des penseurs, des sociologues, s’apercevant de la mainmise, sur l’Etat, des forces détentrices de la fortune, soulignent la dépendance constante de cet organisme et montrent l’inanité des efforts de redressement social qui laissent se reformer, sous les auspices d’une autorité invaincue, des groupes de favorisés dirigeants...
L’école libérale, qui proclamait, dans les vertus d’un laisser-faire où les faibles ne pouvaient qu’avoir le dessous, la toute-puissance de l’individu et ne voulait confier à l’Etat qu’une fonction arbitrale, a battu, de ce bélier, la monarchie de droit divin. Mais, installée au pouvoir, maîtresse de l’Etat, elle a, sinon effacé de la Constitution, au moins altéré le sens de cette liberté dont elle prétendait, la veille, faire un instrument de libération. Elle a pratiqué, comme avant et après elle toutes les écoles autoritaires, le monopole de la liberté. Elle a consolidé les prérogatives des détenteurs de la force, inscrivant dans sa Charte une « égalité devant la loi », dont les législateurs du siècle ont prodigué l’affirmation mensongère. Les lois issues des Assemblées de consultation restreinte, comme de celles qui déclarent tenir leurs mandats d’un suffrage « libre et général » ne cessent jamais d’être à l’égard de l’individu, « un contrat léonin dans ses clauses et vicié dans sa source » entaché de « condition potestative », Elles sont restrictives de la liberté nécessaire. Avec elles, au lieu d’être dans le bon plaisir d’un homme, l’arbitraire est dans la loi même, et le sort de l’individu peut devenir pire qu’auparavant, en ce sens qu’on aura légalisé la servitude et qu’on l’aura rendue plus durable en lui donnant les apparences du droit...
N’oublions pas que « toutes les libertés sont solidaires et qu’elles ont, toutes ensemble, pour support l’égalité ; car toute liberté qui n’est pas dévolue également à l’universalité des hommes doit s’appeler, de son véritable nom, le privilège ». N’est pas la liberté, celle qui demeure l’apanage d’un petit nombre, la liberté que les institutions et les mœurs ne rendent pas, pour tous effective. N’est pas la liberté celle de la République patricienne, malgré le dévouement des Brutus et des Caton, le plaidoyer des Tacite et des Cicéron, ni celle de l’Eglise malgré ses protestations, ni de la France consulaire malgré ses prétentions au libéralisme, ni celle des démocraties prometteuses, en dépit de la sincérité de ses protagonistes, ni celle des fausses républiques modernes que régentent les ploutocraties, ni celle des « républiques sociales » que façonnent les dictatures. Il n’y aura pas de liberté — politique ou sociale : libertés connexes — tant que la bourgeoisie « légataire universelle de la Révolution » n’aura pas restitué au peuple — dépossédé des instruments de travail (sol, outils, capitaux), éloigné en fait des affaires publiques et de l’organisation de la société — le lot et la place qui lui appartiennent. Mais il n’y aura pas non plus de liberté tant que le peuple, par son abdication et son ignorance, laissera se reformer, sur lui, sous l’égide de l’Etat, la coalition du césarisme politique ou économique, tant qu’il ne trouvera pas en lui-même, au lieu de les demander aux gouvernements, inévitablement agents des forts, les garanties de la liberté, tant qu’il ne s’opposera pas à ce qu’on l’emprisonne dans les lois positives. Il n’y aura pas de liberté réelle, tant que les individus prodigueront l’encens à un droit abstrait, « à une idole mutilée », il n’y aura pas de liberté vivante sans la conscience et la vigilance des intéressés...
« La liberté n’est en somme que l’essor des facultés humaines, et l’amour qu’on lui porte est en raison directe de l’élévation de l’esprit et du cœur. »
Avec leurs lumières s’élève le degré de liberté des hommes ; elle monte avec leur savoir et leur raison en pénètre le sens, l’équilibre et la marche. Leur volonté l’empêche de redescendre...
— Stephen MAC SAY
Outre ceux cités plus haut, voir aussi les mots fédéralisme, production, gouvernement, individualisme, socialisme, etc.
LIBERTÉ (POINT DE VUE SOCIAL)
Léon Gambetta qui, s’il fut un tribun fameux, ne fut qu’un penseur médiocre et un piètre philosophe, n’a pas craint de dire un jour :
« Il y a des questions sociales ; il n’y a pas une question sociale. »
Il voulait certainement dire que l’étude de ce que de nombreux sociologues appelaient, dès cette époque, « le problème social » ne se posait pas sous une forme synthétique. Il voulait évidemment dire que, d’une part, chacune des questions se rattachant au problème social doit être étudiée séparément et aboutir à une solution isolée et que, d’autre part, il ne faut pas tenter d’établir entre ces multiples questions un lien d’interdépendance et de solidarité qui n’existe pas, dans le but d’apporter à celle-ci une solution d’ensemble, une solution unique. A l’exception des disciples — peu nombreux — que comptaient les diverses Ecoles socialistes et libertaires, tout le monde partageait, quand elle fut émise, l’opinion de Gambetta. L’Idée socialiste commençait son travail de pénétration dans l’opinion publique et, privée de tous moyens de diffusion, la propagande anarchiste n’avançait que lentement et péniblement. Depuis, la sociologie a fait de remarquables progrès ; elle a précisé les termes du problème à résoudre ; remontant des effets aux causes, puis groupant et sériant les effets et les causes, les différentes écoles sont parvenues à rassembler tous les effets et à les faire remonter, de cause en cause, à une cause essentielle, fondamentale, unique. Actuellement, chaque école se flatte de posséder une doctrine ayant la vertu de contenir la solution de la question sociale toute entière et ce premier point est désormais acquis :
« Il n’y a pas des questions sociales, mais une question sociale. Le problème social doit être étudié d’une façon synthétique ; il comporte une solution d’ensemble, une solution qui découle d’un principe fondamental déterminant les conditions d’existence des collectivités et des individus, une solution qui s’applique à tous les cas d’espèce. »
Je répète que ce point est définitivement acquis. Mais, ici, la pensée parvient à une sorte de carrefour au delà duquel elle s’engage dans des voies différentes. Dans cet article qui, ne le perdons pas de vue a trait à la Liberté, l’exposé, même en raccourci, de la doctrine propagée par les diverses écoles ne serait pas à sa place (Voir Sociologie).
Je dois me borner présentement à faire observer que ces Ecoles se séparent et se différencient profondément : les unes proclamant intangible le contrat social actuel ; les autres, consentant à le conserver mais en y introduisant de sérieuses et multiples modifications ; les autres déclarant carrément que rien ne peut être accompli, -rien de positif, rien d’essentiel — sans que soit déchiré ce contrat social, son principe constitutif et ses articles fondamentaux étant la cause même qui donne naissance aux inégalités et aux antagonismes qu’il faut avant tout et à tout prix supprimer.
Les écoles qui prétendent nécessaire le maintien du contrat social actuel, tel quel ou modifié, sont conservatrices ; celles qui tendent à sa suppression sont révolutionnaires. On comprendra que je ne m’occupe, ici, que de ces dernières. Depuis le commencement de ce siècle, celles-ci ont rallié un nombre considérable d’adhérents ; dans plusieurs nations importantes, elles ont groupé des effectifs qui contrebalancent ceux des écoles de conservatisme social et il n’est pas déraisonnable d’avancer que le nombre des personnes conscientes de la nécessité d’une transformation vaste et profonde serait, d’ores et déjà, suffisant pour mettre à exécution leurs desseins si l’entente existait entre elles. Mais cette entente n’existe pas et j’ajoute qu’elle ne peut pas exister,
Quand des hommes se proposent le même but et que les divergences n’éclatent entre eux que sur la question des voies et moyens, l’accord est souvent long et difficile à se faire ; mais il reste toujours possible et, à la faveur de certaines circonstances, recherchées ou imprévues, il se réalise parfois. Mais lorsque cette opposition de tactique provient de l’opposition du point de départ et du but à atteindre, l’entente ne peut se produire ; car, sur quelle base reposerait-elle ?
Imaginez une troupe d’individus devant effectuer le même voyage, c’est-à-dire partant du même lieu et se proposant d’arriver au même endroit ; il pourra surgir des discussions sur l’heure du départ, l’itinéraire à suivre, le moyen de transport à employer, mais il est à espérer qu’ils finiront par se mettre d’accord sur ces diverses questions et faire route ensemble.
Tandis que, si vous supposez des personnes ayant à effectuer non seulement des voyages différents, c’est-à-dire n’ayant ni le même point de départ, ni le même point d’arrivée, mais encore des voyages en sens inverse — les unes se dirigeant vers le nord et les autres vers le sud — il est de toute évidence qu’elles n’arriveront jamais à suivre la même voie.
Or, dans le grand mouvement social qui caractérise notre époque, les divergences de vue sont nombreuses ; quelques-unes sont de minime importance, mais d’autres tout à fait fondamentales. Ces dernières ont créé deux groupements bien distincts, absolument opposés l’un à l’autre, n’ayant pas la moindre affinité réelle et stable, malgré des extériorités qui, pendant quelques années, les ont fait se ressembler beaucoup et, même aujourd’hui, les font parfois confondre. Ces deux groupements correspondent à deux courants symétriquement opposés : le courant libertaire ou anarchiste et le courant autoritaire ou étatiste, entre lesquels toute conciliation est parfaitement irréalisable. Les divergences de détail ont amené, au sein du parti autoritaire, des querelles, — querelles de personnalités qui, se disputant l’avantage de diriger le dit parti, et de faire peser sur lui comme une dictature, ont fondé plusieurs chapelles dans lesquelles chacun de ces grands Prêtres officie à son aise -, mais disputes qui n’empêchent pas parfois une entente momentanée, petite guerre qui comporte de fréquents armistices et qui peut — quand l’orgueil des leaders déposera — se terminer par un bon traité de paix. Par contre, entre les socialistes (collectivistes ou communistes) et les libertaires, toute conciliation est impossible. Les hostilités ne peuvent aller qu’en s’intensifiant et ne prendront fin que par la victoire complète et définitive des uns sur les autres.
C’est sur la véritable, l’unique cause de tous les maux relevant de l’organisation sociale que s’opposent les deux conceptions : socialiste et anarchiste. La lutte vient de là. Libertaires-anarchistes et Autoritaires socialistes et communistes déclarent volontiers, les uns et les autres, que cette cause, c’est l’organisation sociale ; toutefois cette expression : « l’organisation sociale » est extrêmement vague ; son sens exact demande à être précisé ; il y a plusieurs façons — parfois contradictoires — de comprendre ce terme et c’est lorsqu’on tente de le définir clairement et sans ambigüité que le désaccord naît soudain. Qu’on me permette une comparaison : quand, afin de mieux étudier le corps d’un animal, le naturaliste en examine une à une chaque partie isolément, — comme si elle pouvait se séparer de l’ensemble — le fait ne peut se produire qu’à l’aide d’une abstraction qui n’existe que dans la pensée de l’opérateur mais que dément la réalité des choses. C’est par un procédé du même genre qu’on peut analyser successivement nos diverses institutions sociales ; mais il est bien certain que, en fait, les unes et les autres font partie d’un tout compact et homogène, dont il est impossible, autrement que par la pensée, de détacher les multiples éléments. Si les institutions économiques pèsent principalement et directement sur les besoins matériels de l’individu ; si les politiques atteignent plus spécialement ses besoins intellectuels ; si les morales frappent plus particulièrement ses besoins psychiques, affectifs et sexuels, l’indissoluble lien qui unit tous ces besoins chez l’être social, se retrouve dans ces diverses institutions. C’est que, au fond, et malgré ces adjectifs de distinction : économique, politique, morale, l’iniquité sociale est une comme l’individu est un. L’agencement des Sociétés contemporaines est extrêmement complexe ; il comporte un outillage et des proportions gigantesques : il peut être comparé à un colossal chantier comprenant les machines les plus diverses et les produits les plus variés. Ici, l’on travaille le fer ; là, le bois ; ailleurs, les tissus, etc. De formidables arbres de couche, reliés par des milliers de courroies, de tubes, d’axes, de cylindres, d’engrenages, à une multitude de mécanismes, communiquent le mouvement à ces derniers. Chaque appareil semble distinct, séparé, et pourtant tout se tient, se commande, s’enchaîne. La force motrice est une ; c’est elle qui distribue la vie à tous ces ouvriers métalliques. Que le moteur éclate et le silence se refera, le repos se produira.
Assourdi par le vacarme, distrait par la variété du spectacle qui s’offre à sa vue, perdu dans le nuage de poussière et de fumée qui l’enveloppe, le visiteur oublie facilement, dans cette inquiétante complexité, que tous ces appareils obéissent à la même force. Mais qu’il sorte de cette fournaise, qu’il gravisse la montagne voisine et là, dominant toute la région travailleuse, il sera frappé par cette admirable unité au sein d’une diversité dont les merveilles l’auront, une à une ébloui. De même, pour bien envisager l’immense laboratoire où s’élabore la souffrance humaine, il faut que le penseur fasse l’ascension ; qu’il s’éloigne du fracas, s’isole, et se recueille après avoir vu et examiné. Ainsi regardées de haut et se présentant d’ensemble, les choses se simplifient étrangement. Le philosophe, alors, acquiert la certitude que l’organisation d’une société n’est que le développement nécessaire d’un principe primogéniteur ; qu’elle est la réalisation, dans le domaine des faits sociaux, d’une idée-mère ; que les diverses institutions reposent sur cette base unique ; qu’elles en dépendent en tout et pour tout ; que ce premier principe est aux institutions sociales ce que la force motrice est aux divers ateliers d’une usine, ce que le principe vital est aux organes d’un animal ; qu’en un mot c’est lui et lui seul qui les anime, les développe, les mouvemente, les met en action ; qu’il en est la raison d’être ; que, sans lui, elles se pulvériseraient.
Observateur et doué d’une logique pénétrante, le monde socialiste a compris cette vérité ; il a constaté qu’ainsi, les institutions de toute nature : économiques, politiques, morales, ne sont en réalité, par rapport à la souffrance universelle, que des causes dérivées ; qu’il faut chercher, au-dessus, la cause première de cette organisation ; que, celle-ci maintenue, toute la structure sociale garderait l’empreinte des mêmes vices ; que le seul moyen de remédier au mal, c’est d’en dénoncer l’origine et d’attaquer résolument celle-ci.
L’élément socialiste autoritaire voit cette origine dans le principe de « propriété individuelle » ; l’élément libertaire la découvre dans le principe d’ « autorité ». Ma conviction est que cette dernière opinion est fondée.
Je vais donc indiquer d’abord ou gît l’erreur ; je justifierai ensuite mon appréciation. Cette question est de premier ordre, car c’est de sa solution que dépend tout le problème. Je répète les termes de celui-ci : l’humanité souffre, elle est accablée par la douleur. Quelle est la source de ce fleuve d’infortune ? C’est la Propriété individuelle, parce qu’elle fait « les uns riches et les autres pauvres », disent les socialistes autoritaires, et les libertaires de répondre :
« C’est l’Autorité, parce que faisant des uns des maîtres et des autres des serviteurs elle engendre toutes les oppressions, inégalités et compétitions, parce qu’elle s’oppose à la libre satisfaction de tous les besoins : physiques, intellectuels et moraux, satisfaction qui constitue, pour chaque individu, le bonheur, tout le bonheur ! »
Telles sont les deux réponses ; voyons quelle est la bonne ; examinons qui a tort, qui a raison.
Malgré les obscurités dont on semble s’être plu à envelopper cette question (comme si l’on appréhendait d’être fatalement poussé jusqu’aux conséquences révolutionnaires qu’entraîne un tel examen), il est assez simple d’y apporter la lumière. La cause réelle, première, unique de la mondiale adversité le reconnaît au caractère « d’universalité » qu’elle doit nécessairement revêtir. Toute cause qui ne portera pas ce trait distinctif devra être repoussée ; seule devra être acceptée pour telle, celle qui présentera ce « signe de reconnaissance ».
Mais comment distinguer ce cachet « d’universalité ? »
En soumettant la cause présumée aux deux épreuves suivantes :
-
examiner si les souffrances humaines se rattachent toutes à cette cause et multiplier les expériences dans le domaine physique, intellectuel et moral pour arriver à une certitude en remontant de l’effet à la cause ;
-
contrôler le résultat de cette première constatation par la preuve inverse, c’est-à-dire en descendant de la cause à l’effet pour savoir si, en l’absence de la première, le second disparaît. On voit que rien n’est plus simple ni plus concluant. Ce critérium admis — et il me semble impossible de le contester — expérimentons-le en premier lieu sur la Propriété individuelle.
L’observation établit que la forme actuelle de la propriété — ce que j’appellerai l’iniquité économique -donne naissance aux inégalités les plus choquantes, à des compétitions sans nombre, à un épouvantable paupérisme. J’ai énuméré et décrit trop complaisamment (voir Anarchie, Anarchisme et la plupart des articles publiés dans cet ouvragé sous ma signature) ces plaies sociales pour que vienne à l’esprit du lecteur la pensée de me reprocher d’avoir celé quoi que ce soit de ces tortures. J’ai déjà eu l’occasion de dire, et je ne saurais trop le répéter, qu’étant donné la chaîne que forment les diverses institutions sociales, il est facile de trouver en chacune d’elles le stigmate de toutes les autres. Aussi n’éprouvai-je aucune difficulté à convenir que notre système du « tout appartient à quelques-uns » pèse tant directement qu’indirectement, d’un poids énorme sur les conditions d’existence et les destinées de l’individu. Mais peut-on, quelle que soit la souffrance examinée et quel qu’en soit le sujet, soutenir que c’est l’application de cette unique formule qui la détermine ? Si l’individu n’avait que des besoins économiques à satisfaire si, pour être et se sentir heureux, il suffisait de posséder bonne table, bon gîte, bon vêtement, si la joie de vivre se bornait aux jouissances dites matérielles, on pourrait hardiment répondre par l’affirmative. Sans doute, tout cela, c’est du bonheur ; c’est une partie du bonheur, je ne le nie pas ; mais ce n’est pas tout le bonheur. L’homme n’est-il qu’un ventre ? N’est-il donc qu’un estomac qui digère ? N’est-il qu’un composé de sens qui jouissent ou souffrent ? Est-il heureux par le fait seul qu’il mange lorsqu’il a faim, boit quand il a soif se repose lorsqu’il est fatigué, dort quand il a sommeil et... aime quand il est en rut ? L’être social du XIXème siècle ressent parallèlement à ces besoins de nutrition, de vêtement, d’habitat, de reproduction, toute la gamme des besoins cérébraux et affectifs. Il pense, il sait, il veut, il aspire, il sympathise, il affectionne.
Si la suppression du travail excessif, de l’excessive privation et de l’insécurité du lendemain suffit à la joie de vivre, ainsi que semblent le croire les socialistes anti-propriétaires, comment se fait-il qu’ils ne soient pas complètement heureux, ceux qui, vivant dans l’opulence et à l’abri des coups de la fortune, peuvent ne rien refuser à leur tube digestif, à leurs sens, à leur amour du bien-être, du confortable, du luxe ? Pourtant ces privilégiés connaissent, eux aussi, la douleur. Ils ignorent les angoisses des estomacs affamés, des membres grelottant de froid, des bras tombant de harassement, c’est vrai ; mais ils sont en proie aux affres de la jalousie, aux déceptions de l’ambition, aux inquiétudes de la conscience, aux morsures de la vanité, aux tyrannies du « qu’en dira-t-on », aux sujétions du convenu, aux obligations familiales, aux exigences mondaines ; ils se débattent au sein des écœurements, des dégoûts, des indignations, des révoltes.
Ceux-là ne souffrent point, n’est-ce pas, de la forme d’appropriation individuelle consacrée par le régime capitaliste, puisqu’ils en accaparent personnellement tous les avantages ? Et, cependant, ils sont malheureux, eux aussi, par le fait d’une organisation sociale, d’une éducation, des us et coutumes, des rivalités, des ambitions qui fréquemment leur interdisent de penser, d’aimer, d’agir comme ils le voudraient et les obligent à se conduire autrement qu’ils le désireraient. Voilà donc que sur ce premier point, nous trouvons en défaut la propriété individuelle considérée comme cause première et unique.
Il est vrai que les dialecticiens anticapitalistes ne sont pas embarrassés pour si peu. Ils répondent que ceux dont je viens de parler ne souffrent pas directement de l’organisation économique, que, tout au contraire, ils en bénéficient : mais qu’ils en pâtissent indirectement parce que c’est la susdite organisation qui a fait naitre et qui nécessite les institutions politiques et morales dont ils ont à se plaindre et qui jettent tant d’ombre dans la clarté de leur existence. Eh bien ! Si l’on admet cette hypothèse — je me sers du mot hypothèse parce que cette opinion, même historiquement, n’est nullement démontrée — il suffit d’examiner si la transformation de la seule organisation économique suffirait à faire disparaître les tourments dont il est question. Si oui, c’est que la propriété individuelle est bien réellement la cause première et unique de tous les maux, puisque celle-ci supprimée, la souffrance universelle est conjurée. Si non, c’est que cette cause est ailleurs.
C’est précisément le second point de ma démonstration. Or, les socialistes qui dénoncent la propriété individuelle comme l’unique cause de la douleur sociale, sont partisans de l’autorité. Ils n’entendent en aucune façon briser toutes les entraves, toutes les contraintes. Croyant la réglementation nécessaire, ils se proposent, le pouvoir conquis, de le faire servir à l’application de leur système et de rétablir, sous l’euphémisme d’ « administration des choses », un système étatiste — le quatrième Etat, l’Etat socialiste, l’Etat ouvrier — dont le rôle sera de gérer la richesse sociale, et, pour cela, d’élaborer des lois, de prendre des décisions d’ordre général et, conséquemment, de les faire respecter. Qu’on le veuille ou qu’on ne le veuille pas, cette conception particulière d’une société socialiste est la continuation de notre système gouvernemental. Car, pour être en mesure d’assurer l’exécution d’une décision quelconque et a fortiori d’un ensemble de décisions simultanées et successives embrassant la totalité des manifestations de la vie individuelle et collective, il est indispensable d’employer la contrainte, de recourir à la force. C’est donc le maintien fatal de ce formidable appareil répressif qui nécessite police, tribunaux et prisons ; c’est l’obligatoire perpétuation de cette écrasante hiérarchie qui va du pouvoir suprême au plus humble représentant du fonctionnarisme ; c’est enfin non moins forcément la compression douloureuse de tous les besoins matériels, intellectuels et psychiques, pour que les individus ne soient pas tentés d’enfreindre la nouvelle réglementation établie par les nouveaux législateurs.
Seraient-ils heureux, ceux qui comparaîtraient devant ces tribunaux et seraient plus ou moins longtemps détenus dans les nouvelles bastilles ; ou encore condamnés par la magistrature socialiste aux plus durs travaux ? Les rivalités s’exerceraient-elles moins violemment qu’aujourd’hui, entraînant à leur suite leur hideux cortège de haine, de rancune, d’envie, de calomnie, de bassesse, de flatterie, lorsque, le champ commercial, industriel et financier leur étant fermé elles se livreraient bataille, pour les premières places dans la hiérarchie administrative ? Aurait-il plus que de nos jours, la possibilité de satisfaire tous ses besoins, c’est-à-dire de goûter le bonheur, l’individu dont tous les appétits seraient, comme aujourd’hui, plus qu’aujourd’hui peut-être, incessamment prévus, réglementés et mesurés ? Il est facile de concevoir une société dans laquelle n’existerait plus la propriété individuelle et survivraient pourtant, avec toutes leurs conséquences, les institutions politiques et morales de notre époque.
La transformation de l’organisation propriétaire n’amènerait pas le moins du monde la suppression des iniquités politiques et morales. Ceux qui sont victimes du « tous obéissent à quelques-uns » continueraient à être sacrifiés. Donc, les socialistes autoritaires, une fois de plus, ont tort.
Dans une œuvre admirablement documentée, Emile de Laveleye — une de leurs autorités — en étudiant « La propriété et ses formes primitives » démontre que l’appropriation privée est de date relativement récente et que, en tous cas, elle a été, dans tous les pays, précédée d’une appropriation plus ou moins commune. S’il était exact que le malheur social provînt du seul « Tout est à quelques-uns », il faudrait conclure que les peuples primitifs durent connaître la vie heureuse. Or, l’histoire, la tradition et la science établissent qu’il n’en fut rien. L’erreur des socialistes autoritaires gît dans ce fait que, exaspérés par l’iniquité qui accable le plus grand nombre et opprime les besoins les plus universels et les plus urgents à satisfaire ; l’iniquité économique, ils n’ont vu que celle-là et, étudiant ses rapports avec les deux autres, constatant son évidente ingérence dans le domaine politique et moral, ils l’ont prise — à la légère -pour le point de départ de tous les crucifiements. Ce qui a contribué, plus que toute autre chose, à les faire verser dans cette ornière, c’est l’influence décisive de l’école socialiste allemande et des écrits de Karl Marx considérés comme l’Evangile du Parti, bien que sur mille membres de celui-ci, il n’y en ait pas cinquante qui les aient lus, pas cinq qui les aient compris. Je conclus en disant que les socialistes autoritaires se trompent ; en prenant la propriété individuelle pour la cause unique de la douleur universelle, ils ont simplement pris la partie pour le tout.
Examinons maintenant la réponse des libertaires qui accusent l’Autorité de tout le mal, et procédons comme pour la propriété privée. Ici, j’ouvre une large parenthèse, car il me semble nécessaire de dire comme Voltaire : « Définissons ! » afin de bien préciser de quoi nous parlons. L’Autorité, considérée comme principe de l’organisation sociale, ne correspond pas seulement à l’idée de gouvernement. Il est évident qu’elle doit être envisagée ici dans son acception la plus large, et comme conséquence, dans ses résultats les plus variés. Le système gouvernemental n’est qu’une modalité particulière de l’Autorité, comme la propriété privée en est une autre, comme aussi la morale obligatoire. Propriété, gouvernement, morale, telles sont, au point de vue social, les trois grandes manifestations du principe d’Autorité. Celui-ci s’exerce : plus particulièrement sur les besoins matériels sous la forme « propriété individuelle » ; plus spécialement sur les besoins intellectuels sous la forme « Etat » et plus directement sur les besoins psychiques sous la forme « Morale ». Ce sont comme les doigts de fer d’une seule et même main ; tantôt c’est l’un, tantôt c’est l’autre qui pénètre plus avant dans les chairs meurtries de la pauvre humanité, attaquant tour à tour l’estomac, la tête et le cœur. La propriété tyrannise le ventre ; le gouvernement opprime le cerveau ; la morale broie la conscience.
L’Autorité, c’est la servitude, la contrainte pour tous les membres de la Société ; non pas la servitude partielle comme celle qui peut résulter de l’iniquité économique seulement, mais totale, absolue, permanente ; celle qui saisit l’être tout entier, l’empoigne au berceau. Il suit partout sans jamais lui laisser un instant de répit, substituant à sa volonté une volonté étrangère, faisant qu’il ne s’appartient plus et lui enlevant tout espoir d’émancipation possible. C’est la manie et — il faut bien le reconnaître — la nécessité, une fois le principe admis, de tout réglementer, d’indiquer en toutes choses ce qui est permis et ce qui est défendu ; de protéger ce qui est autorisé, de poursuivre et de condamner ce qui est interdit, d’exiger ce qui est prescrit. La propriété n’est pas autre chose, en fait, que l’autorité sur les objets, c’est-à-dire le pouvoir d’en disposer (jus utendi et abutendi) le gouvernement et l’éthique obligatoire ne sont pas autre chose, en réalité, que l’autorité sur les personnes, c’est-à-dire le pouvoir d’en disposer souverainement, d’en user et d’en abuser. Ne dispose-t-il pas souverainement de l’individu, l’Etat qui en fait simultanément ou successivement un citoyen, un contribuable, un soldat ? Ne dispose-t-elle pas arbitrairement de la conscience, cette Morale qui dicte à chacun ce qu’il doit faire ou éviter, séduisant les cupides par le miroitement de ses promesses, épouvantant les lâches par la crainte de ses menaces ?
Et qu’on m’entende bien : l’Autorité, ainsi conçue, est un principe absolument indépendant — au point de vue qui nous occupe — des personnalités qui le représentent ; que celles-ci soient religieuses ou athées, républicaines ou monarchistes, opportunistes, radicales ou socialistes, l’Autorité peut changer de mains constamment ; mais elle reste identique à elle-même. Elle est ce qu’elle est, ses conséquences sont ce qu’elles sont, toujours et quand même. La grosse erreur de notre démocratie consiste à croire qu’il suffit de changer les hommes pour transformer les institutions ou en supprimer les duretés. Il n’en est rien. Les procédés de l’Autorité sont fatalement les mêmes. Les régimes autoritaires se suivent et se ressemblent forcément et il en sera obligatoirement ainsi aussi longtemps que, en application nécessaire du principe d’Autorité il y aura : d’une part, des gens qui gouvernent et, d’autre part, des personnes qui doivent se soumettre, quelles que soient, au demeurant, celles-ci et celles-là.
On peut maintenant porter ses regards sur n’importe quel point de l’enfer social, on peut examiner le cas de n’importe quelle victime, il est certain que partout et chez toutes on retrouve l’estampille de l’autorité : Propriété, Etat ou Morale. D’où vient toute souffrance ? D’un besoin privé de satisfaction ! D’où vient cette privation ? D’une loi, d’un règlement, d’une menace, d’une contrainte matérielle ou morale ! D’où vient cette pression morale ou matérielle ? De l’Autorité. C’est simple comme deux et deux font quatre ; mais, dit Grove, « la conception la plus simple d’une chose est souvent celle qui s’impose la dernière à la raison ».
Un être a faim : des fruits pendent aux arbres de la campagne ; des montagnes de denrées encombrent les magasins de la ville. Pourtant, il ne mange pas. Pourquoi ? Parce que sa conscience lui représente que ces fruits et ces denrées ne lui appartiennent pas et qu’il serait mal de se les approprier : contrainte morale ; ou bien parce que la crainte de l’agent de police, du magistrat, de la prison l’emporte sur le besoin de se nourrir : contrainte matérielle. Un jeune homme sent toute la dureté de la loi qui l’enferme à la caserne, néanmoins, il fait son service militaire. Pourquoi ? Parce qu’on lui a enseigné que tout homme valide doit apprendre le métier des armes pour contribuer à la sécurité ou à la grandeur de ce qu’on nomme Patrie : contrainte morale ; ou bien parce que des conseils de guerre appliquent un code d’une sévérité féroce à tout coupable d’insoumission ou de désertion : contrainte matérielle. Deux jeunes gens sont pris d’un désir fou de se donner l’un à l’autre et ils se refusent ce bonheur. Pourquoi ? Parce que, malgré les éloquents appels de la nature en feu, ils s’imaginent qu’il serait contraire à l’honneur de passer outre au mariage : contrainte morale ; ou bien parce que, le consentement des parents leur étant refusé, on ne veut pas les unir : contrainte matérielle. Pourquoi la prostitution ? Parce que de pauvres créatures sont poussées par l’intérêt ou la nécessité à trafiquer de leur corps. Pourquoi la jalousie ? Parce que nous introduisons dans les choses de l’amour l’idée de durée, d’obligation, de propriété, de contrat, d’exclusivisme. Pourquoi l’hypocrisie ? Parce que nous sommes poussés à dissimuler ceux de nos actes et de nos sentiments qui sont en contradiction avec la règle établie ou jugés sévèrement par l’opinion publique. Pourquoi la cupidité ? Parce qu’il est besoin d’argent pour se procurer l’objet le plus indispensable aussi bien que le plus superflu ; parce que la richesse confère tous les mérites et que la pauvreté les enlève tous. Pourquoi la guerre ? Parce que les peuples sont élevés dans la haine les uns des autres, qu’ils obéissent à leurs dirigeants qui les contraignent à s’égorger mutuellement. Pourquoi les prisons ? Parce qu’il y a des lois, que celles-ci sont perpétuellement violées et que toute infraction à ces lois nécessite une répression. Pourquoi le crime ? Parce que la passion trop et trop longtemps comprimée se satisfait à tout prix, même par le meurtre, même par l’assassinat. C’est la revanche de la nature outragée ou violentée. Pourquoi l’aplatissement de tout un peuple devant un tyran couronné ou un aventurier de la politique ou de l’armée ? Parce qu’on a tellement infusé dans nos veines le respect stupide de la force, que nous la subissons quand elle se montre dans la personne d’un gendarme ou d’un commissaire de police, et que nous l’acclamons lorsqu’elle se manifeste sous la forme d’un monarque, d’un ministre ou d’un général.
Je pourrais multiplier les points d’interrogation à l’infini, évoquer tous les morts, interroger tous les vivants, à tous demander le pourquoi de ce qu’ils ont souffert ; tous feraient entendre un « parce que » qui aboutirait à un scrupule, à un devoir, à une obligation, à une nécessité, à une servitude. Je défie qui que ce soit de découvrir une seule douleur d’ordre social qui ne découle pas d’une loi ou d’un préjugé, qui ne se rapporte pas à une tyrannie quelconque, qui ne corresponde pas à une contrainte, en un mot, qui ne puisse, en fin de compte, se résumer comme suit : « Je ne fais pas ce qui me plaît » ; « je suis contraint de faire ce qui ne me convient pas ». La société ressemble à un immense bagne ; les individus n’y circulent que les membres brisés par les chaînes, alourdis par les entraves. Ils sont comme emprisonnés dans un de ces instruments de torture qu’on utilisait au temps de la question. Le corps y est étreint tout entier, les pièces diverses de l’appareil se rapprochant alternativement, serrant tantôt la tête, tantôt les pieds. Quel que soit le tourment subi, il vient de l’instrument de torture. Celui-ci n’est-il pas l’image de l’Autorité ?
Aussi, quand je vois des populations entières n’interrompre leurs gémissements que pour demander de nouvelles lois, il me semble que ce sont des condamnés à la question qui supplient le bourreau de se montrer doux et compatissant ou encore le conjurent d’écraser un peu moins l’estomac, dût-il se rattraper sur les jambes et le crâne. Insensés ! Vous réclamez des lois ? Prenez toutes celles qui sont comme les pierres de ce monument colossal : le Code. Compulsez-les toutes, prenez-les une à une et vous n’en trouverez pas une seule qui n’afflige un certain nombre d’entre vous. Le sort d’une loi, quelle qu’elle soit, est de porter la douleur avec elle et si la souffrance est partout, c’est que la législation a tout envahi, tout réglementé, tout codifié. Elle a donné à toutes choses une allure méthodique et obligatoire qui leur enlève tout attrait quand elles en ont, et ajoute à leur désagrément lorsque, par avance, elles sont pénibles. Ignorez-vous donc que, comme le dit Rousseau, « toujours ces noms spécieux de justice et de subordination serviront d’instruments à la violence et d’armes à l’iniquité ? »
Vous revendiquez plus de bonne foi, plus d’équité dans le contrat social ? Mais il y a plus d’un siècle que Condorcet a écrit :
« Quelle est l’habitude vicieuse, l’usage contraire à la bonne foi, quel est même le crime dont on ne puisse montrer l’origine, la cause première, dans la législation, dans les institutions, dans les préjugés ? »
De nouvelles lois ? Mais, malheureux, ne vous rendez-vous pas compte que ces nouvelles lois engendreront de nouvelles infractions, et celles-ci de nouvelles incarcérations ? Or, dit Esquires dans son ouvrage remarquable ayant pour titre : « Les Martyrs de la Liberté », la liberté n’est pas conquise et elle ne le sera pas « tant que les prisons seront debout. Il faudra les renverser et en jeter la clef dans l’abîme, quand on voudra qu’elles ne s’emplissent plus des douleurs du peuple ». Surtout ne dites pas : « tant pis pour ceux qui ne respectent pas la loi et s’attirent les sévérités de la magistrature ! » Les prisons sont une menace pour tous. Nul ne peut affirmer qu’il ne se produira jamais de circonstances qui l’y fassent entrer. Elles s’emplissaient naguère de républicains ; ceux-ci se chargent aujourd’hui d’y envoyer leurs adversaires. Je plains celui qui peut regarder ces édifices en se disant : « Je ne serai jamais enfermé dans ces murs ! » Celui-là ne peut avoir ni dignité, ni passion, ni courage, ni conviction. Il est le plat valet des oppresseurs, prêt à se faire oppresseur lui-même.
Donc, dans l’ordre économique comme dans le politique et le moral, il n’est pas une affliction qui ne découle directement d’une servitude ou d’une contrainte, qui ne soit, par conséquent, le fait du principe d’Autorité. Voilà pour le premier point. L’examen est concluant si l’on va des effets à la cause. Il nous reste à tenter l’épreuve en sens inverse, c’est-à-dire en allant de la cause aux effets. Cette épreuve n’est, à la vérité, que le contrôle de la précédente. Lorsque, un peu plus haut, nous avons eu constaté que la propriété individuelle n’est pas la cause unique de toutes les adversités, nous n’avons eu aucune difficulté à reconnaître que la disparition de cette seule iniquité n’entraînerait pas celle de toutes les autres. En ce qui concerne l’Autorité, s’il est admis que tous les tourments de la vie individuelle et sociale se greffent sur ce tronc unique, il va de soi que, celui-ci sapé, il ne restera rien de l’arbre néfaste, rien de ses feuilles, rien de ses fruits, qu’un amas de matières putrides bien vite dispersées par le souffle libertaire. Que disparaisse le principe autoritaire et aussitôt s’effondrent toutes les lois, conventions, règlements et préjugés qui, dans la société moderne, meurtrissent la personnalité humaine. Les besoins cessent d’être contrariés et trouvent ouvert devant eux l’horizon infini des saines satisfactions ; les appétences se donnent libre cours ; les facultés, rationnellement cultivées, se développent normalement ; les aspirations trouvent dans le grand Tout matériel, intellectuel et affectif, les assouvissements désirables ; les attractions et les répulsions se classent, se sérient, circulent à l’aise, associant ici, désagrégeant là.
Les groupements se forment, se multiplient, se fédèrent, sans autre lien que l’intérêt général étroitement et indissolublement réconciliés avec les intérêts particuliers ; l’humanité prend sa place dans la nature, combinant harmoniquement hommes et choses, suivant les seuls principes de la force et du mouvement, sans autres entraves que celles afférentes à chaque être, à chaque état, à chaque âge.
Un individu a faim et il mange ; pourquoi ? Parce qu’il a conscience que le droit de se nourrir ne peut lui être contesté : plus de contrainte morale ! Et, parce que l’arbitraire du tien et du mien n’existant plus, il n’a plus à redouter la sentence d’un magistrat : plus de contrainte matérielle ! Deux jeunes gens s’aiment et ils cèdent, sans scrupule, aux désirs qui les jettent dans les spasmes enivrants ; pourquoi ? Parce qu’ils n’ont à appréhender ni les reproches d’une conscience bêtement timorée, ni la déconsidération publique, ni les conséquences éventuelles d’une heure de volupté, parce qu’ils savent au contraire que le plaisir est bon par lui-même et qu’il devient vertu lorsque, en s’en procurant, on en donne à un autre : plus de contrainte morale ! Et parce que, n’ayant à subir l’autorité de personne ni d’aucune loi, il leur semblera on ne peut plus naturel et équitable de disposer d’eux-mêmes comme il leur plaît : plus de contrainte matérielle !
Il est impossible d’imaginer qu’une seule des infortunes d’ordre social signalées au cours de cet ouvrage puisse survivre à la suppression du principe d’Autorité. Dans une société privée des lois qui attribuent la richesse aux uns et laissent la misère aux autres, dépouillée de la force qui sanctionne l’accaparement des premiers et la détresse des seconds, peut-on concevoir des hommes manquant du nécessaire à côté d’êtres gorgés de luxe ? Je ne le pense pas ! Dans une humanité débarrassée de l’outillage tyrannique des monarchies, des républiques parlementaires, des Etats, conséquemment des tribunaux, des prisons, des casernes, peut-on imaginer des maîtres qui commandent et des esclaves qui obéissent ? Pas davantage ! Peut-on enfin supposer, dans une société qui n’a pour toute règle de morale que le « fais ce que veux » de l’immortel Rabelais, des individus dépensant leur énergie, à châtier leurs plus naturelles et plus nobles passions, à vivre dans les transes d’une conscience terrorisée, à résister aux propulsions de la chair, aux turbulences inquiètes de la pensée, au désir de rechercher et de savoir ? Evidemment non !
Et la prostitution ? Et le vol ? Et la violence ? Et la guerre ? Et l’hypocrisie ? Et la cupidité ? Et la soif de domination ? Ces fléaux de notre époque mercantile et hiérarchique, n’est-il pas certain qu’ils disparaitront plus ou moins rapidement quand ils ne trouveront plus à s’alimenter ?
Pourquoi la femme se prostituerait-elle, si elle ne trouvait aucun intérêt à se vendre et si rien : ni loi, ni famille, ni opinion publique, ni éducation, ni morale, ne lui reprochait de se donner ? Pourquoi volerait-il, celui qui n’aurait qu’à prendre au tas tout ce dont il aurait besoin ? Et si, atteint de kleptomanie, quelqu’un dérobait un objet à l’usage d’un autre, quel tort ferait-il à ce dernier qui pourrait remplacer l’objet soustrait, avec beaucoup moins de peine et d’ennui qu’il n’en prend aujourd’hui pour saisir d’une plainte le commissaire de police, déposer devant le juge d’Instruction et témoigner en justice ? Pourquoi la guerre, en l’absence de patries, c’est-à-dire d’agglomérations plus ou moins étendues vivant sous le même gouvernement et les mêmes lois, gouvernants et législateurs ayant été emportés avec l’Autorité qui les crée ? Il n’y aurait plus alors qu’une seule patrie : l’univers, et France, Allemagne, Angleterre, Russie, Etats-Unis, seraient de simples expressions géographiques représentant une partie de la planète, comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux sont aujourd’hui des expressions géographiques servant à désigner, en France, des points spéciaux. Pourquoi l’hypocrisie, lorsque la vérité n’aurait rien à perdre, la fourberie rien à gagner ? Qui donc consentirait à se souiller sans profit du mensonge ? Qui donc s’affublerait d’un masque pour le seul plaisir d’en être incommodé ? Pourquoi la rapacité, alors que billets de banque, actions et obligations ne seraient que de vulgaires chiffons de papier, et que, le commerce n’ayant plus sa raison d’être, point ne serait besoin, pour se procurer les choses utiles ou agréables, de posséder de l’or ou de l’argent ? Que deviendrait la soif de domination, parmi des hommes libres dont nul ne consentirait à obéir et dans une société dont seraient brisés à jamais tous les rouages hiérarchiques ? Faute d’aliment, l’ambition de commander mourrait.
Je pourrais remplir des pages et des pages de points d’interrogations de ce genre ? A tous la réponse serait identique. Par elle-même la propriété individuelle n’est rien autre chose qu’une fiction, Elle ne devient réalité — et hélas réalité douloureuse ! — qu’en s’appuyant sur la Législation qui stipule les conditions dans lesquelles il est permis d’accaparer une part de l’avoir commun, d’en tirer profit, et sur la force armée, mise au service de cette législation tout en faveur des riches. Intrinsèquement, la morale n’est qu’un mythe et, malgré dogmes religieux, famille, éducation, bien faible serait son pouvoir sur les consciences, si toute dérogation au « Devoir » n’était punie par le législateur et sévèrement jugée par l’opinion publique. Il n’y a de réel, de tangible, de redoutable dans ces expressions : capital, gouvernement, morale, que le principe qui les anime et les fortifie : le principe d’autorité, lequel se traduit par des obligations et des entraves qui mettent les individus et les groupes dans la nécessité de renoncer à faire ce qui leur convient et à subir toutes les contraintes,
Ainsi, les deux épreuves auxquelles nous avons soumis le principe d’autorité se corroborent pleinement. De la première, il découle que toutes les afflictions humaines se rattachent directement à une quelconque des applications sociales du principe d’Autorité. De la seconde, il résulte que, ce principe abandonné, toutes les contraintes disparaissent et, avec elles, la douleur universelle,
J’insiste : je reprends et résume cette démonstration, car elle est d’une importance capitale :
-
Des effets à la cause : l’homme est un composé de besoins extrêmement variés. La compression de ces besoins, voilà la douleur. J’aperçois clairement que la cause immédiate de cette compression — atteignant une partie quelconque de l’individu : ventre, cerveau ou cœur, organes correspondant à l’une quelconque des catégories de besoins : matériels, intellectuels ou moraux — est une quelconque de nos institutions sociales. Or, malgré la complexité de ses organes, l’individu est un. J’en infère que, en dépit de la variété corrélative de ses institutions, le superorganisme social pourrait bien être un également. Je cherche où peut se trouver cette unité et je la découvre dans un principe, un fait, une base : l’Autorité.
-
De la cause aux effets. J’intervertis la marche de mes observations. Je constate que « le principe d’Autorité » comporte des organismes « manifestations », que ceux-ci, causes dérivées, s’affirment par des sous-organismes qui agissent enfin directement sur le patient : l’individu.
Induction d’abord, déduction ensuite : les deux méthodes aboutissent au même résultat concluant, décisif, inattaquable : « Dans le domaine social, l’Autorité est la cause unique de la douleur universelle ! »
Le principe d’Autorité ! Voilà donc le virus qui empoisonne toutes les institutions, tous les rapports humains, toutes les relations sociales !
Voilà, pour employer le langage du jour, le microbe qui engendre toutes les maladies dont agonise l’espèce humaine.
On a pu trouver trop longue cette démonstration et estimer trop touffus les développements qui précèdent. Je ne veux pas m’excuser de ces longueurs : elles m’ont paru nécessaires et, en vérité, je pense qu’elles étaient indispensables. Car, si je suis parvenu à établir que le Principe d’Autorité et ses inéluctables conséquences sont, sur le terrain social, la cause profonde, essentielle, fondamentale, unique des misères, des servitudes, des iniquités, des antagonismes, des vices et des crimes dont souffre le corps social, j’aurai, ipso facto, j’aurai du même coup, j’aurai de plano — j’insiste et me répète de propos délibéré — prouvé irréfutablement que le remède si laborieusement et si passionnément cherché par les philosophes sociologues se trouve dans le principe de Liberté.
Toutes ces choses, je les considère, depuis plus de quarante ans, comme des certitudes indiscutables, et, j’en ai administré la preuve il y a déjà trente-cinq ans dans mon livre : « La Douleur universelle ». Ces certitudes qu’on peut logiquement condenser dans cette formule limpide, résumant admirablement toute la Doctrine anarchiste :
« Le principe d’Autorité, voilà le Mal, Le principe de Liberté, voilà le remède ! »
Les anarchistes tiennent l’Autorité pour la source empoisonnée d’où jaillissent toutes les iniquités sociales et la Liberté pour le seul contrepoison qui soit de nature à purifier l’eau de cette source. Ils sont les ennemis irréductibles de l’Autorité et les amants passionnés de la Liberté : c’est pourquoi ils se proclament libertaires.
Seuls, ils ont la courageuse franchise de s’affirmer libertaires et de se déclarer loyalement pour la liberté contre l’Autorité. Et, cependant, le masque jeté, instinctivement et au fond d’eux-mêmes, tous les hommes sont, sinon théoriquement, du moins pratiquement épris de liberté. Etant donné que, depuis des temps immémoriaux, l’humanité a adopté cette forme sociétaire qui consacre la domination d’une collectivité ou d’une classe, et la servitude de l’autre, il advient que, par la force même des choses, chacun tend à faire partie de la classe dominante, car il semble et il est en réalité plus avantageux et plus agréable de faire partie du groupe des maîtres que de se perdre dans la multitude des esclaves. Cette tendance à diriger, régenter, donner des ordres et gouverner répond en outre à une accoutumance héréditaire qui, se développant, en sens opposé, de génération en génération, a donné infailliblement naissance à deux races d’hommes : celle qui paraît faite pour porter la tête haute et ordonner et celle qui est appelle à courber l’échine et à obéir. L’observateur superficiel s’appuyant sur cette constatation, conclut à la légère que, les uns étant destinés à exercer l’Autorité et les autres à la subir, celle-ci est le principe rationnel et la condition même de l’Ordre dans toute société. Cet observateur se laisse abuser ; il prend l’Effet pour la Cause et il attribue faussement à celle-ci ce qui appartient à celui-là. Sans avoir besoin de recourir à une argumentation subtile qui exigerait de délicats et longs développements, je puis aisément dissiper l’erreur qu’il commet. Ce n’est pas la Nature qui a institué d’office, et par anticipation, en raison de la différence des constitutions et des tempéraments, des maîtres et des esclaves ; c’est la Société. La Nature, elle, à des époques si éloignées de nous que nul encore n’est parvenu à en fixer le commencement, a ajouté un anneau à la chaîne innombrable des espèces animales : cet anneau, c’est l’homme. Je laisse aux spécialistes de cette branche particulière de la Science, le soin et l’honneur de nous enseigner tout ce qu’ils savent de l’existence précaire et misérable de l’animal « homme » en ces temps préhistoriques. Je ne sais, moi-même, sur ces temps obscurs, que ce que peut en savoir toute personne qui s’est quelque peu intéressée à cette partie spéciale des connaissances humaines. Ce que nul ne peut ignorer, c’est que l’homme primitif vécut très probablement dans l’état d’isolement, sans autre guides que l’instinct de conservation et le besoin de reproduction : le premier le poussant à chercher ses moyens d’existence et le second à se procurer l’accouplement indispensable à la satisfaction de ses besoins génésiques. C’est ainsi qu’à la première molécule humaine : l’individu, succéda peu à peu le premier noyau : la famille. Lorsque, beaucoup plus tard vraisemblablement, plusieurs familles se formèrent et se rencontrèrent, il paraît probable qu’elles luttèrent tout d’abord entre elles et que les tués servirent de pâture aux survivants. Mais innombrables étaient, alors, les forces ennemies contre lesquelles nos lointains ancêtres avaient à se défendre et elles étaient de toutes sortes. Les familles furent insensiblement amenées à cesser de se faire la guerre et à se rapprocher, dans le but de se protéger mutuellement et d’être en état de se procurer moins difficilement et plus abondamment ce qui était nécessaire à leur vie. De la réunion de ces familles sortit la tribu. Nomades à l’origine, vivant de la chasse et de la pêche, ces tribus se fixèrent dans la contrée qui, au cours de leurs pérégrinations, leur offraient le plus de ressources et devinrent sédentaires. C’est alors, alors seulement, que ces tribus se multipliant, il est permis de dire que les individus qui les composaient vécurent en société et c’est alors, alors seulement, que l’Autorité fit son apparition dans la personne des chasseurs les plus adroits, des pêcheurs les plus heureux, des vieillards les plus expérimentés et les guerriers les plus redoutables.
Le petit aperçu historique suffit à démontrer que ce n’est pas la Nature qui a engendré l’Autorité, mais la vie sociétaire, et que, conséquemment (la cause devant être nécessairement antérieure à l’effet) c’est à tort que certains prétendent que le principe d’Autorité est le principe primordial et la condition même de l’Ordre dans toute société. La vérité est exactement le contraire de cette assertion. La réalité historique est que, choisis pour la défense et la protection des plus faibles, les plus forts, devenus des Chefs, ne tardèrent pas à devenir des despotes ; qu’ils forgèrent peu à peu des coutumes et des règles ayant pour but de légitimer leur domination et qu’ils s’entourèrent graduellement d’un rempart de sanctions et de violences destinées à réprimer toute tentative de révolte. En sorte que, loin d’être, depuis la formation des sociétés humaines, un facteur d’ordre, un régulateur d’équilibre, d’entente, de justice et d’harmonie, l’Autorité fut, dès le commencement, une cause de désordre et d’iniquité dont les brigandages et les crimes se sont, de siècle en siècle, aggravés et multipliés.
« L’existence de l’Autorité se perd dans la nuit des temps », disent la plupart des historiens. C’est exact. Mais on est en droit d’affirmer avec la même véracité que l’existence de la révolte, remonte à la même époque. Il y a concomitance entre celle-ci et celle-là ; car, du jour ou les chefs s’avisèrent de confisquer l’Autorité à leur profit, l’esprit de révolte prit naissance et la puissance des Maîtres ne parvint jamais à l’étouffer totalement ; à telle enseigne que l’histoire de tous les temps et de tous les peuples, fourmille de gestes d’insoumission, de complots, de conspirations, d’émeutes, d’insurrections, de soulèvements populaires ; elle démontre, éloquemment et jusqu’à l’évidence, que la haine de l’Autorité et l’amour de la Liberté ont jeté dans la conscience humaine des racines si profondes que ni persécutions, ni massacres ne réussirent à les en extirper.
Quand, à l’instar des libertaires, on envisage l’histoire sous cet angle déterminé, on est conduit à constater que le processus humain se déroule, dans le temps et l’espace, sur le plan du conflit incessant entre l’esclavage et l’indépendance, de la bataille permanente livrée par les individus, les nations et les races contre tous les éléments : naturels et sociaux, qui les réduisaient à la servitude et entendaient les y maintenir. Ce processus historique n’est plus, alors, autre chose qu’une épopée gigantesque, un duel à mort dressant tragiquement l’un contre l’autre ces deux principes contradictoires, ces deux forces fatalement opposées : l’Autorité et la Liberté.
Je sais que des esprits généreux, des cœurs pavés — comme l’Enfer — d’excellentes intentions conçoivent l’irréalisable rêve de concilier ces deux forces ennemies, et d’amalgamer dans un dosage savant, ces deux principes irréductiblement contraires. Eh bien ! Supposez deux personnes dans une même salle. L’une veut absolument que la porte soit fermée ; l’autre veut non moins énergiquement que la porte soit ouverte. La discussion menace de s’éterniser et des paroles on va venir aux coups, lorsque s’introduit un troisième personnage qui, doucereusement, ne voulant se mettre à dos personne, ami de la chèvre et protecteur du chou, s’efforce d’amener la conciliation en proposant que la porte soit fermée, tout en restant ouverte, ou qu’elle soit ouverte tout en restant fermée. Le premier, l’autoritaire, veut que la porte soit fermée, c’est-à-dire que l’Autorité règne : le second, l’anarchiste, exige que !a porte soit ouverte, c’est-à-dire que la Liberté soit. Et le troisième, ne voulant ni de l’autorité qui va jusqu’à l’oppression, ni de la liberté qui va jusqu’à la licence, propose un système mixte, un régime qui assurerait la compatibilité dans la pratique de ces deux choses qui, en droit comme en fait, s’excluent absolument. Car l’autorité ne se fractionne pas plus que ne se morcelle la liberté. Elle est toute entière avec ses conséquences, ou elle n’est pas du tout.
Impossible de concevoir une société basée sur l’autorité, sans que la dite autorité ne se manifeste par un système gouvernemental quelconque, lequel système entraîne logiquement une hiérarchie, des fonctionnaires, des assemblées légiférantes et fatalement une police, une magistrature et des prisons. Au sein d’une pareille organisation sociale, les uns ont le pouvoir de commander et les autres le devoir d’obéir. Enclins, les premiers à abuser de leurs pouvoirs, les derniers sont incités à la désobéissance. Et pour étouffer la révolte, deux freins sont nécessairement mis en usage :
-
Les préjugés, soigneusement entretenus par les classe-dirigeants dans le cerveau des masses dirigées ; gouvernement, lois, patrie, famille, suffrage universel, morale, etc., c’est le frein moral ;
-
Magistrats, policiers, gendarmes, soldats, garde-chiourmes, c’est le frein matériel.
Toute autorité qui ne s’appuierait pas sur cette double force, la seconde venant sanctionner la première, n’aurait plus sa raison d’être, puisqu’on pourrait, sans inconvénient comme sans danger, ne s’y pas soumettre. La liberté, elle aussi, est intégrale ou n’existe pas. Elle ne supporte ni lois, ni gouvernements, ni contrainte. Elle ne s’accommode ni de policiers, ni de magistrats, ni de gardiens de prisons. L’homme qui ne fait pas ce qu’il veut, rien que ce qui lui plaît et tout ce qui lui convient, n’est pas libre. Cela ne se discute même pas. En conséquence, on peut affirmer que, en droit comme en fait, il est impossible d’admettre un système bâtard qui tiendrait à la fois du principe d’autorité et du principe de liberté. On peut, à son gré, se prononcer pour l’Autorité contre la Liberté ou pour la Liberté contre l’Autorité ; mais on ne peut être pour l’une et pour l’autre. Il faut opter. Les anarchistes se sont prononcés ; leur choix est fait ; ils sont contre l’Autorité, pour la Liberté. Et ils ne craignent pas d’affirmer que l’Humanité, elle aussi, implicitement tout au moins, s’est prononcée évolutionnellement — en faveur de l’indépendance contre la servitude c’est-à-dire pour la Liberté contre l’Autorité.
On comprend que les premiers échantillons de la race humaine qui parurent sur le globe durent être soumis à toutes sortes de servitudes. A peine sorti de l’animalité, faible et grossière ébauche de l’homme des civilisations avancées, l’être primitif se trouva sous la dépendance absolue de la nature. Exposés aux intempéries, à la fureur et aux caprices des éléments, incapables de s’orienter au travers des inextricables fourrés des régions vierges, arrêtés à tout instant par des cours d’eaux, les montagnes, des ravins, luttant parfois corps à corps avec les animaux féroces, sans autre nourriture que celle qu’ils réussissaient à se procurer par une chasse et une pêche souvent dangereuses et toujours exténuantes, victimes des maladies et des fléaux, nos premiers ancêtres durent connaître toutes les horreurs d’une existence passée à se défendre contre des forces aveugles, irrésistibles, mystérieuses. Terreur perpétuelle, déchirement de la faim, brûlure de la soif, morsure du froid, ignorance complète, tel fut le lot de l’humanité dans l’enfance. Ce qu’on a appelé « l’état de nature », la liberté primitive, fut donc en réalité une épouvantable servitude. Servitude matérielle à l’égard de la nature, servitude intellectuelle à l’égard de la science, l’être tout entier fut dans un état de complet esclavage. Mais peu à peu, avec des lenteurs et des arrêts dont notre siècle de rapidité ne peut se faire une idée précise, les liens se relâchèrent. Avec une opiniâtreté incroyable, l’homme mesura ses forces contre la nature. Enhardi par quelques succès et en possession de quelques outils rudimentaires, le genre humain s’appliqua à utiliser les produits naturels et chercha à en assurer la régulière production. La vie cessa d’être une perpétuelle et douloureuse pérégrination à travers les espaces stériles et encore inexplorés. Des groupements se formèrent, un langage se fonda, des idées s’échangèrent, des relations s’établirent. Le cerveau se dégagea peu à peu des originelles épaisseurs ; il y entra quelques lueurs indécises qui contenaient en puissance les clartés futures. Sans plan préconçu, sans méthode préméditée, par la seule force des choses, par le seul jeu des organes de mieux en mieux exercés, les facultés se développèrent.
Mais pendant que l’homme se soustrayait insensiblement à la tyrannie de la nature, le despotisme de l’homme sur l’homme faisait son apparition. Ce ne fut plus seulement la guerre de l’individu contre les forces coalisées de l’univers ; ce fut encore la lutte des individus entre eux, des collectivités entre elles.
Des populations entières furent condamnées à l’esclavage. Des castes et des classes divisèrent l’humanité, les unes dépouillant et opprimant les autres. La servitude sociale vint s’ajouter aux servitudes antérieures et il serait difficile de dire si les avantages que l’humanité remporta sur le globe et les progrès qu’elle réalisa dans le domaine scientifique compensèrent les inconvénients de ce nouvel état de choses. Je n’ai pas à relater longuement les efforts faits, les conquêtes obtenues, les admirables développements de l’esprit humain. D’autres ont raconté, mieux que je ne saurais le faire et avec une compétence qui me fait défaut, les étonnantes péripéties de cette lutte séculaire de l’homme contre tous les écrasements antiques. Aujourd’hui, les conditions respectives de l’humanité et de la planète sont interverties. Ce n’est plus celle-ci qui domine celle-là, c’est le contraire. Le sol est cultivé, le sous-sol livre ses richesses, les forces naturelles sont utilisées, la plupart des maladies vaincues, les ravages épidémiques atténués, les fléaux en partie conjurés, les éléments domestiqués, la matière asservie, l’homme n’est plus le jouet de l’Univers. Il a posé sur le globe terraqué qu’il peuple un pied vainqueur et s’y est assuré désormais la première et la meilleure place : la servitude matérielle ou pauvreté sociale n’existe donc plus et tous les maux qu’elle faisait naître sont ou peuvent être supprimés.
L’homme n’est plus cet être grossier, craintif et ignorant que le moindre phénomène étonnait. Il ne sait pas tout sans doute, mais il est mille choses qu’il n’ignore plus. Et les connaissances dont son cerveau s’est enrichi sont assez étendues, sûres et variées, pour que non seulement il échappe aux tourments de l’ignorance, mais encore goûte les joies du savoir ; donc, la servitude intellectuelle ou ignorance sociale n’est plus qu’un triste souvenir et les douleurs qu’enfanta l’ignorance ancestrale font désormais partie de l’histoire du passé.
Reste la servitude sociale.
Après la double victoire que je viens de rappeler, sera-t-il dit que l’homme ne voudra pas ou ne saura pas s’affranchir de l’homme ? Et qu’après avoir brisé les chaînes que la nature avait forgées contre lui, il ne pourra pas se débarrasser des entraves artificielles que lui imposa la force ou que consentit son ignorance ? Que de luttes pourtant, que d’héroïsmes, que de sang versé, que d’existences sacrifiées pour ce seul mot « Liberté » ! Tendance instinctive d’abord, aspiration vague par la suite, poussée nette, précise et formidable de nos jours, l’amour de la Liberté a, depuis des siècles, fait battre des milliards de cœurs et armé des milliards de bras. Il semble, tant est grande la force d’expansion et de résistance de cet esprit de liberté, que celui-ci se soit accru de toutes les oppressions et que cette soif d’indépendance ait augmenté chez les asservis dans la même proportion que l’amour de la domination chez les maîtres.
L’histoire — non pas cette comédie dans laquelle monarques, ministres et grands capitaines sont seuls acteurs, mais ce drame d’un intérêt palpitant qui raconte la vie des peuples, les souffrances des déshérités, leurs aspirations et leurs révoltes — l’histoire n’est que l’écran sur lequel se développent les émouvantes péripéties de la lutte millénaire du principe de Liberté contre le principe d’Autorité. Il est dans la nature de l’Autorité de chercher constamment non seulement à conserver les positions acquises, mais encore à en conquérir de nouvelles ; cette tendance n’est pas moins dans la nature de la Liberté et comme le domaine de l’un ne peut s’étendre qu’au détriment de l’autre, l’essence même de ces deux principes diamétralement opposés est, je tiens à le redire, de se livrer un perpétuel combat. Or, toute la vie humaine depuis l’antiquité jusqu’à notre siècle est contenue dans les deux termes que voici : élimination progressive du principe d’autorité, affirmation graduelle et correspondante du principe de liberté. Chaque conquête de celle-ci est une défaite pour celle-là. L’immense cri de : « Liberté ! Liberté ! » retentit à travers les âges. Toutes les révoltes, toutes les revendications, toutes les révolutions ont ce mot d’ordre. Lisez la profession de foi de tous les candidats, parcourez le programme de tous les partis politiques : vous ne trouverez pas un manifeste qui ne revendique plus de liberté, pas un politicien qui ne se réclame de celle-ci. C’est que tout le monde sent et sait que sans liberté, il n’y a pas de bonheur, que, comme le dit L’Hôpital : « Perdre la liberté ! Après elle que reste-t-il à perdre ? La Liberté, c’est la vie ; la servitude, c’est la mort ! » que, suivant la belle parole de Proudhon : « La perfection économique est dans l’indépendance absolue des travailleurs, de même que la perfection politique est dans l’indépendance absolue du citoyen ». Pour être complet, Proudhon aurait dû ajouter que la perfection morale est dans l’indépendance absolue des consciences dégagées de tous préjugés de tous dogmes. Emile de Girardin n’a-t-il pas écrit :
« Dans l’avenir, le progrès sera de rétrécir de plus en plus le cercle des lois positives et, au contraire, d’élargir de plus en plus le cercle des lois naturelles. Toute loi naturelle est un principe qui se vérifie par la justesse de ses conséquences. Toute loi positive est un expédient qui se trahit par ses complications. »
« On n’élève pas les âmes sans les affranchir », dit Guizot dans un accès de franchise. En un langage d’une suave poésie, Marc Guyau prédit le prochain triomphe de la liberté : « Dans l’avenir, l’homme prendra de plus en plus l’horreur des abris construits d’avance et des cages bien closes. Si quelqu’un de nous éprouve le besoin d’un nid où poser son espérance, il le construira lui-même brin par brin, dans la liberté de l’air, le quittant quand il en est las, pour le refaire à chaque printemps, à chaque renouveau de sa pensée ». Guillaume de Greef s’exprime ainsi :
« Le principe, aujourd’hui, n’est plus contestable : la société n’a que des organes et des fonctions ; elle ne doit plus avoir de maîtres. »
« La tendance pratique du matérialisme, dit l’éminent auteur de L’homme selon la science, Louis Büchner, est aussi simple, aussi unitaire, aussi claire et nette que sa théorie ; et tout son programme pour l’avenir de l’homme et de l’humanité, peut s’exprimer en quelques mots contenant tout ce que l’on peut et doit, théoriquement et pratiquement, revendiquer pour et avenir. Les voici : Liberté, instruction et bien-être pour tous ! ». « Ni Dieu, ni Maître ! » a dit Blanqui. Il est étrange de trouver les lignes que voici sous la signature d’un écrivain qui fut député, c’est-à-dire « fabricant de lois » ; mais les politiciens, comme la politique, sont pleins de ces contradictions. « Nulle dépendance, écrit M. Barrès, une vie aisée, l’entière harmonie avec les éléments, avec les autres hommes et avec notre propre rêve ; voilà quel besoin m’agite et le satisfaire c’est toute ma conviction ». Voici enfin comment s’exprime un des savants les plus estimés, M, Letourneau, dans « L’Evolution politique » :
« Au point de vue sociologique, ce qui est particulièrement intéressant dans les républiques des fourmis et des abeilles, c’est le parfait maintien de l’ordre social avec une anarchie complète. Nul gouvernement ; personne n’obéit à personne et cependant tout le monde s’acquitte de ses devoirs civiques avec un zèle infatigable ; l’égoïsme semble inconnu ; il est remplacé par un large amour social. »
Assez de citations. Ce qu’il faut retenir de ces extraits, c’est que, de l’avis d’une foule de penseurs non moins que de la constatation des faits, il ressort que c’est dans le sens de la liberté que l’évolution se produit. C’est là une vérité en quelque sorte banale, tant elle est évidente par elle-même ; car nul ne peut supposer que l’humanité puisse se mouvoir dans le sens de la servitude. Je n’ai insisté sur ce point que pour montrer l’accord existant entre la théorie et les faits, et prouver que, si une étude impartiale et minutieuse de l’organisme social nous conduit à reconnaître que le principe d’autorité est la cause unique de la souffrance qui nous étreint, l’humanité a, depuis longtemps, compris — inconsciemment, souvent même sans qu’il y paraisse — que le mal vient de là, puisque, depuis des milliers d’années, elle cherche à s’affranchir et ne cesse de combattre les esclavages multiformes qui la brisent.
Dans le domaine biologique et cosmique, l’élimination de la servitude ne sera jamais complète ; à ce point de vue, donc, la liberté humaine n’existera jamais à l’état absolu, il s’agit simplement de restreindre à son minimum l’asservissement et de pousser l’émancipation à son maximum.
Mais la domination de l’homme sur l’homme, l’exploitation de l’homme par l’homme, en un mot, l’esclavage social, d’ordre entièrement artificiel et transitoire, peut et doit être entièrement aboli. Pas de bonheur espérable sans cette porte brisée d’abord et s’ouvrant ensuite sur les perspectives heureuses de l’avenir. En dehors de la liberté sociale conquise par l’abolition de l’Autorité sociale, c’est la misère, l’oppression, la contrainte, la douleur, sans qu’il puisse y être porté remède. A ce point de vue, l’élimination complète du principe d’Autorité, d’une part, l’affirmation intégrale du principe de Liberté d’autre part, voilà l’idéal ! Voilà, en même temps, le terme fatal de l’évolution à laquelle nous assistons.
L’esprit d’indépendance n’est plus aujourd’hui une aspiration nuageuse vers un Droit platonique ; il se pénètre de la conviction que l’exercice de la liberté est incompatible avec celui de l’Autorité. Tandis que les assoiffés de pouvoir, les inconscients et les peureux qu’affolent les symptômes du prochain bouleversement social rêvent de remettre à l’Etat la clef de toutes choses, celle des intérêts économiques comme celle des affaires politiques, il se forme, avec une vigueur qui fait présager les succès futurs, une humanité de plus en plus nombreuse, écoutée, résolue et consciente, bien décidée à laisser à l’Etat le moins de clefs possibles et même à le supprimer pour ne point lui en laisser du tout. Ceux que les vicissitudes présentes plongent dans l’admiration du passé ne cessent de répéter que la propriété privée, le gouvernement, la religion, la famille, la patrie, ont rendu à l’humanité les plus grands services ; à les entendre, ce sont ces principes et ces institutions qui firent naître et assurèrent tous les progrès réalisés. Peu importe !
L’observation établit que tout évolue. Propriété, gouvernement, patrie, religion, famille et toutes les institutions qui en découlent ont eu leur heure dans l’histoire. Adaptées aux développements de jadis, elles l’ont été, elles ont dû l’être nécessairement. Est-ce une raison pour qu’elles soient conformes aux développements d’aujourd’hui ? Le vêtement qui habille un enfant ne saurait être porté par un adulte. L’humanité fut cet enfant : elle vagissait intuitivement vers la liberté. Aujourd’hui elle est adulte. Faudrait-il donc qu’elle supportât encore et toujours le maillot et les langes, sous prétexte que ceux-ci lui furent « utiles » autrefois ? Ses chairs sont fermes, ses membres robustes, ses muscles solides ; elle veut marcher seule, aller où bon lui semble, circuler selon sa fantaisie. Elle ne veut plus de maitre, plus de tyran.
Elle commence à se rendre compte que toute société repose et ne peut reposer que sur la Force ou la Raison. Elle a subi la force brutale du guerrier, celle du sorcier, du prêtre et du monarque incarnant la Force mystérieuse de la croyance en la Divinité, celle de la Force anonyme et ondoyante du Nombre représentant la Force aveugle des Majorités ; elle fait présentement la douloureuse expérience de la Force personnifiant la Dictature d’une classe. Le jour approche ou, ayant parcouru tout le cycle, épuisé toutes les formes sociales reposant sur la Force, elle finira par concevoir que c’est sur la Raison, c’est-à-dire sur la Liberté que la Société doit être bâtie pour la félicité de tous et de chacun.
A travers les obstacles et les embûches que les détenteurs de l’Autorité et leurs soutiens — j’allais écrire « souteneurs » — multiplient sous ses pas, elle s’achemine vers la Liberté. Les résistances désespérées qu’on lui oppose ne décourageront pas les libertaires. Ceux que terrorise le pressentiment d’un bouleversement social plus ou moins prochain peuvent redoubler d’acharnement dans les mesures d’étouffement et de répression par lesquelles ils tentent de briser l’élan. Celui-ci est désormais irrésistible. Menaces et persécutions ne parviendront pas à abattre la foi de ceux qui ont — enfin ! — compris que l’Autorité c’est le Mal et que la Liberté, c’est le Bien. Derrière les générations qui montent, c’est l’Autorité vieille et chancelante, avec son escorte de brigandages de détresses matérielles et morales, d’ignorances et de guerres ; devant ces générations, c’est la Liberté resplendissante de jeunesse et de vigueur, avec ses horizons illimités de paix, de savoir, d’abondance, de joie et d’harmonie. C’est l’Anarchie apportant à tous les humains débarrassés à jamais de tous les Dieux et de tous les Maîtres, la possession de ces deux trésors qui les contiennent tous ; le Bien-Etre et la Liberté.
— Sébastien FAURE
LIBERTÉ INDIVIDUELLE
On entend généralement par liberté individuelle « le droit de disposer librement de sa personne et d’obtenir protection ou réparation contre les arrestations illégales, violations de domicile, ou autres atteintes portées à la sûreté dont chaque citoyen doit jouir dans la société » (Larousse). D’après Littré :
« Le droit que chaque citoyen a de n’être privé de la liberté de sa personne que dans les cas prévus et sous les formes déterminées par la loi. »
La liberté individuelle ainsi entendue n’est pas la liberté naturelle définie par Littré :
« Le pouvoir que l’homme a naturellement d’employer ses facultés comme il lui convient. »
Et par Larousse :
« Le droit que l’homme possède par nature d’agir à son gré, et non par une contrainte extérieure. »
Elle est la liberté civile, pouvoir ou droit de « faire tout ce qui n’est pas défendu par les lois ». La jouissance des droits que donne la loi est la limite politique.
Dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, sous la forme où on l’entend généralement et qui fut votée par l’Assemblée Constituante de 1789, la liberté est ainsi définie dans les articles 4 et 5 :
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi l’exercice des droits naturels de chacun n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membresde la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint de faire ce qu’elle n’ordonne pas. »
Bescherelle dit :
« Faire ce qui nous plaît est la liberté naturelle ; sans nuire aux autres est la liberté civile. »
Il est certain que la liberté naturelle de l’individu doit être limitée, dans la vie en société, par la liberté des autres. C’est le principe qui doit régir la liberté civile, celui qui, de tout temps, a été à la base des protestations contre les atteintes à la liberté humaine et des revendications en faveur de la liberté individuelle. Il a sa base morale et sociale dans la maxime de la justice disant :
« Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’il te soit fait. »
Sans ce principe, il n’est pas de société possible, et il n’est pas d’homme doué de raison, fût-il le plus farouchement individualiste, qui puisse le contester. Quand Rabelais disait : « Fais ce que veulx », il s’adressait aux hommes sages de son abbaye de Thélème. La question est dans les limites que la sagesse humaine doit fixer à la liberté, d’elle-même et sans contrainte, pour faire que la liberté de chacun et de tous soit respectée. Est-ce la loi, comme on l’entend généralement, qui pourra fixer ces sages limites ? Nous répondons, sans aucune hésitation : Non.
On dit que les anarchistes sont des « utopistes » parce qu’ils prétendent que la liberté de chacun et de tous ne sera possible que dans une société où il n’y aura plus de lois. Il est encore plus utopique de prétendre faire des lois qui respecteront et feront respecter cette liberté. Le Nouveau Larousse illustré , qu’on ne saurait taxer de tendance anarchiste, dit ceci :
« L’exercice normal de la liberté politique exige trois conditions :
-
il faut que le citoyen ne soit pas contraint de faire autre chose que ce que prescrit la loi ;
-
il faut que la loi soit l’œuvre de la volonté libre des citoyens ;
-
il faut que la loi, toujours modifiable, ne viole jamais la justice. »
Il est aussi difficile de faire des lois remplissant ces conditions que de vivre sans lois. Si les hommes sont capables de faire et d’observer de justes lois qui respecteront leur liberté, ils sont certainement capables de vivre sans lois. Pourquoi, alors, faire des lois, si ce n’est pour restreindre ou leur enlever leur liberté par des moyens plus ou moins brutaux ou hypocrites ? Et les lois n’ont jamais eu d’autres fins.
Examinons les trois conditions réclamées pour « l’exercice normal de la liberté politique ». D’abord, la loi ne doit pas contraindre les citoyens à faire autre chose que ce qu’elle prescrit. C’est la seule condition que la loi remplit ; elle suffit pour démontrer la nocivité de cette loi, car elle sanctionne une liberté arbitraire et immorale, celle de l’adage qui dit :
« Tout ce que la loi ne défend pas est permis. »
Les auteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme n’ont pas vu la contradiction dans laquelle ils se mettaient en disant :
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. »
Et, plus loin :
« Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché. »
C’est précisément par le moyen oblique de ce qu’elle n’empêche pas que la loi autorise les pires attentats à la liberté, en soutenant le régime de l’exploitation humaine et en légitimant toutes les turpitudes sociales. C’est par ce moyen que la loi sanctionne une liberté qui consiste à nuire à autrui plus qu’a ne pas lui nuire. En voici des exemples : La loi ne prescrit pas qu’un travailleur ne gagnera, durant toute sa vie, que des salaires de famine et que, devenu vieux, il sera jeté sur le pavé et réduit à mourir de faim par celui dont il aura fait la fortune ; mais la loi le permet. La loi n’oblige pas les êtres humains à se prostituer, à tomber dans l’alcoolisme, à croupir dans des taudis, à exercer des métiers ignobles ; mais la loi est l’armature d’un état social qui contraint des êtres humains à subir ces misères et elle en protège les bénéficiaires contre les victimes. La loi ne commande pas que la confiance publique sera exploitée par des imposteurs religieux, des filous financiers, des aventuriers politiciens, mais la loi laisse faire ces exploiteurs qui savent habilement se servir d’elle. Ainsi, la liberté de faire tout ce que la loi ne défend pas rend totalement inopérante l’obligation de ne pas nuire à autrui. La loi ne fait pas respecter la liberté de chacun et de tous, elle n’empêche pas de nuire à autrui ; elle sanctionne le droit usurpé par certains de violer la liberté des autres et elle met une rhétorique filandreuse au service de leur violence.
« Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? » dit le loup à l’agneau qu’il voudrait convaincre de son droit de le manger, et à qui il ne manque que la toque de Perrin-Dandin. Aussi, lorsque le Nouveau Larousse ajoute : « Il faut que la loi soit l’œuvre de la volonté libre des citoyens », est-ce une dérision. C’est comme si on disait à un oiseau en cage qu’il a la liberté de s’envoler ; il n’a qu’à ouvrir sa cage ! Il n’y a pas plus de volonté libre pour les citoyens que pour les oiseaux qui se brisent les ailes dans leur prison ; toujours leur volonté est contrainte par les inégalités sociales et l’arbitraire qu’elles produisent. Même dans un pays de plébiscite comme la Suisse, un salarié, entre autres, ne peut exprimer sa volonté que dans la mesure où ses maîtres, le patron, le propriétaire, le curé ou le pasteur veulent bien le lui permettre. Enfin, il est encore plus impossible que « la loi ne viole jamais la justice », puisqu’elle est faite pour sanctionner l’injustice des plus forts qui se sont établis sur les plus faibles et ne consentent à être justes que dans la mesure où ils y trouvent leur intérêt.
Le Nouveau Larousse Illustré nous prouve tout cela lorsqu’il ajoute :
« Les restrictions apportées à la liberté ne peuvent avoir pour cause que l’intérêt social. La difficulté est de savoir où commence et où finit l’intérêt social. On admet en principe la liberté de penser, de parler, d’écrire. En fait, il n’est pas de parti qui ne demande l’interdiction de l’expression publique de certaines doctrines. La raison d’Etat s’oppose à l’exercice normal de la liberté politique. »
Que deviennent alors la volonté libre des citoyens et la justice ? Et la loi protectrice de la liberté, n’est-elle pas une mystification ? Le Nouveau Larousse est ici aussi « anarchiste » que nous en faisant ces constatations, et il donne un nom à la volonté des plus forts qui est à la base de toutes les lois quelles qu’elles soient : la raison d’Etat. C’est la raison de tous les gouvernements sans en excepter aucun, cette raison qui est toujours « la meilleure » comme l’a montré La Fontaine, et dont l’arbitraire est tel qu’elle n’hésite pas, le cas échéant, à violer ses propres lois et à pratiquer l’illégalité lorsque l’intérêt des plus forts est en jeu. L’histoire est pleine des méfaits de la raison d’Etat. Elle a prétendu justifier, au nom de « l’ordre », tous les attentats contre les peuples et contre les individus. C’est elle qui a fait chasser les premiers hommes du paradis terrestre, — la raison d’un Elohim ou Jéhova qui est l’image primitive de tous les usurpateurs -, et c’est elle qui justifie l’illégalité d’un ministre républicain, M. Briand contre les cheminots, en 1910 — ou la mise hors la loi de tout un parti — M. Sarraut contre les communistes en 1928.
Voilà sur quelles bases fausses et arbitraires est établie la liberté civile ou politique dans la société. Ce sont les mêmes qui régissent la liberté individuelle ou liberté de la personne. Cette liberté n’existe pas si l’individu ne peut avoir l’entière disposition de ses facultés, aller et venir comme il lui plait, croire et penser comme il l’entend, exprimer tout ce qu’il pense sans qu’un pion, génial ou imbécile, un dieu ou un gendarme, soit là pour le rappeler à une souveraine orthodoxie.
Homère a dit :
« Le jour qui enlève à l’homme sa liberté lui ôte en même temps la moitié de sa vertu. »
Et Voltaire :
« Pourquoi la liberté est-elle si rare ? Parce qu’elle est le premier des biens. »
Comment les hommes qui exercent la raison d’Etat, et dont la puissance n’est possible que par le maintien des autres hommes dans la dépendance et la démoralisation. Accorderaient-ils à leurs victimes cette liberté qui est le premier des biens et qui fait la vertu ? Ce serait préparer eux-mêmes l’écroulement de leur puissance.
Pendant longtemps le mot liberté fut considéré comme subversif et banni du langage. L’individu n’était pas libre ; il devait obéissance à Dieu, au Roi, au Maître. On s’étonne toujours de voir parmi les sculptures de la cathédrale de Chartres, une statue de la Liberté ! On continue à nier l’esprit libertaire, cet esprit toujours proscrit, qui inspira l’auteur de cette statue, comme on nie le même esprit dans les autres formes naturistes de l’architecture et de la littérature du moyen-âge. La symbolique religieuse s’efforce encore d’expliquer que la Liberté de Chartres, comme les représentations dans les sculptures des cathédrales de nonnes forniquant avec des moines, et les violences des fabliaux contre les prêtres, sont des manifestations de la foi et de l’humilité chrétiennes. Les libertaires ou partisans de la liberté, qu’on appelait jadis libertins, étaient comme aujourd’hui des hérétiques, traités en ennemis de 1’ordre public. Confondus avec les accusés de « crimes d’exception », ils étaient jugés suivant des procédures spéciales qui aboutissaient le plus souvent à leur « assassinat légal ». Contre les criminels d’exception, les juges n’étaient pas obligés « aux communes et ordinaires procédures que le droit ordonne pour les autres ». Il ne s’agissait pas de rechercher s’ils étaient ou non coupables des faits qu’on leur reprochait. Accusation signifiait condamnation ; on sauvait seulement les apparences par un simulacre de procès. C’est par ces procédures exceptionnelles que furent condamnés et exécutés des milliers d’hérétiques mal pensants ou trop remuants.
Aujourd’hui, il n’est pas de mot plus galvaudé que celui de liberté. Il est dans tous les discours des politiciens, « baveux comme pots à moutarde », eût dit Rabelais. Il est dans tous les actes officiels ; il est même peint sur les murs des casernes et des prisons avec ceux d’égalité et de fraternité. Mais l’hypocrisie démocratique qui s’en prévaut ne vaut pas mieux que l’absolutisme théocratique et monarchiste qui le bannissait, ou qui ne voulait la liberté qu’à son usage en l’interdisant aux autres. Si on n’écartèle et si on ne brûle plus publiquement les libertins, on n’en continue pas moins à leur appliquer des procédures spéciales et à les traiter en criminels d’exception. Il se commet aujourd’hui, au nom de la loi « protectrice de la liberté individuelle », autant d’attentats contre cette liberté qu’aux temps où régnait le « bon plaisir » des rois et de leurs satellites.
Abritée derrière les apparences d’une légalité, émanée, dit-on, du « peuple souverain », la raison d’Etat est plus dangereuse qu’au temps du bon plaisir royal. S’il n’y a plus les lettres de cachet, il y a les pouvoirs discrétionnaires des représentants du gouvernement et des magistrats. Dans la 140ème édition du petit Dictionnaire Larousse (1905), on peut lire ceci :
« L’abus des lettres de cachet a été remplacé de nos jours par les longues détentions préventives. »
Ce dictionnaire aurait pu ajouter : « et par les détentions définitives, sans jugement ». La maison Larousse a expurgé les éditions suivantes de cette constatation subversive. Le pouvoir discrétionnaire des agents du gouvernement et des magistrats n’en est pas moins toujours sans limites, car il dépend, non de l’application de la loi, mais de son interprétation qui est laissée à leur conscience!... On va loin avec une telle pratique. On connaît ce que fut, sous l’ancien régime, la conscience des Laubardemont, qui ont rempli la chronique judiciaire de leurs crimes. Sénac de Meilhan a parlé du sadique besoin de voir souffrir et de torturer qui faisait de certains magistrats de véritables monstres. On a vu à l’œuvre, pendant la « Guerre du Droit », les consciences des pourvoyeurs de poteau aussi féroces que lâches et stupides. Aujourd’hui, comme de tout temps, personne n’est sûr, en sortant de chez lui, d’y rentrer le soir et de coucher dans son lit. Personne ne sait si une quelconque raison d’Etat ou particulière — car, lorsqu’on dispose de l’arbitraire, il est facile d’en user pour soi et pour ses amis — ne fera pas qu’il sera arrêté, incarcéré, inculpé et peut-être condamné pour un délit ou un crime imaginaire auquel il ne comprendra rien. Très heureux si quelque exécuteur anonyme ne le raye pas brutalement et définitivement du « cadastre des humains » sans que les gens de justice se préoccupent de sa disparition.
Jadis, dans les procès de sorcellerie, on produisait contre les accusés, comme pièce à conviction, la copie « écrite par la main du démon du pacte fait avec lui et dont la minute était en enfer!... » Si on n’emploie plus ces témoignages écrits par le diable, on se sert d’autres qui ne valent pas mieux, fabriqués par la malveillance policière. On voit de notre temps des gens condamnés parce qu’on a trouvé chez eux, bien qu’ils n’y avaient jamais été, tels documents compromettants, voire des attirails de cambrioleurs ou de faux-monnayeurs. Plus d’un est allé mourir au bagne, condamné comme « anarchiste dangereux », sur des preuves de cette espèce, par douze imbéciles qu’aveuglaient la haine et la peur. En matière politique, le coup du complot, quoique pas mal éventé, est toujours une excellente ressource pour les gouvernants sans scrupules. L’histoire est pleine des récits de ces infamies, et notre époque démocratique n’en est pas exempte. On vit, en 1894, le procès des Trente. Pour discréditer l’anarchisme aux yeux des satisfaits et des timorés, on y inculpa pêle-mêle des théoriciens, philosophes, littérateurs, et des cambrioleurs ou faux-monnayeurs. On va plus loin encore, tant la haine de l’esprit de liberté obture certaines cervelles policières. En 1905, à Paris, une bombe faillit tuer le président Loubet et le roi d’Espagne. Les débats judiciaires établirent que l’attentat avait été l’œuvre des deux polices de France et d’Espagne, qui n’avaient pas craint de mettre ainsi en péril les existences des deux plus hauts personnages de leurs pays pour compromettre les anarchistes qu’elles avaient la scélératesse d’accuser!... Plusieurs histoires de complots ont été mises au compte de la Révolution Russe. On en a déjà vu en France. La plus odieuse de ces affaires est celle du complot bulgare appelé « communiste ». Grâce à de faux documents établis par un nommé Droujilovsky, le gouvernement bulgare réprima sauvagement, en 1925, une prétendue insurrection communiste et fit ainsi des centaines de victimes. Celles qui échappèrent à l’assassinat légal agonisent encore, en 1929, dans les prisons du roi Boris.
La liberté des individus est continuellement menacée par les mouchards, les délateurs, qu’encouragent les autorités et l’indifférence publique. L’Inquisition, inspirée de la loi biblique contre les faux dieux, faisait une obligation aux parents de dénoncer leurs enfants et aux enfants de dénoncer leurs parents. Le pape Grégoire IX se réjouissait de ces dénonciations combien « chrétiennes ». Sous le règne de Louis XIV où la tartuferie s’installa dans les mœurs avec les « belles manières » et le « beau langage », les jésuites organisèrent officiellement le mouchardage et la délation à la Cour et dans les familles. La Société de Jésus et l’Intendant de police avaient leurs espions, souvent les mêmes, dans la domesticité de toutes les maisons. Il y avait toujours des « voyeurs » dans les appartements du roi comme chez les plus simples bourgeois. Cet espionnage n’a pas cessé : au contraire. La délation a poussé comme une fleur vénéneuse sur le fumier de la guerre. Elle a sévi terriblement, loin du front comme parmi les combattants, contre le voisin de palier, le camarade d’atelier ou de bureau, et même contre le compagnon de tranchée, chacun voulant sauver sa peau et livrant, pour cela, celle des autres. Dans les honteux procès du temps de guerre que des magistrats, pour justifier leur utilité loin du front, ont faits par une interprétation malveillante et odieuse de la loi du 2 août 1914 contre les indiscrétions de la presse, on a poursuivi et condamné : « non pas des journalistes pour des délits de presse, non pas des orateurs pour des délits de réunion, mais de simples citoyens et surtout de malheureuses femmes qui s’étaient rendues coupables de dire devant des amis, des voisins, des fournisseurs, des domestiques, ce qu’ils pensaient » (La Vérité, 1er février 1918). Pendant la Commune, il y eut plus de 200.000 dénonciations ; combien y en eut-il de 1914 à 1918 ? Chaque guerre, en agitant la boue qui est au fond des âmes, apporte aux lèvres de la foule le goût de la délation avec celui du sang. La délation devient une vertu civique, une élégance littéraire, pour contribuer à cette « régénération » que M. P. Bourget attribue à la guerre. De tout temps, elle sévit administrativement par le « cabinet noir ». Le téléphone a permis d’y ajouter les « tables d’écoute ». Pour les mouchards officiels et officieux, l’article 187 du Code pénal qui protège, en principe, le secret des correspondances, n’existe pas ; la raison d’État et les procédures exceptionnelles le rendent inopérant. Sous Napoléon Ier, le cabinet noir coûtait 600.000 francs par an. On saura ce qu’il aura coûté de notre temps si on publie, un jour, les détails des « fonds secrets » qui en paient les mystérieux offices.
Les délateurs sont, dans les affaires criminelles, les auxiliaires les plus précieux des magistrats qui ne cherchent qu’à condamner. On les emploie pour toutes sortes de provocations, pour de faux témoignages. Lors du procès Bougrat, à Aix-en-Provence, des repris de justice, vulgaires « moutons », étaient traités par les juges, comme des collaborateurs avec une déférence complice, tandis qu’on bousculait sans aucune politesse des savants qui apportaient la vérité et montraient les mensonges de l’accusation. (Cahiers des Droits de l’Homme, 15 juin 1927). Le temps n’est peut-être pas loin où la délation sera une obligation légale et où tout réfractaire à cette immonde besogne sera puni pour « complicité morale », comme au temps de l’inquisition. Notons, en passant, que la délation fleurit surtout dans les moments d’impuissance révolutionnaire. Quand on n’est pas capable de défendre ses droits et sa liberté d’individu, on est facilement prêt à trahir ceux des autres.
Le pouvoir discrétionnaire des magistrats, la faculté qui leur est laissée d’appliquer la loi selon « leur conscience », permettent les abus les plus révoltants. La loi est comme l’Evangile qui a deux morales ; elle a deux justices, pour permettre aux « consciences » de choisir. Ainsi, les prescriptions du Code d’instruction criminelle sont formelles en matières d’arrestation et de détention dans ses articles 91 à 97 et 113 à 116, complétés par une loi du 8 décembre 1897 et précisés par des circulaires comme celle du 20 février 1900. Leur violation est punie par les articles 112, 114, l19 et 120 du Code pénal. Mais à côté, dans le même Code d’instruction criminelle, les articles 10, 49, 50, fournissent les moyens de violer les précédents en toute tranquillité, et la loi du 30 juin 1838 est là pour, le cas échéant, donner tous les apaisements aux « consciences » les plus « timorées ». Les articles du Code qui punissent les violations de la liberté individuelle et, en particulier, l’article 114 du Code pénal contre les « attentats » à cette liberté, restent à l’état de lettre morte. Non seulement les forfaiteurs peuvent procéder impunément, mais ils retirent souvent, comme récompense de leur forfaiture, des faveurs qu’attendent vainement les « timorés » dont la conscience s’encombre de scrupules. On a vu ainsi les bourreaux du capitaine Dreyfus demeurer dans leurs situations officielles, avec tous leurs profits, à côté de ses défenseurs. On comprend comment il est si difficile d’obtenir la réparation des erreurs judiciaires les plus manifestes et des violations de la loi les plus scandaleuses. Les « consciences » qui président à l’administration de la justice s’efforcent d’empêcher ou de retarder ces réparations par tous les moyens. Leur rêve : c’est de faire proclamer « l’irrévocabilité de la chose jugée ! » (H. Guernut, L’Œuvre, 30 octobre 1927). Ils voudraient nous ramener ainsi au temps de l’infaillibilité théocratique. Dieu ne peut pas se tromper ; les imposteurs qui parlent en son nom sont par conséquent infaillibles. La Loi est souveraine ; ceux qui l’appliquent partagent donc cette souveraineté et n’ont de comptes à rendre à personne. C’est simple et commode. Bon plaisir et forfaiture tiennent ainsi la justice en échec au temps des Droits de l’Homme comme au temps du droit divin ; ils la manipulent à leur gré et sont assurés de l’impunité. Quelles sont les garanties de la liberté individuelle dans de pareilles conditions ?
Non seulement en cas de flagrant délit, mais sous le prétexte d’une dénonciation quelconque, des auxiliaires de police peuvent arrêter quelqu’un, perquisitionner et saisir ce qui leur plait chez lui, l’incarcérer, l’interroger ou le tenir au secret, entendre des témoins, tout cela en dehors de toutes les garanties de justice prévues par les articles 93, 97 et 113 du Code d’instruction criminelle. Plus de juge d’instruction et d’avocat. Le subalterne qui a fait l’arrestation remplace le juge. S’il s’est trompé en arrêtant, il cherchera peut-être, pour réparer son erreur, à obtenir des aveux. Tous les moyens sont bons, même la torture, dans ces « chambres des aveux spontanés » où le « coupable » est seul, sans défense devant des policiers qui « veulent l’avoir »... Par le moyen de la loi du 30 juin 1838, l’incarcération peut devenir une détention temporaire ou définitive dans un asile d’aliénés, ce, sans instruction judiciaire, sans jugement, sur les seuls rapports de médecins complices. Des gens importants et bien placés dans la hiérarchie sociale peuvent ainsi se débarrasser sans bruit de qui les gêne : maîtresse compromettante, enfant illégitime, tuteur sans complaisance, parent riche trop long à mourir, ouvrier ou employé dont on veut se venger, pauvre bougre dont la tête ne « revient pas » à un puissant, conjoint sans compatibilité d’humeur, locataire qu’on ne peut expulser légalement, etc... : (Affaires Verlain, Haworth, Lemoine, Chateaubriand, Larcher, Boutet, Mayrargue, Daltour, d’Orcel, et cent autres). Malgré l’article 114 du C. P., il n’y a aucune réparation pour ces victimes. Heureuses sont-elles quand elles peuvent sortir vivantes des in-pace où les avait plongées le bon plaisir de leurs bourreaux. On voit que la suppression des lettres de cachet n’a rien supprimé du tout.
Tous les jours, des policiers, procèdent à des violations de domicile, à des perquisitions irrégulières, sans mandats de justice. Malgré l’article 113 du C. d’I. C. on incarcère préventivement, pendant des semaines et des mois, sons les prétextes les plus futiles, des gens ayant un foyer, des répondants honorables, alors que la détention préventive ne doit pas dépasser cinq jours lorsque le prévenu n’est passible que de la correctionnelle et d’une peine inférieure à deux ans de prison. On voit des choses comme ceci :
Le 1er septembre 1926, le tribunal de Marseille condamnait seulement à 16 francs d’amende, avec sursis, tant le délit était léger, sinon inexistant, une marchande qui avait vendu dans la rue et sans autorisation, quelques légumes. Cette femme avait préalablement subi 83 jours de prison préventive. Non seulement elle ne reçut aucun dédommagement du préjudice matériel et moral qu’elle avait souffert, mais encore, on lui réclama la somme de 174 francs pour frais de justice ! (Cahiers des Droits de l’Homme, 20 avril 1928).
On voit aussi des Procureurs de la République imposer à des prévenus qu’aucune condamnation n’a encore frappés, et qui sont mis en liberté provisoire, une interdiction de séjour prévue uniquement contre des condamnés récidivistes (Affaire du professeur Platon). Dans cette affaire du professeur Platon, que la Ligue des D. de l’Ho. s’occupe de faire réviser, on a pu voir toutes les irrégularités, toutes les illégalités, tous les abus de pouvoir de la magistrature. Les condamnations ont été prononcées « par ordre » venues de politiciens puissants et de diffamateurs qui se trouvaient même dans le personnel du Ministère de la Justice. Tous les magistrats qui ont été mêlés à cette affaire, et devraient connaître les rigueurs de l’article 114 du C. P., ont eu de beaux avancements et ont été décorés de la Légion d’honneur, ainsi que des journalistes stipendiés, sans parler des profits récoltés par des politiciens, médecins et autres « honnêtes gens » pour qui cette affaire a été une véritable curée (Cahiers et brochures de la Ligue des Droits de l’Homme).
Des raisons politiques, des intérêts particuliers, interviennent à tout propos dans l’administration de la justice pour supprimer toute liberté aux uns, pour l’accorder jusqu’à la licence aux autres. On étouffe certaines affaires, on fait une publicité scandaleuse à d’autres. On ménage les gens en place, les favorisés de la fortune. Leurs turpitudes trouvent toutes les indulgences, toutes les complicités ; mais on sévit lourdement contre les petits. Il en est comme sous Louis XIV :
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. »
(LA FONTAINE)
Pendant que des indigents subissent la « contrainte par corps » parce qu’ils ne peuvent pas payer le montant d’une amende, des gens riches échappent même à la prison à laquelle ils ont été condamnés.
« M. Bourdon cite l’exemple d’un riche automobiliste condamné à huit mois de prison pour homicide par imprudence, qui a été libéré au bout de quinze jours » (Cahiers des Droits de l’Homme, 10 janvier 1927.)
« Vous punissez celui qui est pauvre », disait Jules Favre aux législateurs impériaux de 1867. Ceux, républicains, de 1928 continuent.
A tous les abus contre la liberté individuelle s’ajoute la publicité qui déshonore les individus et les livre à la malignité publique avant toute preuve de culpabilité contre eux. La presse descend, dans cette besogne, au-dessous des policiers. L’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 dit ceci : « Il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d’une amende de 50 francs à 1.000 francs ». La loi veut que l’instruction judiciaire soit secrète, renfermée dans le cabinet du juge instructeur. Ce secret n’est respecté que suivant la qualité de l’inculpé. Les magistrats sont « discrets comme des tombeaux », si discrets même que les affaires sont définitivement enterrées sans qu’on en parle jamais lorsqu’il s’agit de hauts personnages. Mais le plus souvent leur instruction se fait sur la place publique, surtout lorsque les passions sont soulevées et que des politiciens puissants, qui seront utiles à leur avancement, ont des intérêts dans l’affaire. L’inculpé, mis dans l’impossibilité de répondre publiquement, est à la merci des indiscrétions tendancieuses du juge d’instruction. Elles alimentent les romans-feuilletons des journalistes qui étalent, grossissent, défigurent les faits afin d’exciter la curiosité perverse et l’animosité de la foule. Un homme arrêté est ainsi jugé d’avance, condamné avant tout verdict. Même innocent, il restera l’homme qui a été en prison, dont tout le monde aura eu le droit de s’occuper pour fouiller dans sa vie, le salir, le déshonorer. Parfois il perd son travail et la possibilité d’en retrouver ; il est un suspect, car, dit-on, « il n’y a pas de fumée sans feu » ; il a sa fiche à l’anthropométrie et la police continue de le traquer chez ses employeurs. Elle traque même les membres de sa famille à qui elle fait perdre leur emploi (Affaire Rabaté, juin 1926).
Ainsi, plus la société avance dans les formes dites « démocratiques » qui ont des apparences généreuses et étalent une vertu grandiloquente, plus elle rétrograde vers la barbarie et l’inhumanité par une sorte de cruauté et d’insensibilité collectives. De plus en plus les arrestations et les détentions s’accompagnent de mauvais traitements. Les violences du « passage à tabac » et des « chambres des aveux spontanés » sont courantes, admises par la veulerie publique comme par la « conscience » des magistrats. Un d’eux, M. Séb. Ch. Leconte, écrivait dans La Victoire du 20 juin 1923 :
« Le passage à tabac est une nécessité de nos mœurs, destiné à suppléer à l’insuffisance répressive de nos lois et à l’indulgence de « tribunaux ». Par ces moyens de torture, on oblige, comme au temps de l’Inquisition, des malheureux à se reconnaître coupables de crimes qu’ils n’ont pas commis (affaire Rémy et nombre d’autres). On ne proteste plus contre ces infamies, même lorsqu’on a été personnellement « bosselé » par les matraques policières, parfois estropié. »
M. Gustave Hervé, qui publie aujourd’hui les déclarations de M. Séb. Ch. Leconte, a oublié entre tant de choses l’affaire Liabeuf. On ne réagit pas davantage contre les diffamations du journalisme. On est demeuré tout aussi indifférent quand on a rétabli dans les prisons l’usage de la cagoule pour la promenade en commun des prisonniers. On admet parfaitement que des tortionnaires, parmi lesquels des médecins, ne craignent pas de se mêler, alimentent de force des prisonniers faisant la grève de la faim pour protester contre les abus dont ils souffrent. Il faut des événements particulièrement graves, des mutineries, des révoltes, pour que l’opinion publique porte attention aux mauvais traitements infligés à des prisonniers. Mais l’émotion est vite éteinte. La foule populaire, châtrée de tout raisonnement par la « blagologie » politicienne, de toute énergie par les saignées de la guerre, paraît avoir perdu jusqu’au sentiment des souffrances de sa propre chair, torturée dans ses enfants livrés à l’enfer des maisons de correction, des prisons centrales, de la Guyane et de « Biribi ». Il semble que tout besoin de justice et de liberté soit épuisé pour elle lorsque, de temps en temps, un « bourgeois » subit, tout à fait exceptionnellement, le sort qui est invariablement le sien. Elle ne se dit pas qu’il ne faudrait d’injustice pour personne ; elle ne comprend pas que pour un « bourgeois » frappé injustement, mille des siens le seront davantage dans leur liberté et dans leur vie.
Le 15 septembre 1927, après avoir adressé au Ministre de la Justice un rapport lui signalant un nouvel attentat à la liberté individuelle, le Secrétaire général de la Ligue des D. de l’Ho. faisait les commentaires suivants :
« Douze fois par an, au moins, la Ligue des Droits de l’Homme conte au ministre de la justice des anecdotes semblables. Et il y a vingt-sept ans que la Ligue existe ! Il faut croire que les ministres successifs de la Justice trouvent ça drôle ou amusant puisque ça continue. Le 16 décembre 1804, M. Clemenceau avait déposé à la Chambre un projet de loi qui avait pour effet de prévenir de tels accidents, de punir les coupables, d’indemniser les victimes. Devenu ministre, il l’a oublié... » (Cahiers des Droits de l’H., 10 novembre 1927.)
Tous les ministres l’ont oublié ensuite comme oublient tous les politiciens sans vergogne, malgré les promesses faites à leurs électeurs. La question de la liberté individuelle, si imparfaitement réglée qu’elle aurait été par le projet de loi Clemenceau, demeure toujours en suspens. Devant la passivité du « peuple souverain » qui résigne le premier des droits de l’homme et du citoyen : la liberté, on est tenté de penser parfois que ce peuple, plus assez ignorant pour ne pas comprendre, mais trop lâche pour agir, n’a que « la liberté et les gouvernants qu’il mérite », comme disent ceux qui l’exploitent, le fouaillent et le méprisent.
On peut donc dire que socialement, légalement, en dehors de toutes considérations métaphysiques sur le libre-arbitre et le déterminisme, la liberté individuelle n’existe pas, et cela, non seulement comme liberté de la personne, dans l’exercice de ses facultés physiques et de ses mouvements, mais aussi dans la liberté de sa conscience et de ses opinions. Car toutes les libertés se tiennent entre elles ; on ne peut attenter à l’une sans atteindre les autres, on ne peut en posséder une sans les posséder toutes, et c’est ce que nous allons voir dans leurs diverses formes.
1. Liberté de l’enfant.
Elle est à la base de la liberté individuelle. Un enfant emprisonné ne pourra faire un homme libre, pas plus qu’un avorton ne fera un géant. Confucius disait déjà, six siècles avant l’ère chrétienne :
« Dès qu’un enfant est né, il faut respecter ses facultés. »
Depuis Confucius, tous les pédagogues qui n’ont pas été des abrutisseurs ont tenu le même langage et se sont efforcés de l’appliquer ; mais son principe est resté lettre morte. Un autre plus puissant, celui de l’autorité et de la violence contre les facultés de l’enfant, n’a pas cessé d’intervenir pour les plier à l’acceptation des préjugés sociaux, au respect des mensonges conventionnels, à une obéissance passive (Voir Instruction populaire). Si les facultés de l’enfant résistent au « dressage » qui le soumettra au patronat, à la servitude militaire, à la loi des « majorités compactes », à l’adoration des idoles, des ventres solaires politiciens et des bondieuseries religieuses ou laïques, si elles protestent et veulent demeurer libres : interviennent alors les pensums et les corrections promis aux « mauvaises têtes ». Le pater familias, antique barbe descendue du droit romain, se dresse d’abord. S’il n’a plus le droit de vie et de mort sur l’enfant, il lui reste celui de l’abrutir selon son caprice et cela, en requérant même contre l’indiscipliné les rigueurs de la loi. En cas d’absence ou de déchéance paternelle, la loi intervient automatiquement. Elle prétend protéger l’enfant et elle a fait pour lui ses textes du 23 décembre 1874 concernant le premier âge et les nourrissons, du 24 juillet 1889 et du 15 novembre 1921 sur les enfants maltraités ou moralement abandonnés ; du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des filles mineurs dans l’industrie ; du 11 avril 1908 relatifs à la prostitution des mineurs ; du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée, etc... Malgré tant de mesures protectrices, l’enfant insoumis est abandonné à des patronages ou à des maisons de correction d’où il sort trop souvent contaminé de toutes les façons, physiquement et moralement, religieusement ou laïquement, préparé à toutes les déchéances ou prêt à la révolte furieuse et inutile de fauves lâchés dans la jungle sociale. C’est ainsi qu’on a respecté ses facultés et procédé à ce qu’on appelle son « relèvement moral »!... On a souvent dépeint le sort des enfants livrés aux maisons de correction. « Tous, ou presque tous, terminent leur existence à la Guyane », a déclaré un directeur de ces maisons, ajoutant : « Si quelque génie du mal avait cherché la formule d’un bouillon de culture pour le microbe du vice et de la criminalité, il n’aurait pu trouver mieux que la maison de correction » (Louis Roubaud : Les enfants de Caïn). On comprend qu’il faut tant de gendarmes, de magistrats, de garde-chiourmes, pour faire respecter la liberté selon la loi.
A la question de la liberté de l’enfant se rattache celle de la liberté de l’enseignement. On voit, par ce qui précède, qu’elle ne peut être que la liberté d’abrutir l’enfance suivant les dogmes laïques ou religieux qui dominent socialement.
2. Liberté du travail
L’enfant, ainsi préparé à toutes les servitudes et devenu adolescent, est invité à se mettre au travail pour « gagner sa vie ». Les économistes ont longuement écrit sur la liberté du travail proclamée par la Révolution Française. La loi des 2 et 17 mars 1791 a été établie, disent-ils, pour « laisser à tout homme le choix de son travail », et des ministres, tel M. Herriot, viennent dire aux enfants, lors des distributions de prix :
« Choisissez bien votre métier, on ne fait bien que ce que l’on aime .... »
Quelle est la liberté de ce choix pour le jeune homme qui n’a pas eu la possibilité de développer ses facultés et a été pris, dès sa venue au monde, dans l’engrenage du déterminisme social ? Même s’il est capable de faire un choix, n’est-il pas empêché de le suivre dans la plupart des cas par la nécessité d’apporter sa quote-part au foyer familial où il a été jusque là une charge, et qui l’oblige à accepter, non à choisir, n’importe quel métier, pourvu qu’il soit lucratif ? Il n’est donc pas libre de choisir son métier, et il n’est pas davantage libre de discuter les conditions de son travail avec celui qui l’emploiera ; il doit subir celles de l’employeur.
Certes, le travailleur n’est plus l’esclave antique, le serf féodal ; il est libre de refuser les conditions d’un patron, mais qu’est cette liberté si elle ne lui laisse d’autre ressource que de ne pas trouver du travail et de mourir de faim ? Les économistes disent excellemment :
« La liberté du travail est le seul moyen de donner à la puissance de l’homme le maximum qu’elle peut atteindre ; elle détermine les goûts et les aptitudes, développe l’esprit d’invention, suscite l’initiative, assure l’énergie et la persévérance. Elle est le principe de la propriété qui permet à l’homme de jouir et de disposer des fruits de son travail et qui, en sollicitant les volontés, active et augmente la puissance productrice. Sans la liberté et la propriété qui sont unies d’une façon indissoluble, le travail perd ses principales forces, et la société s’immobilise dans l’inertie et dans la misère. » (Georges Bry : Les lois du travail industriel et de la Prévoyance sociale.)
Le point noir, c’est que ces beaux principes sont contredits par les faits suivants : la propriété est constituée non par le travail, mais par l’exploitation de celui des autres, et la propriété est l’ennemie de la liberté du travail. Aussi est-ce bien vainement qu’on a fait toute une législation du travail, sauf pour réglementer son esclavage. On a créé un Code spécial du Travail, des comités, des conseils supérieurs, des ministères du Travail dans chaque pays, et un Office International du Travail. On a tenu des Congrès du Travail, particulièrement à Washington, en 1919. Tout cela ne fait que mieux ressortir cette constatation qui est inscrite dans le Traité de Versailles du 28 juin 1919 :
« ...Attendu qu’il existe des conditions de travail impliquant, pour un grand nombre de personnes, l’injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l’harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu’il est urgent d’améliorer ces conditions... »
Telle est la situation reconnue et décrite par les basochiens officiels. Que devient la liberté du travail avec cela ? Aussi, est-ce en vain que les gouvernements, même avec le « collaborationnisme » — formule barbare d’une entreprise vaine — des patrons et des travailleurs, s’efforcent d’étayer par des lois un édifice qui s’écroule. L’organisme est vicié dans son propre sang par l’exécrable exploitation humaine qui est à la base de l’organisation du travail. Tant qu’il y aura salariat, il n’y aura pas liberté du travail. Il ne peut y avoir liberté quand il y a contrainte sous la menace de la faim et, dans cet état d’esclavage où la dignité du travailleur est méprisée, où l’effort de ses facultés est déprécié, le travail porte une souillure qui ne peut qu’en donner le dégoût à celui qui l’accomplit.
La loi reconnait pour les ouvriers comme pour les patrons le droit de coalition et le droit de grève. Mais qu’arrive-t-il quand les ouvriers usent de ce dernier ? Les conditions matérielles de la lutte sont d’une telle inégalité entre les deux parties que les ouvriers, réduits par la famine, sont bientôt obligés de se rendre. S’ils résistent trop longtemps, s’ils manifestent leur rancœur, leur besoin et leur volonté de justice, ils trouvent devant eux les fusils des « chiens de garde du Capital ». — « Vivre en travaillant, mourir en combattant ! » criaient dans leur désespoir les canuts loqueteux de l’insurrection lyonnaise en 1831. On n’est pas sûr de vivre en travaillant, on est plus sûr de mourir en combattant. A défaut de pain, il y a du plomb qui est distribué au nom de « l’ordre », et on ne regarde pas aux victimes. Les premières que firent les fusilleurs d’ouvriers de la IIIème République, à Fourmies, le 1er mai 1891, furent des femmes et des enfants dont une fillette de huit mois ! En 1867, le premier usage du chassepot avait été fait à Mentana par l’armée française au service du pape contre les républicains italiens. En 1891, ce furent des ouvriers en grève que tuèrent les premières balles Lebel. Depuis, on a fabriqué spécialement des « balles de grève » pour tirer sur les travailleurs (Pierre Hamp : Un nouvel honneur).
La tendance, depuis la Grande Guerre qui a fait une consommation si effroyable de matériel humain, est de transformer de plus en plus les travailleurs en fonctionnaires, en automates, dans des cadres interchangeables où ils ne sont plus que des boulons, des manivelles. Ils y trouveront peut-être plus de sécurité économique, cette sécurité trompeuse qui fait 1’égoïsme et crée l’inertie syndicaliste des corporations privilégiées, mais que deviendront dans tout cela la liberté du travail, le goût, les aptitudes, l’esprit d’invention, l’initiative, etc... ? On voit que les travailleurs ont encore de longues luttes à soutenir s’ils veulent connaitre la liberté du travail inscrite si fallacieusement dans la loi. Elle ne sera possible que lorsqu’ils auront supprimé le salariat par leur action révolutionnaire.
3. Liberté de la femme
Sauf dans les circonstances plutôt rares d’organisations sociales basées sur le matriarcat, la femme a toujours été sous la dépendance de l’homme. Considérée comme inférieure, elle a dû subir un tuteur. Aujourd’hui encore, le mariage tel qu’il existe et dont, dans son ignorance, elle croit avoir besoin pour sa défense, n’est toujours qu’une forme de cette dépendance. Le christianisme, qui prétend avoir libéré la femme, a fait peser sur elle la plus terrible malédiction. En adoptant le mythe païen de Pandore, qui fait porter à la femme la responsabilité des maux de l’humanité, il a encore exagéré, comme toujours, en matière d’imposture et de barbarie. Le Dieu de la Bible a dit à la femme :
« Tu enfanteras dans la douleur. Tes désirs se tourneront vers l’homme et il dominera sur toi. »
Même lorsque ses désirs ne sont pas tournés vers l’homme, elle est toujours dominée par lui, et la société laïque d’aujourd’hui continue contre elle l’injustice des sociétés religieuses. En France, les « droits de l’homme » ne sont toujours pas ceux de la femme. Politiquement, elle n’existe pas. Si intelligente soit-elle, elle n’a pas ce droit de vote que possèdent les pires abrutis masculins. Civilement, socialement, elle n’existe que pour faire des enfants et supporter les plus lourdes charges de la famille, ou pour servir de bête à plaisir, d’animal de luxe. Même lorsqu’elle arrive par la séduction qu’elle exerce à dominer l’homme et à prendre alors sur lui des revanches terribles, elle n’en est pas moins réduite à une honteuse quoique insolente prostitution.
Jésus et ses compagnons recevaient volontiers les faveurs des femmes ; les apôtres encore davantage et, depuis, les ecclésiastiques ont toujours trouvé auprès d’elles les principales ressources de leur parasitisme (Voir Simonie). L’Eglise n’en a pas moins la haine foncière de la femme. Jésus n’avait aucune considération pour sa mère. Le culte de la Vierge ne s’est formé que de la tradition populaire du culte de Vénus. Les prêtres cherchaient vainement à l’extirper et ils furent obligés de l’adopter ; ils en firent alors l’idolâtrie de l’Immaculée Conception ! Pour Tertullien, la femme était « la porte du diable ». Il voulait qu’elle fût voilée dans les assemblées. Jean Chrysostome l’appelait : « Souveraine peste, dard aigu du démon ». Jean de Damas voyait en elle une « méchante bourrique ... Un affreux tamia qui a son siège dans le cœur de l’homme..., une sentinelle avancée de l’enfer ». On n’en finirait plus d’énumérer ces aménités ecclésiastiques. Aujourd’hui encore, l’Eglise humilie la femme par la cérémonie des relevailles où elle fait amende honorable de sa maternité comme d’une chose honteuse!... La société civile, même laïque, n’est pas dégagée de ces sottises. Hypocritement, elle n’accorde sa considération à la maternité que dans le mariage !
La femme ne possède donc pas la liberté conventionnelle de l’être humain dans l’état social, et elle subit la forme la plus révoltante et la plus lâche de la loi de l’homme par l’esclavage de sa chair. La formule : « ton corps est à toi », qu’a répandue un roman de Victor Margueritte, est toujours considérée comme révolutionnaire. Le corps de la femme n’est pas à elle. Il est à l’homme qu’elle a « épousé » par ignorance, par préjugé, pour être une « femme honnête », et à qui la loi donne le droit de lui imposer le « devoir conjugal » malgré la répugnance qu’elle peut en avoir. Il est à la brute qui abuse d’elle dans un moment de faiblesse sentimentale, d’émoi de ses sens, et s’en va ensuite sans souci des conséquences de son acte. Il est à la société qui en exige la reproduction de l’espèce, à l’Etat qui lui réclame la multiplication des citoyens sans lui offrir les garanties d’une maternité de son choix. Si, menacée par la misère, affolée par l’idée du « déshonneur », ou simplement soucieuse de sa santé et pour ne pas porter seule le poids d’une « faute » commise à deux, elle supprime son enfant par un avortement ou un infanticide, la loi intervient pour la punir sévèrement avec ceux qui l’ont aidée de leurs conseils ou de leurs actes (Article 317 du Code pénal et loi du 31 juillet 1920). Le séducteur, l’homme, n’est pas inquiété et peut continuer, selon son caprice, son rôle de fécondateur des femmes en émoi. La loi humaine s’abaisse ainsi au-dessous de la loi naturelle, car il est bien peu de ces espèces animales auxquelles l’homme prétend être si supérieur, chez qui le mâle ne partage pas avec la femelle la charge des enfants et s’en libère aussi cyniquement.
Quand la femme est devenue une « fille », une « putain » cataloguée et plus ou moins tarifée, son corps appartient alors à la débauche des « honnêtes gens », des « bons bourgeois », qui vont « jeter leur gourme » avant le mariage et se distraire, après, du « pot au feu conjugal » dans les maisons infâmes où ces malheureuses sont parquées. On est effaré lorsqu’on lit dans certains journaux les chroniques scandaleuses qui racontent les ébats extraconjugaux de tant de dignitaires de « l’élite sociale », hauts personnages gouvernants, financiers, magistrats, militaires, gens du monde et d’église, tous professeurs de vertu, marchands de morale, champions des bonnes mœurs, pères et fils de « respectables » familles, et qui ne sont que de vieux et jeunes saligauds renouvelant l’immondice des lupanars où se vautrèrent Sodome, Babylone et Rome. Et ce sont ces gens-là qui font des lois pour la défense de la moralité publique!...
La prostitution est la tare la plus honteuse de la société, la forme la plus crapuleuse de l’exploitation humaine, et c’est la plus hypocrite, parce qu’on feint de l’ignorer. L’Etat, qui a une conception spéciale de la pudeur, refuse à la prostitution une existence légale ; mais il veille attentivement sur elle pour en percevoir la dîme. Il est comme ces papes qui condamnaient la débauche au nom de la religion, mais qui tenaient des lupanars où des femmes « travaillaient » pour eux et pour les cardinaux. L’Etat s’occupe de pourvoir les villes de garnison de « maisons de tolérance ». Avec l’estaminet et le marchand de tabac qu’il ravitaille, il procure ainsi au militaire les trois éléments de joie chantés dans le Châlet :
qui achèvent de l’abrutir quand les exercices guerriers n’y suffisent pas. Dans sa sollicitude toute spéciale, l’Etat entretient ainsi, nationalement, des générations d’alcooliques, de syphilitiques et de fous. En 1912, un ministre ne disait-il pas aux marchands d’alcool :
« Vous êtes le rempart de la dignité et de la prospérité nationales... »
Il eût pu en dire autant à Mme Tellier et à M. Philibert. Actuellement, l’Etat retire plus de deux milliards par an de la vente du tabac et ses ministres disent à ceux qui le débitent :
« Vous êtes à la fois des collaborateurs dévoués de l’Etat et les excellents serviteurs du public. » (M. Herriot, 21 octobre 1928)
Une dame Zwiller a dit des prostituées :
« Ce ne sont pas des femmes comme les autres ; les prostituées sont des femmes d’une catégorie tout à fait inférieure, tout à fait en bas de l’humanité. Elles ne sont pas bonnes à autre chose ; la prostitution, c’est leur vocation naturelle. Elles sont très utiles, et si elles n’existaient pas, il faudrait les inventer. » (Cité par les Cahiers des Droits de l’Homme, 20 mai 1928.)
Heureuse cette dame qu’une situation privilégiée met sans doute à l’abri d’une telle « vocation » ! Mais si c’est là l’opinion des gouvernants, qu’ils le disent nettement et que la turpitude ne soit pas masquée de tartuferie. Pendant que la prostitution d’en haut trouve toutes les complaisances et participe aux élégances du régime, celle d’en bas est traquée avec la dernière rigueur. La loi, ne voulant pas connaître les prostituées, les abandonne à tous les abus de la « police des mœurs ». Sans autres motifs que des caprices policiers, sans avoir commis aucun délit prévu par le Code, elles sont arrêtées, incarcérées pour un temps plus ou moins long. La « mise en carte » en fait des esclaves à la merci des trafiquants, policiers et autres, qui les traitent comme une marchandise. Ces « reines du trottoir » n’ont pas la liberté de la circulation, même lorsqu’elles ne se livrent pas à leur métier. Elles sont sous la surveillance constante de la police et n’ont aucune des garanties de la liberté individuelle, même au sens de l’article 114 du Code Pénal.
Ce n’est pas seulement lorsque la femme a commis une « faute » qu’elle est livrée par l’hypocrisie sociale à la prostitution. La faim et l’ignorance sont les grandes pourvoyeuses du trottoir et des maisons de tolérance. Les trafiquants guettent comme des oiseaux de proie la femme jeune, jolie et pauvre. Les professions sont très rares dans lesquelles elle peut gagner sa vie et s’assurer une indépendance économique lui laissant la liberté de son corps. Dans presque tous les métiers son travail est insuffisamment payé. L’infamie capitaliste exploite sa situation. La jeune fille devra avoir un « ami », chercher « un vieux », pour parfaire l’insuffisance de son salaire, quand ils ne se présentent pas sous les traits d’un patron ou d’un contremaitre qui la priveront de travail si elle ne leur cède pas. Même la femme mariée devra recourir à de tels moyens si son mari n’apporte pas dans le ménage tout l’argent nécessaire. Il est peu de grands magasins où les directeurs, les chefs de service, graves personnages, pères de famille bien pensants décorés, ne disent aux femmes qu’ils emploient :
« Nous vous payons peu, mais vous êtes gentilles et vous pouvez vous faire des ressources au dehors ! »
Il n’y a guère que des emplois de fonctionnaires qui procurent l’indépendance économique à la femme sans fortune pour s’établir dans le commerce ou dans une profession libérale. Elle peut y être relativement libre et tranquille ; encore faut-il qu’elle ne soit pas sous la coupe de chefs qui lui jetteront le mouchoir.
Au théâtre, pendant longtemps, il fut impossible à la femme d’éviter la prostitution. Sous l’ancien régime, un engagement à l’Opéra était un « passeport de mauvaise vie et de mœurs ». Aujourd’hui, sauf dans les cas très rares où elle s’impose par un talent vraiment supérieur, une actrice est à peu près certaine de ne pas réussir, même dans les théâtres les plus subventionnés, si elle n’a pas de « commanditaires » financiers ou des « protecteurs » parmi des politiciens à qui les directeurs de théâtre ne peuvent rien refuser. La femme de théâtre est en outre la proie de tous les satyres du journalisme et d’autres entreprises de publicité qui exigent d’être payés « sur la pièce » et se livrant pour cela, sous le couvert de la critique théâtrale, aux plus sales chantages. Le « beuglant » fut longtemps le concert dans la maison de tolérance. Il l’est encore parfois, en province, malgré les énergiques interventions des syndicats du personnel des théâtres. La chanteuse n’était pas payée ; après avoir chanté, elle faisait la quête dans les rangs du public et complétait son gain en faisant des « passes ». Les contrats les plus immoraux lui étaient imposés par des marchands de chair humaine appelés « agents lyriques » et la police des mœurs était là pour faire respecter ces contrats. Aujourd’hui, malgré toutes les apparences de liberté, la femme de théâtre échappe encore difficilement à une prostitution qui est sa plus grande chance de réussite et en est le moyen le plus à sa portée. Il en est de même dans toutes les professions féminines, et il en sera ainsi tant que la femme n’aura pas obtenu dans la société toutes les garanties de liberté individuelle qui doivent être celles de tous.
4. Liberté de conscience et liberté d’opinion
La liberté de conscience n’est que la liberté d’opinion considérée en matière religieuse.
Dans une brochure intitulée : La liberté d’opinion, par E. Boudeville, cette liberté a été remarquablement définie et étudiée. Elle n’est pas seulement le droit d’avoir une idée et un sentiment personnels sur toute chose, elle est en outre et essentiellement :
« Le droit d’exprimer, d’expliquer, de commenter, de répandre publiquement, soit par la parole, soit par des écrits, ses opinions, ses conceptions, ses doctrines, et d’en proposer, à une fraction de la collectivité ou à la collectivité tout entière, l’application ou l’usage. »
L’esprit, qui ne connait aucune limite, aucune barrière à ses investigations, doit pouvoir s’exprimer avec la même liberté. Cette liberté est la première des conditions du progrès social. Ce progrès est impossible dans une société qui ne pratique pas, pour la manifestation des idées, la tolérance la plus absolue, la « liberté sans rivages », comme disait Jules Vallès.
On comprend l’intolérance et l’interdiction de la pensée dans les sociétés théocratiques et monarchiques. Aux hommes ignorants et méchants, Dieu a donné des guides éclairés et bons par qui ils doivent se laisser conduire. Ces guides, les prêtres, les princes, les chefs, pensent pour eux. Ils n’ont pas à penser par eux-mêmes, il leur est même interdit de penser pour ne pas risquer de tomber dans l’hérésie et la révolte. Ils n’ont plus qu’à croire et obéir.
Par contre, l’intolérance et l’interdiction de la pensée sont absolument incompatibles avec une société républicaine. La République, qui doit être le gouvernement du peuple tout entier, du « peuple souverain », n’est possible qu’avec le concours des lumières de tous. C’est non seulement un droit, c’est un devoir impérieux pour chaque citoyen d’exposer ses idées et ses conceptions, de formuler ses critiques, si vives soient-elles, pour que tous puissent les examiner, les discuter et, le cas échéant s’y rallier dans l’intérêt commun. Comme dit Boudeville :
« L’expérience collective ne peut se constituer, et la raison collective s’exercer, sans la liberté intégrale d’opinion. »
Ceci admis, et nous ne voyons pas qu’on puisse le discuter, comment peut-on appeler : République, un État où cette liberté intégrale d’opinion n’existe pas ? Cette étiquette ne couvre alors qu’une caricature de république déguisant un régime théocratique ou monarchique plus ou moins odieux selon la gravité des abus cachés sous ses vocables pompeux mais vides.
Il n’est rien de tel, pour juger l’imposture d’un régime usurpant la qualité républicaine, que de voir l’étiage de la liberté qu’il laisse à l’opinion. Dans aucun cette liberté n’existe, parce qu’ils sont tous dominés par un gouvernement plus ou moins théocratique ou monarchique qui règne par la loi, c’est-à-dire la violence organisée, au nom d’une fallacieuse souveraineté du peuple (Voir plus haut). Tout comme le gouvernement d’un Moïse ou d’un Napoléon, ces gouvernements dits républicains ne peuvent tolérer sans danger pour eux-mêmes et pour les privilégiés dont ils représentent les intérêts, l’expression d’une pensée autre que la leur et susceptible d’inciter le peuple à vouloir une vraie république. La liberté d’opinion, qui serait le fondement et la sauvegarde de cette république, est considérée comme une calamité dans les républiques à l’envers, tout comme si elles avaient à leur tête ces dictateurs et ces papes qui jetaient l’anathème contre toute pensée n’émanant pas de leur « infaillibilité ». De l’aveu même de leurs bourreaux, Sacco et Vanzetti n’ont été exécutés, en Amérique, que parce qu’ils étaient anarchistes !
On a fait, contre la liberté d’opinion, les lois les plus antirépublicaines qui puissent être, les « lois scélérates » des 12 et 18 décembre 1893, 28 juillet 1894 et 31 juillet 1920, qui permettent les persécutions les plus sournoises et les condamnations les plus étendues. Lancé dans cette voie, on ne manquera pas d’en faire d’autres encore si on en voit le besoin, comme on a fait celle de 1920 vingt-six ans après les trois autres, lois de circonstances qui devaient être abrogées quelque temps après et qui sont de plus en plus férocement appliquées. Grâce à ces « lois scélérates », les garanties essentielles que donnait à l’expression de la pensée la loi sur la presse du 29 juillet 1881, sont sans effet. Ces lois permettent de faire poursuivre pour « propagande anarchiste » l’auteur de n’importe quel discours ou article de journal devant un tribunal correctionnel. « Donnez-moi deux lignes de l’écriture d’un homme, et je le ferai pendre », disent encore certains magistrats ; on leur a donné les « lois scélérates » et ils étranglent la pensée. La loi de 1881 renvoyait les crimes ou délits d’opinion devant la cour d’assises ; mais le jury ne condamnait pas assez au gré des gouvernants qui en étaient trop souvent pour le ridicule de leurs poursuites. En correctionnelle, c’est plus sûr, les condamnations tombent automatiquement et si, par hasard, un tribunal se refuse à cette besogne servile, les juges d’appel ou de cassation l’accomplissent à sa place pout que force, sinon prestige, reste au pouvoir. D’une déclaration faite le 10 janvier 1927, à la Chambre des Députés, par M. Barthou, il résulte que, du 1er janvier 1925 au 31 juillet 1926, les « lois scélérates » ont servi à faire prononcer 535 condamnations ! La presse appelée « républicaine », honteusement domestiquée, ne proteste pas. Elle approuve même, quand elle ne les réclame pas, les condamnations de plus en plus lourdes qui s’abattent sur telle ou telle catégorie de personnes, sur tel ou tel parti politique. Il faudrait avoir la vie de Mathusalem pour payer le nombre d’années de prison accumulées sur la tête de certains. Les larbins de presse s’amusent de ces « records » ; ils les atteindront peut-être eux-mêmes, un jour, pour des chantages ou des escroqueries, mais certainement pas pour la défense d’une liberté qu’ignore leur servilité. Les condamnations sont prononcées en série. Les juges ne s’occupent pas du cas particulier de chacun. Il suffit que le dossier porte cette étiquette : « propagande anarchiste ». L’étiquette s’applique à toute opinion ou toute activité dite subversive : libertaire, communiste, syndicaliste, antimilitariste, antireligieuse, néo-malthusienne, etc... Tous ceux qui ne sont accusés sont des malfaiteurs avérés ; s’ils discutent, ils ne font que se compromettre davantage. Le ministre Constans disait :
« Les anarchistes sont ceux qui m’em... ! »
C’est ainsi que les « lois scélérates » sont employées contre tous ceux qui « em... » le gouvernement.
Cette répression ne suffit pas ; elle est aggravée par tous les moyens. Le « régime politique », dans les prisons, la « libération conditionnelle », ont de moins en moins de règles. Ils dépendent des caprices des maîtres du jour. On met au régime politique des condamnés de droit commun : escrocs, diffamateurs, tripoteurs d’affaires, voleurs de Bourse, qui sont bien en cour. On refuse le régime aux condamnés pour délits d’opinion dont la fierté de caractère et de principes demeure hostile à l’immoralité dirigeante. Dans les « Santé » républicaines, remplaçant les « Bastille » royales, la haute pègre des inculpés et condamnés de droit commun coule des jours agréablement sustentés et arrosés de Pommard thermidor et de Haut-Brion, en attendant un non-lieu, prélude du ruban rouge, ou une évasion rocambolesque. Mais des condamnés politiques, qui ne sont que de « vagues humanités » pensantes et révoltées, subissent toutes les rigueurs du droit commun, Un Gaonach, instituteur condamné pour ses opinions, y subit sa peine jour pour jour. La libération conditionnelle d’usage lui fut refusée sous prétexte que ses amis avaient « manqué de déférence » à l’égard d’un ministre!... Gourmelon, phtisique arrivé au dernier degré d’épuisement, mais anarchiste impénitent, est mort après deux mois et demi de prison préventive pour un crime dont il était innocent!... On applique non moins arbitrairement la « contrainte par corps », aggravant ainsi des condamnations déjà excessives. On expulse sans aucune enquête, de la même façon qu’on interne abusivement les étrangers suspects. La même fantaisie préside à des extraditions pouvant coûter la vie à leurs victimes. Pour plaire à des gouvernements voisins, satisfaire des rancunes particulières, on ignore ou on viole ce « droit d’asile » que respectèrent jadis les pires tyrans.
Mais on va plus loin encore. En violation formelle des « lois scélérates » elles-mêmes, et ne les trouvant sans doute pas assez liberticides, on saisit et on confisque les publications suspectes. La loi n’admet que la saisie partielle, pour établir qu’il y a eu délit et motif de poursuite. Par la saisie préventive et totale, hypocrite application du principe : « il vaut mieux prévenir que guérir », on supprime le délit, on arrête la poursuite et on enlève à l’opinion toute possibilité de se répandre. C’est l’étranglement sans phrase de la pensée, la suppression pure et simple de la liberté d’opinion. On ne faisait pas mieux sous Napoléon Ier, qui se vantait de ne pas faire de procès de presse!... (Voir Presse). On arrête et on condamne non seulement des vendeurs de journaux interdits, mais aussi de journaux qui ne sont l’objet d’aucune poursuite ! On condamne des gérants pour des articles dont les auteurs n’ont jamais été poursuivis. Suivant la direction que le vent donne aux girouettes politiciennes, certains vieux articles ministériels de M. Briand, par exemple, valent la prison à qui les reproduit. Les mêmes procédés d’interdiction et de répression sont employés contre la liberté de réunion. Les pouvoirs des préfets et des maires leur permettent d’inter n’importe quelle réunion, sous prétexte d’évite des troubles. On arrête même préventivement des manifestants « présumés », (1.500 personnes à Ivry, le 5 août 1928, 1.200 autres à Vincennes, en octobre 1928. Manifestants de Dreil (Alpes-Maritimes), le 30 octobre 1928. Féministes à Paris le 6 novembre 1928. Communistes dans toute la France le 1er août 1929, etc...). On voit ainsi, de plus en plus oppressive, la manifestation de la haine bourgeoise contre la liberté d’opinion, haine qui se traduisit pendant tout le XIXème siècle par des procès de presse comme par des fusillades et qui se concrétisait dans cette formule cynique : « Silence aux pauvres ! » — « Il faut frapper à la caisse ! » déclare aujourd’hui la valetaille gorgée de sportule qui ose se dire républicaine et parler au nom de la liberté, comme la valetaille théocratique et monarchique parlait au nom de Dieu et du Roi. Tous les jours des saisies préventives et de lourdes condamnations pécuniaires ruinent de petits journaux, et des militants qui n’ont que leur cœur et leurs bras à donner à leur cause sont emprisonnés et condamnés à des amendes excessives. M. Painlevé, ministre de la guerre, a donné la formule devant la Chambre des Députés, et un avocat général à la cour de Poitiers l’a exprimée ainsi dans un réquisitoire : « L’homme que vous avez à juger n’est rien. Mais il appartient à une organisation disciplinée. C’est elle qu’il faut atteindre, et vous ne pourrez la frapper qu’en condamnant ses membres à de fortes amendes qu’elle paiera ». Quand une organisation ne paie pas, on use de la contrainte par corps contre les membres condamnés. Cette contrainte s’exerce même en faveur des particuliers, qui acceptent de faire les frais de l’emprisonnement de leurs adversaires, cela en conformité de la loi du 22 juillet 1867. On a vu, au mois d’octobre 1928, appliquer la contrainte par corps à Martin, gérant du journal Le Flambeau, à la demande de l’évêque de Séez. On a remarqué à cette occasion qu’au temps de Saint Louis, roi de France, une ordonnance interdisait l’emprisonnement pour dettes autres que celles envers le roi. Il a fallu une loi de l’Empire, demeurée en vigueur dans la république laïque, pour permettre à l’épiscope de Séez de satisfaire contre Martin la vengeance qu’un saint, qu’il fait métier de vénérer, lui aurait refusée il y a 700 ans...
« Frappez à la caisse ! » rugissent, rageurs et baveux, les valets de plume banqueroutiers de la liberté et de l’honneur d’une presse dont ils ont fait un dépotoir. Pour ces vendus, l’expression d’une opinion indépendante est intolérable, comme pour les gouvernants. S’il est des circonstances atténuantes pour les criminels plus endurcis, il n’en est pas pour ceux qui demeurent rebelles à l’orthodoxie officielle. L’Etat, même républicain et laïque, continue les traditions de l’Eglise qui « canoniserait Cartouche dévot », comme disait Voltaire mais qui a voué Socrate à une damnation éternelle.
Il y a toujours une pensée subversive ; il y en aura toujours une, tant que la vraie liberté, la « liberté sans rivages », n’existera pas. Et il est parfois aussi dangereux de penser et de s’exprimer librement en matière de science et d’art qu’en politique. Le savant et l’artiste qui ne se soumettent pas à l’orthodoxie sont suspects à l’opinion moutonnière. Elle les fait condamner, à la première occasion, sous des prétextes plus ou moins hypocrites. Un Oscar Wilde en a été la victime ; « il fut traqué hors de la vie parce que ses péchés ne furent pas ceux de la classe moyenne anglaise » (Frank Harris). Ferrer a été fusillé, en Espagne, à l’instigation des jésuites excités contre ses idées pédagogiques. L’Amérique, soumise à la Bible, n’autorise pas l’enseignement des théories de Darwin, et même en France, un professeur a fait l’expérience que Darwin est indésirable dans les collèges. (Affaire du professeur Rietz, à Tourcoing). Selon les circonstances, on interdit dans les lycées certaines lectures, comme celle de la Vision de Babouc, de Voltaire. On n’y admet que des livres soigneusement expurgés. Victor Hugo lui-même y est châtré de son : Déshonorons la guerre, par des eunuques imbéciles qui font du patriotisme avec la peau des autres. Le mensonge patriotique est défendu par des gens qui prétendent représenter l’honneur parce qu’ils le portent à leur boutonnière, et qui excluent de leur rang un Demartial pour s’être permis de dire la vérité sur les responsabilités de la guerre. (Voir Europe, 15 juin 1928). On avait déjà vu la « Légion d’honneur » prendre la défense du faux patriotique contre la vérité que révélait Zola, lors de l’affaire Dreyfus. Au temps de Molière, siffler était un droit qu’au théâtre on payait en entrant. Aujourd’hui, on encourt d’abord un « passage à tabac » des policiers, puis une condamnation à quatre mois de prison sans sursis (Affaire Roux, 10e Chambre correctionnelle de Paris, 4 janvier 1928). Au théâtre, comme partout, le « cochon de payant » doit se taire. Dans toutes les formes de la vie sociale, ainsi que l’a constaté Séverine, « le citoyen doit rester sourd, aveugle et par dessus tout muet ».
C’est ainsi que les caricatures de républiques ressemblent aux démocraties des César et des Octave où la « liberté sans rivages » était remplacée par ce que Naudet a appelé « la hiérarchie de la servitude ».
A la liberté d’opinion se rattache la liberté de la presse (Voir le mot Presse).
5. Liberté des fonctionnaires
Cette liberté n’est pas menacée seulement pour les femmes, par des chefs ou des politiciens jouant aux pachas ; elle est livrée pour tous, hommes ou femmes, aux avatars de la politique. Parfois, on dit aux fonctionnaires :
« Votre devoir est de vous mêler à la vie politique du pays. » (Jules Ferry, 1881)
Ou bien :
« Le fonctionnaire peut user du droit qui appartient à tous les autres citoyens de signer une affiche, un article, de prendre la parole dans une réunion publique. » (Barthou, 1909)
D’autres fois, on leur conteste ces devoirs et ce droit ; on les poursuit, on les condamne et on les révoque s’ils passent outre. Ils sont en somme les jouets de la versatilité gouvernementale.
En principe, le fonctionnaire est un citoyen libre comme les autres. En fait, il ne possède de liberté que dans la mesure où l’Etat, qui est son employeur, veut bien la lui laisser, c’est-à-dire moins qu’aux autres. On lui reconnaît, ou on ne lui reconnaît pas, les droits des travailleurs ordinaires de se syndiquer, de penser ce qu’il veut et d’exprimer son opinion. Il est à la fois Dieu, table, cuvette... et moins encore. On lui dit :
« Un fonctionnaire n’a pas le droit de critiquer le gouvernement qui le paie... »
On oublie d’ajouter :
« ...au dessous d’un certain chiffre d’appointements. »
Car, les gens que le gouvernement paie le plus cher sont ceux qui peuvent le critiquer le plus impunément. Cela paraîtrait paradoxal dans une société bien équilibrée ; c’est un phénomène normal dans « l’ordre » où nous vivons. Le degré de liberté d’un fonctionnaire est déterminé par la place qu’il occupe dans la hiérarchie administrative et par la nature de ses opinions. Un haut diplomate, un grand chef dans un ministère, un professeur de Sorbonne, un général, un amiral, peuvent vitupérer le régime qui les fait vivre grassement. Un commis, un cantonnier, un instituteur, un soldat, un matelot, doivent se taire s’ils ne pensent pas comme leurs chefs, surtout s’ils sont des républicains sincères et pas seulement des budgétivores. Sous le régime dit de « l’Ordre moral », que les républicains flétrissent avec indignation, les fonctionnaires servaient d’agents électoraux pour le succès des candidatures officielles. Aujourd’hui, ils ne reçoivent plus des « ordres » ; le procédé est plus insinuatif, mais il n’est pas moins arbitraire. Dans l’arrondissement, la petite ville, le village, il est dangereux pour les fonctionnaires d’avoir des opinions personnelles et de se tenir en dehors des querelles de la sous-préfecture, de la mairie, du château, de l’église, de l’usine, qui règnent sur la vie économique et sur les consciences de la région. Chacune de ces puissances a son candidat en temps d’élection ; chacune prétend mobiliser le fonctionnaire pour sa cause. Des prodiges d’équilibrisme ne le mettent pas toujours à l’abri des représailles. Suivant qu’il aura été favorable à tel ou tel, ou, ce qui est pire, s’il est resté neutre, il recevra de l’avancement, des faveurs, ou sera envoyé en disgrâce, croupira dans des postes déshérités et sera même brutalement révoqué sur la demande d’un tyranneau triomphant. Jadis, dans leurs domaines, les aristocrates couraient le vilain en même temps que le cerf. Aujourd’hui les grands propriétaires, hobereaux, financiers, politiciens, chassent le fonctionnaire en même temps que le lapin dans la garenne républicaine.
Les fonctionnaires sont à la merci des notes secrètes que des chefs malveillants introduisent dans leurs dossiers. Ce qui compte sur ces fiches, qui font tant crier lorsqu’elles concernent l’aristocratie prétorienne, mais contre lesquelles personne ne proteste lorsqu’elles visent des citoyens obscurs, ce ne sont pas les qualités professionnelles ; ce sont les opinions. « Bon service apparent » veut dire : service bien fait mais caractère indépendant. La pire des notes administratives est : « trop intelligent ». Voilà le plus dangereux des certificats. Celui qui en est l’objet fait trop bien son service pour le public ; il le fait mal pour l’administration qu’il critique sans complaisance, dont il dénonce l’incurie en raillant l’imbécillité galonnée et en refusant de se laisser domestiquer par elle. Ce fonctionnaire-là n’a qu’une chose à faire : quitter une administration où il s’est fourvoyé comme un écureuil dans un trou de taupe. Nous avons eu l’occasion de voir, dans le dossier d’un de ces milliers de procès dits « défaitistes » du temps de guerre, un rapport secret émanant d’une grande direction de province des P. T. T. Ce rapport était d’une telle bassesse policière que le Procureur de la République, écœuré, refusa de s’en servir dans son réquisitoire. On a cité dernièrement, dans l’Œuvre (29 janvier 1929), le cas d’un ancien gendarme condamné à un an de prison en vertu des « lois scélérates » parce qu’il osait réclamer une pension pour infirmité contractée en service!...
En somme, les fonctionnaires paient chèrement, aux dépens de leur liberté, le bien-être et la sécurité relatifs que leur procurent leurs fonctions. Leur situation est celle du chien de la fable :
Portant bâtons, et mendiants ;
Flatter ceux du logis, à son maître complaire ;
Moyennant quoi votre salaire
Sera force reliefs de toutes les façons,
Os de poulets, os de pigeons,
Sans parler de mainte caresse.
Et sans parler de ce collier qui fait fuir le loup, même affamé.
Dans la brochure d’E. Boudeville sur la Liberté d’opinion, la situation des fonctionnaires est particulièrement étudiée.
6. Liberté des indigènes coloniaux
Depuis plusieurs années, de très nombreuses plaintes ont jeté des lueurs dans le brouillard épais du régime des peuples conquis aux colonies.
Méprisés comme appartenant à des races inférieures, ils furent pendant longtemps regardés comme un vil bétail et soumis à toutes les servitudes et les déchéances de l’esclavage. A la clarté des idées du XVIIIème siècle, on commença à voir en eux des hommes comme les autres. La Révolution française répandit en leur faveur des idées plus fraternelles, et durant le XIXème siècle, on arriva peu à peu à supprimer officiellement l’esclavage dans presque tous les pays coloniaux. Il subsiste encore dans certaines possessions comme les Indes anglaises. On apprend de temps en temps qu’un gouverneur de province rend la liberté à des esclaves. 3.350 furent ainsi libérés dans le gouvernement de Durma, en 1926, et ce fut un « vilain cadeau » pour eux, de l’avis de L’Œuvre, journal républicain (7 mai 1926). En 1927, 215.000 esclaves de Sierra-Leone ont recouvré leur liberté.
En principe, il est généralement admis que les indigènes, comme tous les hommes, doivent jouir des Droits de l’Homme. En fait, il n’en est rien. Ils restent des esclaves qu’on exploite et qu’on tue au nom de la liberté républicaine comme on les exploitait et les tuait au nom de cette « heureuse disposition de la Providence » qui les livrait au fouet des négriers. Henri Rochefort a raconté dans son roman : L’Evadé, comment se faisait le trafic des indigènes en Océanie, il y a un demi-siècle, et comment « la civilisation moderne a imprimé à la récolte et à l’écoulement de ce produit (l’indigène) son cachet ordinaire d’hypocrisie prudente ». Cinquante ans après Rochefort, un anglais, auteur des Lettres des Iles Paradis, a fait les mêmes constatations. Aujourd’hui, après la « Guerre du Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » — style officiel -, on lit dans des journaux que cet odieux trafic se continue toujours. Trafic qui se fait dans toutes les colonies, sous des formes plus ou moins déguisées, et dont les échos sont de plus en plus nombreux, en même temps que se manifeste une indignation plus véhémente contre l’hypocrisie de bourreaux démocrates aussi odieux que ceux de droit divin.
Les Anglais, qui sont si jaloux de leur liberté individuelle et si fiers d’avoir, les premiers, introduit dans la législation « civilisée », leur bill d’habeas corpus, sont les moins respectueux de la liberté des indigènes et donnent aux autres « colonisateurs » l’exemple de la plus féroce exploitation de ces malheureux vaincus. Leurs colons de la Rhodésie méridionale ont fait voter par leur parlement, en 1926, une véritable loi esclavagiste autorisant l’emploi d’enfants des deux sexes, sans limite d’âge, dans les mines et dans l’agriculture, et permettant contre ces enfants la flagellation, sans jugement, pour refus d’obéissance ou négligence. Aux Indes et dans les possessions européennes en Chine, femmes et enfants sont exploités dans les mines et les usines. 33 millions de femmes travaillent aux Indes pour des profits britanniques et dans des conditions telles que souvent, lors de la paie, ce sont elles qui doivent de l’argent à leurs employeurs!... La pudique Albion entretient à Bombay une demi-prison, gardée par sa police, ou 900 femmes indigènes sont parquées pour servir au plaisir des blancs (Lansbury Labour Weelky, juin 1926). Comme conséquence de l’exploitation féminine, les mères, obligées de laisser leurs enfants pour aller travailler, leur font prendre de l’opium pour qu’ils dorment en leur absence. 98 p. 100 des enfants sont ainsi empoisonnés. 666 sur mille meurent avant l’âge d’un an. La plupart de ceux qui survivent sont employés, dès l’âge de six ou sept ans, dans les mines, les usines, les plantations, pendant dix heures par jour. A Shanghai, dans les usines textiles anglaises et françaises, des enfants de cinq ans travaillent sans arrêt pendant douze heures par jour!...
L’administration de la justice est en rapport avec cette exploitation humaine. Les colonies ont des tribunaux et des législations spéciales. Le principe est que l’indigène a toujours tort devant le blanc. Magistrats, comme tous autres fonctionnaires, disposent, on peut dire à leur gré, de la liberté et de la vie de l’indigène ; on ne lui doit aucune explication. Voici un exemple caractéristique entre mille. En 1927, à Alger, au centre de la colonie française la plus « civilisée », une petite Mauresque, nommée Ourdia, a été enlevée à sa mère par un médecin français. Malgré ses plaintes en justice, la mère n’a pu se faire rendre sa fille et le ravisseur, demeuré impuni, a gardé sa proie (Brochure du Comité de Défense de l’Enfance d’Algérie).
L’indigène n’est pas plus maître de ses biens que de sa personne. Tous les jours il est exproprié par les concessions qui sont accordées à des privilégiés parmi les vainqueurs. S’il n’est pas chassé, il est exploité dans le travail qu’il fournit sur sa propre terre au profit de ses usurpateurs. La liberté d’opinion est livrée au même arbitraire. Des journaux indigènes sont interdits par simple décision administrative. Le fait de former un syndicat de travailleurs spoliés de leurs biens, d’avoir ure opinion politique, d’écrire dans un journal, de tenir une réunion publique et de prononcer un discours rend passible d’inculpation de « complot contre la sûreté intérieure de l’Etat » et d’internement administratif dans la colonie ou dans une autre plus ou moins éloignée. Les indigènes ne sont d’ailleurs pas électeurs. Ils sont citoyens pour être soldats, recrutés malgré eux pour défendre la « mère patrie », payer des impôts plus élevés que ceux des conquérants qui exploitent leur travail ; mais ils ne le sont pas pour voter et manifester leurs desiderata. Ainsi se continuent sous les apparences du libéralisme verbal créé par une Déclaration des Droits de l’Homme qui n’est pas appliquée, les crimes et les abus qui furent de tout temps ceux de la colonisation. Aussi, les conséquences demeurent les mêmes : travail surhumain, abrutissement des individus, maladie, mortalité, épuisement et extinction des peuples indigènes. Dans toutes les colonies, la civilisation arrive un jour à ne plus régner que sur les ossements blanchis de races disparues. Le drapeau de la liberté flotte victorieusement sur le domaine de la mort.
7. Liberté des aliénés
Lorsqu’on pense que la loi du 30 juin 1838 sur le régime des aliénés sert aussi à attenter à la liberté des gens considérés comme sains d’esprit, comment pourrait-on demander que la liberté des aliénés fût respectée ?
Dans l’antiquité, en Egypte par exemple, et aujourd’hui encore chez certains peuples, les mahométans en particulier, la folie à l’état calme était généralement regardée comme « une maladie sacrée, don mystérieux de la divinité, et plus digne de respect et d’égards que de répugnance » (J. Duval). Les fous vivaient libres parmi les populations. On ne prenait certaines précautions contre eux que s’ils se montraient furieux, et c’est ce qu’on voit encore chez les musulmans, en Turquie, en Algérie, au Maroc. Les chrétiens, qui prétendent avoir apporté au monde l’amour du prochain, virent en eux des possédés du démon ; ils les enfermèrent, les isolèrent, les enchainèrent et leur imposèrent des sévices de toutes sortes quand ils n’allèrent pas jusqu’à les brûler comme sorciers, Ainsi s’établirent, pour exister encore aujourd’hui, les maisons d’aliénés, qui sont « des prisons et non des hôpitaux », où les fous traînent une existence de pauvres bêtes en cage. Il a fallu arriver à la fin du XVIIIème siècle, au temps de la Révolution, pour que le savant Pinel « éleva l’insensé à la dignité de malade » et s’efforça d’apporter quelque douceur dans le traitement des aliénés sur qui régnaient des belluaires plutôt que des infirmiers. Mais les aliénés sont toujours internés, traités plus ou moins en bêtes fauves, et l’odieuse loi du 30 juin 1928 a resserré encore plus sur eux le cercle infernal en permettant de faire partager leur sort à des gens sains d’esprit mais encombrants pour la « confrérie des puissants »!...
Il n’y a pas encore un siècle que la science officielle a découvert dans la Campine, en Belgique, un village où, depuis un millier d’années, des aliénés venus de tous les côtés du monde, forment une colonie libre, mêlée à la population. Ils y trouvent tous les égards que mérite leur état ; ils y reçoivent tous les soins pouvant leur rendre l’intégrité de leur personnalité. Ils sont soutenus, réconfortés, dans leurs moments de lucidité, par cette impression qu’ils ne sont pas retranchés de la communauté humaine. L’histoire de ce milieu, de son organisation, des résultats remarquables et émouvants qu’il a produits, a été racontée par M. Jules Duval, ancien magistrat dans un ouvrage intitulé : Gheel, ou une colonie d’aliénés vivant en famille et en liberté (Hachette, 1867). L’expérience faite à Gheel depuis si longtemps est décisive ; elle devrait inspirer les administrations compétentes. Mais l’état social où règnent tant de prétentieux ignorants aussi vides de cœur qu’encroûtés de fausse science a autre chose à faire qu’à s’occuper des aliénés, de leur liberté, du bonheur qu’on pourrait leur donner en faisant qu’ils ne soient plus une charge pour la collectivité. Comme l’écrivait Jules Duval : « Gheel, création des siècles et des mœurs, est trop beau pour être imité par voie administrative ; il y faut trop de dévouement, trop de bonté, trop de cœur en un mot, et aussi trop de liberté pour une organisation purement officielle... C’est un exemple, un modèle, qui rayonne sur le monde par chacun de ses principes et de ses bienfaits ».
La question est la même pour les aliénés que pour ceux appelés « criminels » que l’on astreint, dans les prisons, à une existence improductive et dont on achève la démoralisation. Pour tous, comme pour tous les disgraciés, les faibles, les exploités, les vaincus, il n’y aura de bonté de liberté que dans une société où l’on ne subira plus l’injustice et la violence de malfaiteurs subtils et de brutes sanguinaires.
8. Liberté des animaux
Après tant de constatations lamentables sur les conditions de la liberté humaine, peut-on parler de la liberté des animaux sans exciter le rire et les sarcasmes ? Nous devons d’autant plus en parler que l’œuvre poursuivie ici est de protestation contre la sottise qu’engendre l’ignorance et la lâcheté complice de la violence. Nous devons être d’autant plus affirmatifs et énergiques que nous flétrissons un état social que nous voulons voir disparaître, qui disparaîtra quand la raison humaine saura lui en substituer un autre où la liberté ne sera plus un mot mais un fait. Et nous ne méprisons pas assez les hommes, même ceux d’aujourd’hui, pour ne pas leur demander d’avoir pour les animaux certains égards ; ils pourraient par la même occasion, les avoir aussi pour eux-mêmes.
Nous ne discuterons pas du sacrifice des animaux qui est une nécessité vitale pour l’homme, obligé à se nourrir et à se défendre comme toutes les espèces qui sont dans la nature. Le sort de tous les êtres est d’être à la fois dévorateurs et dévorés ; c’est la loi du transformisme, c’est-à-dire de la vie, en incessant mouvement et dont Shakespeare a montré le cercle dans cette image :
« Le poisson mange le ver, l’homme mange le poisson et le ver mange l’homme »
Les mystiques eux-mêmes, qui seront mangés un jour malgré leurs prétentions à une vie surnaturelle, et ne mangent pas de viande « pour ne pas tuer », sont aussi meurtriers que ceux qui en mangent. La salade dont ils se nourrissent a autant de droits à la vie que le mouton qu’ils épargnent, et ils ne s’interdisent pas de détruire, à chacun de leurs mouvements respiratoires qui se répètent de quatorze à dix-huit fois par minute, des millions d’animalcules ayant tout autant qu’eux droit à la vie. Mais ce qui n’est d’aucune nécessité, c’est d’ajouter au sacrifice inévitable des animaux l’exploitation et la privation de la liberté pendant le temps qu’on les laisse vivre, quand ce n’est pas le plaisir immoral et odieux de les faire souffrir.
L’exploitation et la souffrance imposées aux animaux participent des mêmes méthodes d’injustice et de violence qui poussent l’homme à se faire souffrir lui-même. Si les animaux domestiques sont arrivés par une accoutumance héréditaire à s’accommoder de la privation de liberté, c’est en échange de garanties de développement et de sécurité que l’homme leur a données et qu’il n’est nullement nécessaire d’accompagner de mauvais traitements. On s’indigne à la lecture de récits d’anthropophagie disant que les « sauvages » ont le soin d’engraisser leurs victimes avant de les mettre en broche. Les « civilisés » en font autant par les gavages barbares qu’ils imposent aux animaux de basse-cour. Il n’est pas d’exploitation plus cruelle que celle imposée par l’homme à sa « plus noble conquête », le cheval, dont il a fait le martyre de la rue, le martyre du cirque, le martyre de la mine, le martyre des étangs à sangsues. Et l’homme qui frappe le plus durement sur les flancs de la bête épuisée est celui que le patronat exploite le plus férocement, de même qu’il est le plus incapable de s’entendre avec les autres exploités pour changer son sort. Inconscience, lâcheté, sournoise satisfaction de venger sa misère sur plus misérable que soi : il y a trop souvent ces choses-là dans les souffrances imposées aux animaux!... Des hommes, des prolétaires, des chairs à travail et à mitraille, vont se réjouir aux spectacles des chasses à courre, des combats de coqs ou de chiens, des « corridas de toros », où l’animal est poursuivi, traqué, torturé, assassiné avec des raffinements sadiques. Ils vont applaudir dans des ménageries les exploits de belluaires grotesques acharnés à faire passer leur propre férocité chez de vieux fauves neurasthéniques, abrutis par les supplices qui accompagnent leur captivité. Ils vont admirer des « animaux savants » à qui on a appris à être aussi sots que l’homme, à coups de fouet, en les faisant marcher sur des plaques métalliques chauffées, en leur enfonçant des clous dans les pieds, quand ce n’est pas en leur crevant les yeux comme aux pinsons « pour les faire mieux chanter »!...
Tant qu’on assistera à l’indifférence des misérables devant la souffrance de plus misérables, l’état social demeurera le même enfer pour tous. Les hommes ont besoin d’acquérir le véritable sens de la liberté en respectant celle des plus faibles. La liberté est inséparable de la justice qui veut la liberté de tous. Lorsqu’ils auront appris le respect des plus faibles, les hommes seront alors capables de l’exiger des plus forts. Tant qu’ils attenteront à la liberté des faibles, vieillards, femmes, enfants, animaux, ils ne seront eux-mêmes que des esclaves, car ils n’auront pas su trouver dans la solidarité des êtres la seule force qui soit capable de faire respecter leur propre liberté.
— Edouard ROTHEN
NOTA. — Les questions examinées dans notre article ont fait, pour la plupart, l’objet des études et des protestations de la Ligue des Droits de l’Homme. On les trouvera dans ses Cahiers notamment dans les suivants :
Rapports de police, 25 avril 1926. — Justice sociale et liberté, 10 janvier 1925. — Réforme judiciaire, 25 octobre 1926. — Liberté individuelle. Compte rendu du Congrès National de 1923. — Cahiers des 10 juin 1928, 28 février et 20 mars 1929. — Affaire du professeur Platon, 10 février, 10 juillet, 5 décembre 1926, 25 avril, 15 octobre 1927, 20 mai 1928. — Affaire Sacco et Vanzetti, 10 et 25 avril, 1er octobre, 10 novembre 1927. — Affaire Bougrat, 15 juin 1927. — Droit d’expulsion et réforme de l’extradition, 20 janvier 1925, 25 février, 1er octobre, 10 décembre 1927. — Affaire Ascaso, Durutti et Jover (extradition), 10 mai 1927. — Affaire Viretto (expulsion), 20 mai 1928. Lois scélérates, 25 décembre 1927, 10 juin 1928. — Arrestations préventives, 10 octobre, 10 décembre 1928, 20 janvier, 1er août 1929). — Secrets de l’instruction, 30 janvier 1929. — Contrainte par corps, 10 avril, 10 juin, 20 décembre 1927, 10 janvier, 10 juin, 10 septembre 1928, 10 février 1929. — Droits de l’enfant, 10 mars, 10 novembre 1927, 30 mars, 20 mai, 20 novembre 1928, 10 janvier 1929. — Liberté et droits de la femme, 15 octobre 1927, 30 avril, 20 mai, 30 octobre 1928, 30 janvier 1929. — Liberté de réunion, 10 et 30 septembre 1928. — Liberté et droits des fonctionnaires.
Compte rendu du Congrès National de 1923. Cahiers des 10 juin, 30 juillet, 30 août, 10 octobre 1928, 10 et 28 février 1929. — Affaire Allard (droits des fonctionnaires), 20 novembre 1928. — Affaire Rombeau (innocent condamné), 20 septembre 1928. — Affaire Adam (innocent condamné), 10 janvier 1929. — Mutineries de Calvi, 10 septembre 1928, 10 février 1929. — Affaire Boutrois, 20 novembre, 30 décembre 1928, 10 janvier 1929. — Affaire Morelli et officiers espagnols (extradition), 30 novembre 1928. — Affaire Balloni (extradition), 20 février 1829. — Objection de conscience, 20 février, 10 mars 1929. — Liberté et droits des indigènes coloniaux, 15 octobre 1925, 25 mars, 30 avril, 15 mai 1926, 10 janvier, 10 et 25 mars, 10 et 25 avril, 25 juin, 10 et 25 novembre, 10 décembre 1927, 20 janvier, 20 février, 10 juin, 30 août, 30 septembre, 10 et 30 novembre, 10 décembre 1928, 10 et 28 février 1929.
LIBERTÉ (ÉDUCATION)
L’éducation impartiale de l’enfant apparait au premier abord difficultueuse parce qu’elle essaie de satisfaire diverses tendances métaphysiques dont nous ne parvenons pas toujours à nous libérer.
C’est ainsi que les droits de l’enfant, sa liberté, le souci de respecter sa personnalité arrêtent dès le début l’éducateur sincère et profondément individualiste. Comme précisément le but de l’éducation consiste à former et développer la personnalité de l’enfant, il y a une certaine contradiction apparente entre le fait de respecter une personnalité et le fait de la former. Si on veut respecter l’enfant et sa liberté, on doit le laisser tel qu’il est ; si on l’influence que devient le principe d’impartialité et de neutralité !
En réalité la personnalité naissante de l’enfant a déjà été déterminée lors de la fécondation de l’ovule maternel et si ses parents ne se sont point souciés de lui assurer une bonne hérédité physiologique et psychique, il sera toujours un produit malchanceux et taré entre les mains de l’éducateur. Même conçu sainement, l’enfant est inévitablement déterminé par les lois de l’hérédité et respecter strictement sa personnalité c’est respecter une combinaison physico-chimique représentant le terme d’une longue série d’expériences évidemment intéressantes puisqu’elles ont triomphé du milieu, mais dont quelques-unes peuvent influencer fâcheusement le caractère de l’enfant. C’est dire que le caractère d’un enfant ne saurait être quelque chose de sacré et que ses anomalies psychiques ne sont pas plus admirables que ses malformations physiques.
D’autre part l’être humain est modifié, modelé par la succession des évènements qu’il subit depuis sa naissance jusqu’à sa mort et cela constitue véritablement une éducation. Comme cette éducation peut être néfaste à l’enfant qui ignore précisément les causes de vie et de mort, l’éducateur représente le résultat d’une longue évolution, d’une longue expérience de la vie transmises par le savoir spécifique, héréditaire ou traditionnel évitant à l’enfant les expériences douloureuses des ancêtres.
Donc, au lieu de partir de considérations métaphysiques sur le moi de l’enfant, il vaut mieux observer l’évolution et le fonctionnement de la vie. Nous voyons que l’être est en perpétuelle réaction contre le milieu ; que ces réactions suivent un certain ordre logique dans l’espace et dans le temps et qu’un bon équilibre de toutes ces réactions est nécessaire pour la vitabilité même de l’individu. Nous voyons également que la succession de tous les phénomènes s’effectue invariablement dans un ordre précis constituant un enchainement de nécessités universelles, et que l’inversion de cet ordre et les erreurs en résultant restreignent l’activité vitale et détruisent la vie. Le but de l’éducateur ne peut être que l’adaptation intelligente de l’enfant à ces nécessités universelles, assurant sa durée vitale et son bonheur. Développer l’acuité des sens, la précision des mouvements, l’habileté tactile, l’endurance physique, l’esprit d’analyse et d’observation, la compréhension de l’enchaînement des choses, le jugement, la volonté, l’énergie créatrice ; voilà le véritable terrain impersonnel de l’éducation. Parallèlement à l’évolution de ces facultés, l’éducation devrait développer les conséquences logiques de l’amitié, de l’association, de l’entraide, de la fraternité imposées aux hommes par les nécessités naturelles. Ainsi comprise, l’éducation objective et impersonnelle n’imposerait point à l’enfant l’immoralité des intérêts de tel individu, groupe, chapelle, parti ou nationalité, mais l’harmoniserait avec les nécessités universelles faites de la solidarité de tous les éléments.
La personnalité de l’enfant se formerait et s’harmoniserait d’elle-même par le développement et 1’équilibre intérieur de toutes ses facultés et la compréhension de son propre fonctionnement. La connaissance des causes déterminant les choses et les êtres, jointe à une vie saine et un fort développement de la volonté feraient plus pour l’amélioration ou l’évolution de son moi que tous les traités de morale de l’univers.
L’éducateur ne doit jouer qu’un rôle accélérateur. Il doit faciliter les expériences, permettre à l’enfant de trouver lui-même le secret des choses et lui laisser la joie des découvertes et des réalisations. Il ne doit pas être un maitre qui impose, ordonne, récompense ou punit. Ce sont les résultats mêmes des actes qui doivent punir ou récompenser l’enfant en lui enseignant le jeu des causes et des effets. L’éducateur ne peut être qu’un grand ami qui sait beaucoup de choses.
Le but essentiel de cette éducation ne consisterait point à faire de l’enfant un citoyen, un partisan, un enrôlé, une fraction d’homme, admirateur de ses parents, de sa tribu ou de sa nation, mais au contraire un individu fort, ayant sa fin en lui-même, sa conception particulière de la vie, sans obligation à venir envers le milieu qui lui doit la santé, le savoir et l’aisance. Sa seule raison d’association doit être un avantage démontré, une supériorité évidente d’une activité sur une autre et sa raison doit suffisamment le déterminer pour lui permettre de concevoir, conclure et tenir des engagements amplifiant sa vie.
L’éducation ne saurait donc être libre c’est-à-dire exercée par n’importe qui, soumise à la fantaisie, à l’ignorance ou la malfaisance des éducateurs politiques ou religieux. Nous voyons les résultats de cette éducation et nous en connaissons les méfaits. L’éducation doit être impersonnelle, scientifique et objective et résulter d’une étude profonde de la vie.
Tous nos efforts doivent tendre à faire admettre ces conceptions par les progéniteurs lesquels, comprenant enfin leur lourde responsabilité favoriseront la création de milieux éducatifs rationnels, seules sources possibles de transformations sociales profondes et durables.
— IXIGREC
LIBERTÉ (ÉDUCATION)
Nous avons déjà parlé de la liberté aux mots Education et Enfant. Nous sommes libres, disions-nous, dans la mesure du facteur personnel de la décision. Autrement dit, il n’y a liberté que s’il y a personnalité. Mais la personnalité n’est pas quelque chose d’inné ; elle se forme peu à peu et résulte en définitive : de l’hérédité — le jeune enfant a des tendances, les instincts qu’il doit à ses ancêtres ; de l’influence du milieu sur l’individu — adaptation du tempérament individuel aux exigences du milieu social ; de l’expérience individuelle.
« Cette expérience individuelle vient se surajouter à l’expérience ancestrale et à l’expérience collective pour déterminer le caractère de l’individu et conditionner son comportement. » (Vermeylen)
Ainsi donc il y a évolution dans la formation de la personnalité ; tout d’abord, de très bonne heure apparaît la notion du « mien ».
« Le « mien », c’est non seulement l’enfant lui-même... mais tout ce qui l’entoure et qui lui sert. Il ne se distingue pas encore des vêtements qui l’habillent, des bras qui le portent, du sein qui le nourrit. » (Vermeylen)
Peu à peu l’enfant devient capable de faire cette distinction et acquiert la notion du « moi ». Cette « notion s’établit progressivement sans qu’on puisse lui attribuer des limites fixes. Vers l’âge de trois ans elle n’est pas encore nettement assise. Lorsque, par jeu, on fait semblant de prendre l’enfant pour une autre personne, on le voit parfois s’inquiéter comme si la chose restait malgré tout pour lui possible ». Prenant conscience du mien et du moi, de ce qu’il a été, de ce qu’il est, de ce qu’il sera, l’enfant acquiert enfin la notion du « je », mais jusqu’au moment de la puberté, ce « je » reste très peu personnel ; l’enfant est avant tout un imitateur. « Au cours de l’adolescence, au contraire, le sentiment personnel s’hypertrophie souvent de façon exagérée et entre en lutte avec le milieu ».
Tout autant que les contraintes des parents ou des éducateurs, l’insuffisance du développement de la personnalité rend la liberté des enfants toute relative. La relativité de la liberté est d’ailleurs admise pour les adultes aussi bien que pour les enfants :
-
Liberté matérielle. — Il faut reconnaître qu’il existe quelque chose comme une liberté matérielle..., découlant de la possession de l’argent, d’une bonne santé, de la puissance. Sa limitation s’exprime par la pauvreté, la maladie, les conventions ;
-
Liberté émotive. — Nous sommes tous esclaves de nos émotions sous une forme ou sous une autre ; nous ne sommes pas libres...
-
Liberté mentale. — Peu de gens ont été capables de s’élever au-dessus des limitations des doctrines politiques, des crédos, du sentiment national. Beaucoup d’entre nous sont liés par leur point de vue et ne sont pas libres au point de vue mental ;
-
Liberté spirituelle. — On ne peut donner que ce que l’on possède. « A moins d’être relativement libres, nous ne pouvons transmettre la liberté à nos élèves. Un des plus graves problèmes éducatifs est donc celui de la libération spirituelle du maitre » (Béatrice Ensor).
Mais même si le maître était libéré spirituellement, il ne pourrait accorder le même degré de liberté à tous les enfants. Le degré de liberté qui peut être accordé à l’enfant varie suivant l’âge et le type d’enfant.
-
L’âge. — « Ainsi on peut tolérer des actes et des réactions chez un enfant de trois ans qu’on n’admettra plus à six ans, et de même à six ans qu’on ne permettra plus à douze ans et ainsi de suite. Et il est bien entendu qu’il s’agit de l’âge mental bien plus que de l’âge réel. »
-
Le sexe. — Les garçons moins dociles demandent une main plus ferme. Il y a d’ailleurs des exceptions.
-
Le facteur physiologique. — Les enfants vigoureux dépassent plus facilement les limites permises.
-
Les instincts. — Instinct combatif, groupal, etc. qui modifient le comportement.
-
L’état sensoriel et émotif. — « Chez l’enfant sourd ou aveugle, la discipline est rendue beaucoup plus difficile du fait que l’élève reste isolé du milieu social et ne subit que faiblement l’influence du groupe et de l’éducateur. »
-
L’intelligence et les aptitudes. — « Un enfant arriéré ne comprenant pas la nécessité de l’ordre et de la règle troublera la classe entière. »
-
Les habitudes acquises dans la famille. — L’enfant unique est souvent indiscipliné et l’on est souvent obligé de restreindre sa liberté à l’entrée à l’école.
-
Les connaissances de l’enfant. — « S’il a fait lui-même certaines expériences fâcheuses ou s’il a vu d’autres en faire, il s’adapte plus rapidement que l’enfant qui a été tenu à l’écart de ces mêmes expériences. » (D’après le Dr Decroly)
Cependant si, dans l’intérêt même des enfants, on ne peut accorder à ceux-ci une liberté entière, il faudrait au moins que les restrictions apportées à cette liberté le soient dans l’intérêt des enfants et non pour satisfaire l’égoïsme des adultes.
« Dans la majorité des familles des lieux où les adultes vivent avec les enfants, tout est prévu pour que les grands aient leurs heures de relâche, de détente, leurs aises ; les locaux, les horaires sont organisés en vue de ne pas gêner les grands, et en fait les entraves à la liberté des petits sont très souvent dues à l’égoïsme des grands....
« Le facteur dominant, conscient ou inconscient, c’est ce qu’on appelle la loi du moindre effort, et comme le grand est le plus puissant, il s’arrange, avec la meilleure foi du monde d’ailleurs, pour que le cadre où il doit vivre avec le petit soit approprié à ses propres besoins, à ses goûts à lui d’abord, à ceux de l’enfant ensuite, s’il le peut et s’il y songe. » (Dr Decroly)
Cependant la liberté de l’enfant n’est pas moins utile aux éducateurs, parents ou maîtres, qu’aux élèves. Pour agir efficacement sur le développement d’un enfant il faut connaître cet enfant, ses actions, ses réactions, ses intérêts, et comment connaître cela si on ne l’observe pas en liberté. Dans l’école oppressive c’est pendant les récréations, c’est-à-dire pendant les moments de liberté, que les maîtres apprennent le mieux à connaître leurs élèves.
* * *
Le problème de l’éducation pour la liberté, de la libération de l’enfant se pose d’abord dans la famille. Il se pose ensuite à l’école et y est d’autant plus difficile à solutionner que la plupart des écoles ont des externats, ce qui n’est pas un mal à tous points de vue mais qui, dans ce cas, risque de soumettre l’enfant à deux régimes tout à fait différents. Il ne sert de rien d’adopter à l’école le régime le plus favorable à la libération de l’enfant si dans la famille cet enfant se trouve soumis à un régime opposé, soit que la licence, soit que l’excès d’autorité règne à la maison. Par suite, il est nécessaire de travailler à réaliser un accord entre la famille et les maîtres de l’école afin que la famille et l’école collaborent efficacement à la libération de l’enfant.
Dans l’esprit des adversaires de la liberté de l’enfant, cette liberté-là aboutit à supprimer toute réaction de la part des adultes à l’égard des activités désagréables, nuisibles, dangereuses ou instinctives de l’enfant, à ne pas s’opposer à tout ce que ses tendances étroitement égoïstes, et ses impulsions défensives inférieures, le poussent à faire ou à ne pas faire...
Mais les adversaires n’envisagent en fait qu’un côté du problème, celui où la tolérance est accordée aux actes et manifestations défavorables. Or, laisser l’enfant libre, c’est aussi lui permettre de manifester ses tendances favorables, le laisser libre de « bien faire ». Cette liberté-là a, certes, autant de poids que l’autre. Permettre à l’enfant d’expérimenter, de débrouiller les énigmes dont il est entouré, c’est lui permettre d’exprimer, par les divers moyens dont il dispose, les pensées qui l’occupent et qu’il désire communiquer ; c’est lui aider à formuler ses inquiétudes, ses curiosités, ses désirs et ses peines ; c’est réaliser les conditions les plus favorables pour qu’il prenne peu à peu conscience de lui-même et de son milieu en vue d’une adaptation plus rapide et plus parfaite.
Et c’est non seulement lui permettre de manifester ses tendances favorables, c’est encore lui aider à découvrir le monde, à faire des expériences à propos de ce qu’il rencontre, à essayer ce qu’il imagine, à construire ce qu’il invente. C’est également organiser le cadre naturel et humain, le milieu des choses et des êtres, l’ambiance des événements et des faits, de manière à lui suggérer ces expériences, ces découvertes, ces fantaisies, ces inventions.
Or, « il est incontestable qu’il faut restreindre la liberté, lorsqu’elle se manifeste sous le premier aspect. Il faut, au contraire, l’encourager dans le second cas » (Dr Decroly).
Ainsi, le premier rôle de l’éducateur consiste à préparer pour l’enfant un milieu tel qu’il ait des occasions d’agir conformément à sa nature, sans danger pour lui et de telle façon que son action, comportant le maximum possible d’initiative, favorise le développement de sa personnalité.
« Laisser les tout-petits enfants libres de faire ce qu’ils veulent, ce n’est donc point leur donner des jouets qu’ils n’aient qu’à voir ou à tenir dans leurs mains, mais leur fournir des occasions d’agir ; de faire mouvoir des choses, de les transformer, de les construire, de les démolir, de les reconstruire. Les parents avertis savent que les petits enfants jouent avec des objets très simples à condition que ces objets permettent une action, un rudiment de construction : paniers à remplir et à vider, boîtes à fermer et à ouvrir, cubes à assembler et à défaire. Ces matériaux une fois en sa possession, l’enfant peut être laissé libre sans le moindre inconvénient, il peut faire ce qu’il veut, puisque ce qu’il veut est précisément à la fois conforme à la nature de son activité et à la nature les objets sur lesquels elle s’exerce. » (Cousinet)
Une telle liberté restera encore longtemps impossible à l’école car les programmes d’études y sont établis sans souci des intérêts enfantins : or tant que le maître ne pourra pas motiver, aux yeux des enfants, les exercices et les travaux scolaires il devra les imposer.
En second lieu l’éducateur — père, mère, instituteur — doit suggérer à l’enfant des buts, accessibles pour lui et pouvant lui donner l’occasion de réfléchir, de faire preuve d’initiative et de persévérance. En troisième lieu, il doit suggérer les moyens d’atteindre ces buts, lorsque l’enfant est incapable de trouver ces moyens à lui seul. En ce cas il doit limiter autant que possible son intervention : il n’est pas mauvais que l’enfant se trompe parfois ou même tâtonne dans la recherche des moyens ; il suffit d’éviter l’excès afin qu’il n’y ait point une perte trop grande de temps et de forces.
Enfin l’éducateur doit être le modèle raisonnable que l’enfant imite tout naturellement et à l’exemple duquel il rapporte ses actions (Voir à ce propos : 1° Education, p. 638, 2ème col. 2° Enfant, pp. 684 et 685. – Errata : p. 684, avant-dernière ligne, lire : Ainsi d’un côté ... et non Admis d’un côté...)
Si l’on ne tenait compte que de l’évolution de l’enfant, c’est-à-dire du développement de sa personnalité, de l’accroissement de ses connaissances et de son expérience on admettrait qu’il faut accorder de plus en plus de liberté à l’enfant. Par suite, un enfant de douze ans devrait jouir, à l’école primaire, de beaucoup plus de liberté qu’un enfant de quatre ou cinq ans à l’école maternelle. En réalité c’est actuellement l’inverse qui est la règle. La raison en est qu’on ne se préoccupe guère d’instruire l’enfant de quatre à cinq ans tandis qu’au contraire le souci d’instruire l’enfant plus âgé prime celui d’assurer son développement.
Il en résulte que les pédagogues se sont ingéniés afin de créer un matériel de jeux éducatifs pour les jeunes enfants (matériel Montessori, matériel Decroly, matériel de l’Institut Jean-Jacques Rousseau, etc.), qui donne satisfaction aux besoins et aux intérêts de ces petits tout en favorisant leur développement. Mais les enfants plus âgés, à l’école primaire comme à l’école secondaire, ont des programmes et des examens. Faut-il supprimer programmes et examens, ce qui ne serait pas supprimer toute étude mais fixer les travaux suivant les intérêts et les désirs des enfants ? Ce serait parfait si ceux-ci étaient capables de choisir et de déterminer les connaissances et les capacités qui leur seront nécessaires. « C’est à nous, adultes, à faire ce choix, plutôt qu’aux enfants, car les instincts et les intérêts naturels nés d’un passé biologique ne peuvent être un guide certain pour l’enfant dans son choix des connaissances et des capacités que demande notre civilisation moderne industrielle, si artificielle et si complexe ».
Et l’âge de la scolarité, la condition des enfants du peuple, dépendant d’un état social qui précipite l’acquisition des connaissances en même temps qu’il en dénature le chemin, entraînent l’école officielle à orienter précocement le savoir vers des formes définies. D’autre part, si l’enfant ne peut fixer lui-même ses programmes, il faut ajouter que les adultes qui fixent ou appliquent ces programmes le font trop souvent sans réfléchir à toutes les questions qui doivent se poser à nous à ce sujet : Qu’est-ce que l’enfant devenu adulte aura besoin de connaitre ? Qu’est-ce que la vie apprendra à l’enfant ? Qu’est-ce que l’enfant, une fois grand pourrait apprendre seul ? Qu’est-ce que le futur adulte a le désir d’apprendre pendant son enfance ? Qu’est-ce que l’enfant peut apprendre aux divers stades de son développement. ?
Examinons successivement ces questions.
Qu’est-ce que l’enfant devenu adulte aura besoin de connaître ? Nous n’avons évidemment pas l’intention de faire apprendre aux écoliers tout ce qui pourrait leur être utile plus tard, mais nous voulons bien plutôt faire un choix parmi les connaissances utiles. Il est regrettable que ce choix soit fait uniquement ou presque par des spécialistes de l’enseignement qui « accordent parfois une importance exagérée à des choses qui n’en ont aucune pour le reste des mortels... »
Qu’est-ce que la vie apprendra à l’enfant ? — Il est inutile d’apprendre à l’enfant, à neuf ou dix ans, sur les bancs de l’école ce que l’on est assuré qu’il apprendra un ou deux ans plus tard dans sa famille.
Qu’est-ce que l’enfant devenu adulte pourrait apprendre seul ? — Nous ne nous désintéressons pas de ces connaissances dont certaines auront dans la vie leur utilité ou leur agrément, mais l’écolier doit d’abord acquérir les connaissances les plus propres à favoriser l’auto-instruction et l’auto-éducation de l’adulte (apprendre à lire intelligemment, à se servir d’un dictionnaire, etc.) et former son esprit.
Qu’est-ce que le futur adulte a le désir d’apprendre pendant son enfance ? — Si nous avons à choisir entre deux connaissances également utiles au futur adulte nous préférerons enseigner celle qui intéresse le plus l’enfant parce que nous avons beaucoup plus de chances de le lui voir acquérir.
Qu’est-ce que l’enfant peut apprendre aux divers stades de son développement ? Il s’agit :
-
de limiter les connaissances à acquérir en tenant compte des possibilités enfantines comme aussi de la nécessité des loisirs et d’une part de temps à réserver aux activités libres individuelles ou collectives ;
-
de faire acquérir ces connaissances au moment le plus favorable, ni prématurément — comme on le fait trop souvent — ni trop tard, autrement dit d’établir un bon échelonnement des difficultés.
Les questions qui précèdent ont pour but de fixer des programmes qui permettent :
-
de limiter, autant que possible, les études qui doivent être imposées aux enfants dans l’intérêt des futurs adultes ;
-
d’acquérir ces connaissances imposées au meilleur moment et dans l’ordre le plus favorable à une acquisition rapide ;
-
d’accorder plus de temps aux travaux éducatifs propres à développer la personnalité, l’initiative, la volonté et aux travaux libres, individuels ou collectifs.
Alors que, dans nos écoles actuelles, presque tous les travaux sont imposés par les adultes, dans les écoles de l’avenir la plus grande partie du temps sera consacrée à des travaux libres, vraiment libres : soit qu’ils soient suggérés aux élèves par le milieu et le matériel mis à leur disposition dans les meilleurs cas ; soit qu’ils aient été entrepris à la suite de la suggestion du maître, aussi discrète que possible.
Mais bien que le travail-corvée disparaisse peu à peu, bien que les pédagogues s’efforcent de plus en plus de motiver les travaux scolaires, il restera encore sans nul doute des connaissances à acquérir dont l’étude ne sera pas désirée mais imposée par les adultes. Cependant, de ce côté encore, de gros progrès sont en cours de réalisation. Dans les écoles qui travaillent selon le « Dalton-Plan » c’est encore l’adulte qui fixe le travail à l’élève mais ce dernier jouit d’une certaine liberté, d’une certaine initiative dans l’exécution du travail, il le fait où il veut et quand il veut. L’enfant a une fiche de travail mentionnant les travaux qu’il doit accomplir en une semaine et sur laquelle il indique, au fur et à mesure, les travaux faits. A Winnetko, les fiches sont remplacées par des livres de buts soigneusement gradués mais la méthode est analogue : les enfants peuvent s’entraider, travailler en groupe, interroger le maître. Les pédagogues s’efforcent d’autre part de réduire autant que possible l’intervention de celui-ci, soit grâce à l’emploi d’un matériel auto-correcteur, soit par une bonne graduation des difficultés.
La graduation des difficultés qui convient à un élève intelligent ne convient plus à un élève moyen et à plus forte raison, à un élève faible ; aussi on s’efforce de plus en plus — en Amérique surtout — d’individualiser l’enseignement et l’individualisation de l’enseignement est ainsi favorable à la libération de l’enfant puisqu’elle limite l’intervention du maître.
Mais si l’individualisation de l’enseignement est favorable à la libération de l’enfant, parce qu’elle lui permet d’acquérir le savoir, et en particulier les techniques (lecture, écriture, calcul), en marchant à son pas ; il n’en faudrait pas croire que les travaux individuels sont seuls favorables à nette libération, ce serait oublier l’importance du milieu pour la formation de la personnalité. Actuellement les pédagogues novateurs s’efforcent de remplacer la concurrence (compositions, etc.) par la coopération ; de là, des travaux collectifs dont le but est fixé le plus souvent par les adultes en coopération avec les enfants, mais parfois par les enfants eux-mêmes.
En résumé, on s’efforce :
-
de limiter les travaux imposés grâce à un meilleur choix et à une meilleure gradation du contenu des programmes ;
-
de motiver tous les travaux scolaires ;
-
de tayloriser l’enseignement pour valoriser l’éducation en accordant une plus large place aux activités spontanées et aux travaux libres (individuels on collectifs) ;
-
d’accorder le maximum de liberté possible dans l’exécution des travaux imposés ;
-
de faire place aux travaux collectifs qui permettent à l’initiative des enfants de s’exercer et les prépare à la vie sociale.
Il faut convenir que nous sommes encore loin d’avoir atteint tous ces buts.
Ceci ne sera d’ailleurs possible qu’à la condition de se préoccuper également du problème du choix et de la formation des maîtres. Tous les individus, même fort instruits, n’ont pas les aptitudes qui conviennent à la libération de l’enfant. Les meilleurs à cet égard sont les maîtres actifs, qui fournissent ainsi un modèle à l’enfant, et les maîtres intuitifs qui devinent ce qui convient à l’enfant et savent user de la suggestion plutôt que de l’ordre ou de la défense. L’aptitude du maître peut aussi être perfectionnée, non pas seulement par les connaissances qu’il acquiert pour se rendre de plus en plus capable de remplir son rôle de guide, mais aussi par l’observation des modèles. Il serait désirable que tous les maîtres, à tour de rôle, pussent aller observer la vie d’une école où les enfants jouissent d’une plus grande liberté, pour se rendre compte, par eux-mêmes des moyens de parvenir à ce résultat.
Enfin, rappelons qu’il reste aussi à se préoccuper de l’éducation des parents et d’une meilleure collaboration de l’école et de la famille.
— E. DELAUNAY
LIBERTICIDE
(adj. lat. libertas, et cœdere, tuer, détruire)
Qui attente à la liberté, qui la détruit. L’appareil des lois, l’organisation de la justice, les prérogatives gouvernementales sont, dans notre société, les cadres permanents d’un système politique éminemment liberticide. L’autorité, qui est leur fondement, est par essence liberticide et, s’ils n’en pénètrent la nocivité et n’en proscrivent les institutions, les hommes aspireront en vain vers la liberté.
Socialement, le capitalisme, qui soumet l’ouvrier aux maîtres des usines et aux possesseurs de la terre, à tous ceux qui, dispensateurs de la besogne quotidienne, sont en même temps les arbitres du salaire dont dépend son existence (sans parler des répercussions indirectes) le capitalisme est une forme liberticide.
Sur les méfaits des uns et des autres, nous ne nous étendrons pas davantage ici. Nombreux sont les mots où ils seront explicitement, et à leur place, vigoureusement dénoncés.
LIBERTINS
n. et adj. (lat. libertinus, affranchi)
A le sens de dégagé de la contrainte, du dogme, de la discipline. Cette désignation s’est étendue à tout sujet qui s’écarte des règles, les transgresse ou les répudie. De l’impatience de tout frein à la facilité dissolue, du vagabondage de l’esprit à la fantaisie butineuse des sens, l’appellation de libertin s’est davantage fixée de nos jours dans la désignation de ce qui a trait à l’indépendance des mœurs en matière sexuelle.
Le mot Libertin a d’abord signifié affranchi de la discipline de la foi, indépendant dans ses croyances. C’est le sens que lui dormaient le protestant d’Aubigné, les catholiques Bossuet et Bourdaloue.
Le qualificatif de libertins a été donné à deux groupes de protestants bien différents : l’un résidant dans les Pays-Bas, l’autre se trouvant à Genève. Les libertins des Pays-Bas avaient à leur tête Antoine Pecques, Chopin et surtout le picard Quintin, un tailleur d’habits. Ils niaient les anges, le paradis, l’enfer, l’immortalité de l’âme, la révélation, la responsabilité individuelle. Puisque les hommes ne sont responsables de rien, ils ne sauraient, en toute justice, être blâmés ou punis, lorsqu’ils commettent le mal. La seule préoccupation de l’homme doit être de faire de la terre un paradis terrestre en vivant sans contrainte.
On peut considérer les libertins de la Hollande et du Brabant comme des précurseurs directs des libertaires actuels. Ils furent poursuivis avec une rigueur extrême selon les ordres de l’altière et superstitieuse Marguerite d’Autriche. Quintin fut brûlé à Tournai en 1530
Tout en demeurant attaché à la Réforme, dans son esprit plutôt que dans sa lettre, les Libertins de Genève combattaient le joug intolérable de Calvin qui, on le sait, s’exerçait à la fois sur la religion et sur les mœurs. Un des libertins les plus fameux d’alors fut Sébastien Castellion, originaire du Bugey, latiniste et humaniste distingué, « très excellent personnage » au dire de Montaigne. Pédagogue de grand mérite directeur du collège de Rive à Genève, Castellion eut le tort de vouloir entreprendre une traduction du Nouveau Testament en français, puis de différer d’opinion avec Calvin au point de vue théologique. Il dut se réfugier à Bâle, où il édita Xénophon, Homère, finalement la Bible (1555), en français et en latin. Dans son introduction, il soulevait la question de l’inspiration des Ecritures, ce qui déchaîna contre lui l’ire de Calvin et de De Bèze. Là-dessus survint, à Genève, le supplice ou médecin espagnol Michel Servet (à qui on a attribué la découverte de la circulation du sang), coupable d’avoir nié le dogme de la Trinité. Calvin se montra, en l’occurrence, cruel et cynique, raillant sa victime jusque sur le bûcher, ce que n’aurait pas fait un Torquemada. Il y eut une protestation universelle contre ce supplice et il parut simultanément à Lyon et à Bâle, en français et en latin, un « Traicté des hèrectiques, à savoir si on les doit persécuter » s’appuyant sur toutes sortes de citations, et qui démontrait précisément le contraire. Ce Traité était précédé d’une magnifique préface, plaidoyer en faveur de la tolérance, dont la paternité fut attribuée par Calvin et de Bèze à Castellion, cela va sans dire. « C’est comme s’ils disaient, rétorquait Théodore de Bèze, qu’il ne faut punir des meurtres de père et mère, vu que les hérétiques sont infiniment pires ». L’Eglise Romaine n’a jamais été plus loin. Castellion, d’un côté, Calvin et De Bèze, de l’autre, continuèrent ainsi à batailler jusqu’à ce que, à 48 ans, le premier nommé eût succombé au surmenage et aux privations.
« C’est un précurseur de Bayle et de Voltaire, un précurseur qui ne leur a laissé rien à dire sur le grand sujet de la tolérance religieuse et de la liberté de conscience. » (Jules Janin)
Castellion avait pu mourir dans son lit. Mais à Genève la vie était insupportable. Les dictatures d’un Robespierre ou d’un Lénine paraissent jeux d’enfants auprès de celle de Calvin, alors que sa république n’était menacée d’aucune attaque extérieure. Visites domiciliaires fréquentes, interrogations officielles sur l’orthodoxie des habitants, lois somptuaires, réglementation de la forme des vêtements et des chapeaux interdiction des habits de soie et de velours aux genevois de basse condition, défense aux hommes de porter des cheveux longs, aux femmes de se friser, que sais-je encore ? Et il y avait des châtiments prévus pour les écarts de conduite et de langage. Les chefs des Libertins payèrent cher leur révolte contre l’intolérance calviniste. Jacques Gruet, Jean Valentin Gentilis, Monnet, Antoine d’Argillières furent condamnés à mort. Denis Billonnet fut marqué au front d’un fer chaud, Du Bois dut faire amende honorable, en chemise, nu-pieds, torche au poing ; Antoine Norbert eut la langue percée d’un fer chaud. Que d’autres condamnés à l’amende, au bannissement, à l’emprisonnement. Un jour, Clément Marot, venu à Genève pour fuir la persécution catholique qui sévissait en France, se permit de jouer au tric-trac avec un sien ami, lequel fut cité incontinent par devant le Consistoire, ce que voyant, le poète du « doux nenni » s’en alla ailleurs planter sa tente.
Au début du XVIIème siècle, on a dénommé « libertins » ceux qui réclamaient au nom de l’indépendance de la pensée, le droit à l’incrédulité, ainsi que les « épicuriens ». Libertins étaient le philosophe Gassendi, le voyageur Bernier, les poètes Chapelle et Th. de Viau, le littérateur Saint-Evremond et tous ceux que la libertine Ninon de Lenclos réunissait dans son salon. Les libertins forment la transition entre les grands sceptiques du XVIème siècle, les Montaigne et les Charron, et les philosophes athées du XVIIIème. Fontenelle fut l’un des derniers libertins.
Aujourd’hui on applique le mot de « libertins » à celles et à ceux qui s’insoucient des règles conventionnelles ou légales en fait de bonnes mœurs, qu’il s’agisse d’actes ou décrits. Le libertin n’est pas un débauché, car la débauche est un abandon inconscient, irraisonné, immesuré aux besoins, aux appétits, aux passions sexuelles ou érotiques. Le libertin reste conscient de ce qu’il veut et ne verse pas dans l’inconscience. Plusieurs des Encyclopédistes et de leurs amis furent des libertins et non des débauchés. Le libertinage n’est pas non plus de la prostitution, ce n’est pas pour de l’argent que la libertine ou le libertin est à la recherche de plaisirs de l’ordre sexuel ; ni l’un ni l’autre ne sont des professionnels de la volupté, des marchands et des acheteurs de jouissances charnelles. Ce qu’étaient jadis les libertins par rapport au dogme religieux, les libertins le sont aujourd’hui par rapport au dogme de la moralité : des hérétiques ou des hétérodoxes.
— E. ARMAND
LIBRAIRE, LIBRAIRIE
(lat. librarius, de liber, livre)
Le libraire est celui qui tient boutique de livres (voir ce mot) qui fait commerce d’imprimés. C’est aussi (libraire-éditeur) celui qui achète leurs manuscrits aux auteurs pour les faire imprimer et vendre. Dans l’antiquité (nous nous bornerons ici à un bref historique), les libraires dictaient aux copistes le texte des ouvrages et offraient ensuite ces manuscrits aux amateurs. D’abord assez restreint, leur nombre augmenta, tant à Rome qu’à Athènes, à mesure que les matériaux furent moins rares, et les boutiques des libraires devinrent le rendez-vous des chercheurs et des gens cultivés. Avec le christianisme, la copie des ouvrages — sacrés d’abord, puis profanes — gagna les couvents. Les invasions, les troubles des guerres successives y tinrent concentré le travail de transcription des œuvres intellectuelles et les entreprises extérieures disparurent... Elles se réveillèrent peu à peu avec la sécurité renaissante.
En 1275, une première ordonnance règlementa le commerce de la librairie. Stationarii (copistes), librarii (vendeurs de livres) étaient, avec les relieurs et parcheminiers, incorporés à l’Université dont le contrôle s’étendait au prix comme à la forme et au fond des ouvrages. Les libraires prêtaient serment, pour être admis à l’exercice. Longtemps, leur nombre, à Paris ne dépassa pas trente. La découverte de l’imprimerie transforma la librairie et favorisa merveilleusement son essor. De Louis XII datent les privilèges de la corporation (1509). C’est l’âge florissant des Frellon, des Ant. Virard et des Estienne. Mais avec la prospérité et les facilités de la propagation naquirent les inquiétudes du pouvoir royal et se manifestèrent ses tracasseries et ses rigueurs. L’Université, la Faculté de théologie et le souverain en dernier ressort régnaient, — trinité soupçonneuse — sur la corporation. Brocards, pamphlets et libelles couraient cependant le public sous la Ligue et la Fronde, malgré que la pendaison fut parmi les peines qui atteignaient les infractions aux édits...
En 1618 se constitua le syndicat de l’imprimerie et de la librairie. Sous Louis XIV, la confrérie, reconstituée en corps savant, exigea que les libraires fussent « congrus en langue latine » et sussent « lire le grec ». Et elle put citer avec orgueil les Vitré, les Cramoisy... Restrictions diverses, visa, obligation de dépôt, etc. puis, en 1723, mise sous la férule du lieutenant de police et des intendants, la librairie connut la dépendance et les difficultés jusqu’à la Révolution de 1789 qui en proclama libre le commerce... Liberté précaire, comme tant de conquêtes de l’époque. La censure préalable était, en effet, dès 1811, restaurée. Les régimes successifs, tremblant pour leur stabilité, surveillèrent jalousement la librairie, l’entourèrent de mesures vexatoires et tyranniques. Il fallut le 10 septembre 1870 pour rétablir « la profession libre ». Depuis la loi de 1881, la vente est affranchie de l’autorisation et du contrôle, mais le libraire-éditeur ou imprimeur demeure astreint à l’obligation de dépôt et passible de poursuites. Son commerce est assujetti aux dispositions répressives qui frappent les imprimés « délictueux » (Voir imprimerie, livre, etc.). Mais la librairie, par contre, participe aujourd’hui des mœurs du capitalisme. Elle a, elle aussi, ses lancements sensationnels et souvent malpropres, et la fortune dore le blason de ses boutiquiers. Formidable est la production imprimée qui entretient la prospérité sur ses marchés. Du livre au périodique et aux journaux foisonnent les publications où s’alimente, beaucoup plus que l’élite cultivée et les gens désireux d’accroître intelligemment leurs connaissances, la démocratie nourrie du faux savoir de l’instruction populaire. Aliment, en général d’ailleurs, de nature à fourvoyer les esprits plus qu’à les libérer et davantage apparenté au ragot scandaleux qu’à la littérature ; mais c’est à son « rapport » que se jaugent aussi les qualités de la « marchandise » imprimée...
Comme on l’a entrevu au mot lettre, comme on le reverra à littérature, livre, etc., depuis longtemps il est autrement lucratif de faire commerce des ouvrages de l’esprit que de pâtir de longues veilles pour en accoucher. Et Voltaire déjà pouvait dire :
« Les libraires hollandais gagnent un million par an parce que les Français ont de l’esprit. »
Et Etienne :
Après les procureurs, j’ai connu les libraires !
Depuis des siècles, en définitive, les écrivains ont été aux gages des libraires. Avec la position de la librairie moderne, cette sujétion n’a fait que s’accentuer (depuis quelques décades on voit des auteurs payer les éditeurs pour qu’ils daignent tenter profit avec leur effort en jetant leurs œuvres dans la circulation). Les plus beaux fruits de la réussite vont aux trafiquants du papier noirci (voir Lettres). Et cela est dans la logique de l’économie immorale de notre temps qui veut que ceux qui font métier d’intermédiaires monnaient la sueur de ceux qui peinent sur la production.
Des libraires ont été, à diverses époques, d’audacieux serviteurs de la pensée et ont subi de ce fait des persécutions. Certains ont apporté aussi jusqu’à des temps proches de nous un amour éclairé des travaux dignes d’affronter la curiosité publique. Tels les Poulet-Malassis ou les Reinwald, ils furent assez souvent des lettrés et des savants et leur discernement a plus d’une fois sauvé de l’obscurité des œuvres valeureuses. Mais plus que jamais le négoce envahit la carrière et, avant les ouvrages qui méritent, sont patronnées, par les hommes d’affaires de la librairie, les médiocrités qui rapportent : « Le libraire est trop souvent l’exploiteur de l’homme de lettres. A un excellent livre d’un auteur sans réputation, le libraire, marchand avant tout, préfère un mauvais livre d’un auteur célèbre ». Incapable d’ailleurs, trop souvent, d’apprécier de nos jours les vertus d’une œuvre inconnue, il trouve plus pratique de se confier au tapage prometteur de l’opinion. Son ignorance et son escarcelle y trouvent leur satisfaction.
LIBRE ARBITRE
Par libre arbitre s’entend la liberté du vouloir, c’est-à-dire la décision entre deux possibilités opposées appartenant exclusivement à la volonté de l’individu, sans que, pour rien, puissent influencer sur cette décision la pression du milieu extérieur et la lutte intérieure des divers motifs et mobiles. Malebranche (De la recherche de la vérité, 1712, I, p, 1), définit le libre arbitre : la puissance de vouloir ou de ne pas vouloir, ou bien de vouloir le contraire.
Et Bossuet (Traité du libre arbitre, 1872, C. II) : plus je recherche en moi-même la raison qui me détermine, plus je sens que je n’en ai aucune autre que ma seule volonté ; je sens par là clairement ma liberté, qui consiste uniquement dans un tel choix.
Pour ceux qui admettent le libre arbitre comme possibilité concrète, et ceux qui l’admettent seulement comme possibilité abstraite, c’est-à-dire entre indéterministes et déterministes, la lutte est séculaire. Kant a rompu la traditionnelle conception du libre arbitre (spontanéité absolue, liberté d’indifférence, exception au principe de causalité) en le présentant comme autonomie de la raison de laquelle la volonté dépend. Pour Kant l’autonomie du vouloir est : « cette propriété du vouloir pour lequel il est une loi à lui-même », (Krit. d. Prollt. Vern., 1878, I. S. 8 ; Grundl. Z. Met d. sitt. 1882, p. 67).
Pour l’Ardigò, l’autonomie est spécialisation et indétermination d’action qui rentre dans la loi Universelle de la causalité. L’autonomie du végétal est la vie ; celle de la brute, le cerceau ; de l’homme, l’idée, autonomie maximum, formation naturelle plus complexe qui se superpose aux formations inférieures en les dominant. L’autonomie est libre arbitre : arbitre, en tant que forme spéciale d’activité qu’elle possède en elle-même la raison d’être et qui domine les inférieures ; liberté parce qu’elle n’est pas l’unique possibilité de l’hétéronomie, mais elle est un nombre indéterminé de possibilité (La morale dei positivisti, 1892, pp. 118 et suiv.).
Pour Bergson (Essais sur les données imm. de la conscience, 1904, p. 167), la liberté est le même pouvoir par où le fond individuel et inexprimable de l’être se manifeste et se crée dans ses propres actes, pouvoirs desquels nous avons la conscience comme d’une réalité immédiatement sentie. S’appelle liberté le rapport du moi concret avec l’acte qu’il accomplit et ce rapport est indéfinissable précisément parce que nous sommes libres.
Le déterminisme volontaire, qui n’est qu’une espèce du déterminisme universel, énonce que toutes les actions de l’homme sont déterminées par ses états inférieurs. Les actes volontaires sont déterminés par le pouvoir impulsif et inhibitoire des représentations : le choix dépend de la représentation qui possède une plus grande impulsion. Si l’on pouvait connaître — écrivit Kant — toutes les impulsions qui meuvent la volonté d’un homme et prévoir toutes les occasions extérieures qui agiront sur lui, on pourrait calculer la conduite future de cet homme avec la même exactitude que celle avec laquelle on calcule une éclipse solaire ou lunaire.
Il y a diverses formes de déterminisme volontaire : le théologique, l’intellectuel, le sensitif, l’idéaliste.
Selon le déterminisme volontaire théologique nos actions sont un produit de l’action divine, de la prédestination, de la grâce, de la providence. Le prédéterminisme théologique se concilie avec la théorie catholique du libre arbitre dans la doctrine de la science moyenne, doctrine avec laquelle Molinos (et les jésuites en général) soutient que Dieu connaît ce qui est actuel et possible, mais qu’il y a aussi ce qui est conditionnellement possible, c’est-à-dire ce qui est entre la pure possibilité et l’actualité. La connaissance divine de cette troisième catégorie de faits est science moyenne ou conditionnelle. Dieu a prévu les actions humaines de cette troisième espèce (conditionnellement possibles) : malgré cela elles sont libres.
Le déterminisme volontaire intellectuel, dit aussi psychologique, remet l’action déterminative dans l’intelligence, faisant de tout acte la conséquence pure d’un jugement, cependant que le déterminisme sensitif ou sensuel fait des sensations l’unique cause nécessaire des actes, et que le déterminisme idéaliste considère l’idée en soi, absolue, comme la déterminante des actes humains, sans aucun lien avec la réalité matérielle.
Il ne faut pas confondre le déterminisme avec le fatalisme. Ici les événements sont prédéterminés ab œterno d’une manière nécessaire par un agent extérieur, pendant que là la nécessité est immanente et se confond avec la nature même.
— C. BERNERI
LIBRE ARBITRE
De l’examen des croyances et des religions passées et présentes il est facile de dégager que le problème du Libre Arbitre est un de ceux qui furent réellement situés dans leur vrai sens, avec ses deux aspects subjectif et objectif, depuis la plus haute antiquité, par tous ceux qui cherchèrent à s’expliquer le fonctionnement humain. L’homme s’interrogeant constata le libre jeu de sa volonté, le commencement absolu de ses décisions, sa liberté de choix. Mais, d’autre part, il vit qu’objectivement tout était déterminé dans la nature par des causalités inéluctables imposant aux humains des nécessités, des conditions de vie déterminant cette volonté. De là cette antinomie irréductible entre l’affirmation de la liberté de l’âme et les commandements quels qu’ils soient limitant et par conséquent détruisant, cette liberté. De là ce dualisme insoluble entre la liberté de l’être sans cesse affirmée, et toutes les nécessités extérieures, y compris Dieu, heurtant et modifiant la volonté individuelle. Mais si tous les penseurs ont nettement compris les deux aspects de la question et leurs caractères contradictoires on peut dire que tous ont échoué dans leurs tentatives de conciliation de ces deux aspects.
Quelle est la cause de cette impuissance ? Elle paraît résider uniquement dans l’emploi de la méthode subjective, la seule usitée jusqu’ici pour étudier la volonté et le choix. Or, la seule investigation possible de nous-mêmes ne s’effectue qu’à l’aide de la conscience, et cette conscience ne paraît être que la faculté de connaître nos pensées et nos vouloirs mais nullement de les former. La conscience ne précède pas les volitions, pas plus que la forme d’un triangle ne précède la formation du triangle ; elle n’apparaît qu’avec chaque manifestation psychique et n’indique qu’un état de fait. Elle n’est qu’un résultat du fonctionnement physiologique mais ne nous renseigne en rien sur ce fonctionnement lui-même et nous n’avons aucune connaissance subjective du jeu même de nos cellules. La conscience n’apparaît que comme une lumière éclairant notre personnalité intérieure formée d’innombrables souvenirs, de désirs, de besoins physiologiques, de tendances, d’aspirations multiples, etc. Jamais l’analyse subjective ne nous révèlera l’origine des vouloirs parce qu’en dernière analyse nous ne trouvons plus d’autres motifs déterminants qu’une pure faculté de choix, déterminée par une soi-disant pure raison soustraite à toutes influences extérieures connues directement par la conscience. C’est à cette ignorance des causes physiologiques déterminant nos vouloirs qu’est dû le concept du libre arbitre.
De nombreux psychologues modernes ont essayé de rajeunir le concept de la liberté et du libre arbitre, entres autres William James, Pierre Janet, Fouillée, Bergson.
Pour William James la conscience n’est pas impuissante, elle est créatrice ; car, tandis que l’acte réflexe et instinctif est inconscient, l’acte volontaire n’est accompli qu’après une représentation consciente de cet acte et un jugement décidant de sa convenance au but recherché.
Pierre Janet, après de longues expériences sur les diverses altérations de la personnalité, conclut à la liberté de l’homme par le fait que, si les mouvements sont déterminés par des images sensorielles, l’acte volontaire, et principalement l’acte génial, n’est ni donné, ni contenu dans les sensations reçues ; que le jugement est quelque chose d’absolument nouveau, une création, un phénomène mécanique (sensations) et que par rapport à eux il est indéterminé et libre. Il n’y a rien de plus libre, dit-il, que ce qui est imprévisible et incompréhensible pour nous.
Fouillée, plutôt adversaire du libre arbitre, ne conclut point pour la liberté, mais introduit dans le déterminisme humain l’influence de l’idée de liberté ; car, dit-il, les idées sont des forces et l’idée de liberté est une idée force nous orientant vers la liberté idéale
Enfin Bergson pense que les causalités extérieures se produisant dans un milieu homogène peuvent se reproduire et se formuler par une loi, tandis que les faits psychiques ne se présentant qu’une fois à la conscience et ne reparaissant plus, échappent aux phénomènes de causalités.
Toutes ces raisons prennent leur source dans la métaphysique mais non dans l’observation des faits. En effet, tout jugement quel qu’il soit ne peut établir un rapport de convenance qu’après expérience ; et le rapport des choses entre elles, qui n’est que l’ordre logique des faits, ou enchaînement de causalités est tout ce qu’il y a de plus déterminé. S’il n’en était ainsi, rien ne serait intelligible dans l’univers et les plus profonds penseurs devraient s’abstenir d’écrire et de penser puisque cela n’aurait aucun sens pour autrui. L’observation nous montre que l’objectif précède le subjectif ; que l’enfant ignore tout des causalités extérieures ; qu’il apprend lentement le fonctionnement universel et que son jugement est l’expression même de sa compréhension du déterminisme objectif. En fait rien n’est plus éloigné du caprice, de l’incertain, de la fantaisie, du bon plaisir, de l’imprévu qu’un raisonnement rigoureux, un jugement bien établi ; telles les démonstrations géométriques.
L’imprévisibilité, pas plus que la variabilité ne détruisent le déterminisme humain ; elles ne font que révéler notre ignorance. Aucun mathématicien de génie ne peut prévoir à l’avance le parcours apparemment capricieux de la foudre. D’autre part la variation individuelle démontre l’instabilité du moi et le déterminisme inévitable des humains les acheminant inexorablement vers la mort, malgré leur désir de vie. D’ailleurs l’évolution du moi, depuis l’enfance jusqu’à l’extrême vieillesse, s’effectue suivant des normes rendant possibles une vie sociale et une certaine prévision de l’activité humaine, base de toutes sociétés,
En réalité un être ne pourrait être libre qu’à la condition qu’aucune cause passée, présente ou future ne le modifie en rien ; que son moi soit en dehors de toutes influences, pressions, contraintes, menaces, promesses ou déterminations de quelque nature que ce soit. Ce concept métaphysique est en contradiction avec toutes les données de l’expérience. Que la prévision exacte des pensées et gestes d’un humain soit impossible cela n’enlève rien au déterminisme de ses actes c’est-à-dire qu’il agit toujours en vertu d’un motif, lequel est inclus dans tous les phénomènes biologiques, lesquels, à leur tour, sont déterminés par de multiples lois mécaniques que le savoir humain essaie de découvrir tous les jours.
La méthode objective basée sur l’examen de la vie même et sur d’innombrables expériences démontre la détermination rigoureuse des phénomènes vitaux. Parmi les multiples études effectuées dans ce domaine la phylogénie, l’autogénie, la biologie et la pathologie éclairent suffisamment les faits pour en comprendre le développement. La phylogénie étudie l’évolution progressive des êtres depuis les formes les plus imparfaites se confondant presque avec le règne minéral, jusqu’aux derniers mammifères et constate les déterminations physico-chimiques (tropisme) des premiers ; l’évolution progressive et prodigieuse des organismes et des organes, surtout du système nerveux, parallèlement au développement de l’intelligence et la complication des actes volontaires. L’autogénie suit l’être depuis l’œuf fécondé jusqu’à son complet épanouissement. Là aussi il est facile de constater que la physicochimie détermine les premières manifestations vitales, presque identiques chez tous les animaux, surtout les vertébrés. Dans l’espèce humaine le nouveau-né et le jeune enfant démontrent par leur vie animale, réflexe et instinctive l’absence des vouloirs raisonnés et conscients. Le moi se forme lentement sous l’influence des phénomènes extérieurs, enrichissant la mémoire de faits perçus dans l’espace et dans le temps. La biologie nous montre le phénomène vital étroitement lié à la physicochimie, obéissant à des lois d’accroissement, d’assimilation, d’élimination, d’équilibre, d’imitation, d’habitude, d’hérédité, d’éducation, etc. L’être vivant paraît être un accumulateur et un transformateur chimique d’énergie puisqu’il est entièrement formé de substance et d’énergie qu’il conquiert dans le milieu. La vie ne peut se passer d’oxygène, de carbone, d’azote, etc., et la physiologie agrandit chaque jour ses investigations sur le fonctionnement physiologique des organes. Mais c’est surtout la pathologie mentale qui révèle quelques-uns des secrets de notre moi. Les maladies de la mémoire, de la volonté, de la personnalité observées par de nombreux psychiatres démontrent le rôle secondaire de la conscience. Les malades suggestionnés pendant leur sommeil somnambulique croient faire à leur réveil ce qu’ils veulent consciemment et n’ont aucune connaissance de l’origine réelle et objective de leurs volitions, ni de la multiplicité de leur moi. La volonté est impuissante devant la perte progressive de la mémoire, les changements, les désagrégations de la personnalité et cela démontre suffisamment l’erreur du libre arbitre,
Même pour un être sain, il est absolument impossible de penser et d’improviser un discours de mille mots et de vouloir ensuite le répéter textuellement sans se tromper. Une volonté qui ne peut vouloir cela n’est point omnipotente et ne fait point ce qu’elle veut.
La volonté n’apparaît donc point comme un principe unique dirigeant l’individu mais plutôt comme une synthèse de toute son activité cérébrale physiologique, et la conscience comme la connaissance de certains seulement de ces processus mentaux.
Les conséquences sociales de l’absence du libre arbitre sont considérables et permettent tous les espoirs en justifiant les efforts de tous ceux qui œuvrent pour l’amélioration des humains. Comment en effet concevoir une transformation individuelle et sociale si les processus de causalités sont inapplicables aux hommes ? Si leurs gestes, leurs actions sont indéterminés, imprévisibles ? Non seulement le libre arbitre détruit les possibilités de déterminations, de modification et d’amélioration mais encore il détruit toute coordination, entente, convention, et partant toutes sociétés, puisqu’il n’y a plus de nécessités, ni de causes déterminant obligatoirement les hommes selon un ordre logique des faits s’enchaînant dans l’espace et dans le temps. Le libre arbitre supprime également toute responsabilité et l’utilité de toute critique, de tout effort éducatif, car toute critique n’est formulée que pour influencer et modifier autrui ; ce qui a un caractère nettement déterministe. Critiquer serait d’ailleurs une contradiction, car on ne peut vouloir déterminer quelqu’un et affirmer qu’il est indéterminé.
L’étude de la vie permet d’ignorer ces contradictions métaphysiques. Les hommes étant déterminés nous pouvons construire une meilleure société en réalisant les conditions nécessaires à son avènement. La vie ne se manifeste point dans l’incohérence, mais elle n’est possible qu’en accord avec les phénomènes objectifs et elle dépend comme eux de l’ordre et de la succession des choses dans l’univers. Savoir comment on est déterminé c’est mettre en soi un grand nombre d’éléments de détermination, lesquels s’équilibreront avec les lois naturelles et les nécessités objectives, en nous permettant de vivre et de durer.
Quant à la responsabilité elle ne peut s’entendre que comme recherche et évaluation des causes déterminantes possédées par l’homme, non pour le récompenser ou le punir, mais pour situer exactement sa valeur sociale et préciser les modifications subjectives à effectuer pour améliorer le présent et l’avenir. Etablir les responsabilités ce n’est donc pas reprocher un acte à quelqu’un, c’est reconnaître simplement quelles ont été les causes qui l’ont déterminé à agir, de manière à faire entrer l’expérience passée dans le déterminisme à venir, ce qui doit le modifier dans le sens d’une meilleure adaptation et de son intérêt vital.
Quant aux erreurs et méfaits occasionnés par l’individu, le milieu social en est entièrement responsable puisqu’il a précédé et formé cet individu. On ne saurait donc lui reprocher d’être ce qu’il est. Tout au plus doit-on chercher à le modifier dans un sens fraternel et harmonieux.
Remarquons enfin que suivre son bon plaisir ou suivre aveuglément son déterminisme signifie exactement la même chose, puisque le bon plaisir est lui-même déterminé par l’hérédité et l’éducation. C’est pourquoi la réalisation de l’harmonie individuelle et sociale ne peut aucunement se baser sur la fantaisie libre arbitriste, ou le déterminisme du dément, mais sur les lois biologiques déterminant cette harmonie, lesquelles ne peuvent être établies que par la raison basée sur l’expérience et l’observation.
— IXIGREC
LIBRE ARBITRE
Le problème du libre arbitre (ou de franc arbitre) est l’un des plus importants dans le domaine des sciences humanitaires : de la philosophie générale, de la métaphysique, de la morale, de là jurisprudence, de la psychologie, de la sociologie. Il est, en outre, étroitement lié aux problèmes de la croyance et de la religion. Il joue, enfin, un assez grand rôle dans certaines manifestations de la vie de tous les jours : action éducatrice, réaction contre la criminalité, activité sociale, etc.
A certains points de vue, son importance est capitale. On pourrait dire qu’il se trouve au centre ou, au moins, au carrefour décisif de tous les problèmes ayant trait à l’existence, à l’évolution ou à l’activité humaines. Il n’est pas ici une seule question plus ou moins considérable et vaste qui ne dépende, dans telle ou telle mesure, de la solution — intime et instinctive ou théorique et motivée — de celle du libre arbitre.
Cependant, c’est un des problèmes les plus obscurs, les plus difficiles, compliqués, embrouillés. On est loin d’avoir trouvé sa solution définitive. Pis encore : son interprétation même, la façon de la formuler ne sont point nettes ni uniformes.
Ne pouvant pas nous occuper, dans un bref article de dictionnaire, de tous les aspects de la question en détail, — ce qui exigerait un ouvrage spécial -, nous nous bornerons à exposer ici l’essentiel de la controverse, en tenant compte de la perspective historique.
Dans sa forme primitive, élémentaire, brutale, le problème du libre arbitre se pose comme suit :
L’homme a la sensation intime de pouvoir opter librement pour telle ou telle action, prendre tel parti plutôt que tel autre. Il a la conscience immédiate du libre choix. Sa volonté parait être indépendante dans ses fonctions ; elle semble avoir la puissance de choisir, de se déterminer, d’être juge suprême des actes de son porteur. (Ce ne sont que les passions violentes et les actes inconscients qui lui échapperaient).
S’il en est ainsi, si cette liberté de la volonté n’est pas une simple illusion, alors les actes humains ne sont nullement déterminés à l’avance, c’est-à dire, ils se trouvent en dehors de toute causalité.
Mais, d’autre part, l’homme, avec sa volonté et ses actes, est soumis aux lois générales de la nature, à la causalité universelle ainsi qu’aux conditions, aux lois et aux influences de son hérédité, de sa constitution anatomique et physiologique, de l’ambiance sociale, du milieu, de l’entourage, du passé historique, du niveau de culture, etc., etc... qui, dans leur ensemble, déterminent en dernier lieu et à l’avance, le caractère, le tempérament, toute la psychologie et, par conséquent, le fonctionnement de la volonté et les actes mêmes de tout être humain. Nul ne pourrait y échapper. Nul ne pourrait se placer, ou placer sa volonté en marge de toutes ces déterminantes, de la causalité naturelle générale qui ne peut pas être rompue.
S’il en est ainsi, alors la liberté de notre volonté n’est qu’une illusion explicable par l’ignorance de toutes les causes qui mènent nécessairement, fatalement à tel ou tel acte de volonté. Dans ce cas, toute décision, toute action humaines seraient absolument déterminées à l’avance par une suite de causes étroitement enchaînées, irrésistibles, et le libre arbitre n’existerait pas.
Si la pensée humaine s’en tenait opiniâtrement, dans cette controverse brutale, à l’un de ces deux pôles extrêmes du problème : arbitre libre (ou indéterminisme) absolu — ou bien déterminisme absolu, alors le problème serait insoluble.
En effet :
-
L’argumentation détaillée de chacune des deux thèses paraît à peu près également solide. Ici et là, on trouve des arguments irréfutables ;
-
En se tenant aux extrémités, les deux thèses s’excluent mutuellement, sont irréconciliables ;
-
L’adoption intégrale de l’une d’elles mène, cependant, à une absurdité éclatante.
Cette situation des choses prédispose déjà elle-même à l’abandon des extrémités et à la recherche de leur réconciliation possible devant se rapprocher plus ou moins de la réalité, de la vérité.
Comment donc ce problème fut-il traité à travers les siècles ? Quelle est sa situation actuelle ?
Remarquons, tout d’abord, qu’il fut l’objet des études approfondies d’un très grand nombre de penseurs et d’érudits dans toutes les branches des sciences humanitaires et de l’activité humaines. Cela se comprend aisément. Il est facile de voir, en effet, que là solution d’une quantité de questions, non seulement purement philosophiques, mais aussi psychologiques, morales, juridiques, pédagogiques, sociales et autres, — questions ayant souvent une importance pratique immédiate -, dépend de la solution du problème traité. Habituellement, on ne s’en rend pas compte, car on s’intéresse peu, dans la vie quotidienne, aux sciences ou à la pensée philosophique. On se contente d’avoir la conscience intuitive de pouvoir, vouloir et choisir librement (à part les cas d’irresponsabilité), et on s’y base. Et puis, il est bien connu qu’on a l’habitude d’accepter docilement, sans réfléchir, de façon trop simpliste, les faits, institutions, coutumes, lois, tels qu’ils se présentent. Mais aussitôt qu’on se donne la peine de regarder les choses de plus près, de les approfondir quelque peu, on voit bien que telle ou telle question est beaucoup plus compliquée, et que sa solution véritable gît dans celle du problème d’arbitre libre.
Si, par exemple, tous mes actes étaient absolument prédéterminés par des forces et motifs se trouvant en dehors de moi-même, si ma liberté de choix n’était qu’une illusion, alors ma responsabilité morale, juridique, sociale, tomberait à zéro ; car je ne serais au fond, dans ce cas, qu’un instrument aveugle des éléments que je ne pourrais même pas connaître
Si, au contraire, ma volonté avait la puissance absolue de s’élever au-dessus de toute causalité, si mon choix était absolument libre, alors ma responsabilité personnelle serait aussi absolue, entière, illimitée.
Si, enfin, ma volonté était relativement et partiellement indépendante ; si mes actes n’étaient prédéterminés qu’en partie ; si mon choix était, ne serait-ce que relativement libre, dans ce cas ma volonté, mon choix, tout mon « moi » et ma responsabilité personnelle seraient engagés aussi partiellement, relativement : notamment, dans la mesure de ma liberté de vouloir, de choisir, d’agir. Il faudrait donc, dans ce cas, analyser et établir, autant que possible, cette mesure : la proportion de ma responsabilité réelle.
On voit ainsi que l’un des problèmes les plus graves de la vie sociale de l’homme, celui de sa responsabilité morale ou autre envers ses semblables, est étroitement lié au problème de l’arbitre libre. On voit aussi que la solution plus ou moins juste du problème de la responsabilité est extrêmement délicate et compliquée sinon impossible.
Le problème de l’efficacité de l’éducation, par exemple, ainsi que le choix des méthodes éducatives, dépendent beaucoup de la façon de concevoir la question du libre arbitre.
Il en est de même avec plusieurs autres problèmes. Les philosophes les plus anciens connaissaient déjà la controverse traitée et s’en occupaient. Nous trouvons surtout son analyse assez approfondie, bien qu’un peu naïve, chez plusieurs philosophes de l’antiquité, tels que : Socrate (468–400 av. J.-C.), Platon (429–347 av. J.-C.), Aristote (384–322 av. J.-C.), Epicure (341·270 av. J.-c.), Carnéade (219–126 av. J.-C.). Les penseurs antiques penchaient vers la reconnaissance du libre arbitre absolu. L’idée de la causalité naturelle, telle que nous la concevons aujourd’hui, leur était encore étrangère et ne les gênait pas beaucoup.
La philosophie scolastique du Moyen-âge s’occupe aussi du problème. En conformité avec le caractère général de l’époque, elle se confond avec la pensée religieuse. Car la religion, de même que plus tard la science laïque, s’est trouvée en face des contradictions et difficultés logiques analogues, avec cette différence qu’il s’agissait pour elle non pas de la prédétermination naturelle, mais de la prédestination et de la prescience de Dieu. En effet, si le libre arbitre existe, que reste-t-il de la prédestination divine ? Si, au contraire, le libre arbitre n’existe pas et que tout est prédestiné, comment expliquer alors 1’apparition du mal, puisque Dieu est bon, et le monde l’œuvre de sa bonté infinie ? La pensée théologique moyenâgeuse et postérieure (Erigène, env. 830–880 ; Abélard, 1079–1142) ; Thomas d’Aquin, 1226–1274 ; Bacon, 1214–1294 ; Bossuet, 1627–1704, et autres) déploya pas mal d’énergie pour atténuer la contradiction flagrante et trouver un élément de réconciliation entre les deux points extrêmes. Cet élément fut trouvé tant bien que mal. Il constitue un des dogmes fondamentaux de la théologie chrétienne, en vigueur jusqu’à nos jours. La prédestination existe. Mais le libre arbitre existe aussi, le bon Dieu ayant doté l’homme d’une liberté relative de volonté, de choix et d’action, sous condition toutefois d’obéissance à certains préceptes du Père-Créateur. Or, l’homme désobéit, c’est-à-dire, son libre arbitre, qui ne devait se mouvoir que dans le sens du bien, se détacha de l’élément divin ; la possibilité du mal, l’apparition du mal en fut le résultat. Cette formule donnait, il est vrai, aux dominateurs de tous temps et de toute marque, religieux ou non, la faculté de persécuter, de torturer, d’exterminer les hérétiques et les « mauvais sujets », détachés de Dieu et du bien, engagés irrévocablement sur le chemin du mal. Mais déjà Bossuet dut avouer dans son « Traité du libre arbitre » qu’on n’aperçoit pas bien le lien qui doit unir les deux bouts désunis : la prédestination divine et la liberté humaine.
En ce qui concerne la pensée et la science laïques dans leur essor des temps nouveaux, leurs représentants — les philosophes et les savants des siècles derniers — se divisèrent, tout d’abord, et pour une assez longue durée, en deux camps diamétralement opposés : celui des partisans du libre arbitre ou « indéterministes », et celui des « déterministes » irréconciliables. Mais avec le développement des sciences et l’accumulation de l’expérience, le problème du libre arbitre abandonna les hauteurs de la pure philosophie spéculative. Il devint l’objet des études très variées et plus concrètes des psychologues, des moralistes, des juristes, etc. Les résultats obtenus, les données acquises permirent, depuis quelques dizaines d’années déjà, de rechercher la conciliation possible des deux thèses opposées. Ces recherches aboutirent à des conclusions intéressantes.
Généralement, il est admis par la science moderne que :
-
l’homme comme tel, avec sa volonté, avec son « caractère », avec sa personnalité tout entière, est un chaînon autonome dans la chaîne causale aboutissant à tel ou tel autre acte humain ;
-
bien que la personnalité humaine, qui devient ainsi l’une des déterminantes libres de l’action, soit elle-même déterminée par de nombreuses influences, — la personnalité, c’est précisément l’homme lui-même — ; il ne peut, évidemment, s’agir que de sa dépendance (ou indépendance) de quelque chose d’autre que lui-même ; il serait un non-sens, de s’occuper de son indépendance de lui-même ; donc, si l’homme est un chaînon autonome dans la suite des motifs déterminant l’acte, alors son sentiment de liberté n’est nullement une illusion.
On admet donc, de cette façon l’existence d’une causalité psychique spécifique qui introduit dans la chaîne des causes générales un anneau « sui generis », un facteur indépendant, dans une certaine mesure.
Mais cette constatation est encore loin de pouvoir éliminer toutes les difficultés du problème et amener sa solution définitive. On pourrait, en effet, y faire cette objection : l’homme ne saurait être effectivement libre que s’il avait la puissance de surmonter, de rompre, quant à son existence ici-bas, au moins dans une certaine mesure, la fatalité, la causalité psychique elle-même, déterminée, elle, par des forces et facteurs en dehors de sa volonté. Cette dernière n’est, non plus, qu’un produit de ces forces fatales, bien que l’homme ne s’en aperçoive pas. En réalité, il n’est donc pas libre. Sa liberté n’est, au fond, qu’une illusion, car il ne crée pas sa volonté, et sa volonté ne crée rien. En admettant même la causalité psychique autonome (ce qui n’est pas encore absolument démontré ni accepté par tous), on ne saurait considérer l’homme comme effectivement libre qu’à condition qu’il puisse créer de nouvelles valeurs psychiques qui l’auraient élevé au-dessus de ses qualités fatales. Ce n’est qu’alors qu’on pourrait vraiment parler de son libre arbitre et de sa responsabilité, Or, cette puissance créatrice, est-elle possible chez l’homme ?
C’est ainsi que l’on s’approche d’un nouveau problème, infiniment intéressant et d’une importance vraiment primordiale pour toutes les questions concernant l’homme. C’est le problème de la création, de la capacité créatrice chez l’homme, de l’énergie créatrice en général, de son essence et de son rôle dans l’évolution générale et humaine.
C’est là la véritable clef de toute la question.
Or, c’est un problème qui, non seulement n’est pas encore résolu, mais n’est même pas encore dûment posé scientifiquement.
Ainsi surgit une nouvelle difficulté théorique considérable, sans parler d’une quantité de difficultés pratiques déjà signalées : celle, par exemple, d’établir la proportion exacte où l’homme pourrait porter une juste responsabilité vis-à-vis de ses semblables.
En tout cas, l’aspect théorique moderne du problème du libre arbitre n’est plus ni religieux, ni celui, purement métaphysique, de savoir si c’est le libre arbitre absolu ou la prédétermination absolue qui dirige la conduite des hommes ; c’est bien celui, plus scientifique, d’établir en quel sens et dans quelle mesure les actes humains peuvent être reconnus libres malgré l’existence d’une certaine causalité fatale par rapport à sa conduite.
Et quant à la vie pratique (qui, souvent, devance les recherches et les résultats théoriques), elle se meut, depuis assez longtemps déjà, dans le même sens que celui pris actuellement par le problème abstrait du libre arbitre. Dans le domaine de la vie normale ainsi que dans celui du droit ou de l’éducation, on s’efforce de trouver la mesure dans laquelle la volonté, la responsabilité, l’influence de l’homme seraient engagées.
Naturellement, tous ces efforts, rendus difficiles par l’état actuel, toujours assez primitif, des sciences humanitaires, enrayés et défigurés, de plus, par la monstrueuse organisation sociale moderne, sont aujourd’hui encore maladroits, peu efficaces, parfois déplacés. Mais en comparaison avec les siècles lointains, c’est au progrès. Le chemin est bon. Il ne reste qu’à le déblayer de toutes sortes d’obstacles et à le poursuivre activement.
Remarquons pour conclure que la voie sur laquelle le problème du libre arbitre semble s’engager actuellement et définitivement, nous parait être, non seulement la voie juste, menant vers le résultat définitif, mais aussi celle qui doit intéresser tout particulièrement les anarchistes. Car ce sont eux qui s’intéressent le plus aux questions de l’énergie créatrice. C’est précisément, la notion de la puissance créatrice de l’homme : des masses, des groupements, des individus, qui se trouve au centre de leur conception, qui en est l’âme même. Et c’est, peut-être, à la pensée anarchiste qu’appartiendra un jour le mérite d’avoir éclairé le mystère et trouvé ainsi la clef de tant de problèmes passionnants.
— VOLINE
NOTA
-
La littérature se rapportant au problème du libre arbitre est, depuis plus d’un siècle, tellement abondante et, surtout, dispersée à travers toutes les branches des sciences humanitaires, qu’il est impossible de la désigner ici utilement. Celui qui voudrait élargir et approfondir ses connaissances dans ce domaine, n’aurait qu’à consulter les divers traités de philosophie, de physiologie, ainsi que plusieurs œuvres de moralistes, de juristes, etc... se rapportant au sujet traité ;
-
Voir aussi les mots : Déterminisme, Fatalisme, Liberté, Volonté, et les ouvrages qui y sont désignés.
LIBRE-ECHANGE
Pour définir le libre-échange on ne peut mieux faire que se référer aux paroles que prononçait à la Conférence internationale de Londres, en 1920, le président de la Ligue qui s’est vouée à sa propagation. Yves Guyot disait alors :
« Qu’est-ce que le libre-échange ? C’est la non-intervention de l’Etat dans les contrats d’échange, à l’intérieur et à l’extérieur, entre particuliers : c’est la liberté et la sécurité des contrats privés.
Qu’est-ce que le protectionnisme ? C’est la substitution, dans la direction des échanges, de la volonté des gouvernants à la volonté des particuliers. L’impérialisme économique est le protectionnisme agressif. »
Après ces précisions, notre choix pourrait-il rester un instant douteux ? Devons-nous tolérer les restrictions que le protectionnisme prétend imposer à la liberté des contractants, les entraves que mettent les Etats à la circulation des produits ? Que sert de parquer ces paisibles brebis qui circulent à leur guise, se répartissant fraternellement le pâturage ? Renversons bien vite ces barrières. Aussitôt, grande liesse au camp des loups. Les rétablir ? C’est donner toutes facilités au maître pour tondre le troupeau ou le conduire à l’abattoir. Or loups et bouchers foisonnent dans notre société. Avant de nous prononcer, il convient donc d’y regarder de près.
Nous n’avons pas à envisager ici les transactions bénévoles, manifestations de générosité, non susceptibles de mesure, mais les échanges effectués sur les marchés nationaux et internationaux dans lesquels entre en jeu l’équivalence des services échangés ou des matières qui les représentent (nous n’insisterons pas sur la notion de valeur ; l’adjonction du terme « service » est d’ailleurs une indication du sens que nous lui attribuons). De plus nous resterons dans le plan de la société actuelle, les remarques que nous ferons ayant simplement pour but de mettre en lumière des principes applicables à une société plus parfaite. Examinons donc les arguments que l’on peut apporter pour ou contre ce que les économistes appellent la liberté des échanges, pour ou contre le laisser-faire, laissez-passer.
La jouissance de la liberté dépend, à la fois, de la position relative des échangeurs et de la possibilité d’établir des rapports exacts entre la nature et la quantité des marchandises livrées. Sur les marchés mondiaux, les échangeurs sont-ils placés sur un pied d’égalité, toute contrainte ouverte ou masquée est-elle éliminée, aucune méprise n’est-elle possible sur la valeur incorporée aux denrées offertes ? Non certes ! D’abord, les nations, pas plus que les individus, ne sont d’égale force. Si l’on a pu (bien à tort d’ailleurs) alléguer que la loi des grands nombres établissait un certain équilibre entre les prétentions d’une multitude d’individus, l’assertion est manifestement inexacte lorsqu’il s’agit des nations. Leur nombre est limité, leur superficie très inégale et, eu égard à la complexité de la vie moderne, peu d’entre elles peuvent se suffire à elles-mêmes. Tandis que grâce à l’étendue, aux contrastes et aux ressources de leurs domaines, certaines peuvent, à la rigueur, s’enfermer dans leurs frontières, la majorité est dans la dépendance des plus favorisées. Sans doute elles peuvent constituer une union douanière assez vaste pour se libérer de l’emprise des monopoles. Mais s’engager dans cette voie c’est se résigner à une phase préalable de restriction des échanges, circonscrits au sein de trois ou quatre grands groupements, vivant à l’écart les uns des autres, bientôt hostiles — Etats-Unis d’Europe contre Etats-Unis d’Amérique. Le défaut d’équilibre entre les Etats est un empêchement à la liberté des échanges.
Considérons la valeur des objets échangés, La plupart d’entre eux ont employé, au cours de leur fabrication, à la fois du travail humain et de l’énergie issue des forces naturelles et cela dans des proportions dépendant des climats, de la configuration du sol, de sa richesse en matières premières et en puissance motrice. Si le producteur étranger ne prétendait qu’à la rémunération de sa propre peine, sans faire état d’un travail qu’il n’a pas fourni, la justice serait aisément satisfaite ; la cession gratuite de ce que la nature a donné gratuitement compenserait l’infériorité de celui que le sort a desservi et les services étant simplement payés de services égaux, l’échange serait effectivement libre. Mais les choses ne se passent pas ainsi. Le spéculateur, abusant de ses avantages, cherche à tirer de sa marchandise le profit maximum. Il réclame de son partenaire un prix aussi proche qu’il se peut du prix de revient au lieu d’importation, retenu seulement par deux considérations : ne pas décourager l’acheteur éventuel, ne pas constituer de stocks trop importants qui déprécieraient son avoir dans son propre pays. En un mot, en abusant de facilités de production dont il n’est pas l’auteur, le trafiquant étranger, contre ce qui représente deux unités de travail, en exigera trois ou davantage au lieu de livraison.
Un pays d’antique civilisation produit, par exemple, du blé à 120 fr. l’hectolitre, tandis qu’un pays neuf, dont le sol n’a pas été épuisé, ou encore présente assez de disponibilités pour une culture extensive, peut le livrer à 100 francs. Les négociants de ce dernier ne demanderont pas les 100 francs qui rémunéreraient leur travail, mais 114 francs, 115 francs, chose facilitée, à notre époque par les cartels qui suspendent l’effet de la concurrence.
Cela est précisément, réplique-t-on, un des bienfaits du libre-échange. Le pays mal placé n’a qu’à abandonner une production pour laquelle il n’est pas fait et à en entreprendre quelque autre qui lui permettra de dominer, à son tour l’adversaire. Renonciation équivaut à asservissement s’il s’agit d’une denrée de première nécessité. En outre, des populations entières ne peuvent s’outiller du jour au lendemain pour de nouveaux travaux ; le retour à l’équilibre économique causera maintes souffrances. Au surplus, les richesses du sol ne sont pas inépuisables en une contrée, la primauté passe de l’une à l’autre, les forces naturelles sont souvent sujettes à des variations périodiques ; la nécessité de revenir aux industries délaissées peut un jour se faire sentir. Quelle peine pour équiper à nouveau les métiers abandonnés, pour réadapter la main-d’œuvre ! Un droit d’entrée de 20 francs dans le cas que nous avons supposé, éviterait ces conséquences funestes, garantirait le maintien d’une culture essentielle et limiterait le tribut que veut lever sur les travailleurs le producteur-importateur plus favorisé.
Il faut remarquer encore que si l’activité productrice d’un pays se spécialise trop étroitement, son niveau intellectuel et moral sera déprimé. Il en est des peuples comme des individus, ils déclinent si certaines fonctions sont développées au détriment des autres.
Les inégalités naturelles ne sont pas les seules en cause. Il en est d’autres qui rendent difficile jusqu’à la constitution des Unions douanières. Tous les pays, en raison de leur passé diffèrent, ne supportent pas les mêmes charges budgétaires : la différence des prélèvements opérés sur le fruit du travail influe sur les prix. Un produit affiché chez nous 15 francs contiendra 10 francs de travail et 5 francs d’impôts. Un voisin plus heureux, grevé seulement de 2 francs pourra offrir le même produit, à 12 francs, il nous dépossèdera d’une industrie et nous éliminera des marchés extérieurs. L’industriel capitaliste voudra se tirer d’affaire par une exploitation plus intensive de la main-d’œuvre, à moins que l’Etat, animé d’impérialisme économique, ne pratique le dumping, c’est-àdire ne restitue au fabricant sous forme de prime à l’exportation, les 3 francs afférents à la différence des impôts. Mais comme, l’Etat vit en parasite, c’est sur la généralité des consommateurs nationaux qu’il récupérera cette prime.
Proudhon a fait justement remarquer qu’en France, l’abolition des douanes intérieures n’avait été réalisée qu’après que la Révolution eut unifié les charges fiscales. Certes il subsistait à l’intérieur des disparités naturelles mais on s’efforçait d’y remédier par divers moyens, classification des terres en vue de l’impôt foncier diminution des frais de transport en raison des distances... etc. Avant de jeter bas les barrières entre les nations des révolutions sont nécessaires.
Pour un pays qui n’est pas principalement adonné au commerce, qui ne joue pas, comme l’Angleterre, il ya peu d’années encore, le rôle de commissionnaire des peuples, le fait de trop recourir à l’importation pour la satisfaction de ses besoins, quelque soit 1’avantage momentané qu’il y trouve, expose à un grave danger. Les produits s’échangent contre des produits, si la valeur des entrants dépasse celle des sortants on dit que la balance du commerce est défavorable. Lorsque ce fléchissement devient chronique, Proudhon qu’il faut encore citer nous avertit qu’un pays solde ses dettes en se vendant lui-même (c’est aujourd’hui, notre cas). Cela ne nous importerait guère sans doute, si l’acquéreur n’était pas un maître qui, s’il se garde d’anéantir le client débiteur exproprié, ne se fait pas faute de l’exploiter rigoureusement. Comment se défendre contre cette exploitation, quand le spoliateur trouve son point d’appui à l’extérieur ? Si la contrée asservie est favorable au tourisme, les hommes s’y transforment en valets, les femmes en courtisanes ; la production des objets de luxe, s’y développe au détriment du nécessaire, l’inégalité y est portée à son comble avec la démoralisation pour conséquence.
* * *
On fait au protectionnisme des objections qui ne sont pas moins fondées.
Aux barrières, l’étranger oppose des barrières. A la prohibition de ses produits fabriqués, il réplique par le refus de ses matières premières et, pour les utiliser, développe chez lui des industries dont le rival vivait ; il le supplante peu à peu sur les marchés mondiaux.
Le protectionnisme se retourne contre celui qui y a recours, il cause le renchérissement de la vie, et, en fin de compte, fermer sa porte aux denrées que d’autres obtiennent avec moins de peine, c’est s’infliger à soi-même une privation inutile. Il n’est pas exact de dire que les droits de douane retombent uniquement sur l’importateur. Reprenons notre exemple du blé (avec les mêmes chiffres fictifs). Si notre production est de 80 millions de quintaux et le supplément importé de 10 millions, en frappant ce dernier d’une taxe. Même de 19 francs, nous percevons 190 millions, que l’Etat s’adjuge d’ailleurs sans que le consommateur en profite. Mais l’apport extérieur devenant moins abondant les 80 millions restants dont le prix eut baissé à 115 francs resteront à 119 ou 120 (ou davantage si les droits d’entrée sont nettement prohibitifs), grevant le consommateur de 320 millions. Encore pourrait-on faire ce sacrifice si le prélèvement revenait bien au véritable travailleur-producteur et rétablissait un équilibre faussé à son détriment dans l’ensemble de l’économie nationale. Mais il n’en est rien ; le relèvement des cours n’enrichit que le propriétaire oisif ou l’agioteur.
On nous dit encore que la protection est obligatoire lorsqu’il faut assurer des débouchés à une industrie naissante, en relever d’autres qui périclitent, empêcher leur émigration là où la main-d’œuvre est à vil prix, qu’on garantit ainsi les travailleurs contre l’avilissement des salaires et le chômage. Cela n’est vrai que dans une faible mesure. D’abord, il s’en faut que toutes les industries nouvelles méritent des encouragements. Pourquoi favoriser celles qui pourvoient au luxe ruineux des classes riches ? D’autres encore répondent à des besoins trop peu essentiels pour qu’on les développe inconsidérément ou même qu’on fasse effort pour les maintenir sur son territoire. Nous avons accru hâtivement la superficie de notre vignoble et pour le faire fructifier nous nous privons de l’appoint de nos colonies d’Afrique, tandis que les indigènes qui les peuplent, s’ils ne se résignent pas à une existence misérable, doivent venir concurrencer les nôtres dans nos usines. On voit par là ce qu’il faut penser de la garantie du salaire rémunérateur.
Mais, de tous les reproches que l’on peut faire au protectionnisme, voici le plus sérieux, car il ne repose pas seulement sur des arguments, toujours discutables, mais sur l’observation des faits. Dès qu’un peuple d’ancienne civilisation en arrive à s’enfermer dans un réseau de douanes, les industriels favorisés par des élévations de tarifs perdent tout intérêt à l’amélioration de leur technique et de leur outillage. Patrons et ouvriers se laissent aller à une routine de plus en plus incurable. Si l’on objecte que, grâce à la protection, nos agriculteurs ont pu faire les frais d’un outillage plus parfait, sélectionner leurs semences et ainsi accroître les rendements nous répondrons que ce n’est pas seulement à une mesure, peut-être momentanément justifiée qu’ils ont dû leur relèvement, mais au fait qu’en raison de la répercussion qu’entraîne la hausse de certaines denrées alimentaires, les droits d’entrée n’ont jamais pu être exagérés au point de fermer à l’étranger le marché national et supprimer tout stimulant. Le protectionnisme ne laisse place au progrès que dans la mesure même où il tempère sa rigueur ; aucune nation n’a pu l’appliquer intégralement. Au temps où les corporations se disputaient jalousement leurs monopoles et se défendaient contre toute intrusion, l’évolution industrielle n’a guère été possible que grâce aux faveurs que le pouvoir royal a accordées à des manufactures soustraites à la règle dépressive et grâce à l’appel à des techniciens et ouvriers étrangers.
Il est donc vrai de dire que la protection est l’ennemie du progrès.
Ainsi, ni le laisser-faire-laissez-passer, ni le protectionnisme n’apportent une solution acceptable au problème des échanges mondiaux. L’un et l’autre favorisent tantôt l’une tantôt l’autre des catégories des classes possédantes, toujours au préjudice du producteur laborieux. Au poids des iniquités qui le chargent à l’intérieur du pays ils ajoutent celui des inégalités naturelles ou artificielles que caractérisent les diverses nations. Ce qu’il faut c’est une organisation qui nivelle ces différences.
Cet équilibre on a cherché à le réaliser par deux procédés. Les Etats se sont engagés dans la voie des traités de commerce. Pour chaque catégorie de matières et de produits, besoins, moyens de satisfaction, charges, possibilités de développement sont soigneusement examinés ; il en résulte une tarification qui vise à harmoniser les intérêts des parties contractantes, au lieu de les opposer, à faciliter l’expansion économique de chacune d’elles au lieu de l’entraver. Aux caprices des gouvernements, aux revirements de leur politique se substitue la fixité des conventions commerciales. Mais, à peine ces traités sont-ils conclus que l’âpreté des appétits des gros producteurs de chaque nation les pousse à s’y soustraire par des subterfuges : épizooties supposées, par exemple, suspendant le transport du bétail, spécialisation minutieuse d’un produit restreignant les facilités primitives. La guerre de tarifs reprend, avivée par d’autres gouvernements lésés par l’accord partiel conclu trop souvent à leur détriment. Bientôt elle entraîne des conflits plus redoutables.
Les grands cartels internationaux sont une tentative d’organisation d’une tout autre portée. Se partager à l’amiable les matières premières, se répartir les zones à desservir, contingenter la production pour l’adapter à la demande, tout cela constitue incontestablement une œuvre utile. Malheureusement ce n’est pas l’utilité générale qui est prise en considération mais l’intérêt d’une minorité avide. Néanmoins les résultats obtenus dans le sens de la rationalisation devront être retenus pour être mis au service d’une autre cause.
Tant que les services ne s’échangeront pas uniquement contre des services équivalents, tant que des privilégiés pourront trafiquer des matières et des forces gratuites dont la propriété usurpée donne le pouvoir de frustrer de ses droits le travailleur démuni, la liberté des échanges est un leurre, la protection un danger. Mais, une fois ces conditions remplies, le problème de l’organisation demeure. Fixer les règles qui devront présider à la concession, à l’utilisation, à la répartition des richesses dont le capitalisme monopolise aujourd’hui l’usage, voilà la tâche pressante qui s’impose à nous, car, telle est notre mollesse atavique, que des transformations sociales qui intéressent notre vie matérielle inspireront des craintes à la masse tant que le régime nouveau n’aura pas été, sinon défini avec une précision que les événements rendraient vains, au moins assez nettement esquissé pour incliner les esprits à son acceptation.
— G. GOUJON
LIBRE EXAMEN
On appelle libre examen une certaine méthode de recherches et d’investigation applicable à tous les problèmes qui sollicitent l’attention des hommes — et quel que soit le domaine de l’activité humaine qu’ils intéressent — laquelle méthode repose sur un examen rationnel et impartial de toutes les questions qu’elle approfondit, un examen libéré de toute considération « aprioristique », c’est-à-dire ne tenant aucun compte des dogmes, préjugés, conventions, institutions ou traditions, de quelque ordre que ce soit.
La méthode de libre examen peut, en ce qui concerne certaines questions controversées, aboutir à une conjecture ou à une hypothèse. En effet, il manque à l’homme force connaissances, non seulement pour se faire une idée exacte des mouvements, des énergies, des forces cosmiques mais encore — par ignorance de tous les éléments déterminants — pour porter des jugements exempts d’inexactitude, soit sur des phénomènes d’ordre purement tellurique, soit sur la marche de l’évolution des milieux ou des individus. Or, la caractéristique de la méthode de libre examen, c’est qu’elle conduit, en pareil cas, quiconque s’en sert loyalement, à présenter ses déductions ou ses opinions pour ce qu’elles sont : des hypothèses ou des conjectures que l’avenir confirmera ou infirmera.
Il peut même arriver que la méthode de libre examen n’aboutisse pas, pour une même question posée à plusieurs personnes, à une solution identique. Il y a, en effet, dans la sphère de l’abstrait, de l’intellect, des mœurs, voire dans la sphère économique, des problèmes dont la solution dépend du tempérament, des connaissances, des aspirations de l’individu qui entreprend de les résoudre. Scrutées à la lumière du libre examen, il est des questions qui comportent plusieurs réponses.
La méthode appliquée ordinairement par les hommes d’Etat ou les hommes d’Eglise à l’examen des questions que pose l’évolution humaine est limitée au contraire par les dogmes, les préjugés, les conventions, les institutions d’ordre religieux ou laïque, moral ou légal, intellectuel ou éducationnel, etc., que leur réponse ne peut jamais transgresser. C’est pourquoi l’enseignement étatiste ou ecclésiastique ne peut jamais être un enseignement basé sur le libre examen.
— E. ARMAND
LIBRE-PENSEE
Le mot composé libre-pensée, employé constamment, est assez récent : il ne se trouve pas dans Littré, qui contient trois grandes colonnes sur le mot libre. Cependant il y eut toujours des libres-penseurs, selon le sens qu’on attribue généralement à ce mot, mais on leur donnait des noms divers. On les appelait incrédules, incroyants, infidèles, païens, athées, même quand ils croyaient en un Dieu créateur. Au XVIIIème siècle, les libres-penseurs étaient dénommés philosophes, déistes, théistes, voltairiens, esprits forts, sceptiques.
Le distingué historien anglais contemporain, John M. Robertson, dit que le mot libre-penseur est une traduction de l’anglais freethinker, qui avait été appliqué, vers 1667, à quelques membres de la Royal Society (académie des sciences de Londres). Mais le terme n’était pas employé dans le sens actuel du mot, car il existe une brochure publiée vers 1692, où il est question d’une secte nommée : Fraternité des libres-penseurs. C’était probablement un groupe de croyants non orthodoxes.
La première fois qu’on trouve le mot dans l’acception d’incrédule, c’est dans une lettre de l’écrivain Molyneux au philosophe Locke, en 1695. L’auteur, parlant de Toland, dont un ouvrage sceptique avait été brûlé à Dublin par le bourreau, appelle cet auteur un candide libre-penseur.
C’est en 1713 que le déiste Collins donna pour la première fois le mot libre comme synonyme de déiste dans son Discours sur la libre-pensée, à propos de la naissance et des progrès d’une secte nommée Libres-Penseurs.
Une revue hebdomadaire non sceptique fut fondée en 1718, sous le nom de The Freethinker (Le libre-penseur), mais ce n’était qu’une publication d’avant-garde politique. Swift, le célèbre pasteur, auteur des Voyages de Gulliver, avait publié en 1714 ses Libres Pensées sur l’Etat actuel des affaires. Ce n’était pas un ouvrage antireligieux. Peu à peu la question religieuse devint le sujet des discussions, la libre-pensée fut une sorte de réaction contre certaines phrases des doctrines traditionnelles en religion, et bientôt ce fut un synonyme du mot déiste, à la façon de Voltaire. Un grand nombre de penseurs anglais repoussant les superstitions chrétiennes, comme Thomas Paine, auteur de l’Age de raison, mordante satire de la Bible, étaient des déistes convaincus. Ils croyaient en un Dieu créateur, mais cet esprit n’intervenait pas dans les affaires du monde.
Paine avait conservé les idées de son jeune âge sans approfondir celles de création, de gouvernement du monde. Ses ennemis eurent tôt fait de l’appeler athée, ce qu’il n’était pas. Encore à présent, en Amérique, on parle sans cesse de Paine, l’un des fondateurs de la Constitution des Etats-Unis, et la majorité des citoyens ont une sorte de sainte horreur du célèbre publiciste, ancien membre de la Convention Nationale à Paris, parce qu’on l’accuse encore d’athéisme. Roosevelt l’a appelé un sale petit athée, trois expressions absolument fausses. Paine n’était pas petit, il était extrêmement soigneux de sa personne, et il n’était pas athée. C’était un libre-penseur resté déiste.
En Angleterre, bien que le mot libre-penseur fût né dans ce pays, on appelait les non-croyants des athées, des païens, des infidèles, mot d’insulte qui est resté en usage jusqu’à ces dernières années. A présent, outre Freethinker, titre d’un journal qui ne cache pas ses idées matérialistes et athées, les libres-penseurs revendiquent surtout le titre de rationalistes, de sécularistes (c’est donc de ceux qui s’occupent du présent et ne pensent pas au ciel).
Le célèbre physiologiste Huxley, propagateur ardent du transformisme, ne voulant pas être appelé athée, inventa le nom d’agnostic, du grec a-gnosco (je ne sais pas). Mais cette espèce de pyrrhonisme n’est pas éloigné de l’athéisme, car les athées n’affirment pas qu’il n’y a pas de Dieu, mais seulement qu’ils ne comprennent pas ce qu’est un Dieu, être ou esprit que nul n’a jamais pu définir clairement. Herbert Spencer, philosophe, dont les œuvres très célèbres en Russie, sont plus connues en Angleterre par leurs titres que par leur contenu, admet une philosophie de l’inconnaissable, qui n’est qu’une sorte d’athéisme ou d’agnosticisme, sauf l’affirmation d’inconnaissable, terme peu philosophique, puisque nul ne peut savoir ce que l’avenir réserve à la science. L’inconnu d’aujourd’hui sera peut-être admis demain par tous les savants.
En Russie, jusqu’à la révolution, on les appelait aussi boussourmans (corruption de Musulmans), voltairiens, puis ce furent des nihilistes, comme le Bazarov de Tourgueniev, mais le nom de libre-penseur ne leur était pas donné. Encore à présent, le mot libre-penseur (svobodno mouislitel), n’est guère employé que par les littérateurs ; le peuple se sert plutôt du terme bezbojniki (les sans Dieu) pour appeler les libres-penseurs qui sont protégés par le gouvernement bolcheviste. Il paraît à Moscou un très beau journal caricaturiste, nommé Le Bezbojnik ou Stanka. Un autre journal hebdomadaire du même genre est l’organe de l’Union des athées, à l’établi, et est très répandu. Une revue mensuelle, L’anirelighiosnik (l’Antireligieux) contient des articles très sérieux sur la philosophie, sur les sciences, sur les sectes si nombreuses dans le pays et dont quelques-unes sont franchement révolutionnaires, tandis que d’autres sont dégoutantes, comme les klilisti et les eunuchs.
En Ukraine, depuis la révolution, la libre-pensée a fait de grands progrès. Les libres-penseurs y sont appelés Bezverniki (les sans religion), c’est le titre d’une magnifique revue illustrée, publiée à Kharkov.
Tant que la Croatie fut soumise à la Hongrie, l’Eglise catholique était toute puissante ; mes étudiants à l’Académie de Susvak (prononcez Sonchack) étaient obligés d’aller à la messe, quoique la plupart me déclarassent qu’ils ne croyaient à rien. Même les professeurs croates étaient tenus d’assister aux cérémonies, ce dont ils se plaignaient car la plupart étaient libres-penseurs. Depuis que le pays fait partie de la Yougoslavie, royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la politique absorbe tous les esprits et la libre-pensée est un peu mise de côté.
Cependant une belle revue était publiée à Zagreb (capitale de la Croatie) sous le titre de Slobodna Missao (Libre-Pensée). Je ne sais si cette publication paraît encore. En Bohême, où le mouvement est très puissant, on appelait Hussites ceux qui rejetaient les dogmes catholiques. Un Congrès international de la Libre-Pensée a siégé à Prague et chaque année on célèbre, au pied de la statue de Hus, la commémoration de ce martyr.
Le principal journal libre-penseur tchèque s’appelle Volna Myslenka (Libre-Pensée). Le président de la république Mazarik est libre-penseur. On publie aussi de très nombreux volumes libres-penseurs et des journaux comme Volna Skola (Ecole libre) Havlitchek, nom d’un des plus actifs journalistes libres-penseurs anciens.
Les Allemands de Bohème très actifs aussi, publient un hebdomadaire Freie Gedanke (Libre-Pensée). Ils font de la propagande dans tous les districts allemands, malheureusement ils ont une tendance nettement marxiste.
L’Allemagne est actuellement le pays où il y a le plus de libres-penseurs organisés, probablement plus d’un million. On y publie de nombreux journaux libres-penseurs, et des ouvrages qui sont souvent confisqués comme par exemple L’Eglise en caricature, dont, après un long procès, la justice vient enfin d’autoriser la vente. Des Congrès qui comptent plusieurs centaines de membres ont siégé dans certaines villes.
Cependant anciennement les vrais libres-penseurs étaient rares. Les Allemands trop longtemps occupés de querelles entre les protestants et les catholiques romains, avaient peur du nom de libre-pensée, même lorsque Frédéric II se montra incroyant au christianisme. Au XVIIIème siècle les plus avancés étaient dénommés par le peuple Gottlos, sans Dieu, mais les athées étaient presque introuvables. Peu à peu on a appelé philosophes, Kantiens, Hégéliens, Schopenhaueriens, ceux qui se fondaient sur les principes de ces écrivains qui, eux, niaient les dogmes chrétiens, sans s’appeler libres-penseurs.
A présent cela a bien changé. On se nomme sans crainte Freidenker ou même astheist. Un ancien moine Hans Ammon se proclame athée dans son journal Lichtbringer (Le porteur de lumière).
Avant la guerre, il y avait à Nuremberg un Atheist, journal plutôt anti-belliciste qui fut supprimé pendant les hostilités. Un autre nom appliqué à la libre-pensée est Geistesfreiheit. Il y a encore une société dénommée Freie-Religiöse Gesellschaft (libre société religieuse).
Cette organisation a des pasteurs qui donnent des leçons de morale aux écoliers dont les parents ont déclaré qu’ils sortaient de l’Eglise. Pour donner ces leçons dans plusieurs Etats, il faut une autorisation du gouvernement. Le titre donné aux libres-penseurs qui sont sortis des églises est confessionslos (sans confession), mais ce sont des libres-penseurs, même s’ils ne font partie d’aucune organisation de libre-pensée. On les compte par centaines de mille. Donc Confessionslos est une définition de la libre-pensée en Allemagne.
En Autriche, depuis la république, la libre-pensée ; les athées, les Confessionslos ont fait de grands progrès.
L’Association de propagande libérale de Montevideo a publié plus d’une centaine de brochures, entre autres ma plaquette espagnole : « Mythe ou réalité, Jésus est-il un personnage historique » (épuisée en français) et mes Curiosités du Culte des Saints (inédites en français). Ce sont des œuvrettes nettement libres-penseuses. En Argentine et dans d’autres républiques de l’Amérique du Sud, les libre-penseurs sont des libéraux.
Comme avant toutes choses il faut s’entendre sur les mots qu’on emploie, il est nécessaire de commencer par citer les définitions qu’on a données ou qu’on donne encore de la Libre-Pensée.
La libre-pensée est selon moi, la doctrine anarchiste appliquée aux croyances religieuses. Comme les libertaires n’admettent aucune autorité, ils ne sauraient admettre de dogme qui les oblige à croire quoi que ce soit. Ils n’admettent aucune affirmation a priori, ils ne peuvent croire que ce que la science expérimentale a démontré et encore ils pensent que ce qui passe pour vrai à présent, peut très bien être renversé par les progrès de la science, comme nous l’avons vu dernièrement à propos de l’unité de la matière donc, pour moi, la libre-pensée est la libre étude des sciences au moyen de la raison ; ainsi libre-pensée c’est le rationalisme appliqué aux superstitions religieuses.
Le professeur Gabriel Séailles a donné, au Congrès de Genève en 1902, la définition suivante :
« La libre-pensée peut se définir : le droit au libre examen. Elle exige que toute affirmation soit un appel de l’esprit à l’esprit, qu’elle se présente avec ses preuves, qu’elle se propose à la discussion, qu’aucun homme par suite ne prétende imposer sa vérité aux autres hommes au nom d’une autorité extérieure et supérieure à la raison.
Est donc libre-penseur quiconque, quelles que puissent être, d’ailleurs, ses théories et ses croyances, ne fait appel pour les établir qu’à sa propre intelligence et les soumet au contrôle de l’intelligence des autres.
La Libre-Pensée n’exclut ni l’hypothèse, ni l’erreur ; elle est même par excellence la liberté de l’erreur ; car refuser à l’homme le droit de se tromper, c’est se croire naïvement en possession de la vérité absolue, se déclarer infaillible, se conférer à soi-même sa petite papauté. La Libre-Pensée est une méthode, elle n’est pas une doctrine, car elle ne se donnerait pour une doctrine qu’en se niant au moment même où elle s’affirme. »
Séailles dit encore :
« Libre-Pensée signifie libre examen, libre usage de la raison à ses risques et périls...
La pratique des méthodes de la science nous interdit de faire repérer le connu sur l’inconnu. Nous ne pouvons plus prendre pour mobile de nos actes l’attente de sanctions futures. Nous refusons de rêver la justice dans une cité céleste, en nous résignant au mal ici-bas ; nous entendons la réaliser dans les rapports réels des hommes et nous ne comptons que sur notre effort pour y réussir. »
Séailles, bien que non-anarchiste, montre que la Libre-pensée devrait être l’application de la morale anarchiste.
En novembre 1902, au Congrès où l’on fonda à Paris, l’Association nationale des Libres-Penseurs de France, on nota la déclaration suivante :
... L’Association a pour but de protéger la liberté de penser contre toutes les religions et tous les dogmatismes quels qu’ils soient, et d’assurer la recherche libre de la vérité par les méthodes de la raison.
Au même Congrès, Ferdinand Buisson, président de l’Association, a dit :
« Un libre-penseur ne veut sous aucun prétexte se laisser imposer ni Dieu, ni Maître, il ne veut rien croire a priori. »
Voici une autre définition, celle-ci par Jules Carrara, poète suisse, professeur à l’Ecole Normale de Lausanne et qui a perdu sa chaire à cause de ses idées libres-penseuses :
« La Libre-Pensée, c’est avant tout, ce devrait être exclusivement, une méthode scientifique, un moyen de connaître, un moyen d’arriver à la Vérité, donc au Progrès, et par conséquent au Bonheur. »
Vérité, Progrès, Bonheur, voilà les trois étapes que doit franchir l’humanité et que doit franchir d’abord chacun de ceux qui la composent.
(Mais qu’est-ce que la Vérité ? ajouterai-je ? La Vérité absolue n’existe pas. Vérité pour l’un, fausseté pour l’autre, etc.).
Carrara dit encore (dans Découvrir la Vérité), nous avons notre raison ... si ce moyen n’est pas infaillible, il est encore le meilleur de tous ; et le seul indispensable.
A moins d’être complètement privé de raison, c’est-àdire fou, tout homme est plus ou moins, doué de raison, capable de raisonner, raisonnable.
La raison est de toutes nos facultés, la seule dont on peut dire qu’elle est par essence, commune à tous les hommes, indispensable à tous...
La raison est la faculté maîtresse et modératrice des autres, le balancier que nul ne rejette sans perdre l’équilibre. Ayons donc confiance en notre raison et soyons rationalistes.
Le rationalisme est la seule méthode scientifique la seule philosophie, la seule mentalité favorable à la découverte de la vérité. Un libre-penseur est un homme qui prend sa raison pour guide et pour juge, pour qui sa raison est comme un crible qui retient les vérités et laisse passer les erreurs, qui soumet au contrôle de sa raison toutes les apparences, toutes prépositions, tous les postulats, toutes les affirmations, toutes les prétentions, et qui n’en conserve que ce que sa raison lui a confirmé être vrai.
Le rationalisme, ce n’est pas autre chose que la Libre-Pensée, c’est le libre exercice de cette faculté qui nous permet de comparer, de juger, de penser, de connaître, de savoir. Le rationalisme s’oppose à la révélation, il oppose la science à la croyance et la raison à la Foi
La Libre-Pensée... empêche la stagnation, l’encroûtement, la coagulation, la paralysie des intelligences. Depuis une année, le journal La Libre-Pensée Internationale, de Lausanne, est rempli de discussions sur le sens et la portée du mot Libre-Pensée.
Un membre de la Fédération romande, de libre-pensée, M. le professeur de chimie Pelet veut absolument que la Libre-Pensée soit une religion. Quoiqu’il ait été pendant bien des années membre actif de nos groupements, il prétend que la génération actuelle sent le besoin d’une religion, même sans dogme. Il a écrit un volume à ce sujet et il a jeté la zizanie parmi les libres-penseurs de la Suisse romande. Il n’a guère été approuvé que par des pasteurs libéraux, cependant il continue.
Le principal sujet discuté au Congrès des libres-penseurs de la Suisse romande, à Neuchâtel, au mois de mai 1928 a été celui-ci : la libre pensée est-elle en train de devenir religieuse ? La résolution suivante a été votée à l’unanimité moins trois voix :
« Le congrès de la Fédération romande de la Libre-Pensée, réuni le dimanche 26 mai 1928, à la Maison du Peuple, à Neuchâtel, après avoir discuté sur la question « Libre Pensée et Religion », formule les déclarations et résolutions suivantes :
La Religion a été, dès son origine à nos jours, une attitude essentiellement mystique basée sur la croyance au surnaturel.
A la lumière de l’histoire, elle s’est révélée surtout comme un instrument de domination spirituelle et par là de soumission envers les puissances temporelles.
La Libre-Pensée est la force de libération qui s’est opposée à la puissance de domination de la Religion. Elle se place sur le terrain naturel et dès lors elle ne peut approuver l’attitude mystique. Elle est irréligieuse.
Cependant, la Libre-Pensée n’entend en aucune circonstance empêcher les individus d’adopter et de pratiquer les croyances qui leur plaisent. Mais elle se dresse contre les collectivités religieuses toutes les fois que celles-ci veulent employer leur force numérique, économique et traditionnelle pour défendre et perpétuer leur domination.
Elle vise au contraire à la réalisation d’une Société où ni le fait de croire, ni le fait de ne pas croire, ne soient pour personne une cause de dommage ou de privilège.
La Libre-Pensée est idéaliste. Elle ne nie pas que la Religion puisse l’être à sa manière. Mais elle sait que cette tendance n’est pas caractéristique de la foi religieuse, puisque le fondement essentiel de la Religion est un absolu mystique.
Il n’est donc pas nettement exact de dire que la Religion, ce soit l’idéal que l’homme se propose.
D’ailleurs, la Libre-Pensée ne proclame aucun absolu. Son idéal n’est pas la vérité « absolue », ni la justice « absolue », ni la liberté « absolue ».
Elle écarte ces notions métaphysiques qui se sont avérées comme trop commodes pour justifier précisément la renonciation à la poursuite d’un idéal inatteingible.
La Libre-Pensée, restant au contraire dans le domaine de l’action et des possibilités, veut d’avance anéantir tout prétexte à une telle renonciation, en proclamant pour maximes :
Toujours plus de vérité,
Toujours plus de justice,
Toujours plus de liberté,
pour réaliser toujours plus d’entente et d’amour entre les hommes.
Si la Libre-Pensée, en tant que doctrine, est irréligieuse, en tant qu’organisation, elle ne ferme cependant pas ses portes aux hommes de bonne volonté, quand même ceux-ci persisteraient à appeler religion l’idéal de la Libre-Pensée. »
ESQUISSE D’HISTOIRE DE LA LIBRE PENSEE
De tout temps il y eut des hommes qui, se servant de leur raison, ont repoussé les superstitions des milieux où ils vivaient. Ces rationalistes inconscients, même parmi les sauvages, se contentaient de garder pour eux leurs idées ; ils ne voulaient pas se créer des ennemis, car l’homme ordinaire, persuadé que ce qu’il croit est la vérité entière, trouve mauvais qu’un individu ne pense pas comme lui-même.
A mesure que la peur des phénomènes physiques incompréhensibles pour l’esprit des êtres créait les religions et que les hommes qui se distinguaient par leur force s’emparaient du pouvoir et voulaient avoir à leur dévotion d’autres hommes peut-être plus intelligents, les dogmes se formaient, des rites s’imposaient et ce fut presque un crime que de ne pas admettre les théories des prêtres. Les rationalistes n’avaient pas exposé leurs idées, pour ne pas être exposés à l’assassinat. Voilà pourquoi les noms des anciens libres-penseurs nous sont presque inconnus.
Aux Indes, en Perse, les négateurs étaient nombreux ; la multiplicité des dieux devaient naturellement démontrer que ces êtres divins n’étaient que de pures inventions. Gautama Sakya Mouni, le Bouddha, était un libre-penseur qui ne croyait pas à la trinité brahmanique et niait l’existence d’un Dieu suprême. Sa raison lui montrait que tous les récits des brahmines, leurs légendes n’étaient que des fables. Mais il croyait à une entité spirituelle, l’âme, et c’est sur cette croyance qu’il basait ce qu’on a appelé la religion bouddhiste, puisque lui-même voulut seulement exposer a priori une morale mal fondée sur l’amour du prochain.
Gautama fut un des premiers libres-penseurs dont les théories nous soient parvenues, bien qu’elles aient été déformées par des milliers de disciples plus ou moins fidèles. Kong-Futse en Chine, qui ne croyait pas à une vie future, peut être regardé comme un libre-penseur. Mithra, dont on a voulu faire un dieu, un des prototypes de Jésus, était un libre-penseur de son temps, un réformateur social.
Ce n’est pourtant que vers l’an 600 avant notre ère, que parurent, en Grèce, des libres-penseurs bien réels, les philosophes qui, pendant plus de 500 ans, cherchèrent à pénétrer les secrets de la nature, sans s’occuper des dogmes de leur temps, en écartant la période religieuse, poétique et gnomique, représentée par Orphée et les mystères, la théogonie d’Hésiode et les sept sages.
La philosophie grecque, qu’on peut faire remonter jusqu’à Thalès, s’est développée jusqu’à l’arrêt de Justinien, qui ferma, en 529, les écoles de philosophie.
La première école de cette philosophie libre-penseuse, l’école ionienne, commence par Thalès, de Milet (639–549). Le caractère commun à tous les philosophes de cette école est de chercher l’origine de l’univers dans un élément matériel, unique chez les uns et produisant toutes choses par dilatation et instruction (dynamisme), multiple chez les autres qui considèrent tous les êtres comme le résultat des combinaisons diverses de ces éléments.
Les principaux représentants de l’école ionienne sont Anaximandre (610–546), Héraclite d’Ephèse, Anaxagore, Diogène, d’Anallonie, Arhélaüs et Empédocle.
Toutes sortes de légendes sur les idées d’Héraclite sont connues parmi nous, mais il ne faut pas s’y arrêter. On l’a opposé à Démocrite, sous les noms de Jean qui pleure et Jean qui rit, c’est-à-dire en faisant de l’un un pessimiste pleurnicheur, de l’autre un sceptique moqueur ; qualificatifs erronés.
L’école italique ou pythagoricienne qui suivit l’époque de l’école ionienne (de 584 à 370), s’attache principalement au côté mathématique de l’univers, tandis que l’école ionienne s’était surtout préoccupée du côté physique. Les nombres sont l’essence de toutes choses et l’unité, ou monade, est le principe des nombres. L’âme est un nombre qui se meut de lui-même. Le retour à l’unité constitue la vertu. Pythagore admettant l’âme parle aussi de la métempsychose. Toutes les théories de Pythagore et son ascétisme sont plutôt nuageuses pour nous, mais ce philosophe était libre de toute idée théologique. Lui et ses disciples n’admettaient que la raison individuelle, c’étaient donc de vrais libres-penseurs. Parmi ses élèves il faut citer Théano, sa fille, Aristée, son gendre ; Philolaüs (450–395) Anhisas de Tarente, Aliméon, de Crotone, etc.
L’école atomistique a précédé la science moderne, la ricien s’applique d’une manière exclusive au principe métaphysique de l’univers, c’est-à-dire à l’idée de substance et combat par la dialectique les deux écoles antérieures. Dans les éléates il n’y a pas de milieu entre l’être absolu et le néant ; l’idéal d’un être multiple est pleine de contradictions. Il n’y a que l’un, l’infini et le nécessaire qui existe : tout le reste n’est qu’apparence. Parmi les Eléates nous citerons : Xénophane de Colophon (617–510), Parménide d’Elée (530–455), Mélissus de Samos, Zénon d’Elée (vers 500).
L’école atomistique a précédé la science moderne, la théorie atomistique de Würtz, Gebhard et de tous les physiciens actuels. L’école atomistique quoique ne possédant pas les moyens d’investigation dont nous disposons à présent, observait et raisonnait librement.
Les philosophes de cette école reconnaissaient un nombre infini d’atomes, de formes diverses et doués d’un mouvement éternel. L’âme est composée d’atomes ronds et ignés, qui impriment le mouvement au corps. La connaissance résulte du choc des atomes extérieurs sur l’âme (premier essai de psychologie sensualiste). Parmi les sensualistes, on trouve surtout Démocrite d’Abdère (480–407), Diagoras, Nessus, Anaxargue, Nausiphane, maître d’Epicure.
Les sophistes ne sont pas les inventeurs d’absurdités comme le sens actuel du mot pourrait le faire croire. C’étaient des sceptiques à l’égard des théories mises en avant pax les philosophes d’alors. Ils ont été utiles en vulgarisant les données de la science et en indiquant les contradictions des systèmes. Ils ont pavé la voie à l’école socratique.
Parmi les sophistes, nous nommerons Gorgias de Leontium, Protagoras d’Abdère, Critias d’Athènes
Jusqu’alors les philosophes s’étaient surtout occupés de la nature, de la physique, ils n’avaient pas fait une étude spéciale de l’homme et de ses facultés, ce fut le mérite de Socrate de s’être limité à la sphère morale. Il ne proscrivait pas la spéculation dont s’étaient servies les anciennes écoles, car lui-même a parlé d’un Dieu unique, simple assomption qu’on ne peut prouver. Il regardait ce Dieu comme le bien.
L’âme, selon Socrate, se rapproche de Dieu par l’exercice de la raison et de la liberté, c’est-à-dire par la pratique de la vertu.
METHODE SOCRATIQUE : Procédés principaux.
-
Ignorance simulée, hypothèses admises comme vraies et leur fausseté mise à nu par l’absurdité de leurs conséquences (ironie socratique) ;
-
analyse des notions complexes, développement graduel des germes de vérité continus dans l’esprit humain ; induction.
Tout notre enseignement philosophique jusqu’au XVIIème siècle découle des principes socratiques, malgré leur base arbitraire, peu scientifique, principes qui nous ont été transmis par Platon (dans ses nombreuses œuvres), et par Xénophon, etc.
Socrate, accusé de corrompre la jeunesse, c’est-à-dire de parler contre les dieux adorés par le peuple, fut condamné à boire la ciguë. Ce fut un martyr de la libre-pensée.
Quoique les anciens Grecs n’aient jamais été si intolérants que les chrétiens le furent plus tard, et surtout l’atroce religion de Jéhovah, qui fit exterminer tous les Cananéens et les autres peuplades qui n’adoraient pas le Dieu d’Israë1, on parle d’autres martyrs de la libre-pensée en Grèce. Diagoras de l’île de Mélos, surnommé l’Athée fut, dit-on, condamné à mort à cause de ses violentes diatribes contre la religion de ses concitoyens, mais on ne sait rien de certains sur sa mort. Diagoras avait été, croit-on, esclave, puis il fut disciple de Démocrite. On raconte que vers 412 avant notre ère, il s’enfuit d’Athènes par crainte de la ciguë parce qu’il raillait ouvertement et constamment les mystères religieux et leurs initiés. Il n’aurait pas péri victime de l’intolérance, puisqu’on lui doit les sages lois qu’il édita pour Mantinée.
La mort de Socrate n’effraya pas les libres-penseurs de son temps. En effet, plusieurs écoles philosophiques continuèrent à faire abstraction des dogmes polythéistes...
L’Ecole cyrénaïque, dont le principal protagoniste était Aristippe, de Cyrène (nord de l’Afrique) déclarait que le bien consistait dans la volupté et le mal dans la douleur. Comme au XVIIIème siècle l’enseignait Condillac, selon Aristippe les sens sont les seuls juges de ce qui est vrai, beau et utile.
L’école cynique, ne professait rien de ce que nous appelons cynique (du grec kuon, chien).
Le plus fameux représentant de cette école fut Diogène, sur qui l’on raconte maintes anecdotes plus ou moins apocryphes. Antisthène, Cratès, Hipparchie, enseignaient que le bien est dans la vertu et que celle-ci consiste à vivre selon la nature, sans que les sages s’inquiètent du qu’en dira-t-on ou d’observer les mœurs courantes. Le cynique jugeait toutes choses d’après ce qu’il considérait comme sa raison.
Euclide, fondateur de l’école de Mégare, est plus connu comme mathématicien que comme philosophe. On lui attribue l’invention de la géométrie et son nom en Angleterre est devenu le synonyme de géométrie plane. Les élèves dans les écoles anglaises disent toujours : « J’apprends l’arithmétique, l’euclide, l’algèbre, etc. Cependant, comme philosophe libre-penseur il a eu une grande importance. Selon lui, la raison doit être le seul guide, son objet est l’universel, l’absolu qui seul existe ; le bien c’est la raison, le mal n’est qu’une apparence. Parmi les partisans de cette philosophie, il faut nommer Médème et Phédon ; celui-ci étant l’objet d’un des dialogues de Platon.
La libre-pensée est par nature sceptique, puisqu’elle n’admet aucun dogme. Le représentant de ce doute universel fut Pyrrhon, fondateur du Pyrrhonisme. Selon lui toute prétendue science repose sur des hypothèses. La vertu seule est précieuse. La science elle-même ne conduit à aucun résultat positif. On a prétendu que l’essence même de la philosophie de Montaigne, de La Boétie, de Charron, venait du pyrrhonisme ce qui est très discutable.
Le scepticisme eut de nombreux partisans, comme Enésidème, de Crête (contemporain de Cicéron), Agrippa (vers 70 avant notre ère), Sextus Empiricus (vers 230 après J.-C.).
Les principaux arguments des sceptiques sont les suivants :
-
La raison ne pouvant se prouver à elle-même sa propre légitimité, toute affirmation est une hypothèse gratuite ;
-
La raison est condamnée par sa nature à des contradictions insolubles.
Le vaste système de Platon a pour centre la théorie des idées. Ce disciple de Socrate a fondé l’école dite Académie qui attira des disciples de tout le monde hellénique. Platon est encore commenté, discuté ou attaqué par tous les philosophes modernes surtout parce qu’il croit en un Dieu unique qui a modelé la matière éternelle comme lui. Peut-on considérer Platon comme un libre-penseur ? La croyance en un Dieu, croyance a priori me semble opposée à la libre-pensée ; bien que des déistes comme Voltaire, Paine, doivent nécessairement être regardés comme des libres-penseurs.
Aristote, de Stagyre, en Thrace, de 384 à 322, a joui pendant des siècles d’une dictature intellectuelle sans exemple dans l’histoire. Attaquant vigoureusement dans sa base la théorie de son maître, Platon, il refuse aux idées une existence substantielle, il ne voit en elles qu’un élément distinct de la sensation, mais impuissant à procurer la connaissance sans cette dernière. Aristote a cherché un milieu entre l’idéalisme et le sensualisme. On est loin d’être d’accord sur ce point.
Les œuvres d’Aristote, qui étaient restées presque inconnues en occident, jusque vers 1200 de notre ère furent enfin popularisées par des traductions de l’arabe. Les musulmans et les Juifs comme Maimonide, Averroès étaient devenus d’enthousiastes aristotéliciens, leur philosophie était presque exclusivement dérivée des œuvres du fondateur du Lycée ou école péripatéticienne (école d’Aristote). Les Maures d’Espagne introduisirent en Europe les idées du maître d’Alexandre le Grand et bientôt elles dominèrent tous les esprits au moyen-âge, à un tel point que l’Eglise catholique fit de nombreuses victimes parmi les hommes qui n’étaient point assez orthodoxes au point de vue aristotélicien.
La renaissance des lettres et les œuvres des philosophes grecs qui furent apportées de Grèce dans les originaux, ébranla l’influence du péripatétisme, mais il y a encore des esprits qui s’attachent à l’aristotélisme. Sylla fut un des premiers Romains à apporter à Rome quelques-uns des écrits d’Aristote. Un des principaux mérites d’Aristote a été sa classification des sciences, de même qu’au XIXème siècle la réputation d’Auguste Comte est d’abord venue de sa classification des sciences. Cette classification d’Aristote s’appuie sur les trois principaux modes de développement de l’esprit humain ; savoir, agir, produire. Il classifie les sciences théoriques en physique, mathématique, métaphysique ; les pratiques en morale, économie, politique, artistique, poétique, rhétorique, logique.
Bien que l’Eglise catholique ait pendant des siècles imposé l’aristotélisme, le philosophe lui-même, repoussant les religions de son temps doit être considéré comme un libre-penseur.
Les deux principaux ouvrages d’Aristote qui nous restent sont l’Organon, ou logique en six traités, et la Métaphysique ou Philosophie première, en 14 livres. Bacon fondant sa philosophie sur l’étude a posteriori, a intitulé son œuvre le Novum Organon.
Epicurisme. Epicure (337–270) est probablement le philosophe grec qui a été le plus calomnié par les écrivains modernes. Le mot épicurien est devenu le synonyme de goinfre. On a été jusqu’à appeler ses disciples « le troupeau des pourceaux d’Epicure », quoique la morale d’Epicure fût plutôt stoïque, Il recommandait à ses disciples la vertu, la tempérance qui seule pouvait conserver la santé. Il est vrai qu’il a dit que le but de l’homme devait être le bonheur, mais ce bonheur, il le mettait dans l’équilibre parfait de la vie, dans le repos, la méditation.
On ne peut atteindre au bonheur que par la connaissance de soi-même et du monde. Sa philosophie est l’atomisme de Démocrite modifié. Sa logique admet deux éléments dans l’intelligence, les sensations et les anticipations, notions généralisées par l’entendement. La sensation est le critérium de la certitude. Epicure eut de nombreux disciples, et sa philosophie fut adoptée par la plupart des écrivains romains : Lucrèce, dans sa Natura rerum, Cassius, Pomponius Athicus, Lucullus, Crassus, Horace.
Les Romains n’eurent pas de grands philosophes originaux, ils empruntaient aux Grecs leurs théories. Pourtant il faut citer Epictète, Marc Aurèle, Brutus, Caton d’Utique, Sénèque qu’on peut classer parmi les stoïciens. De la Grèce, la philosophie avait passé à Alexandrie d’Égypte. Le néo-platonisme d’Alexandrie avait la synthèse comme méthode, son but était d’associer dans un vaste éclectisme l’esprit oriental, mais déjà le christianisme faisait sentir sa funeste influence sur l’esprit humain. Aussi vit-on saint Cyril exciter ses partisans contre la grande savante libre-penseuse Hypatie, qu’on mit à mort, en lui enlevant ses vêtements et en déchirant son corps avec des coquilles d’huîtres en 415.
L’édit de l’empereur Justinien, en 529 fermant les écoles de philosophie, fut le signal de la décadence de l’intelligence. En Europe, la libre-pensée est écrasée sous les persécutions. Quelques philosophes comme saint Erigène (vers 856) tentèrent d’appliquer au dogme chrétien les formes logiques de l’Organon d’Aristote, traduit par Boèce. L’obscurité s’étend partout, la religion étouffe toute activité d’indépendance de la pensée. La philosophie de la scolastique n’est plus que l’humble esclave de l’Eglise.
Le bûcher, les tortures atroces menaçaient quiconque osait élever des doutes sur les dogmes catholiques. Ce fut une époque de cauchemar pour ceux qui ne pouvaient croire implicitement. Au lieu de la liberté grecque, le monde civilisé n’avait plus que l’esclavage du cerveau, le catholicisme faisait reculer la civilisation de presque mille ans.
La réformation, sortie de la renaissance des lettres, osa secouer les chaînes de la pensée, mais pourtant Berthelier, le libertin, c’est-à-dire libre-penseur, fut mis à mort à Genève, où à présent s’élève sa statue. Servet, le célèbre médecin espagnol, qui avait osé nier la divinité de Jésus fut condamné par l’Eglise catholique ; fuyant Vienne (France) où on allait le brûler, il se réfugia à Genève, où Calvin fit exécuter la condamnation papale. A présent une statue de Servet orne une place d’Annemasse (Haute-Savoie), Genève n’ayant pas voulu accorder un emplacement pour y élever la statue, résultat d’une souscription internationale. La ville de Genève s’est contentée d’ériger un monolithe à l’endroit même où, à Chavapel, fut brûlé le martyr. A Paris une statue de Servet se trouve dans le square de la mairie du XIVème arrondissement. Le protestantisme ne croyait plus à certains dogmes catholiques ; par exemple à la transsubstantiation (l’hostie changée en corps et en sang de Jésus), aux indulgences, aux prières pour les morts etc., mais ayant la Bible comme fétiche, il était aussi loin de la liberté de la pensée que le catholicisme autoritaire.
La renaissance des études grecques a produit, en Italie, le renouvellement de la libre-pensée. Toute une pléiade de penseurs ont, au péril de leur vie, exprimé leur amour de la liberté intellectuelle. Le chroniqueur Villani parle de nombreux épicuriens opposés à l’orthodoxie. Brunetto Latini, maître de Dante, dans son Tesoretto, fait de la nature le pouvoir universel, laissant la divinité de côté. Cecco d’Ascolo, professeur de philosophie et d’astrologie, à Bologne, périt sur le bûcher en 1327, parce qu’il avait écrit que Jésus avait vécu en poltron, en paresseux avec ses disciples.
On peut considérer Dante, Boccace, Pétrarque, comme des libres-penseurs de leur temps, bien que l’Eglise ait biffé de leurs ouvrages tous les sentiments anticléricaux.
Pulci, grand poète de la Renaissance, échappe à l’Inquisition malgré ses satires anticléricales ; mais, à sa mort, on refusa à son cadavre un enterrement en terre consacrée. Gabriele de Salo (en 1497) avait osé dire que Jésus avait trompé le monde par sa ruse, et que peut-être il était mort sur la croix à cause de ses crimes ; ce médecin bolonais fut protégé par ses patrons contre l’Inquisition. Georges de Novarra fût brûlé en 1500 pour avoir nié la divinité de Jésus.
Parmi les écrivains libres-penseurs, il faut surtout mentionner Pomponace (1462–1525), dont on a dit qu’il avait réellement initié la philosophie de la Renaissance italienne. Il niait l’immortalité de l’âme, la réalité des miracles ; mais il prétendait se soumettre à l’Eglise, ce qui lui sauva la vie.
Pendant que de nombreux italiens se distinguaient par leur scepticisme à l’égard des dogmes, la France, l’Espagne, la Scandinavie, pliées sous le joug de l’Eglise romaine, ne produisaient aucun esprit indépendant du moins aucun qui ait laissé un nom. En Bohême, Jean Hus, ayant osé parler librement, fut condamné par le concile de Constance et brûlé vif (1413) malgré le sauf-conduit de l’empereur Sigismond. Le disciple de Hus, Jérôme de Prague, un peu plus tard, eut le même sort que son maître. La guerre des Hussites qui s’en suivit et qui dura longtemps, fut un drame politique, qui détourna en Bohème et en Moravie, l’esprit public des questions de libre-pensée.
Aux Pays-Bas, Koornhert (1522–1590), fut banni de Delft, à cause de ses ouvrages hétérodoxes. L’histoire des Pays-Bas, par Liewe van Aitzema, fut supprimée pour athéisme ; les Exercitationes Philosophicae de Gorlaens eurent le même sort. Un Kverbogh qui, en 1668, avait publié un dictionnaire de la langue hollandaise où se trouvaient des définitions libres-penseuses, dut fuir d’Amsterdam, fut poursuivi pour blasphème, condamné à 10 ans de prison et 10 ans de bannissement. Il mourut en prison.
Nous voyons donc que même les pays qui avaient adopté la réforme n’étaient pas exempts d’intolérance quand un libre-penseur avait exprimé ses idées. A l’époque même où Calvin établissait son pouvoir à Genève et faisait de la Bible le guide infaillible de ses partisans et par là renonçait à toute liberté de penser véritable, il y avait en France un philosophe sceptique qui eut une énorme influence sur les esprits cultivés, je veux parler de Montaigne (Michel Eyquem de) (1533–1592), dont les Essais sont encore le livre de chevet d’un grand nombre de penseurs. Ces Essais sont composés sans plan, ils forment un recueil de pensées et d’observations. Montaigne repousse toute doctrine imposée, toute théorie admise. Il veut penser par lui-même et doute de tout ce qu’il n’a pas reconnu comme vrai. On l’a appelé pyrrhoniste, mais il n’a pas dit, comme Pyrrhon, dit-on, : ce que je sais, c’est que je ne sais rien. Montaigne s’abstient de toute affirmation. Les Essais de Montaigne sont fréquemment réédités. Une traduction anglaise qui avait été supprimée par la censure comme athée, a reparu et eut un grand succès.
L’ami de Montaigne, Etienne de La Boétie (1530–1563), a laissé un petit ouvrage, La Servitude volontaire, où l’on a voulu voir des prémisses de l’anarchie.
Pierre Charron (1541–1603), autre ami de Montaigne, qui mourut dans ses bras, fut d’abord prédicateur catholique, mais dans son ouvrage le plus connu, Traité de la Sagesse, il est disciple de Montaigne et cherche à démontrer l’incertitude et l’impuissance de la raison, il condamne toutes les religions. Il choqua tout d’abord les croyants en disant que si l’homme a une âme, les animaux en ont une aussi. Le Traité de la Sagesse fut poursuivi pendant la vie de l’auteur et après sa mort.
Un contemporain italien de Montaigne et Charron, Giordano Bruno, fut un des plus grands savants de son temps. On trouve dans ses œuvres l’idée du transformisme développée au XIXème siècle par Lamarck et Darwin. Né vers 1548, il entra dans l’ordre des Dominicains, mais ses doutes sur la religion et ses violentes attaques contre les moines le poussèrent à quitter l’Italie vers 1580. Il se rendit à Genève, espérant y trouver la liberté de pensée, mais il vit bientôt que la liberté y était aussi peu connue que dans les pays catholiques. Il alla à Paris où, à la Sorbonne, il attaqua l’aristotélisme à la mode, puis il partit pour l’Angleterre, où il défendit le système de Copernic contre les professeurs d’Oxford. Ensuite il parcourut l’Allemagne, excitant partout une grande opposition, car il attaquait les thèses mêmes du catholicisme ; il publia des ouvrages scientifiques, plutôt panthéistes. Ayant été invité par un ami à aller à Venise, où il lui promettait la liberté de ses opinions, il fut trahi par cet ami même, qui le livra au pape. Enfermé par l’inquisition de Rome, il gémit pendant sept ans dans les cachots, puis il fut brûlé vif le 17 février 1600. Cet audacieux penseur est devenu un héros pour la libre-pensée européenne, une statue lui fut érigée par souscription internationale à l’endroit même où fut allumé le bûcher où il périt. Un grand palazzo, (belle maison) de la société Giordano Bruno s’élevait à Rome vis-à-vis du Vatican. On allait le reconstruire pour en faire le point central des sociétés de libre-pensée, mais la prêtraille veillait. Le traître Mussolini, ce presque anarchiste, lorsqu’il était ouvrier à Lausanne, devenu le dictateur tout puissant et malfaisant, a fait démolir ce palazzo, sous le prétexte de faire passer une rue sur l’emplacement, mais la rue ne sera jamais faite.
Les fonds de la Giordano Bruno ont été confisqués par le gouvernement fasciste.
Les ouvrages de G. Bruno ont été traduits en allemands en plusieurs volumes.
Le XVIIème siècle vit naître deux écoles de philosophie qui ont certainement des bases dans la libre-pensée, ce sont les écoles de Bacon en Angleterre et le cartésianisme ou école de Descartes en France.
Les travaux de Bacon (François) (1561–1626) ont un double objet :
-
la réforme et le progrès des sciences ;
-
la classification raisonnée des connaissances humaines.
Selon lui les procédés que la science doit suivre se réduisent à trois :
-
prendre la nature sur le fait et enregistrer les purs phénomènes, sans chercher d’abord â les expliquer ;
-
construire des tableaux où les phénomènes soient classés dans un ordre facile à saisir ;
-
s’élever à la connaissance des lois au moyen de l’induction, dont il analyse minutieusement les procédés.
Les principes posés par Bacon, que l’activité intellectuelle ne s’exerce que sur un fond primitivement fourni par les sensations sont développés et appliqués à la psychologie et la morale par ses disciples immédiats (Hobbes, 1588–1679 ; Gassendi, 1592–1655 ; Locke, 1632–1704) et par l’école sensualiste du XVIIème siècle. Les idées libérales de Bacon n’influencèrent guère les événements de son temps. Les persécutions continuèrent. En 1619 le savant libre-penseur Lucilio Vanini, fut brûlé vif à Toulouse après qu’on lui eût arraché la langue avec des tenailles rougies au feu. (Une statue devait être érigée à Vanini à Lecce, sa ville natale, mais la guerre et le fascisme ont empêché l’érection de ce monument).
Marie Tudor (Mary la sanglante comme on l’appelle en Angleterre), fit brûler ou décapiter des centaines de protestants ; sa sœur Elisabeth massacra des catholiques. Le fils de Marie Stuart, Jacques 1er d’Angleterre, fit brûler le dramaturge Kyd, le savant Barlholomew Legate (1611), et la même année Wightman. Après ce dernier autodafé, on ne brûla plus les libres-penseurs, on se contenta de les mettre en prison pendant de longues années. Une loi punit encore aujourd’hui d’emprisonnement les blasphémateurs. Il y a trois ou quatre ans, un orateur en plein air, Gott, fut condamné pour avoir employé des mots un peu violents contre la trinité. Il est mort en prison. Chaque année une pétition est présentée au Parlement par des personnages distingués en faveur de l’abrogation de cette loi, relique du moyen âge, mais le gouvernement s’oppose à cette mesure libérale.
La philosophie de René Descartes (1590–1650), opposée à la réforme de Bacon, a dominé toute philosophie depuis le milieu du XVIIème siècle jusque vers 1750 et encore à présent elle a de nombreux partisans.
Descartes peut être dénommé libre-penseur pour la raison que dans le Discours sur la Méthode il fait abstraction — table rase — de toutes les idées préconçues, de tous les dogmes et ensuite il reconstruit par l’observation des faits internes, il fonde ainsi la psychologie, d’où il tire la logique, l’éthique ; mais, par une étrange aberration, venant peut-être de la peur des persécutions auxquelles il avait déjà été exposé en Hollande, il remonte jusqu’à Dieu, qui n’a absolument rien à faire avec la logique ou la psychologie. Cette théodicée lui fut probablement imposée par les mœurs de son temps.
Parmi les représentants les plus autorisés de son école, nous verrons Malebranche (1638–1715), Arnauld, Nicole, Bossuet, Fénelon, etc., et au XIXème siècle, Royer-Collard, Gérando, Cousin et toute l’école éclectique. Spinoza qui fut disciple dé Descartes se sépara de son maître et construisit un système de panthéisme. Il était libre-penseur, fut banni de la synagogue à cause de cela.
Au milieu du XVIIIème siècle, en Angleterre, le déisme prit une grande extension, malgré les persécutions du clergé protestant. Un garçon de 18 ans, Thomas Arkenhead fut pendu comme déiste et pour avoir appelé l’Ancien Testament les Fables d’Esdras, Jacob Ilive, qui avait nié toute révélation divine fut attaché trois fois au pilori (1753) et condamné aux travaux forcés pour trois ans ; un vieillard de 70 ans, Peter Annet qui s’était moqué des histoires du pentateuque (les cinq ouvrages attribués à Moïse), fut aussi attaché au pilori et envoyé aux travaux forcés pour une année.
Cependant on peut s’étonner qu’il n’y ait pas eu plus d’ouvrages défendant le déisme ; on n’en compte guère qu’une cinquantaine, et pourtant la plupart des hommes remarquables de cette époque, étaient déistes, ils n’allaient pas jusqu’à douter de l’existence d’un Dieu, ce Dieu était le créateur rien de plus. Ils ne se demandaient pas où ce Dieu avait pris la substance de la création, celle-ci, d’après la genèse n’ayant été que la mise en ordre du chaos ; mais qu’était ce chaos ? Etc.
Voltaire qui fut le roi intellectuel du XVIIIème siècle était un déiste. Ayant dû fuir la France, il avait pendant son séjour en Angleterre étudié les écrits des déistes, il en absorba tout le suc et il expliqua dans un style impeccable bien supérieur à celui des Anglais les idées des déistes.
La vie et les écrits de Voltaire sont trop connus pour qu’on ait besoin de les dépeindre ici. Son influence n’est pas diminuée, bien que ses tragédies, ses comédies, ses poèmes épiques ne soient plus lus, mais le nom de Voltaire a encore une force très grande. Il n’est pas de jour où je ne voie ce nom cité par les journaux américains, anglais, allemands, russes, tchèques, polonais, ukrainiens. Les cléricaux ont beau faire rage, inventer calomnies sur calomnies, Voltaire reste roi de la pensée antireligieuse.
Son Dictionnaire philosophique, Candide, et d’autres contes sont traduits et lus dans toutes les langues et dans tous les pays. C’est la bête noire des cléricaux.
Voici un paragraphe que j’ai lu aujourd’hui dans le journal anglais The Literary Guide :
« Voltaire : Philosophe, dramaturge, historien ; le châtieur des hypocrites, l’exposeur des faussetés, l’ennemi acharné, infatigable de la superstition, le protecteur du travailleur, le vengeur de Colas et de Sirven, Voltaire qui le premier fit de la plume une puissance devant le nom de qui les papes et les potentats apprirent à ramper ; qui bannit Jéhovah du ciel et l’Enfer de l’autre monde, le génie qui a tant fait (pour l’humanité)... Voltaire et Napoléon sont symboliques comme Ahriman et Osmuzd, de la mythologie perse, ils sont comme les principes du conflit du bien et du mal, de la Raison et de la Force, principes toujours en guerre , guerre incessante, etc. » (La suite de l’article est un éloquent discours contre la guerre). On y trouve encore cette phrase : « j’espère, j’ai confiance qu’un jour viendra où hommes et femmes n’offriront plus un culte aux restes de Napoléon, et qu’ils trouveront en Voltaire leur instituteur et leur inspirateur. »
Ainsi la haine des catholiques n’a pu ronger le piédestal sur lequel l’humanité moderne a érigé l’idéal du philosophe.
Autour de Voltaire, nous voyons une foule d’hommes de talent, même de génie, aller plus loin que lui et se proclamer athées. La Mettrie, d’Argens, d’Holbach, l’abbé Meslier, Dumarsais, d’Alembert, Mably, Naigeon, Dupuis. Ces hommes dont les œuvres ont eu une influence colossale sur le progrès de la libre-pensée et de l’histoire mériteraient des notices spéciales dans notre Encyclopédie, mais l’espace manque. Rappelons seulement que l’Encyclopédie fondée et rédigée par Diderot et dont l’introduction par d’Alembert est devenue une œuvre classique, est constamment citée, quoique la partie scientifique ait été laissée en arrière par les découvertes modernes. C’est le sort inévitable de toutes les encyclopédies. Condorcet, grand savant, fondateur de la théorie du progrès, avocat du Droit des femmes, mérite notre admiration.
Après la mort de Voltaire et des principaux encyclopédistes, la libre-pensée devint le mot d’ordre de presque tous les écrivains et les penseurs. Quand la Révolution éclata presque tous les leaders étaient imbus des idées de Voltaire et de ses disciples, ou de celles de J.-J. Rousseau qui, malgré ses palinodies, fut toujours plus ou moins libre-penseur. On fut étonné dès la Constituante de voir des évêques, des prêtres, comme Talleyrand ou l’abbé Grégoire renoncer à leur vocation et se proclamer libres-penseurs.
Danton, Marat, Mirabeau, étaient des libres-penseurs convaincus. Marat, abominablement calomnié par la plupart des historiens était un grand savant et un homme intègre, Robespierre, l’incorruptible Maximilien, a fait du mal à la Révolution et au monde par ses idées théistes et la réintroduction de la religion en France ; mais quand on compare la vie et l’intégrité de Robespierre avec la vie et les actions de nos hommes d’Etat, on est forcé d’admirer cet homme malgré sa mauvaise influence contre la libre-pensée. Saint-Just, Lebas, Couthon étaient des héros aux idées plus avancées que leur leader. Hébert, le rédacteur du Père Duchesne, se servait du langage grossier de certaines couches populaires pour convertir ces hommes aux idées révolutionnaires et athées. Barras et les réactionnaires qui ont renversé le régime de Robespierre n’étaient pas libres-penseurs. C’étaient des arrivistes à la façon de nos parlementaires, de nos ministres, beaucoup étaient des hommes vicieux restés chrétiens.
Nous avons oublié de parler d’hommes qui ont eu une grande importance comme Helvétius, dont les volumes : De l’Esprit, et Du Bonheur, sont franchement athées.
Pendant la période révolutionnaire parurent des ouvrages importants pour la libre-pensée, par exemple Les Ruines des Empires, par Volney, publiées en 1791 ; elles ont été souvent rééditées. L’énorme ouvrage de Dupuis, Origine de tous les cultes, qui porta des coups formidables aux théories chrétiennes, date de 1795 ; Sylvain Maréchal, auteur du fameux dictionnaire des athées, publia en 1797, son Code d’une Société d’hommes sans dieu ; en 1798, les Libres-Pensées sur les Prêtres ; en 1799, les six volumes de son ouvrage athée Voyage de Pythagore. Le Dictionnaire des athées ne parut qu’en 1800. Il a été agrandi par le grand astronome athée Lalande.
Parmi les plus grands savants de l’époque révolutionnaire et napoléonienne, nuls noms ne mériteraient plus d’être loués que ceux de Lamarck, fondateur du transformisme (1744–1829) et de Laplace (1749–1827). Celui-ci a dit :
« Il n’est aucun besoin de l’hypothèse Dieu. »
Tandis qu’au XVIIIème siècle en France, la libre-pensée prenait conscience de sa force ; en Angleterre, il y avait quelques esprits puissants, comme l’historien, philosophe et sceptique Hume (prononcer Youme, 1711–1776), qui avait brisé les chaînes qui tenaient l’esprit humain attaché au christianisme et plus tard au déisme. Hume avait même influencé Voltaire dans sa jeunesse ; mais il n’y avait pas de mouvement libre-penseur prononcé en Grande-Bretagne.
Un autre écrivain, Gibbon (prononcez Ghibene), 1737–1704, grand historien, élevé à Lausanne, y subit l’influence de Voltaire et dans son énorme ouvrage Déclin et chute de Rome, il fouailla les crimes du christianisme et montra la futilité de cette religion. Gibbon est encore lu par tous les intellectuels de langue anglaise, son œuvre devenue classique et souvent réimprimée a actuellement une influence heureuse sur les universitaires.
Robert Owen (prononcez Roberte Oenne), réformateur social né en 1771, ne se fit connaître par ses ouvrages qu’en 1810. Nous parlerons de lui parmi les libres-penseurs du XIXème siècle. Il en sera de même du très grand poète athée Shelley, né en 1792.
En Allemagne, le protestantisme au nord et le catholicisme au sud avaient empêché tout progrès de la libre-pensée, mais Frédéric II de Prusse, voltairien dès sa jeunesse, voulut, une fois sur le trône, empêcher la libre-pensée de se répandre parmi le peuple, il fit supprimer des livres allemands à tendance sceptique, comme un ouvrage de Gébbhard attaquant les miracles de la Bible ; il fit emprisonner un jeune homme Rüdiger pour la même offense, mais quand il fut persuadé qu’il était assez fort pour résister à la poussée antireligieuse révolutionnaire il appela à sa cour des incrédules notoires comme La Mettrie, qui mourut à Berlin, le marquis d’Argens, Robinet (1735–1820). (I1 ne faut pas confondre ce Robinet avec le positiviste Robinet). Au XIXème siècle, cet écrivain peu connu était un ex-jésuite, qui en 1776, publia un ouvrage libre-penseur : De la Matière.
Il y eut alors un réveil de l’esprit public, mais la plupart des écrivains restaient déistes, comme G. Schaie , Edelmann, Bœhrd, Basedow (1723–1790), réformateur de l’éducation : Reimans, Moses, Mendelssohn.
Le plus grand poète dramatique allemand, Schiller (1759–1805), auteur des drames Les Brigands, Guillaume Tell, etc., et de l’Histoire de la Guerre de trente ans, était rationaliste, quoiqu’il n’ait pas laissé d’œuvre traitant spécialement le sujet de la religion et de l’anti-religion.
Kant (1724–1804), célèbre philosophe qui effectua une révolution dans la philosophie allemande par ses œuvres : Critique de la Raison pure ; la Religion dans les limites de la Raison pure, était un rationaliste qui eut une très grande influence. Il y a bien des critiques qui le considèrent encore comme le représentant le plus remarquable de la philosophie en Allemagne, qu’il a laissé dans l’ombre Schelling, Fichte, Hegel et l’énorme liste de philosophes allemands dont la plupart sont des libres-penseurs timides.
Gœthe, le plus grand poète allemand (1749–1832) était résolument rationaliste. Il a écrit que ce qu’il haïssait le plus c’était la croix (le christianisme) et les punaises. Dans une lettre à l’écrivain suisse Lavater, Gœthe a écrit : « Jamais rien ne pourra me convaincre, fût-ce une voix prétendue divine, que l’eau peut brûler, que le feu peut étancher la soif, qu’une femme peut concevoir sans l’aide d’un mâle, qu’un mort peut ressusciter, etc. ». En politique, en histoire, en roman, son influence a été immense. Il commence sa carrière dramatique par la pièce révolutionnaire Gœtz von Berlichingen, puis vinrent Egmont, où il décrit le noble caractère de la victime Egmont luttant contre la tyrannie catholique des Espagnols dans les Pays-Bas. Dans Faust, on voit le diable faire un pari avec Dieu, tous deux de tristes sires, Gœthe était un savant qui admirait les idées de l’évolution propagées par Geoffroy Saint-Hilaires, Lamarck, etc. Après Gœthe la libre-pensée eut de grands représentants en Allemagne, Buchner, Feuerbach, von Hartmann, Schopenhauer, Nietzche, Karl Marx, Engels et toute l’école socialiste de 1848.
Les Allemands du Nord, moins fanatiques que les Bavarois et les habitants des bords du Rhin étaient plus indifférents, vraiment libres-penseurs, tandis qu’en Bavière le cléricalisme était et est encore tout puissant. Les rationalistes étaient pourtant groupés en plusieurs grandes associations qui n’ont cessé de lutter contre le clergé.
Je donnerai avant de terminer un tableau succinct des organisations qui englobent les libres-penseurs et je parlerai de leur presse.
En Autriche, sous l’empire, le cléricalisme était le maître. Il n’y avait aucune liberté pour les libres-penseurs excepté en Bohème, où la lutte contre le catholicisme se poursuit activement.
Avant la guerre mondiale, il y avait à Prague trois journaux libres-penseurs, la Volna Myslenka (La Libre-Pensée), la Volna Skola (Ecole libre) et Havlicek, nom d’un grand écrivain tchèque libre-penseur. Mais peu après 1900, le gouvernement impérial interdit toute propagande, ferma les sociétés rationalistes et s’empara de leur argent. Il va sans dire que tous les libres-penseurs tchèques haïssaient le gouvernement autrichien. A peine la république fut-elle proclamée qu’un libre-penseur qui avait souffert pour ses idées. M. Massaryk, fut élu président de la république. Lors du Congrès international de la libre-pensée, M. Massaryk reçut favorablement les membres du Congrès. Depuis lors, il y a eu parmi les libres-penseurs une scission dont je ne comprends pas la portée. Un vieux lutteur Bartosek a été exclu parce qu’il voulait faire de la propagande communiste.
Les libres-penseurs tchèques sont très actifs, leur propagande est prospère, ils publient de nombreux volumes.
En France, les guerres de Napoléon, qui absorbaient toute l’énergie du pays empêchèrent les progrès de la libre-pensée parmi le peuple. La Restauration, le règne de Charles X et les mesures réactionnaires retardèrent aussi le mouvement. Mais déjà on voyait poindre une renaissance des idées sociales. Fourier (1772–1837) créateur de la théorie phalanstérienne qui eut de nombreux et distingués disciples était libre-penseur, mais il croyait à la transmigration des âmes. On peut faire remonter à lui l’idée de la coopérative de production, tandis que celle de consommation peut-être attribuée à Robert Owen (dans son ouvrage Nouvelles vues sur la Société, Essais sur la Formation du Caractère 1810–1815). Le réformateur écossais était un ennemi acharné du christianisme et un grand partisan de la réforme scolaire. On venait de tous les pays voir ses écoles et ses établissements où il avait su transformer la nature de ses ouvriers corrompus, en d’utiles travailleurs. Toutefois ses essais de communautés en Amérique (New-Harmony) et en Angleterre firent fiasco.
Son fils Robert Dale Owen, mort en 1877, fut un des aides de son père à New-Harmony, et un libre-penseur convaincu dans ses nombreux écrits. Devenu citoyen américain, il fut chargé d’affaires à Naples. Pendant la guerre civile, il défendit l’affranchissement des esclaves. Après 15 ans d’efforts au Parlement de Washington, il réussit à faire accorder aux femmes de l’Indiana, le droit de posséder en leur nom.
En France, Cabet, sous Louis-Philippe, était resté chrétien, mais avec une forte teinte d’idées communistes, qui le conduisirent à la fondation de la commune d’Icarie qui exista dans l’Iowa jusque vers 1900.
Auguste Comte (1778–1857), fondateur du positivisme, théorie philosophique qui n’admet que les vérités prouvées par les sciences, développa ses idées philosophiques dans son grand ouvrage Cours de Philosophie positive (1830–1842) qui renversa toutes les idées de philosophie a priori ; mais plus tard, déjà touché par la folie, il écrivit sa Politique positive, sorte de religion athée avec toute une hiérarchie calquée sur le catholicisme. La Philosophie de Comte eut surtout pour disciples Littré, Wyroubov, etc. L’organe de Littré et de Wyroubov Revue de Philosophie positive, parut de 1867 à 1883.
A partir de 1848, le rationalisme a pris une extension remarquable. On peut dire que la philosophie de Littré, etc. s’est imposée. A part quelques esprits conservateurs, tous les savants, tous les écrivains remarquables ont abandonné les vieilles fables religieuses. Proudhon, le propagateur de l’anarchie, ne mâchait pas ses mots. Ses œuvres contiennent des attaques furibondes contre le christianisme. Tous ses partisans étaient des libres-penseurs ardents. Il fut suivi par Bakounine, Kropotkine, les Reclus, J. Grave, Malato, Séb. Faure qui dénonça, à travers le pays, en paroles ardentes, les « Crimes de Dieu », en un mot par tous les libertaires. Il y eut une autre école aussi négative que la philosophie de Proudhon, c’est celle du baron Colins, auteur d’énormes volumes indigestes, dont une vingtaine ont été publiés par ses disciples Hugontobler, A de Potter, Poulain, Frédéric Bordes, etc., et par leur organe La Philosophie de l’Avenir. Cet « avenir » n’a pas admis les théories de Colins, le fondateur du « socialisme rationnel ». Colins avait dit :
« L’idée d’un dieu est aussi raisonnable que celle d’un bâton avec un seul bout. »
Blanqui, le fameux révolutionnaire qui passa une grande partie de sa vie en prison, est l’auteur de la devise : « Ni Dieu, ni Maître », qui fut le titre d’un journal de ses partisans. Tous les blanquistes, ces jacobins modernes étaient aussi d’ardents libres-penseurs.
La Commune de Paris en 1871 était dirigée par des Jacobins comme Félix Pyat, Vermorel, Delescluse, etc. qui tous auraient bien voulu anéantir la puissance de l’Eglise tout en installant une nouvelle forme d’Etat fédéraliste. La minorité plus socialiste que les chefs n’était pas moins opposée à la religion, toutefois on ne peut attribuer aux idées antireligieuses la mort de l’archevêque de Paris, du Président Bonjean, des fusillés de la rue Haxo. Ces fusillades étaient le résultat de haines politiques qui n’avaient rien à voir avec le mouvement rationaliste. Les massacres par les Versaillais, les torrents de sang versé par les valets de Thiers, de Galiffet, etc. n’arrêtèrent pas le progrès de la libre-pensée. Au contraire, les réfugiés qui avaient échappé aux hécatombes portèrent à l’étranger avec les idées d’affranchissement des peuples, l’idée de liberté de la pensée. Le rationalisme étouffé en France quelque temps reprit de plus belle. Malheureusement les chers socialistes, par esprit politique, pour ne pas offusquer les électeurs non encore débarrassés des vieilles superstitions, ont proclamé le principe que la religion était une affaire individuelle. Ils ont fermé les yeux sur les progrès énormes que fait le cléricalisme ; les écoles laïques créées avec tant de peine dans le dernier quart du XIXème siècle sont ébranlées par l’influence des femmes. Les maîtresses laïques sont mises à l’index dans certaines provinces, les écoles n’ont presque pas d’élèves, car les parents menacés par les partisans de l’Eglise craignent de perdre leur situation, leur gagne-pain. Les socialistes, aveugles volontaires, ne veulent pas voir qu’en abandonnant la libre-pensée, ils ouvrent la voie à la réaction la plus noire, ce qu’on voit en Italie, en Espagne et dans les départements où la libre-pensée n’a pas d’influence. Gare à la civilisation si le cléricalisme ou même le socialisme officiel viennent à être victorieux !
Pourtant les recherches scientifiques à la Sorbonne et dans d’autres laboratoires font progresser la science et démontrent l’absurdité des théories théistes. Si quelques savants comme Pasteur, Lapparent, Branly, sont restés chrétiens, c’est que, absorbés par leurs recherches, ils n’ont jamais tenté d’aller plus loin, et de plus, les Branly et les Lapparent, professeurs dans les universités catholiques, auraient pu perdre leurs places s’ils avaient dit qu’ils étaient libres-penseurs : ils ont trahi leurs idées libres-penseuses par politique.
Malheureusement nous avons vu de notre temps des palinodies honteuses : les Briand, les Millerand, etc. Après avoir prêché la grève générale ils ont fait arrêter ceux qui avaient mis en pratique leurs méthodes. Millerand fut le premier à envoyer une ambassade au Vatican. Nous voyons le résultat de ces honteuses manœuvres, le cléricalisme sera le maître de la situation. Déjà les Jésuites, les frères ignorantins, ont de longues processions d’élèves qu’ils abrutissent et dont ils feront les soutiens de l’Etat bourgeois et obscurantiste
Au XXème siècle la situation a empiré. Les ouvriers occupés de leur gagne-pain, ne pensent plus à leur cerveau, ils élisent des députés, des sénateurs et ne voient pas les nuages noirs qui vont fondre sur la pensée humaine.
En France, il n’y a presque plus de sections organisées de la Libre-Pensée. La presse se réduit à un ou deux petits journaux, comme le Libre-Penseur de France. Une Union fédérale des Libres-Penseurs révolutionnaires de France existe, parait-il, mais son programme est strictement marxiste, donc assez éloigné de la lutte antireligieuse. La Fédération nationale des Libres-Penseurs de France (dont Lorulot est le propagandiste officiel) est influencée par les tendances libertaires de l’Idée Libre, organe qui consacre à la propagande rationaliste un effort suivi et des pages intéressantes.
En Suisse, il y a une Fédération romande de la Libre-Pensée, dont l’organe est la Libre-Pensée internationale. Cette Fédération a quelques sections, mais elle ne fait guère de recrues. Les jeunes gens ne pensent plus qu’aux sports et ne lisent rien. Le journal anarchiste Le Réveil de Genève, et sa partie italienne Il Risveglio, sont de bons défenseurs de la libre-pensée.
Dans la Suisse allemande ou alémanique, il y a une fédération assez active et un journal Der Freidenker, publié à Bale, et fort bien rédigé. Les libres-penseurs des deux langues assistent aux congrès internationaux. En Allemagne le mouvement montre une énergie très heureuse, mais entachée d’idées marxistes en politique.
Les libres-penseurs organisés comptent au moins un million d’adhérents. Ils publient de nombreux journaux et d’intéressantes et savantes revues, comme Les Cahiers mensuels monistes, organe officiel de la Ligue moniste allemande, qui a des sections dans presque toutes les villes, lesquelles donnent un grand nombre de conférences scientifiques. Mais l’Association la plus nombreuse, c’est l’Union pour la Libre-Pensée et la crémation qui, en 1928, comptait 550.261 membres payants. Cette Union a publié, en 1928, une grosse brochure de 100 pages, in-8°, sur son activité, plaquette intitulée : Notre travail, Nos critiques, illustrée de nombreuses photographies, l’Hôtel de la direction des automobiles pour la distribution des journaux, les salles de réception, de fiches, de dépôt de livres, de séances, de la bibliothèque, de composition typographique, etc. La fortune accumulée est de près de 2 millions de marks or. Avec de telles ressources on peut publier force journaux, revues, livres ; on peut venir au secours des libres-penseurs malheureux, bâtir des crématoires, faire donner des conférences un peu partout. Il n’y a pas, en Europe, d’installations pareilles à celle des libres-penseurs à Berlin. Il y a à côté de l’Union des libres-penseurs prolétariens et autres, d’autres organisations, comme celles qui publient la revue scientifique Urania et le journal Der Atheist. Un ancien moine, Hans Ammon, devenu un éloquent propagandiste de la libre-pensée, publie un petit journal appelé Des Lichtbringen (le porte-lumière ou Lucifer). Sa propagande se fait sentir en Bavière, son pays natal, où il a été exposé à de dures persécutions.
En Tchécoslovaquie paraît en allemand un bon journal allemand, le Freie Gedanke, où écrivent des hommes de talent comme le professeur Drews (auteur du Mythe de Jésus) et le professeur Hartwig de Bruno en Moravie. Ainsi l’Allemagne dame le pion à la libre-pensée des autres pays.
L’Autriche qui, sous l’empire des Habsbourg, était soumise au joug de l’Eglise romaine, se relève à présent. Un journal Der Freidenker (qu’il ne faut pas confondre avec les journaux du même nom publiés à Berlin et en Suisse), paraît à Vienne et fait une propagande remarquable. Il en est de même de Der Atheist. Les anarchistes ont un organe excellent Erkenniniss und Befreinug, à tendances franchement libres-penseuses. Il publie de beaux ouvrages antimilitaristes, etc. La Ligue libre-penseuse d’Autriche s’occupe trop de politique, selon moi, et nuit ainsi à la cause de la libre-pensée. Néanmoins, l’activité des organisations de la libre-pensée en Allemagne et en Autriche est surtout dirigée vers le mouvement de Confessionslos (des sans confession ou mieux sans religion). En Allemagne, en Autriche et même à Zurich, en Suisse, quiconque cesse de vouloir appartenir à une Eglise, doit faire officiellement la déclaration de sa sortie de l’Eglise. Il y a déjà eu plus d’un million de ces renonciations à la religion. Il va sans dire que les autorités locales font tout ce qu’elles peuvent pour empêcher ce mouvement qui diminue les recettes du clergé. Grâce à ce mouvement, les enfants des Confessionslos ne sont plus forcés d’assister aux leçons de religion, excepté dans quelques Etats allemands.
En Angleterre il y a trois grandes associations : l’Association de la Presse rationaliste, qui a pu, grâce aux legs généreux qu’elle a reçus, acheter une grande maison en plein district des libraires et y publier un grand nombre de livres libres-penseurs à bon marché, sans parler de son journal The Literary Guide. Son activité littéraire se fait sentir dans tous les pays où l’on parle anglais. The National Secular Society, fondée par le remarquable propagandiste libre-penseur, Foote, continue la publication du Freethinker (Le Libre-penseur), journal plus énergique que le Literary Guide. Son rédacteur en chef Chapman Cohen a publié de nombreux volumes comme Essais en libre-pensée dont trois tomes ont paru. Le Matérialisme réexposé, etc., etc. Le Freethinker organise dans toutes les grandes villes des conférences, des colloques entre croyants et rationalistes. La National Secular League avait, il y a quelques années, des roulottes où des propagandistes allaient par toute l’Angleterre, s’arrêtant sur les places publiques des villes et des villages pour faire des conférences contradictoire sur la religion. De très nombreux adhérents à la libre-pensée ont été gagnés de cette façon.
L’Ethical Society (Société éthique) a des orateurs de choix qui s’adressent plutôt aux classes intellectuelles, aux instituteurs qu’au peuple même. Les Comtistes qui ont eu des écrivains de premier ordre comme Congreve, Frédéric Harrisson ; etc., font moins parler d’eux depuis la mort de ces leaders. Il existe pourtant une église de l’humanité où l’on fait des discours sur la politique positiviste, etc. Mais ce groupement a peu d’influence.
Aux Etats-Unis le mouvement libre-penseur est très énergique. Les organisations comme l’Association rationaliste américaine, l’A. A. A. A., association américaine pour l’avancement de l’athéisme, la ligue rationaliste de Washington, etc., etc., luttent avec force contre l’obscurantisme qui, dans certains Etats, a fait voter des lois interdisant sévèrement d’enseigner la théorie darwinienne de l’évolution. Dans l’Etat d’Arkansas, l’un de ceux qui possédaient le système de l’initiative emprunté à la Suisse, le peuple a voté une pareille loi défendant d’exposer les théories scientifiques modernes qui peuvent ébranler la foi à la création d’après la Bible. Le président des A. A. A. A. a été emprisonné en 1928, avant même le vote de la loi, pour avoir ouvert une boutique où l’on aurait vendu des ouvrages libres-penseurs. Auparavant un grand orateur, Ingersoll, a pu publier une attaque contre la création sous le titre Les Erreurs de Moise. On a élevé une statue à Ingersoll qui fut même candidat à la présidence des Etats-Unis. A présent on emprisonne un athée parce qu’athée ! Un des plus remarquables journaux libres-penseurs qu’il y ait au monde est le Trussi Seeker, qui a célébré, il y a quelques années, le cinquantenaire de sa fondation.
En Hollande, où pendant longtemps l’ex-pasteur Domela Nieuwenhuys rédigea le Dageraad (l’Aurore), le mouvement s’est un peu ralenti, mais il compte encore des représentants de valeur. Les Flamands publient à Anvers De Tribuun (la Tribune), un bon journal. En Belgique où est le bureau central de la Fédération internationale, il y a quatre journaux : La Pensée, La Raison, Le Penseur, et Le Matérialiste, organe de l’Association prolétarienne.
— G. BROCHER
M. J.-M. Robertson vient de publier une monumentale histoire de la Libre-Pensée au XIXème siècle (History of Freethought in the nineteenth Century, chez Watts et C°, à Londres). Aucun ouvrage de cette envergure n’existe dans d’autres langues. De très beaux portraits des principaux libres-penseurs ornent ce remarquable volume. On y trouve entre autres les portraits des écrivains suivants, avec des études sur leurs œuvres : Bentham, Thomas Paine, Laplace, Strauss, Herbert Spencer, Colenso, G. Holyoake, Darwin, Bradlaugh, Renan, Huxler, Shelley, A. Comte, Proudhon, Rab. Owen, Grote, Ch. Lamb, Emerson, Geddes, Baur, Feuerbach, Büchner, Bain, H. Martineau, George Eliot, Leopardi, Heine, Haeckel, Fylor, Morley, Ingersoll, Guyau, Kuenen, Taine, Lange, etc. Cette liste embrasse la plupart des noms connus sur le continent. Il en est d’autres dont la réputation est limitée aux pays anglo-saxons.
L’ouvrage de Robertson fera bien comprendre le mouvement libre-penseur dans tout le monde au XIXème siècle.
Un chapitre très intéressant est consacré à Thomas Paine, un peu oublié en France, quoique son Age of Reason, commencé dans sa prison à Paris, où il avait été arrêté à cause de ses idées antireligieuses, ait eu malgré son déisme, une immense influence. Ce livre est constamment réédité. Sa tombe, à New Rochelle aux Etats-Unis, est un lieu de pèlerinage pour les libres-penseurs.
Robertson s’étend sur la vie et l’activité sociale de Robert Owen, de même que sur la pléiade d’écrivains éminents qui, depuis le commencement du siècle, ont illustré la pensée libre en Angleterre et en Amérique.
Le 5ème chapitre, avec la belle gravure de Laplace, est consacré aux sciences naturelles avant Darwin, tant en France, qu’en Allemagne et en Angleterre, puis nous lisons la critique biblique jusqu’à Baur, la réaction en Allemagne et en France ; Feuerbach, I. Büchner, ouvrent de nouvelles voies à la pensée philosophique dans leur pays. Herbert Spencer profond philosophe, anarchiste bourgeois, est aussi un grand libre-penseur.
A partir de 1840, la libre-pensée fait de grands progrès en Amérique, l’influence panthéiste de R. Owen se dépasse et Kneeland, fondateur du plus ancien journal de libre-pensée le Boston Investigator (1831) fut condamné en 1833 à deux mois de prison.
— G. BROCHER
LIBRE-PENSÉE
De même que je considère avec inquiétude — du point de vue de l’avenir humain comme de la pureté de nos connaissances ultérieure ! — toute sociologie qui vise au système et s’y emprisonne, toute idéologie qui tend au culte et s’y réduit, de même toute « libre-pensée » me met en alarme et m’apparaît celer quelque tare ou quelques faiblesses invaincues, qui laisse le plus petit domaine en dehors de son investigation.
La libre-pensée est avant tout — sinon elle retourne à l’Eglise — effort vers la pensée libre. Et se situe en marge d’une activité d’esprit qui m’intéresse sympathiquement : quiconque — et avec lui toute modalité intellectuelle — refuse à notre examen et met à l’écart de son propre contrôle, soit une idée, soit une institution, une hypothèse philosophique, une solution sociale, un élan du sentiment ou une édification de la raison, bref dérobe quelque matière ou quelque forme à l’analyse ou n’admet pas, après une première interrogation, qu’elle reste soumise à une permanente vérification. Que ce soit paresse, passivité, parti-pris ou lâcheté humaine, la personnalité abdique ou s’amoindrit qui abrite des « vérités » toutes faites en un tabernacle intangible. Que quelqu’un dresse un autel des notions taboues et s’effondre entre nous le pont des recherches communes. Pas de réserves dévotes et de respects à genoux bas, à regards clos. Pas de régions sucrées interdites à nos pénétrations. Pas de grottes où l’on n’entre pas ; nous voulons voir !
Et la croyance, et le dogme, et la révélation qui muent a priori l’invérifié en certitude, le momentané en immuable, l’inconnu en surnaturel et les soustraient à notre dissection d’abord, à notre révision ensuite, qui, des impénétrés provisoires — impénétrables peut-être — font des inconnaissables certains aux « explications » divines, hissent un mur d’ombre devant nos pas et sont par essence incompatibles avec cet esprit critique qui est à la base de la connaissance et la condition d’un libre-examen sans obstacle, d’une libre-pensée avertie et totale.
Mais par cela même — et c’est d’ailleurs la marque de son audace et de sa virilité, la garantie aussi de sa fécondité — la libre-pensée se doit de tout étudier, d’approcher hardiment de toute zone obscure avec l’espérance de quelque vérité. Le sentiment anticipateur, que d’aucuns nomment religieux (appellation impropre et équivoque, car à la religion se rapportent toutes les « solutions » stagnantes, toutes les données « célestes », soustraites à la démonstration, toutes les impulsions d’acceptation, et nous ne pouvons sans danger laisser appliquer cette terminologie à l’hypothèse, excitant scientifique de l’expérience) le sentiment anticipateur, ancré au cœur de l’homme depuis l’enfance de l’humanité est un des moteurs humains soumis à notre interrogation ouverte et large et l’écarter — à plus forte raison le condamner — sans l’entendre est une faute et un danger. Car tel ostracisme révèlerait une restriction de la méthode et comme le tracé d’un cordon de peur autour de nos curiosités enrichisseuses.
Ce sentiment n’est peut-être que l’impatience puérile de la faculté de savoir. Par les chemins proprement religieux, il mène à la foi aveugle — cette paralysie de la recherche — mais par les aspirations ardentes et vaillamment questionneuses d’une haute avidité humaine, il engendre un idéalisme singulièrement fécond. Il témoigne d’ailleurs d’une assez saisissante vitalité pour que nous nous penchions sur lui hors du sarcasme desséchant et que nous tâtions ses témérités, ses erreurs, ses déviations, ses velléités, aussi ses promesses. Mais le religieux qui vient à nous fermé n’est pas le frère critique du libre-penseur. L’est seulement celui, quelque emprise que conserve encore sa croyance, qui s’ouvre et dit :
« Ensemble, nous qui cherchions toujours, regardons au fond de nous-mêmes comme des choses... »
Il n’est pas (et cela, promptement, va nous garder de l’équivoque et des taquineries intestines), il n’est pas un adepte des religions établies ou des cultes en gestation, qui nous tiendra ce langage de la prudence et du doute et qui, activement, jettera dans le crible les absolus de son cerveau ou les enseignements définitifs de ses prêtres. Mais, par contre, qui fait ce pas loyal vers la lumière est — des vocables seuls encore nous éloignent — virtuellement déjà des nôtres...
L’accueil que nous offrons ainsi à l’adepte des théocraties classiques, nous le tenons prêt pour l’illuminé des filiales rajeunies du déisme. Mais si sympathique en apparaisse l’allure, si voisines de nos espérances en soient parfois les gestes familiers, si orientée vers la liberté ressorte leur attitude pratique, nous ne pouvons regarder sans défiance les courants dont l’esprit ramène à la superstition. Quels que soient leur figure moderniste, leurs vêtements et leur adaptation scientifique — voire certaines de leurs attaches — nous attendons, sans adhésion précipitée (quoique disposés à promener nos flambeaux droits parmi les arcanes nouvelles), les invitations et les éclaircissements du spiritualisme et de ses dérivés (théosophie, occultisme, magie, astrologie, etc.) comme de toutes les tendances et des réactions (sentimentales pour la plupart) qui accordent à la foi plus de place qu’à la preuve et n’établissent de liaison avec « l’au-delà » (Dieu ou Cosmos) qu’à la faveur de la supercherie ou de la suggestion et n’apportent à nos questions inquiètes d’autre réponse qu’un credo...
De même nous demeurons sceptiques à l’égard des systèmes — sociaux ou autres, et arborassent-ils l’étiquette libertaire — pour lesquels leurs protagonistes refusent d’attendre le baptême des faits et la consécration de l’expérience et vis-à-vis desquels la critique, bien qu’animée d’un loyal souci de réformation, est accueillie avec une impatience hostile et des manifestations d’intolérance. Qui ne supporte dès aujourd’hui la discussion de ses constructions favorites sera, dans l’avenir, si les événements lui répondent, le gardien sectaire d’une forme périssable et l’ennemi d’un mieux attendu. La libre-pensée ne peut s’enfermer dans le champ préconçu des doctrines. Elle a besoin de confronter et de mettre en balance, de ne donner aux solutions qu’on lui apporte qu’une adhésion révisable, de tenir ouverte à « l’élément nouveau » sa confiance et sa raison. Elle ne peut — ce serait sa condamnation et sa perte — s’adapter à la mentalité fermée du partisan, ni épouser l’esprit de corps des organisations et des clans.
C’est assez dire que nous ne pouvons nous approcher sans réserves de ceux — hommes ou groupes — qui, cantonnés dans un anticléricalisme « homaisien », témoignent, par leurs actes essentiels, de la persistance d’une inquiétante religiosité. Ils sont encore prisonniers du passé et libres-penseurs seulement d’intention les militants qui poursuivent les pratiques des religions régnantes et n’ont pas affranchi leur propre pensée et leur vie, des habitudes de fanatisme et de crédulité. Autour de leur esprit rôdent et se reforment les conspirations de l’intolérance et du dogme. Si les préjugés et le parti pris se sont retirés d’une fraction de leurs opinions, la méthode en demeure dépendante et d’autres conceptions, persistantes ou prochaines, révéleront la nécessité de leurs victoires et en attesteront la limitation. D’hostiles timidités et des préventions insurmontées les retiennent au seuil des critiques viriles. Là où nous situons la table rase préalable et le qui-vive permanent s’installent encore en maîtresses des croyances de remplacement... D’autre part, nombreuses sont toujours, parmi les sociétés qui se réclament de la libre-pensée, celles qui s’agitent dans le sillage, trompeusement démocratique, du pouvoir et ne s’élèvent que faiblement au-dessus des associations politiques, celles aussi qui s’avèrent, avec plus ou moins de franchise, les succursales des comités électoraux. Aux uns et aux autres il manque cette audace et cette volonté d’examen, et cette indépendance de mouvement sans lesquelles la pensée n’est qu’une mineure en tutelle
La libre-pensée qui veut vivre ne s’effraie ni des similitudes égarantes, ni des apparences, ni des mots. Ce fut le vice et la courte vue de celle d’il y a quelque vingt ans encore (et elle est loin d’en être partout libérée) et une des causes de sa stagnation et de son étiolement, que de s’être rétrécie à l’anticléricalisme superficiel, à la dénonciation plus qu’à la réfutation, à la localisation religieuse, à la pâle sociologie réformatrice, à d’indignes et illogiques mesures sociales, de s’être confinée dans un matérialisme trop concret et comme fini, encadrée dans des principes stabilisés et au seuil de cette rigidité pleine de contradictions dont est mort, par ailleurs, le positivisme religiosâtre. Une sorte de suffisance doctorale y trônait sur des aphorismes simplistes et laissait se réinstaller dans les mœurs un dogmatisme paradoxal. Et la science dont elle se réclamait, débordait de toutes parts ses cloisonnements, ses proscriptions sectaires mêlées d’hésitations quasi rituelles, et soulignait l’enfantillage et l’aridité de ses anathèmes... La libre-pensée (que cet esprit et cette volonté animent ses groupements comme ses individualités) doit être forte, mais expansive hardie et vivante, et aller au-devant de toutes les forces mystérieuses encore de la vie...
— S. M. S.
LICENCE
« D’accord avec vous — me disait un jour un bourgeois libéral et sympathique — la liberté, toute la liberté, mais pas la licence. » Mais vous vous gardiez bien ô bourgeois sympathique et libéral, de définir ce que vous entendez par « liberté » ; et quelle signification vous donnez à « licence »!... Je n’ignore pas malgré votre silence, les allures et les démarches de « votre » liberté : on peut se promener avec elle sans crainte de se faire remarquer ni risquer de se taire taxer de ridicule. « Votre » liberté est une personne bien élevée, qui jouit de ressources avouables, qu’on emmène avec soi en visite, qui ne dit mot avant qu’on l’ait priée de parler et qui justifie si bien qu’on puisse se passer de gendarmes, de garde-chiourmes et de bourreaux que, dans les derniers salons où l’on cause, l’autorité est la première à lui offrir une tasse de thé. « Votre » liberté est comme « votre » anarchie : à l’usage des honnêtes gens et des gens comme il faut. L’essence de « ma » liberté, c’est justement la « licence », autrement dit tout ce qui, dans la liberté, vaut la peine d’être vécu, car somme toute — pour m’en tenir à la définition de « vos » dictionnaires — ce n’est point être libre que de n’user que « modérément » d’une faculté concédée, que d’être astreint à une conduite « réglée », que de se contraindre à des paroles et à une conduite « convenables ». L’autorité est toute disposée à me « concéder » tout cela et même quelquefois un peu plus. « Ma » liberté implique la faculté d’user immodérément des « droits » que j’arrache, d’avoir une conduite « irréglée », de parler et d’écrire de façon « inconvenante » et de me comporter de-même. Etant entendu que je n’entends point, isolé ou associé, me ou nous imposer à autrui, autrement dit amener autrui à faire comme je le fais, comme nous le faisons, à nos risques et périls, si cela ne lui agrée point.
Si nous passions contrat pour habiter sous le même toit, sur le même terrain, temporairement ou durablement, dans une maison commune, dans une colonie, par exemple, réunissant plusieurs groupes, ce serait à la condition sine qua non que personne n’intervînt dans la salle, la partie du logement ou la parcelle de terrain occupée par nous, pour entraver ou critiquer notre façon « licencieuse » de vivre notre vie « en liberté ». Sinon, je me sentirais, nous nous sentirions aussi esclaves que dans le milieu dont nous voulons nous évader, justement parce qu’il veut émasculer la liberté en en éliminant la licence, c’est-à-dire selon notre définition, l’élément dynamique, virilisateur. Et ces dernières lignes pour jeter un peu de clarté sur l’éthique de l’associationnisme tel que le comprennent les individualistes anarchistes.
— E. ARMAND
LIGUE
(bas-latin liga et italien lega, de legare, lier)
Au cours des siècles, on qualifia ligues maintes confédérations et alliances de princes ou d’Etats, maintes associations fondées dans un but quelconque, et même de simples cabales. Sans remonter aux Ligues Achéenne, Etolienne et autres, fameuses chez les anciens, on trouve plus près de nous : la Ligue du Bien Public qui groupa les seigneurs contre Louis XI en 1465 ; la Sainte-Ligue dirigée par le pape Jules II contre Louis XII ; la Ligue du Rhin fondée en 1680 pour garantir le maintien du traité de Westphalie, Louis XIV en fut le protecteur ; la Ligue d’Augsbourg conclue en 1686 contre ce dernier roi ; la Ligue de Neutralité Armée qui opposa la Russie et la Suède, en 1800, puis la Prusse et le Danemark à l’Angleterre. On a donné aussi le nom de Ligue à l’entente des villes hanséatiques d’Allemagne, associées à partir de 1241, pour la protection de leur commerce et la défense de leurs franchises, ainsi qu’à la Confédération des peuplades helvétiques qui devait aboutir à la formation de la Suisse. Mais, du point de vue historique, la Ligue par excellence, ce fut la Sainte-Ligue, fondée sous Henri III, par les catholiques ; son caractère profondément religieux lui donne un intérêt tout spécial.
Dès 1507, Lefèvre d’Etaples avait constitué en France un groupe de réformateurs dont les doctrines s’apparentaient à celles que le protestantisme devait bientôt professer avec tant d’éclat. Malgré la Faculté de théologie de Paris et le Parlement, malgré l’autorité royale devenue persécutrice après 1534, les idées nouvelles, et particulièrement celles de Calvin, se répandirent rapidement ; propagées au début par des moines et des prêtres, outrés de voir les riches prébendes ou les hautes fonctions aux mains des nobles ignares et crapuleux. Humbles desservants, religieux lettrés firent défection en grand nombre, heureux de fuir une Eglise qui ne rappelait en rien celle des chrétiens primitifs ; entre catholiques et protestants, l’abîme, d’ailleurs, était moins profond que celui qui sépare, à notre époque, les libres-penseurs des croyants. L’ordre des Augustins en particulier fournit des apôtres à la Réforme, comme le prouve le long martyrologe de ceux qui souffrirent pour la nouvelle foi ; ils trouvèrent des imitateurs dans les autres congrégations et parmi les séculiers. Un carme est poursuivi à Clermont en 1547, et un dominicain est brûlé à Castres ; sur quatre hérétiques condamnés au feu par le Parlement de Bordeaux en 1551, il y avait deux prêtres ; un théologien est exclu de la Faculté de Paris, en 1552 pour avoir pris part à la cène protestante ; en 1555 le cordelier Rabec est condamné au feu pour crime d’hérésie ; en 1557 l’abbesse de Saint-Jean de Bonneval, qui entretenait des relations épistolaires avec Calvin, doit se réfugier à Genève, ainsi que huit de ses religieuses ; et la même année on réglemente la prédication à Paris, tant le nombre des prêtres favorables à la Réforme s’était révélé grand, à l’occasion des sermons du Carême. Maîtres d’école et régents de collège favorisèrent également la diffusion du protestantisme ; on les surveilla de près, leur enjoignant de mener leurs élèves à la messe sous peine de la hart. Un étudiant, coupable d’avoir brisé des images saintes, fut exposé trois jours au pilori, puis, malgré sa jeunesse, condamné à l’emmurement définitif dans un monastère. Son cachot, spécifièrent les juges, n’aura qu’une fenêtre garnie de barreaux permettant de passer la nourriture, « il finira ses jours et consommera le reste de sa vie au dit lieu, en lamentation, douleur et desplaisance desdits crimes et délitz ».
La répression catholique fut sans pitié. De décembre 1547 à janvier 1559, la Chambre Ardente prononça au moins 500 arrêts en matière d’hérésie ; les victimes furent nombreuses, les supplices effroyables. Après avoir été mis à la question, fouettés de verges, essorillés, tenaillés, les suspects étaient jetés dans des prisons sans jour sur l’extérieur, où l’eau croupissait parfois et qui, dans d’autres cas, ne permettaient de se tenir ni entièrement debout, ni entièrement couché. Le Grand Châtelet contenait des cachots d’où, selon la rumeur publique, personne ne sortait vivant. La peine du feu était courante. Si le condamné s’engageait à ne point parler au peuple, il était quelquefois, par mesure de bienveillance, étranglé avant d’être brûlé ou « après avoir un peu senty le feu », mais s’il refusait de se taire on lui coupait la langue avant le supplice. Prêtres et magistrats redoutaient l’impression faite sur la foule par l’inébranlable conviction des martyrs. En réalité, les persécutions eurent pour résultat d’accélérer la diffusion du protestantisme qui s’organisa d’abord en église et, plus tard, en parti politique. L’ère des combats et des traités succéda à l’ère des martyrs ; la Réforme perdit peu à peu l’exaltation mystique qui avait brillé sur son berceau. Intolérant dans les régions où il fit la loi, le calvinisme gardera en France le rôle de persécuté, généralement ; la Saint-Barthélemy, en 1572, sera le signal d’un massacre global des huguenots. A Paris il y eut 2.000 victimes environ, 800 à Lyon, 1.000 à Orléans ; à Meaux deux cents personnes arrêtées le 25 août furent égorgées le 26 ; à Bordeaux, les autorités organisèrent méthodiquement la tuerie ; à Toulouse, deux conseillers au Parlement guidaient les assassins. Des manifestations miraculeuses entretinrent la rage homicide : une madone parisienne pleurait sur les impiétés des hérétiques. Le pape fît allumer des feux de joie et frapper une médaille en l’honneur de cette mémorable journée ; en son nom et au nom du Sacré-Collège, le cardinal Orsini vint féliciter Charles IX et Catherine de Médicis proclamés les plus fermes appuis du catholicisme.
Mais les calvinistes relevèrent la tête ; et, en 1576, leurs adversaires, se jugeant abandonnés par le roi, formèrent une association puissante, la Ligue, qui se chargea d’assurer le triomphe des doctrines anciennes. Préparée de longue date, elle acheva de prendre forme en Picardie, quand le gouvernement et les habitants de Péronne refusèrent de livrer cette place forte au protestant Condé. Les calculs d’Henri III et de la maison de Lorraine lui permirent bientôt de s’étendre à l’ensemble du pays. Henri de Guise, dont on portait la vaillance aux nues et qui savait capter le cœur des foules, fut son chef réel. Contre les, réformés la Ligue commandait la guerre ; contre les neutres elle usait de « toutes sortes d’offenses et molestes », tenant pour adversaire quiconque refusait de s’enrôler. Ses affiliés étaient poursuivis en leurs corps et biens s’ils venaient à se dédie : ils juraient « prompte, obeyssance et service au chef qui sera député », se promettant de plus aide et appui mutuel. Aux Etats-Généraux de Blois, les députés, presque tous ligueurs, déclarèrent ne vouloir dans le royaume « qu’une foi et qu’une loi ». En conséquence Henri III, qui était suspect aux catholiques mais se donnait comme chef de la Ligue, abolit l’Edit de Beaulieu jugé trop favorable aux protestants. Survinrent la sixième et la septième guerre de religion qui rétablirent les affaires des réformés, la Ligue disparut. Elle se reconstitua lorsque la mort du duc d’Anjou, en 1584, fit de Henri de Navarre l’héritier présomptif de la couronne ; cet huguenot, converti une première fois lors de la Saint-Barthélemy pour redevenir calviniste en 1516, ne pouvait recevoir l’huile de la sainte ampoule, ni jurer de défendre l’Eglise catholique. Les Guise conçurent de hauts desseins ; et de complaisants généalogistes établirent qu’ils descendaient de Charlemagne. Mais, pour ménager les transitions, ils mirent en avant la candidature au trône du vieux cardinal de Bourbon, que le pape devait délier de ses vœux et qui, en mourant, cèderait la couronne à Henri de Guise. Philippe II d’Espagne promit son concours et le pape déclara Henri de Navarre et le prince de Condé déchus de leurs droits. A Paris, les premiers ligueurs, constitués en société secrète, choisirent un conseil dirigeant qui avait la haute main sur tout, sans paraître nulle part. Conduite avec prudence, la propagande se faisait d’homme à homme et l’affiliation n’avait lieu qu’après enquête. De la bourgeoisie moyenne le recrutement s’étendit dans le monde du Parlement et de l’Université, ainsi que parmi les ouvriers des corporations et les travailleurs des ports, halles et marchés.
Des émissaires furent envoyés en province ; en juin 1587 les ligueurs de Paris avaient déjà contracté un accord avec ceux de Lyon, Toulouse, Orléans, Bordeaux, Nantes, Bourges, et d’un grand nombre d’autres villes. Des prédicateurs fanatiques tonnaient dans les chaires ; ils prenaient leur mot d’ordre près de Mme de Montpensier, la sœur des Guise, qui se vantait de faire plus avec leurs sermons que ses frères avec leurs armées.
En mai 1588, le duc de Guise, entré à Paris, malgré les ordres du roi, fut acclamé par la foule ; une émeute éclata, des barricades surgirent et Henri III dut solliciter l’intervention du chef de la Ligue pour apaiser le tumulte. Mais, le 23 décembre suivant, ce dernier, appelé au Louvre, fut tué par les quarante-cinq bretteurs de la garde royale, dans la chambre de Henri III ; le cardinal de Guise fut massacré le lendemain. Alors la haine contre le roi monta jusqu’au délire ; pour les ligueurs parisiens il ne fut plus qu’un « assassin, antéchrist, cafard, Sardanapale » ; des moines décapitèrent sa statue ; on envoûta son image sur les autels ; des enfants porteurs de cierges les éteignirent en demandant à Dieu d’éteindre ainsi la vie des Valois ; et les prédicateurs s’étendirent longuement sur la légitimité d’un régicide. Frère Clément, jeune religieux de vingt-deux ou vingt-trois ans, se chargea de punir le coupable. Encouragé par un théologien, il pria, mortifia sa chair, eût des visions et entendit des voix célestes qui le fortifièrent dans sa résolution. Des âmes pieuses lui remirent une soi-disant lettre de recommandation pour le roi ; introduit près d’Henri III sans défiance, il le frappa d’un coup de poignard au ventre. Puis, debout, les bras étendus en croix, Clément attendit la mort, sûr de monter au ciel. Pour commémorer cet assassinat, le Parlement de Toulouse décréta qu’il y aurait des réjouissances publiques le 1er août ; les autres Parlements témoignèrent de sentiments identiques. A Paris, les duchesses de Nemours et de Montpensier glorifièrent le meurtrier dans les églises et sur les places publiques : le peuple but, chanta, dansa « avec des voix d’allégresse poussées au ciel » , Grégoire XIV fit tout pour détacher la noblesse et le clergé du nouveau roi Henri IV ; ses desseins furent secondés par un groupe de ligueurs intraitables, les Seize, qui devinrent l’âme de la résistance catholique. Groupant plus de 30.000 adhérents, prêtres ou laïques, ils tenaient Paris grâce au réseau serré de leur police, surveillaient les suspects, poussaient dans les charges ceux dont le zèle s’affirmait, et rayaient impitoyablement ceux dont le dévouement semblait s’amoindrir. Après des péripéties nombreuses où les succès suivirent les revers, la Ligue fut mortellement atteinte, en 1593, par l’abjuration d’Henri IV qui estima que Paris valait bien une messe. A genoux, devant l’archevêque de Bourges, le prince renonça au protestantisme et jura de vivre et mourir dans la religion catholique ; puis, toujours à genoux, il entendit la messe, réitéra son serment et communia. Ceci se passait le 25 juillet, dans la Basilique de Saint-Denis ; pourtant lui-même déclarait que sur bien des points : l’autorité du pape, l’existence du purgatoire, le culte des saints en particulier, il ne pouvait admettre les affirmations de l’Eglise romaine. Il paraît qu’il fit néanmoins des miracles, après son sacre : sur cinq ou six cents scrofuleux qui touchèrent ses mains sanctifiées par le divin chrême, quelques-uns parvinrent à guérir. On cria au prodige et la Sorbonne, qui l’avait âprement combattu, se porta garant de son orthodoxie. N’est-il pas vrai que les comédies de l’histoire sont riches en précieux enseignements ? Miracles et visions furent prodigués par Dieu en faveur d’une cause que les catholiques eux-mêmes condamnent aujourd’hui ; la Vierge aux pleurs de la Ligue précéda celle de Marie Mesmin ; les extases du moine Clément évoquent celles de fanatiques contemporains. Et l’on voit combien de crimes furent commis au nom de Jésus ; et quel caractère intéressé présentent d’ordinaire les croyances des grands ou des rois. Puis il apparaît que les choses n’ont guère changé, quand on observe ce qui se passe aujourd’hui.
Si du XVIème siècle nous descendons à l’époque contemporaine, il convient de signaler plusieurs Ligues dont l’action s’est exercée en sens divers : Ligues belge et française de l’Enseignement ; Ligue des Droits de l’Homme ; Ligue des Patriotes, etc. Fondée en 1864, par un groupe de libéraux, la Ligue belge de l’Enseignement eut, dès l’origine, un caractère à la fois politique et pédagogique. Elle lutta pour l’abrogation de la loi de 1842 sur l’enseignement primaire ; ouvrit en 1876 l’Ecole Modèle de Bruxelles, pour expérimenter les nouvelles méthodes ; puis, tout en conservant son indépendance, acquit un caractère presque officiel après les élections de 1878, qui donnèrent, pour un temps, la majorité aux libéraux. Jean Macé assista au deuxième Congrès qui se tint à Liège en 1866 ; il fut le fondateur de la Ligne française de l’Enseignement. « Ce n ‘est pas de la Belgique, a-t-il déclaré par la suite, qu’il a rapporté son idée, c’est au contraire cette idée préconçue qui l’y a fait aller ». Né en 1815, directeur du bureau de la Propagande socialiste, de novembre 1848 à juin 1849, il devint après 1859, professeur dans un pensionnat de jeunes filles, à Beblenheim en Alsace et après 1870 à Monthiers ; élu sénateur inamovible en 1883, il mourut le 13 décembre 1894. Jean Macé fait remonter à 1861 la date de ses premières tentatives ; il s’intéressa d’abord aux bibliothèques populaires ; enfin le 25 octobre 1866, il demandait dans l’Opinion Nationale qu’ « une coalition s’organisât, dans tous les départements, entre tous les hommes de bonne volonté, qui ne demandent qu’à travailler à l’enseignement du peuple ».
Le premier bulletin de la Ligue paraissait le 15 décembre de la même année ; mais c’est en 1881 seulement, au Congrès de Paris, qu’elle fut constituée sous son titre définitif de « Ligue française de l’Enseignement ». Trois hommes du peuple répondirent au premier appel ; en 1867 on comptait déjà 5.000 membres ; en février 1870, il y en avait plus de 17.800. Et les progrès s’accentuèrent, puisqu’en 1902 elle compta 2.787 sociétés affiliées, ce qui représentait deux millions d’adhérents. Dans le projet de statuts, rédigé par Macé en 1867, on lisait :
« Art. 1. — La Ligue de l’enseignement a pour but de provoquer par toute la France l’initiative individuelle au profit du développement de l’instruction publique.
Art. 2. — Son œuvre consiste :
-
à fonder des bibliothèques et des cours publics pour les adultes, des écoles pour les enfants, là où le besoin s’en fera sentir ;
-
à soutenir et faire prospérer davantage les institutions de ce genre qui existent déjà ».
Par crainte des prohibitions gouvernementales, le fondateur restait prudent dans l’exposé de ses desseins ; au fond, il entreprenait une campagne en faveur de l’instruction obligatoire, gratuite et laïque.
Mais il eut beau répéter « qu’il n’y avait rien dans son entreprise qui pût porter ombrage à qui que ce soit », l’autorité religieuse se dressa menaçante. Mandements épiscopaux, sermons des prêtres, calomnies des dévotes tombèrent dru sur l’œuvre nouvelle : Jean Macé fut appelé « un assassin d’âmes ». Pourtant ses idées étaient loin d’être révolutionnaires. Il croyait en Dieu et garda jusqu’à sa mort une religiosité profonde. « Notre corps, écrivait-il, est un temple où Dieu réside, non pas inactif et dérobant sa présence, mais vivant et sans cesse agissant, veillant à l’accomplissement des lois qui régissent les mouvements des organes de la digestion dans le corps de l’ homme, avec autant de soins qu’à celles qui conduisent le soleil et les étoiles ». Dans ses livres, les inepties de ce genre abondent. S’adressant aux instituteurs, il leur dira de développer « la grande idée de la patrie, l’amour et l’honneur du drapeau », leur enjoignant par ailleurs de ne jamais faire le procès des opinions arriérées ou des croyances superstitieuses : « C’est l’enseignement confessionnel seulement qu’il s’agit de renvoyer à l’Eglise. Quant à ce fonds commun de religion universelle qui s’impose à tous et qu’élargissent d’âge en âge les progrès de la conscience humaine, il ne saurait être bon certainement de le rayer du programme de nos écoles ». En 1886, il insiste, au Sénat, pour qu’on ne remplace pas trop rapidement le personnel congréganiste par un personnel laïc, dans les écoles primaires. Puis l’instruction lui paraîtra surtout un « apprentissage électoral » ; il oubliera le bonheur et la dignité des individus pour ne songer qu’à faire des citoyens. Disons à sa décharge que, malgré la timidité de ses conceptions, il fut maudit par tous les bien-pensants de l’époque, et que sa Ligue contribua puissamment à diffuser l’instruction. Après le 24 mai 1873 et le 16 mai 1877 on menaça de peines disciplinaires les instituteurs qui en étaient membres ou en recevaient quelque chose ; certains préfets allèrent jusqu’à fermer les cercles locaux ; et l’on doit reconnaître que Macé lutta jusqu’à la fin pour la gratuité de l’enseignement. La Ligue, du moins à l’origine, fut une école de décentralisation. « Il y a quelque chose de trop en France : c’est Paris ! », disait son fondateur, indigné de voir la capitale prétendre au monopole intellectuel. « Réveillez-vous, belle endormie ! criait-il à la province. Cela vous déplaît que la poste vous apporte vos opinions toutes faites. Eh bien ! Faites-les vous-mêmes, et l’envoyez-les au besoin au maitre d’école dont vous êtes lasse ». Dans sa pensée, la nouvelle Association ne devait être ni dominée par un Comité directeur, ni liée par des règles uniformes ; elle devait seulement consister en une Fédération de sociétés libres. Aujourd’hui la Ligue française de l’Enseignement est presque une puissance officielle, une sorte de ministère hors cadre de l’instruction ; cajolée par les gouvernants, elle dispose des faveurs administratives. Transformation malheureuse, peu propre à garantir son impartialité et son indépendance. Ainsi finissent les associations qui, parties du peuple oublient leur but premier pour devenir de simples rouages du pouvoir.
Une Ligue dont l’action fut malfaisante, dès l’origine, c’est celle des Patriotes. Le 18 mai 1882, Paul Déroulède rappela, dans un discours, qu’on avait fondé une Ligue de la Délivrance en 1872. Il proposa de reprendre cette idée ; on l’applaudit vigoureusement et un Comité provisoire jeta les bases de la Ligue des Patriotes. Le but avoué de la nouvelle Association était d’unir les nationalistes français, sans distinction de parti politique, pour propager l’éducation militaire et le culte de la patrie. Grâce aux ressources, qui affluèrent dès le début, elle couvrit l’ensemble du pays d’un réseau de filiales et de Comités. Bientôt elle eut son journal, Le Drapeau, qui se donnait pour mission de vulgariser les idées les plus chauvines. Paul Déroulède, grand animateur de la Ligue et chansonnier patriote, d’ailleurs dépourvu de talent, fut nommé président d’honneur. Mais la discorde éclata au sein du Comité directeur ; certains membres plus honnêtes ou plus naïfs voulaient, conformément aux statuts, s’abstenir de toute action politique ; Déroulède et ses amis entendaient au contraire se livrer à une intense agitation électorale. Après des luttes assez violentes, ce fut l’influence des seconds qui finalement l’emporta. Sous prétexte d’aider « les hommes et les idées favorables à la défense nationale », la ligue des Patriotes fit une large propagande en faveur de Boulanger, général d’opérette qui jouait au dictateur ; elle assura son succès à Paris, lors des élections du 27 janvier 1889. A la fin d’avril 1888, les sociétaires hostiles à la politique boulangiste avaient constitué un groupe schismatique, l’Union patriotique de France ; mais, incapables de s’organiser, ils sombrèrent bientôt dans l’oubli. Poursuivis à l’occasion d’une souscription, Déroulède et son Comité directeur furent accusés « d’avoir fait partie d’une Association non autorisée, d’avoir fait partie d’une société secrète ». La 8e Chambre correctionnelle de Paris se borna à leur infliger 100 francs d’amende, comme faisant partie d’une Association non autorisée ; la Ligue des Patriotes fut dissoute. Ce qui la mit pour un temps hors de combat, ce fut l’effondrement de Boulanger. Elle devait se reconstituer plus tard, sous la présidence de son fondateur, puis de Barrès à partir de 1914. Préparer la revanche de 1870, reprendre l’Alsace et pour y réussir, favoriser la politique la plus réactionnaire, devint son programme avoué ou secret. L’hécatombe de 1914–1918 fut en partie son œuvre et marqua son triomphe ; ses idées inspirèrent les dirigeants d’alors ; et l’on ne saurait oublier le rôle ignoble d’un Barrès encourageant les autres à mourir, puis se hissant sur leurs cadavres pour atteindre aux suprêmes honneurs. Son influence n’a pas disparu ; elle subsiste dans les hautes sphères religieuses, administratives, universitaires ; les Nouvelles Littéraires, publication vénale par excellence, toutes les revues, tous les journaux bien pensants s’emploient de leur mieux à faire connaître écrivains ou hommes d’action qu’anime son chauvinisme dangereux. Dans le monde militaire, elle règne en maîtresse, cela va sans dire ; et l’Académie réserve ses sourires les plus gracieux aux barrésiens de sacristie.
D’autres Ligues encore mériteraient de nous retenir : la Ligue contre la loi des céréales (anti-corn-law league) qui, en Angleterre, au début du XIXème siècle, joua un rôle considérable dans l’établissement du libre-échange ; la Ligue Agraire (land league), association politique irlandaise fondée par Michel Davitt et dont Parnell fut l’animateur le plus remarquable ; la Ligue des Droits de l’Homme, dont nous parlerons peu, parce que les lecteurs pourront se reporter au mot « Droits de l’Homme », dans le présent ouvrage pour trouver ce qui les intéresse sur ce sujet. Ses origines se rattachent à l’affaire Dreyfus. Cet officier, faussement accusé de trahison, fut condamné, sur la production d’une pièce écrite, en réalité, par le commandant Esterhazy, ancien zouave pontifical passé dans l’armée française. Cléricaux et patriotes firent preuve d’une mauvaise foi insigne ; la Croix, l’organe du clergé français, rédigé par les Assomptionnistes, la Libre Parole journal attitré des antisémites, les feuilles inspirées par la camarillamilitaire, toute la presse bien pensante firent chorus contre un malheureux dont l’innocence était manifeste. Félix Faure, de qui la fille épousera Goyau, l’insignifiant et dévot académicien, ne songeait qu’à faire risette à la réaction ; Boisdeffre, chef de l’état-major était manœuvré comme un pantin par l’astucieux père Du Lac, supérieur des Jésuites parisiens. Mais des hommes courageux protestèrent ; et l’idée d’une Ligue pour la défense des Droits de l’Homme naquit à cette occasion, en 1898... Depuis, sur la base des principes de la « Déclaration des Droits », la Ligue a combattu pour le respect de la liberté individuelle et de la liberté d’opinion, pour les garanties du citoyen livré aux fantaisies de l’appareil judiciaire. Son action, cependant, s’est souvent ressentie d’une conception de la justice retenue au cadre des lois, et nous eussions aimé, qu’issue de la Révolution, elle évoluât vers un esprit plus vaste que les textes. Il serait injuste, certes, de méconnaître les bienfaits de son activité et de ne pas rendre hommage à la persévérance de ses campagnes — suivies souvent de résultats positifs — en faveur des victimes des dénis de justice et de la répression du pouvoir. Mais, il faut noter sa tendance marquée — et croissante, dans la régression générale — à compter davantage sur la bienveillance des gouvernements que sur la conscience avertie de l’opinion. Et elle porte, dans son passé, cette tache d’avoir tenté de justifier la dernière guerre en la plaçant sous les auspices du « droit » et d’avoir pris parti, dans la mêlée, contre la pensée demeurée libre et le pacifisme indéfectible...
Il y eut aussi la Ligue, d’assez facétieuse mémoire, contre la licence des rues, fondée par le sénateur Bérenger et qui, avec la prétention de sauvegarde d’une pudeur blessée par les publications pornographiques, s’attaquait aux manifestations les plus libres de l’art. En 1867, Frédéric Passy, fonda la Ligue internationale et permanente de la paix, etc. Aux XIXème et XXème siècles, un grand nombre de ligues devaient surgir : politiques, religieuses, morales, économiques, pacifistes, surtout après la guerre de 1914–1918. En 1908, Ferrer, fondateur de « l’Ecole Moderne », créa, pour en vulgariser le principes, la Ligue internationale pour l’éducation rationnelle de l’enfance, dont l’organe : l’Ecole rénovée fut une remarquable revue de pédagogie nouvelle, attachée au développement de la personnalité de l’enfant. (Dans un ordre d’idées analogues, la Ligue internationale pour l’éducation nouvelle publie aujourd’hui : Pour l’Ere nouvelle)... Citons encore, parmi les ligues actuelles qui nous intéressent davantage, nous excusant d’en oublier qui nous sont cependant sympathiques : la Ligue anticatholique, la Ligue antialcoolique, la Ligue contre le tabac, etc., la Ligue pour la nationalisation du sol, pour la réforme foncière, pour la terre franche, etc., les Ligues des réfractaires à la guerre, de la volonté de Paix, de l’objection de conscience, etc. (Voir ces divers mots). L’énumération des Ligues modernes, nées pour la défense des intérêts et des opinions, remplirait à elle seule plusieurs pages et déborderait le cadre de cet article. Chaque jour en voit éclore de nouvelles dans les domaines les plus variés. Assurément les Ligues d’avant-garde n’ont pour elles ni l’argent, ni l’oreille de la presse et des autorités. Beaucoup font néanmoins d’excellent travail, grâce au dévouement inlassable de ceux qui les propagent et les soutiennent. Regrettons que leur multiplication excessive divise parfois des efforts qui auraient intérêt à s’associer. Le manque de coordination dans la lutte contre l’adversaire commun, l’émiettement en chapelles, clans et sous-clans infimes, la dispersion à l’extrême des bonnes volontés qui s’offrent, voilà une des causes principales de la faiblesse actuelle des mouvements individualistes et libertaires. Non qu’il faille aboutir à la centralisation, ni à l’uniformité : un accord volontairement consenti entre les différentes tendances suffirait ; l’ardeur de chacun cessant de s’affaiblir en querelles intestines, il deviendrait possible à tous de diriger leurs armes contre l’ennemi du dehors. Evitons aussi d’être injuste envers les hommes et les groupements, qui, sans nous donner satisfaction entière, contribuent à réaliser en pratique quelques-unes de nos aspirations ; n’éloignons pas, sous prétexte de rigide orthodoxie, ceux qui nous témoignent une franche sympathie et acceptent de seconder notre action. Lorsqu’on répudie contrainte, mensonge, hypocrisie, il faut s’élever assez haut pour rendre justice à tous indistinctement.
— L. BARBEDETTE
LIMITE
n. f. (lat. limes, limitis, chemin de traverse, puis lisière, frontière de limus, oblique)
Tout ce qui borne, tout ce qui marque la fin, le point extrême d’une activité, d’un sentiment, d’une pensée, d’une action, d’une influence, tout ce qu’on ne peut dépasser, dans un domaine quelconque, s’appelle limite. D’où les innombrables sens attachés à ce mot et son emploi continuel dans le langage courant, et dans la politique, les sciences, etc. (ligne commune, démarcation entre deux Etats, deux propriétés, deux zones, etc... ; en mathématiques : grandeur limite, méthode des limites, en algèbre : limite des racines d’une équation, en arithmétique : limites d’un problème, en astronomie : points limites, etc.). Il est des limites qui semblent imposées par la nature ; ni le corps, ni l’esprit, ne sont capables d’un effort continu, d’une tension que ne coupe aucun repos ; la vie si longue soit-elle comporte des limites ; il n’est pas jusqu’à la joie qu’une possession trop prolongée ne transforme en ennui. Notre science a des limites et encore très rapprochées malheureusement ; de même notre puissance d’action. Mais comme disait Mme Neck, « les limites des sciences sont comme l’horizon, plus on en approche, plus elles reculent ». Dans le domaine de la pensée et de l’examen critique des choses, nos moyens sont les seules limites dont nous ne connaissions la légitimité. Pour nous, « la raison n’est pas la raison quand on lui impose des limites » (T. Delord).
Cependant, aux limites que nous oppose la nature, la société en ajoute d’autres innombrables ; la masse des lois n’est dans l’ensemble qu’un vaste réseau de prohibitions, de défenses, un véritable répertoire de « gestes limites », qui visent à ne permettre aux individus qu’une activité mentale et physique amoindrie, diminuée, toujours soumise aux caprices des autorités. Sans parler du bagnard, du prisonnier, de tous les enchaînés, que l’on a réduit à n’être que des morts vivants. Les frontières, les patries, les douanes, etc. (voir ces mots) autant de limites, inventées pour le seul profit de ceux qui commandent. Et une morale, qui est souvent le comble de l’immoralité, prétend ligoter les consciences et régenter nos plus secrets désirs. Prêtres et gendarmes s’associent pour que les chefs soient obéis, pour que les travailleurs continuent de produire sans répit, pour que les peuples se déchirent, parce qu’il a plu aux maîtres d’établir des classes sociales, des frontières que la nature ignore et que la raison condamne Mais le troupeau est si aveugle qu’un long temps s’écoulera sans doute avant qu’il comprenne et se décide à briser les clôtures dérisoires où ses exploiteurs l’ont parqué.
Ne point nuire à la légitime activité d’autrui, ne point créer de douleur inutile, voilà les seules limites, que le sage reconnaisse et qu’il assigne à son activité. Ni opprimé, ni oppresseur, ni esclave, ni maître, telle est sa maxime. Il respecte les pensées indépendantes, les volontés libres de ceux qui l’entourent.
« Loin de condamner l’énergique affirmation d’un moi qui veut vivre et se parfaire, nous y voyons le secret ressort de bien des existences utiles et la condition du progrès. Etre plus et mieux, telle est déjà l’inconsciente mais suprême règle du moindre animalcule, telle doit être la loi voulue de l’activité humaine. Plus fort que le raisonnement, l’instinct de conservation l’impose, et le suicide même est une sanglante preuve de notre invincible besoin d’être heureux.
Mais pourquoi accumuler les ruines, pourquoi de la souffrance d’autrui faire la rançon de notre propre joie ? Dans la cité humaine, comme dans le monde des plantes, l’harmonie totale n’est-elle pas rendue possible par la seule diversité individuelle et collective ? Et pour chacun l’union librement voulue ne serait-elle pas souvent préférable à la lutte ? La réponse n’est pas douteuse : pour enrichir son être et le parfaire, nul besoin d’écraser les autres... L’impuissance à sortir de l’horizon borné du moi, à briser ses étroites barrières pour comprendre la vie universelle et sympathiser avec elle, voilà croyons-nous la racine cachée de l’égoïsme qui paralyse et appauvrit. » (La Cité Fraternelle)
Mais naturellement ce n’est pas des stériles batailles politiques que l’homme peut attendre la suppression des limites artificiellement dressées par les chefs, ce n’est pas de son impuissant bulletin de vote que le citoyen doit espérer rien de pareil. Une longue éducation des esprits, une lente formation des volontés aboutiront seules à libérer les cerveaux. Et que chacun travaille, pour lui-même et en lui-même d’abord, à démolir les murailles de la prison où la société prétend l’enfermer ; qu’il apprenne à n’avoir d’autre maître que son propre esprit, ouvert enfin à la lumière des vérités supérieures que cachent soigneusement ceux qui instruisent les enfants ou les hommes pour le compte des Eglises et des Etats.
« Libération sociale et morale sont affaires de volonté ; égoïsme des chefs, veulerie du troupeau voilà les pourvoyeurs des ergastules anciennes ou modernes. A chacun de se sauver lui-même et d’aider au salut de ses frères, autant qu’il est en son pouvoir. Pour briser les barreaux de la cage où la nature nous enferma, un effort plus ardu semble exigé des hommes ; car l’acier des lois cosmiques est dur et la lime de nos connaissances a souvent besoin d’être réparée. » (Par delà l’Intérêt)
Cependant même lorsqu’il s’agit de la nature, ne parlons pas trop rapidement des limites qui s’imposent à notre savoir ou à notre vouloir. Lumières magiques, tapis volant, vision ou audition lointaine, élixir de longue vie, transmutation des métaux, etc. tous les vieux contes qui charmèrent nos ancêtres, la science les réalise graduellement. « Où s’arrêtera notre espèce dans sa prodigieuse ascension ? écrit L. Barbedette, dans Face à l’Eternité. Maîtresse de notre globe, elle en modifiera les conditions à son gré, pour peu que tardent les causes, et rien ne les montre prochaines, de sa propre disparition. Après les chaleurs des tropiques, elle a vaincu les glaces polaires ; desséchant les marais, irriguant les déserts, creusant des ports, perçant des isthmes, elle est devenue la suprême dominatrice et de la terre et des océans. Ni les entrailles du sol, ni les hautes régions atmosphériques n’échappent à ses investigations ; vapeur, électricité, machines de toutes sortes la servent avec docilité. C’est une incomparable odyssée que la sienne ; ne doutons pas de son triomphe final sur les éléments. Progressive diminution de la lumière et de la chaleur solaire, manque d’air ou d’eau, absence de ressources alimentaires ne la trouveront point désarmée. Physique, chimie, mécanique réaliseront, d’ici quelques millénaires, des prodiges supérieurs à ce que conçoit la plus délirante imagination. Et devant la biologie, à peine adolescente, s’ouvrent des espoirs illimités ; contre les gaz toxiques, les poisons, l’asphyxie, le feu peut-être, on prémunira aussi facilement qu’on vaccine contre la maladie. Sans parler des races surhumaines que fera sortir de la nôtre soit la science eugénique, soit l’évolution spontanée ». Les forces humaines sont infiniment supérieures à ce que nous croyons, mais pour que les peuples se résignent à leur triste sort, les pontifes et savants officiels ne cessent de répéter que notre science comme notre action ne sauraient franchir certaines limites imposées par le créateur. Ils humilient notre volonté et notre raison, pour encourager les faibles à se soumettre aux ordres des puissances surnaturelles, qui parlent par la bouche des chefs naturellement.
LIQUIDATION
n. f. (de liquider, rad. liquide)
L’action de liquider, de fixer ce qui est indéterminé et incertain de toute espèce d’affaires et de comptes prend le nom de liquidation.
Les opérations auxquelles donne lieu la cessation d’un commerce prennent aussi le nom de liquidation. On désigne aussi, sous ce vocable, la vente à bas prix de certaines marchandises ou produits en vue de terminer rapidement une situation qu’on a hâte de liquider, de mettre au net.
Le règlement, en bourse, des négociations par livraison de titres achetés, ou bien le paiement des différences constituent une liquidation.
La liquidation est un terme employé en jurisprudence visant la propriété générale. Elle a pour but de fixer les droits qui appartiennent soit à des particuliers, soit à des collectivités par rapport à certaine richesse possédée en commun et qu’il importe d’attribuer respectivement aux destinataires légaux.
Toute société après sa cessation, sa dissolution, doit être nécessairement liquidée.
En sociologie, il s’agit souvent aussi de liquidation théorique pour le moins de la société actuelle et de son remplacement pur une organisation nouvelle de liberté, de propriété et de justice.
La liquidation, à travers les âges, est toujours du domaine de l’actualité et s’y rapporte selon l’état de connaissance de l’époque.
— E. S.
LISIERE
n. f. (Il aurait, selon Diez le sens de lisière, de liste, bande, bordure)
Le bord d’un objet, d’une chose, voilà sa lisière ; ainsi l’on parle de la lisière d’un champ, d’une forêt, d’une étoffe. Et, par extension, ce terme désigne, au moral, la partie soit initiale soit terminale du système philosophique, social, religieux, politique ou autre ; dans le même sens, il s’applique au monde des sentiments, des désirs, des passions, des habitudes de l’activité réfléchie : on dira d’un homme qu’il est à la lisière de la sagesse ou de la folie ou du crime. Mais ce vocable peut encore désigner les frontières que codes et décalogues prétendent tracer entre le bien et le mal, entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. Singulière prétention qu’ont les autorités sociales et religieuses ; une duperie de mots au demeurant. « Parce que les dirigeants rêvaient de prestige ou de rapine, n’a-t-on pas vu récemment des millions d’hommes s’entretuer, au nom de l’honneur national et de la liberté ? Dans la bouche des autorités qui commandent aux consciences, les ambitions de la Haute Banque ne se transforment-elles pas chaque jour en devoir moral ? Une savante alchimie du langage suffit à rendre vertueuse une action coupable et mauvaise une action généreuse : houille, fer, pétrole, acquièrent un prix surnaturel et qui meurt pour leur conquête reçoit la couronne des héros ou des saints ; mais c’est un affreux gredin celui qui sème, parmi les hommes, des idées de fraternité. Comme le changement de couleur des verres de lunette modifie l’aspect d’un objet, les louanges ou le blâme dont on les couvre, font varier pour nous la physionomie d’un sentiment et d’une action » (Le Règne de l’Envie). Tracer des lisières artificielles, qu’il est interdit de franchir, s’avère le travail préféré des moralistes officiels, des législateurs, et aussi des éducateurs que les pouvoirs publics chargent de préparer des générations obéissantes et aveugles.
Cette triste besogne, Stephen Mac Say en donne un véridique et saisissant tableau dans La Laïque contre l’Enfant :
« Il n’existe pas, en dépit des tirades démocratiques, d’atelier laïque où se ferait l’apprentissage de la liberté, mais des prisons dont les geôliers n’ont point la licence de laisser grandes ouvertes les portes et se permettent tout juste le risque d’allonger d’un « oubli » la promenade. Et si les instituteurs abandonnent à l’entrée le fouet du dompteur et veulent, en grands frères, éveiller un à un ces petits êtres, le désordre de la cage aura tôt fait de les dénoncer à la vindicte des chefs... L’esprit ne peut se mouvoir que dans le cadre fermé, exclusif, de cette salle de classe, milieu factice et claustral qui comprime, refoule vers les sources, sous la pesée écrasante de son silence, toute la vie bouillonnante qui entre... Enchaîner sous prétexte de délivrance les instituteurs seront, qu’ils le veuillent ou non, les complices de ce paradoxe criminel. Ils ne feraient pas impunément l’expérience de rendre cet essaim vibrant à la vibrance du dehors. Et ce sont les programmes enjoignant, dans leur détail même, les matières, stipulant les haltes permises, les insistances nécessaires et ne souffrant pas qu’on porte atteinte au déroulement préconçu. Et l’emploi du temps les secourt, fige la dernière élasticité, qui prescrit jusque dans les heures de chaque jour la science obligée du répertoire immuable. Les instituteurs n’auront guère entamé le code du savoir parce qu’ils auront osé l’omission d’un passage plus nocif ou bousculé l’ordre du spectacle. Et ce petit jeu de passe-passe et d’interversion n’ira pas loin d’ailleurs. Car toute une hiérarchie de chefs est là qui surveille leurs évolutions. Ce sont d’abord les directeurs dont ils ont à subir le contrôle immédiat et que, d’ordinaire, l’âge et l’intérêt ne prédisposent guère à tolérer qu’on sorte de l’ornière. Ensuite les inspecteurs primaires, les « commis-voyageurs en pédagogie », aux apparitions espacées quelquefois mais dont la visite possible est toujours une menace : les inspecteurs « chargés, disent les textes officiels, de renseigner l’inspecteur d’Académie sur la façon dont les programmes, les règlements sont appliqués et dont les divers enseignements sont dirigés ». Ils assistent à la classe, questionnent les enfants — leurs interrogations portent sur l’ensemble du programme. Et comme il leur faut un moyen de contrôle rapide, ils tablent sur la quantité et se prononcent sur des apparences. C’est en effet sur les réponses obtenues, sur l’aspect de l’école et l’attitude du maître qu’ils étayent leurs rapports. Gare aux négligences, aux lacunes voulues, découvertes ou soupçonnées, qu’au besoin même révélera l’élève ! De l’impression qu’emportent les inspecteurs dépend le jugement des hauts dignitaires. L’avancement en est influencé, les récompenses en découlent... comme aussi le blâme et la mise à l’index. »
Pour étayer la vérité de ce qu’affirme Stephen Mac Say, la « Fraternité Universitaire » pourrait sortir des dossiers effroyables, relatant le martyre des éducateurs laïques qui voulurent faire vibrer leur classe à l’ambiance des préoccupations les plus hautes de la conscience humaine.
En tous domaines, dans celui de la pensée comme de l’activité sociale, ce ne sont que lisières, dressées intentionnellement par la société afin de domestiquer les individus. Ne soyons pas étonnés que les pouvoirs publics pourchassent tout esprit d’indépendance, même et surtout chez les membres de l’enseignement... Mais nous ne pouvons, quant à nous, accepter qu’on légitime les lisières qui retiennent les hommes en tutelle, de l’enfance au tombeau :
« Emile n’aura ni bourrelets, ni lisières. » (J.-J. Rousseau)
Mais l’éducation générale et les mœurs les tiennent prêts pour l’enfant dès sa naissance. Il reprend avec eux le sentier de la tradition, de l’esclavage et de l’impuissance. Des lisières sans nombre canalisent sa vie vers l’obédience et l’esprit de groupe. Et tout se ligue autour de lui, tout conspire ensuite pour l’y maintenir... Ecartons du jeune âge les lisières, ouvrons-lui les voies fécondes de l’expérience et de la liberté, c’est la pressante besogne de ceux que l’individualité soucie...
LITTÉRATURE
n. f.
On entend aujourd’hui, par littérature, « la science qui comprend la grammaire, l’éloquence et la poésie et qu’on appelle autrement belles-lettres » (Dictionnaire de l’Académie Française). C’est la définition scolaire, celle de tous ceux qui ne voient dans la littérature qu’une forme relative et spéciale de la pensée. Voltaire, plus largement et avec plus de raison voyait en elle « ce qu’était la grammaire chez les Grecs et les Romains », la connaissance de tout ce qui était écriture, depuis l’art d’en tracer les caractères jusqu’à la pensée que ces caractères fixaient ou pouvaient fixer dans toutes les branches du savoir. C’est le sens du mot latin : litteratura.
Bonald a appelé la littérature « l’expression de la société ». Avec plus d’étendue il faut voir en elle « la manifestation intellectuelle de l’humanité » (Larousse), si on veut comprendre son véritable caractère, ne pas s’en faire une idée fausse, incomplète et se perdre dans des considérations bornées et trop particulières. Pour Villemain elle était fort justement « une science expérimentale au plus haut degré, qui s’étend, se renouvelle, se rajeunit suivant tous les accidents de la pensée humaine ». Chaque peuple a ou a eu sa littérature particulière ; mais toutes n’ont été et ne sont que des rameaux de l’arbre immense de la pensée universelle, l’héritage commun à tous les hommes et dont on ne peut détacher des tronçons sans qu’ils soient voués à un rapide épuisement. L’étroite notion de patrie est fatale à la littérature comme à tout ce qu’elle sépare du fond commun de l’humanité et, dans cette forme de l’esprit comme dans toutes les autres, elle « ne contente plus un individu d’intelligence quelque peu développé » (Ibsen).
Il est aussi faux de prétendre qu’une littérature est née spontanément, à une certaine époque et sur un certain territoire, qu’il est faux de croire à la création du monde selon la Bible. La pensée humaine est comme le monde, le produit d’une très longue et discontinue élaboration qui a commencé avec la vie elle-même et dont on ne peut se rendre compte qu’en recherchant ses développements dans le passé, en remontant aussi loin que possible aux origines de l’humanité. L’évolution de la pensée a été celle de l’espèce. La littérature est née lorsque « l’esprit de l’ordre universel » a fait trouver à l’homme son premier bégaiement, lorsque s’est manifestée en lui « l’âme diffuse à l’origine des temps, dissoute dans l’éclosion printanière du monde, l’âme qui, d’audace et de foi virile devait construire une arche allant de la matière à la source de l’être » (Ibsen, Brand). Elle s’est formée, développée avec l’art et la civilisation, et elle a été toute l’activité intellectuelle. Il n’y a pas plus eu, à un moment quelconque de l’humanité, de littérature toute formée qu’il n’y a eu de langue originelle parlée par un premier homme (Voir Langage et Langue). Il a fallu des milliers d’années pour que l’homme, découvrant peu à peu des idées ; apprit à parler pour les exprimer. On n’a aucune notion exacte de ce que put être le langage humain jusqu’au moment où il fut fixé par l’écriture. On estime à des milliers de siècles le temps écoulé entre l’apparition de l’homme et la première forme de l’écriture. Celle-ci est encore inconnue ; peut-être ne la retrouvera-t-on jamais. On la suppose d’après les plus anciens documents idéographiques découverts : dessins, peintures, ornements, hiéroglyphes, qui ne remontent pas à plus de dix mille ans.
Jusqu’à la découverte de l’écriture, les manifestations intellectuelles et leur transmission furent toutes verbales. Celui qui avait une idée la communiquait à d’autres ; ils la discutaient et la faisaient connaître à de plus nombreux, la modifiant, l’amplifiant, la complétant suivant la pensée de chacun. Ainsi se sont formés collectivement, pendant une longue suite de siècles, les récits légendaires d’où sont sorties les premières formes littéraires connues. Grossis de milliers d’alluvions, ils sont devenus la littérature de peuples et de continents entiers. Ils ne sont de personne particulièrement et ils sont de tous, chacun ayant apporté la part de son observation, de ses goûts, de son imagination, suivant son caractère et son milieu. Ils sont comme ces énormes masses géologiques que le temps et les éléments ont composées avec les matériaux les plus différents venus des régions les plus diverses. La littérature est ainsi comparable à la géologie. On peut d’autant plus l’appeler la géologie de l’esprit humain qu’elle est sous une dépendance étroite de la nature, comme l’homme qui l’a produite. Les hommes, quoi qu’ils fassent pour être de « purs esprits », ne peuvent s’abstraire des forces telluriques et il y a toujours un rapport direct entre ces forces et leur pensée. L’homme est sorti de la terre à laquelle il retourne ; il est le produit de son milieu, selon le principe formulé par Hippocrate il y a plus de deux mille ans, et il ne fut jamais, même dans ses manifestations les plus spirituelles, que « la nature prenant conscience d’elle-même » (E. Reclus). C’est la pensée de l’homme qui lui permet d’être cette conscience de la nature. Elle est « une force éternellement active qui brave les temps et les distances, résiste à la force brutale » (Ph. Chasles), force de plus en plus intelligente, active et bienfaisante dans sa marche vers la vérité et que ne peuvent arrêter, quoi qu’ils fassent, les puissants (gouvernants) et les sophistiqueurs (prêtres). Depuis le premier souffle de l’homme elle marche avec lui et avec la vie. Aussi, l’étude de la littérature ne peut-elle se séparer de celle de toutes les formes de la vie. On a rapetissé, méconnu la littérature en l’enfermant dans les belles-lettres, en en faisant une branche de « l’art pour l’art ». Dans le temps même où elle avait sa signification la plus vaste, dans l’antiquité grecque, les sophistes la confinèrent dans l’abstraction rhétoricienne. Ce fut le temps où commença, pour elle comme pour tous les arts, le règne de l’individualisme tyrannique qui s’imposerait, pour substituer l’intérêt particulier et les formes aristocratiques aux grands et libres courants populaires et anonymes, chaque fois qu’ils n’auraient pas la force de lui résister ou se laisseraient détourner par ses artifices. Les sophistes rendirent les études littéraires inutiles et sans profit en les écartant de la recherche de ces grands courants humains. Ils en firent une occupation de mandarin, de dilettante qui se renferme dans une époque, un genre, une école et dont le travail est d’autant plus suspect qu’il suit les directives d’une caste ou d’un parti. Philarète Chasles disait :
« Pour étudier à fond la littérature, il faut étudier la politique, la religion, la société même... Il faut chercher les matériaux de l’histoire intellectuelle, non ceux de l’histoire littéraire. »
Il voulait qu’on recherchât dans les livres non seulement la phrase et la diction mais aussi l’âme pour découvrir « la merveille de communication électrique qui renouvelle les sociétés en fécondant les esprits », pour voir comment « toutes les intelligences sont enchaînées dans une parenté étroite et dans une miraculeuse harmonie ». Ce qu’il voulait trouver chez les écrivains, c’était non « des régulateurs du style et des dictateurs de la phrase », mais « des propagateurs de la civilisation universelle ». C’est par les études littéraires ainsi comprises qu’on peut voir à travers les siècles l’œuvre ininterrompue de la pensée, suivre cette filiation du génie chez qui V. Hugo disait qu’elle a atteint « sa complète intensité ». Indépendamment de ces génies, « quiconque a jeté dans le monde une idée a semé un germe immortel » (Ph. Chasles).
Au début de l’humanité, l’homme désarmé et ignorant fut porté, comme toutes les espèces, à rechercher dans ce qui l’entourait des influences et des concours sympathiques. Dans cette recherche, d’abord toute instinctive puis de plus en plus raisonnée, il ne pouvait manquer de se créer des certitudes par des explications plus ou moins illusoires sur les phénomènes dont les causes lui échappaient. Son esprit avait tout naturellement tendance à admettre le merveilleux. L’orgueil de son propre effort ne pouvait qu’exciter encore cette tendance. Il se créait ainsi des légendes qui mêlaient intimement sa vie à celle de l’univers et ne devaient se transformer, sinon disparaître, qu’avec l’acquisition de connaissances lui apportant des certitudes positives. De ces légendes, des imposteurs devaient s’emparer pour en faire des religions et changer la fantasmagorie imaginée par l’ignorance primitive en dogmes mensongers et immuables. L’imposture a ainsi dressé contre la vérité l’œuvre maléfique de l’autorité qui pèse toujours sur la pensée humaine.
Avant que s’accomplît cette œuvre, l’homme trouva les premiers éléments de sa pensée dans son milieu et dans ses rapports avec lui. C’est ainsi que la première humanité fut naturiste (Voir Naturisme). On le constate à l’origine de tous les mythes dont l’âme humaine a été bercée. Toute la littérature n’est, dans l’infinité de ses modes, que la transformation, la transposition et l’adaptation de ces mythes à travers le temps et l’espace.
Autant les légendes devinrent, par les adaptations cléricales, terrifiantes, sanguinaires et stupides avec leurs mystères incompréhensibles à la raison, autant elles durent être, dans leurs conceptions primitives, aimables, poétiques, inspirées par tout ce qui était bienfaisant et agréable dans la nature. Plutôt que de terreur et d’imploration désespérée, elles devaient être des hymnes de joie et de reconnaissance à toutes les forces qui animaient et embellissaient la vie. Elles exprimaient pour l’homme « l’amour qui le portait vers tout ce monde extérieur vivant d’une vie analogue à la sienne, vers les sources et les ruisseaux, vers les arrhes et les rochers, vers les monts et les nuages, vers le ciel resplendissant, l’aurore, le crépuscule, le large soleil et tous les astres disséminés dans l’espace » (E. Reclus). Avant de devenir « des concentrations de vie nationale, des réservoirs profonds où dorment le sang et les larmes des peuples » (Baudelaire), elles ont dû être l’expression universelle de la joie humaine éclatant devant la vie.
Les animaux, en qui les hommes voyaient des frères, des égaux pourvus d’une âme toute semblable à la leur, avaient leur belle place, parfois la première, dans ces légendes. Elle y était si importante que nombreuses sont les religions dont les dieux sont des animaux. Le christianisme lui-même dut les accueillir, bien qu’il leur refusât une âme, et adopter nombre de mythes comme celui orphique du « bon berger ». Il a vainement tenté de donner le change, par les explications d’un symbolisme abracadabrant, sur l’inspiration naturiste des tailleurs de pierres des cathédrales qui ont couvert ces monuments de représentations d’animaux et de plantes (Voir Symbolisme). Aussi, les traditions « du temps que les bêtes parlaient » sont considérables dans la littérature. Elles sont nées des longs et multiples rapports entre les hommes et les animaux rapprochés par des nécessités communes et qui les faisaient se comprendre. L’homme avait trop de choses à apprendre des animaux pour qu’il n’y eût pas entre eux des relations constantes dans l’intimité d’une véritable association d’intérêts et de sentiments, jusqu’au jour où, par son industrie, l’homme commença à devenir dangereux et malfaisant pour l’animal. Cette intimité était telle qu’elle ne disparut jamais complètement et, lorsque la sottise humaine imagina de s’ériger en puissance supérieure aussi cruelle que stupide sur tout ce qui l’entourait, l’inépuisable bonté de l’animal et sa sociabilité, se pliant à la domesticité, rendirent encore possible le rapprochement avec un maître orgueilleux. Les traditions des rapports avec les animaux sont demeurées les plus vivantes parce qu’elles sont les plus près de la nature et qu’elles éveillent toujours le plus de fibres insoupçonnées. Elles sont à la base de la littérature, mêlées à celles qu’inspirèrent tous les génies primitifs de l’air, de la terre des eaux transformés en héros magnifiques ou en personnages familiers. Elles n’ont fait, en se perpétuant, que répéter les sentiments primitifs et éternels de la nature toute entière : l’amour, la joie et la douleur.
On découvre ainsi, en recherchant dans le temps, cette unité de pensée qui fait que « le genre humain n’a qu’un petit nombre d’idées qu’il renouvelle éternellement » (Ph. Chasles). Du culte naturiste, du communisme primitif avec les animaux, puis de la vie patriarcale, naquirent les traditions populaires des contes, fables, énigmes, proverbes qui se sont en grand nombre maintenus textuellement par la transmission orale d’une génération et d’un peuple aux autres. A la base de toutes les littératures il y a le folklore, la masse des dits populaires répandus chez les peuples et qui est : « le trésor des idées et des imaginations non point créées par le peuple, mais acceptées par lui, la plupart depuis un temps immémorial, conservées par lui et recueillies de nos jours sur ses lèvres » (L. Sudre). Les contes, les récits populaires, se retrouvent chez tous les peuples, avec le même fond et la même forme, a dit aussi M. Sudre (Les Sources du Roman de Renart) ; on y perçoit seulement des différences venues d’influences psychologiques et sociales propres à chaque peuple.
Elisée Reclus a constaté que « les légendes voyagent avec les peuples ». Celles dont notre esprit est toujours nourri ont voyagé avec nos lointains ancêtres descendus, il y a cent ou cent-cinquante siècles, des plateaux de l’Iranie pour se répandre, à l’est jusqu’au Pacifique, à l’ouest jusqu’à l’Atlantique, et apporter chez tous les peuples appelés aujourd’hui indo-européens cette communauté de pensée qu’on retrouve de Gibraltar à Yokohama et qu’atteste la parenté de leurs langues. Du sanscrit elles sont passées dans le persan, l’arabe, le grec, l’hébraïque, l’arménien, le latin, le saxon, le celte et tous leurs dérivés modernes. La transmission orale des légendes s’est faite par les récits d’homme à homme, de la mère à l’enfant, des vieillards aux jeunes gens, et répandue de peuple à peuple par les migrations. Lorsqu’ils étaient fixés sur un territoire, les peuples les recevaient des conteurs étrangers. Ceux-ci mettaient plus ou moins d’art dans leurs récits. Non seulement ils ne répétaient pas toujours strictement ce qu’ils avaient appris et ajoutaient ou retranchaient suivant leur invention, mais ils modifiaient selon le goût de leurs auditeurs. Les récits prenaient de la sorte des versions plus ou moins poétiques jusqu’au jour où les récitants furent de véritables poètes. Ils devinrent alors les aèdes et les rapsodes homériques, les prophètes hébreux, les chamanes finnois, les scaldes scandinaves, les fies irlandais, les scops anglo-saxons, les bardes celtiques et germaniques, les jongleurs gallois et armoricains, les trouvères et les troubadours des pays romans, etc... La diversité de l’interprétation poétique renouvelait les récits et les chants au point qu’on ne démêlait plus leur origine. Il n’est pas jusqu’aux copistes des manuscrits qui n’apportaient leur part de fantaisie en reproduisant plus on moins fidèlement les textes qu’ils recopiaient. Ils y mêlaient parfois des inventions personnelles, faisaient des corrections selon leur goût, modifiaient même la langue encore incertaine. La même œuvre, chanson de geste ou fableau du moyen âge, devenait picarde, bretonne, lyonnaise ou provençale suivant la langue du copiste.
« Mais l’imbroglio n’est pas indéchiffrable ; la comparaison attentive et minutieuse de toutes les formes d’un récit aboutit presque toujours à la découverte de la forme première, de l’archétype d’où tout le reste est sorti. » (Sudre)
Les contes de la Mère Grand qui font toujours la joie des enfants, les proverbes qui sont demeurés l’expression du bon sens populaire, se retrouvent dans l’Avesta, vieux de trente siècles, qui est le plus ancien ensemble de livres sacrés, et ils venaient déjà de loin dans les traditions iraniennes. Depuis, ils ont été recomposés à l’infini, notamment par des mages au IIIème siècle de notre ère. Les conteurs arabes ont adouci ou compliqué leur rudesse et leur naïveté originelles par les enchantements et la subtilité des ruses qui sont dans les récits des Mille et une Nuits. Ils n’en ont pas moins eu les apparences de la nouveauté quand parurent les Contes de Perrault, et ils ne cessent pas d’être adaptés par les écrivains modernes. Dans le même temps où Perrault écrivait ses contes, un moine bouddhiste composait, d’après la fable de la Belle au Bois Dormant, un mystère qui a été découvert récemment dans la littérature tibétaine sur laquelle les Européens commencent seulement à avoir quelques lueurs.
Le même fond de contes, d’histoires de fées a fourni le sujet des livres sacrés de l’Inde et des romans ou fableaux du moyen-âge. Certains auteurs contemporains qui les renouvellent encore dans la forme, ne les présentent pas moins comme étant de leur cru. Lorsque Le Grand d’Aussy, au XVIIIème siècle, exhuma les vieux fableaux français oubliés depuis quatre cents ans, on imagina qu’ils avaient été la création spontanée du moyen-âge. Il fallut les études linguistiques qui étendirent le champ des découvertes littéraires pour révéler l’antiquité de ces fableaux. Au XIIIème siècle, un auteur français qui traduisit de l’espagnol le roman de Flore et Blanchefleur ignorait non seulement l’antiquité de ce sujet, mais aussi que l’auteur espagnol l’avait pris dans la littérature française du moyen-âge. De même Parthénopeu de Blois, traduit du castillan, était un roman français du XIIème siècle et on y retrouve la fable antique de Psyché. Plusieurs fableaux dont les prototypes sont ceux de Sire Hain et dame Hanieuse, de la Dame qui fut corrigée ou de la Male Dame, ont leurs aînés dans un conte persan de KissehKhum et divers récits qui leur sont apparentés. Leur sujet a servi ensuite aux nouvellistes italiens : Boccace, Sansovino, Pécorone, etc... puis à Shakespeare dans la Mégère apprivoisée. Tout cela n’empêcha pas la Correspondance secrète, politique et littéraire de présenter en 1776, comme une chose inédite, la comédie de la Peau de Bœuf, imprimée à Valenciennes en 1710, qui était inspirée du même fond, et lorsque nous aurons dit que Sylvabel, le conte de Villiers de l’Isle Adam, en a été aussi tiré, nous n’aurons pas fini de citer tous les ouvrages qui en sont sortis. Le Marchand de Venise de Shakespeare est dans le Dolopathos d’un moine de Hauteselve et fut avant dans un conte oriental. Le fableau du Chevalier au Chainse a été traité successivement par des conteurs allemands du XIVème siècle, par Brantôme, Schiller, et par Ludovic Halévy dans sa comédie des Sonnettes. La Matrone d’Ephèse nous est venue de l’Inde en passant par le Ludus Sapientium, par Pétrone, Apulée, et par le Dolopathos pour arriver au conte de La Fontaine dont la présidente Ferrand a fait un commentaire imprévu dans sa Correspondance. On a fait grand bruit, il y a quatre ou cinq ans, autour de la « rentrée dans le domaine classique » de l’Homme de cour de Baltasar Gracian, plus ou moins répandu ou oublié depuis sa publication en Espagne, en l647, et M. Rouveyre l’a présenté comme « un des textes fondamentaux de l’ancien Régime humaniste et classique ». Or, l’espagnol Baltasar Gracian n’a fait qu’adapter le Livre du courtisan de l’italien Balthazar de Castiglione paru un siècle et demi avant pour apprendre au monde « jusqu’où on peut mentir, flatter, être perfide et assassiner avec politesse, sans brutalité violente » (Ph. Chasles). Avant Gracian, un autre espagnol, Guevara, s’était servi de l’œuvre de Castiglione. Elle a encore été le modèle des Lettres, de Chesterfield ; de l’Art de plaire, de Moncriff ; de l’Aristippe, de Balzac, et d’autres ouvrages.
Les fables et les contes de La Fontaine furent récités il y a des milliers d’années aux asiatiques. Ils nous sont venus d’eux en passant par Pilpay, les traducteurs arabes, Esope, Phèdre, Marie de France, Boccace et nombre d’autres (Voir Fable).
Le Roman de Renart en France, le Reinhart Fuchs en Allemagne, le Reineart flamand, sont l’aboutissant épique des histoires d’animaux transformées et multipliées par les besoins des temps de tyrannie où les hommes ne pouvant s’exprimer librement donnaient allégoriquement la parole à leurs « frères inférieurs ». Selon les régions, d’autres animaux occupent la place du renard ; c’est le loup ou l’ours dans les pays du Nord, le chacal dans l’Inde, le lapin, le lièvre ou la tortue ailleurs. Les Bestiaires du moyen-âge sont l’adaptation des récits d’animaux à la symbolique religieuse.
On n’en finirait pas de rechercher la filiation et les transformations de tous les thèmes qui se sont répétés dans tous les genres de la littérature. Baudelaire remarquant la parenté des mythes de l’Eve biblique, de la Psyché antique et de l’Elsa de Lohengrin ; victimes toutes trois de leur curiosité, a signalé « la frappante analogie morale qui marque les mythes et les légendes éclos dans différentes contrées ». Il en voyait la source dans « l’origine commune des êtres ». M. Bédier a écrit :
« Chaque recueil de contes a sa physionomie propre. Les mêmes contes à rire, qui ne sont chez nous que des gaillardises, étaient jadis des exemples moraux qu’un brahmane faisait servir à l’instruction politique des jeunes princes. A ces mêmes contes gras, les Italiens ont ajouté des épisodes de sang qui en augmentent l’intérêt dramatique. Chaque version d’un même conte exprime, avec ses mille nuances, les idées de chaque conteur et celles des hommes à qui le conteur s’adresse. »
Les légendes héroïques qui forment la matière épique de chaque peuple ont les mêmes origines multipliées. L’esprit de révolte, qui s’est certainement manifesté dès les premiers abus d’autorité, a eu de nombreux symboles avant d’arriver au plus magnifique de tous, celui de Prométhée personnifiant dans toute sa plénitude la volonté de l’individu irréductiblement tendue vers la liberté. Prométhée avait eu son aîné iranien dans Zohak enfermé dans une caverne du Demanved ; il eut son cadet dans Encelade écrasé sous l’Etna. Il a des multitudes de frères et de descendants dans toutes les mythologies qui contèrent les luttes des hommes pour échapper à la tyrannie des dieux, dans l’histoire de tous les héros célèbres ou obscurs mis à la torture et livrés au supplice par les homuncules grotesques qui ont pris la place des dieux, depuis les Césars maîtres des grands empires anciens jusqu’aux Soulouques modernes qui régentent les démocraties d’ilotes. Par-delà le bien et le mal sur lesquels les religions échafaudaient leurs dogmes étouffants, Prométhée ignorait la terreur et l’humilité d’Adam chassé du paradis terrestre, se courbant sous la malédiction divine, acceptant la « bonne souffrance » avec l’opprobre éternel, et implorant lâchement la miséricorde de son bourreau. Il était le révolté superbe, la voix de l’univers entier par qui « le viol de la justice crie toujours vengeance » (E. Reclus). Il disait aux hommes, à l’encontre des prêcheurs de résignation :
« Je vous promets la réforme et la réparation, ô mortels, si vous êtes assez habiles, assez vertueux, assez forts pour les opérer de vos mains ! »
Il rendait au roi du ciel anathème pour anathème.
« On le cloue sur les rocs. La foudre, le châtiment, le supplice, l’isolement ne le domptent pas ; il s’enorgueillit de sa torture ; il sait qu’elle sera féconde. » (Ph. Chasles)
Elle l’a été en effet et l’est toujours, comme animatrice de la forme la plus vivante et la plus belle de la littérature : la révolte de l’esprit humain.
Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur l’origine et la transmission des récits de tous genres qui composent la littérature. Leur recherche ne peut se faire que conjointement à celles de l’archéologie et de la linguistique ; mais dès maintenant, l’origine de ces récits dans leur unité, et leur transmission sans solution de continuité, paraissent établies par les plus anciens monuments qu’on a découverts.
L’idée fondamentale de la pensée humaine et universelle, sa manifestation éternelle, sont dans la célébration de la vie, des forces qui la produisent et de celles qui l’entretiennent. Les multiples aberrations apportées par les religions n’ont rien pu changer à ce principe. Elles ont seulement semé la confusion dans l’esprit des hommes assez faibles pour les suivre et elles n’ont fait que leur malheur. La vie et la pensée sont nées de la puissance doublement fécondante du soleil, de sa chaleur et de sa lumière. Dans le culte du soleil résident l’unité et la discontinuité de la pensée. Ce culte fut celui du premier homme qui éprouva la chaleur et ouvrit les yeux à la lumière de l’astre bienfaisant ; les religions elles-mêmes ont dû l’adopter pour se faire admettre par l’humanité. Toute la littérature en est imprégnée, inspirée, qu’elle soit celle du croyant ou de l’athée, du maître ou de l’esclave, du civilisé ou du barbare, du chrétien, du juif, du mahométan, du bouddhiste, ou des plus primitifs Esquimaux ou Océaniens ; Jésus, comme Bouddha, Osiris, Mithra, Dionysos, Saturne, et les milliers d’ autres dieux, ne pouvait naître qu’au solstice d’hiver, ce moment étant pour tous les hommes quels qu’ils soient celui du retour à la chaleur, à la lumière, à la vie. Pour tous il est : « Noël ! ». C’est dans la gravitation commune de la terre et de la pensée humaine autour du soleil que l’homme réalise la conscience de la nature. Tous les héros épiques et tous les dieux protecteurs et amis des hommes sont des personnifications du soleil qui lutte contre les forces mauvaises. Les rois, tel Louis XIV, ne faisaient, en se comparant au soleil, que renouveler le vieux mythe païen pour s’assurer l’affection de leurs sujets.
Pour les Européens comme pour les Asiatiques, et peut-être pour la terre entière depuis les temps historiques, c’est des plateaux de l’Iran que se sont répandus, avec toutes les semences de la civilisation les récits légendaires adoptés par les peuples. L’idée d’un « âge d’or » qui fut connu des ancêtres dans une région d’élection d’où ils partirent pour peupler la terre, naquit sur ces plateaux. Elle se répandit et devint un jour le « paradis terrestre » des Hébreux. Elle exprimait les aspirations indéfinies au bonheur ; l’espoir d’un sort meilleur qui stimulait l’effort de l’homme, excitait sa volonté et ses facultés pour une reconstitution perpétuelle du monde. Aussi, « chaque race, chaque peuple, chaque tribu eut ainsi ses paradis. L’histoire géographique nous en fait retrouver des centaines, brillant comme des clous d’or sur le pourtour de la planète, depuis les montagnes du Nippon jusqu’à la ville de Los Cesares, dans les vallées de la Patagonie septentrionale » (E. Reclus). La belle légende qui inspirait la pensée et l’activité humaines n’était pas encore devenue par les artifices d’exploiteurs malintentionnés la source de toutes les terreurs, de toutes les folies et de toutes les déchéances qu’amenèrent les religions anthropomorphiques faisant succéder au culte de la nature celui d’un Dieu unique et réduisant l’âme universelle à celle de l’homme fait à l’image de ce Dieu.
Les traditions du déluge, non moins connues que celles du paradis terrestre, naquirent et se répandirent bien avant la Bible dans les régions basses qu’avaient dévastées de grandes pluies, des inondations de fleuves ou des invasions de la mer. Les hommes qui avaient pu y échapper avaient transmis à leurs descendants le souvenir terrifiant de ces cataclysmes et l’imagination avait tiré de ces récits la légende du « déluge universel ». Cette légende passa de l’Iranie en Chine, dans l’Inde, en Egypte, en Occident et même en Amérique. Chaque région a eu sa « montagne de Noé » ; de nombreux sommets de l’Asie portent ce nom, l’Ararat dans le Caucase, l’Argée, les monts Olympe de Thessalie et de Bythinie, un rocher du Hadjar Taous en Afrique et « jusque dans nos Pyrénées ; le puy de Brigne, le Canigou, sont dits par les bergers roussillonnais porter encore à leur cime les anneaux de fer qui retenaient l’arche sacrée » (E. Reclus).
Les annales écrites iraniennes, dans lesquelles on retrouve toutes ces légendes, ne remontent pas à plus de six mille ans, c’est-à-dire à une époque où s’étaient établies, depuis longtemps, les puissances théocratiques organisatrices de l’esclavage humain qui n’a pas cessé de se perpétuer. La littérature a subi tous les sorts da la condition humaine, elle a été soumise à toutes les déformations et restrictions, livrée à toutes les prostitutions de la pensée. De même que les grands courants de la vie et de l’humanité, elle a été détournée de sa voie dans les chemins des intérêts particuliers aux classes dominantes. Au lieu d’être une stimulatrice de la vie générale, la manifestation de la pensée universelle, elle n’a été le plus souvent, dans le morcellement de ses milliers de formes et d’usages particuliers, que l’expression sénile d’un état social qui descendait peu à peu à la décomposition intellectuelle et morale atteinte aujourd’hui.
Philarète Chasles a divisé l’histoire de la pensée humaine, représentée par la littérature, en quatre périodes : l’ère théocratique, l’ère du polythéisme, l’ère chrétienne, l’ère actuelle éminemment critique et analytique. Les trois premières, après avoir préparé et précipité la décadence et la disparition de tant de civilisations anciennes, ont substitué la suprématie des aristocraties à la liberté naturelle, établi la domination des dogmes sur les esprits et l’arbitraire individuel contre le droit collectif. L’époque actuelle, que Ph. Chasles observait il y a quatre-vingts ans et qu’il qualifiait d’éminemment critique et analytique, aurait dû, semble-t-il, opérer le redressement nécessaire. Elle n’a abouti jusqu’ici, malgré toutes ses audaces et malgré tous les concours que pouvaient lui apporter les esprits éveillés à la liberté par la Révolution, qu’à aggraver la décomposition par des sophistications qui sont d’impudents défis à la vérité et à la raison. Au lieu de balayer toutes les scories du passé, elle a employé son temps à les refondre dans l’espoir insensé d’en faire du pur métal. Pour ne pas faire du nouveau avec une vérité qu’on redoute, on s’est efforcé, et on continue, à galvaniser des choses qui, depuis des siècles, étaient déjà mortes avant d’avoir vécu. Il faudrait remplir de gros volumes pour montrer l’œuvre de perpétuel attentat contre la pensée poursuivie depuis six mille ans dans la littérature au service de l’autorité. Elle transparaît, si dissimulée qu’elle soit sous les fleurs de rhétorique, dans les multiples ouvrages écrits sur les littératures particulières, aussi, comme le disait Bazalgette :
« Il n’est guère de lecture qui vous laisse une impression plus désolante, plus desséchante que celle d’une histoire de la littérature d’un pays, quel qu’il soit. Tout ce qu’elle prétend contenir d’œuvres et d’hommes s’v réduit à cette chose navrante entre toutes : de la lit-té-ra-tu-re. Alors qu’une de ces œuvres, à la supposer forte et originale, vous enveloppe de toute sa vie, vous enrichit et vous exalte, la juxtaposition d’un millier de noms, l’exposé des influences, la place trop belle faite aux médiocres, finalement réduisent ce qui devrait être une merveilleuse histoire à une morne succession d’écoles ... »
Cette lit-té-ra-tu-re que Bazalgette n’aimait pas, c’est celle qui faisait dire à Ph. Chasles :
« J’ai peu d’estime pour le mot littérature. Ce mot me parait dénué de sens ; il est éclos d’une dépravation intellectuelle. »
Cette dépravation, il la voyait dans ce secret de bien parler sur tout et sur tous que des professeurs enseignaient contre argent, en Grèce, et qui produisait les sophistes, « parasites qui tuent l’arbre et paraissent l’orner ». Ils perdirent la Grèce puis ils allèrent à Rome où ils se multiplièrent à mesure que l’organisation sociale s’affaiblit. Aujourd’hui ils sont des légions qui entretiennent cette « blagologie », comme disait Taine, dont le vieux monde est en train de mourir. Il est préférable de voir la littérature dans l’effort de « l’action contre la réaction », dans les manifestations de la pensée vivante, novatrice, considérée comme hérétique et persécutée parce qu’elle a été à l’avant-garde et s’est refusée aux honteuses capitulations. C’est cette littérature militante qui a produit et transmis à travers les siècles, dans ses formes les plus belles, la volonté d’indépendance et les espoirs de bonheur toujours profonds au cœur de l’homme. De cette littérature, nous indiquerons ici quelques grandes lignes et nous l’enverrons pour plus de renseignements aux mots : Poésie, Prose, Roman, Théâtre, Histoire, Critique, etc...
Parmi les peuples qui occupaient les régions de la Chaldée, les Akkadiens sont considérés comme les véritables pères spirituels de la civilisation par l’hégémonie qu’ils exerçaient intellectuellement. C’est chez eux que les sémites, qui auraient été des Arabes d’où sortirent les Hébreux, trouvèrent les diverses légendes qu’ils se sont adaptées, selon leurs convenances particulières et souvent maladroitement, pour faire les récits bibliques. Les préoccupations intellectuelles des Akkadiens sont attestées par leur légende du déluge. Il y est dit que leur dieu, aussi soucieux de sauver les trésors de la pensée que de perpétuer les hommes et les animaux, recommanda à Zisuthros (Noé) de mettre à l’abri du cataclysme, en les enfouissant sous la ville du Soleil, Sippara, le commencement, le milieu et la fin de tout ce qui avait été écrit. On cherche vainement les traces d’une préoccupation semblable dans la légende biblique. Ce qui avait été écrit chez les Akkadiens était considérable dans tous les genres.
« Chaque cité rivalisait d’orgueil comme centre littéraire... Chargina avait fondé une bibliothèque à Nippur. C’est là qu’Assurbanipal fit copier la plupart des textes destinés aux annales du palais de Ninive, et dont le contenu couvrirait dans le forum in-quarto des livres modernes, plus de cinq cents volumes de cinq cents pages. » (E. Reclus)
C’est dans les restes de cette bibliothèque d’Assurbanipal qu’on a découvert douze plaquettes racontant l’épopée de Gigalmés dont l’histoire du déluge est un épisode.
Les premiers documents qui ont fixé l’expression de la pensée humaine et qui ont été laissés par ces peuples intellectuels présentent le plus grand intérêt pour l’étude des races, des langues, de l’histoire et des mœurs. Encore insuffisamment déchiffrés, les plus anciens révèlent l’esprit pacifique des premières populations par la ressemblance des mots qui manifestent cet esprit dans toutes les langues sorties du langage primitif aryen, tandis que les mots de caractère belliqueux n’apparaissent que dans des langues de formation postérieure. Un immense héritage nous est venu du monde iranien tant de ses découvertes de vie pratique que de sa production littéraire. Ses conceptions philosophiques sont à la base de la pensée humaine tout comme ses poèmes, mythes, récits, chants, pour former une chaîne sans fin par le parallélisme des différentes philosophies de l’Orient et de l’Occident et les influences littéraires dont la compénétration a présidé aux métamorphoses des idées.
Dans les temps les plus éloignés, à la civilisation chaldéenne a correspondu celle d’Egypte presque aussi ancienne. D’après le « Papyrus de Turin », dix mille ans environ s’écoulèrent depuis l’établissement du gouvernement théocratique qui précéda les rois. Bien avant les Hébreux, les Egyptiens eurent leur Bible qui fut le Livre des Morts. Plus près de nous, il y a 2.500 ans, le parallélisme se produisait entre les philosophies de la Chine et celles de la Grèce. Lao-Tseu, Confucius, Meng-Tsé, qui donnèrent à la Chine sa morale et aussi son organisation sociale, avaient les idées d’un Socrate. « Le malheur d’un seul être est une défectuosité qui empêche le bonheur de l’univers d’être complet et parfait », dit cette morale. Les quatre livres ou Sse-chu de Meng-Tsé, sont toujours en usage dans les écoles. Ils enseignent l’égalité entre les hommes et la révolte contre les oppresseurs. Le Chu-King, dans lequel Confucius réunit les annales, est d’un esprit rationaliste qui a toujours mis le peuple en garde contre les superstitions répandues par les prêtres. Confucius disait : « Comment prétendre savoir quelque chose du ciel puisqu’il est déjà si difficile de nous faire une idée nette de ce qui se passe sur la terre ? » Encore plus près, la révolution qui a produit le bouddhisme aux Indes a correspondu à celle qui, en Occident, a amené le christianisme. Confucius et Socrate, Bouddha et Jésus ont ainsi marqué, aux confins oriental et occidental du monde l’identité de la pensée aryenne dans ses évolutions. Les lois de Confucius, les enseignements de Socrate, les édits et sermons bouddhistes gravés sur les tables du roi Prayadesi, montrent que les hommes n’ont pas attendu le christianisme pour découvrir « la plus belle des morales ».
Même parallélisme entre les polythéismes brahmanique, égyptien, grec et nordique, ensuite, entre les monothéismes persan, hébraïque, chrétien et musulman. La chronologie biblique et celle des rois égyptiens ont été inspirées de celle de la mythologie brahmanique qui remonte à cinq mille ans. On l’observe par leur concordance. L’origine chaldéenne des légendes bibliques et du culte hébreu est visible même dans le nom de Yaveh donné à Dieu. Abraham, « père de la race », est le roi chaldéen Orkham dont Ovide a parlé dans ses Métamorphoses. Les récits fantastiquement exagérés de l’Exode et des prétendues guerres du petit peuple palestinien, que l’antiquité n’avait pas connu avant le christianisme, ne sont que les échos maladroitement adaptés des légendes recueillies par ses ancêtres, les nomades arabes qui s’étaient fixés dans « la cavité du Jourdain ». Le mythe grec des Argonautes donne une idée autrement vaste du monde que la Genèse. Alors que les Hébreux, rédacteurs du récit du déluge, n’avaient jamais vu la grande mer et ignoraient la construction des navires, comme le démontre leur description de l’arche, les Argonautes avaient parcouru en tous sens la Méditerranée, ils étaient allés jusqu’aux colonnes d’Hercule (Gibraltar), avaient parcouru la mer Adriatique et le Pont Euxin (Mer Noire) au-delà de l’Hellespont. Ce n’est que sous le règne de Josias, au VIème siècle avant J.-C. que 1es Hébreux prétendirent être « le peuple de Dieu », imaginèrent le personnage de Moïse et les fallacieuses histoires du Pentateuque complètement inconnu jusque-là et qu’ils mêlèrent aux vieux livres juifs pour en faire la Bible. Le judaïsme suivait ainsi l’exemple du brahmanisme en fabriquant l’histoire et les dogmes pour mettre les traditions de la foi à la place de la vérité et la religion au-dessus de la morale. C’est l’œuvre d’imposture qui devait être continuée au nom du christianisme et dont le principe est ainsi formulé dans le Zend-Avesta, la bible persane :
« Le bien et le mal ne sont pas dans la conscience, ils sont dans l’obéissance ou la révolte à la parole du prêtre. »
A l’encontre de ces insanités souveraines, on trouve dans les mêmes livres la voix de la véritable humanité. Les prêtres n’ont pu enlever à la Bible la beauté païenne, toute imprégnée de la vie et de la poésie orientale, du Cantique des Cantiques, ni déchirer les pages de Job, « premier cri de la douleur humaine dans la poésie, première apparition du doute, première atteinte portée au fatalisme, au servile optimisme oriental, première réclamation connue contre le malheur des honnêtes gens, le triomphe des mauvais et le gouvernement du monde » (Ph. Chasles). Ils n’ont pas davantage étouffé les imprécations des prophètes « dont la puissance d’expression est commune à tous ceux qui cherchent le vrai et qui font partie du trésor littéraire de l’humanité » (E. Reclus).
Mais c’est dans l’immense étendue de la littérature hindoue qu’on peut le mieux suivre une évolution qui a été celle de la pensée chez tous les peuples appelés « civilisés ». L’Occident a commencé à connaître l’Inde à l’époque où les Grecs d’Alexandre traversèrent l’Indus. On fait remonter à 3.700 ans, approximativement, la descente des Aryens dans l’Inde. Le Vendidad, chapitre de l’Avesta iranien, a raconté leur établissement dans ce pays. Accueillis avec un respect mystérieux, ils apportèrent la plupart des idées qui firent le Rig-Veda, le premier et le plus ancien des livres religieux, puis l’Avesta persan. Ces livres établissaient, depuis les fleuves de l’Inde jusqu’à la mer Caspienne, une unité de langage que les migrations répandirent avec les chanteurs errants et les poètes voyageurs. Leurs récits primitifs disaient les charmes de la nature, la joie des hommes et des animaux. Ils étaient profondément imprégnés d’un naturisme que les prêtres n’avaient pas encore édulcoré pour en faire des prières et des incantations. On retrouve ce naturisme dans Sakountala du poète Calidasa, qui est le poème merveilleux du mariage célébré selon la nature, sans prêtres ni magistrats, dans le Ramayana, qui se récitait dès le VIIIème siècle avant J.-C. et chantait la Montagne Mérou avec ses quatre animaux mythiques : lion, cheval, vache, éléphant, symbolisant les quatre fleuves coulant vers les quatre points cardinaux. De ces symboles, les brahmanes devaient faire les archétypes des quatre castes. La transformation religieuse se fit peu à peu avec celle des mœurs, quand les aryens pasteurs devinrent conquérants. Elle a été décrite dans les autres Védas puis dans le Mahabharata et les lois de Manou, après que les prêtres et les guerriers eurent fait triompher le brahmanisme contre la religion naturelle d’abord, contre le bouddhisme ensuite. L’Atharva-Véda a été l’expression définitive du brahmanisme triomphant. L’Inde du Nord a encore dans ses Védas une littérature ancienne où sont recueillis les chants des immigrants iraniens. Celle du Sud, chez les descendants des Dravidiens du Maisur et du Coromandel, a une littérature très riche en chansons, contes, proverbes.
Le bouddhisme inspira une belle époque d’art et de littérature. Il portait en lui les éléments d’une révolution plus profonde et qui posaient plus nettement la question sociale que le christianisme. La langue sanscrite était au moment de sa plus éclatante floraison lorsque le grammairien Pànini lui avait donné des règles littéraires au IVème siècle avant J.-C. Le Mahabharata, immense épopée de plus de 200.000 vers, recueillit tous les récits épiques et fut l’Iliade de l’Inde. On y trouve, avec la force et la fraîcheur de la sagesse et de la poésie primitives, la douceur infinie de la poésie bouddhique en même temps que la fureur et la duplicité des dieux.
« Les mondes se heurtent et une fleur sourit à l’enfant qui passe. Les Titans dévorent l’univers, et une femme armée d’une paille les extermine de sa main. » (Ph. Chasles)
« Yudichtira force les dieux à admettre son chien dans le séjour des bienheureux... Dans sa merveilleuse puissance de bonté libératrice, il arriva à faire descendre les dieux du ciel pour illuminer les ténèbres de l’enfer et changer en jouissances les supplices des méchants. » (E. Reclus)
On voit que les « charitables » chrétiens qui « se réjouissent de voir les souffrances des damnés » (Thomas d’Aquin), ont encore fort à apprendre du bouddhisme dans les voies de la charité.
Il y a identité entre la légende grecque de la Guerre de Troie et celle, hindoue, de l’histoire d’Hastinapura contée dans le Mahabharata. On n’est pas certain qu’il n’y en ait pas entre le Krichna brahmanique, antérieur à Bouddha, et le Christ. Les drames de Bavhabouti, de Boudraka, de Calidasa correspondent de leur côté à ceux d’Eschyle, de Sophocle, d’Euripide et en ont la grandeur. Manou, le penseur, l’homme libre qui se renouvelle dans des incarnations successives, se retrouve dans Parsifal, l’innocent, le pur des légendes de Graal. Les chansons de geste et les romans fabuleux du moyen-âge remontent au Mahabharata en passant par l’Iliade grecque et les épopées scandinave et germanique. L’épopée de l’Inde est le premier monument de la littérature héroïque ; elle a peuplé le monde de ses héros. En même temps, la poésie et les récits populaires de l’Avesta formaient le trésor des fables indoues, assyriennes, égyptiennes, grecques. Enrichies par l’imagination des conteurs de toutes les régions, multipliées par la variété de leurs idées et de leurs mœurs, ils alimentaient le Pantcha Tantra des Indous, le Javidan Khirad des Perses, la poésie du désert arabe et des délices des jardins enchantés des contes des Mille et une nuits, pour se transmettre dans tout l’Occident et provoquer la floraison de la poésie populaire du moyen âge, jusque dans l’Amérique du Nord où Erik le Rouge et ses compagnons norvégiens portèrent la poésie de leur pays au Xème siècle. L’influence de l’Inde s’était répandue en Indochine avant que cette région fut soumise à la Chine. La civilisation Khmer, dont l’œuvre artistique est si admirée aujourd’hui, fut d’origine indoue. Les Malais eurent par leurs navigateurs une influence prépondérante sur toutes les terres océaniques et leur apport fut plus grand dans les contes des Mille et une nuits que celui des Indous, des Cinghalais et des Arabes.
La connaissance des langues indo-européennes a bien établi aujourd’hui l’unité de la pensée aryenne dans la littérature de ces langues. Il y a encore à découvrir si des rapports n’existent pas entre cette pensée et les vieilles civilisations d’autres langues disparues, particulièrement en Amérique. Au Mexique, on retrouve une des plus belles langues, le Kahuath, dont la richesse en termes abstraits montre un très haut développement intellectuel (E. Reclus). Les Maya (Yucatan) avaient une littérature attestée par les bibliothèques que les inquisiteurs catholiques brûlèrent. Les Quichué du Guatémala ont laissé un livre d’histoire, le Popol Vuh que l’ignorance de leur langue n’a pas encore permis aux Européens de traduire. En Colombie on a retrouvé la grammaire et le lexique de la langue chuintante que les Muysca et les Chilcha, aujourd’hui disparus, parlaient encore au XVIIIème siècle. Les Incas, qui occupaient la plus grande partie de l’Amérique du Sud, eurent une langue et une littérature épique dont les souvenirs sont demeurés dans les chants des indigènes opprimés. Morelly a célébré, dans sa Basiliade, les mœurs communistes de ces peuples qui furent victimes de leur douceur et de leur passivité devant les violences des « civilisateurs » qui prétendaient les tirer des « ténèbres de l’idolâtrie!... »
La connaissance de plus en plus exacte de la formation et du développement de la pensée humaine, de l’origine et de l’étendue de ses manifestations, a pour utile résultat de mettre les idées et les hommes à leur vraie place. A mesure que les idées se découvrent et se précisent dans leurs origines, les hommes sous les noms desquels elles étaient présentées perdent de plus en plus de leur prestige personnel. Le prétendu créateur n’est plus qu’un adaptateur plus ou moins génial ou quelconque et apparaît souvent comme un imposteur quand il n’est pas un personnage mythique. Aussi, importe-t-il de moins en moins que les Moïse, les Zarathoustra, les Jésus, les Orphée, les Homère, les Ossian, les Shakespeare et la multitude de tous ceux qui peuplent les légendes aient ou non existé. Vrais ou mythiques, ils ne sont que la personnification d’états de la pensée humaine. Ce qui importe, c’est l’action que cette pensée a exercée sur la masse des hommes, car c’est peut-être de cette masse qu’est sortie, anonymement, ce qu’elle a produit de plus beau et de plus fécond. Comme l’a écrit Gorki :
« L’éternité manque à ces littérateurs dont les noms ne sont pas distinctement gravés dans la mémoire séculaire. Mais c’est eux qui créent la « littérature » au sens le plus large du mot ; et ils ressemblent à ces maçons anonymes qui construisaient les cathédrales miraculeuses du moyen-âge. »
Trop souvent la déification des individus quels qu’ils furent n’a été qu’une déviation malfaisante de la pensée dans ses fins universelles. Il importe peu aussi que l’œuvre attribuée à Shakespeare ait été celle de Bacon ou d’autres, que Don Juan, Tartufe, le Misanthrope, soient de Corneille et non de Molière, comme l’a soutenu Pierre Louys. Si Shakespeare est « le plus purement humain de tous les grands artistes » (Oscar Wilde), c’est par l’œuvre qui porte son nom, ce n’est pas par une existence individuelle dont il n’est resté aucune trace certaine. Si Molière prenait son bien où il le trouvait, comme il le déclarait lui-même, la seule chose importante est que ce bien ait mérité l’admiration des hommes.
Il n’est pas d’homme « créateur » dans le vrai sens du mot ; il n’est que des hommes qui ont su se servir de la pensée formée avant eux et ils ne sont plus ou moins grands que dans la mesure où ils ont fait servir cette pensée pour tous les hommes. L’œuvre individuelle a été utile pour apporter de l’ordre dans le chaos de la pensée collective et pour lui donner plus d’art. Suivant les temps et les circonstances qui ont plus ou moins favorisé le génie de ces hommes, leur œuvre a été plus ou moins utile à l’humanité. Par contre, l’œuvre individuelle a trop souvent fait perdre à la pensée son caractère général et véritable. C’est par elle que se sont établies toutes les formes arbitraires et spéciales de la littérature ; c’est par elle que la pensée perdant son indépendance s’est faite la servante des puissances et a été transformée en moyen d’exploitation. La pensée, et toutes les manifestations de son domaine, ne sont véritablement utiles à tous qu’en fonction de la liberté.
Les afflux désordonnés et tumultueux du passé trouvèrent en Grèce leur expression et leur grâce suprêmes dans l’harmonie de la pensée et de la forme réalisant la plus haute et la plus universelle beauté. Homère marqua la fin du désordre épique dont la substance avait été recueillie dans les expéditions des Argonautes, des Héracleides et des Théséides, et le commencement de cette harmonie dont si souvent les temps modernes durent rechercher les exemples. Elle a, de toute la matière de l’antiquité, forgé la matrice d’où est sortie une vie nouvelle, aussi est-ce bien à tort qu’on a fait commencer l’ère moderne à une date arbitrairement fixée au temps d’Auguste. Rome d’abord, le christianisme et les temps modernes ensuite, n’ont eu et n’ont encore de grandeur que dans leur rapport avec la pensée grecque qui a condensé et purifié l’esprit humain. Socrate, Eschyle, Phidias, ne sont pas une fin ; ils sont un commencement et ils sont l’éternité de la beauté spirituelle et plastique. Avec eux, Hésiode, Pindare, Platon, Aristote, Sophocle, Aristophane, Démosthène, Hérodote, Thucydide, ont continué et achevé l’œuvre d’Homère. Ils ont donné à la poésie, à la philosophie, au théâtre, à l’éloquence, à l’histoire, ces formes éternelles auxquelles toutes les époques qui ont suivi, et la nôtre en particulier, ont dû revenir pour se souvenir que la pensée humaine eut des sources pures. C’est bien en vain qu’on cherche à donner le change en prétextant qu’il faut à la vie actuelle d’autres modes de pensée ; on rejette le meilleur de l’héritage antique, mais on en conserve le pire. Cette ère véritable commença avec l’histoire écrite, au temps où Phédon faisait frapper les premières monnaies. Trois siècles après, Pisistrate faisait recueillir les textes des chants homérides qui formèrent l’Iliade. C’était il y a environ 2.700 ans, époque qui correspond aux premières Olympiades. L’adoption de l’ère des Olympiades eût été plus justifiée que celle de l’ère d’Auguste qui prévalut uniquement par flatterie pour la puissance romaine et dont on a fait cinq cents ans plus tard l’ère chrétienne. On pourrait appeler cette période plus exactement « l’ère de l’impérialisme », car c’est elle qui a inauguré en Occident, par le triomphe parallèle de l’empire romain et du monothéisme, cette forme odieuse d’attentats permanents contre les peuples ; que, depuis deux mille ans, l’orgueil imbécile et criminel des chefs d’Etats et d’Eglises n’a pas cessé d’entretenir. Si cet impérialisme eut une certaine grandeur au temps de Rome, où il s’accompagna d’une œuvre vraiment civilisatrice, il perdit complètement, depuis, cette grandeur pour descendre à la honteuse dégradation que l’humanité a atteinte aujourd’hui dans les guerres entre nations et les entreprises coloniales. Le christianisme n’a pas mérité de donner son nom à l’ère qui le porte parce qu’il a provoqué et favorisé un véritable progrès humain, mais il l’a bien mérité par les lourdes et terribles responsabilités qui lui incombent dans le développement de la barbarie impérialiste, responsabilités que toutes les sophistications historiques ne pourront effacer. Il suffit de voir ce que les représentants du christianisme font aujourd’hui pour se rendre compte de ce qu’ils purent faire hier.
Dans le domaine de la pensée, Rome ne sut que s’inspirer de la Grèce.
« Rome, dans ses temps d’austérité conquérante, n’avait pour poésie que des chants guerriers et des lois oraculaires. » (Ph. Chasles)
Les vaincus lui apprirent à penser à autre chose qu’aux conquêtes et aux pillages. Esclaves méprisés sous le nom de « Grécules », les Grecs lui apportèrent une langue, une philosophie, une littérature, un théâtre qui ne possédèrent quelque beauté qu’en étant aussi peu romains que possible. Quand Rome perdit la rigidité de ses mœurs, ce fut pour tomber dans la pire corruption politique et la plus criminelle débauche, malgré les efforts de quelques hommes supérieurs à qui elle confia parfois son destin. Certains de ces hommes firent de l’époque de « la paix romaine » une des plus grandes de l’humanité. Un Lucrèce s’inspira d’Epicure dans sa Nature des choses et donna à la littérature latine les grandeurs humaines de la pensée grecque. Un Sénèque, qui avait pour patrie « l’enceinte de l’univers », continua l’œuvre des Socrate, Zénon et Epicure. Un Marc Aurèle la porta jusqu’au trône des empereurs. Cicéron, Tite-Live, Horace, Virgile, Ovide, Properce, Catulle, Tibulle, Plaute, Térence, les Pline, Lucien, Martial, Pétrone, Juvénal, Perse, Tacite, etc... furent tous d’esprit grec plus que romain. Les plus romains furent les moins dignes, ceux qui se firent les « clientis » flagorneurs des « patronus » et célébrèrent les dépravations de la décadence. On a vanté le génie de César ; les plus grandes réserves sont à faire à son sujet. Il y avait autour de lui trop de flatteurs et il y a dans son histoire trop de plutarquisme (voir ce mot).
Avant la décadence romaine, une renaissance scientifique, philosophique et littéraire s’était produite, d’abord en Egypte où s’étaient réfugiés savants et lettrés grecs ; elle s’était étendue à l’ancienne Grèce, puis à Rome. Cette renaissance fut savante, mais ses écrivains furent trop souvent des sophistes aux conceptions alambiquées et à l’expression obscure. Les idées s’usaient chez les peuples, les paroles devenaient « hargneuses », comme a dit Montaigne. Les plus connus de ces écrivains sont, à des degrés de valeur très divers : les poètes, Stace, Aratos, Callimaque, Lycophron, Théocrite, Apollonius de Rhodes ; les prosateurs, philologues, grammairiens, critiques littéraires, Zénodote, Aristarque, Cratés, Denys de Thrace, Apollonius le sophiste, Zoïle, Plutarque, Julien ; les historiens, Hérodien, Arrien, etc... Ce que cette renaissance eut de plus remarquable, c’est qu’elle coïncida avec un mouvement vaste et profond des esprits, qui avait de nombreux foyers en Orient et s’étendait jusqu’à l’Inde d’où lui venait l’influence du bouddhisme. Ce mouvement se manifestait partout où fermentait le besoin de justice et de transformation sociale. Ils portaient les espoirs d’une révolution universelle que les prophètes juifs appelaient fougueusement et que les chants sibyllins annonçaient dans ces termes :
« La terre sera le bien de tous. On ne la divisera pas par des limites ; on ne la fermera pas en des murailles. Il n’y aura plus de mendiant, ni de riche, de maitre ni d’esclave, de petit ni de grand, plus de rois, plus de chefs ; tout appartiendra à tous... »
Ce fut là la première littérature chrétienne et, de l’effervescence qu’elle créa, est sorti le christianisme. Le mouvement dépassait singulièrement les imposteurs religieux, particulièrement hébraïques, ignorants de tout ce qui appartenait à l’univers, qui se sont servis du personnage mythique de Jésus pour en faire un nouveau Mithra, un nouvel Apollon, un nouveau Bouddha, après en avoir fait le Messie vers lequel se levaient les éternels espoirs des hommes éternellement dupés. Il ne fut qu’un de plus parmi tous les messies qui devaient venir abolir la loi ; il ne vint que pour « l’accomplir » (Saint Mathieu). Des dieux s’en allaient, comme l’a constaté Renan, pour faire place à d’autres ; les hommes étaient une nouvelle fois écartés de « l’unité primitive » et du « culte de tout ce qui est l’homme, la vie entière sanctifiée et élevée à une valeur morale ».
L’Ecole d’Alexandrie, qui représentait le plus activement la nouvelle Grèce, fut le foyer intellectuel du mouvement préparateur du christianisme. Philon et les Thérapeutes ou « Guérisseurs », précédèrent les chrétiens de l’école judéo-grecque ; « ils furent des chrétiens avant le Christ, et c’est très justement qu’Eusèbe de Césarée, l’historien de l’Eglise primitive, vit en eux des fidèles de son culte » (E. Reclus). M. Havet a vu en Philon, inspirateur de Paul de Tarse et de l’auteur de l’Evangile dit de Jean, « le premier père de l’Eglise ». Plus tard les discussions furent vives entre les néoplatoniciens parmi lesquels furent Plotin, Porphyre, Jamblique, et les orateurs ou écrivains de la nouvelle foi. Tout s’éteignit avec la disparition de l’Ecole d’Alexandrie, un quart de siècle après la destruction de la bibliothèque de cette ville en 390, et après le meurtre d’Hypatie. Les derniers savants se réfugièrent alors à l’Ecole d’Athènes ; un siècle après, la renaissance grecque était finie quand Justinien fit fermer cette école. Le christianisme triomphait de l’humanité dans toute l’Europe.
Les « Pères de l’Eglise » qui fondèrent le christianisme dans sa morale primitive et non dans ses dogmes, furent les orateurs et écrivains les plus remarquables de la littérature chrétienne. Les plus grand d’entre eux, Jérôme en Occident, Jean Chrysostome en Orient, sont oubliés sinon reniés de l’Eglise au profit de tous les métaphysiciens qui ont fabriqué son impénétrable casuistique. La plupart de ces « pères » mirent un enthousiasme profond et sincère au service de la pensée nouvelle qui aurait dû amener la plus magnifique révolution. La passion de la rhétorique en égara plus d’un dans les voies perfides dont l’Eglise a profité pour s’établir solidement, tel Augustin, ergoteur subtil. On vit Cyprien, philosophe et homme politique, Salvien, orateur élégiaque, Sidoine Apollinaire, rhétoriqueur bel esprit qui apportait dans le christianisme le dilettantisme de la décadence. A côté de Jean Chrysostome, dont la véhémence oratoire faisait trembler le trône de Byzance, Jérôme, ascète farouche et le plus grand de tous par la puissance de ses écrits « poussait toute sa force à l’anéantissement de l’ordre social... Pendant qu’Attila frappait les hommes, Jérôme tuait les idées » (Ph. Chasles). Il était aussi violent contre les premiers abus des chrétiens que contre ceux du paganisme agonisant. « Puissant et terrible satirique », c’est dans son œuvre « qu’il faut étudier les peintures les plus cruelles des mœurs du temps » (id). Il y a en lui l’ardeur et les accents des anciens prophètes qui élevaient la morale au-dessus de la religion et faisaient passer la question sociale avant la 1oi pour revendiquer les droits de la justice.
La pensée chrétienne perdit vite cette grandeur âpre et sauvage lorsque le christianisme ne posséda plus son esprit de révolte, qu’il ne fut plus la clameur de l’humanité appelant la vérité, la justice et la liberté. Au kalon des Grecs, qui confondait le beau et la vertu en exaltant la vie, elle allait substituer l’abnégation et le malheur qui sanctifient la souffrance. Elle tomba aux disputes dogmatiques des gens d’église et à la casuistique entortillée par laquelle ils s’adaptaient au monde. Le christianisme ennemi de l’art ne pouvait produire des poètes. Il ne pouvait faire chanter un Homère ou un Virgile alors qu’il brûlait leurs œuvres. La première poésie chrétienne fut d’une lamentable médiocrité. Elle fut représentée par de tristes et pauvres productions de vagues rhéteurs, des Prudentius, des Vigilantius, qui voulant « appliquer aux dogmes chrétiens le rythme des poésies païennes s’épuisèrent dans ce labeur stérile » (Ph. Chasles). Leurs successeurs ne réussirent pas mieux ; ils ne furent grands que dans la mesure où ils furent humains et non chrétiens, tels un Racine, un Lamartine, et lorsqu’ils exprimèrent, tel un Lamennais, la révolte de l’esprit de liberté contre les dogmes.
Malgré le système d’envoûtement, de terreur et de mort que l’Eglise faisait peser sur la pensée, celle-ci ne pouvait mourir. Pendant dix siècles elle prépara dans les masses populaires son nouvel enfantement. Tout en se formant peu à peu en nationalités, ces masses se firent des langues à elles qui éliminèrent ou absorbèrent celles des vainqueurs pour être celles de leur terroir. Elles se créèrent des moyens nouveaux d’expression pour parvenir à définir et à extérioriser tout ce qui bouillonnait en elles. Et ces dix siècles de laborieuse gestation aboutirent, malgré le christianisme, parfois avec lui parce qu’il était redoutable, souvent contre lui parce qu’il ne pouvait détruire l’instinct humain, à la magnifique éclosion d’une littérature et d’un art en qui furent exaltées une fois de plus toutes les vieilles légendes du ciel, de la terre, des eaux qui demeurèrent de tout temps au cœur des hommes. On assista alors dans la plus grande partie de l’Europe, mais particulièrement en France, à l’épanouissement de ce XIIIème siècle qui fut peut-être, en littérature, le plus beau de tous parce qu’il apporta les magnificences d’un renouveau qui n’eut jamais plus, depuis, des sources aussi fraîches et aussi pures. La pensée humaine s’évadait des catacombes, des cryptes, des couvents, elle échappait aux massacres et aux autodafés, elle s’envolait au-dessus des in-pace et des cimetières vers la lumière, la liberté et la vie. Car il n’est pas vrai que le moyen-âge, sur lequel l’Eglise régnait si lourdement comme puissance temporelle plus que spirituelle, ait été soumis. « Aucune société n’a été plus dominée par la violence et l’intérêt », a écrit M. Sartiaux. Il n’est pas exact non plus que le moyen- âge fut une époque de grande foi ; les arts de la pierre, de l’écriture, de la parole l’attestent par les cathédrales, les livres, les sermons. « Les témoignages surabondent à toutes les époques du moyen-âge, en France, que les libres-penseurs de tout genre n’ont pas manqué » (Ch.-V. Langlois). Il en était de même dans toute la « chrétienté ». En Italie l’incrédulité se manifestait jusque chez les Papes. La cour de Frédéric II, en Sicile, était au XIIIème siècle « le centre le plus brillant de culture et le plus hardi de pensée » (Sartiaux). D’après Benvenuto d’Immola « plus de cent mille nobles pensaient, comme leur capitaine Farinata et comme Epicure, que le paradis ne doit être cherché que dans ce monde ». Des savants affrontaient hardiment les discussions scolastiques, malgré les menaces ecclésiastiques. L’Université retentissait des échos des débats qu’apportaient dans les chaires les Jean Scot, Tanchelm, P. de Bruys, Eon de l’Etoile, H. de Lausanne, Arnaud de Brescia, les érudits de l’Ecole de Chartres, etc... Adelhard de Bath, qui mettait la raison au-dessus de l’autorité, disait :
« Qu’est-ce que l’autorité ? Sinon une corde qui sert à conduire les bêtes »
Joachim de Flore, Amauri de Bène, Ortlieb, les averroïstes, parmi lesquels Siger de Brabant fut le plus célèbre, furent aussi de ces libres discuteurs. Les hérésies se multipliaient :
« La plupart n’ont aucun caractère dogmatique ; presque toutes constituent un vaste mouvement de révolte contre l’Eglise. » (Sartiaux)
L’art des cathédrales montrait chez les artistes des préoccupations plus naturistes que religieuses et le peuple n’aimait tant ces monuments que parce qu’ils étaient ses « maisons communes », où il discutait de ses affaires et se réjouissait aux jours de fêtes publiques, plus que les « maisons de Dieu ». Le jour où l’on ne voulut plus l’y admettre que pour le culte, lorsqu’il n’y fut plus chez lui, qu’on lui interdit d’y chanter et danser, d’y célébrer ses fêtes de l’Ane, des Fous, des Cornards et autres joyeusetés dont des ecclésiastiques eux-mêmes étaient les principaux animateurs, il s’en désintéressa, et on finit de construire des cathédrales.
La même liberté de l’esprit se manifestait dans toute la littérature. Jamais elle ne fut plus libre, plus variée, plus riche de pensée et d’expression. Elle ne fut d’aucune école et elle fournit des modèles à toutes celles qui naquirent dans les siècles suivants. Les esthètes compliqués qui ont mené de notre temps un combat qu’ils croyaient audacieux pour « l’art pour l’art », la « poésie pure », le « vers libre », n’ont rien inventé, pas plus que les romantiques, les naturalistes, les réalistes, les symbolistes, les surréalistes et autres istes plus ou moins bruyants. Leurs revendications montrent seulement tout ce que l’autorité des cuistres d’académies, la discipline du « bon goût » restrictif et hypocrite, établies pour le service des classes dirigeantes, ont fait perdre à l’esprit humain depuis le moyen-âge et tout ce que cet esprit a à reconquérir.
A côté des ouvrages des clercs qui opposaient l’incrédulité au dogme ou discutaient de sa légitimité, tels les Quatre Ages de l’Homme, de Philippe de Novare, les Vers de la Mort, de Hélinant, le Livre de Mandevie et une foule d’autres, les fableaux montraient une incrédulité frondeuse, parfois jusqu’à la cruauté, en affirmant dans la littérature française ce qu’on a appelé « l’esprit gaulois ». La littérature courtoise des chansons de geste, des romans, de la poésie lyrique, composée par des poètes devenus officiels auprès des grands et destinée à la distinction de ceux-ci, était plus soumise à l’Eglise. Malgré ce, les traits y étaient nombreux d’une indépendance vivace que les formes du respect n’atténuaient qu’en apparence et, lors de la Croisade des Albigeois, les troubadours protestèrent avec la plus grande violence contre les crimes de l’Eglise et de la royauté qui tuaient leur langue et leur littérature en massacrant les hérétiques. La littérature bourgeoise des romans moraux, des contes d’animaux, celle du Roman de la Rose, du Roman de Renart, du théâtre profane, jusqu’aux contes plus ou moins dévots, aux mystères joués dans ou devant les églises, aux sermons gaillards débités par des moines de haulte-graisse, tout cela avait la plus libre allure et manifestait parfois une incrédulité profonde et agressive. On y trouve les échos des conflits nombreux entre les administrations communales, la féodalité, le roi, l’Eglise, et des disputes scolastiques où l’Université prenait une indépendance trop oubliée aujourd’hui. A côté de l’œuvre collective, anonyme, qui fut immense et qui est perdue pour la plus grande partie, le moyen-âge littéraire vit éternellement dans les œuvres des Marie de France, Chrétien de Troyes, Villehardouin, Guillaume de Lorris, Jean de Meung, Joinville, Rutebeuf, Froissart, Oresme, Gerson, Charles d’Orléans, Coquillart, Villon et des nombreux auteurs qui ont alimenté du Xème au XVIème siècles les poésies lyriques et dramatique, les romans d’aventures et antiques, les fableaux, les littératures didactique, morale et religieuse, l’histoire et tous les autres genres. C’est ce magnifique héritage, méprisé sottement par Boileau au nom de Malherbe, que depuis cent ans la France a retrouvé, qu’elle étudie et dont elle est encore loin d’avoir épuisé le fond.
Avant de terminer avec le moyen-âge, il est indispensable de voir rapidement comment l’épopée universelle, chant héroïque de l’humanité, se retrouve dans les traditions des différents peuples modernes. Les mêmes sources, encore obscures, d’où était sortie l’épopée aryenne, sont à l’origine de toutes les mythologies qui prirent des caractères particuliers avec la formation des nationalités. Ces mythologies ne furent pas moins riches dans les pays du Nord européen que dans ceux du voisinage méditerranéen plus directement soumis à l’imprégnation gréco-latine. Les unes et les autres, malgré les modifications profondes qu’elles reçurent des milieux où elles se développèrent, n’en conservèrent pas moins un air de famille révélateur de la source commune : le mythe solaire, engendreur des héros aimés des hommes.
Dès les temps les plus lointains, les récits apportés par les poètes voyageurs ont trouvé des concordances dans la matière intrinsèque de chaque région et s’y sont adaptés. Chaque peuple a eu sa mythologie, héritage merveilleux des époques panthéistes où la pensée des hommes s’harmonisait avec la nature. Il en a gardé un souvenir plus ou moins vivace. Les mythologies des peuples du Nord, qui ont moins subi les déformations des disciplines chrétiennes, sont demeurées beaucoup plus vivantes et ont entretenu chez ces peuples un esprit de liberté, un respect de la personnalité humaine de plus en plus effacés dans les pays gréco-latins. C’est le norvégien Ibsen qui a apporté dans la littérature contemporaine la volonté la plus ferme, la raison la plus lucide, le courage le plus héroïque, à la défense du moi humain, à l’effort de l’individu pour s’associer à tous les hommes dans une communion harmonieuse, contre les tendances du moi-égoïste, de l’individu écraseur qui s’érige en maître sur la collectivité asservie. Ibsen, dans sa conception de l’individualisme, a exprimé le vieil instinct que sa race n’a jamais perdu, cette « révolte de l’âme humaine » dont il a ravivé la flamme avec une puissance désormais inoubliable. La voix qui prononce ces paroles : « Dieu est charité », à la fin de Brand, « est celle de l’être universel, de la nature une et indivisible dans laquelle Brand — le brandon qui porte l’incendie pour mettre le feu aux âmes — s’est enfin absorbé » (Prozor). C’est la voix millénaire d’un paganisme resté, dans les glaces hyperboréennes, plus ardemment animateur des âmes, excitateur des esprits, que sous le brûlant soleil de la Grèce, de l’Italie et de l’Espagne. Depuis la nuit des temps, il fait galoper l’imagination de Peer Gynt et de la vieille Aase vers les fêtes du château de Soria-Moria, il berce leur naissance et leur mort de la chanson de Solveig.
Odin, le « marcheur », fut le chef des caravanes qui apportèrent en Scandinavie, avec les marchandises précieuses, les légendes de l’Orient. Les Vikings, chasseurs et pirates du Nord, en firent leur dieu, celui des conquérants, le « maître des gibets », et lui donnèrent pour séjour le « Val holl », le « palais des égorgés », où il réunissait après leur mort les héros tués dans les combats et qui lui étalent sacrifiés. Ils revivaient auprès de lui pour des fêtes éternelles. Les Eddas sont les chants de l’épopée sur laquelle régna Odin après avoir détrôné Thor, « l’homme au marteau », protecteur des esclaves. Ces Eddas sont à l’origine de l’épopée germanique des Nibelungen qui ont ouvert à Wagner le trésor des légendes nationales allemandes. Wagner leur a donné une illustration grandiose dans sa Tétralogie de l’Anneau du Nibelung où l’on trouve les symboles d’une philosophie profondément libertaire, ceux de la corruption des dieux, puis des hommes, par la possession de l’or. Le Ragnaraka ou Ragna-Rokur scandinave est le « crépuscule des dieux », Wotan, « le voyageur », est le sosie d’Odin ; Loge « le feu » est celui de Surt ; Siegfried, Gunther, Brunhild, Gutrune, sont les Sigurd, Gurnar, Hjœrdis, Dagny scandinaves, les personnages des Guerriers d Helgeland d’Ibsen. Les héros de l’Edda rejoignent ainsi ceux de l’Heldenbuch germanique (Livre des héros) par l’épopée plus moderne des Nibelungen. Les Nornes, présidant aux destinées des héros scandinaves et germaniques, sont les Maïrai des Grecs, les Parques des Romains. Dans la mythologie scandinave, encore plus que dans celle de Germanie, la femme occupe un rang aussi élevé et aussi respecté que celui de l’homme. Elle n’est jamais tombée, dans les pays du Nord, au degré d’abaissement où la mirent le judaïsme, le christianisme, le mahométisme, ou seulement à l’état d’infériorité où elle est encore tenue dans les pays latins. Elle y est demeurée l’égale de l’homme, même sous l’influence chrétienne, aussi a-t-elle, dans l’épopée du Nord, une place autrement importante que dans les autres. Le christianisme, qui ne modifia jamais profondément le caractère scandinave, établit seulement quelques analogies : entre Odin-Wotan et Dieu le père, entre Thor et Jésus, entre Alfadir, le « Père universel » des Islandais et Dieu. Lorsqu’il pénétra en Islande, il eut de bons rapports avec l’ancienne religion. Le prêtre islandais Sœmond Sigfusson commença, vers l’an mil, le recueil des récits et chants de l’Edda appelés de la « vieille grand-mère ». Snorri Sherleson le continua entre 1178 et 1241. Le christianisme aurait vainement tenté, en Scandinavie, l’œuvre de destruction qui fut la sienne en pays latins.
Les vieilles traditions ont été perpétuées en pays scandinaves par les Sagas, récits composés pour la plupart en Islande, du XIIème au XIVème siècle. Le Flateyjarbok norvégien en est un recueil. On y retrouve l’évolution des chansons de geste par le mélange d’éléments étrangers, et des sagas redirent les légendes de Tristan et Yseult, de Parsifal, qui appartiennent à une des épopées les plus importantes, celle des Celtes. Ces peuples étaient particulièrement curieux de connaissance nouvelle et de poésie. Dans le clan celtique, l’homme riche ne l’emportait pas sur le lettré dans la considération générale. Il y avait plusieurs classes de lettrés. Les bardes celtiques, les « porteurs de torches », étaient nombreux et actifs, répandant la pensée de leur race dans l’Europe entière. Ils chantèrent les plus belles légendes qui alimentèrent la production épique, celle si humaine de Tristan et Yseult, la plus admirable des légendes d’amour, et celles des lais qui sont à l’origine de la poésie courtoise. Cette poésie se rattache aux sagas irlandaises dont les auteurs étaient des druides ou files, et au cycle de Finn ou Find, appelé Fingal par Macpherson qui en a donné, a dit Ph. Chasles, une « parodie ». L’épopée irlandaise chantait les guerriers d’Erin. Ossian, cité comme son principal poète, fut un personnage plus ou moins mythique.
L’épopée galloise, apparentée à la précédente et plus mystique, donna naissance, lorsqu’elle fut en contact avec le christianisme, au cycle de Merlin ou de la poésie bretonne. On y trouve combinés les cultes de Mithra et de Jésus avec les idées druidiques.
L’épopée anglo-saxonne fleurit à côté des épopées scandinave, germanique et celte. Le poème de Beowulf, roi du Jutland, fut une de ses principales œuvres. Du XIIème au XVème siècle, l’Angleterre chanta les ballades de Robin Hood, le héros saxon mis hors la loi, qui symbolisait la résistance contre les envahisseurs normands et qui est devenu Robin des Bois dans la traduction française du Freychutz ; l’opéra de Weber.
Les rapports de ces épopées avec la mythologie générale se retrouvent dans celle de Finlande. Les chants populaires sont demeurés vivaces chez les Finnois plus qu’en toute autre région. Le Kantelatar, où ces chants sont réunis, le Kalevala, ensemble de l’épopée finnoise, le Loitsurunot, collection de chants magiques, ont été recueillis directement de la bouche du peuple par Elias Lönarot, auteur de ces ouvrages, dans la première moitié du XIXème siècle.
En Russie, les chansons appelées bylines se sont aussi transmises dans le peuple depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours. On y trouve des souvenirs scandinaves et tartares, mais elles prirent de bonne heure un caractère religieux inspiré des écrivains byzantins. La Serbie a aussi conservé la vieille poésie populaire de ses pesmés. Les Hongrois ou Magyars apportèrent avec eux une poésie lyrique plus particulière à leur race et qui a gardé longtemps son originalité populaire. Comme le finnois, le hongrois appartient au groupe des langues ouralo-altaïques ; il s’est beaucoup modifié aux contacts européens. L’ancienne littérature est demeurée non moins vivante dans la poésie arabe qui a conservé les contes, proverbes, apologues des livres de Calila, de Bidpaï, des Mille et une nuits, du roman d’Antar, et qui a connu un magnifique épanouissement au temps des califes Abassides, Aaroum-Al-Raschid et Al-Mamoun. Les Arabes ont répandu leur poésie avec leur civilisation dans tous les pays où ils sont passés. Ils ont formé, avec la poésie persane que les religieux Soufis firent à la fois sensuelle et dévote, la littérature turque.
Les épopées française, germanique, anglo-saxonne, s’influencèrent mutuellement. Les chansons de geste françaises sont d’inspiration franque. Commencés sans doute pour célébrer la gloire des premiers rois francs leurs héros principaux, Roland et surtout Charlemagne, furent les sujets d’une littérature, épique aussi importante en Allemagne qu’en France. L’épopée des Nibelung devint française en devenant burgonde et certains y rattachèrent l’histoire de la reine Frédégonde Albérich, un des Nibelung, se retrouve dans l’Aubéron de Huon de Bordeaux, roman français. Les jongleurs gallois et bretons fournirent la matière du cycle appelé armoricain auquel se rattachent les Lais de Marie de France, les légendes de Tristan et du Graal, celles de toute la chevalerie de la Table Ronde avec Arthur pour principal personnage. Adaptées par Chrétien de Troyes dans son Tristan et son Perceval, ces légendes passèrent en Allemagne. Elles y eurent de nombreuses versions dont Wagner se servit pour faire son Tristan et Yseult, son Lohengrin et son Parsifal. Au mélange singulier des divers cultes adoptés par le druidisme, les Francs et les Germains ajoutèrent l’empreinte de leur rudesse. Toute la matière épique qui remplit le moyen-âge fut inspirée du génie septentrional. De ce génie sont nés « cet amour de la nature, cette contemplation mélancolique, ce culte des femmes et cette méditation tendre, abstraite, souffrante, que le génie oriental repousse, et qui a donné un caractère nouveau à la littérature et aux arts chrétiens » (Ph. Chasles).
La littérature chevaleresque française influença fortement l’Espagne et le Portugal. L’Espagne eut son héros aussi populaire que Roland dans le personnage du Cid. Lorsque les « barbares du Nord », comme Stendhal a appelé ceux qui firent la Croisade des Albigeois, eurent tué la poésie provençale en France, cette poésie se réfugia dans la Catalogne et l’Aragon. Bien avant Louis XIV, il n’y avait plus de Pyrénées entre le Languedoc et la Catalogne. Ce sont les Catalans qui ont eu l’honneur de conserver vivante la langue d’oc et avec elle l’esprit méridional de révolte qu’ils n’ont pas cessé d’opposer à la puissance doublement oppressive des rois et de l’Eglise. L’Italie reçut l’influence provençale marquée de son côté par les Arabes. La langue d’oc contribua à la formation de la langue italienne. La littérature des troubadours provençaux fut familière à Dante, à Pétrarque, à Boccace, qui portèrent cette langue à sa perfection. C’est dans l’œuvre de Dante que la pensée chrétienne a trouvé son expression la plus vaste et la plus humaine. Cette œuvre est comparable à une cathédrale.
Tel est le tableau, rapidement esquissé, du vaste mouvement littéraire, de source et de formation populaires et collectives qui remplit quinze siècles dans l’Europe en gestation de ses différentes nationalités. La Renaissance allait changer les choses. A la pensée de source populaire issue des bouleversements de cent siècles de migrations dont l’Europe était le produit, elle substituerait celle de formation savante née de la stabilisation des civilisations indoue, égyptienne, grecque, romaine et arabe. A la vie sociale collective qui réunissait les individualités dans un même ensemble de pensée et d’activité formé par l’esprit et la solidarité corporatifs, elle allait faire succéder l’esprit individualiste et la concurrence qui diviseraient les hommes. La littérature imprimée succéderait à la littérature orale. La production collective, transmise par les poètes errants, s’épuiserait privée de voix et de renouvellement. Il ne resterait, pour le peuple illettré et retranché de la communion intellectuelle des hommes, que des baladins inférieurs incapables d’élever son âme et qui ne pourraient que l’abaisser par leur vulgarité. Ceux qui auraient quelque talent écriraient des livres pour les riches qui pourraient les acheter sinon les lire. Bien plus qu’au moyen-âge, la nuit se ferait autour du peuple, la nuit de l’esprit dans laquelle il serait plongé systématiquement pour tomber au niveau de cette bête humaine qu’il serait à la veille de 1789 en attendant qu’on lui donnât les lumières fallacieuses qui en feraient le « matériel humain » d’aujourd’hui. Le manant, qui n’avait été inférieur au seigneur que par la différence de condition sociale, allait devenir la « canaille » qu’on mépriserait encore plus pour son ignorance. Dans la société hiérarchisée plus rigoureusement et contenue par des pouvoirs plus forts, les classes seraient de plus en plus séparées et hostiles, les individus plus divisés par la multiplicité des intérêts. L’art et la littérature prendraient des formes individuelles et un caractère aristocratique étrangers au peuple. Les classes ne parleraient plus la même langue. La véritable invention littéraire serait tarie en perdant le contact de la vie générale au point qu’on créerait une nature artificielle. On donnerait plus de perfection à des formes anciennes de la pensée, on en renouvellerait d’oubliées, on en redécouvrirait de perdues, mais la véritable sève, celle de la vie populaire, de la vie de tous, leur manquerait le plus souvent. Les poètes, réduisant leur inspiration à la matière livresque, chercheraient en vain, comme André Chénier plus tard, à faire « des vers antiques sur des pensers nouveaux » ; tout ce qu’ils pourraient, et ce qui donnerait tant d’importance aux superfluités de l’art pour l’art, serait de faire des vers nouveaux sur des pensers antiques. Ils se renfermeraient toujours plus dans des conventions étroites et fausses d’écoles, de chapelles, de boutiques littéraires ; ils s’isoleraient de la vie commune par une vanité de caste, des superstitions séniles que la vie déborde tous les jours. Le goût immodéré de la forme les pousserait à ces « désordres monstrueux et inconnus » constatés par Baudelaire. Certes, il y en a eu, il y en a encore, sachant s’évader de cette cage et mériter l’attention reconnaissante de tous les hommes. Mais combien a été plus nombreuse la foule bruyante et encombrante, quand elle n’était pas malfaisante, des parasites qui n’ont pas plus inventé qu’ils n’ont pensé, la multitude des rhéteurs ne se comprenant pas eux-mêmes, des surhommes qui n’ont été que d’orgueilleux imbéciles, des goujats qui se sont pris pour des maîtres, des mystificateurs et des hurluberlus qui ont voulu élever
A l’aide des vautours ouvrir le sein des mers »
(A. CHÉNIER)
Sur ceux-là qui ne firent que moudre du vent et furent ces littérateurs qui n’étaient aux yeux de Malherbe « pas plus utile à l’Etat qu’un bon joueur de boules », nous disons :
« Paix à leurs cendres, et que leur règne finisse!... »
Nous passons sur la pré-Renaissance qui se manifesta à plusieurs reprises à l’occasion des premières rencontres de l’Occident et de l’Orient.
La Renaissance proprement dite naquit en Italie dès le milieu du XIVème siècle ; elle s’y développa durant le XVème pour se répandre à l’étranger au XVIème. Des hommes comme Pétrarque et Boccace avaient nourri leur esprit de l’antiquité mutilée ; ils commencèrent à la ressusciter en même temps que les philosophes et les artistes. L’épuration du latin employé par les savants provoqua celle des langues nationales. Les littératures particulières, mises en rapport direct avec la pensée antique par des études critiques de plus en plus dépouillées de scolastique médiévale, se replongèrent aux sources de la vraie beauté classique. Cette révolution « humaniste » aurait pu avoir les conséquences les plus humaines si elle n’avait pas été détournée de ses véritables voies par l’esprit individualiste et aristocratique d’une part, la Réforme religieuse d’autre part, pour l’empêcher de présider à un ordre nouveau favorable à tous les hommes. La Réforme fut la principale cause d’avortement. Au lieu de briser définitivement le vieux moule des règles religieuses qui craquait de toute part, elle établit, en prétendant s’appuyer sur le libre examen et la liberté de conscience, des disciplines nouvelles plus étroites et plus lourdes. Alors que la Renaissance « profondément humanitaire tendait à l’émancipation complète de l’esprit, à la destruction des sottes croyances du christianisme, à l’émancipation des masses populaires du joug nobiliaire et princier, le mouvement de la Réforme, fanatiquement religieux, théologique et, comme tel, plein de respect divin et de mépris humain, devait nécessairement devenir l’ennemi irréconciliable et de la liberté de l’esprit et de la liberté des peuples » (Bakounine). Après avoir entraîné les peuples, particulièrement les paysans, d’Allemagne qui s’étaient levés au cri de : « Guerre aux châteaux, paix aux chaumières ! », contre l’Eglise et les princes, la Réforme contribua à les soumettre à un joug plus écrasant lorsqu’elle se fut fait sa place parmi les puissances gouvernantes. Luther, « théologien plus soucieux de la gloire divine que de la dignité humaine » (Bakounine), trahit la révolution qu’il avait soulevée, et Munzer put lui dire avec raison : « Tu as fortifié le pouvoir des scélérats impies, sot moine, et tu as perdu le peuple ! » Entreprise pour ramener le christianisme à des mœurs plus pures, « la révolution protestante ne tint aucun compte de la personnalité humaine qui avait été le pivot même de la grande révolution chrétienne » (Delacour). Elle n’aboutit qu’à apporter des formes nouvelles à l’esclavage.
Si grand que fut le mouvement de pensée provoqué par la Renaissance, il n’eut donc pas toutes les conséquences qu’on en pouvait attendre. Dans le domaine littéraire, il engendra les premières grandes œuvres modernes ; elles sont demeurées parmi les plus belles de tous les temps.
En Italie, la grande époque littéraire a été le siècle du Trecento, le XIVème. Dante y acheva le moyen-âge en lui donnant son expression la plus magnifique. Pétrarque et Boccace y commencèrent la Renaissance qui devait rapidement se corrompre en « précipitant les mœurs italiennes de la barbarie dans la mollesse » (Ph. Chasles). Après un XVème siècle qui fut surtout d’érudition et dont la plus remarquable figure fut Savonarole, fanatique adversaire des mœurs nouvelles, l’Italie connut au XVIème tout l’épanouissement de la Renaissance européenne. Ce fut le siècle de l’Arioste, de Tasse, de l’Arétin et surtout de Machiavel.
En Espagne, les cantares de gesta et les cronicas avaient donné naissance au romancero qui prolongea dans ce pays, à partir du XVème siècle, la poésie populaire et constitua la véritable littérature espagnole. La Renaissance y fut d’inspiration profondément catholique dans la survivance du roman chevaleresque qui alla jusqu’à Cervantès, mais demeura arabe dans la poésie lyrique. Durant le moyen-âge, les Arabes avaient enseigné à l’Espagne leur art et leur littérature ; ils lui avaient communiqué la violence et la passion de leur poésie. La liste des poèmes arabes qui est conservée à l’Escurial ne comprend pas moins de vingt-quatre volumes. De Cervantès à Calderon, la Renaissance espagnole se manifesta surtout au théâtre. Elle donna aussi un grand développement à l’histoire et à la littérature mystique ; Calderon fut le plus grand poète catholique. La grandeur politique de l’Espagne alors maîtresse du monde et qui ne voyait pas le soleil se coucher sur son empire, favorisa cette brillante période littéraire. Dans le pays voisin, en Portugal, Camoëns écrivait les Lusiades, « la plus neuve et la plus grandiose des épopées modernes » (Ph. Chasles).
Jusqu’au XIVème siècle, l’Angleterre n’eut, d’une part que les ballades populaires qui manifestaient la résistance anglo-saxonne à la conquête normande, d’autre part les imitations de la poésie française que les trouvères avaient apportée avec les conquérants. La Renaissance coïncidant avec la fixation de la nouvelle nationalité anglaise aida à l’éclosion d’une littérature nationale qui fut particulièrement vivante et variée lorsque la langue, longtemps influencée par les éléments les plus disparates, eut ses formes définitives. Chaucer, au XIVème siècle, fut le premier grand poète anglais. Deux siècles après Spenser et nombre d’autres donnèrent à la poésie un vif éclat. Tout un mouvement dramatique se créa qui aboutit à Shakespeare. Le philosophe et historien François Bacon fut l’Aristote du XVIème siècle. Tous firent de la seconde partie du XVIème siècle appelé « siècle d’Elisabeth », la plus glorieuse époque de la littérature anglaise.
En Allemagne, le développement intellectuel avait été longtemps retardé par les luttes féodales. La formation de la langue fut longue. Perfectionnée par Luther qui traduisit la Bible, cette langue n’atteignit sa forme définitive qu’avec Gœthe. Le XIIIème siècle avait été, comme en France, une belle période littéraire avec les minnesingers, trouvères et troubadours allemands. Il sortit d’eux, au XIVème siècle, les associations bourgeoises de minnesingers (maîtres-chanteurs) qui s’organisèrent dans tout le pays. Leur art se prolongea en se momifiant de plus en plus jusqu’au commencement du XIXème siècle. Wagner, dans ses Maîtres-Chanteurs de Nuremberg, a fait un tableau saisissant, à la fois noble et satirique, du caractère de ces associations et de la vie populaire qu’elles entretenaient. Hans Sachs en fut, au XVIème siècle, le plus grand des animateurs ; il fit une œuvre considérable qui aida beaucoup au progrès de la Réforme. La Renaissance proprement dite eut ses penseurs et ses lutteurs avec Erasme, Reuchlin, Ulrich von Hutten, Ascolampade, Zwingli. Nulle part elle ne créa un mouvement social aussi profond, ne fut plus hardie de pensée et d’action, plus généreusement inspirée par l’esprit de liberté pour donner un caractère révolutionnaire au soulèvement des masses ; nulle part aussi elle ne vit se dresser contre elle une réaction plus féroce, celle de la Réforme triomphante qui accabla le peuple avec autant d’inhumanité que le faisait l’Eglise romaine.
En France, la Renaissance se manifesta surtout dans les arts et la littérature à la suite des expéditions guerrières qui permirent de découvrir la Renaissance italienne, bien qu’elles fussent faites dans des buts moins nobles. Les guerres religieuses que la Réforme provoqua ne furent que des luttes de partis ; il s’agissait de savoir seulement qui l’emporterait au gouvernement des Valois, des Guise ou des Bourbon. On faisait beaucoup de bruit et d’excentricité, on versait beaucoup de sang, répandait beaucoup d’encre et de furieuse éloquence, mais sans créer un mouvement profond. Le peuple, partisan malgré lui, demeurait sceptique sinon indifférent devant ces luttes dont il lui resterait à payer les frais. Sauf quelques exceptions farouches, comme celle d’Agrippa d’Aubigné, les chefs réformés pensaient comme Henri IV que « Paris valait bien une messe », et ils devinrent « bons catholiques » en même temps que lui. Le véritable esprit du temps était celui de Montaigne qui s’appuyait sur « le mol oreiller du doute », plus que celui des prédicateurs enflammés dont la virulence satirique excitait à l’assassinat. Cet esprit était aussi celui du libertaire intellectuel Rabelais qui, deux cent cinquante ans avant Beaumarchais, s’empressait de rire pour ne pas avoir à pleurer. Homme de science et de conscience, après avoir bouleversé les institutions et passé la sottise humaine au crible de la satire la plus savante et la plus véhémente, il se réfugiait dans son abbaye de Thélème et se retrouvait avec tous les « utopistes » que la République de Platon et les anticipations des arabes Avempace et Avicenne avaient plus ou moins inspirés. Contemporain de Thomas Morus, auteur d’Utopia, précurseur du Tasse de l’Amiata et du Campanella de la Cité du Soleil, il réveillait dans la forme littéraire de son temps le vieux rêve naturiste de l’humanité.
Plus que le roi François 1er, appelé par flatterie le « protecteur des arts » mais qui voulait supprimer l’imprimerie, sa sœur, Marguerite d’Angoulême, favorisa les débuts de la Renaissance littéraire en France. Celle-ci commença dans la poésie avec Clément Marot et se continua avec Ronsard et la Pléiade. Cette poésie fut par trop tributaire d’un esprit savant et d’exagérations qui la gâtèrent, même chez Ronsard dont le génie a produit une œuvre admirable ; mais, si elle a défiguré souvent la nature par parti-pris « savantissime », du moins elle ne l’a pas ignorée comme devait le faire le classicisme. La prose fut mieux servie par Rabelais, Calvin, Despériers, les d’Estienne, La Boétie, Amyot, Pasquier, l’Hôpital, Montluc, Montaigne et Charron. Ils remplirent le XVIème siècle, si fécond par la pensée et les progrès de la langue française, et occupèrent le commencement du XVIIème, avant que le classicisme coupât définitivement les ailes à l’esprit de la Renaissance et aussi à l’esprit de la vieille France qui allait être volontairement écarté, au mépris du vrai caractère national, pour en faire un autre qui serait tout de convention.
Ainsi, la Renaissance a produit de grandes œuvres, signées de grands noms, mais elle est arrivée à fermer pour le plus grand nombre des hommes le monde de l’art et de la pensée auquel ils avaient participé avant elle, et elle a ouvert la voie au classicisme.
Dans la période de transition qui s’écoula avant le classicisme, d’Aubigné, Mathurin Régnier, Théophile de Viaud défendirent le vieil esprit français en l’alliant à la Renaissance. Les philosophies de l’épicurien Gassendi, et de Descartes qui le combattit, furent les dernières manifestations, ou plutôt l’aboutissant, de l’humanisme. Le cartésianisme est la suprême expression de la Renaissance et ce qu’elle a produit de plus définitif. Il est le pont qui réunit cette période au XVIIIème siècle. Il fut suspect au classicisme avant qu’il l’adoptât pour en faire le rempart de la philosophie d’ordre conservateur lorsque le XVIIIème siècle commença à saper cet ordre. Jusqu’à la fin du XVIIème siècle, la Sorbonne lança ses décrets contre Descartes au nom de la vieille scolastique persistante.
Malherbe marque officiellement en France le moment où les « beaux esprits » entreprirent de « dégasconner », de « débarbariser » le pays et de réaliser le « grand monde purifié » de Chapelain. « Enfin, Malherbe vint... » devait dire Boileau. Il vint pour établir, non les règles de la langue dont faisaient usage tous les Français, mais celles du « bon usage » qu’en faisaient les « beaux esprits ». Ceux-ci commencèrent par oublier dédaigneusement la vieille littérature française, vouant au même sort le bon et le mauvais, la Chanson de Roland, le roman de Tristan, ceux de Renart et de la Rose, et la foule des pauvres imitations dont on avait été saturé. Rutebeuf, Villon, Charles d’Orléans, Ronsard, furent délaissés comme Chrétien Legouais, Martin Lefranc, Martial d’Auvergne et cent antres moins dignes de l’immortalité. Aujourd’hui encore, la plupart des anthologues ignorent un Coquillart dont l’œuvre, a dit d’Héricourt, est « le monument le plus important de l’histoire politique et littéraire de la fin du moyen-âge ». Les « beaux esprits » furent les « précieux » de l’Hôtel de Rambouillet, les « intellectuels » de la cour, les « mondains » de la ville, qui voulaient parler et écrire « noblement ». De ces cénacles sortit l’Académie Française dont ils firent partie pour la plupart. Précieux et académiciens « débarbarisèrent » si bien la langue qu’à la fin du XVIIème siècle ils en avaient fait ce que le P. Bouhours a appelé « le type accompli de la délicatesse intellectuelle et de l’inaptitude artistique de la société polie ». Cette langue où les termes de chasse, de blason et de guerre dominaient, mais où manquaient les mots techniques et ceux nécessaires à la vie pratique, était devenue « trop savante pour l’usage des honnêtes gens » qui parlaient et vivaient comme tout le monde. Elle n’était plus que le langage d’une aristocratie sans intelligence, sans imagination et sans entrailles. Cœurs secs et cervelles vides qui ne connaissaient plus, en fait de nature, que les décors d’opéras et de ballets et de règles de pensées que celles de la cour. Tous les jours, les quelques centaines de courtisans qui représentaient la France et en détenaient les destinées réglaient leur existence sur l’humeur du roi ; quand il avait daigné sourire, la France était heureuse. Pour faire croire qu’un tel monde avait une sensibilité, les littérateurs allèrent lui en chercher une chez les Grecs et les Romains. On fit rugir Oreste sous les canons de Mascarille et on mena Iphigénie au sacrifice sous les atours de Mme de Montespan. Cette littérature fut la majestueuse et froide parure de l’étiquette qu’Henri III avait introduite en France et qu’un duc de Richelieu s’obstinait à défendre à la veille de la Révolution. Le prodige est que la pensée ait résisté et que, dans une pareille société, un Racine et un Molière aient pu encore exprimer des sentiments humains.
L’indigence de pensée à laquelle le classicisme était réduit aurait vite arrêté sa carrière sans les influences étrangères qui créèrent des modes et lui donnèrent des aspects nouveaux qui le prolongèrent. Depuis la Renaissance, les littératures européennes ont tourné dans le cercle de leurs influences réciproques, résultat de relations plus faciles et plus fréquentes sinon plus amicales. Pendant que les princes se faisaient la guerre aux dépens des peuples, ils échangeaient entre eux ces politesses dont V. Hugo a parlé. Ces influences montraient plus de désordre que de renouvellement et de progrès dans une pensée qui demeurait conventionnelle et n’avait que de lointains échos dans l’âme populaire. Nous allons voir quelles ont été les principales, celles qui ont déterminé des courants littéraires.
Dès le moyen-âge, la France avait été une intermédiaire entre les littératures du Nord et du Midi. L’Italie, puis l’Espagne, exercèrent leur influence dans la formation de ce que M. Lanson a appelé « la première génération des grands classiques ». Les générations suivantes du classicisme devaient influencer à leur tour le Nord et le Midi.
On accueillit avec faveur, en France, les affectations précieuses du concetto italien, du gongorisme espagnol qui marquèrent la fin du roman chevaleresque épuisé. Elles fleurirent dans les productions des d’Urfé, Scudéry, Voiture. L’Espagne avait Don Quichotte, la France n’eut que l’Astrée et des imitations du roman picaresque dont les plus heureuses furent celles de Scarron, mais qui ne devaient trouver leur exemplaire français le mieux réussi qu’un siècle plus tard, dans le Gil Blas de Sentillane de Le Sage. Le génie espagnol ne passa pas les Pyrénées ; on n’en eut que la caricature hypocrite, car l’Espagne importa en France ce respect des grands et des prêtres que le moyen-âge et la Renaissance avaient ignoré. Tartufe, et cent ans plus tard Bazile, sont de ses produits. Elle garda les couleurs, la passion et la profonde humanité que recouvrait l’ironie d’un Cervantès pour n’exporter que la noirceur d’âme de ses moines et la crasse de sa noblesse cagote. C’est au théâtre que l’influence espagnole se fit le plus sentir (Voir Théâtre).
Celle du jansénisme vint des Pays-Bas. Elle fut un mélange épuré du catholicisme et du protestantisme opposé an jésuitisme dont la morale favorisait l’irréligion en accommodant la foi aux mœurs du siècle. Pascal et les maîtres de Port-Royal, véritables savants et écrivains supérieurs, furent les saints de cette nouvel1e église, à la fois orthodoxe et mondaine, qui avait sur l’autre cette supériorité de ne pas s’opposer au développement de la pensée et d’élever la controverse religieuse à la hauteur philosophique. Peut-être leur doit-on l’émulation qui anima alors les érudits bénédictins dans les recherches scientifiques et littéraires.
Le triomphe de la royauté absolue, marqué par l’avènement de Louis XIV en 1660, inaugura le règne du classicisme qui prétendit établir l’équilibre du fond et de la forme pour dire bien de bonnes choses. Le défaut du classicisme, comme de toutes les écoles, fut de s’attacher surtout aux règles qui caractérisent la forme et de leur sacrifier trop souvent le fond. Non seulement la forme brillante cacha un fond sec et aride mais elle favorisa les sophistiqueurs de la pensée dont Bossuet, panégyriste de l’esclavage, de l’intolérance et de la persécution, fut le plus partait modèle. Le classicisme ne fut grand que dans les œuvres où le fond ne le céda pas à la forme ; dans les autres, il ne fut qu’un somptueux décor. Il fut ainsi servi, à des degrés de valeur différents, par les La Rochefoucauld, Retz, Sévigné, Corneille, Boileau, Racine, Molière, La Fontaine, Bossuet, Bourdaloue et tous les écrivains ou orateurs qui ont appartenu à ce qu’on a appelé fort improprement « le siècle de Louis XIV » (Voir Plutarquisme). Ce qu’il y avait d’artificiel, de pompeusement vide, apparut dans le classicisme lorsque, ces grands écrivains étant disparus, il ne resta que des J.-B. Rousseau, des Campistron, des Lagrange-Chancel. La tragédie ne se releva pas de la mort de Racine, même avec Crébillon et Voltaire. La comédie fut plus heureuse, sans doute parce qu’elle était plus près de la vie ; elle eut Regnard, Dancourt, Le Sage, puis Marivaux.
Au XVIIIème siècle, le classicisme ne fut plus qu’une façade. L’armature craquait avec celle du pouvoir absolu et tous deux devaient succomber ensemble. La querelle des Anciens et des Modernes lui porta les premiers coups. Perrault et Fontenelle avaient pris la défense de la raison moderne contre l’imitation de l’antiquité. Ce qu’il y avait de meilleur chez les écrivains classiques était ce qu’ils avaient de moderne. Boileau, qui fut le plus brillant champion des Anciens, dut en convenir. La querelle eut pour résultat de faire revenir à une pensée et une forme que le classicisme avait écartées, d’ouvrir la voie au cartésianisme et de retrouver le rationalisme humaniste. L’humanité y gagnerait ce que l’esthétique y perdrait. Deux grands écrivains en offrirent la démonstration dès le début du XVIIIème siècle : La Bruyère et Fénelon. Ils mirent l’homme à sa place dans la littérature et dans la vie ; ce faisant, ils dénoncèrent les turpitudes de leur temps, la misère du pays tout entier sacrifié au luxe et aux plaisirs de Versailles. Seul, jusque-là, Vauban avait osé dépeindre au roi la ruine du pays et lui dire qu’il devait avoir de la considération pour ses sujets. La Bruyère et Fénelon sont des précurseurs des Encyclopédistes.
Comme toutes les époques, le XVIIIème siècle ne fut grand que dans la mesure où il se rapprocha de la nature et d’une humanité comprenant tous les hommes. Laborieusement, mais audacieusement, il apporta la vie et l’air dans la pensée. La Révolution n’aurait qu’à donner son coup d’épaule pour faire écrouler le classicisme avec les institutions qu’il soutenait.
Mais avant, le classicisme avait influencé l’Europe entière. Il s’était répandu, grâce à la réaction politique amenée par la Réforme dans les pays du Nord, grâce à une discipline plus sévère, du moins en apparence, adoptée par le catholicisme qui s’était vu en danger de mort dans ces pays et fortement ébranlé dans ceux où il était souverain. L’Angleterre, influencée par la France au XVIIème siècle, agit sur elle au XVIIIème. Après la brillante période du XVIème siècle, elle n’avait eu comme grand poète au cours du suivant que Milton, « le Dante de l’épopée protestante » (Ph. Chasles). Le même siècle vit Locke dont la philosophie sociale est encore à la base de toutes les constitutions républicaines. Le XVIIIème anglais fut plus éclatant dans tous les genres. La politique libérale anglaise exerça une action prépondérante dans la formation de la pensée encyclopédique française, celle de Montesquieu et de Voltaire en particulier. La mode tourna à l’anglomanie qui ne cessa pas depuis de se manifester et qui sévit aujourd’hui dans les formes les plus ridicules en dehors de la littérature. Le romantisme eut des prémices communes dans les deux pays. (Voir Romantisme). Du côté anglais se manifestèrent Addison, Pope, Richardson, sterne, Thomson, Young, Macpherson, Swift. On fit en France des traductions de Milton et on commença celles de Shakespeare.
En Allemagne, la Guerre de Trente Ans avait apporté de tels malheurs que jusqu’au milieu du XVIIIème siècle le pays n’eut plus de pensée propre et que sa littérature ne vécut, malgré des efforts isolés, que des influences étrangères : italienne, espagnole puis française. L’imitation italo-espagnole, marquée de concetti et de gongorisme, fit créer des académies de gens bien intentionnés mais trop souvent ridicules. Un Weckherlin, médiocre imitateur français, se vantait de n’écrire que pour les seigneurs et de parler comme eux « parce qu’ils sont les dieux de la terre et que la poésie doit parler le langage des dieux ». Après Madrid, Versailles devait donner le ton des « beaux esprits » aux Allemands. L’influence française s’accentua encore pour devenir plus sérieuse et ouvrir la voie à l’esprit encyclopédique, quand l’Allemagne accueillit les protestants chassés par la révocation de l’édit de Nantes. Opitz et quelques autres avaient tenté une certains résistance pour demeurer d’esprit allemand, mais ils s’étaient perdus dans les théories d’un pédantisme saugrenu. Le désordre où la langue était tombée depuis Lutter avait découragé les savants, tel Leibnitz, lui s’étaient remis à enseigner et à écrire en latin. Le classicisme, tel qu’il se manifesta en France au XVIIème siècle, n’inspira aucun grand écrivain en Allemagne. Gottsched fut un pâle copiste de tragédies antiques, mais de sa lutte pour le classicisme français contre l’anglomane Bodmer sortit le réveil de la pensée allemande qui devait trouver son expression chez Klopstock Lessing et Wieland d’abord, puis, de plus en plus dégagée du classicisme, pour faire refleurir le vieux lyrisme populaire dont la souche plongeait dans les Eddas scandinaves et arriver au romantisme en passant par Herder, Gœthe, Schiller et Jean-Paul Richter. Les Encyclopédistes influencèrent fortement cette Allemagne nouvelle, J.-J. Rousseau surtout, qui trouvait des échos nombreux dans sa sentimentalité. Ce fut Voltaire qui révéla Shakespeare à Lessing. Wieland était appelé le Voltaire allemand. On doit à Napoléon cette double calamité : d’abord, l’enchaînement de la Révolution en France et son avortement en Europe, ensuite la transformation du lyrisme allemand sentimental et idéaliste en volonté nationaliste et impérialiste. Beethoven devait déchirer sa dédicace de la Symphonie héroïque à Bonaparte, héros de la Révolution, quand il eut la douleur de constater que ce héros n’était qu’un homme moins encore : un empereur ! Alors que le républicain Schiller, ami de l’humanité, avait été proclamé « citoyen français » par la Convention, toute la jeunesse généreusement fraternelle qui avait recueilli son héritage intellectuel allait se dresser non seulement contre le nouveau César, mais aussi contre la France aux appels furieusement guerriers de Kœrner ! Il n’est pas, dans toute la littérature, d’exemple plus caractéristique du revirement de la pensée de tout un peuple passant de la spéculation idéologique à l’action pratique, de l’amitié à la haine, sous la malfaisante influence d’un tyran. Siegfried se remettait « en quête d’exploits nouveaux » pour finir cent ans plus tard dans Guillaume II ! C’est à Napoléon qu’on le doit avec toutes les turpitudes subséquentes.
En Italie, le classicisme lutta en vain contre les affectations précieuses pour réveiller une véritable poésie. L’œuvre littéraire la plus sérieuse des XVIIème et XVIIIème siècles italiens fut dans la critique. A la fin du XVIIIème, sous l’inspiration de Molière, Goldoni réforma la Commedia dell’arte. Molière eut une influence non moins heureuse sur Holberg, fondateur du théâtre danois.
En Espagne, toutes les formes littéraires étaient devenues afrancesados. Il n’y avait plus de littérature espagnole depuis Cervantès et Calderon.
L’Autriche, demeurée catholique à côté de l’Allemagne protestante, s’était dégagée de celle-ci dès le XVIème siècle au point de repousser la langue littéraire formée de la Bible de Luther et s’était tournée vers l’Italie, l’Espagne, puis la France. Elle ne retrouva une pensée commune avec l’Allemagne qu’au XVIIIème siècle dans l’acceptation de la culture et des mœurs françaises. De même qu’à Berlin, sous le règne de Frédéric II et à Saint-Pétersbourg sous celui de Catherine, on était plus français qu’en France à Vienne, à la cour de Joseph II et de Marie-Thérèse. Wieland, le premier écrivain allemand qui réconcilia la littérature de son pays avec l’Autriche, n’y fut accueilli qu’à la faveur de cet engouement. Malgré les aventures napoléoniennes et l’attitude du César à l’égard de l’Autriche, l’influence française y demeura très grande pendant tout le XIXème siècle. Depuis la Guerre de 1914, la France semble s’acharner à détruire la sympathie plusieurs fois séculaire de ce pays qui représente la culture scientifique et artistique la plus développée d’Europe.
Ce qui caractérisa les écrivains français du XVIIIème siècle, ce fut l’esprit encyclopédique qui étendait ses investigations non seulement à tous les genres littéraires, mais aussi à toutes les sciences. La littérature fut militante. Elle eut encore le souci des belles formes, mais elle eut surtout celui des idées. Les écrivains de ce siècle ne sont pas moins grands que ceux du XVIIème dans l’expression de leur pensée ; ils ont été souvent plus grands par leur pensée elle-même et l’universalité qu’elle a atteinte. Ils ne furent plus les chefs d’écoles littéraires, ils furent des philosophes et politiques passionnés de toutes les sciences de la vie et de toute la vie des hommes. Bayle, apôtre de la tolérance à une époque où il y en avait si peu, avait été leur précurseur avec son Dictionnaire historique et critique, à la fin du siècle précédent. Uniquement préoccupé de la vérité, il l’avait présentée, quelle qu’elle fût, avec une objectivité vigoureuse, dépouillée de tout préjugé.
La lutte des idées fut ardente avec Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, d’Alembert, Buffon, Vauvenargues, Condillac, Grimm, Helvétius, Mably, Condorcet, d’Holbach, Mirabeau, Turgot, Marivaux, Beaumarchais. Dans la philosophie morale et sociale, les sciences naturelles, la critique, le théâtre, tous ces écrivains apportèrent, avec des talents divers, la plus grande variété littéraire. Les lettres proprement dites furent moins heureuses, la poésie en particulier. Les règles artificielles du classicisme, de l’art pour l’art, de la poésie pure, s’accordaient de moins en moins avec le besoin d’action et de vérité qui se manifestait ; mais elles imposaient encore leurs conventions au sentimentalisme et au naturalisme de la plupart des productions. Manon Lescaut, de l’abbé Prévost, Paul et Virginie, de B. de Saint-Pierre, la Nouvelle Héloïse, de J.-J. Rousseau, parmi les plus célèbres, sont de médiocres romans que les Contes de Voltaire dépassent de beaucoup ; ils ont pourtant fait retrouver à la littérature l’éternité des sentiments humains. La poésie, qui demeurait pompeusement vide, n’ayant plus à chanter, avait perdu tout lyrisme et ignorait la vraie nature, les dieux d’un Olympe de carton et les nymphes des pièces d’eau de Versailles, elle avait à redécouvrir les bois et la campagne, la montagne et la mer, la vie et les hommes.
Le XVIIIème siècle prépara, en même temps que la Révolution politique de 1789, la révolution littéraire de 1830, appelée romantique. Durant la période de bouleversement et de rétablissement autocratique qui va de 1789 à 1815, le désarroi fut complet dans le domaine de la pensée. Le classicisme avait elle pour résultat de jeter un voile d’incompréhension aussi étendu sur la vie antique que sur la vie contemporaine. Le « retour à la nature » du XVIIIème siècle n’était pas moins ignorant de la vie naturelle. La « Raison universelle » ne savait si elle devait nier Dieu ou se rallier à un Etre Suprême. Les idées de liberté et de gouvernement se confondaient dans un mélange de communisme primitif célébré par Mably, de libéralisme anglais et de républicanisme américain. Il y avait dans l’air, comme au temps de la Renaissance, tous les éléments d’une révolution totale de la pensée humaine et, comme conséquence, des sociétés ; mais il y avait aussi une confusion, une indécision de cette pensée qui pouvaient faire craindre les pires turpitudes si des aventuriers s’imposaient à ces hésitations. C’est ce qui arriva.
Dès avant 1789, les recherches archéologiques avaient déterminé un engouement pour l’art gréco-latin. Il se manifesta par des résultats parfois heureux dans les arts, avec David dans la peinture, Soufflot dans l’architecture. En littérature, il produisit le Voyage du jeune Anacharsis, de Barthélémy, qui n’est plus guère lisible, et l’œuvre d’André Chénier qui servit mieux la poésie du XVIIIème siècle en la dégageant des fadeurs des J.-B. Rousseau, Lebrun, Dorat, Parny, Saint-Lambert, Roucher, Gilbert, Delille et Lefranc de Pompignan, mais ne réussit pas, malgré ce, à mettre des « pensers nouveaux » dans des « vers antiques ». Cet engouement créa chez les hommes de la Révolution une sorte de « plutarquisme » qui leur fit trop souvent perdre le sens des réalités en les faisant plus romains que n’avaient été les Romains eux-mêmes. De là, nombre d’erreurs, de fautes, aboutissant au point de vue constitutionnel et législatif au Code Napoléon, pilier de la réaction sociale encore régnante aujourd’hui. Dans le domaine littéraire ce « plutarquisme » suggéra une abondante production de médiocre valeur où seules méritent l’attention les formes militantes du journalisme et de l’éloquence politique complétées de Discours écrits, de Mémoires et de Correspondances.
Pendant la période révolutionnaire s’était préparé l’avènement du romantisme, un beau titre donné à un nouvel avortement. Ce romantisme fut l’expression artistique et littéraire du Tiers-Etat victorieux non seulement de l’ancien régime mais aussi de la Révolution. Il triompha avec ce Tiers-Etat sous la royauté de Louis-Philippe (Voir Romantisme). Ce qui demeura alors du classicisme ne fut plus que la manifestation de plus en plus sénile d’une noblesse qui ne subsistait encore qu’en se mésalliant, en attendant de participer aux coups d’Etat des renégats républicains et aux escroqueries financières. Mais ce classicisme allait passer au service de la bourgeoisie heureuse de se frotter à des ducs et de leur donner son argent avec ses filles. Il deviendrait la formule « juste milieu » — « ni réaction ni révolution », « modération réfléchie et réflexion modérée » — du nouvel ordre social que le romantisme inquiéterait parce qu’il se joindrait parfois au peuple pour faire des barricades. Bourgeoisie conservatrice et romantisme s’entendirent pourtant si bien que les révolutionnaires littéraires allèrent finir pour la plupart à l’Académie et au gouvernement, tel ce M. Thiers, prototype le plus complet du renégat révolutionnaire et du bourgeois florissant. Les gens de lettres qui se déshonorèrent en jetant l’injure aux héros vaincus de la Semaine Sanglante furent moins que romantiques, et ceux qui font aujourd’hui du classicisme dans les voies d’un néo-catholicisme engraissé des dépouilles de la guerre et des filouteries de l’après-guerre, le sont bien moins encore.
Des hommes généreux parmi lesquels on retient en littérature les noms de Michelet, Quinet, P.-L. Courier, Claude Tillier, Lamennais, Proudhon, voulurent réaliser un romantisme de fait qui eût été la conséquence logique de la Révolution, mais ils furent impuissants et ne purent qu’aider au développement des idées socialistes. Celles-ci donnèrent naissance au naturalisme (voir ce mot) qui fut, comme le romantisme, un avortement au point de vue social, malgré les audaces de pensée qu’il portait en lui ; V. Hugo, Balzac. G. Sand, Flaubert, Sainte-Beuve, Stendhal, Taine, Renan, furent les intermédiaires entre le romantisme et le naturalisme ; Baudelaire et Leconte de Lisle relièrent les romantiques aux parnassiens. Les poètes du Parnasse, par réaction contre le naturalisme, revinrent à l’art pour l’art. (Voir Poésie). Depuis, le symbolisme (voir ce mot) et les écoles décadentes n’ont fait que multiplier la confusion de la pensée individualiste et aristocratique ; une foule d’avatars futuristes, algébristes, larvaires, en démontrent la complète déliquescence. L’accord d’une pensée collective, populaire et humaine est devenu complètement impossible avec la mégalomanie furieuse ct criminelle des classes dirigeantes qui ne se maintiennent plus dans leur puissance que par les abus de la force.
Le XIXème siècle a été marqué par les efforts nationaux pour la constitution d’unités intellectuelles de même que politiques, mais ces efforts n’ont pu empêcher l’envahissement d’un cosmopolitisme douteux, dans les mœurs d’abord, dans la littérature ensuite, et qui n’a rien de commun avec une pensée universelle largement humaine. Il a aussi été marqué par une régression indiscutable de la liberté de la pensée, régression qui a été inversement parallèle à la montée sociale de la bourgeoisie triomphante. Cette bourgeoisie a commencé, dès l’époque napoléonienne, par interpréter faussement les idées du XVIIIème siècle pour ensuite les sous-estimer et les dénigrer. L’Académie et Loriquet s’entendirent sur le dos des Rousseau, Voltaire, Diderot, comme des Marat et Robespierre. On en fit des caricatures pour mieux les combattre au nom d’une prétendue critique indépendante, et en continue aujourd’hui avec un succès qui montre combien la pensée des philosophes encyclopédistes est toujours suspecte et subversive cent cinquante ans après la Révolution malgré ce dont on se réclame. En 1913, M. Barrès n’eut qu’à parler au nom du conservatisme réactionnaire devant le Parlement de la France appelée républicaine, pour qu’on décidât de ne pas fêter nationalement le deuxième centenaire de la naissance de Diderot.
Ce que le XIXème siècle a fait de plus remarquable dans l’ordre de la pensée, est dans ses travaux critiques. Grâce aux découvertes de la linguistique, grâce au nouvel esprit scientifique qui ne se contentait plus d’affirmations a priori mais recherchait des documents et des certitudes, on a battu en brèche et fortement ébranlé le règne despotique de la science livresque opposée à la science expérimentale. Il n’y avait plus qu’à descendre de leur piédestal tous les bonzes qui représentaient et défendaient encore cette science livresque pour en finir avec elle. Mais il eût fallu que la critique fût exercée par des gens indépendants, ne se tenant ni au-dessus ni au-dessous des œuvres qu’ils jugeaient selon que les auteurs étaient des hommes plus ou moins considérables. Il eût fallu que la critique fût dépouillée de ses préjugés de classe, de ses habitudes d’école, qu’on ne se considérât pas comme un des piliers d’un ordre social qu’il fallait respecter, qu’elle n’eût d’autre souci que de découvrir la vérité où qu’elle fût et de la dire, qu’elle ne fût plus l’apanage de « clercs qui trahissent » et qu’elle déclarât, comme un Romain Rolland de nos jours : « Ma tâche est de dire ce que je crois juste et humain. Que cela plaise ou que cela irrite, cela ne me regarde plus ». Ce sentiment du devoir intellectuc1 qui faisait dire à Renan : « Il n’est pas permis au savant de s’occuper des conséquences qui peuvent sortir de ses recherches », manque trop souvent à la critique. M. Brunetière disait de la critique qu’elle a « empêché le monde d’être dévoré par le charlatanisme ». Cela a été l’œuvre bienfaisante de l’esprit critique propre à l’humanité, l’œuvre à la fois de son instinct et de sa raison. Certains hommes qui ont fait profession de critique ont particulièrement exprimé cet esprit, mais le plus grand nombre a favorisé le charlatanisme plus qu’il ne l’a combattu. Ils lui ont donné les explications nouvelles par lesquelles il s’est maintenu et dit toujours aux hommes ; « Demain, on rasera gratis ! » Ils ont fait ainsi œuvre de sophistication plus que de vérité, et ce n’est pas la besogne si nettement rétrograde de la critique d’aujourd’hui, indifférente devant les pires atteintes à la pensée, qui démontrera le contraire.
Depuis le moyen-âge qui la vit se former, la science livresque n’a pas cessé de s’opposer au libre développement de la vie, à barrer la route aux esprits apportant des connaissances nouvelles, s’obstinant dans les mêmes erreurs, répétant inlassablement les mêmes sottises. Elle fut inventée par les gens d’église, par haine de la nature et du libre développement de la pensée. Dans de lourdes et ténébreuses compilations, la métaphysique aidant la théologie, ils tissèrent le réseau scolastique dans lequel notre temps étouffe encore. Leur méthode fut adoptée par l’académisme dont la sotte vanité prétendit donner à l’esprit humain des formules lapidaires intangibles en dehors desquelles tout ne serait que désordre. Si un Albert le Grand écrivait au XIIIème siècle que les mouches avaient huit pattes, les académiciens français ne savent pas encore aujourd’hui lequel du chameau ou du dromadaire a deux bosses. Au XIXème siècle, il y a eu encore des instituteurs enseignant que la terre était le centre du monde et que le soleil tournait autour d’elle ; il n’est pas certain qu’il n’y en ait plus. Chaque fois que l’Eglise a dû reconnaître une vérité, elle ne l’a fait qu’en la tripatouillant pour la mettre d’accord avec la foi. Chaque fois que les pontifes académiques sont dans l’obligation de s’incliner devant un fait indiscutable, ils ne l’admettent qu’en le faisant accorder avec les convenances sociales qui constituent le « mensonge immanent des sociétés ». La méthode livresque s’est traduite, particulièrement en littérature, en formules toutes faites qui imposent les traditions, les opinions dogmatiques des « gens qualifiés » et dont ne savent que rarement se dégager même ceux qui se donnent la peine ou le plaisir d’aller aux sources pour se faire une idée personnelle. Or, l’histoire et la critique littéraire ne remplacent pas la littérature, la pensée originale. Elles peuvent aider à sa connaissance, elles ne peuvent dispenser de son contact direct. On s’imagine trop qu’on connaît la littérature parce qu’on a lu une anthologie plus ou moins copieuse et les commentaires qui l’accompagnent.
« La littérature n’est pas objet de savoir : elle est exercice, goût, plaisir. On ne la sait pas, on ne l’apprend pas ; on la pratique, on la cultive, on l’aime. » (Lanson)
Ce n’est que par la lecture directe des œuvres littéraires qu’on peut trouver toutes ces satisfactions. Combien d’hommes les ignorent encore ! Combien, même parmi les plus savants, dédaignent toujours, par exemple, sur la foi du sot arrêt de Boileau, la magnifique littérature du moyen-âge si savoureuse, si pleine de sève et qui semble avoir gardé le secret du véritable lyrisme de la poésie française depuis qu’elle ne vibre plus dans l’âme populaire. Combien de pontifes disent encore que le Roman de la Rose entre autres, qu’ils n’ont pas pris la peine de lire, est une œuvre ennuyeuse.
La littérature a tout dit depuis qu’elle a produit ses premiers balbutiements. Il lui reste à retrouver le cœur des hommes pour redevenir l’expression de la pensée de tous. Ses destins ont toujours été liés étroitement au fait social. L’homme, qui ne vit pas que de pain, vit encore moins du seul esprit. De tout temps la pensée, qui va plus vite et plus loin que l’action, a été arrêtée et détournée de ses voies par le fait social. Le naturisme a été éliminé par l’anthropomorphisme qui détruisit l’égalité primitive et favorisa l’exploitation de l’homme par l’homme que le monothéisme a aggravée pour atteindre les formes actuelles. Les grands courants de révolte et de liberté qui amenèrent le christianisme furent endigués par ce christianisme même qui les souilla d’imposture et les noya dans le sang. La Renaissance avorta dans la Réforme qui opposa au large esprit de l’humanisme des sujétions nouvelles et plus étroites à l’autorité. La Révolution qu’avait préparée le XVIIIème siècle fut captée, monopolisée par la bourgeoisie triomphante et défigurée pour servir ses intérêts, avec autant d’astuce et de mauvaise foi qu’en avait employées l’Eglise pour dominer le monde au moyen-âge. Aujourd’hui, la pensée subit le sort du « matériel humain ». Elle est « rationalisée », mobilisée, passée à tabac, envoyée à la guerre, déchirée et pillée au nom de patries soumises à des syndicats de mercantis spéculateurs et de financiers banqueroutiers. Elle est tenue dans la servitude par le capitalisme et le militarisme, livrée à la prostitution pour le plaisir d’aventuriers qui pèsent, achètent, vendent un livre ou une œuvre d’art comme un chargement de guano ou un lot de femmes destinées à des maisons publiques, de noirs on de jaunes recrutés pour des concessions coloniales. Elle est enfin toujours l’objet des sophistications religieuses renouvelées des artifices médiévaux. Les dieux n’ont pas encore cessé de ronger le cœur ardent de Prométhée.
Que peut être et que peut devenir la pensée humaine dans un tel monde et sous les formes de la littérature ? Que peuvent y trouver les hommes qui recherchent une véritable activité intellectuelle, de véritables joies morales et rêvent toujours d’un perfectionnement social ? Quel levier peut-elle fournir à la masse humaine sacrifiée pour soulever le poids de son esclavage ? On a envisagé souvent de former à côté de l’art et de la littérature « bourgeois » un « art du peuple », une « littérature prolétarienne ». Les nombreuses tentatives de ce genre n’ont abouti qu’à de lamentables échecs. Car elles sont inopérantes, sinon funestes, à l’art et au peuple, à la littérature et au prolétariat. Quels sont ceux qui entreprendront de faire de l’art populaire, une littérature prolétarienne ? Le peuple ne peut avoir d’art et de littérature que ceux qu’il produit lui-même, dans une harmonie heureuse de sa pensée et de son activité sociale. II y a alors un peuple qui est l’ensemble de tous les hommes et il n’y a plus de prolétaires. Lorsque le peuple ne produit rien, c’est qu’il est dans la situation calamiteuse du servage social et d’étouffement de la pensée qui fait le prolétariat. Soumis à des conditions de vie anormales, il lui manque les rapports nécessaires avec la nature et les autres hommes pour exalter son âme, il est privé de la joie et de la liberté indispensables pour produire l’art. Le prolétariat n’est pas une condition normale des hommes ; il est un état monstrueux dont ils doivent vouloir la disparition dès que possible. Il ne peut donc être question de donner une pensée à cette monstruosité, encore moins de lui trouver une expression qui la rendrait supportable, sinon aimable, à ceux qui la subissent. Il ne peut y avoir de littérature prolétarienne ; il ne pout y avoir qu’une littérature pour la suppression du prolétariat.
Cette littérature, elle existe. Les hommes l’ont faite comme ils ont fait dans le domaine de la pensée tout ce qu’elle pouvait produire de viable. Elle est celle de la révolte. Son œuvre est innombrable, depuis les imprécations des prophètes se terminant par le rêve édénique d’un temps où le fer des lances sera fondu en socs de charrues, jusqu’à la justicière Internationale qui conduira aux Heureux Temps. Tout ce que le prolétariat peut vouloir réaliser comme action sociale lui a été dit dans ces vers lapidaires :
Prends la terre, paysan.
Tout ce qu’il peut rêver dans l’espoir lumineux d’une fraternité qui ne peut être qu’universelle lui a été chanté par Beethoven dans son Hymne à la Liberté. Il ne s’agit pas d’opposer une « littérature prolétarienne » à la « littérature bourgeoise », une classe à une autre classe, une haine à une autre haine. Il s’agit de supprimer toutes les classes et toutes les haines. Les hommes ont plus de littérature qu’il ne leur en faut pour se décider à passer à l’action. Il est inutile d’augmenter le nombre des sophistes. Non seulement ils sont déjà assez nombreux pour « affaiblir la société », mais ils sont trop qui contrarient et paralysent la volonté d’action prolétarienne par leurs sophismes malfaisants. Lorsque les hommes auront su établir une harmonie sociale en supprimant toutes les classes, le besoin naîtra tout naturellement en eux et chez tous d’une littérature nouvelle qui dira leur joie du bien-être et de la liberté conquis. Jusque là, il sera plus noble et plus utile aux hommes d’agir que d’ajouter aux millions de volumes dans lesquels ils ont répandu de tout temps leurs rêves impuissants.
Lorsqu’on ajoute au mot « littérature » un qualificatif et qu’on parle de littérature philosophique, religieuse, bourgeoise ou prolétarienne, on ne fait qu’en indiquer l’esprit, la tendance, on ne peut dire qu’elle est à l’usage des philosophes, des religieux, des bourgeois ou des prolétaires. La littérature, quelle qu’elle soit, est pour tous les hommes ; c’est à eux à lui faire un sort. Une littérature est toujours le reflet de son temps. A toutes les époques, « la marque infaillible de la civilisation a été dans le degré de loisir qu’a eu un peuple pour se créer une littérature » (Larousse). L’esclavage, la misère, la souffrance, n’élèvent pas les sentiments humains et n’excitent pas le travail de l’esprit. Sauf de rares exceptions, se rencontrant de moins en moins dans la vie moderne qui tue plus rapidement que jamais l’individu désarmé, la dépendance, la privation, la douleur annihilent les facultés humaines. L’homme absorbé par la nécessité du pain quotidien n’a pas le temps de s’instruire. L’organisation sociale est faite de telle sorte qu’elle l’empêche de penser, même quand il s’amuse. Aussi, ne peut-il y avoir une littérature prolétarienne faite par des prolétaires.
Il y a une littérature aristocratique et bourgeoise, parce que l’homme riche a le temps de cultiver son esprit, de réfléchir et d’exprimer sa pensée dans des directions qu’il a la liberté de choisir. Cette littérature intéresse généralement tous les privilégiés ; ils y trouvent l’expression de leurs sentiments et s’y voient vivre agréablement. Elle est la manifestation de la béatitude de leur égoïsme, mais aussi de leur inquiétude devant l’incertitude d’un bonheur illégitimement fondé sur le malheur d’autrui. De là, cette tendance chez elle vers cette hyper-analyse qui est, a dit Barbusse, « un des signes de la décadence artistique actuelle ». Mais il n’y a pas de littérature prolétarienne parce que rien dans la vie du prolétaire n’exalte ses sentiments et qu’il n’aime pas se voir vivre. Il a besoin, il a hâte d’échapper, au moins par l’imagination, à sa misère, au travail sale, laid, meurtrier, auquel il est condamné et qu’il fait sans goût, au foyer sans confort où son repos est sans joie. Cela explique les échecs répétés de toutes les tentatives littéraires qui ont prétendu lui faire aimer sa condition. Cela explique aussi la facilité avec laquelle il s’abandonne à l’usage des poisons que ses maîtres ont inventés pour lui procurer un peu de rêve qui l’anesthésiera davantage et dont les formes « littéraires » sont la chanson de café-concert, le roman-feuilleton, le cinéma. En dix ans, le cinéma a plus fait pour l’abrutissement du prolétariat que cent ans de littérature religieuse, patriotique et politicienne.
Est-il rien de plus triste que les roulades d’un oiseau en cage, la mélopée d’un esclave tournant la meule, le chant d’un prisonnier ? Seuls, des esthètes malades, à qui il faut de la souffrance, surtout celle des autres, pour faire de la beauté, peuvent aimer ces appels du désespoir adressés à la vie et à la liberté. Quand les hommes auront l’énergie de faire leur vie libre et belle, la pensée refleurira sur leurs lèvres pour des poèmes et des chants immortels, et la littérature ne sera plus le produit morbide de leurs turpitudes.
— Edouard ROTHEN
LIVRE
Ce mot vient du latin liber, du nom de l’enveloppe membraneuse de certain roseau sur laquelle on écrivait et qui était le papyrus. Bien avant d’employer le papyrus, on avait écrit sur la pierre, la brique, l’ivoire, le plomb, le bois, particulièrement celui de cèdre que l’amertume de sa substance préserve de la destruction des vers ; ensuite, sur des peaux préparées dont on était arrivé à faire le parchemin, et sur des toiles de lin. Le livre proprement dit a été le recueil des papyrus ou des parchemins qu’on enroulait sur eux-mêmes et qu’on appelait volumes (de valvere, enrouler), puis des feuillets carrés réunis ensemble dans un morceau d’étoffe ou un étui en bois.
Le premier livre de l’homme a été la pierre, avant même qu’il la couvrit d’inscriptions. V. Hugo a écrit :
« Depuis l’origine des choses jusqu’au XVème siècle inclusivement, l’architecture est le grand livre de l’humanité, l’expression principale de l’homme à ses divers états de développement, soit comme force, soit comme intelligence. »
L’architecture commença cette expression par l’utilisation de la pierre, dont elle fit le premier alphabet, en lui donnant différentes positions, en la groupant de diverses manières.
« On retrouve la pierre levée des Celtes dans la Sibérie d’Asie, dans les pampas d’Amérique. »
Le menhir, le dolmen, le cromlech, le tumulus, le galgal, sont des mots et des phrases. Les pierres de Karnac sont tout un livre sinon une bibliothèque. Les cathédrales furent la suprême expression de l’écriture architecturale. Celle-ci fut tuée par l’imprimerie au XVème siècle.
« Ceci tuera cela. » (V. Hugo : Notre Dame de Paris)
Les pierres écrites les plus anciennes qu’on a retrouvées étaient en Iranie. La stèle de Hourin-CheihkKhan, près de Kalman, avait été déjà restaurée il y a 56 siècles. On voit au musée du Louvre l’obélisque du roi Manichtuou sur lequel est gravé un titre de propriété datant de 57 siècles. Sur une autre pierre, le code des lois du roi Hammurabi est vieux de 40 siècles. Les négriers qui exploitent « l’empire colonial » de « l’Europe civilisée » pourraient y apprendre à traiter humainement les esclaves, et les féministes y trouveraient des arguments pour leur propagande. Les stèles quadrilingues de Bisutun, en écriture cunéiforme, qui disent la gloire de Darius, le « roi des rois », ne remontent qu’à 500 ans avant J.-C. et paraissent modernes à côté des milliers de tablettes écrites que les savants ont retrouvées dans les décombres des monuments écroulés et sur lesquelles ils cherchent à démêler les origines de la civilisation des régions du Tigre et de l’Euphrate. On a découvert parmi ces ruines, dans les fouilles de Ninive, une partie de la bibliothèque qu’Assurbanipal constitua sept siècles avant J.-C. d’après les textes akkadiens réunis il y a sept mille ans à la bibliothèque de Nippur.
Les pierres écrites d’Egypte ne sont pas moins nombreuses et importantes pour l’histoire de l’humanité. Tous les monuments, temples et tombeaux, de ce pays constituaient, par leurs inscriptions et leurs peintures, de véritables bibliothèques qui ont été stupidement détruites.
Les manuels scolaires chinois disent que dans la haute antiquité, on écrivait en nouant des cordes. L’écriture idéographique chinoise se modifia avec les matériaux employés et fut plutôt de la peinture sur des fragments de bambou, sur des écorces et des pellicules, sur le papier. Les Chinois employèrent l’imprimerie et le papier bien avant que les Européens les découvrissent. Ils abandonnèrent les caractères mobiles trop peu pratiques au moment où l’Europe les adopta. Depuis le XIIIème siècle, ils usent de la reproduction xylographique. Le résultat en est qu’il n’est pas de pays où il paraisse autant de livres, sur de si bon papier et à meilleur marché qu’en Chine. (A. Ular, Revue Blanche, 1er septembre 1899).
Les runes des peuples nordiques étaient gravées sur la pierre ou le bois, et leurs signes paraissent dérivés d’un ancien alphabet dont on retrouve les traces apportées par les Scandinaves jusqu’en Asie Orientale. Les anciens Mexicains peignaient leurs hiéroglyphes sur les feuilles des « arbres à papier », le maguey ou autres, et les gravaient sur le bois ou la pierre.
La Grèce reçut l’écriture alphabétique des Crétois et des Cadméens. Les Crétois gravaient leurs lois sur des tables de bronze. Les lois romaines des Douze Tables furent écrites sur l’airain. Grecs et Romains écrivirent sur des tablettes de bois, enduites de cire, avec un stylet, puis sur le papyrus au moyen de l’encre. Ils délaissèrent le papyrus pour le parchemin. Les deux prévalurent pour la commodité qu’ils présentaient d’être enroulés en volumes qui tenaient moins de place que les tablettes de métal ou de bois. Les rayons d’une bibliothèque de volumes enroulés présentaient l’aspect de ceux d’une boutique de papiers peints ; une inscription sur la tranche, ou front, indiquait le titre du livre. Déjà, en ce temps-là, les Chinois fabriquaient du papier avec de la soie. Les Arabes en firent avec du coton ; ils en apportèrent la fabrication et l’usage en Espagne, au XIème siècle. Mais l’emploi du papier pour le livre ne fut réellement adopté qu’avec l’imprimerie. (Voir ce mot et aussi Ph. Chasles : Le Moyen Age, l’atelier de Gutenberg).
Le véritable art du livre s’est formé et développé avec l’usage du manuscrit sur papyrus et sur parchemin. Pour les livres sur parchemin, à peu près les seuls qui soient parvenus jusqu’ à nous, cet art consistait d’abord dans la préparation des peaux d’animaux. Le mot parchemin vient du nom de Pergame, ville d’Asie Mineure où cette préparation atteignit sa plus glande perfection. Les parchemins étaient de trois couleurs : blancs, jaunes ou pourprés. Leur fabrication ne fut pas toujours assurée selon les besoins qui devinrent considérables en Europe lorsque l’Egypte ne lui fournit plus de papyrus, à partir du VIIème siècle. Le résultat fut désastreux pour les lettres antiques, car on se mit à gratter les anciens manuscrits pour y transcrire les textes nouveaux. Cela explique la rareté des manuscrits antérieurs au VIIème siècle qui subsistent encore. Les manuscrits grattés furent appelés palimpsestes par les Grecs qui, les premiers, se livrèrent à cette détestable besogne. (Voir Vandalisme). Les manuscrits palimpsestes sont reconnaissables à ce qu’ils portent des traces de la première écriture.
L’industrie et la vente du parchemin prirent une très grande extension. Jusqu’au moment où l’imprimerie adopta le papier, la fabrication du parchemin n’arriva pas à satisfaire les besoins. Aussi, était-il cher. L’Université surveillait le commerce de la corporation des parcheminiers qui ne devinrent indépendants qu’en 1545, lorsque le papier commença à concurrencer leur marchandise.
On ne peut préciser l’époque des premiers manuscrits. Il en a été écrit un nombre incalculable pendant des siècles ; il n’en est resté qu’un nombre infime. Le peu de soins qu’on en a encore aujourd’hui, malgré la vénération dont on les entoure, fait qu’ils disparaissent peu à peu, surtout dans des incendies. Il n’y a que quelques mois, le 23 avril 1929, le feu a détruit à la bibliothèque de Dunkerque un manuscrit du Trésor de Brunetto Latini du XIVème siècle, ainsi que plusieurs autres des XVIème et XVIIème siècles. Les odieuses reliques de la guerre et de la puissance criminelle des despotes sont mieux gardées et préservées dans les musées que les trésors de l’art et de la pensée humains. Les vieux manuscrits, qui sont parfois uniques, ne pourraient-ils pas être conservés à l’abri du feu, dans des coffres, comme les titres de propriété du premier « bourgeois » venu?...
Les plus anciens manuscrits encore existants sont des papyrus égyptiens qui ont plus de trois mille ans. Il en reste bien peu de l’antiquité. Leur disparition a eu des causes diverses, mais la guerre a toujours été la principale, guidée par la haine sauvage des sectaires religieux plus acharnés contre la pensée que contre les hommes eux-mêmes. On a conservé de plus nombreux manuscrits du moyen-âge, mais leur nombre est loin de compenser la qualité de pensée des livres anciens à jamais détruits. Ce sont presque tous des ouvrages religieux, des copies des lourds produits de la métaphysique scolastique que les moines répandaient avec autant de zèle qu’ils en avaient mis à détruire la pensée profane. Le travail des manuscrits se fit uniquement dans les couvents jusqu’au jour où des corporations laïques de maîtres-écrivains se formèrent pour les besoins de la nouvelle littérature.
La besogne des copistes des manuscrits se complétait de celle des enlumineurs. Lorsqu’elle était bien exercée, elle faisait des manuscrits, non de simples reproductions de textes, mais des œuvres d’art précieuses. Les enlumineurs décoraient les manuscrits d’ornements colorés, entre autres de miniatures qui ont été la première forme de la peinture moderne, celle-ci ayant été pratiquée par les primitifs selon les procédés des miniaturistes. Les Grecs se livraient déjà à l’ornementation des livres et semblent l’avoir apprise des Egyptiens. A Rome, l’art des enlumineurs atteignit une véritable magnificence pour décliner pendant la décadence. Il retrouva un grand éclat dans l’empire byzantin et se développa ensuite en Europe selon le goût propre à chaque peuple. L’amour des beaux livres qui se manifestait à la fin du moyen-âge fut certainement dû à leur ornementation. La plus belle époque des enlumineurs fut le XVème siècle. Leur art déclina peu à peu devant le développement de l’imprimerie pour disparaître ensuite. Il a été remplacé par la gravure et les autres procédés de ce qu’on appelle aujourd’hui l’illustration du livre.
La production du papier fit naître une industrie encore plus importante que celle du parchemin, Les usages de plus en plus nombreux qu’on en fit dépassèrent de beaucoup l’art du livre, et l’avilissement où sa qualité tomba arriva à faire employer pour le livre un papier dont un épicier n’aurait pas voulu pour envelopper ses cornichons. Le papier de coton et de chiffons de lin ou de chanvre a été de plus en plus remplacé par celui de bois qui tombe en poussière au bout d’un certain temps (Voir plus loin). Mais tout se tient. Les facilités de l’imprimerie firent produire le livre bon marché. Celui-ci fut assez bien présenté tant que la composition fut moins chère que le papier ; on se rattrapa sur celui-ci quand la composition se fit plus chère, sans être pour cela mieux faite, au contraire.
Après la reproduction manuscrite ou imprimée, l’art du livre comporte le brochage et la reliure. Le brochage par lequel on réunit ensemble les différentes feuilles d’un livre, est un procédé tout mécanique qui ne nécessite aucune recherche d’art. Par contre, la reliure est un art véritable dans lequel se sont distingués de remarquables artistes, comme dans l’enluminure. Les premiers brocheurs ou relieurs, qui collaient ensemble les feuilles de papyrus ou de parchemin étaient appelés dans l’antiquité glutinatores. Les feuilles étaient ensuite roulées en volumes. Le véritable métier du relieur commença avec les livres carrés. Dès le IVème siècle, on relia des livres avec un grand luxe, en revêtant leurs couvertures d’ornements et de pierres précieuses. Les couvertures étaient de bois, pour les ouvrages d’un usage fréquent, puis de plus en plus d’étoffe et de cuir. Presque tous les livres étaient reliés pour mieux les conserver en raison de leur valeur. Un inventaire de la bibliothèque du Louvre, fait par Gilles Malet au XIVème siècle, donne des renseignements très intéressants sur ce qu’était la reliure à cette époque. Elle fut de plus en plus variée et riche d’ornements et de matières précieuses, mais elle n’a guère été modifiée depuis par les inventions de la main-d’œuvre.
Le travail et le commerce du livre se font par l’intermédiaire des éditeurs et des libraires. Avant l’imprimerie on ne faisait pas d’éditions, c’est-à-dire de tirages d’un nombre plus ou moins grand d’exemplaires d’un ouvrage. Editeurs et libraires étaient, dans l’antiquité, les écrivains et transcripteurs des livres qui les lisaient aux amateurs et les leur vendaient. On les appelait amanuenses à Rome. Les libraires furent exclusivement des marchands quand le livre se multiplia pour les besoins des études. Rome et Alexandrie eurent leurs quartiers des libraires qui exercèrent leur profession dans des conditions à peu près les mêmes que celles d’aujourd’hui. Au moyen-âge, cette profession n’exista pas tant que l’art du livre fut renfermé dans les couvents. La littérature laïque la fit renaitre. Dès le XIIIème siècle, les écrivains de manuscrits sortirent des couvents et fournirent leurs ouvrages aux libraires. Le commerce de la librairie fut organisé en 1275 sous le règne de Philippe le Hardi. La corporation des gens du livre se composait, en 1292, de 24 copistes, 17 relieurs et 8 libraires. Ceux-ci ne mettaient les livres en vente qu’après les avoir soumis au contrôle de l’Université qui fixait même les prix de vente et de location. L’Eglise et le Parlement exerçaient aussi leur censure. Au XIVème siècle, rien qu’à Paris, plus de six mille personnes vivaient de la librairie. Elle prit une importance de plus en plus considérable avec l’invention de l’imprimerie. Dès la fin du XVIème siècle, on avait imprimé plus de 13.000 ouvrages qui représentaient environ quatre millions de volumes. L’imprimerie, d’abord favorisée par Louis XII, parut si menaçante au pouvoir royal que François 1er ordonna la fermeture de toutes les librairies, sous peine de mort. C’est à cette époque qu’Etienne Dolet fut brûlé vif pour avoir imprimé deux Dialogues de Platon. Henri II renchérit encore sur les ordonnances de François 1er : il obligea Robert Estienne à briser ses presses et à s’exiler pour éviter le bûcher. Les librairies ne furent autorisées de nouveau qu’à la condition de ne mettre en circulation que des ouvrages dont les idées seraient agréables au pouvoir. L’Eglise était là pour exciter le zèle royal contre les livres, au cas où il se serait refroidi. On comprend quelle ennemie l’imprimerie trouva dans l’Inquisition qui avait été établie pour faire la guerre à toute pensée s’écartant de l’orthodoxie. L’imprimerie était d’autant plus dangereuse qu’elle pouvait répandre cette pensée à l’infini. Aussi, l’Eglise établit-elle, en 1565, la congrégation de l’Index chargée de tenir la liste des livres jugés préjudiciables à la Foi et, jusqu’à la Révolution, cette congrégation put faire brûler les livres qu’elle condamnait quand elle ne brûlait pas les auteurs eux-mêmes. En Espagne, après que les Arabes eurent été chassés, à la fin du XVème siècle, l’Inquisition fit détruire les collections de manuscrits. L’inquisiteur Ximenès procéda et Grenade à un autodafé de 8.000 de ces écrits. En 1611, à Toulouse, l’inquisiteur Pierre Girardet ordonnait, au nom du Saint-Siège et du roi, à tous les libraires de lui soumettre tous les livres qu’ils avaient en leur puissance, sans en excepter aucun, sous peine d’excommunication majeure outre la confiscation des biens, des livres et les amendes ordinaires. Ce n’est qu’à partir de 1826 que l’Index autorisa la publication de livres disant que la Terre tourne autour du Soleil. Depuis la Révolution, si l’Eglise n’eut plus les mêmes pouvoirs, elle inspira encore trop les décisions de la censure officielle, tant les intérêts ecclésiastiques et dirigeants demeurèrent communs, même en régime républicain et laïque, contre la libre expression de la pensée. Napoléon 1er inaugura le système hypocrite qui consiste à empêcher les publications désagréables au pouvoir pour n’avoir pas à les pour suivre et pour se vanter ensuite de ne faire jamais de procès de presse. Tous les gouvernements suivants ont plus ou moins usé de ce système, et il est regrettable de voir que la IIIème République l’emploie de plus en plus par la saisie préventive des publications. (Voir Liberté et Presse). L’Index existe toujours, en marge de la censure républicaine, pour condamner les livres non orthodoxes.
Au XVIIème siècle, sans remonter plus haut, Gui Patin accusait déjà les libraires d’être des « fripons, coupeurs de bourse, sots, menteurs, ignorants », et Boileau se plaignait que les mauvais livres trouvassent toujours : « Un marchant pour les vendre et des sots pour les lire ». Les choses n’ont guère changé. La pornographie, les romans sans littérature et les bas feuilletons trouvent toujours des éditeurs pour les imprimer et des libraires pour les vendre, alors que les ouvrages sérieux par leur caractère scientifique et littéraire ne se publient et ne se répandent qu’avec peine. Par exemple, les écrits de Max Nettlau, qui ont une importance capitale pour l’histoire de la philosophie et du mouvement anarchiste, attendent toujours un éditeur qui en publiera une édition française. On trouve difficilement des éditions complètes et à la portée des petites bourses des plus grands écrivains de tous les genres, depuis Ronsard jusqu’à Proudhon.
Pendant longtemps, les éditeurs furent des lettrés. Cette qualité donnait à leurs éditions des garanties d’exactitude de textes et de soins dans la présentation qui manquent trop chez les marchands de papier imprimé lorsque l’auteur n’est plus là pour surveiller ce qui s’imprime sous son nom. Les Alde, Estienne, Elzevir, Didot el d’autres furent de véritables savants soucieux d’une présentation scrupuleuse et artistique des œuvres qu’ils éditaient et dont ils faisaient un choix sévère. Mais le nombre des éditeurs incapables de choisir des ouvrages dignes de la presse et ne recherchant que le succès s’est multiplié. Certains sont même complètement illettrés. Le mal qu’ils font est considérable en répandant des mauvais livres « qu’on ne lit pas impunément », disait V. Hugo, et des traductions d’œuvres étrangères absolument dénaturées dans leur texte et leur esprit par des traducteurs ignorants et sans scrupules. La chronique du livre est pleine des falsifications de tous genres commises par des éditeurs. Le XVIIIème siècle en particulier vit leur effronterie. Des éditions falsifiées de Voltaire, Rousseau, Diderot et tous les philosophes furent publiées à la faveur de l’interdit qui obligeait ces auteurs à se faire imprimer à l’étranger et souvent sous l’anonymat. Schiller disait, à propos de Kant et de ses éditeurs :
« Voyez combien un seul riche nourrit de mendiants. Quand les rois bâtissent, les charretiers ont de la besogne. »
Les éditeurs-charretiers ne distinguent pas, le plus souvent, entre les rois et la valetaille. Ne les voit-on pas aujourd’hui découvrir tous les matins un nouveau génie parmi des gens chez qui un insolent puffisme tient lieu de talent, et à qui ils s’associent pour la plus odieuse exploitation mercantile, celle de la pensée ?
En marge de la librairie sont les bouquinistes. Ils ne sont pas les moins intéressants parmi ceux qui vivent du livre. On se donne l’air, assez souvent, de les dédaigner sinon de les mépriser, surtout lorsque leur boutique est un capharnaüm noir et malodorant qui sent la friperie, ou plus simplement un étalage dans la rue ou une boîte sur les quais. L’un d’eux, Antoine Laporte, répliqua assez vertement à un homme de lettres qui les avait malmenés. Dans une brochure intitulée : Les bouquinistes et les quais de Paris tels qu’ils sont (Paris, 1893). On considère davantage celui enrichi dont la boutique s’intitule : « Librairie ancienne et moderne ».
Les bouquinistes font le commerce des bouquins, c’est-à-dire des vieux livres regardés, comme sans valeur mais qui en ont parfois beaucoup au contraire, ce que nous verrons au sujet de la bibliographie. Ils sont plus souvent des savants que les éditeurs et ils ont besoin de connaissances bibliographiques autrement étendues que celles des libraires s’ils veulent prospérer dans leur profession : Le plus célèbre fut le flamand Verbeyst, dans la première moitié du XIXème siècle. Sa « boutique » était une maison de plusieurs étages où il possédait près de 300.000 volumes tous anciens, tous rares, dont il renouvelait incessamment le fond par ses achats de bibliothèques particulières.
La science du livre est la bibliographie. L’amour du livre est la bibliophilie. D’autres termes qui ont plus ou moins de rapports avec ces deux mots se rattachent à eux par leur origine commune qui est dans le grec biblion, venu de biblos dont le sens est exactement celui de liber dont on a fait livre. Biblion a produit les différents mots qui désignent les sciences et les usages du livre. La Bible est « le livre par excellence ». On a fait de ce mot le titre de nombreux livres religieux, celui des Hébreux entre autres, et de divers ouvrages. Michelet a dit dans sa Bible de l’humanité :
« L’humanité dépose incessamment son âme en une Bible commune. Chaque grand peuple y écrit son verset... »
La bibliographie est la science des livres dans les formes matérielles de leurs diverses éditions, et surtout la connaissance de tous les ouvrages parus sur des sujets déterminés. C’est la science de tous les livres, c’est-à-dire de toutes les connaissances humaines écrites. Ceux qui s’en occupent ne peuvent évidemment que se cantonner dans certaines branches de ces connaissances. Une Bibliographie Universelle, qui serait établie avec le concours de bibliographes de tous les pays, formerait un précieux catalogue de ces connaissances en ce qu’il en empêcherait la dispersion et l’oubli et permettrait de voir tout ce qui a été écrit sur un sujet quel qu’il soit. On a fait de nombreux travaux dans cette voie en composant des bibliographies particulières, nationales ou spéciales, relatives aux différentes branches des sciences.
Le métier de l’éditeur a su varier la présentation du livre pour le rendre plus agréable et surtout pour augmenter sa valeur marchande. Il a ainsi développé, sinon créé, à côté de la bibliographie la bibliomanie. « De tout temps les bibliophiles ont recherché les anciennes et belles éditions, mais les bibliomanes apprécient surtout les éditions rares, et surtout l’édition où il y a la faute », a dit Du Rozoir. Pons de Verdun faisait dire à un bibliomane :
Car voilà, pages quinze et seize,
Les deux fautes d’impression
Qui ne sont pas dans la mauvaise.
La « bonne édition », pour le bibliomane, n’est pas celle du beau livre sans fautes, c’est celle du livre qui a des verrues. Pour le bibliophile le livre le plus précieux sera d’une édition à la fois la plus ancienne et la plus soignée d’un chef-d’œuvre de grand écrivain, Pour le bibliomane ce sera un Pastissier François du XVIIème siècle parce qu’il sera le plus rare des livres.
Les éditions les plus recherchées sont les incunables publiées dans les premiers temps de l’imprimerie et les princeps, premières éditions imprimées d’un auteur ancien. Beaucoup d’incunables sont des princeps. La valeur des éditions anciennes varie beaucoup suivant leur époque, leur éditeur et les caractéristiques bonnes ou mauvaises de chacune d’elles. Les prix subissent es mêmes fluctuations que ceux des œuvres d’art ; ils sont soumis aux mêmes caprices de la mode. Depuis la Grande Guerre, le snobisme est au livre cher ; il fait la fortune des libraires et des bouquinistes. Des ouvrages se paient des centaines de mille francs. Un manuscrit de La Nouvelle Héloïse, entièrement écrit, a-t-on dit, de la main de J.-J. Rousseau, a été vendu il y a quelque temps 273.000 francs. Infortuné Rousseau qui enrichit les « charretiers » alors qu’il bâtissait dans la misère ! Combien d’autres ont connu son sort!... Les catalogues abondent en ouvrages qui se vendent couramment 10.000 francs. Des éditions du XVIème siècle du Roman de la Rose, d’Alain Chartier, de Jean Bouchet, de Clément Marot, des poètes de la Pléiade, se débitent comme des petits pains entre 15.000 et 30.000 francs. C’est à croire qu’on en fabrique encore et que c’est une industrie comme celle des faux Rembrandt. On fait un grand commerce des éditions appelées originales, qui sont le premier tirage de tout ce qui s’imprime particulièrement des romans à la mode. Certains éditeurs réservent ces éditions pour des « abonnés » tout ce qu’ils font paraître.
La bibliophilie est le goût, l’amour du livre pour lui-même, pour la pensée qu’il renferme comme pour sa présentation. Le bibliophile est heureux de posséder et de lire une belle œuvre dans un beau livre dont la présentation est digne de la pensée qu’il contient. Il s’attache toutefois plus à la substance ou livre qu’à son aspect extérieur. C’est pourquoi il y a tant de sympathie entre le bibliophile et le bouquiniste qui lui procure le bouquin introuvable en librairie, dont la vieillesse, l’usure, parfois la crasse ne le rebutent pas. Il découvre dans l’antre poudreux livré aux microbes et aux vers, l’ouvrage ancien qui ne fut plus réédité, celui qui est oublié au point que sa réapparition sera une nouveauté ; et ce sont pour lui des joies toujours nouvelles, inconnues des philistins.
Le véritable ami du livre dit avec affection : « mes bouquins » ; il ne dit pas avec une vanité ridicule : « mes livres... ma bibliothèque », à la façon des gens « comme il faut » pour qui une bibliothèque n’est qu’un meuble, comme la baignoire dont ils ne se servent pas et le piano dont ils ne jouent pas. Il préfère à tous les livres neufs, trop neufs parce que personne ne les ouvre, le vieux livre de travail fatigué par l’usage, avec lequel il a passé des heures. Il a pour lui les tendresses de Bérenger pour le vieil habit qu’il brossait depuis dix ans. Il sait qu’il ne peut avoir de compagnons plus agréables, d’amis plus fidèles que ses bouquins, et il ne s’en « débarrasse » pas en les vendant ou en les reléguant dans un grenier pour faire place au luxe conjugal de la chambre Louis XV et de la salle à manger hollandaise, le jour où il se met en ménage.
Tous les lettrés sont des bibliophiles. Ils aiment les livres qui ont été pour eux « le sel de la terre », qui les ont nourris spirituellement. Le roi d’Egypte Osymandias, qui forma 2.000 ans avant J.-C. une des premières bibliothèques, avait fait écrire à l’entrée ces mots : « Trésor des remèdes de l’âme ». Bien antérieurement, le respect de la pensée du livre avait été manifesté dans les récits chaldéens du déluge (Voir Littérature). Cléopâtre est citée parmi les bibliophiles célèbres pour l’intérêt qu’elle porta à la Bibliothèque d’Alexandrie.
On lit dans le Roman de Renart ces deux vers :
Qui n’aime livre ne croit.
(Celui-là meurt à bon droit déshonoré qui n’aime pas les livres et ne croit pas en eux.)
C’est grâce aux bibliophiles que les livres condamnés ont pu être sauvés tant dans l’antiquité que dans les temps modernes. Jamais le livre n’eut tant d’ennemis que dans les premiers siècles du christianisme ; jamais il n’eut de plus ardents défenseurs. Les derniers philosophes grecs le transportèrent en Asie lorsque la persécution chrétienne s’acharna contre lui. C’est là que les Arabes retrouvèrent la pensée antique mutilée et qu’avant les humanistes de la Renaissance ils la recueillirent pour la rapporter en Europe. Les bibliophiles n’ont pas seulement sauvé le livre, ils ont rendu aussi le service immense de former des bibliothèques et de réunir des collections complètes et raisonnées des différentes époques et des divers genres.
Il ne faut pas confondre les bibliophiles avec les bibliomanes, maniaques qui aiment le livre uniquement pour le posséder et en tirer vanité. On a raillé, non sans raison, le bibliomane qui thésaurise le livre comme l’avare entasse de l’argent ; le plus souvent, il ne le lit pas et il en prive ceux à qui il serait utile car, bien entendu, il le prête encore moins qu’il ne le lit. Lucien envoyait un de ses opuscules : « À un ignorant qui formait une bibliothèque ». Dans la Nef des fous, Sébastien Brandt a fait figurer les fous bibliomanes. La Bruyère les a raillés dans son chapitre de « La Mode », des Caractères. Voltaire disait des beaux livres collectionnés par des ignorants de son temps :
Saint-Simon a parlé d’un comte d’Estrées qui ne lisait jamais et possédait 52.000 volumes réunis en ballots ! Il y a, parmi les bibliomanes, de nombreuses variétés de maniaques, ceux qui volent les livres, ceux qui les mutilent ou qui corrigent l’auteur en écrivant leurs réflexions dans les marges. Une espèce abondante est celle des obscénophiles qui recherchent l’obscénité dans les livres. La librairie fait un commerce important et particulièrement lucratif des spécialités réclamées par ces malades.
C’est l’exploitation de la bibliomanie qui fait le livre cher et le met hors de la portée des travailleurs. La bibliomanie est, par ses conséquences, un des abus les plus odieux de la société capitaliste en ce qu’elle prive des bienfaits de la pensée contenue dans les livres ceux qui ne peuvent les acheter. Pendant que les bibliomanes accumulent chez eux des livres qui ne servent à personne, des hommes d’étude en sont dépourvus et ne peuvent travailler. Dans un ordre d’idée semblable, Wagner a raconté qu’étant à Paris, pendant de nombreux mois il n’avait pu disposer d’un piano, les dix francs nécessaires à la location mensuelle de cet instrument lui ayant fait défaut. Mais des milliers de pianos restaient sans usage, quand ils n’étaient pas employés à faire de la musique « le plus odieux de tous les bruits » chez le propriétaire ou chez la concierge de Wagner!... Les bibliomanes répondront que les travailleurs ont à leur disposition les bibliothèques publiques. Sans compter qu’il n’est pas facile de travailler dans une de ces bibliothèques, on n’y trouve pas toujours, surtout en province, tous les livres dont on a besoin et que pour quelques francs, sinon pour quelques sous, on devrait pouvoir se procurer. Dans les premiers temps de l’imprimerie, alors qu’elle était loin d’avoir atteint les perfectionnements pratiques d’aujourd’hui, le livre se vendait à un bon marché tel qu’il était à la portée des plus pauvres. Un inventaire fait en 1523 indique qu’on pouvait avoir les livres classiques pour quelques sols. Ajoutons qu’ils étaient imprimés sur du papier solide. Aujourd’hui, le livre dit « à bon marché » ne coûte pas moins de dix à vingt francs. Il est de plus imprimé sur du papier d’aspect misérable, sans consistance, vite jauni et qui tombera en poussière avant vingt ans. La pensée humaine est ainsi plus menacée par des éditeurs avides de s’enrichir qu’elle ne le fut par les gratteurs de manuscrits de l’antiquité et du moyen-âge.
Du grec biblion sont encore sortis nombre de mots le plus souvent inusités. La bibliognosie est la connaissance des livres au point de vue de leur valeur marchande. La bibliologie traite des règles et des termes de la bibliographie. La bibliatrique ou médecine du livre, est l’art de le restaurer. La bibliopégie est le travail du relieur. La bibliolâtrie est l’attachement excessif à un texte en même temps que l’amour exagéré des livres. Le bibliotacte est celui qui les range, les classe et le bibliopole est celui qui les vend. Enfin, le bibliotaphe est celui qui enterre les livres en ce sens qu’il ne les prête à personne. Il n’est pas toujours ridicule et son attitude est fort souvent justifiée par l’inconscience ou le défaut de scrupules des gens qui rendent les livres mutilés, souillés de traces de doigts sales ou qui même ne les rendent pas. C’était une question très grave, avant l’imprimerie, que de prêter des livres, alors qu’ils étaient chers et surtout rares au point que des exemplaires étaient uniques. On ne les prêtait qu’avec les plus grandes précautions, et encore n’était-on pas toujours à l’abri des voleurs et des destructeurs. Isidore de Péluse se plaignait au Vème siècle et comparaît aux accapareurs de blé, les possesseurs de livres qui ne les prêtaient pas ; mais n’avait-on pas trop souvent affaire à des dissipateurs lorsqu’on les prêtait ? Eustache Deschamps, au XIVème siècle, a exprimé amèrement, dans une balade, sa rancœur contre ceux à qui il avait trop facilement prêté les siens et racontait comment il était arrivé à taire ce serment :
En 1471, la Faculté de Médecine de Paris exigeait un gage de 12 marcs d’argent et 20 sterlings pour prêter au roi Louis XI un manuscrit de Rasés, médecin arabe du Xème siècle. Les bibliothèques publiques ont toujours été particulièrement éprouvées, tant par les vols commis par des gens « distingués » à qui elles ont prêté leurs livres en faisant confiance à leur réputation, que par les actes de vandalisme, commis dans leurs salles mêmes, par de véritables malfaiteurs qui arrachent des pages des livres ou les souillent d’encre et d’expectorations.
Il nous reste à parler des bibliothèques. L’homme qui avait eu le souci de fixer la pensée par l’écriture, devait avoir aussi celui de conserver les monuments et objets sur lesquels il avait écrit. Aussi, constitua-t-il des bibliothèques bien avant qu’il eût composé des livres proprement dits. Les légendes babyloniennes de la création du monde disent qu’à Eridu les observatoires furent établis et les tablettes furent recueillies avant que « la graine d’humanité ne fut semée » (Elisée Reclus). Il y eut des bibliothèques dans plusieurs villes de la Chaldée il y a six ou sept mille ans. Celle de Nippur fournit à celle qu’Assurbanipal fit constituer à Ninive la matière de plus de 500 volumes de 500 pages dans le format in-quarto moderne (E. Reclus) Les temples égyptiens étaient des bibliothèques par leurs inscriptions murales. Leurs « pierres éternelles » parlaient pour les temps à venir. On s’en rend compte par un bas relief du grand temple de Medinat Habu que les vandales ont épargné et dont les inscriptions constituent une véritable encyclopédie des connaissances de l’ancienne Egypte.
La première bibliothèque qui réunit des manuscrits aurait été celle d’Osymandias, en Egypte. Elles furent nombreuses dans cette contrée où l’on eut un culte si grand de la pensée et de l’étude. La plus importante et la plus célèbre fut celle que fonda Ptolémée et qui devint la Bibliothèque d’Alexandrie. Elle compta jusqu’à 700.000 volumes répartis en deux monuments, le Bruchion, le plus ancien, et le Sérapéion. Le Bruchion fut détruit avec ses 400.000 volumes quand César conquit Alexandrie. Le Sérapéion, qui s’était augmenté de la bibliothèque de Pergame donnée par Antoine à Cléopâtre, fut saccagé avec ses livres en 390 par les chrétiens que l’évêque Théophile excitait. Une légende tenace, répandue entre-autres par Mennechet dans son Cours de littérature grecque, a attribué aux Arabes la destruction de la Bibliothèque d’Alexandrie en 641. La vérité est que le fanatique Amrou, dont l’esprit concordait si peu avec celui de sa race, ne détruisit que les restes de la bibliothèque du Sérapéion. Il y a des témoignages indiscutables de la destruction accomplie par les chrétiens, celui entre-autres du prêtre Orose, ami de saint Augustin, qui a vu à la fin du IVème siècle les ruines du Sérapéion et a déploré dans son Histoire Universelle la dévastation de la bibliothèque.
Pendant le moyen-âge barbare, acharné à détruire les bibliothèques grecques et romaines, ce furent les Arabes qui s’employèrent à sauver les documents de la pensée humaine et à les reconstituer. Ils fondèrent des bibliothèques dans tout l’empire musulman. Celle de Fez, au Maroc, réunissait 100.000 volumes. Celle de Cordoue en possédait 600.000 richement reliés. L’Espagne comptait 70 bibliothèques publiques et de nombreuses collections privées. Au Xème siècle, à la bibliothèque des Fatamites, au Caire, il y avait deux millions et demi de volumes, avant que la ville fût pillée par les Turcs.
Les bibliothèques publiques et privées se sont multipliées depuis l’invention de l’imprimerie ; jusque-là elles furent rares hors des couvents. La première que l’on vit en France fut celle de Charles V réunie au Louvre et qui était à la disposition des savants. Elle comptait environ 900 volumes dont Gilles Malet dressa l’inventaire. Dispersée ensuite, la bibliothèque royale fut rétablie par Louis XI et considérablement augmentée par Charles VIII. Après diverses aventures, la bibliothèque du roi fut définitivement constituée sous Louis XIV. Au commencement du XVIIIème siècle, elle possédait 70.000 volumes. Un arrêt du 31 mai 1689 obligea les imprimeurs à lui fournir deux exemplaires de tout ce qu’ils imprimaient. Cette bibliothèque s’enrichit ainsi de tout ce qui parut et aussi de l’apport de nombreuses et précieuses collections particulières. La Révolution de 1789 lui apporta les trésors d’un grand nombre de bibliothèques des couvents et des émigrés. Demeurée bibliothèque royale et privée jusque-là, elle devint la Bibliothèque Nationale publique. Cette bibliothèque est la plus importante de France et peut-être du monde. A côté d’elle d’autres spéciales sont rattachées aux différents ministères et corps savants. En province, il est peu de villes qui n’aient leurs bibliothèques publiques où sont parfois des ouvrages anciens de la plus grande valeur.
La première grande bibliothèque publique fut en France celle de Mazarin, appelée aujourd’hui la Mazarine. Il l’ouvrit au public en 1643. Elle fut la quatrième en Europe qui n’était pas fermée, après celles de Milan, d’Oxford et de Rome.
Les plus célèbres bibliothèques d’Europe sont, avec celles de Paris, où la Bibliothèque Sainte-Geneviève tient la seconde place, celle du Vatican, la plus ancienne, avec ses archives de la papauté, celle de Munich qui possède 12.000 incunables, celle du British Muséum à Londres, celle de l’Escurial à Madrid, fondée par Charles Quint, celles de Milan, de Vienne, de SaintPétersbourg. La bibliothèque des Birmans, aux Indes, est la plus ancienne de celles existant actuellement. Elle renfermait déjà 370.000 volumes en 502. Leur nombre doit être aujourd’hui prodigieux.
Toutes les bibliothèques sont ou devraient être accessibles aux travailleurs soucieux de s’instruire ou seulement de se distraire intelligemment. Malheureusement, trop souvent l’incurie administrative les ferme à ces travailleurs. Les bibliothèques ne sont ouvertes parfois qu’à des heures où ils ne peuvent y aller. Certaines sont fermées le soir pour manque de personnel ou même d’éclairage ! Ajoutons toutefois que les procédés routiniers de l’administration ne sont que la conséquence de l’indifférence du public. Si les travailleurs voulant fréquenter les bibliothèques étaient plus nombreux, il leur serait facile, par quelques protestations, de faire modifier des règlements désuets. Une longue expérience nous a montré que, sauf certains rond-de-cuir abrutis et hargneux qu’il ne serait pas impossible de ramener dans les voies de la civilité, le personnel des bibliothèques ne demande qu’à faciliter le public. Les bibliothécaires, gardiens des bibliothèques publiques, sont généralement des bibliographes et des bibliophiles sinon toujours savants, du moins amis des livres et accueillants à ceux qui les aiment. Suivant que les bibliothécaires sont plus ou moins instruits, intelligents et actifs, les bibliothèques sont des centres intellectuels clairs et vivants mis à la portée de tous les travailleurs, ou des capharnaüms poussiéreux, abandonnés aux rats et aux filous qui découragent toute volonté de travail.
Il y a aussi des bibliothèques populaires. A Paris, un ouvrier lithographe, Girard, en eut la première idée et s’occupa de la première réalisation. Elles se formèrent et se développèrent dans tous les arrondissements parisiens et elles sont nombreuses en province. Elles ont pour les travailleurs l’avantage du prêt du livre. Ils peuvent l’emporter chez eux et l’ont ainsi à leur portée aux moments de loisir. Actuellement, Paris compte 83 bibliothèques populaires municipales. Elles ont prêté en 1927 un million et demi de livres. Ce chiffre, qui paraît considérable, est ridicule comparé à celui de la population ouvrière ; il ne représente pas un volume par personne et par an. Si cette « consommation » du livre est mise en regard de celle de l’alcool qui est, annuellement, de vingt litres par tête de Français, on est plutôt porté à faire de tristes réflexions.
On discute souvent de la production du livre et du goût public à son égard. Y a-t-il ou non « crise du livre »?... Lit-on plus ou moins que jadis?... demande-t-on dans les journaux. Il est certain qu’on lit plus dans les époques où l’on est plus instruit ou plus avide de s’instruire et qu’on en a plus le loisir. « Les illettrés ne lisent pas », dirait La Palisse. On devrait plutôt demander : Que lit-on ?... Car la qualité des lectures d’un peuple fait juger de sa civilisation plus que leur quantité. Or, on lit surtout des journaux ; les neuf dixièmes des gens n’ont pas d’autre pâture intellectuelle. Si on regarde ce que lit presque tout l’autre dixième, les livres qui se vendent par centaines de mille et atteignent parfois le million d’exemplaires, on a une idée plutôt lamentable du niveau intellectuel et moral des uns et des autres, lecteurs de journaux et lecteurs de livres. Nourris de pareilles lectures, on comprend qu’ils sont incapables de former autre chose que cette « majorité compacte » sur laquelle les gouvernants s appuient en toute sécurité pour commettre leurs méfaits.
-Edouard ROTHEN
LOGEMENT
n. m.
La pièce, le gite qu’une personne ou une famille habitent prend le nom de logement. Ce mot, quoique ayant pour valeur appartement, sert à désigner, dans une maison, la partie la plus modeste. Alors que les appartements se composent de plusieurs pièces et sont situés dans des immeubles plus ou moins modernes et confortables, les logements (qui, dans les villes, se situent dans les mansardes ou les maisons de rapport de second et de troisième ordre et, dans les campagnes dépendent des chaumières et des bâtisses médiocres et usagées) servent de gîte aux classes laborieuses toujours déshéritées.
Ainsi, dans la pratique, et quoique le mot logement ait une valeur analogue — en théorie — à celle d’appartement, la différence s’établit par le genre d’occupants et l’aspect des lieux.
Aussi, même le langage courant désignera sous le vocable logement des pièces soit restreintes, soit peu en harmonie avec les règles d’une hygiène modeste, tandis que par appartement le même langage s’appliquera à des locaux mieux aménagés pour l’habitation et qui donnent à ceux qui les occupent des commodités et des satisfactions qu’un simple logement ne comporte pas.
Selon que l’homme habite une chaumière ou une mansarde, ou qu’il loge dans des appartements réduits ou vastes, aérés et aménagés pour la commodité de l’existence, cet homme éprouve de la joie ou de la tristesse parce qu’il se sent tributaire de son logement dans les questions de maladie et de santé. La question du logement, de l’habitation, se pose à la société comme une question d’hygiène et de moralité.
Beaucoup de logements, en France, remontent encore à des époques reculées. Autrefois les constructions qui servaient d’abri à la plèbe, aux serfs et aux travailleurs en général se faisaient au petit bonheur et la prévoyance des besoins était bien faible pour ne pas dire nulle. Les classes privilégiées ne témoignaient pas, non plus, d’une grande connaissance de l’hygiène ; mais les moyens dont elles disposaient suppléaient aux aptitudes des propriétaires de l’époque. Ce n’est guère que depuis le milieu du siècle écoulé que les constructions d’immeubles se sont effectuées dans des conditions meilleures que par le passé et en harmonie avec la science.
Dans certains départements montagneux et de faibles ressources, les constructions rurales surtout, remontent à des époques relativement lointaines, ce qui implique des habitations malsaines et dangereuses. Il est encore des hameaux, des villages où la famille cohabite avec le bétail qu’elle élève. Les « chambres de veillées », en Beauce, qui ne sont qu’une portion de l’étable, et où les animaux font profiter les gens de la chaleur dégagée... et du reste, demeurent, à ce point de vue, caractéristiques. Aujourd’hui encore, le couchage des ouvriers de ferme s’inspire toujours de la même économie et bénéficie des mêmes émanations ; la tuberculose en profite pour ses rafles sournoises...
Le gouvernement démocrate (que secondent, pour le profit, d’habiles sociétés privées) après avoir constaté et déploré l’exode des paysans vers les grandes villes, a pensé que la question méritait plus que des jérémiades sur le dépeuplement des campagnes. Il vient d’inscrire à son budget — accaparé sans vergogne par les œuvres de mort — quelques préoccupations touchant la vie. Il a décidé de consacrer quelques centaines de millions pour édifier, aux champs comme à la ville, un réseau de maisons, dites... à bon marché, afin de pallier, dans une certaine mesure, à l’insuffisance générale des logements. Précautions excellentes en principe, mais lamentablement impuissantes en face d’un mal profond, étendu et poignant... Les travailleurs aisés, dont les salaires se prêteront à la saignée, continueront d’engloutir dans les « maisons ouvrières » leurs économies et à hypothéquer un avenir d’efforts et de privations. Leurs groupes s’étageront vers cette bourgeoisie conservatrice à laquelle ils auront l’illusion de s’incorporer et ils mettront l’amour du gîte au service des institutions rétrogrades. Quant aux masses miséreuses elles attendront que le Pactole qui coule vers l’armée s’avise de rénover les lépreuses maisons où le travail enterre ses détresses, ses amours et ses tares...
« Notre » gouvernement républicain (d’autres gouvernements démocrates et ploutocrates ont, depuis la guerre, entrepris l’amélioration de l’habitation pour les masses laborieuses), se doit en effet de suivre l’exemple donné par les institutions conservatrices d’autres pays où les gildes ont contribué avec succès aux entreprises. Il s’occupera des logements ouvriers (il feindra surtout de s’en occuper) par intérêt, par démagogie et parce que l’attention qu’il semblera prendre par là aux maux du peuple sera un excellent tremplin politique. Il ne peut éviter d’ailleurs d’apporter au moins des projets et d’amorcer quelques réalisations. L’existence des taudis, dans les grandes villes, est d’autant plus dangereuse et, par suite, révoltante, que la misère confine aux splendeurs de l’opulence. Le contraste est trop frappant et la société bourgeoise cherche à en atténuer l’effet.
En résumé, la question du logement tient à la santé générale, à la probité et aux mœurs de la Société. Elle mérite, de tous ceux qui comprennent la question du logement, comme une question de justice pour tous, la plus grande attention, car il ne faut pas oublier que sous la domination du capital, la Société ne se résout à réaliser quelque amélioration que quand elle ne peut plus en différer l’exécution.
— Elie SOUBEYRAN
LOGEMENT
Depuis son apparition sur la planète l’abri, le logement ont tenu une place considérable dans les préoccupations de l’homme. L’existence leur a été maintes fois subordonnée et, quand il n’a pas joué un rôle capital et exigeant, le logement est cependant resté étroitement lié aux influences de site, de climat, ainsi qu’aux mœurs, au genre de vie de ceux qui l’ont rencontré ou conçu. Il a accompagné l’évolution des races et des grandes branches humaines, fixé souvent leurs traits persistants et leurs conquêtes incertaines.
Leur capacité d’initiative, leur discernement, leur esprit inventif, la gamme de leurs découvertes ont marqué le caractère et l’étendue de ses réalisations, servi ses audaces, permis ses progrès... Le sujet n’ayant été qu’effleuré au mot habitation (voir ce mot, voir aussi architecture, ville, etc.) nous donnerons ici, en bref, un historique du logement dont les stades, parfois dépouillés d’art, portent à travers les époques, et chez les peuplades de civilisation rudimentaire, l’empreinte d’une enfance simpliste et obstinée, millénaire souvent et parfois contemporaine de nos savants édifices...
« L’excès en froid ou en chaud de la température, la présence de fauves dangereux ont conduit les hommes à chercher un refuge dans les grottes et les cavernes. Ce furent les habitations des hommes quaternaires. Les Lapons, Samoyèdes, Ostiaks et autres habitants de régions sibériennes bâtissent des huttes, le plus souvent coniques, avec des perches assemblées par le sommet et couvertes d’écorce d’arbre et de mottes de gazon. Quand elle n’est pas formée de blocs de glace et de neige tassée, chez les Kamchadals, les Esquimaux et autres peuplades boréales, la hutte d’hiver est creusée en terre et couverte d’un tumulus de terre gazonnée. Mentionnons les cités lacustres ou villages bâtis sur pilotis, dans les eaux tranquilles d’un lac ou d’une rivière, et les habitations construites sur les grands arbres de l’Afrique centrale.
Avant la conquête romaine, les peuples de la Gaule habitaient ordinairement des huttes cylindriques ou rectangulaires dont les parois étaient constituées par un clayonnage revêtu d’argile ou par des pierres brutes jointoyées avec du mortier de terre et couvertes en chaume. La case cylindrique et en forme de ruche est aujourd’hui la caractéristique des villages nègres de toute l’Afrique et d’une partie de l’Océanie et de la Nouvelle Calédonie. Une partie de la population du nord de l’Afrique et de l’Asie était nomade et avait besoin d’abris facilement transportables ; elle en a trouvé dans la tente en écorce, en peau, en feutre ou en étoffe. Certaines peuplades, de nos jours encore, n’ont aucun abri permanent...
Avec la civilisation apparaît la véritable habitation, construite avec des matériaux plus durables : la pierre et la brique. En Orient, aussi bien dans l’antiquité qu’aujourd’hui, les relations sociales, à cause de la polygamie surtout, étaient restreintes dans d’étroites limites. La vie intérieure s’y dérobait et s’y dérobe encore au public. D’où les dispositions intérieures de ses maisons antiques et modernes. Une seule porte d’entrée ouvre sur l’extérieur, de rares ouvertures aux divers étages, soigneusement grillagées. A l’intérieur, une cour sur laquelle prennent le jour et l’air toutes les pièces de l’habitation. Celles-ci sont nettement divisées en deux parties : l’une, proche de la porte d’entrée, la plus publique, est destinée aux hommes ; l’autre est réservée aux femmes, qui occupent souvent les étages supérieurs, couverts par une terrasse, où, loin des regards, elles jouissent de quelque liberté. Cette disposition était celle des maisons de la Chaldée, de la Perse, de l’Egypte ancienne, Elles apparaissent jusqu’à certain point dans la Grèce antique, où les femmes, sans être clôturées, se mêlaient peu à la vie publique. Dès la fin de la république et le commencement de l’empire, les Romains adoptèrent les arts, l’architecture et les mœurs des Grecs. Eux qui s’étaient longtemps contentés de modestes cabanes, assez semblables à celles des Gaulois, ils se construisirent des demeures décorées d’un péristyle à la grecque qui s’ouvrait sur un vaste atrium et où le gynécée tint une place importante. Mais cependant la partie destinée au public, où le patron pouvait recevoir ses nombreux clients, était plus développée qu’en Grèce. L’architecture byzantine ne change que peu de choses à ces dispositions romaines.
On ne rencontre le pittoresque, c’est-à-dire la fantaisie, que dans les demeures du moyen-âge. C’était l’époque où la guerre régnait ; tout le monde tenait à être fortifié. Il en résultait que faute de terrain dans l’intérieur des fortifications, on se trouva obligé d’accroitre la hauteur des maisons. Par suite des circonstances économiques, le rez-de-chaussée fut bâti en pierre, les étages supérieurs le furent en bois et s’avancèrent souvent en encorbellement sur la rue. Pour ne rien oublier, signalons les élégantes constructions en bois de la Norvège, de la Suède et de la Suisse, et les isbas des moujiks russes. La Renaissance modifia surtout l’extérieur des maisons. A partir du XVIIème siècle, l’influence de plus en plus prépondérante de la classe bourgeoise dans la société, éloigna les préoccupations d’art des demeures particulières au profit du confortable.
En Chine, au Japon, et dans les pays de l’Extrême Orient, les habitations se distinguent extérieurement par leur mode de construction original. Leur plan intérieur présente généralement un quadrilatère plus ou moins vaste, divisé en un certain nombre de chambres par des cloisons mobiles qui permettent d’agrandir les chambres quand le besoin s’en fait sentir. Là aussi, le maitre de maison cherche à s’isoler du contact extérieur... » (Larousse)
* * *
Aux diverses périodes, seuls les princes, les seigneurs, les riches, les gens aisés, la bourgeoisie marchande et industrielle ont connu les demeures somptueuses, robustes et vastes, plaisantes et protectrices, bref les habitations les meilleures du temps. Quant aux logements (cabanes, chaumières, galetas), où le peuple fut contraint toujours d’abriter sa vie précaire, ils ont été invariablement un défi au sens commun, à la dignité de l’espèce, à l’équité. Ils sont aujourd’hui encore une insulte permanente à l’hygiène et aux conditions élémentaires de la vie. Cette situation poignante devant laquelle les esprits justes et les cœurs sensibles ne peuvent rester indifférents a, dès le XIXème siècle (avant 1789 nul n’en prenait souci, les serfs étant à peine regardés comme des hommes), préoccupé économistes et philanthropes et parfois même les autorités, quand un courant d’opinion en portait l’écho jusqu’aux assemblées.
« Après la révolution de 1848, on fit de nombreuses enquêtes sur la situation des ouvriers. Il faut lire les rapports de Villermé, Blanqui, Frégier, Lestiboudois, Kolb-Bernard, Ebrington, H. Robert et Grainger pour se faire une idée des conditions épouvantables dans lesquelles vivait une grande partie de la population ouvrière... Les ouvriers, disaient-ils, surtout dans les grands centres comme Paris, Lyon, Lille, Rouen, Reims, Amiens vivent fréquemment dans des logements non aérés, parfois dans des caves humides, au milieu de véritables foyers pestilentiels et dans des conditions hygiéniques désastreuses. Ceux qui logent à la nuit, dans les garnis, ne sont pas mieux partagés. Le rapport du conseil général de salubrité en 1848 disait :
« Un tiers seulement est dans des conditions à peu près supportables ; le reste est dans l’état le plus affreux. 40.000 hommes et 6.000 femmes logent, à Paris, dans des maisons meublées qui sont, pour la plupart, de vieilles masures humides, peu aérées, mal tenues, renfermant des chambres garnies de huit ou dix lits pressés les uns contre les autres, et où plusieurs personnes couchent encore dans le même lit. »
Les plaintes soulevées par un tel état de choses devinrent telles que, en 1849, l’Assemblée législative, sur l’initiative de M. de Melun, vota la loi du 13 avril 1850, qui s’occupa des logements insalubres (nous y reviendrons tout à l’heure)... En 1852, un décret affecta dix millions à l’amélioration des logements d’ouvriers et une partie de cette somme fut accordée à diverses compagnies de Marseille, de Mulhouse, de Paris, qui firent construire des cités ouvrières... » (Larousse Universel)
Melun, dans ses Annales de la Charité, a tracé un tableau typique des grandes misères de la population indigente du 12ème arrondissement.
« Il est une partie de la ville, dit-il, qui paraît avoir échappé à la loi du mouvement et n’avoir jamais eu rien à perdre. Malgré l’aspect misérable et fangeux du faubourg Saint-Marceau, on ne trouve chez lui aucune trace de décadence ; ses rues resserrées et à pic, ses passages en planche, ses carrefours dépavés n’ont jamais pu porter de voitures, et on dirait que ses maisons, si hautes et si sombres, avec le nombre de leurs étages, la raideur de leurs escaliers, l’humidité de leurs chambres, ont été bâties pour des gens qui ne devaient pas payer leurs loyers. Dans ces demeures malsaines, sur cette paille qui souvent sert de lit, ne demandez pas de la fraîcheur et de la santé à l’enfant, de la force à l’ouvrier, de la verdeur au vieillard. Les scrofules, seul héritage que se transmettent les familles, nouent les ressorts et arrêtent les développements de la vie. »
Et, outre le pêle-mêle, plus hideux encore qu’ailleurs, le prix de ces bouges, où on logeait au jour, à la nuit et à l’heure, était exorbitant. Sans doute, ce tableau a vieilli et les tons s’en sont un peu éclaircis. Des trouées ont amélioré ce quartier et quelques soins ont tenté de rendre ces repaires moins lugubres. Mais les vices généraux n’en ont point disparu. Là, comme en bien d’autres coins de misère, la cupidité des logeurs continue à entasser les malheureux dans des pièces de quelques mètres carrés. Et la tradition de faire suer le logement continue à être la méthode sacrée de M. Vautour...
Quant à l’attention périodique des pouvoirs publics et aux interventions des philanthropes, elles n’ont apporté, depuis plus d’un demi-siècle, que de telles peintures ont pu être tracées sur le vif, que des adoucissements superficiels et des relèvements insuffisants. Le mal reste aujourd’hui singulièrement grave et étendu. Il est trop profond d’ailleurs et rattaché à trop de raisons connexes pour qu’il puisse être guéri par des bonnes volontés isolées et quelques saignées empiriques, par les aumônes de la bienfaisance et les crédits à retardement des administrateurs officiels. Seul un régime nouveau, situant sur son vrai plan, qui est d’ensemble social et non fragmentaire, le problème de l’habitation, pourra, s’y attaquant résolument et sans ménagements, dresser sur les ruines des masures actuelles des abris sains pour ceux qui travaillent. Seul aussi, il pourra, faisant litière des cloisonnements et des classes, ouvrir à tous les humains, un accès équitable aux demeures édifiées... Malgré des privilèges subsistants, des partialités de distribution manifestes, malgré surtout la tendance à favoriser son armée de fonctionnaires civils et militaires et sa corporation d’ouvriers qualifiés, la Russie soviétique a fait un effort notable dans le domaine du logement. D’avoir réduit, dans les immeubles existants, le nombre excessif de pièces affectées autrefois aux familles de la bourgeoisie pour y abriter des travailleurs sans logis ; d’avoir, dans les châteaux princiers et les vastes parcs où la camarilla tsariste noçait et chassait à la santé du peuple, installé pour celui-ci des maisons de repos et de retraite, des établissements pour les malades et pour l’enfance, constitue un fait nouveau, l’esquisse pratique d’une économie populaire (sinon pleinement révolutionnaire) encore inédite, qu’il serait injuste de passer sous silence...
Il est évident en effet que, au moins autant que d’insuffisance, nous souffrons, en matière de logement, d’une mauvaise répartition. De vastes immeubles, des habitations de 14 à 20 pièces (sans compter les dépendances utilisables) sont limités à « l’usage » d’une ou deux personnes. D’autres ne sont occupés — et encore partiellement — que quelques mois, parfois quelques semaines dans l’année. Nombreuses sont dans les maisons les pièces d’apparat, les chambres de réserve ou « d’amis » qui jamais n’ont abrité quiconque ou rendent de fallacieux services. J’en appelle — pour accuser cette disproportion dans l’affectation et souligner l’arbitraire, d’ailleurs patent, de la jouissance — au témoignage peu suspect d’un statisticien bourgeois. En 1908, le Dr Jacques Bertillon écrivait dans le Journal :
« Il y a dans les maisons de Paris environ 2.250.000 pièces (hôtels et habitations collectives telles que hospices, casernes, etc., non compris). Ainsi il y a presque autant de pièces que d’habitants et l’on pourrait imaginer que chaque habitant pourrait avoir une chambre pour lui tout seul. Naturellement, il n’en est pas ainsi : les uns ont plusieurs pièces à leur disposition, et beaucoup d’autres sont loin d’en avoir autant. »
Et il ajoutait — constatation sévère derrière le laconisme tolérant :
« Sur 1.000 habitants de Paris (de tout âge et de tout sexe), il y en a près de la moitié (exactement 482) qui sont assez spacieusement logés, à savoir 266 qui disposent d’une pièce par personne, et dont le logement peut passer pour suffisant, 138 qui ont plus d’une pièce, et 78 plus de deux pièces à leur disposition et qui sont largement ou très largement logés ; l’autre moitié est moins bien partagée : 363 vivent dans des logements dits insuffisants, où il n’y a pas une pièce par personne, et enfin 149 sont logés à raison de plus de deux personnes par pièce. Les logements de ces derniers sont dits surpeuplés. Six habitants sur mille ont des logements indéterminés (bateau, voiture, écurie, magasin, etc.) ... »
Il ne s’agit pas là d’une crise ou d’une infériorité nationales. Comme tous les maux qui frappent les classes pauvres, la pénurie et l’inique conditionnement du logement ne connaissent pas de frontières. Berlin, Vienne, Budapest, pour citer les plus caractéristiques parmi les capitales étrangères, sont aussi mal partagées et des gens y vivent aussi dans les caves et les sous-sols. Et ils ont leurs Schlafleûte, « les gens qui louent une portion de chambre ou de lit »... Si l’on considère d’autre part le territoire français dans son ensemble, on note, en prenant les mots dans leur acceptation ci-dessus qui révèle un critérium d’indulgence bourgeoise manifeste, qu’à l’époque dont parle Bertillon, sur 1.000 personnes, 260 vivaient en logements surpeuplés, 360 en logements insuffisants, 168 disposaient d’une pièce par individu, autrement dit que près de 800 souffraient, à des degrés divers, d’une solution mauvaise du problème de l’habitation.
Arrêtons-là les citations. Entrer dans le détail des villes et des communes rurales plus ou moins favorisées, opposer l’une à l’autre cités et provinces n’éclairerait pas davantage notre documentation générale. Les chiffres sont probants et Bertillon pouvait conclure :
« Un logement encombré est aussi nuisible à la santé physique qu’à la santé morale. Que de déchéances, que de ruines même sont dues à la promiscuité causée par un logement trop étroit ! »
Que viendront faire, en face de cette calamité, les remèdes doucereux de la charité, les mesures, toujours hésitantes, d’amendement public ? Qui, bénévolement, parmi ceux qui bénéficient d’un scandaleux déséquilibre, se résignera aux abandons nécessaires, quels favorisés feront la nuit du 4 août des locaux inutiles ? Quelle législation, dans le champ fermé de l’économie capitaliste, fera des prélèvements efficaces, groupera, sans en faire retomber la charge sur les misérables et mettra utilement en œuvre, les lourds crédits indispensables ? Non, le logement du pauvre ne disparaîtra qu’avec le paupérisme...
Nous avons vu que les municipalités, urbaines notamment, ont constitué des commissions d’hygiène ayant, dans leurs attributions, le contrôle des locaux d’habitation. Voici comment leur rôle est défini par la loi de 1850. « Elles visitent les lieux signalés comme insalubres mis en location ou occupés par d’autres que le propriétaire, l’usufruitier ou l’usager ; elles déterminent l’état d’insalubrité et en indiquent les causes, ainsi que les moyens d’y remédier. S’il est reconnu que les causes d’insalubrité dépendent du fait du propriétaire, l’autorité municipale lui enjoint d’exécuter, sous peine d’amendes que détermine l’article 9 de la loi, les travaux jugés nécessaires. S’il est reconnu que le logement n’est pas susceptible d’assainissement et que les causes d’insalubrité sont inhérentes à l’habitation elle-même, l’interdiction de location à titre d’habitation peut être prononcée, sous les sanctions pénales prévues par l’article 10 de la loi. Enfin, si l’insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes, ou si ces causes ne peuvent être détruites que par des travaux d’ensemble, la commune a la faculté d’acquérir, par expropriation, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux » (Nouveau Larousse). Depuis la loi de 1902, la mise en mouvement des moyens de coercition qui ne pouvait se produire lorsque l’occupant était le propriétaire lui-même, l’insalubrité atteignît-elle les voisins, peut avoir lieu à l’égard de « tout immeuble dangereux pour la santé des occupants, quel qu’ils soient, ou pour la santé des voisins ». D’autre part, l’action légale atteint non seulement les logements et leurs dépendances, mais « les immeubles entiers, y compris les parties non bâties ».
Il y a là évidemment, au nom de la santé publique, le principe d’une immixtion heureuse de l’autorité sociale dans l’état des lieux habités. Il porte atteinte aux droits souverains de la propriété et en restreint l’arbitraire meurtrier. Mais tous ceux qui connaissent le fonctionnement des commissions d’hygiène savent dans quelles circonstances elles se déplacent. Et les malheureux qui habitent les maisons que leur passage, suivi d’effet, « assainirait », peuvent goûter une fois de plus l’ironie des lois de sauvegarde et attendre que les pouvoirs publics daignent s’appuyer sur elles pour enjoindre la réfection des quartiers inhabitables, A plus forte raison pourront-ils — s’ils en connaissent — épingler comme un événement révolutionnaire, l’expropriation pour cause d’insalubrité !
On se garde le plus souvent de porter le regard — et encore moins la pioche ! — dans les taudis existants. Tout au plus s’inquiète-t-on, assez distraitement, d’exiger que les constructions neuves réalisent certaines conditions élémentaires de salubrité. Les « villes tentaculaires » qui aspirent et précipitent dans leur tourbillon les populations abusées ou économiquement infériorisées des campagnes, souffrent avec acuité d’une crise du logement que la dernière guerre a accrue et accélérée. Et elles cachent encore dans leurs flancs — stigmates qui sont la honte d’un régime et suffiraient à le condamner — des milliers d’infects chenils qui sont l’habitation obligée du pauvre... Les soupentes tour à tour glaciales et surchauffées qu’aère une maigre lucarne et où croupissent des familles entières dans une promiscuité malsaine et révoltante, les vagues « pièces » superposées dans les cours noires et empuanties de tous les reliquats des cuisines et des water-closets, avec leurs boyaux d’accès où règne une éternelle demi-nuit et auxquels on a eu le cynisme de donner le nom de rues, continuent dans un Paris surpeuplé et dans les vieux quartiers de la plupart des grandes agglomérations de province (où le visiteur admire leur « couleur » historique et leur originalité), à servir d’abri et déjà de tombeau aux nichées laborieuses...
* * *
Quelques passages d’un document officiel d’avant 1914 loin de les réduire, le cataclysme destructeur a accentué les vices dénoncés et les tares se sont étalées et approfondies — souligneront, de leurs traits et de leurs chiffres précis, les peintures que nous esquissons et accuseront leur modération. Elles éclaireront d’un jour cru la lèpre que représentent en plein vingtième siècle les habitations des hommes...
« En 1891, il y avait à Paris 72.705 logements surpeuplés, c’est-à-dire habités par plus de deux personnes par pièce : 331.976 personnes occupaient ces logements. En 1901, on comptait encore 69.901 de ces logements, habités par 341.041 personnes ; 15.432 familles n’avaient qu’une pièce pour quatre personnes. Il faut, en outre, tenir compte des 190.000 personnes qui logeaient en garni : en 1896, il y avait là 2.783 groupes de quatre personnes et plus logeant « sous la même clé ». Les recensements ultérieurs 1906, 1911, se sont bien gardés de refaire le dénombrement du « bétail humain » ainsi entassé. Mais « à défaut de statistique précise, on peut voir un indice de l’aggravation de la crise dans l’augmentation croissante du nombre des ouvertures de garnis, qui s’est produite dans les arrondissements périphériques. Le nombre des chambres contenues dans ces garnis — refuges ouverts à toutes les inquisitions de propriété et de police — est passé de 671 en 1907 et 804 en 1908 à 1.649 en 1909, 2.216 en 1910 et 4.600 en 1911. D’après les relevés de la Préfecture de police, il y avait, en 1908, 189.177 locataires dans les garnis et 196.925 en 1911. Or, il ne faut pas perdre de vue que l’hôtel meublé, dans les quartiers ouvriers, est souvent le refuge des familles qui ne peuvent plus se loger dans les maisons particulières et qui en sont réduites à s’entasser dans une chambre garnie, dont le loyer est payé à la semaine.
D’autre part, des enquêtes auxquelles ont procédé des hygiénistes comme les docteurs Mangenot et Boureille ou des œuvres philanthropiques telles que « l’Amélioration du logement ouvrier » ont montré dans quelles épouvantables conditions d’insalubrité vivaient de nombreuses familles ouvrières : c’est, à Grenelle, huit personnes logées dans une pièce de 36 m. cubes ; rue Falguière, six personnes couchant dans une chambre de 29 m. cubes où ne pénètre jamais le soleil ; dans le 10ème arrondissement, sept personnes habitant une pièce dont l’unique fenêtre donne sur une courette sombre qui sert de réceptacle à toutes les immondices de la maison, etc.
Dans ces recoins humides, sans air, ni lumière, la tuberculose, maladie de l’obscurité, du surpeuplement et du surmenage, règne en maîtresse sur les travailleurs et leurs enfants... Les familles nombreuses (malgré les exhortations officielles à la procréation : de même que Dieu bénit les nombreuses familles mais ne les nourrit pas, la patrie demande des enfants sans s’inquiéter de leur gîte et de leur pâture), sont particulièrement frappées et sont non seulement les premières victimes des taudis, mais celles de la crise elle-même. On cite un père de dix enfants ayant visité, à l’époque (on peut multiplier aujourd’hui les chiffres de ces courses stériles) « 33 logements sans être accueilli ». Une autre, avec neuf enfants, a passé trois nuits à la belle étoile. D’autres mettent leurs meubles au garde-meubles et les vendent peu à peu pour payer la chambre d’hôtel où on a consenti à les héberger avec leurs sept enfants : plusieurs se construisent des baraques en planches ou en carreaux de plâtre sur des terrains qu’ils louent parfois des prix exorbitants. » (Rapport de la commission des habitations au Conseil municipal de Paris)
Tant que le logement fera partie du système de « revenu privé » qui est la caractéristique de l’économie actuelle, le mal subsistera, plus ou moins étendu, plus ou moins douloureux. Et les propriétaires, arbitres intéressés, pourront, dans la logique de l’affaire que représente pour eux un loyer, faire aux déshérités cette réponse souveraine à savoir qu’ « ils ne sont pas obligés de faire de la philanthropie à leurs dépens ». Le problème du logement est un problème social, lié à tous ceux que le capitalisme tient en suspens sous sa griffe obstinée... Toutes les mesures qui ne sont pas d’appropriation sociale et de transformation fondamentale, toutes les tentatives, gouvernementales ou privées, en vue de corriger la situation ne sont que des palliatifs insuffisants et trompeurs et de paresseuses solutions d’attente...
* * *
Des maisons futures quelles seront les formes et les dispositions générales, quels seront leurs agencements essentiels ? De quelles conceptions hygiéniques s’inspireront-elles ? Elles seront influencées à la fois par les progrès de la science physiologique et ceux de la technique constructive, sous le contrôle artistique de l’esthétique dominante. Mais les habitations seront affranchies de tous les facteurs d’exiguïté, d’insécurité et d’insalubrité qui en font aujourd’hui les antichambres parfois précipitées de la mort. Délivrés des malfaçons et des sabotages de rapport des entreprises actuelles, les groupes constructeurs iront aux matériaux et aux procédés appropriés à des fins de résistance et de bien-être. Mais, ouvert à la lumière bienfaisante, baigné d’air et ensoleillé, spacieux et pratique, le logement devra constituer le milieu quotidien, à la fois riant et normal, où « il fait bon vivre »...
Déjà le ciment, le béton armé, remarquable pour ses qualités de cohésion, d’incombustibilité et de résistance aux intempéries, est devenu d’une utilisation courante. Il a permis, depuis quelques années à peine que sa vogue s’est affirmée, de réaliser d’audacieux et puissants édifices ; il a inspiré même une architecture nouvelle et parfois originale, entraîné de souples adaptations de l’art décoratif, en particulier sculptural, donné naissance çà et là à quelques formules hardies et vigoureuses. Et voilà que la technique constructive s’oriente vers les immeubles en acier édifiés comme il est pratiqué pour la coque d’un navire cuirassé :
« Grâce à un dispositif intérieur, les maisons ne seraient ni plus chaudes en été, ni plus froides en hiver que celles réalisées en maçonnerie, et leur solidité, leur durée seraient aussi certaines... »
Sur les suggestions de l’Office public des habitations dites « à bon marché », la Ville de Paris se propose à la faveur de la loi de juillet 1928 (loi Loucheur) de procéder à une tentative qui porterait sur une quarantaine de pavillons et coûterait un million environ. Les avantages les plus marquants du nouveau principe seraient l’introduction d’une industrialisation particulièrement poussée dans le domaine du bâtiment. La possibilité d’usiner en série les différentes pièces ferait baisser dès maintenant le prix de revient et assurerait une rapidité et une simplicité d’exécution dont les sociétés de l’avenir tireraient un intéressant profit. Amenées sur leurs emplacements ces constructions seraient facilement et promptement assemblées. D’ores et déjà des expériences, faites à l’occasion d’expositions récentes, ont montré qu’une semaine pouvait suffire pour édifier une maison du type envisagé. Et ce n’est pas là le denier mot de la technique de la fabrication et du montage.
Les constructions de demain seront-elles dispersées dans les bocages, au gré de la fantaisie poétique ou uniront-elles à l’instar des familistères ébauchés (voir familistère) ; ce maximum d’avantages généraux que favorise la synthèse ? Les deux sans doute auront leurs favoris et se verront recherchées selon les préférences de chacun. Tarbouriech (La Cité future) a imaginé :
« Un cadre de la vie privée comportant un groupe d’habitations, auquel un ensemble de services administratifs et économiques au moins rudimentaire, constitue une individualité propre quant à la consommation. Ce groupe d’habitations, auquel il a donné le nom générique d’habitat, peut être isolé ou former une partie d’une agglomération urbaine plus ou moins importante. En campagne, il est constitué par des maisons simples, mais élégantes, plus ou moins grandes selon l’importance des familles, entourées chacune d’un jardinet et s’alignant le long d’allées, plantées d’arbres, une place égayée par des parterres et dont les côtés seront constitués par les bâtiments des services généraux : maison commune avec bureaux, salles de commissions, salles des fêtes, école, dispensaire, économat, hôtel-restaurant, qu’on pourrait réunir aux habitations par des galeries, un parc où les enfants joueront, où les vieux se promèneront.
En ville, c’est un grand carré qui constituera un vaste parc accessible de la rue par des passages coupant les bâtiments en bordure de la voie publique. A ces bâtiments s’en ajouteront d’autres répandus dans l’intérieur et dont Tarbouriech fixe, pour Paris, l’orientation nord-sud, comme étant la plus convenable au climat. Ces constructions, dont les façades pourront être agréablement variées, artistement décorées, comprendront, en principe, un rez-de-chaussée élevé de un mètre à deux au-dessus du sol et de deux ou trois étages, pas davantage. Inutile, en effet, d’entasser des pierres les unes sur les autres jusqu’à des hauteurs invraisemblables, alors que le terrain ne coûte rien et que la terre est si grande. Au centre du carré se trouveront, en des constructions plus belles, les services généraux et des galeries intérieures ou extérieures permettant à tous les habitants de chaque habitat d’aller, à l’abri des intempéries, au cercle, à la salle de réunions, à l’économat ou à l’école ; des wagonnets électriques roulant le long de ces galeries assureront le service de distribution à domicile. Le grand charme de ces quartiers sera dans leurs parcs. Les jardins publics seront ainsi étroitement réunis aux habitations et on s’y promènera comme chez soi, en tenue d’intérieur, etc. Ainsi, avec des services généraux organisés de façon à ce qu’il se suffise à lui-même, quant aux nécessités courantes de la consommation, l’habitat apparait à l’auteur comme devant concilier le maximum de communisme compatible avec notre mentalité et le maximum de liberté individuelle que l’on puisse désirer et mettre chaque citoyen dans une situation telle qu’il puisse, à son gré, ou se replier dans un isolement farouche ou goûter tous les charmes de la vie sociale la plus raffinée. » (Résumé emprunté à l’Encyclopédie socialiste)
Edward Bellamy, dans son évocation de « l’an 2.000 », dépeint avec couleur les habitations séduisantes, et enrichies d’un confort enfin socialisé, de la société transformée. Dans Travail, Zola envisage la disparition de toute conglomération d’habitations. Pour lui « dans le régime social futur, les villes auront une étendue considérable, car la maison à logements multiples de nos grandes villes aura disparu et seule existera l’habitation servant à une unique famille, enfouie dans un jardin qui la séparera de toute autre habitation. Si la liberté individuelle trouve mieux son compte dans cette conception » (ajoutons que « la vie de famille » se sera, comme la famille elle-même, sans doute profondément modifiée) « rien n’empêcherait d’ailleurs le citoyen épris de sociabilité et tenant au commerce quotidien de ses semblables, de donner satisfaction à ses goûts, car, pour être prévus moins nombreux, moins à la portée de la main, les services généraux imaginés par Zola n’en sont pas moins accessibles et n’en sont que plus grandioses »... (Encycl. social.)
Nos cités de l’avenir — si l’appellation de cité convient encore à leur physionomie — cesseront de dresser des gratte-ciels de multiples étages sur des rues de corridor. « Il nous sert peu, dit le Dr Bridou, d’accélérer nos moyens de communication, si nous continuons à nous entasser stupidement comme les cloportes sous des masses ténébreuses de moellons ». Les constructeurs futurs feront litière, nous l’espérons, de l’absurde faculté de « bâtir à toutes les hauteurs, en masquant la lumière aux malheureux qui logent en bas ou en arrière de ces bâtisses ». Ils feront aussi généreuse que possible la part du soleil afin que tous aient accès à ses caresses et à ses pénétrations bienfaisantes. Ils sauront qu’il « doit égayer chaque logis familial pour en écarter à la fois la tristesse, la laideur et les autres maladies dont nous cherchons à réduire les méfaits trop coutumiers ». Ils ne sépareront pas d’ailleurs la préoccupation du logement des conditions générales de la vie. Ils les associeront harmonieusement en vue de l’essor vers le maximum de satisfactions. Pénétrés de « l’indivision foncière de tous les éléments qui contribuent au progrès civilisateur des sociétés », ils se garderont d’oublier que « quand on sépare l’hygiène physique de l’esthétisme et de la moralité sociale, on dissocie le développement de l’existence humaine... »
Bref, nous verrons (nous en caressons l’espoir) les cités décongestionnées et les avantages de la ville, grâce aux communications rapides du temps, les possibilités accrues de pénétration et une organisation enfin rationnelle de la répartition, transportées jusqu’au fond des campagnes. Puisse le bruit, qui fait si souvent cortège aux inventions modernes et ponctue désagréablement les avances de la civilisation, ne pas rendre illusoires — pour ceux qui l’aimeront encore — toute possibilité de retraite et de recueillement, et la nature conserver quelques-uns de ses charmes primitifs et profonds... Il est à présumer que « la plupart des ateliers et fabriques installés sur des emplacements trop exigus, dans les grandes villes, se dissémineront à travers le pays et seront établis un peu partout dans les communes rurales et dans les conditions les plus parfaites pour que le travail y soit commode, agréable et sain et l’activité industrielle proprement dite se réunira ainsi à celle des agriculteurs, qui, d’ailleurs, s’industrialise chaque jour davantage...
Ainsi, la vie à la campagne, en gardant ses avantages propres, acquerra ceux jusque-là réservés aux grandes villes, sans en prendre les inconvénients ; car bientôt seront transportées à la campagne toutes les choses nécessaires à l’état de civilisation auquel la population urbaine est habituée : les musées, les théâtres, les salles de concert » (les émissions radioélectriques porteront demain, au domicile privé de chacun, grâce à la téléphoto et au film sonore, le cinéma parlant, et ressusciteront le charme des spectacles et des auditions vécues) « les cabinets de lecture, les établissements d’instruction, les lieux de récréation, etc., sans compter que la multiplication des moyens de transport en commun et leur gratuité, donneraient toute facilité à l’habitant de la campagne de venir pour ainsi dire autant qu’il le désirerait, participer aux amusements et distractions plus nombreux que la ville pourrait encore offrir » (Encycl. social.).
Encore une fois, les modalités de l’habitation future et sa situation seront fixées, en leur temps, par les générations intéressées et en accord avec les mœurs et les ressources d’alors. Et nos recherches et les projets que nous pouvons faire à cet égard seront regardés peut-être par nos descendants comme un dessin désuet ou des injonctions utopiques. Ils peuvent y trouver, cependant, de profitables suggestions... Mais, à moins que la chimie biologique ne bouleverse nos données actuelles sur les milieux et les éléments organiques ou que d’ingénieuses découvertes ne permettent, d’ici là, de régénérer pour ainsi dire spontanément nos tissus menacés et ne rendent caduques nos connaissances et nos précautions d’hygiène, il est des considérations primordiales qui devront guider l’homme de l’avenir dans l’établissement de ses locaux de séjour, dans ses ateliers comme dans ses maisons de repos : c’est qu’il doit fournir incessamment à ses poumons un air aussi pur que possible, et pour cela éloigner de ses habitats les gaz toxiques et les microbes qui s’accumulent ou se développent dans une atmosphère confinée et soustraite, par surcroît, à l’action des rayons solaires. Et c’est que la recherche du bien-être et la protection contre le froid ne peuvent le dispenser de maintenir son corps en état de résistance par un entrainement et une activité appropriés...
Des mesures générales favoriseront la réunion de ces conditions : ne pas accoler les maisons les unes aux autres et surtout ne pas placer à proximité des habitations les établissements industriels qui répandent dans l’air des émanations dangereuses... Entourer toute habitation humaine d’une étendue suffisante de terrain couvert de végétation qui l’isole de sa voisine. Non pas seulement l’éloigner des usines, tenir celles-ci à l’écart des régions habitées, mais obtenir que l’industrie brûle ou neutralise complètement les sous-produits, de façon à ne laisser sortir sous forme de gaz ou de liquides, que des produits non dangereux... Les situer à la campagne ne suffit pas ; il faut que les maisons aient des chambres vastes et lumineuses et que le souci d’y entretenir, l’hiver, une tiédeur confortable n’incite pas à leur conserver une herméticité dangereuse. Ne pas emprisonner l’humidité dans ses murs et, surtout, empêcher qu’elle y pénètre...
Voici les grandes lignes d’un plan d’habitation saine établi par Michel Petit : « Orientation à l’Est ou au Midi dans nos régions (en attendant que les maisons sur pivot se présentent à leur gré au soleil). Construction de la maison de façon à n’avoir, autant que possible, d’ouvertures que sur une face ; si la maison offre un grand et un petit côté, sur deux faces, si elle est carrée ou, ce qui est préférable, si elle est bâtie en équerre. Qu’il y ait une ou deux façades, exposées comme il est dit, ces façades doivent être, en tous cas, presque entièrement vitrées sur toute leur hauteur et leur largeur.
Mais il n’est pas nécessaire que tous ces vitrages soient mobiles. Ils sont destinés à laisser pénétrer le soleil beaucoup plus qu’à l’aération. C’est pourquoi, dans une grande fenêtre, il suffit qu’une portion puisse s’ouvrir... L’aération continue peut se faire par divers procédés qui en reviennent tous, comme principe, à des prises d’air établies en différents points de la façade de l’habitation et à des tuyaux de sortie de cet air établis au sommet de la maison, en sorte que l’air extérieur pénètre constamment et que l’air usé soit constamment évacué, et cela sans procurer de courant d’air froid. On évite cet inconvénient en faisant passer l’air extérieur entre deux cloisons et, en hiver, au contact d’un tuyau rempli de vapeur d’eau à basse pression, avant qu’il pénètre dans les appartements. Il y a bien d’autres moyens, je me borne à signaler celui-là pour montrer que la difficulté peut être résolue.
« Dans l’aménagement intérieur de l’habitation, il y a de grandes lois à observer. Etablir le moins de petites pièces possible ; n’encombrer les pièces que le moins possible, et supprimer totalement tapis, rideaux, tentures, meubles couverts en étoffe surtout des pièces où l’on se couche. Comme type de maison je proposerais une grande pièce, comprenant à elle seule presque la moitié de l’habitation, et dans laquelle les habitants passent leurs journées : c’est la pièce où l’on vit. Elle s’ouvre directement, ou par un court vestibule, au dehors et offre des portes d’accès avec les autres pièces de la maison consistant en cuisine, chambres à coucher et, s’il y a lieu, bureau ou autre pièce spéciale. Cette maison ne comporte qu’un rez-de-chaussée. Si on le préfère, on peut n’avoir, au rez-de-chaussée, que la grande salle et la cuisine et mettre les chambres à coucher au premier étage. Mais ce qu’il faut toujours, c’est que chaque pièce soit largement ajourée et que l’air y circule, par quelques procédés que ce soit... »
Comme le vêtement, qu’il complète, le logement doit être au service de notre vitalité et de notre expansion. Et il ne peut favoriser nos joies que fugacement s’il nous enserre de jour morose et d’espace exigu, s’il prive nos organes, nous épuise et nous diminue...
— Stéphen MAC SAY
LOGIQUE
adj. et subs. fém. (grec logikos, de logos, discours, raison)
D’interminables et vaines querelles ont mis aux prises les philosophes pour savoir si la logique est un art ou une science. Elle suppose la connaissance des opérations supérieures de l’entendement, se rapproche par là de la psychologie et, sous cet angle, apparaît comme une science. Mais, alors que la psychologie décrit ce qui est, la logique fixe ce qui doit être ; elle apprécie et son caractère normatif la rapproche singulièrement de l’art. « Science des sciences » ou « art de penser », elle se donne pour but d’orienter l’esprit dans la recherche du vrai, d’établir les règles de la pensée normale et scientifique. Deux parties la composent : la logique formelle, dont l’objet est l’accord de la pensée avec elle-même, la logique appliquée ou méthodologie qui vise à l’accord de la pensée avec son objet.
Longtemps la logique formelle garda une place prépondérante. Au IVème siècle avant l’ère chrétienne, Aristote la porta presque à sa perfection ; au moyen-âge, avec les scolastiques, elle devint le cœur de la philosophie ; l’ambition suprême des doctes fut alors d’argumenter « en forme ». Les humanistes d’abord, puis les empiristes anglais et les rationalistes cartésiens réagirent heureusement contre cet excès. Sous le nom de logistique, elle fut approfondie, à la fin du XIXème et à l’époque contemporaine, par des philosophes qui ont élargi et modifié l’œuvre d’Aristote, restée presque immuable jusque-là. Quant aux néo-scolastiques, pompiers sans esprit ou farceurs à la Maritain, ils en parlent avec onction, mais n’insistent plus autant que leurs chicaniers ancêtres.
A la suite du Stagirique, la logique formelle classique porte principalement sur le concept, le jugement, le raisonnement. Mais elle ne s’attarde ni aux opérations qu’ils exigent, ni à leurs rapports avec les données de l’expérience ; elle s’intéresse exclusivement à leur validité intrinsèque, à la présence ou à l’absence, de contradiction. C’est dire qu’elle est entièrement et uniquement commandée par le principe d’identité, loi souveraine de toute pensée raisonnable. Le concept, dont le terme est la traduction verbale, suppose un ensemble de qualités, c’est sa compréhension ; il s’applique à un ensemble d’êtres ou d’individus, c’est son extension. Réunion de deux termes, sujet et attribut, au moyen du verbe « être », la proposition est l’énoncé d’un jugement. Elle est universelle ou particulière d’après l’extension du sujet ; affirmative ou négative selon qu’elle pose ou exclut un terme par rapport à l’autre ; analytique ou synthétique selon que l’attribut fait ou ne fait pas partie de la compréhension du sujet. Le raisonnement peut être immédiat, c’est-à-dire résulter de la seule confrontation des prémisses et des conclusions ; ainsi dans la « conversion » et « l’opposition ». Il est médiat quand il suppose un ou plusieurs intermédiaires entre la proposition d’où l’on part et la proposition où l’on arrive. De tous les raisonnements médiats le syllogisme est le plus fameux, celui que les scolastiques ont particulièrement étudié. C’est, dit Aristote, « un discours dans lequel, certaines choses étant posées, une autre chose en résulte nécessairement, par cela seul que celles-ci sont posées ». Les trois propositions, dont il est formé, impliquent seulement trois termes ; celui qui sert d’intermédiaire disparaît dans la conclusion.
Or Socrate est homme ;
Donc Socrate est mortel.
Le syllogisme n’est légitime que s’il remplit certaines conditions longuement débattues au moyen-âge et résumées, par les scolastiques, dans huit règles : les deux premières définissent le syllogisme, les six autres interdisent de dépasser dans la conclusion ce qui a été posé dans les prémisses, aussi bien en ce qui concerne les termes qu’en ce qui concerne les propositions. Ce sont des applications du principe d’identité qui permettent de passer du même au même et du plus au moins, jamais du moins au plus. La transgression de ces règles rend le syllogisme captieux : la rigueur de la déduction n’est plus qu’apparente et la conclusion devient vicieuse. En voici deux exemples :
Or je n’ai pas perdu de cornes ;
Donc j’ai des cornes. »
Et
Or les nègres sont noirs ;
Donc les hommes sont noirs. »
Dans le premier cas on joue avec l’amphibologique expression « je n’ai pas perdu » ; dans le second on donne au terme « hommes » une extension plus large dans la conclusion que dans les prémisses. Les syllogismes diffèrent entre eux soit par le « mode », qui dépend de la nature des propositions, soit par la « figure » qui dépend de la place du moyen terme. Il existe encore des syllogismes hypothétiques, dont la majeure renferme une condition, des syllogismes disjonctifs, dont la majeure énonce une alternative :
Or il est beau ;
Donc il n’est pas mauvais.
Mentionnons, parmi les variétés de raisonnements médiats, l’enthymème, l’épichérème, le sorite, le polysyllogisme :
Ce qui fait du bruit remue ;
Cette rivière remue.
Ce qui remue n’est pas gelé ;
Cette rivière remue ;
Cette rivière n’est pas gelée, etc.
A côté de l’ancienne logique formelle, celle des propositions d’attribution, les logisticiens modernes veulent créer une logique nouvelle, sorte d’algèbre qui englobe les propositions de relation. Comme l’algèbre, elle use de symboles, qui diffèrent malheureusement avec les auteurs ; les règles logiques se démontrent par théorèmes et corollaires. Et de même que l’on construit des machines à calculer, de même l’anglais Jevons a fabriqué une machine à raisonner. Son piano logique exécute mécaniquement les opérations logiques essentielles, grâce à un système de touches représentant soit les divers rapports possibles, soit un concept ou sa négation. Pourtant beaucoup ne voient dans la logistique qu’une sténographie fort subtile. Elle réduit en formules mathématiques des combinaisons d’idées, négligées par le Stagirique, mais il est douteux qu’elle puisse devenir l’art infaillible que certains espèrent.
Le moyen-âge fit un extraordinaire abus de la logique formelle et du syllogisme. Considérée non seulement comme un bon procédé d’exposition ; mais comme l’instrument par excellence de la recherche scientifique, la méthode scolastique dégénéra en arguties insensées ; elle devait régner en maîtresse, dans les écoles, jusqu’en plein XVIIème siècle. Aristote devint l’oracle souverain dont la parole n’était jamais mise en doute ; le professeur suivit servilement le texte de ses livres et la formule : « Magister dixit » (le Maitre a dit) fut l’argument suprême qui permit de sortir victorieux dans toutes les disputes. Or les exercices scolaires se bornaient, pour l’élève, à la soutenance « en forme », selon des procédés invariables et séculaires, de thèses fixées d’avance. Il y avait des termes rituels, des phrases consacrées, dont l’omission pouvait rendre un examen nul ; la Faculté de Paris faillit annuler une thèse de Bossuet parce qu’il avait passé un mot dans la formule de compliment prescrite au début. Nos sorbonnards, dont la sottise parfois déconcerte, ont de qui tenir on le voit ! Qu’on traitât de philosophie, de théologie, de droit, de médecine de physique, l’assaillant « disputans » et le candidat « respondens » déroulaient interminablement, selon des règles inflexibles, syllogismes, enthymèmes, etc. ; et les « concedo », les « nego », les « distinguo » pleuvaient au cours de la discussion ; le Diafoirus de Molière emploie tous les termes scolastiques avec une parfaite convenance. Ajoutons qu’on s’exprimait en un latin barbare, et qu’on s’en tenait en général à des jeux de mots, à des subtilités frivoles, négligeant le fond des problèmes. Sans jamais recourir au contrôle de l’expérience, même en physique, on prétendait vider le réel de son contenu tout entier, grâce à d’interminables raisonnements a priori, dont le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils étaient d’ordinaire parfaitement déraisonnables. Depuis Descartes on a compris que le syllogisme ne pouvait servir qu’à exposer ce qu’on savait déjà ; ce n’est pas un instrument de découverte puisqu’il se borne à passer du général au particulier, du contenant au contenu. Plusieurs l’accusent encore d’être un cercle vicieux, dont la vérité de la conclusion est nécessaire à la vérité des prémisses.
L’Eglise, ce monstrueux éteignoir, toujours désireuse d’étouffer la pensée libre, se devait de ressusciter la scolastique tombée dans un juste discrédit. Elle le fit dans la seconde moitié du XIXème siècle. Dès son avènement au pontificat, en 1878, Léon XIII recommandait le retour au thomisme et, l’année suivante, par une Encyclique qui provoqua la démission de nombreux professeurs, il imposait son enseignement dans les Universités catholiques. Ce pape trouva un auxiliaire dans l’abbé Mercier, le futur cardinal, qui fut chargé en 1880 d’enseigner la philosophie thomiste à l’Université de Louvain. J’ai lu ses livres : ce sont d’indigestes mélanges, sans originalité, où le fatras d’une érudition peu profonde remplace le talent. Bientôt les scolastiques devinrent tout-puissants dans les séminaires et les écoles catholiques. Ils n’ont atteint le public que plus tard, grâce à des charlatans, dont Maritain est un beau spécimen présentement. Applaudis par la bourgeoisie, que ses intérêts ont converti à une religion de façade, ils ont vu leurs élucubrations insanes couronnées par l’Institut, propagées par les grands périodiques, et favorisées même par les universitaires. Ayant voulu présenter une thèse en Sorbonne où je malmenais le thomisme, à la fin de 1918, un professeur israélite me fit savoir que l’heure était par trop mal choisie, alors surtout que j’avais contre moi de n’être ni décoré de la croix de guerre, ni même simplement soldat. Peu après deux badernes philosophiques de Gand, admiratrices du Divin Thomas, devaient s’indigner non moins fortement devant l’audace de mes conclusions. Malgré journaux et revues pseudo-littéraires, malgré les complaisances des éditeurs pour les écrivains catholiques, la vogue néo-scolastique sera sans lendemain ; les livres des Maritain sont promis à l’oubli.
Mais, à côté de la logique formelle, il y a place pour la logique appliquée ou méthodologie. Presque inconnue au moyen-âge, cette dernière s’est beaucoup développée au cours du XIXème siècle ; elle suit le progrès des sciences particulières et constitue l’une des branches essentielles de la philosophie contemporaine. Son but est de fixer les procédés requis pour connaître scientifiquement les divers objets étudiés par l’esprit. Or tantôt nous créons un monde abstrait, dégageant les règles idéales de toutes choses réelles ou possibles, tantôt nous observons le monde sensible et précisons les lois que l’expérience y découvre. D’où les sciences mathématiques d’une part et, d’autre part, les nombreuses sciences qui, de la physique à la sociologie, se partagent l’étude de l’univers observable. Les premières ont une méthode déductive et a priori, la démonstration ; les secondes, malgré les variations résultant de la diversité de leur objet, ont en commun une méthode a posteriori, expérimentale, inductive.
Négligeant la qualité, les mathématiques s’en tiennent à la seule quantité, soit continue soit discontinue, figures et nombres ; elles étudient les lois de variations corrélatives entre les grandeurs. A l’origine leur méthode fut tributaire des données sensibles : c’est l’expérience qui révéla aux anciens la mesure de la circonférence par le diamètre, la valeur, toujours égale à deux droits, de la somme des angles d’un triangle quelconque, etc. Mais aujourd’hui les mathématiques, devenues sciences exactes, ne procèdent que déductivement, par démonstration. Partant des définitions des nombres et des figures, créations de l’esprit suggérées par l’expérience, elles tirent par raisonnement et sous le contrôle d’axiomes évidents mais indémontrables, toute la splendide floraison de lois rigoureuses qui constituent leur domaine. Le principe d’identité s’avère l’ossature de leurs constructions ; leur vérité consiste dans un constant accord de la pensée avec elle-même. Sur l’origine des nombres et des figures, purement expérimentale selon les uns, purement rationnelle selon d’autres, à la fois l’une et l’autre d’après beaucoup, les logiciens discutent ; de même sur la valeur exacte des définitions et sur le rôle des axiomes. Les plus graves dissentiments concernent les postulats, propositions spéciales à la géométrie, synthétiques, indémontrables, d’une évidence moins immédiate que les axiomes, avec lesquels on les a confondus parfois. On connaît celui d’Euclide : « Par un point pris hors d’une droite, on ne peut mener qu’une parallèle à cette droite ». Lowatchewski l’a nié, puis a construit une géométrie non moins cohérente, non moins logique, non moins vraie, du point de vue de l’identité, que l’ancienne. On peut mener, par un point, une infinité de parallèles à une droite donnée, parallèles qui se rencontrent à l’infini ; et les trois angles d’un triangle sont inférieurs ou supérieurs à deux droits. Riemann, d’autre part, a imaginé un espace ne possédant pas trois dimensions, largeur, hauteur, profondeur, comme le nôtre, mais un nombre de dimensions moindre ou plus grand, 1, 2, 3, 4, 5, n, dimensions. On a encore contesté l’homogénéité de l’espace et son uniformité. De nombreux métagéomètres ont travaillé dans ces diverses directions et les théorèmes qu’ils ont déduits n’ont rien d’absurde. Seule l’expérience nous apprendra laquelle de ces géométries est physiquement vraie, c’est-à-dire s’accorde avec l’univers observable. Il semble, en tout cas, que certains animaux, souris japonaises, lamproies par exemple, perçoivent un espace ayant moins de dimensions que le nôtre. Et des expériences répétées font croire que nos trois dimensions correspondent aux trois canaux semi-circulaires de l’oreille.
Aussi peut-on se demander si les lois mathématiques sont les lois du monde réel, si elles constituent un invariable plan de l’univers. Descartes le croyait ; arithmétique et algèbre, écrivait-il, « règlent et renferment toutes les sciences particulières », il admettait une conformité absolue entre les lois de la raison et les lois des choses. Beaucoup en doutent aujourd’hui, sans apporter, d’ailleurs, d’arguments décisifs en faveur de leur conception. Dans les sciences expérimentales, l’esprit ne déduit pas les lois a priori comme en mathématiques, il les dégage des faits. On examine d’abord les phénomènes pour en avoir une connaissance objective et précise : soit que l’on étudie sans idée directrice ceux qu’offre la nature, c’est l’observation ; soit qu’une hypothèse nous guide et qu’on les reproduise intentionnellement, c’est l’expérimentation. Puis, des faits nous passons aux lois, grâce au raisonnement qui parvient à distinguer les successions causales des successions accidentelles et grâce à la généralisation inductive du rapport nettement établi entre l’antécédent-cause et l’antécédent-effet. Ainsi la méthode expérimentale suppose une collaboration de l’esprit et des choses : sans une constante interrogation de la nature, nous risquons de tomber dans une vaine et illusoire scolastique ; mais seul l’entendement peut dégager les lois du fatras des phénomènes enchevêtrés. Nos sens perçoivent des successions, nullement le lien de causalité, et la diversité des antécédents déguise la cause productrice ; impossible, par ailleurs, de réaliser un vide où chaque antécédent serait isolément introduit. C’est par des artifices de raisonnement, dont Bacon puis Stuart Mill ont précisé les méthodes, que la pensée aboutit à la coïncidence solitaire, preuve infaillible du rapport causal.
Ce rapport, le savant l’universalise d’emblée ; de quelques cas observés, parfois d’un seul, il conclut à tous les cas présents, passés, futurs et déclare que dans de telles conditions, tel antécédent sera toujours suivi de tel conséquent. Quel principe garantit cette affirmation inductive ? Dans la déduction, le principe d’identité suffit parce que l’esprit va du général au particulier, du genre à l’espèce et que les prémisses contiennent en totalité la conclusion. Ici nous tirons, au contraire, l’universel du particulier, nous allons du moins au plus, de quelque à tous. Par ailleurs les savants se défient trop de la finalité, faussement étendue au monde physique quoiqu’en pense Lachelier, pour qu’on l’invoque en faveur de cette généralisation. On ne peut légitimer l’induction que grâce au principe d’universel déterminisme ; en assurant que « dans les mêmes circonstances les mêmes causes produisent les mêmes effets », ce dernier permet d’ériger en lois les rapports de succession reconnus essentiels. Pour le savant, qui se refuse à dépasser le monde sensible afin de pénétrer dans la chimérique région des choses-en-soi, la cause n’est d’ailleurs rien d’autre que l’antécédent nécessaire et suffisant du phénomène-effet.
Si le passage de la constatation des faits à l’affirmation des lois s’opère de même façon dans toutes les sciences expérimentales, méthodes et procédés d’observation ou d’expérimentation varient beaucoup selon qu’on étudie la matière inorganique, les manifestations de la vie ou les phénomènes mentaux. Physiciens et chimistes disposent d’une foule d’instruments de précision, souvent enregistreurs automatiques, qui rendent faciles les mesures exactes et ne gardent des phénomènes que les éléments quantitatifs. Aussi ont-ils pu aboutir, fréquemment, à des lois assez parfaites pour être traduites en formules mathématiques. Le biologiste a besoin d’instruments d’un genre différent, microscope et scalpel ; mais la complexité des faits observés lui permet rarement d’arriver à des lois très précises. Botanistes et zoologues doivent s’occuper en outre de classer plantes et animaux d’après leurs caractères essentiels. En psychologie il faut joindre l’introspection interne ou observation par la conscience à la méthode objective ; et l’expérimentation s’avère plus difficile encore qu’en biologie. Sans parier des objections que beaucoup élèvent contre l’idée de loi psychologique. Aussi ne s’étonnera-t-on pas que peu de phénomènes mentaux soient parfaitement expliqués. Quant à la sociologie, dont la statistique sera le procédé le plus fécond, elle trouve d’utiles indications dans l’étude comparée des sociétés de toutes époques et de tous genres, mais l’expérimentation lui reste interdite lorsqu’il s’agit des problèmes vraiment fondamentaux. L’histoire, même devenue scientifique, est une connaissance d’un type très différent. Peut-être parviendra-t-elle dans l’avenir à dégager des lois, mais aujourd’hui elle se borne à reconstituer les faits disparus, en partant des vestiges laissés par eux.
Parler d’expérimentation serait un non sens ; il conviendrait, par contre, que l’histoire cessât d’être au service des prêtres et des dirigeants, pour devenir strictement impartiale. Dans toutes les sciences d’observation des hypothèses générales ou théories, qui visent soit à schématiser seulement les phénomènes, soit à faire connaître leurs vraies causes, résument un ensemble parfois considérable de faits et de lois particulières. Citons l’hypothèse de Laplace en astronomie, celles de l’unité des forces en physique, de l’unité de la matière en chimie, du transformisme en biologie, de l’associationnisme en psychologie. Des découvertes nouvelles conduisent à les remanier, ainsi a-t-on fait de celle de Laplace ; quelquefois à les abandonner presque totalement, c’est le cas pour l’associationnisme. En histoire on cherche à dégager une philosophie ; le matérialisme historique de Karl Marx a le mérite de mettre en lumière l’importance du facteur économique, mais il se trompe en déniant toute valeur aux sentiments et aux idées. La loi des trois états, d’Auguste Comte, est une hypothèse historique plutôt qu’une loi sociologique ; elle offre un très grand intérêt. Si l’histoire n’est pas encore au stade des larges synthèses, j’ai confiance qu’elle y parviendra et qu’un jour nous connaitrons, par elle, le sens du devenir humain. Quant à l’hypothèse d’Einstein (dont il est moins question car on a reconnu qu’elle repose sur une erreur d’expérimentation), à la fois physique et mathématique, elle est un essai de synthèse de l’espace et du temps. Elle mérite de retenir l’attention à ce titre ; quelques-uns de ses arguments gardent aussi leur valeur, lorsqu’il s’agit de la relativité, cette doctrine mi-philosophique, mi-scientifique qui, elle, découle d’incontestables observations.
Mais que valent nos lois les plus certaines, même en physique ou en chimie ? Aucune d’elles, en pratique, n’offre une rigueur totale ; jamais l’application n’est le décalque exact de la formule théorique. Ingénieurs, praticiens, expérimentateurs le savent ; toujours ils laissent une marge pour les causes d’erreurs possibles. Et si du monde inorganique on passe à celui de la vie puis à celui de la pensée, les lois, nous l’avons dit, deviennent de plus en plus imprécises. Pourquoi ? C’est, répondra Bergson, que le devenir est essentiellement créateur, qu’il y a dans le monde constante apparition de nouveauté et que, si notre intelligence peut encore se mouvoir aisément parmi les solides, elle s’avère incapable de comprendre la vie. C’est, prétendra Boutroux, que la réalité, surtout la réalité vivante, reste foncièrement contingente, indéterminée. Nos lois scientifiques indiquent le sens habituel de la succession phénoménale ; comme le lit du fleuve détermine l’écoulement ordinaire de ses eaux ; mais il arrive que la nature échappe au réseau de nos formules, comme parfois le fleuve sort de son lit. D’où les erreurs, constatées si fréquemment par l’expérimentation, dans le domaine de la vie, et plus encore dans celui de la pensée. Contre ces interprétations la majorité des savants s’élève avec vigueur, car une double cause explique parfaitement la marge constatée entre la théorie et son application. D’une part la cause n’est pas simple, les antécédents sont extrêmement nombreux et compliqués, surtout dans le monde organique ; il est donc impossible que nos dosages soient rigoureusement identiques et que la qualité des antécédents reste la même dans tous les cas. D’autre part les sciences expérimentales, et la biologie et la psychologie en particulier, sont à leur début ; des recherches extrêmement longues seront nécessaires avant que nous parvenions à connaître, fut-ce en gros, la cause des principaux phénomènes. La complexité du réel et notre ignorance suffisent à rendre compte de toutes les erreurs d’expérience. Ne constatons-nous pas que plus la science progresse, plus l’imprévisible et l’indéterminé disparaissent : une analyse très poussée permet aussi de réduire l’importance des erreurs possibles. Ces arguments militent de même en faveur du déterminisme universel base essentielle des lois expérimentales. S’il n’est qu’une hypothèse commode, convenons que cette hypothèse acquiert une singulière probabilité du fait que chaque découverte scientifique la confirme. Et nous pouvons dire que le miracle, entendu au sens religieux du mot, est inexistant ; il a sa source dans les lacunes de notre savoir, nullement dans la puissance divine. La foudre, la tempête, dues aux caprices de divinités particulières, étaient des miracles pour les anciens ; la brusque guérison d’un paralytique, le dédoublement de la personnalité l’étaient encore au début du XIXème siècle. Pour quiconque a étudié, ce sont des faits naturels aujourd’hui. Déjà l’on découvre comment s’opère la guérison rapide de certaines maladies organiques ; les phénomènes de télépathie semblent très naturellement possibles, etc. Toute conquête de la science marque un recul pour l’action divine et pour l’intervention des entités de l’au-delà. Un atavisme millénaire rend seul compte de la crédulité sympathique qui accueille les faiseurs de miracles, toujours nombreux dans les religions les plus opposées.
— L. BARBEDETTE
OUVRAGES A CONSULTER.
La Logique, l’Organon (Aristote). La Logique de Port-Royal (Arnauld et Nicole, 1662). La Logique, l’Art de penser (Condillac). Système de logique ; Philos. de Hamilton (St. Mill). Logique (Hegel, 1861). Novum organum (Bacon). Discours de la méthode (Descartes). Recherche de la Vérité (Malebranche). Essai sur l’entendement (Locke). Critique de la Raison pure, Logique (Kant). La Logique d’Aristote (Th. Reid). La Logique (D. de Tracy, 1825). Logique (Bossuet). Essai de logique objective (J. Tissot). Nouveaux essais (Leibniz). Essais de logique (Waddington). Logique (Renouvier). De l’intelligence ; Les Philosophes classiques (H. Taine). De natura syllogismi, du fondement de l’induction (Lachelier). Théorie du jugement, du syllogisme ; etc. (P. Janet et G. Séailles). Logique ; les logiciens contemporains ; Les Définitions géom. et empiriques (Liard). La méthode dans les sciences du raisonnement (Duhamel). Leçons de philosophie, logique (Rabier). La synthèse chimique (Berthelot). La philosophie en France au XIXème siècle (Ravaisson). Logique (Bain). Introduction à la médecine expérimentale (Cl. Bernard). Logique de l’hypothèse (Naville). De l’espèce et de la classification (Agassiz). La philosophie zoologique (Meunier). De la méthode sociologique (Durkheim). La logique de S. Mill ; l’Erreur (Brochard). L’évolution des idées générales (Ribot). Les illusions des sens et de l’esprit (J. Sully). Psychologie du raisonnement (Rignano). L’évolution psychologique du jugement (Th. Ruyssen). etc.
LOGOMACHIE
n. f. (de logos, discours et machê, combat)
La logomachie est une querelle, une dispute de mots, c’est-à-dire sur les mots. C’est, dans l’équivoque, un échange vain de propos à faux qui n’éclairent les questions débattues ni n’enrichissent l’esprit. Cette manière de psittacisme est beaucoup plus fréquente qu’on ne le pense généralement et Proudhon accusait avec raison la philosophie de n’être « souvent qu’une logomachie ».
Les milieux d’avant-garde sont la proie de ces joutes pointilleuses ou désaxées qui piétinent au seuil de la discussion profitable. Les systèmes y sacrifient, comme les individus et la base et le caractère véritables en sont souvent oubliés parmi de fumeuses et stériles controverses. Maints économistes et sociologues sont tombés dans la logomachie... L’impropriété des termes, l’à-peu-près des dénominations, la fantaisie des définitions : autant d’obstacles au progrès des sciences exactes ; et Buffon pouvait dénoncer comme logomachie « ces créations de mots nouveaux à demi-techniques, à demi-métaphysiques, qui ne représentent nettement ni l’effet, ni la cause ».
A une époque où le verbe est tout-puissant et où la démocratie n’est en fait qu’un aréopage de bavards encombrant le forum, la politique ne pouvait manquer de s’annexer ce travers et d’en illustrer ses jongleries.
LOI
n. f. (étymologie présumée : latin lex, legem ; qui se rattacherait à ligare, ce qui lie, lier, plutôt qu’à legere, lire)
La loi est un acte par lequel une puissance quelconque impose à un milieu, quel qu’il soit, des dispositions conformes à sa volonté. Les mots : décret, règlement, ordonnance, constitution, encyclique, etc..., servent à désigner des modalités de la loi.
La croyance en un Dieu tout puissant, créateur du ciel et de la terre, a fait désigner sous le nom de « lois naturelles » les conditions déterminantes des phénomènes qui, sous nos yeux. Se reproduisent invariablement chaque fois que sont réunies les circonstances favorables à leur apparition. Que l’apparition de ces phénomènes ne soit pas due au caprice d’une législateur suprême, mais simplement à des coïncidences toutes physiques, rend quelque peu impropre, en l’occurrence, l’utilisation du mot « loi », mais ne modifie point le résultat, quant à notre situation d’hommes, du jeu des forces dont notre vie est issue, et auxquelles notre existence demeure subordonnée.
Les grandes lois d’évolution des sociétés humaines sont le prolongement et la conséquence, dans le domaine qui nous intéresse, de lois naturelles préexistant à notre apparition sur le globe terrestre, et dont le règne animal eut, avant nous, à supporter les effets. Les instincts de conservation personnelle et de procréation, d’une part, et, d’autre part, la disproportion considérable existant entre notre faculté naturelle d’accroissement et nos possibilités d’augmentation des moyens de subsistance, fut et demeure génératrice de combats meurtriers, d’émigrations et de rivalités de toutes sortes, pour la possession, d’abord, et la conservation ensuite, des meilleurs territoires. L’inégalité des aptitudes devait déterminer, au sein des groupes, des différences de traitement, et favoriser la reconnaissance de chefs, en raison de l’importance exceptionnelle de certains individus pour le salut commun. De l’insuffisance naturelle des biens et de la nécessité de défendre contre les pillards ceux péniblement acquis par la spoliation ou par le travail, est née la propriété, à laquelle ne sont indifférents ni l’hirondelle travailleuse, défendant son nid contre le martinet fainéant son cousin germain, ni le scarabée sacré défendant, contre les congénères sans scrupules, la pilule qu’il s’évertue à parfaire. La féroce lutte dont les grandes cités sont le théâtre, et qui ont pour objet, non seulement le bien-être et la sécurité matérielle, mais encore la satisfaction de besoins de luxe toujours plus nombreux et l’exemption des travaux exténuants, est la continuation, avec des mobiles plus complexes, de celle qui, dans la forêt primitive, faisait s’entredéchirer les mâles pour la saillie des femelles, ou le rapt des morceaux les plus savoureux, et dont la jungle nous fournit le spectacle. La loi individuelle du plus fort par les muscles, ou du plus habile en stratagèmes, a été dépassée par l’organisation collective en vue de l’application de la loi écrite due, tantôt à l’autorité d’un seul agréé par le nombre, tantôt à l’initiative de minorités dirigeantes, en vue de la conservation de l’ordre établi, et de la défense de certains privilèges, dans les associations de plus en plus nombreuses où, il faut le reconnaître, le rationnel tend à se substituer progressivement, dans tous les domaines, à l’arbitraire aveugle et tyrannique, sous la pression des agitateurs et des philosophes, sans que, pourtant, le combat pour la vie, avec ses inévitables suites, ait disparu de la scène du monde.
Quelles que soient ses conceptions morales, ce n’est que dans la mesure où l’humanité acquiert, par le développement des sciences appliquées, la possibilité de se soustraire à la fatalité des lois naturelles, et de les faire servir à ses desseins, qu’il lui devient loisible de s’organiser sur d’autres bases, de se débarrasser de certaines tares, et de fournir à ses aspirations idéalistes des solutions pratiques.
Sans la connaissance des lois de la reproduction humaine, et l’invention des procédés qui permettent à la femme de limiter sa progéniture ; sans la tendance naturelle des humains les plus éclairés à opérer, d’eux-mêmes, cette limitation, l’espoir d’une paix universelle ne serait qu’une utopie généreuse. Car, si le règne de la loi du plus fort entre les nations avec, pour sanction, la puissance des armes, ne peut disparaître, en fait, de manière définitive, qu’à la condition que soit abandonné le système de la production capitaliste privée, génératrice de conflits, il n’en demeure pas moins que la condition primordiale, pour la persistance d’un tel résultat, est que l’augmentation de la population, au sein des nations associées, ne dépasse jamais les ressources alimentaires acquises par elles. S’il n’est pas très difficile, en effet, de disposer à l’harmonie des consommateurs autour d’une table d’hôte copieusement servie, il serait chimérique d’espérer obtenir des mêmes gens, qu’ils se sacrifiassent volontairement au profit du voisin, sur quelque radeau de « La Méduse ».
L’abandon de toute législation ou, ce qui est tout un, de toute contrainte, sous une forme quelconque, à l’égard de la production et de la consommation ; l’application de la formule communiste intégrale : « De chacun selon ses forces, à chacun suivant ses besoins », supposent, préalablement réalisées, deux conditions essentielles : d’abord une surabondance telle des produits de toute sorte qu’il puisse être fourni, sans rationnement ni réserves, à des demandes sans limitation ; ensuite, un progrès industriel suffisant pour que cette surabondance puisse être, d’une façon permanente, entretenue sans qu’il soit nécessaire d’exiger des citoyens plus que la tâche qu’ils sont disposés à remplir bénévolement.
L’abandon de toute législation, comme de toute sanction, sous une forme quelconque, à l’égard des actes de violence, ou d’intolérance, envers autrui, suppose une adhésion quasi universelle à l’ordre nouveau ou, du moins, une suffisante rareté dans les attentats, pour que la sécurité publique, c’est-à-dire la persistance de l’ordre nouveau, n’en soit point gravement compromise. Que, dans ces divers domaines, l’une quelconque de ces conditions essentielles ne soit point réalisée, et c’est à nouveau, inévitablement, sous une forme quelconque, le retour à des conflits, à des luttes finalement à l’autorité du plus fort, en raison de cette loi naturelle, physiologique, qui fait que les organismes sociaux, de même que les corps vivants, réagissent toujours, par instinct de conservation, contre les éléments de désagrégation et de mort surgis en eux, et ne cessent de réagir, sous peine de mort pour eux-mêmes, que lorsque ces éléments destructeurs ont été expulsés, anéantis, ou réduits à l’impuissance, par un moyen plus ou moins brutal ou bénin.
Que ces conditions soient réalisées, ce qui peut nous reporter à une échéance lointaine, mais non illusoire cependant — le progrès humain ayant, depuis l’âge des cavernes, réalisé bien d’autres merveilles ! — et l’humanité se trouvera libérée des principales entraves qui nuisaient à son bonheur et retardaient sa marche. Il ne restera plus aux humains que l’obligation, dans leurs accords en vue de l’hygiène de l’espèce, et d’une production collective aux exigences de plus en plus réduites, de se conformer à un petit nombre de règles biologiques, justifiées par l’expérience et consacrées par la nécessité.
— Jean MARESTAN
LOI
A) Loi naturelle.
Prenons un exemple classique : je place sur la paume de ma main une pierre ; je retourne ma main, la pierre tombe. Autant de fois, je répéterai cette expérience, autant de fois la pierre tombera. Je conclus de mes constatations que la pierre, en tombant, obéit à une loi, à une loi de la nature.
Toute cause permanente ou identique produit des effets identiques ; le mot loi exprime en ce cas la nécessité de cette genèse, et je sens bien que l’équilibre du système auquel je suis assujetti exige l’invariabilité du phénomène : l’effet doit se produire quand la cause se renouvelle ou persiste. Si la pierre livrée à elle-même ne tombait pas, le satellite ne serait plus asservi à la planète, l’attraction des masses et la gravitation des mondes seraient déréglées.
Il est très important de ne point se laisser prendre à de vaines apparences, quand on prétend codifier les lois naturelles. En 1846, 56, 66 la Loire a débordé. Maintes gens ont prétendu qu’elle sortait constitutionnellement de son lit tous les dix ans. Ils s’étaient trop hâtés d’admettre la constance de l’événement. Il faut, en outre, rattacher à leur véritable cause les effets observés. La balle n’est point projetée hors du fusil, parce que le percuteur a frappé la douille, cette cause ne serait pas suffisante, mais parce que cette percussion a fait jaillir l’étincelle qui a enflammé le fulminate et la force de propulsion est produite par l’expansion des gaz. La balle qui sort du fusil obéit à la loi de la dilatation, l’inventeur de l’outil a eu recours à cette loi mystérieuse que décèle l’observation : le choc, c’est-à-dire le mouvement contrarié engendre la chaleur, symptôme d’un travail moléculaire qui peut aller jusqu’à la combustion.
Dire que la nature a des lois, ce n’est pas dire qu’elle a eu un législateur en la personne d’un créateur omnipotent ni qu’elle soit à elle-même son propre législateur, ni qu’elle soit un créateur indépendant. Je m’explique. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Cette discipline contente notre idée d’ordre et satisfait notre raison. Nous en concluons qu’un être doué de raison a organisé, a sérié, a relié cette gamme naturelle. Mais il peut très bien se faire que les choses soient ainsi parce qu’elles sont ainsi, ce qui leur a permis d’être. Les icebergs qui dérivent dans le détroit de Behring n’ont pas eu d’architectes, et leur vague ressemblance avec des édifices leur donne seule à nos yeux une particularité qui nous les signale comme plus remarquables qu’un champ de glaçons disloqués. Lorsque la terre incandescente s’est refroidie et a pris de la consistance, la vie est devenue possible à sa surface et la vie y est apparue. Mais ce n’est point pour que la vie s’y montrât, pour que l’homme s’y levât, qu’une main éternelle (puérile et grossière image!) a refroidi la nébuleuse en fusion.
La vérité c’est que la science, de jour en jour davantage, nous montre l’erreur où nous tombons quand nous imaginons la matière dense, compacte, continue. La matière, ainsi comprise, n’existe pas. Il n’y a que des systèmes stellaires d’atomes, soumis à la gravitation dans des cycles distincts. Les forces différentes que nous connaissons dans notre monde ou dans le monde sont les apparences diverses sous lesquelles se manifeste à nous une force unique, quand sa condition change ou quand son intensité se modifie. Les découvertes les plus récentes permettent de croire que les rayons lumineux sont des rayons X amortis, atténués, et devenus perceptibles pour notre œil ; les vibrations du son n’influencent plus notre oreille, quand elles dépassent une certaine fréquence ; les ondulations de la lumière n’influenceraient plus notre rétine, au-delà d’une certaine puissance. Nous savons que l’énergie arrêtée dans son mouvement, contrariée, refoulée produit la chaleur. Il est permis de penser qu’une force dégagée par la brusque abolition ou la transformation soudaine d’un système moléculaire, traverse et bouleverse de proche en proche d’autres systèmes moléculaires et que ce frissonnement qui se propage est l’électricité. Mais ce qui est la force unique, essentielle, nous n’en savons rien. Elle existe... Que parlons-nous de création ? Toute force ou toute source de force ne peut être engendrée ou constituée que par une force, ce qui recule l’origine de la force vers l’infini.
Ne nous laissons pas abuser par cette idolâtrie grandiose qui élève la nature au rang d’une bête fabuleuse et la consacre comme une divinité de fait. On enseignait, il n’y a pas cent ans, que la nature avait horreur du vide, et ainsi, commodément, on expliquait ce que devait amener à comprendre la théorie des pressions. Refusons-nous à un panthéisme religiosâtre. La nature n’est pas cette gigantesque marmotte en boule qui, digérant les Univers dans son ventre, aurait un instinct à défaut d’un esprit et créerait ses lois au rythme de son souffle.
Le mot loi, quand il désigne la loi naturelle, ne doit avoir qu’un sens : ce mot exprime que la relation d’une cause a avec ses effets m, n, r, etc. reste constante lorsque la cause subsiste ou se renouvelle. Pour le mot loi dont nous nous servons, nous indiquons que dans l’enchaînement des phénomènes nous savons discerner la cause de l’effet, nous proclamons que le plan de la réalité matérielle est conforme au plan mathématique de notre intelligence et que la déduction qui s’opère : l’effet engendré par la cause, était obligée, nécessaire.
B) Loi artificielle, loi écrite.
La loi de la nature, avons-nous dit, est indispensable au maintien, à l’équilibre d’un système, le système auquel l’existence nous assujettit. Sans doute, nous nous sommes adaptés aux conditions matérielles dans lesquelles nous sommes obligés de vivre, mais il n’est pas douteux que notre existence serait impossible, et la vie telle, du moins, que nous la concevons de tous les êtres également si les lois naturelles n’existaient plus. Supposons abolie la loi que nous appelons loi de l’attraction, l’air ne serait plus maintenu à la surface du globe, nous ne serions plus adhérents au sol, et nous ne serions plus même des corps constitués puisque les molécules de notre corps ne seraient plus associées, puisque le sang qui ne serait plus du sang, ne serait plus contenu dans nos artères évanouies.
La loi artificielle, la loi fabriquée par l’homme, devrait être semblable à la loi naturelle. Nulle loi ne peut être excusable ou ne peut sembler légitime que si elle est nécessaire au maintien, à l’équilibre du système vital qui permet à l’individu de subsister au milieu de ses congénères.
L’esprit public est imprégné de cette idée que la loi est un bien. La loi est un mal, car toute loi restreint la liberté. « La loi n’atteint la licence qu’en frappant la liberté ». Qui a dit cela ? Un révolutionnaire ? Pas précisément. L’auteur de cette pensée est celui qui, à la formule célèbre de Danton : « l’audace, et puis l’audace et encore l’audace » opposait cette devise : « la justice, et puis la justice et encore la justice ». Ce téméraire tribun s’appelait Royer-Collard. Sa sentence qui frappe au front, la loi n’a pas jailli d’un nuage orageux : elle a brillé comme une lueur d’aurore sur les pentes d’un génie moyen couvert de lauriers un peu fanés, mais que le vernis de l’histoire empêchera longtemps de se flétrir.
Voyons comment s’est formée la loi (Voir droit, code, légalité, législation, justice, etc.). Le droit primordial de l’homme, c’est le droit à la vie. Le devoir primaire de l’homme envers lui-même, c’est de défendre et de protéger son existence.
On a dit qu’il fallait vivre d’abord, philosopher ensuite : « primum vivere, deinde philosophari ». Nous dirons, en modifiant cet adage bien connu : vivre d’abord, c’est le principe essentiel de la philosophie ; c’est l’axiome du droit individuel et du droit social.
Imaginons un paysage biblique. Un homme se dresse sous les cieux resplendissants mais impassibles, dans une plaine luxuriante mais sauvage et inculte. Les cratères en éruption s’empanachent au-dessus de sa tête. Eperdu d’effroi à l’idée de son isolement, tremblant d’angoisse à la vue de son péril, il se nourrit de racines et se protège contre les éléments. Le soleil neuf est ardent, l’homme veut boire...
Près de la source où il va se désaltérer, un autre homme, son semblable a surgi. La source murmurante occupe un étroit entonnoir... Si le trou d’eau, comme disent les explorateurs, n’est ni assez large ni assez riche pour se prêter au désir des deux bouches qui veulent humer l’onde bienfaisante, rien n’y fera. Le plus fort des deux compétiteurs tuera le plus faible, ou le plus agile le moins leste. Le vainqueur boira, courbé sur le cadavre du vaincu.
Mais que l’eau soit accessible et d’un débit suffisant, part à deux ! Primus, pour parler le langage juridique, prend conscience de cette vérité élémentaire : que son droit à la vie peut marcher de pair avec le droit identique de Secundus. Primus et Secundus boiront ensemble ou l’un après l’autre. L’accord s’établit, ou le compromis se réalise.
Peu à peu, notre clairière édénique se peuple de colons involontaires ; ils n’ont pas demandé à venir au monde : ils sont nés cependant. Si l’un d’eux est plus faible ou malingre, il peut être sacrifié ; l’audace et la convoitise rompront à son détriment l’équité. Mais un clan se forme. Le disgracié, le déshérité de naissance trouve des défenseurs parmi ses compagnons de la prairie. Ces protecteurs égoïstes redoutent pour eux-mêmes la contagion du mauvais exemple, la prédominance de la force brutale, sur la notion du partage ou de la jouissance collective. Ils se font les défenseurs du droit individuel pour le salut du droit commun.
La présence des femmes et la survenance des enfants compliquent la question sociale primitive. Les femmes, qui doit les défendre, et qui doit les posséder ?
Un fait est certain : pour tous les biens, dont le principal est l’aliment, les appétits doivent être réfrénés, s’ils ne peuvent se débrider en même temps ; ils doivent se tempérer ou se restreindre quand devient plus rare ou moins facilement accessible la « masse » nécessaire aux besoins de tous. Et quand un bien est affecté au besoin d’un individu, ce bien appartient à cet individu. Ainsi se dégage le principe de la propriété dont la notion est donnée à l’homme par la possession de son corps.
C’est sur ces assises primitives que s’est formée la loi ; l’équité réside dans l’exactitude avec laquelle la restriction imposée, ou acceptée, correspond à la nécessité de sauvegarder le droit identique du voisin ; la morale consiste dans la reconnaissance spontanée et dans l’observation bénévole de l’équité. Le monde ancien a vécu de cette morale dont le symbole est une équation : l’équation des droits, et qui se résume en deux formules : « il ne faut pas entamer injustement le droit d’autrui » « neminem lœdere » ; que chacun soit maître de ce qui lui appartient et reçoive ce qui lui revient « suum cuique tribuere ». Et les civilisations rudimentaires ou primitives ont sanctionné la loi de justice par un châtiment fondé sur l’équivalence de la pénalité ou de la réparation avec le dommage.
La loi romaine des douze tables taillait dans le débiteur vivant une livre de chair en représentation du poids de numéraire non payé, et l’ancien droit pénal, pour employer ces mots modernes qui s’appliquent mal aux époques reculées, a connu la peine du talion, cette vindicte qui subsiste encore dans l’usage oriental et ne semble devoir s’y dissoudre qu’à la longue :
Le cadre de cette étude nous restreint. Nous ne saurions exposer ici, nous mentionnons seulement que le Christianisme a tenté de fonder une morale sur une idée nouvelle. Cette idée que la Cité antique ne pouvait concevoir, c’est l’amour du prochain ; un tel altruisme suppose le sacrifice joyeux spontané, tout ce que le désir de faire le bonheur ou d’apaiser la souffrance peut mettre d’abnégation et d’élan dans ce mot dont la doctrine épurée prétendait rajeunir l’étymologie grecque : le mot de Charité.
* * *
La loi fixe la règle ; la loi opère sur les ambitions une compression, impose aux appétits une restriction, conditionne le droit individuel afin d’assurer l’exercice du droit collectif, ou afin de permettre à tous les individus l’usage suffisant de leur droit particulier.
Mais qui fera la loi ? Qui discernera dans quelle mesure et de quelle manière la compression doit se produire, la restriction être imposée ? Car la loi ne peut sortir automatiquement de la nécessité sociale. La machine sociale ne règle pas elle-même l’introduction ou l’expulsion de la vapeur, comme ces mécaniques modernes qui assurent par leurs propres organes le libre jeu nécessaire à leur rendement.
C’est à ce point que la loi artificielle, oscillant entre ces deux pôles : le bon plaisir et le bon sens, bifurque et se sépare nettement de la loi naturelle, ou loi de la nature. Quelles que soient les révolutions qu’aient subies les nations, les constitutions gouvernementales se ramènent et se ramèneront toujours à trois types : la monarchie, l’aristocratie ou oligarchie, la démocratie. Montesquieu, sur ce sujet, et pour cette classification, se rencontre avec Aristote.
Dans une analyse qui a pour thème le mot : loi, on s’étonnerait que Montesquieu ne fût pas nommé, que l’Esprit des lois ne fût pas cité.
L’Esprit des lois est une œuvre considérable, qui est assurée d’une gloire éternelle. Cet heureux destin se perpétue pour les ouvrages consacrés, que les bibliothèques opulentes ou simplement traditionnalistes se doivent à elles-mêmes d’accueillir, mais qu’une main fervente ou fureteuse ne vient plus troubler dans la paix définitive de leur asile.
L’Esprit des Lois est une œuvre dont la trame est forte, mais brochée de soies très disparates, où les considérations anecdotiques traversent la thèse doctrinale. Vous apprendrez que les Tartares étaient obligés de mettre leur nom sur leurs flèches, afin que l’on connût la main qui les lança, et ce chapitre est intitulé : « Des lettres anonymes ». L’auteur vous entretiendra de Gelon, roi de Syracuse, et des Bactriens « qui faisaient manger leurs pères vieux à de grands chiens » avant d’écrire ces chapitres imposants et graves qui ont pour titre : « Combien il faut être attentif à ne point changer l’esprit général d’une nation » (thèse discutable), ou bien encore : « De la tolérance en fait de religion » (sujet périlleux pour l’époque et trop prudemment abordé). Dans l’Esprit des lois on peut reconnaître à la curiosité de son esprit personnel l’auteur des « Lettres persanes ». Le goût de l’érudition exotique bariole ce classique traité, la fantaisie plante des panaches inattendus sur la masse sévère du monument.
Combien Aristote est plus simple, plus beau, moins varié mais plus complet dans sa Politique ! Quelle surprise de constater que la politique, en tant que science sociale, ait si peu changé depuis qu’il y a des hommes, et qui oppriment !
Il va de soi que, sous tous les régimes, où le pouvoir est centralisé entre les mains d’un maître ou d’une caste, le fait du prince, pour parler comme les juristes, se rapproche de l’arbitraire. La loi favorise des privilégiés ou une classe de privilégiés, et pour voiler sa tyrannie ou dissimuler son exaction, elle se réclame hypocritement de l’intérêt public. Elle sacrifie des droits individuels, non pour assurer l’équitable répartition de la liberté entre tous les citoyens, mais pour frustrer le nombre au profit de bénéficiaires qui cumulent. Elle fait une fixation frauduleuse de la réduction à opérer sur la liberté plénière sous prétexte de conférer à chaque ayant droit son prorata de liberté. Elle fait une banqueroute perpétuelle, mais muscle ses créanciers. Le seul contrepoids qui modère la tyrannie et l’arrête dans son audace, c’est la crainte de la révolution qui jetterait bas la pyramide au sommet de laquelle trône la tyrannie. Contre l’excès avéré de la loi, la résistance est un devoir ; il importe seulement de ne pas se tromper quand on prétend que dans sa balance la légalité a mis de faux poids, qu’elle a fait pencher le plateau vers le favoritisme au détriment du droit populaire. Tous les Gouvernements déloyaux se sont réclamés de l’ordre public, quand ce n’était pas de l’ordre moral, et toutes les scélératesses royales, impériales ou dictatoriales ont été baignées de douces larmes : « le prince » s’attendrissait en songeant au sacrifice salutaire qu’il allait offrir sur l’autel de la Loi à la cause de l’ordre et à la religion du bien public.
Il ne faut pas croire que les démocraties n’aient pas aussi leur tyrannie. Leur formule : « tous pour un, un pour tous » ne garantit pas l’homme libre contre la pire des servitudes : celle qui peut l’enchaîner à l’Etat. La lecture de l’histoire romaine m’a enlevé tout regret de n’avoir pas vécu à l’époque la plus brillante des Quirites, au plus beau temps des consuls. Un frisson m’agite comme au sortir d’un songe, lorsque je vois combien était entière et intraitable cette « res publica », dans quel esclavage cette entité collective, formidable et sacrée, faisait vivre les citoyens. Elle faisait bon marché de leur vie. Eternelle, massive, écrasant sous sa roue ardente tous les obstacles, elle était un de ces chars augustes qui se préoccupent peu des êtres qu’ils portent. Le char divinisé sacrifiait tout à sa solidité, à sa splendeur et à sa route. La République, entité idéale, avait un intérêt supérieur, préférable à l’intérêt de la collectivité qui la composait. Les hommes, de nos jours, admettent encore cette fiction monstrueuse de l’Etat, Moloch impersonnel, statue creuse, statue d’airain pareille à ces idoles qu’on remplit de victimes. Louis XIV disait au moins, en despote : « l’Etat c’est moi » ; nous disons : « l’Etat c’est nous », mais nous faisons de l’Etat une carapace distincte de nous, et dont notre chair meurtrie doit épouser la rigueur. Il y a toujours quelqu’un pour exiger que cette armure soit renforcée. Nous demandons en soupirant ou en gémissant : quel Dieu le veut ? Il y a toujours un oracle pour répondre : l’intérêt public. C’est bientôt dit. Et l’étui se blinde et l’étreinte se resserre. Pour ce traître travail, il se trouve toujours un ingénieur bien outillé, des auxiliaires commodément installés, des spéculateurs, des arrivistes. Ici un rivet, là une bande d’acier : c’est bientôt fait.
Lorsque l’autorité entreprend de fabriquer à sa manière et par ses moyens le bonheur du peuple, elle a le choix entre deux systèmes : trancher ou concilier. Elle a rarement le courage d’aiguiser sa hache et d’abattre des chênes pour ouvrir une éclaircie. Elle ménage l’arbre et la liane. Quand les intérêts s’affrontent se heurtent et menacent de s’effondrer en se ruinant les uns par les autres, la loi se multiplie, incohérente, hâtive, innovatrice, contradictoire, parfois inapplicable. On voit alors les partisans de la liberté se chercher, essayer de se joindre et de s’unir pour former un Etat dans l’Etat.
Si les mœurs influent sur les lois et les lois sur les mœurs, c’est que la loi légitime devrait sortir du consentement de tous ceux qui sont appelés à s’y soumettre, connaissance prise des intérêts à satisfaire et du retranchement à subir par contribution. Cette délibération collective, cette consultation permanente sont impossibles. Le législateur légifère. Les mœurs s’adaptent à la loi, c’est-à-dire que la collectivité intéressée se plie avec souplesse à la réforme acquise. Les mœurs, au contraire, modifiées par l’expérience, par le déclin d’une croyance, par le succès d’une invention, par la nécessité de la vie courante, par la péremption des usages peuvent provoquer l’avènement de la loi : c’est qu’une atmosphère s’est créée à laquelle le législateur a été sensible. Il a été averti d’une discordance entre le désir ou la récrimination des intérêts en malaise, et le statut ancien qui s’est trouvé soudain les desservir. Le système du suffrage universel aboutit à l’élection d’un mandataire auquel ses mandants font confiance sur le vu de sa couleur et qui, pour le renouvellement de son mandat se tient en communion d’idées ou de tendances avec ses électeurs les plus puissants ou les plus nombreux. A notre époque, le peuple se flatte facilement d’être souverain alors qu’il est dominé par le capitalisme et maté par la finance. Volontiers il se satisfait des ballons rouges que ses représentants légaux gonflent à son intention et lui mettent en mains au bout d’une ficelle, comme des articles de réclame. Il se laisse séduire par la rondeur de l’objet que la ploutocratie saura dégonfler à coups d’épingles. Il admire le vermillon qui fait reluire son jouet : cette couleur lui est chère. Ces ingénieux aérostats qui tendent vers le ciel et semblent vouloir le conquérir sont fabriqués en série par la Chambre lorsque, périodiquement, elle arrive à son déclin. Jamais les mœurs électorales n’ont eu plus d’influence sur la loi !
* * *
La loi a eu beaucoup de peine à devenir une et indivisible, comme la République, à réunir sous son faisceau digne des licteurs tous les sujets d’un même Etat. C’est que la diversité des climats, des traditions, des habitudes et des besoins crée dans un pays qui, politiquement, constitue une patrie, des intérêts différents ou même contraires. Au mot « Droit » nous avons exposé brièvement la genèse de la Loi, nous avons montré que la loi avait été formée par l’amalgame des coutumes propres à chaque province, ou, en cas de conflit, par la prédominance accordée aux unes sur les autres. La Loi est sortie, armée et casquée, du génie de la Révolution. Son empire a été dessiné par le Tribunat et consacré par Napoléon Ier.
Au fur et à mesure que le monde se civilise, que la pénétration réciproque des Etats augmente, que leurs communications se multiplient et se perfectionnent, les Etats, comme jadis les provinces, éprouvent le besoin de régler leurs rapports et ceux de leurs nationaux avec les étrangers, ou vice-versa, par une législation internationale. Nous voyons se développer deux Droits internationaux : le Droit international public qui règle les rapports des nations entre elles, le Droit international privé qui détermine les principes d’après lesquels certains actes passés dans un pays peuvent être considérés comme valables par les autorités d’un autre pays, et qui fixent la condition civile d’un étranger dans le pays où il passe, séjourne ou s’établit. Nous réduisons la question à sa plus simple expression,
Le plus ancien droit international semble bien avoir été constitué par les lois de la guerre — triste origine — et par les règles admises pour la navigation.
Peu à peu, sous la pression des nécessités économiques, les Etats se sont mis d’accord par des conventions au moins partielles sinon universelles pour les tarifs du télégraphe et de la poste, pour les tarifs douaniers, des traités interviennent de puissance à puissance. Des traités ou des conventions, surtout celles de la Haye, ont ouvert aux ressortissants des puissances contractantes la libre pratique des tribunaux institués par l’une ou par l’autre.
L’étranger hors de son pays conserve la condition civile que sa nationalité lui confère, ce qu’on appelle son statut personnel. Exemple : un Italien épouse une Française qui devient Italienne par son mariage et il se fixe en France. Sa femme l’actionne en divorce. L’action est irrecevable, car la loi du défendeur n’admet pas le divorce.
Nous ne ferons qu’effleurer ce vaste sujet. Le système métrique sera plus facilement généralisé que le Code international complet, forgé, approuvé, édicté. La diversité des races s’opposera-t-elle longtemps à l’adoption d’une langue universelle ?
La loi réduite au minimum, par l’exercice conscient et raisonné de la liberté, l’internationalisation des peuples, l’espacement des frontières par la pénétration réciproque des intérêts correspondants ; voilà un bref résumé pour une étude!... Voilà un magnifique programme pour des siècles de lutte, de foi, de ferveur..., de persécution et de progrès.
— Paul MOREL
LOI
a) LOIS NATURELLES
L’établissement des lois naturelles par l’homme représente une évolution remarquable de l’intelligence humaine se libérant de l’explication mystique primitive pour se rapprocher de l’explication déterministe basée sur l’observation et l’expérience.
Par lois naturelles nous devons entendre la connaissance exacte des rapports invariables et précis se succédant dans un ordre inéluctable entre les différents aspects des choses impressionnant notre subjectivité.
Cet ordre et cette invariabilité étant niés par certains philosophes, il est nécessaire de savoir comment on peut affirmer ou nier l’existence de ces lois et en quoi consiste la connaissance proprement dite.
Connaître quelque chose c’est se faire de ce quelque chose une représentation, une image ou une série d’images dans l’espace et dans le temps. Toute image dans l’espace et dans le temps repose sur une sensation ou plutôt sur un ensemble de sensations, lesquelles, simultanées ou successives, ont précisément pour résultat de créer en nous les idées d’étendue et de mouvement. Otons de notre sensibilité toutes les sensations et notre connaissance sera nulle. Si donc nous entendons par connaissance toutes sensations perçues par la conscience et si nous ne pouvons supposer, ni imaginer une autre sorte de connaissance, nous sommes bien obligés d’admettre que l’affirmation ou la négation des lois naturelles repose sur le sens particulier que nous donnons au mot connaître qui peut tantôt signifier les représentations sensuelles, tantôt indiquer une représentation psychique de l’objectif hors de toute sensation. Ce qui constitue la recherche stérile de la chose en soi, sorte de casse-tête et de passe-temps métaphysique issus de l’ignorance et du verbalisme pur.
En effet la recherche de la chose en soi peut se comprendre, soit comme la représentation ultime des choses hors de l’étendue et de la divisibilité, hors des rythmes et des vibrations, c’est-à-dire hors de l’espace et du temps qui sont des données essentiellement sensibles, et on se demande ce qu’une telle représentation peut signifier pour l’intelligence humaine ; soit comme une représentation sensuelle, une attribution des modalités synthétiques de l’objectif sensuel à l’extra-sensuel analytique et insaisissable.
Ces deux conceptions aboutissent à deux absurdités manifestes. La première vient de l’impossibilité de sortir de soi-même et de séparer de nos représentations l’élément sensuel ou image, ce qui reviendrait à faire de l’imagination sans image. La deuxième vient de cette proposition qui suppose que le tout est semblable à la partie, les corps synthétiques égaux à leurs éléments analytiques ; ce qui égale l’affirmation que chaque cellule du corps humain ressemble à un homme.
Si nous voulons alors comprendre la nature de notre connaissance sensuelle et ce que l’on peut entendre par réalité et même par explication, nous devons chercher tout d’abord ce qu’est la vie elle-même, car la vie précède toute connaissance et toute explication.
L’observation d’un œuf vivant nous montre ce germe formé d’éléments chimiques connus empruntés au milieu, soumis aux mêmes phénomènes physico-chimiques que tous les autres corps, mais réagissant selon les caractéristiques de toute matière vivante qui est l’assimilation et l’accroissement. Chaque cellule vivante possède sa formule chimique et son ou ses rythmes, ses résonances, lesquelles conquièrent, lorsqu’elles le peuvent, les autres substances susceptibles de vibrer selon leurs propres modalités et, modifiées à leur tour par cette assimilation, se trouvent en équilibre avec les autres phénomènes physico-chimiques du milieu ambiant. Ce milieu n’étant nullement homogène mais, au contraire, hétérogène, présente des conditions d’existence très variables, parfois opposées au fonctionnement vital et à sa durée. Nous voyons qu’entre la substance vivante et le milieu il y a une étroite dépendance puisque l’être vivant est formé de la substance et de l’énergie de ce milieu, qu’il en subit tous les phénomènes et se comporte comme un transformateur de substance et d’énergie. Nous pouvons admettre même que les sensations viennent uniquement de l’influence du milieu sur l’être vivant et que les sens correspondent à une réaction spéciale de la substance vivante déterminée par un état particulier du milieu objectif. Nos sens ont donc été créés par le milieu et leur diversité indique la diversité des phénomènes objectifs.
Les variations du milieu influent donc inévitablement sur l’être vivant, accélérant son rythme, le ralentissant ou le détruisant. Tout être vivant actuel est le descendant d’ancêtres dont les réactions ont été favorables à leur conservation, à côté de maintes autres réactions fatales à d’autres espèces ou individus.
La sélection est donc le résultat final de ces rythmes qui se heurtent, s’harmonisent ou se détruisent, ne laissant précisément subsister que ceux dont les successives modifications ont rendu la coexistence possible. Il ne faut pas entendre autrement l’adaptation sous peine de tomber dans un finalisme spiritualiste et mystique.
Tout être vivant lutte donc sans arrêt et, lorsqu’il ne meurt pas immédiatement, conserve les traces, les souvenirs de ses luttes ou de ses victoires. Ces souvenirs représentent les variations du milieu et les réactions particulières du survivant. Chaque variation du milieu, bonne ou mauvaise, ne se présente jamais brutalement mais avec une intensité et une durée variables, de telle sorte que les souvenirs antérieurs, liés les uns aux autres et mis en action par les phénomènes objectifs, déclenchent l’action compatible avec la conservation de la vie. Comme celle-ci est la résultante précisément de cette double action du milieu sur l’individu et de l’individu sur le milieu, créant une suite ininterrompue d’équilibres et de déséquilibres, nous voyons qu’il est absolument nécessaire, pour que les réactions de l’être vivant soient favorables à sa conservation, que les variations du milieu correspondent à des variations connues antérieurement ou peu différentes. Toute variation, même nouvelle, contient donc une part de connu déterminant une réaction pouvant être en équilibre ou en déséquilibre plus ou moins néfaste avec la part d’inconnu ; il peut en résulter une modification avantageuse ou nuisible, mais si toutes les variations objectives se présentaient de telle sorte qu’elles ne pussent correspondre à aucun souvenir, à aucune classification connue dans l’espace et dans le temps, la vie serait impossible par difficulté d’adaptation de l’être vivant au milieu.
Cet exposé rapide nous fait voir que nous ne sommes vivants que parce que les variations du milieu présentent une certaine constance dans l’espace et dans le temps.
C’est uniquement cette constance qui pour nous constitue la réalité. Qu’il s’agisse de la substance elle-même classée en corps simples ou de ses modifications engendrant des phénomènes physico-chimiques, nous cherchons toujours à retrouver, pour affirmer un fait, une constance, une ressemblance, un souvenir rattachant ou identifiant le fait présent au fait antérieur.
L’ordre, la régularité, la succession, la durée, la nature des phénomènes se sont imposés aux êtres vivants, les ont déterminés et façonnés de telle sorte que les survivants des réactions ancestrales portent dans leur système nerveux les seules réactions en équilibre avec ces phénomènes, ce qui constitue la connaissance du milieu. L’évolution cérébrale de l’homme s’effectuant surtout vers le développement des facultés associatives et abstractives, cette particularité psychique s’est caractérisée chez lui par des représentations symboliques de cette constance dans l’espace et dans le temps. Les lois naturelles sont donc des représentations symboliques déterminées par la constance des phénomènes objectifs s’imposant à tous les êtres vivants. Comme nous savons que nos sens correspondent à des états différents de l’objectif, nous recherchons dans chaque canton sensuel cette constance favorable à notre adaptation et notre curiosité — issue de la nécessité de projeter les représentations du passé dans le présent et d’en imaginer l’avenir pour lutter contre le soudain — nous fait étendre les divers rapports de chaque canton sensuel aux autres cantons pour trouver entre eux une relation, un lien logique satisfaisant notre désir d’explication. Celui-ci apparaît donc comme une nécessité psychique de décomposer les synthèses sensuelles fournies par nos sens pour en connaître les éléments sensuels particuliers et leur ordre de groupement et de succession, en supposant que la dernière analyse nous donnera une constance dans l’espace (représentation qualitative de la chose analysée) et dans le temps (représentation dynamique d’ordre et de mouvement). Expliquer quelque chose, c’est en somme faire connaître les différentes qualités des éléments composant cette chose (en les comparant à des éléments déjà connus) et l’ordre, l’agencement, le dynamisme particulier de ces éléments se comportant selon des mécanismes également connus. De la succession de deux faits, de l’antériorité de l’un et de la postériorité de l’autre, nous déduisons les relations de causalité et d’effet, lesquelles engendrent inévitablement, par là réversibilité des faits, les concepts d’équivalence et de conservation ou de constance des éléments constituant les faits. S’il n’en était ainsi, si l’effet ne se proportionnait, ni ne se relativisait point à la cause, rien ne nous paraîtrait cohérent dans l’univers et tout y serait imprévisible et chaotique. Le concept d’équivalence s’impose donc de lui-même et nous pouvons dire que la mentalité humaine issue du fonctionnement des choses n’est qu’une résonance subjective des phénomènes objectifs. Nous n’inventons ni lois naturelles, ni raisonnement, ni logique, ni mathématique, car toutes ces choses se trouvent incluses dans les rapports des éléments entre eux et nous ne faisons que les constater et les découvrir par l’expérience et l’observation.
On peut alors se demander, s’il en est ainsi, pour quelles raisons l’explication mystique a précédé l’explication objective et même pourquoi celle-ci ne s’est pas uniquement imposée à l’entendement humain. La cause de cette interprétation erronée des faits paraît provenir de la faculté d’analyse intérieure fournie par la conscience, laquelle ne nous fait rien connaître des causes antérieures subjectives ou objectives déterminant nos vouloirs. Ceux-ci nous apparaissent alors hors du déterminisme objectif. Les conséquences de cette analyse introspective et consciente sont considérables, car l’absence de nécessité déterminante et la constatation d’actes volontaires apparemment inexplicables ont imprimé aux premières explications abstraites, dépassant le cadre immédiat de l’expérience vitale, un caractère mystique excluant les nécessités mécaniques qui apparaissent dans toute observation.
De là, ce mélange curieux, chez les peuples primitifs et chez nombre de nos contemporains, de connaissances réellement positives et pleines de bon sens concernant la plupart des actes usuels de la vie, et adaptant celle-ci aux nécessités objectives, et d’absurdité et de fétichisme concernant les modifications des choses dans l’espace et dans le temps, hors des possibilités fournies par l’expérience et la réalité observable.
C’est en se débarrassant de cet état d’esprit mystique, qui imprègne malheureusement la plupart des théories sociales, que nous pourrons connaître les conditions réelles déterminant les phénomènes individuels et sociaux.
Dans le domaine purement spéculatif les sciences établissent des représentations assez satisfaisantes du fonctionnement universel. L’analyse minutieuse des phénomènes paraît, à première vue, nous transporter hors du sensuel, dans le domaine chicanier de la métaphysique ; mais il n’y a pas de science sans observation et toute observation repose sur des sensations. Aussi loin que nous poussions nos recherches, nous finissons par trouver une limite au-delà de laquelle il n’y a plus de sensuel. Le sens qui nous sert le mieux en la circonstance est celui de la vue. L’odorat permet bien de déceler des quantités infimes et des rapports très subtils des substances entre elles, mais il se prête très mal à des mesures quantitatives.
Comme l’étude objective effectuée par la vue et le tact conduit à la conception mécanique et cinétique de l’univers, Alfred Binet trouve illogique cette déformation représentative de l’objectif, qui pourrait, dit-il, être aussi bien olfactive ou auditive. Son point de vue serait exact si l’univers pouvait en effet se comprendre et s’expliquer aussi bien et même mieux de cette façon, mais non seulement il faut voir dans l’explication mécaniste une commodité, comme le pensait Henri Poincaré, mais encore nous devons penser que cette représentation psychique n’est produite en nous par le milieu que parce qu’elle correspond à quelque chose de permanent dans tous les phénomènes, c’est-à-dire le mouvement. Si en définitive nous trouvons toujours du mouvement dans tout ce qui vient à notre contact, s’il nous paraît toujours exister dans la lumière, l’électricité, la radioactivité, la chaleur, le son, le parfum, la sapidité, etc., alors que souvent quelques-unes de ces caractéristiques font défaut dans notre perception de l’objectif, il est tout naturel d’en déduire qu’il est la cause des différentes sensations que nous percevons.
Si nous constatons que des vibrations, des rotations, des ondulations, des chocs se produisant à des vitesses, des amplitudes, des fréquences, des déplacements précis, correspondent à des perceptions sensuelles précises, nous aurions tort d’aller chercher ailleurs la cause de ces sensations qui ne sont que les réactions de la matière vivante contre ces divers mouvements. Il est alors compréhensible que des mouvements différents, pris synthétiquement, soient irréductibles entre eux dans leur synthèse, ce qui est le cas pour le son et la lumière par exemple qui ne peuvent s’expliquer, ni se comprendre sensuellement, l’un par l’autre, puisque ces deux mouvements ne se produisent point à la même échelle. Les vibrations lumineuses s’effectuent à raison de 500 millions de milliards par seconde, tandis que celles du son varient entre 35 et 75.000. Vouloir les percevoir par le même sens reviendrait à peu près à vouloir regarder en même temps un grain de sable et une montagne.
Si nous ajoutons que l’étendue n’est qu’une propriété synthétique de la substance impressionnant nos sens et la divisibilité notre faculté d’analyse s’exerçant sur cette étendue, nous voyons qu’au-delà du sensuel il nous est interdit d’employer les mêmes images et les mêmes processus analytiques, car nous ignorons totalement, nous l’avons déjà vu, ce que sont les choses hors de nos sens.
Et c’est une faute d’expression que d’avoir baptisé Ether une sorte de nécessité explicative des choses extra-sensuelles. Les soi-disant contradictions de cet éther, de cette nécessité sans masse mais, paraît-il, plus rigide que l’acier, sont évidentes lorsqu’on suppose que cet inconnu, cet élément analytique a les mêmes propriétés que les corps synthétiques connus. Si, au contraire, nous admettons que ce qui est hors de nos sens a des propriétés absolument différentes, comparables à rien de connu ; si nous admettons même que le fait de nous représenter un millimètre cube d’ hydrogène avec ses 36.000.000 de milliards de molécules ne correspond à rien de précis pour notre imagination sensuelle ; si nous continuons à admettre que chacune de ces molécules est encore un monde extrêmement compliqué dont chaque élément peut aussi se décomposer en systèmes également complexes, nous éviterons d’appliquer comme cause, à ce monde inconnu, les propriétés matérielles et cinétiques qui en sont au contraire les effets.
Mais notre méconnaissance de l’au-delà sensuel ne nous autorise en rien à douter de notre connaissance sensuelle. Si la nature ultime du mouvement et de la substance nous sont inconnues, nous en constatons les effets et leur déterminisme absolu. L’enchainement des phénomènes, l’équivalence énergétique, la constance des lois naturelles nous permettent d’utiliser usuellement toutes les formes de mouvement depuis la vieille énergie mécanique et la chaleur millénaire jusqu’à la radioactivité, les ondes hertziennes, les rayons X, sans oublier l’électricité, le magnétisme, la lumière et la mystérieuse pesanteur, source peut-être de toutes les autres énergies.
Par des observations extrêmement ingénieuses, par des mesures, des calculs, des raisonnements déductifs et inductifs, des humains parviennent à trouver et découvrir le fonctionnement, les relations, l’ordre, les équivalences, les constances des mouvements de la substance constituant 1’espace et le temps. De ce que cette connaissance, à notre échelle, est exacte, pouvons-nous en déduire que les explications déterministes sont de nature à satisfaire toutes les curiosités ? Nous savons déjà que ceux qui recherchent la chose en soi ne seront pas satisfaits ; mais en dehors de ces métaphysiciens, on peut se demander si les lois naturelles sont immuables, si notre petite durée n’est pas insuffisante pour oser se représenter et comprendre à notre échelle le fonctionnement universel lui-même. A ceux qui doutent et tremblent ainsi devant ces problèmes formidables, il est bon d’opposer le spectacle réconfortant des innombrables esprits positifs cherchant à situer la position de l’homme dans la nature. Si l’on compare alors les misérables explications animistes des peuplades primitives, les sottes et dangereuses explications mystiques et religieuses des peuples soi-disant semi-civilisés, avec les magnifiques conquêtes de la méthode objective, on trouve une sorte d’abîme intellectuel entre ces deux représentations mentales de l’ordre des choses.
Avec la méthode objective tout apparaît cohérent, lié dans l’espace et dans le temps. Le transformisme situe et explique une évolution compréhensive des formes animales liées aux évolutions géologiques. Tout se tient, tout se coordonne, toutes les sciences concourent par leurs observations à la connaissance du fonctionnement universel.
La chimie, la physique, la géologie, la météorologie, l’astronomie, la paléontologie, la philogénie, l’ontogénie, la physiologie apportent leurs documents précieux et, par sa méthode déductive et inductive, l’homme remonte dans le temps, étend sa durée minuscule dans un passé prodigieusement éloigné, mesure des espaces stellaires et dans toutes ces investigations retrouve toujours les mêmes manifestations de la substance et du mouvement.
Il y a évidemment des cycles énormes dépassant la durée des êtres vivants et l’univers peut ainsi présenter des aspects tendant à fausser une compréhension trop étroite des phénomènes liés à ces cycles évolutifs. Ainsi en est-il du phénomène d’entropie, lequel consiste en une sorte de perte constante et inévitable de la tension énergétique se transformant en chaleur dans la manifestation des phénomènes. Comme la chaleur est un mouvement qui tend précisément à se diffuser, à perdre sa différence de tension, source et cause de tout phénomène, pour tendre à l’uniformité, l’on en déduit qu’il y a une évolution universelle vers l’immobilité.
Il est probable qu’il y a là une évolution dynamique en rapport avec la sénilité des systèmes stellaires faisant partie des cycles gigantesques où naissent et disparaissent des univers entiers. Notre vie n’étant peut-être compatible qu’avec cette dernière partie du cycle évolutif, où s’effectue l’entropie, on en déduit la fin et l’immobilité définitive du monde. Si, par contre, notre vie s’était manifestée au début du cycle évolutif, nous aurions probablement trouvé un accroissement progressif de l’énergie et déduit une tendance au déséquilibre et à l’instabilité perpétuelle.
Puisque rien ne se perd dans ces diverses transformations et que la quantité d’énergie reste la même, la quantité et la vitesse des mouvements doit également rester invariable et seule la direction de ces mouvements varie, rendant alors impossibles certains phénomènes jusqu’au nouveau cycle où se modifient ces directions.. Si l’humanité vieillit suffisamment dans sa voie expérimentale, accumulant observations et découvertes, elle connaîtra, peut-être, bien des enchaînements et des relations que nous ne soupçonnons point. Ces observations, ces découvertes, ces lois naturelles contrôlées, expérimentées, critiquées, transmises d’une génération à l’autre, soumises aux nécessités éliminatoires de l’utilisation pratique, constitueront le seul savoir humain, car écartant le coefficient individuel d’erreurs sensuelles ou psychiques par la participation de tous les hommes, elles permettront aux humains, dépouillés de tout mysticisme, d’ adapter leur espèce aux meilleures conditions vitales, lesquelles sont incluses dans les lois biologiques, fractions elles-mêmes des lois naturelles manifestations inéluctables du déterminisme universel.
b) LOIS DE CREATION HUMAINE.
L’examen impartial des lois créées et subies par les hommes offre quatre sujets d’études qu’il est intéressant d’approfondir avant de se prononcer pour ou contre leur utilité ou leur nocivité et, d’autre part, la connaissance de l’origine et de l’évolution de ces lois peut aider à la compréhension des formations sociales et à l’amélioration des relations entre les humains. Ces quatre sujets peuvent se formuler ainsi :
-
Pour quelle raison les hommes ont-ils stabilisé leur activité sous l’aspect de formules rigides et invariables, appelées lois, alors que la vie est si manifestement en perpétuelle évolution ?
-
Pourquoi ces lois sont-elles si différentes, si en opposition ou en contradiction d’un peuple à un autre ?
-
Comment se fait-il que certains hommes seulement, semblables aux autres et faillibles comme eux, peuvent être considérés comme seuls capables d’élaborer des principes supérieurs et d’où ces hommes faillibles tirent-ils l’infaillibilité de leurs lois ?
-
Enfin pourquoi les hommes jugés, ou se jugeant incapables de se conduire selon leur propre volonté personnelle obéissent-ils finalement à la volonté également personnelle d’un autre homme ? Ou, si l’on préfère, pourquoi des hommes ayant conçu des directives ont-ils besoin de se les faire imposer par d’autres hommes et placent-ils le motif de leur détermination dans la décision d’un autre homme plutôt qu’en eux-mêmes et pourquoi faut-il qu’ils extériorisent leurs désirs sous forme de lois intransigeantes et générales pour s’y conformer ensuite plutôt que de satisfaire leurs désirs directement et personnellement sans les objectiver ?
Avant tout examen de ces questions il paraît bien évident que les lois n’ont pas toujours existé et que des formes de vie très rapprochées de la vie animale ont précédé les groupements plus évolués. Si donc l’état primitif de ces pré-hommes ignorait la loi, celle-ci n’a pu se créer que sous l’influence des nécessités liées à l’évolution même des groupements humains et il est puéril et vain d’en nier le fait ou la nécessité, tout comme il est oiseux de s’élever contre l’utilisation du feu ou la création du vêtement. L’observation des sociétés encore primitives nous permet de saisir quelque peu la source de ces complications vitales bien que ces sociétés soient en réalité très éloignées des débuts véritables et des formes beaucoup plus simples des premiers groupements humains. Ce qui caractérise ces hommes primitifs, c’est une sorte de sens pratique, une appréciation très souvent exacte des faits tombant immédiatement sous les sens, avec une assez grande ingéniosité, jointes à un mysticisme explicatif sur l’origine, la cause ou les relations plus ou moins lointaines de ces faits.
Alors que l’esprit rationnel de l’homme évolue, cherche l’enchainement des faits, la succession logique des phénomènes et que, par l’observation et l’expérience, il acquiert la connaissance du déterminisme· universel, l’homme primitif reste dominé par la crainte de l’inconnu et des puissances invisibles qui animent toutes choses et causent par leur volonté toutes sortes de biens ou de maux. L’intelligence humaine, beaucoup plus développée que celle des autres animaux, saisissant très facilement les rapports des choses sensuelles entre elles, ne pouvait aller au-delà du sensuel et les représentations mentales, associant entre eux des faits sans relations objectives véritables, firent dépendre quantité d’événements de causes qui leur étaient totalement étrangères. L’homme ayant conscience de ses vouloirs dota toute la nature de semblables vouloirs bienveillants ou hostiles et les rêves ou les hallucinations créant d’une part un monde fantomatique, certains phénomènes naturels et redoutables tels que le gel, la foudre, l’obscurité, ou bienfaisants tels que le soleil ou la lumière furent, d’autre part, la source de croyances anthropomorphiques pleines de conséquences ultérieures pour les agissements de l’espèce.
Pour le primitif, toute chose devint animée d’une volonté et la lutte pour la vie prit pour lui un caractère très, différent de ce qu’elle était pour tout autre animal. D’autre part, les subsistances ne furent presque jamais proportionnées au nombre des humains et ce déséquilibre, aggravé par l’esprit conquérant de l’homme, accentua encore davantage la lutte entre les êtres vivants. La vie est un ensemble de mouvements conquérants, transformant indifféremment et inlassablement toutes substances assimilables selon ces divers mouvements. Or, si ces mouvements peuvent se conserver, s’engendrer et se multiplier à l’infini, la substance assimilable, nécessaire à l’existence de ce dynamisme particulier, est nettement limitée. Il y a donc lutte entre ces mouvements vitaux pour conquérir la substance, et tour à tour le végétal et l’animal se consomment dans des cycles sans fin. L’homme participe inévitablement à cette lutte, soit qu’il dispute la substance à ses congénères, quand il ne les mange pas directement, soit qu’il la dispute aux autres animaux. Cette lutte développa certainement son intelligence, mais elle nécessita l’association. Ces premières associations, semblables aux autres associations animales, ne connurent vraisemblablement aucune hiérarchie organisée, parce que la coordination chez les animaux s’effectue par l’initiative des plus forts et des plus courageux et par l’imitation. Les besoins étant très limités chez eux, les actes individuels se différencient peu des actes sociaux et la sélection éliminant les espèces dont l’activité ne s’adapte point aux circonstances, les survivants sont précisément ceux chez qui le comportement individuel se confond avec la conservation de l’espèce, ce qui ne peut avoir lieu que par une certaine homogénéité psychique des types individuels.
Mais l’évolution de l’intelligence humaine compliqua cette coordination primitive. Tandis que le crâne de l’homme de Neandertal nous indique un psychisme assez réduit, une écorce cérébrale partagée entre les fonctions sensitivomotrices et celles de la pensée véritable, le cerveau de l’homme évolué indique une prépondérance énorme de la faculté associative puisqu’elle en occupe les deux tiers de la surface totale. Or, l’homme de Neandertal était lui-même bien supérieur aux autres animaux. Les conséquences de cette évolution intellectuelle furent précisément d’individualiser l’être humain, lequel différencié de ses congénères par ses facultés personnelles et sa sensibilité particulière, s’écarta de ce fait de la coordination primitive issue de l’homogénéité psychique de l’espèce. Ces différenciations auraient amené la disparition des groupements humains, car, divisés par leurs concepts particuliers, les hommes se seraient trouvés en infériorité devant les espèces mieux armées pour la lutte. Mais, d’une part, leur nature animale les détermina selon la coordination primitive, c’est-à-dire que les plus forts et les plus valeureux entrainèrent les autres par imitation et devinrent des chefs et, d’autre part, les mêmes phénomènes, inexplicables pour eux, créèrent les mêmes croyances et l’animisme primitif fut la plus universelle des religions.
Nous voyons que, d’un côté, l’imagination humaine créait inévitablement des divergences et des divisions tendant à affaiblir la coordination animale primitive autour du chef et, d’un autre côté, le mysticisme naissant créait un nouveau lien par l’unité des croyances issues des mêmes réactions psychiques en face des phénomènes objectifs et subjectifs inexplicables. La vie en commun révéla probablement des aptitudes et des qualités assez différentes chez les différents membres du groupement. Les plus expérimentés, les plus rusés ou les plus habiles, sinon les plus forts et les plus courageux, furent la cause de nombreuses victoires durement mais profitablement acquises. Ces chefs, plus intelligents que les autres, furent sans doute, pour la même raison, davantage égarés par leur imagination explicative. Pendant des millénaires, ces associations mentales ne furent que d’obscures abstractions transmises par des traditions mêlées de réalisations pratiques, utiles et avantageuses, au point qu’elles firent partie de l’expérience ancestrale, de l’activité individuelle ou collective, et se mêlèrent intimement à la réalité.
Mais tandis que cette interprétation mystique des choses imprégnait la mentalité humaine, les nécessités véritables, beaucoup plus anciennes et découlant directement des circonstances mêmes de la lutte pour la vie, façonnaient également cette mentalité selon un processus conforme au triomphe des plus aptes et des mieux doués, C’est ainsi que se formèrent lentement les instincts sociaux favorables à la durée des individus et par conséquent de l’espèce et que les notions de bien et de mal s’objectivèrent sous la forme d’une morale vague liée au triomphe de la vie sur la mort, de la joie sur la douleur.
Il est difficile de se représenter exactement les premières explications mystiques ainsi que les premiers groupements humains ; mais cette double activité peut encore s’observer par des mœurs et des croyances qui nous paraissent étranges et absurdes, telles que le totémisme, le tabou, le fétichisme, la sorcellerie, etc. etc...
La vie sociale ayant créé une coordination particulière, celle-ci s’effectua sous les nécessités les plus impérieuses, variant avec chaque latitude selon les ressources locales, la nécessité ou les dangers menaçant les individus ; mais, sous des apparences diverses, ces nécessités objectives s’imposèrent dans des conditions assez semblables pour tous les humains et la coordination ne put s’effectuer autrement que par une sorte d’unification des vouloirs, des désirs, des gestes plus ou moins adaptés réellement au but poursuivi. Si donc chaque tempérament individuel amenait une variation dans les mœurs sociales, l’ensemble du groupement, essentiellement déterminé dans sa coordination par ce qui pouvait être commun et spécifique, restait soumis aux grandes nécessités biologiques et conservait ainsi une structure d’autant plus solide qu’elle était mieux adaptée aux faits généraux intéressant tous les membres de ce groupement.
Comme la cohésion et l’orientation ne pouvait s’effectuer sans une personnification humaine prenant l’initiative et la direction de l’action, il est compréhensible que cette personnification, exigeant des qualités particulières, créerait une sorte de supériorité du chef ou du sorcier sur les autres individus. Le développement et l’importance des groupements, la spécialisation et la division du travail accentuèrent encore les différences individuelles et les croyances, les traditions, l’expérience ancestrale ainsi que les pratiques mystiques longtemps communes furent progressivement transmises, conservées et pratiquées par ceux que les circonstances déterminèrent à jouer ce rôle directif et coordinateur.
Ainsi, d’une part, la lutte pour la vie matérielle contraignait l’homme à l’association et cette association ne put être fructueuse que par l’entente et la coordination créant le fond moral commun aux humains. D’autre part, sa curiosité développée par le besoin de prévoir et favorisée par son intelligence, créa l’explication mystique commune aux primitifs et ces deux activités engendrèrent la hiérarchie des chefs et des sorciers, lesquels devinrent, par suite de l’évolution des groupements, les hommes d’église et d’Etat. Il est donc naïf de croire que ceux-ci inventèrent l’Etat et la religion.
La plupart des humains sont encore mystiques et la raison purement objective, scientifique et expérimentale n’est qu’un acquis récent de l’humanité. Les hommes ne purent unifier leurs vouloirs que sur des choses communes, et ce qui leur fut le plus commun, ce furent la faim, la peur, le besoin d’explication et plus tard l’amitié.
Actuellement encore, ils s’unifient beaucoup plus sous les appels impérieux de la faim et du mysticisme que sous l’appel de la raison et le fétichisme est à peine dissimulé. Les mouvements de masse sont sentimentaux et s’effectuent en vertu de l’ancestrale morale héréditaire, source de la solidarité humaine, faisant responsable tout le clan de l’acte individuel.
Avant la loi écrite il y eut donc la loi non écrite, presque plus impérieuse et plus tyrannique que l’autre, car elle était écrite au fond de chaque conscience et ne permettait aucune dérogation. La tyrannie du tabou est d’ailleurs encore telle qu’on a vu maints primitifs l’ayant enfreint, plus ou moins volontairement, se laisser mourir de faim, terrorisés par l’ignorance, la peur et la superstition. S’il est parfois possible de tourner, plus ou moins, les lois écrites, il est presque impossible, en certaines régions, de heurter la coutume, les mœurs ou les traditions, car chaque membre social en est le gardien, l’observateur et le conservateur intransigeant et l’opinion publique est la plus incessante des tyrannies.
L’invention de l’écriture ne fit qu’attacher un caractère encore plus fétichiste à la tradition orale, déjà solidement matérialisée par tous les objets des cultes et des hiérarchies sociales, donnant un caractère mystique et sacré à toutes sortes de choses ou de matières, mortes ou vivantes, et une valeur toute conventionnelle à des attributs décoratifs et distinctifs, indiquant la supériorité ou lui suppléant largement.
Il serait sot d’affirmer que l’humanité ne pouvait évoluer autrement, mais il serait vain de soutenir que, cette évolution s’étant effectuée dans certaines conditions, elle pouvait s’accomplir autrement.
Nous pouvons maintenant répondre à nos quatre questions.
1°
Si les hommes ont semblé stabiliser leur activité sous formes de lois, alors que la vie est mouvement, c’est que toute société présente la double activité d’une vie commune et de vies individuelles. La vie commune, déterminée par les nécessités collectives et les grandes lois biologiques, présente peu de variations parce qu’en fait, à travers tous les âges, les hommes furent toujours déterminés par les mêmes besoins physiques et psychiques, et que les lois naturelles peu variables dans leur ensemble ont modelé les hommes suivant un type collectif et spécifique. La lutte pour la subsistance, le déséquilibre entre les désirs conquérants et les moyens de les satisfaire créèrent toujours des méfaits identiques dans leurs résultats.
La vie est faite de conservation et de durée et il est tout naturel que l’expérience triomphante des anciens soit transmise aux jeunes générations. Mais chaque humain a son tempérament particulier ; son évolution personnelle de l’enfance à la vieillesse est beaucoup plus rapide que celle de son groupement et son activité propre peut osciller très rapidement d’une direction à une autre. De là cette impression de dynamisme, de variabilité, de vitalité opposés à la stabilité collective. Un milieu composé de gens de tous âges, de tempéraments très différents et d’activités très dissemblables ne peut présenter une continuité et une durée certaine que par une homogénéité déterminée par l’hérédité spécifique qui leur est commune, issue de l’adaptation de l’espèce aux lois naturelles.
Toute société présentera donc toujours des nécessités collectives susceptibles d’obligations ou de contrats variant selon l’importance et la durée de l’œuvre sociale envisagée ; mais, en même temps, chaque individualité conservera son activité personnelle par impossibilité d’association, ou son unicité. Si donc nous prenons tantôt l’activité individuelle, tantôt l’activité sociale, nous trouvons inévitablement une opposition entre le contrat (ou la loi) et l’évolution de la vie. Ce qui aggrave cette opposition, c’est la fixation, la cristallisation définitive de conventions momentanées, à caractère personnel et par conséquent transitoire et fortuit, se prolongeant dans le temps, hors des causes les ayant nécessitées. La vie est faite, nous l’avons vu, d’acquisition et de conservation et les sociétés ne peuvent vivre qu’en conservant une certaine continuité dans leurs directives, mais la vie est également faite d’élimination, de renouvellement et l’esprit trop conservateur, l’inertie, la passivité, la tendance au moindre effort des humains perpétuent des mœurs que nous savons néfastes, créées par l’ignorance, la peur et la bestialité !
Le caractère fétichiste des lois et leur intangibilité prolongent la torpeur intellectuelle des individus, entravent l’initiative et la responsabilité, nivellent les activités personnelles, s’opposent à toute transformation profonde et bienfaisante.
Tout contrat social devra donc éviter cet écueil malfaisant, cette cristallisation mortelle et résoudre le double problème, apparemment paradoxal, de conserver l’acquis social et de faciliter l’évolution indéfinie des individus, ce qui ne pourrait être résolu que par l’étude de ces nécessités biologiques délimitant le commun et le durable, du personnel et du fortuit.
2°
La différence des lois et leurs contradictions sont évidemment les résultats des premiers efforts de l’imagination ayant contribué à l’explication mystique des choses et des difficultés vitales particulières à chaque habitat. L’imagination associant plus ou moins heureusement, comme nous le savons, des faits observés, peut varier à l’infini et il est tout à fait compréhensible que la diversité des croyances et des lois en soit résulté. L’important pour les hommes, c’était d’avoir un motif quelconque de coordination et tous les emblèmes de ralliement, indépendamment de leurs formes et de leurs couleurs, remplissent également bien cette fonction. Les croyances les plus utiles à ce but, et conséquemment les plus fidèlement transmises par la tradition, furent précisément celles dont l’impossibilité de vérification expérimentale permit les plus ineptes affirmations. Que ce soit le culte du totem, celui des ancêtres, de l’autel de la Patrie, de l’avenir du Prolétariat sinon celui de l’Humanité, les foules sentimentales auront longtemps encore, sinon toujours, besoin, pour les grandes coordinations (à défaut de sagesse et de raison) d’un emblème dépassant le cadre immédiat de leur activité, laquelle conduit, nous l’avons vu, à la divergence et à l’unicité.
Mais les étrangetés et les diversités mêmes des lois prouvent l’indifférence de leurs formes et le caractère artificiel de leur aspect exotérique. Sous ces apparences contradictoires et absurdes on retrouve toujours, chez les divers peuples, les nécessités vitales créatrices d’associations matérielles et l’explication mystique créatrice de liens psychologiques. Ici encore, si nous opposons les unes aux autres les formes presque toujours déraisonnables des lois, nous ne trouverons qu’absurdité et incohérence, inharmonie avec les conditions présentes de la vie. Plus l’individu évolue hors du mysticisme et de la bestialité primitive et plus l’écart s’agrandit entre le formalisme archaïque des lois et la raison. Celle-ci ne reconnaît que quelques règles de vie très simples, dictées par les nécessités objectives qui furent communes aux hommes pendant des millénaires et façonnèrent identiquement leur conscience spécifique. Tout le fatras fantasmagorique des lois, imaginé par le mysticisme et l’esprit de conquête, mais commandé et fixé par le besoin de coordination, se désagrège sous l’influence de la raison. Seules les nécessités matérielles proportionnées au nombre et au désir de consommation des groupements humains exigeront des contrats en rapport avec les difficultés de coordination ct de production.
3°
L’infaillibilité des lois, créées par des hommes faillibles, ne se soutient plus actuellement puisqu’elles sont sans cesse remaniées par chaque parti au pouvoir, mais ce caractère sacré se justifiait aisément lorsque la loi civile et la loi religieuse ne faisaient qu’un, comme cela existe encore chez quelques peuples fanatiques. Le sorcier primitif et redouté, entouré d’une crainte superstitieuse, était le dispensateur de calamités que l’on évitait par une obéissance rémunératrice et généreuse. L’infaillibilité de l’église catholique et de son chef est universelle et cette sorcellerie savante émet encore la prétention de représenter la divinité et de nous courber sous son joug despotique. Si ces vieilleries périmées ne justifient plus leur infaillibilité, les lois humaines modernes, équilibrant les intérêts opposés des partis et des individus, ne justifient pas davantage la leur ; mais leur création par des hommes semblables aux autres et leur caractère quasi-sacré vient, d’une part, de l’esprit encore mystique et fétichiste des hommes, et de l’autre, de l’inévitable difficulté de coordination inhérente à tout groupement humain, en l’absence des directives de sagesse et de raison, et que l’on peut formuler ainsi :
Tout groupement humain doit coordonner ses efforts par une discipline volontaire ou involontaire. Si la discipline est volontaire, c’est sagesse et raison. Si la discipline est involontaire, c’est tyrannie et violence. L’une conduit au contrat volontaire ; l’autre à la loi imposée.
Comme les humains ont encore une mentalité de bête conquérante et mystique, ils ont recours à la violence. La loi n’est donc plus le produit infaillible d’hommes faillibles, elle est le triomphe d’un intérêt sur un autre intérêt, d’une nécessité sur une autre ou d’un esprit de conquête sur un autre esprit de conquête, quand ce n’est pas sur d’équitables esprits. Ce triomphe ne peut s’assurer que par l’application intransigeante de la loi et c’est le moindre mal que peuvent obtenir des hommes déraisonnables. Parfois des hommes de bon sens en bonifient l’esprit, sinon la lettre ; parfois d’autres personnages en aggravent la malfaisance dans les deux sens, mais de toutes façons, elle est la manifestation d’une nécessité sociale, parfois momentanée, intransigeante elle-même en ses exigences ct qui fait que volontairement ou involontairement les actes sociaux doivent se coordonner et les désirs conquérants se limiter et s’équilibrer sous peine de désagrégation des milieux sociaux.
4°
Tout ce qui précède explique aisément l’obéissance de l’homme ; mais si, autrefois, les attributs du sorcier ou du chef en faisaient des personnages sacrés, les chefs actuels ne représentent plus qu’un élément indifférent, bien que très désavantageux, de coordination et une sorte de canalisation et de spéculation de l’esprit de conquête des individus en leur propre faveur. La fable de l’huître et des plaideurs est admirablement vraie et repose sur une base psychologique très profonde. Deux intérêts opposés, deux concepts conquérants ne peuvent qu’entrer en lutte, se détruire réciproquement ou se soumettre à un arbitrage plus ou moins onéreux. Peu de groupements et d’individualités même échappent à cette belliqueuse ou humiliante détermination. Si les hommes ont préféré l’arbitrage de la loi plutôt que la lutte ouverte et permanente, c’est parce que, en réalité, cela correspondait mieux à leur nature artificieuse, prudente et spéculative et à l’intérêt général mieux satisfait par la ruse que par la violence perpétuelle. Mais il y a autre chose de plus profond dans l’objectivation d’un concept général tel que celui du droit ; il y a une abstraction tendant à exprimer une sorte de rapport universel entre individualités, à exclure des réactions humaines les points divergents pour ne laisser subsister que ce qui constitue le lien spécifique et fraternel commun à tous les humains. Cette tendance à formuler ainsi ces concepts généraux est une conquête de l’esprit positif, substituant progressivement au pouvoir personnel et arbitraire des conquérants et des sorciers de tout acabit, une sorte de directive sociale impersonnelle imposée uniquement par les nécessités déterminant tous les êtres vivants.
Ainsi la coordination humaine présente une curieuse constance dans son évolution. Alors que l’indifférence individuelle des premiers hommes rendait cette coordination facile dans le clan primitif par la solidarité des besoins et des croyances l’intelligence, se libérant de cette étroite servitude et tendant à détruire toute coordination par son individualisation excessive, retrouve précisément dans la raison, basée sur l’instinct social héréditaire, une cause plus efficace de cohésion et d’homogénéité humaine par l’universalisation de ses concepts et l’impersonnalisation de ses directives sociales.
Mais ce n’est que par l’éducation de leur volonté et de leur raison que les hommes se débarrasseront de l’humiliant, du dégradant et malfaisant arbitrage légal et du fétichisme judiciaire. Ils reconnaîtront alors l’utilité d’une discipline volontaire pour la limitation de leur esprit de conquête et l’élaboration et l’observation des contrats assurant un minimum de conservation au milieu social, lequel mieux coordonné, permettrait, contrairement à l’affirmation des esprits encore embrumés de mystique, un bien meilleur développement de l’unité individuelle.
— IXIGREC
LOI
a) LOIS NATURELLES (leur portée, leur contingence)
C’est parce que les phénomènes se répètent, nous donnent l’impression de similitudes, de concordances, que nous nous mouvons avec sécurité dans le monde qui nous environne. « Nous sentons qu’il y a un rapport entre l’expérience actuelle et certaines expériences antérieures ». Par là nous est rendue possible la prévision, base de toute organisation de la vie.
Nous pourrions nous borner à dresser un répertoire des faits passés et des particularités corrélatives que nous aurions relevées parmi eux, catalogues et recettes qui inspireraient notre comportement. Mais quelle cervelle humaine saurait retenir la multitude des faits, quelle bibliothèque serait capable d’en conserver la trace, si l’homme ne s’ingéniait à soulager la mémoire en reliant les faits les uns aux autres par quelque lien logique ? Ce qui importe à tout instant « c’est de trouver en soi l’indication de tous les phénomènes extérieurs possibles en se reportant au minimum de données observées » (Le Dantec).
Le procédé d’inventaire qui se borne à noter les phénomènes sans les interpréter, sans les codifier par une synthèse, constitue l’empirisme. Nul n’a jamais pu le pratiquer dans toute sa rigueur ; la faveur qu’ils lui accordent n’a jamais servi qu’à dissimuler l’étroitesse de vues de ceux qui s’en réclament.
L’homme de science, au lieu de se borner à dresser un répertoire de faits, emploie sa raison à les expliquer, à les encadrer dans un groupe plus vaste duquel il les rapproche, à discerner, sous leur complexité naturelle, des composants plus simples laissant apparaître des similitudes, entre lesquelles on pourra établir des relations et dont il sera facile de suivre les variations dans l’espace et dans le temps.
Le savant exprime le résultat de son travail dans une formule ou loi qui résume ce qu’il y a d’essentiel dans un ensemble d’expériences passées et permet de prévoir le plus grand nombre possible de faits à venir. « La meilleure loi naturelle est celle qui condense le plus de faits » (Le Dantec). Un exemple : les petites oscillations d’un pendule sont d’égale durée, et chacun a pu observer que celle-ci s’accroît avec la longueur de l’instrument. On aurait pu s’en tenir à rédiger des tables numériques donnant, pour chaque lieu du globe et pour chaque longueur, la durée du battement. La science fait mieux, elle nous dote d’une brève formule de quatre lettres et de trois signes qui, grâce à trois opérations élémentaires, nous permet de connaître le temps cherché pour tel appareil que l’on voudra.
Opérant sur ces lois particulières comme il a opéré sur les faits, l’esprit s’est élevé à des lois de plus en plus générales et à des principes en nombre toujours plus restreint, qui suffisent à condenser tout notre savoir et à vivifier toute notre industrie. La formule de l’attraction universelle, due à Newton, d’une concision égale à la précédente, ne nous explique pas seulement les mouvements du système solaire ; elle nous permet d’aborder une foule d’autres problèmes concernant par exemple, les actions électrostatiques et magnétiques, la capillarité, etc...
Mais nous sommes sujets à une illusion. Cette loi, qu’au prix de longs efforts nous avons tirée de la connaissance des faits passés, qui n’est en somme qu’un moyen de classification indispensable, nous sommes aussitôt portés à lui attribuer une valeur absolue, à croire qu’elle s’impose fatalement à l’avenir. Nous regardons comme une loi inhérente à la nature, inéluctable, divine, ce qui n’est en définitive qu’une loi de notre esprit ou, si l’on préfère, le reflet dans notre esprit de phénomènes dont l’essence nous demeure impénétrable. Les lois physiques expriment « non pas l’activité de la nature, mais les relations entre cette activité et celle de l’homme » (Le Dantec). On a pu se demander si elles sont des lois éternelles.
« En toute simplicité, on doit répondre que nous n’en savons rien. Pour qu’elles fussent nécessaires, éternelles, il faudrait que la justification d’un corps de doctrine reposât sur une autre base que sa convenance au réel, telle que nous l’avons étudiée. Tout ce que nous pouvons dire, c’est : tel symbole convient aux faits réels sur lesquels on a expérimenté jusqu’ici. Mais nous n’avons rencontré nulle part quoi que ce soit nous permettant d’affirmer en augures : tel symbolisme conviendra éternellement aux faits réels de l’avenir... On dit parfois que nous arrivons à connaître, non les choses, mais les rapports des choses. C’est encore un leurre. Nous ne parvenons qu’à formuler des relations entre les symboles des choses. La différence est formidable entre les deux prétentions ; gardons-nous de confondre l’image scientifique que nous nous faisons du monde avec le monde lui-même. » (Gl Vouillemin)
b) LOIS SOCIALES.
Les lois qui gouvernent les sociétés, tout comme celles qui règlent les phénomènes de la nature, sont empreintes de relativité. Elles le sont même à un plus haut degré puisqu’elles définissent les rapports de l’homme avec un milieu qui se modifie sous l’action de l’homme. Nous ne sommes plus en présence d’un équilibre quasi stabilisé par la lenteur de l’évolution de l’un des facteurs, le facteur cosmique, mais d’une relation entre des termes, individus et groupes, dont les changements, s’ils ne sont ni simultanés, ni identiques, sont sous la dépendance d’une même cause, le psychisme humain et par suite du même ordre de grandeur.
Aux deux sens civil et moral « les lois sont des produits naturels, ce sont des produits des phases particulières du développement humain. Ce développement est lui-même capable d’être traité par la méthode scientifique, et la suite de ses degrés petit être exprimée par des formules scientifiques ou bien par des lois naturelles, si l’on considère la loi civile et la loi morale comme des phénomènes objectifs ».
Envisagées sous cet angle, les lois sociales seraient de simples guides nous servant à orienter notre conduite dans la compagnie de nos semblables, de même que les lois scientifiques guident notre action dans l’ensemble du monde naturel ; elles nous avertiraient des réactions que nos actes doivent susciter chez ceux qui nous entourent. Malheureusement, au cours des âges, le milieu social ne s’est pas organisé spontanément par le concours d’instincts sensiblement équilibrées ; des volontés particulières et collectives y ont prédominé. Les lois ne sont pas seulement explicatives, mais impératives ; elles prétendent contraindre au lieu de conseiller. Cependant certains indices de leurs fonctions naturelles sont parfois visibles. Sous l’ancien régime, à côté des ordonnances promulguées d’autorité par le pouvoir, existaient des lois qui n’étaient que des coutumes rédigées. Et ce souci de réduction était justifié. Rien de plus tyrannique que les exigences d’un groupe inconstant, obéissant à des impulsions irréfléchies, imprévisibles. Un texte est une garantie contre l’interprétation abusive d’un usage mal défini. La jurisprudence, à son tour, adapte à la vie des formules trop immuables.
D’un autre point de vue, légitime est le souci que nous avons d’influer sur l’évolution de cette partie du milieu vital qui relève plus directement de notre volonté. Dans ce cas, la loi abdiquant son caractère de contrainte exercée de l’extérieur devra se réduire ci une obligation ressentie par les consciences individuelles, trouvant son point d’appui dans leur commune volonté de progrès. Quels seront la source et le champ d’application d’une telle législation ?
Lorsqu’elle visera la manifestation des tendances morbides ou perverses unanimement réprouvées, elle ne différera guère, sinon dans sa formule, du moins dans son effet, de celle qui nous régit aujourd’hui. Mais pour tout ce qui concerne les rapports politiques ou économiques entre les hommes elle ne sera rien plus que l’expression des conditions afférentes à la réalisation d’un idéal consciemment poursuivi par les membres d’une collectivité. Cela ne sera possible qu’autant que les liens qui les uniront n’engloberont que la part de leur activité appliquée à la poursuite d’un but exactement spécialisé. Les tendances humaines sont trop hétérogènes pour que les statuts d’un groupe puissent les confondre dans un seul bloc, sans en écraser le plus grand nombre sous le poids d’une discipline trop uniforme.
Dès l’instant qu’il se livre tout entier à un groupe, l’être abdique sa personnalité. Dans une sphère délimitée, au contraire, l’individu accroît ses moyens d’action en joignant sa propre force à d’autres semblables dirigées dans le même sens. Comme l’a fait remarquer Durkheim (nullement libertaire d’ailleurs), c’est au sein de groupes issus de la similitude des activités et des œuvres que s’élaborent les lois morales, « car il est impossible que des hommes vivent ensemble, soient régulièrement en commerce, sans qu’ils prennent le sentiment du tout qu’ils forment par leur union, sans qu’ils s’attachent à ce tout, se préoccupent de ses intérêts et en tiennent compte dans leur conduite. Or, cet attachement à quelque chose qui dépasse l’individu, cette subordination des intérêts particuliers à l’intérêt général (nous dirions plutôt à l’intérêt qui a motivé l’accord) est la source même de toute activité morale. Que ce sentiment se précise et se détermine, qu’en s’appliquant aux circonstances les plus ordinaires et les plus importantes de la vie il se traduise en formules définies, et voilà un corps de règles morales en train de se constituer ».
Les sentiments et les usages qui, dans chaque sphère d’activité, maintiennent l’accord entre les participants, auront un fond commun qui, généralisé à l’ensemble du milieu social, en assurera l’harmonisation. C’est à ces règles qu’une pratique journalière aura gravé dans toutes les consciences que, dans des sociétés exemptes des tares qui corrompent celles d’aujourd’hui, se réduira le code des lois.
— G. GOUJON
LOÏSME (et Loïstes)
Toute l’histoire du moyen-âge et nous reviendrons sur la question lorsque nous étudierons la Réforme et ses précurseurs, est caractérisée par l’existence de sociétés ou mouvements communistes, plus ou moins anarchisants, prétendant pratiquer le christianisme primitif en interprétant à leur façon l’enseignement évangélique. C’est surtout de ceux qui se développèrent dans les Flandres que nous connaissons le mieux les faits et gestes : hérésie de Tanchelin, « vauderie », hommes de l’intelligence, turlupins (qui se dénommaient entre eux : la fraternité ou la société des pauvres), adamites, etc. Ces ébauches finirent par constituer un mouvement révolutionnaire des plus importants à l’époque de Luther, qui ébranlera jusqu’en ses fondements l’Allemagne du Nord ; je fais allusion ici aux Anabaptistes, dont la révolte fut étouffée dans le sang par les princes luthériens et dont le chef, Jean de Leyde, périt dans d’inconcevables supplices, après la prise de Munster.
La chute du boulevard de l’Anabaptisme fut le signal d’une persécution générale des anabaptistes, qui ne les fit pas disparaitre. Ils se cachèrent avec plus de soin. C’est chez ceux qui restaient que durent se recruter les Loïstes, hérésiarques connus aussi sous le nom de « Libertins d’Anvers » auxquels un écrivain belge renommé, Georges Eekhoud, a consacré de vivantes pages (dans les Libertins à Anvers, édité par Le Mercure de France, ouvrage épuisé).
Le prophète des Loïstes fut un couvreur du nom d’Eloi ou Loïet Pruystinck, connu sous le nom de Loïs le Couvreur. Tout illettré qu’il fût — il ne savait pas lire — Loïs possédait une telle mémoire qu’il retenait et récitait par cœur ce qui avait été lu une seule fois devant lui. Il composait de petits traités fleuris comme des poèmes qu’il dictait à Dominique d’Uccle, l’un de ses partisans, qui les imprimait pour les besoins de sa cause. L’influence qu’il exerçait sur les siens est presque inimaginable. A Anvers — et où ailleurs qu’en la ville des enfants de Priape le Loïsme aurait-il pu prospérer ? — quand il sortait, la foule se prosternait sur son passage et lui faisait une escorte, renouvelant ce qui s’était passé du temps de Tanchelin. Sa bonne mine, sa voix musicale, sa parole enjolivée lui attiraient d’innombrables prosélytes. De beaux enfants lui servaient de pages, les fillettes jonchaient de fleurs la voie que foulaient ses pieds, ses « gardes du corps » étaient recrutés parmi les portefaix, les Kraankinders (débardeurs), les porteurs de tourbe, les abatteurs et les bateliers les plus décoratifs.
Pruystinck avait gardé la coupe dégagée et gaillarde de son costume de maçon, jusqu’aux nuances et aux cassures incluses, mais l’étoffe en était aussi précieuse que celle des habits de grand seigneur. Dans ces brocarts et ces velours mordorés, de savantes déchirures, d’ostensibles rapiéçages simulaient l’usure, la trace des accidents, les cicatrices et les stigmates de rigueur sur les sayons et les braies des va-nu-pieds ; tel des costumes de parade de Loïs était calqué, mais avec des draps d’or et des pierreries, sur d’authentiques guenilles... C’était sa façon de tourner en dérision le luxe et la richesse égoïstes. A vrai dire, une pensée profonde se cachait sous cette pratique biscornue... Aujourd’hui Lois portait de vrais haillons et le lendemain, il endossait leur reproduction en matières plus coûteuses que celles d’un manteau impérial. Un jour, le prophète était réellement maculé de boue, de sang, d’écume, de bave ; le surlendemain, cette friperie sordide ne représentait qu’un trompe-l’œil et ces prétendues guenilles eussent payé un trône. C’était son disciple, un certain bijoutier parisien du nom de Christophe Hérault qui lui confectionnait ces vêtements dont les frais étaient supportés par les Loïstes riches, lesquels, en s’affiliant au loïsme, versaient, à en croire la légende, leur fortune entre les mains du prophète.
Mais, au fait, en quoi consistait donc la doctrine loïste ? Sans nul doute, au point de vue économique, mise en commun des richesses. Parmi les Loïstes se rencontraient, en effet, et des gueux et des richards.
Loïs s’appliquait à nouer des liens d’amitié fraternelle entre vagabonds et gentilshommes, ribauds et clercs. D’un côté, d’opulents facteurs Anversois, de riches directeurs de factoreries, de comptoirs étrangers — lombards, florentins, hanséatiques — s’empressaient de répudier ce que leur avaient enseigné leurs prêtres ou leurs « dominés » et de se rallier à ses maximes épicuriennes. De l’autre côté, ces mêmes maximes lui attiraient la soi-disant lie de la population, tout ce monde amphibie des barques et des bouges de l’Escaut, plus ou moins pillard d’épaves, garçons d’étuves, coureurs de grèves, ramasseurs de moules, naufrageurs professionnels furtifs et prolifiques. Pour réunir les uns et les autres, il avait inventé des rites bizarres, mais touchants, somme toute. Au cours de la cérémonie d’initiation, il appariait le gentilhomme et le manant, l’opulent et le gueux, substituant les haillons de l’un à la somptueuse défroque de l’autre. Les nobles troquaient leurs noms historiques et vénérés contre les sobriquets des enfants trouvés.
Au point de vue éthique et religieux :
« Pruystinck prêchait l’amour libre, la polygamie, la polyandrie, les rapprochements sexuels sans entraves, ce qu’il appelait l’affranchissement complet des âmes et des corps : ni pénitences, ni jeûnes, ni mortifications. A chacun de réaliser de son mieux son paradis sur la terre, sous la seule réserve de ne pas empiéter sur la liberté du prochain. »
« ...Loïet prêchait encore que l’être entier, impérissable, retourne à la nature, au grand Tout, que les religions bibliques appellent Dieu et dont émane chaque créature. La mort nous replonge dans l’éternel creuset d’où sortent toutes les formes et toutes les pensées. Une seule chose importe : vivre avec gratitude, avec ardeur, mais avec lucidité, se réjouir en la plus extrême bonté de la beauté et de l’excellence de la Création ; jouir de la chair et des fleurs, des livres et des fruits, de l’art et de la lumière, de l’esprit et du soleil, de Tout... »
On comprend que l’hérésie de Lois, qui se confondit d’abord avec la réformation luthérienne, s’en soit bientôt disjointe. Rien de commun, d’ailleurs entre la doctrine froide, dogmatique, compassée, du solitaire bourru de Wittenberg et les aspirations vers la vie — la vie ample, intense, ardente — qui formaient le credo des amis du Couvreur.
« Religion de volupté. Oui, certes, mais d’autant plus belle. La volupté n’est-elle pas l’amour intelligent, l’enfant de l’Amour et de Psyché, la l’encontre sublime de la Chair et de l’Ame, la fille de cette union merveilleusement chantée et célébrée par tant de poètes, de peintres, de musiciens, depuis les Mystères orphiques, les Fables milésiennes et Aulée jusqu’à Prud’hon et César Franck en passant par Le Corrège et le divin Raphaël ? »
Des bruits calomnieux se répandirent bientôt sur Loïet et ses disciples. Des femmes abandonnées par leurs maris à cause de leur jalousie, des époux répudiés par leurs femmes pour le même motif, des parents tyranniques reniés par leurs enfants : tous imbéciles, méchants, dépités, colportèrent des rumeurs fantaisistes et attribuèrent à Loïet et aux Loïstes les pires extravagances.
S’il comptait autant de pauvres que de riches dans sa communauté, il y eut autant de pauvres que de riches pour le diffamer et conspirer contre lui.
Quelle pire accusation porter contre lui que celle de magie ? Ne fallait-il pas être un sorcier pour amener de jeunes gentilshommes, des fils de famille, des héritiers d’opulents facteurs à fraterniser avec des loqueteux dont ils se seraient autrement détournés avec dégoût ? C’était à ne pas y croire. Comment expliquer cette fraternité entre des hommes que séparaient des abîmes d’incompatibilité morale, de préjugés sacro-saints, politiques, sociaux, religieux ? Il fallait bien qu’ils fussent la proie d’un charme.
Ce ne fut pas tout. On accusa les Loïstes de se livrer toutes les nuits à des sabbats où, préparés par des prêches, des danses, des hymnes, ils exaltaient la guenille humaine dans tous ces détails, finissant par l’exposer dans ce qu’ils appelaient tous sa triomphale et radieuse nudité. Les armes qui avaient servi contre les Templiers, les Vaudois, les Hommes de l’Intelligence n’étaient point émoussées. Tout ce que peut inventer la malveillance d’une populace grossière, dépourvue de goût et de culture fut attribuée à ces précurseurs : viols, abus de mineurs, infanticides. On trouva des voisins qui affirmèrent que les Loïstes s’employaient jusqu’au matin à chanter, à boire, à des pratiques abominables dont la moindre consistait dans le sacrifice des enfants. Ils étaient couronnés de fleurs, nus comme les mauvais anges et les faux dieux. On les avait vus, au cours de cérémonies luxurieuses, s’agenouiller devant une statuette de Priape.
Doctrine à part, il aurait suffi de moindres accusations pour les conduire au bûcher. Eussent-ils échappé à Marie de Hongrie, la vice-reine des Pays-Bas, que les hommes de Luther, eux, n’auraient pas laissé glisser entre leurs mains ces hommes dont le rêve avait été « d’affranchir la Volupté, l’enfant sublime de l’Ame et de l’Amour ».
Deux incidents de l’histoire des Loïstes nous arrêteront quelques instants.
Le premier est l’abjuration d’Eloi Pruystinck et de neuf de ses compagnons, alors que poursuivis une première fois par l’Inquisition. Georges Eeckoud explique cette attitude en nous dépeignant son héros comme une âme bonne et généreuse, mais nullement héroïque ou stoïque. « Comme les païens, comme les Grecs, Loïet — écrit-il — estimait l’existence terrestre, le bien le plus rare et le plus précieux. Il pensait devoir le défendre et le prolonger coûte que coûte, fût-ce au prix d’une apparente palinodie et d’une attitude humiliante... Il voulait vivre et jouir le plus longtemps possible. Pareille conduite s’accorde avec tout ce qu’il prêcha. Il fut parfaitement logique. Cet apôtre de la joie charnelle n’avait pas les nerfs grossiers qui conviennent aux martyrs, et s’il finit par subir le supplice, la mort lui fut d’autant plus cruelle qu’il n’avait jamais rêvé d’autre ciel que le paradis terrestre »... « Les puritains de toutes confessions sont donc mal venus de jeter la pierre à cet épicurien, parce qu’il céda avant tout à l’instinct de la conservation ».
On peut dire à sa décharge que les peines effroyables dont étaient alors passibles les hérétiques justifiaient l’emploi de la ruse. Son attitude, d’ailleurs, ne porta préjudice à aucun des siens. Une fois la tourmente quelque peu calmée, tous reprirent leur propagande.
Le second incident a trait à l’application même de la doctrine prêchée par Le Couvreur. Il aurait bien admis la polygamie en ce qui le concernait, mais n’aurait pu supposer que son amante préférée, Dillette, entretînt commerce avec d’autres que lui. Eeckhoud, en son livre, établit une distinction entre un point de vue qu’il voudrait être celui de Loïet (lequel, fidèle à sa nature exigeante, avait entretenu un commerce amoureux avec nombre des affiliées au loïsme), soit donc : l’amour libre facultatif, la communion amoureuse réciproque — et celui de Cousinet (présenté comme le mauvais disciple, le traître) et de son parti, proclamant le communisme charnel obligatoire, général et réciproque, sans que nul ne puisse se refuser au désir qu’il ou elle inspire. On sent le vieil homme se réveiller chez Eloi lorsque Cousinet — son point de vue ayant triomphé — réclame Dillette pour sa compagne d’une nuit. Après une scène déchirante avec son amant bien aimé, la malheureuse se livre, se sacrifiant pour Loïet et le loïsme, puis s’empoisonne.
Sa mort ne sauva ni l’un ni l’autre.
Ce drame est une légende ou se rapporte à un fait démesurément grandi, sans doute. Ce qu’il y a d’établi, ce sont les divisions intestines qui perdirent la secte, à la suite de rivalités personnelles. Le bûcher consuma les plus en vue des Loïstes — dont Eloi Pruystinck (voir note) et Christophe Hérault — les autres s’en allèrent en Hollande, en Angleterre, en Allemagne, plus loin encore, conservant en leur esprit la vision d’un Paradis tangible, palpable, où il leur avait été donné d’habiter quelque temps et d’où ils avaient été chassés non par le glaive de l’Ange exterminateur, mais par les dissensions et l’intolérance orthodoxe et politique.
— E. ARMAND
NOTE. Le 25 octobre 1544. La tradition veut que ses bourreaux se soient acharnés sur lui et que — à l’exemple de Jacques de Molay — au moment de succomber, Loïet ait prédit au chef de ses tourmenteurs, Gislain Géry , que non seulement il mourrait vingt ans plus tard, torturé et mutilé comme lui, de la main de son confrère de Bruxelles, mais que son fils, obligé de lui succéder dans son abominable office, agoniserait plus affreusement encore que lui. La tradition veut que les deux prophéties se soient littéralement accomplies. L’hérésie avait pris un tel développement que les prisons ne suffisaient pas à contenir les « coupables » dont les principaux n’étaient pas toujours brûlés ; c’est ainsi que Davion, Brousseraille, van Hove furent décapités ; enfin, beaucoup furent bannis.
LONGÉVITÉ
n. f. (latin longœvitas)
C’est là un mot du langage courant qui désigne le fait de vivre vieux, mais la relativité de cette définition saute aux yeux. Si les mots utilisés font illusion, la plupart du temps, il s’en faut de beaucoup que les objets qu’ils désignent soient précis.
Il faudrait pour que longévité ne fût pas un terme de convention, que l’on fût fixé, physiologiquement, sur la durée normale de la vie, tant des animaux et de l’homme, que des végétaux. Or, de même que la vie est un processus inconnu dans son essence et dans son évolution, de même la date de la mort, autrement dit la longévité, est inconnue.
Nous dissertons sur un terrain de pure approximation. On est toujours le longévite de quelqu’un comme on est le brévivite de quelque autre. Il serait vain, du reste, d’attendre plus de précisions. Pourquoi ?
Parce que le processus vital relève dans sa marche de causes multiples dont la variété est infinie et livrée à tous les hasards. Ces causes sont intrinsèques et extrinsèques.
Causes intrinsèques. — Elles sont telles quand elles visent l’élan vital dont l’individu est possesseur en arrivant au monde et qu’il tient de deux autres facteurs : l’hérédité immédiate (la sienne) et l’hérédité éloignée (celle de la race). Longévité est dans un rapport étroit avec le processus de la dégénérescence qui a raison des races les plus vigoureuses, mais dont la fatalité s’étend sur un nombre indéfini de générations selon le déplacement intercurrent des forces de résistance que l’espèce sait ou peut mettre en œuvre. Faire l’histoire de la décadence d’une race, d’une nation, d’une famille, c’est faire indirectement le procès de la longévité puisque tout processus de régression aboutit obligatoirement à la stérilité, c’est-à-dire à zéro, en passant par une période de longévité progressivement diminuée.
Causes extrinsèques. — Voici maintenant les causes extrinsèques qui finissent, grâce à une accumulation prolongée par modifier l’espèce et par se confondre avec les causes intrinsèques ci-dessus mentionnées.
Les influences extérieures subies par l’individu sont inhérentes aux milieux. L’individu ne naît que pour mourir et sa vie se passe à lutter contre la mort. La vie n’est qu’une lutte constante du point de vue psychologique et social et du point de vue organique.
La vie, dans sa plénitude, comme la longévité, ne sera qu’une résultante de facteurs qui s’entremêlent, s’entrechoquent, s’excitent mutuellement ou se contrarient au détriment de la victime qui est l’Homme. Il n’y a guère d’exemple que l’homme ait jamais triomphé des causes de destruction, ce qui prouve que la vie de l’espèce ne sera qu’une perpétuelle défense ; les conquêtes ne sont que temporaires et toujours fertiles en déceptions. Si l’individu s’insurge parfois et attaque au lieu de subir passivement, s’il parvient à jeter de la poudre aux yeux en modifiant les milieux grâce à son industrieuse intelligence, on ne saurait dire, historiquement parlant, qu’il ait jamais vaincu. Le Væ Victis a toujours pesé sur l’individu, et l’on comprend les velléités d’indépendance qui se manifestent chez les hommes conscients qui s’efforcent de diminuer les causes de misère auxquelles on a succombé à travers les temps. C’est une sorte de sauve-qui-peut, qui seul produira une sélection, laquelle se traduira par une plus grande résistance et par suite par une plus grande longévité.
C’est en vain que l’on objectera que les progrès humains s’échelonnent sur un nombre énorme de générations et que c’est le résultat final qu’il faut envisager pour nos descendants lointains. Là encore, les faits contredisent : car il advient que les progrès allégués ont toujours comporté jusqu’ici de tels abus que ces progrès sont douteux en fait et qu’ils n’ont procuré la longévité qu’à une toute petite exception. Le reste, c’est-à-dire les hommes dans leur ensemble ont toujours marché au gouffre.
L’idée de sélection jaillit tout de même de cet exposé, et c’est toujours à la loi de Darwin qu’il en faut revenir pour comprendre cet important problème de biologie. Elle s’exprime par l’élimination progressive des moins aptes au profit des forts et des habiles. La longévité, comme la dégénérescence, s’entendra donc toujours par rapport aux générations les plus prochaines.
Si, dans une famille on constate qu’un bon nombre de sujets ont vécu plus longtemps que les précédents, on en conclura leur longévité et on la déduira des preuves, faciles à découvrir, des efforts qu’ils ont su réaliser pour surnager dans la dérive,
Si, dans une nation l’on constate que l’âge moyen de la vie a augmenté, on en conclura qu’elle est mieux organisée pour la lutte que les précédentes générations et qu’elle a une plus grande longévité comme rançon de son habile résistance. Les facteurs peuvent du reste s’inverser aussi bien chez l’individu que dans l’espèce. A une période de prospérité relative peut succéder une période de déclin. Telle est la loi du rythme.
Il faudrait des volumes pour rappeler les causes extérieures de diminution de la durée de la vie. Elles sont d’ordre économique, moral, social, politique et pathologique,
La misère engendre des souffrances, physiques et morales, qui s’expriment par une grosse mortalité. Les époques de disette et de famine sont célèbres. C’est par millions que nos frères en humanité, dans les Indes et ailleurs, ont été décimés par la cupidité des conquérants. L’Inde est tristement célèbre, l’opium y a remplacé le blé. Cette mortalité, le plus souvent précoce abaisse la moyenne de la durée de la vie. Et ce n’est pas la multinatalité qui est capable de relever ce niveau. Cette multiplicité des naissances ne fait que grossir le bloc des victimes de la vie.
Dans les pays d’apparence plus libre et plus civilisée, le résultat n’est pas moins frappant. La pseudo-aisance que le capital est censé distribuer aux forçats du travail, et dont ils acceptent trop souvent les chaînes n’empêche point le taux de la vie chère de monter effroyablement et de baisser le ressort physique et moral. Personne n’ignore que la France se dépeuple surtout parce qu’on y meurt trop. Trop mourir, c’est abaisser la moyenne générale de la vie et par suite diminuer la longévité.
Les points de vue moral, social et politique se confondent en somme, parce qu’ils y aboutissent fatalement, avec le point de vue économique. Tout ce qui diminue la puissance intellectuelle et morale d’un sujet le dispose à mourir prématurément. Les chagrins minent jusqu’aux sources de la résistance.
Mais je ne saurais passer sous silence le grand facteur de brévivité que sont les guerres, les immondes hécatombes que l’or et l’instinct de possessivité provoquent périodiquement, sans que les candidats à la boucherie aient été capables jusqu’ici de les détourner. La guerre de cent ans a anéanti des millions d’hommes. Les guerres de l’Empire dont tant de sadiques politiciens affichent pompeusement l’admiration, a saigné le pays et l’Europe aux quatre veines. La race ne s’en est jamais relevée et le niveau moyen de la durée de la vie n’a fait que décliner depuis lors. Comment en serait-il autrement quand on sème sur les champs de bataille les meilleurs étalons et que la sélection ne peut plus être l’œuvre que des résidus échappés à l’holocauste pour raison primordiale de faiblesse ?
Mais que dire du massacre de millions d’hommes qui pourrissent encore autour de nous depuis 1914 et de l’état moral collectif qui en fut la conséquence ? Il faut être voué à la cécité pour n’y pas voir la cause la plus puissante de notre désorganisation sociale, de notre affaiblissement organique et de notre dépression morale.
Un dernier mot sur les causes pathologiques de la brévivité. Les maladies contagieuses, endémiques, constitutionnelles, qui s’abattent sur les individus, comme la tuberculose, la syphilis et l’alcoolisme, qui provoquent la mort prématurée et inutile d’un demi-million de nos compatriotes chaque année, précipitent la décadence. Quelles que soient les améliorations, plus apparentes que réelles, plus incohérentes que logiques, dont les discours politiques font chaque jour étalage pour éblouir la masse moutonnière.
Rien ne montre mieux la relativité trompeuse de la longévité que la répétition inlassable des mêmes statistiques mortuaires, si décourageantes que puissent paraitre les courbes (la tuberculose par exemple). Car il faut saigner la nation, c’est-à-dire le travailleur, de ses plus chers deniers pour maintenir l’apparence de tels résultats ! Et il en sera de même jusqu’au jour où l’on consentira à classer les causes pathogènes par ordre d’importance et à porter l’effort régénérateur là où l’égoïsme humain s’est réfugié.
On voit que le problème de la longévité est tout un monde. Seul, le philosophe peut l’envisager sous son angle véritable. Il est clair qu’il se résume en ces mots : On ne meurt pas, on se tue ou l’on est tué. « L’homme qui ne meurt pas de maladie accidentelle, dit Buffon, vit partout 90 ou 100 ans ». Metchnikoff a démontré que la vieillesse est une maladie. Ce n’est pas cent années que l’homme devrait vivre (car bien qu’il lui appartienne en bonne partie de conduire sa vie beaucoup plus loin, il ne saurait pourtant résister indéfiniment aux causes accumulées de décadence), mais beaucoup plus que cent ans. L’hygiène générale devrait et pourrait enseigner à bien vivre et à mourir noblement. C’est un art en même temps qu’une science.
Chacun est l’artisan de sa vie comme il l’est de son bonheur, de sorte que le dernier mot du problème de la longévité s’appelle l’Hygiène, qu’il faut entendre du point de vue moral comme du point de vue physique.
Toutes les fautes d’hygiène sont une prime à la maladie et par suite à la mort. Mais il est curieux de constater qu’il semblerait y avoir une contradiction dans les faits envisagés de ce point de vue : l’Hygiène est une science moderne, elle est loin à coup sûr d’avoir dit son dernier mot. Elle est née de façon sérieuse depuis un siècle, depuis Claude Bernard avec ses vues hautes sur la biologie générale et depuis Pasteur avec les lumières qu’il a projetées sur l’origine des maladies parasitaires. Le XIXème siècle aura vu la première œuvre de l’hygiène individuelle sérieuse, mais aussi et surtout celle de l’Hygiène dite sociale.
L’idée de faire supporter au milieu ambiant l’énorme part de responsabilité qui lui revient dans la genèse et l’entretien des maux humains devait jeter un jour frappant sur l’avenir et faire germer de grands espoirs dans l’esprit des hommes pour qui vivre vieux est un postulat intéressant.
Or, peut-on dire que ce grand mouvement des idées se soit traduit par des résultats palpables ? Il y a comme une malice dans les événements qui se chargent cyniquement de détruire les plus belles chimères. Jamais l’Homme considéré dans sa masse n’a pratiqué, semble-t-il, plus qu’aujourd’hui, les moyens de se détruire. L’homme succombe moins qu’avant à la tuberculose, mais l’aviation, l’automobilisme, multiplient les causes de décès. Aujourd’hui la mortalité par accident occupe une rubrique de première grandeur parmi les autres causes de mort. Ce n’est pas d’aujourd’hui qu’on a signalé l’illusion du progrès et la relativité encore de ce processus. Ce qu’on dénomme ainsi un peu abusivement n’est parfois qu’une cause intense de régression, de sorte que l’on se demande parfois s’il y a quelque avantage à se porter en avant si l’on ne veut pas ajouter aux causes banales de découragement celles que l’on doit à son propre effort.
Comme tout se tient dans l’histoire de l’Humanité ! Et ce que j’ai dit du mal physique est vrai aussi du mal moral. L’Hygiène dite morale qui balbutie ses premières règles, qui réalise pour l’individu une facile découverte capable d’enrichir sa pensée, d’élever son idéal n’a-t-elle pas aussi pour effet de multiplier ses besoins, de lui imposer par ricochet de nouvelles épreuves s’il se heurte à un milieu mal disposé à favoriser l’évolution de l’Individu.
L’Hygiène mentale, branche de l’Hygiène morale est aussi à ses débuts. Ouvrant des jours nouveaux sur les causes d’amoindrissement cérébral, offrira-t-elle à l’Individu des moyens sérieux de défendre sa vie et par suite d’accroître sa longévité ?
Autant de problèmes qui s’accrochent les uns aux autres et qui montrent tout un monde d’idées se cachant derrière ce petit mot de longévité.
La longévité est-elle du reste une question bien posée sur le terrain de l’Individu ? Est-il intéressant du point de vue de l’Unité de vivre vieux ? J’entends surtout que la question n’est intéressante que par la diminution de la douleur qu’elle fait entrevoir à quiconque a des lueurs en matière d’Hygiène. C’est beaucoup, à coup sûr, mais ne convient-il pas d’élever le problème à des hauteurs où il devient plus large, plus séduisant, plus poétique, sans cesser d’être réaliste et pragmatique ?
N’oublions pas que la vie et la mort sont deux phénomènes étroitement liés. L’homme qui ne voit que sa propre mort, et par suite sa propre vie n’a que des vues étroites.
Je partage la pensée du philosophe pour qui la vie n’est autre chose que l’art de bien mourir, parce que bien mourir c’est préparer la vie heureuse de nos survivants, c’est-à-dire de nous-mêmes réapparaissant dans la race.
L’individualiste à outrance n’a que des vues bornées s’il n’attend de son effort que des jouissances limitées à sa personne et s’il ne conçoit pas que les disciplines qu’il sait s’imposer, si elles limitent sa liberté, peuvent accroitre celle des camarades qui naîtront plus tard, et à qui seront attachées de terribles fatalités.
Diminuer leurs chances de souffrir n’est-ce pas augmenter notre propre élan vital ? Tout s’harmonise, considéré sous cet angle.
On le voit donc :
A l’abri du bourreau social, l’individu peut encore faire œuvre de conservation utile et intéressante, à condition qu’il connaisse les bonnes règles de la vie. Concourir au suicide collectif par négligence ou désintérêt est une absurdité, car l’abandon de soi-même n’est productif que de misères et de souffrances, sans compter qu’il n’est point digne de l’Homme doué d’un cerveau pensant et d’un bras qui travaille.
— Dr LEGRAIN
LOTISSEMENT
n. m.
Dans la société générale, le lotissement, qui est l’action de lotir, revêt une importance sociale de premier plan et constitue une opération d’économie politique.
Ainsi, dans une liquidation ou succession, attribuer à certains, en accord avec lui, un objet, un meuble, une terre, une maison, etc., c’est faire du lotissement. Et les lots, suivant l’espèce d’organisation sociale sous laquelle on vit, sont déterminés : soit par les moyens dont disposent les classes possédantes, soit par les moyens de tous qui sont d’une égalité relative.
A notre époque de domination du capital et du développement des intelligences en rapport de la fortune, il est impossible à la généralité des travailleurs de pouvoir déterminer le lot auquel ils ont droit par le travail et le mérite.
La naissance assigne, en général, la part de facilités ou d’obstacles que chacun doit rencontrer dans la vie. C’est sous un régime de privilèges et de monopoles que se font les lotissements.
En résumé, dans notre société bourgeoise et d’exploitation des masses, le lotissement dessert toujours le travail à l’avantage du capital.
— E. S.
LOUP
n. m. (du latin : lupus), fém. louve
Espèce animale du genre chien, qui peuplait il n’y a pas encore bien longtemps, les grandes forêts de l’Europe, mais qui en a à peu près disparu aujourd’hui. On en rencontre beaucoup en Russie, en Sibérie, et dans le nord de l’Asie, ainsi qu’en Amérique septentrionale.
Le pelage du loup est d’un fauve grisâtre, mais varie selon les climats, en roux ou blanchâtre. Plus grand, plus robuste que le chien, cet animal n’en diffère pas cependant très sensiblement et d’ailleurs des accouplements peuvent avoir lieu et les hybrides obtenus restent indéfiniment féconds, ce qui prouve un voisinage de race assez intime. En deux ouvrages absolument remarquables de vie et d’observation : L’appel de la forêt et Croc Blanc, l’écrivain américain Jack London, présente : là un chien de trait, retournant auprès des loups, ses ancêtres, à l’appel de la forêt ; et ici le fils du chien, redevenu loup, se faisant chien par nostalgie de la société des hommes.
Les loups vivent solitaires, dans les steppes, les fourrées des grandes forêts, les ravins. Ils se reposent le jour, et la nuit entrent en chasse ; l’hiver, ils se réunissent en bandes et, pressés par la faim, s’attaquent aux bêtes les plus robustes, aux bœufs, aux chevaux, aux moutons, et aussi, aux hommes ; mais :
« Une fois le besoin ou le danger passé, ils se séparent et retournent en silence à leur solitude. C’est en hiver que les louves deviennent en chaleur ; plusieurs mâles suivent la même femelle et se la disputent cruellement : ils grondent, ils frémissent, ils se battent, ils se déchirent, et il arrive souvent qu’ils mettent en pièces celui d’entre eux qu’elle a préféré. Ordinairement, elle fuit longtemps, lasse tous ses aspirant, et se dérobe pendant qu’ils dorment, avec le plus alerte ou le préféré. Le loup n’aboie pas, il hurle ; il a l’ouïe très bonne, la vue perçante et l’odorat exquis ; il chasse, portant partout le nez au vent, avec plus d’avantage que le chien. Toujours en garde contre les surprises, l’expérience lui a appris à se défier des hommes, et si l’on ne prend des précautions pour lui dérober le sentiment des pièges, si la moindre odeur d’homme ou de fer vient frapper son odorat, il évite les embûches. Fort et vorace, il attaque les animaux plus gros que lui. Naturellement poltron, il ne brave le danger que lorsqu’il est pressé par la faim. Il emploie la ruse pour approcher des troupeaux, saisir des moutons, des chèvres, des vaches, des chevaux. Le loup a beaucoup de force, surtout dans les parties antérieures du corps, dans les muscles du cou et de la mâchoire. » (Buffon)
Le loup fossile existe dans le diluvium des trois continents où il vit encore aujourd’hui, avec des formes variables mais suffisamment rapprochées de celles des espèces actuelles.
Outre le loup ordinaire, les naturalistes distinguent un assez grand nombre d’autres espèces : le loup noir, le loup odorant, le loup des prairies, le loup rouge, le loup du Mexique, le loup de Java, le culpeu, le Koupara ou chien crabier, le petit Koupara, le corsac, le Karagan et le Kenlic.
Nombreux dans les forêts du centre de la France et de l’Est, les loups, destructeurs des troupeaux, furent combattus comme un véritable fléau. Sous la royauté, leur destruction était confiée à l’un des grands officiers de la couronne, qui prenait le nom de Grand-louvetier. Cette charge disparut avec la monarchie et des primes importantes furent attribuées aux chasseurs pour chaque tête de loup. Le Dictionnaire universel de Lachâtre nous donne les prix suivants : 18 francs pour une louve pleine, 15 francs pour une louve non pleine, 12 pour un loup, 6 pour un louveteau. Il est à noter que c’est là à peu à peu près le seul profit que les chasseurs retiraient de leur travail, car la chair du loup est immangeable et dégage une odeur insupportable. Seule, la peau peut être utilisée pour faire des fourrures chaudes et durables, mais grossières.
Le loup joue un grand rôle dans la fable et les traditions des peuples. Chez les Egyptiens, il était particulièrement adoré à Lycopolis (vile du loup), ce qui n’empêchait pas d’employer la figure de cet animal dans les hiéroglyphes comme le signe du voleur. Les Grecs voyaient dans le loup Lycaon, transformé par Jupiter en bête féroce. Chez eux, cet animal était consacré à Apollon ; chez les Romains, il l’était au dieu Mars ; Romulus et Remus, fils de ce Dieu, avaient été allaités par une louve. Il y a, au musée du Capitole, un groupe dit : louve de Romulus, représentant selon la légende, une louve allaitant Romulus et Remus exposés au pied du Palatin. Ce groupe avait été placé sur le Palatin, en 296 av. J.-C.
Le loup est le personnage le plus sympathique d’une des meilleures fables de La Fontaine, Le loup et le chien, où le grand fabuliste (voir fable), oppose l’amour de la liberté, même dans l’incertitude du lendemain, à la sécurité et l’abondance dans la servitude :
Où vous voulez ? — Pas toujours : mais qu’importe ?
— Il importe si bien que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte,
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. »
Cela dit, maître loup s’enfuit, et court encore.
Le puissant écrivain, poète et philosophe : A. de Vigny, a consacré un de ses plus beaux morceaux à La mort du loup, et l’on connaît la fermeté hautaine et l’ultime fierté de l’apostrophe qui le clôture :
Accomplis jusqu’au bout ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le sort a voulu t’appeler,
Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler ».
Loup, est employé métaphysiquement dans nombre de locutions familières : Il fait un froid de loup : un froid très rigoureux. Marcher à pas de loup : silencieusement, et à dessein pour surprendre. Connu comme le loup gris, ou blanc : être bien connu de tout le monde. Entre chien et loup : sur le soir, au moment du crépuscule, pendant lequel on entrevoit encore les objets sans pouvoir les distinguer. Se jeter dans la gueule du loup : s’exposer, de soi-même, à un péril évident, qu’on pouvait éviter. Enfermer le loup dans la bergerie : mettre, laisser quelqu’un dans un lieu, dans un poste où il peut faire beaucoup de mal. Signifie aussi : laisser se refermer une plaie avant qu’il en soit temps, ou faire rentrer un mal qu’il fallait faire sortir au dehors. La faim fait sortir le loup du bois : la nécessité contraint à faire bien des choses pour se procurer de quoi vivre. La lune est à l’abri des loups : dans les rangs élevés de la société on n’a rien à craindre des personnes de « basse condition ». A chair de loup, sauce de chien : il faut traiter les gens selon leur mérite. Quand le loup est pris, tous les chiens lui lardent les fesses : symbole de la lâcheté générale ; quand un homme fort, ou redouté est tombé, tous ceux qui s’aplatissaient bassement à ses genoux et encensaient sa puissance sonnent l’hallali et se précipitent sur lui comme des chiens à la curée. Les hommes indépendants frappés par le pouvoir, les victimes des erreurs judiciaires connaissent cette lapidation morale et parfois physique de la foule avilie. Le loup mourra dans sa peau : il ne faut pas s’attendre à voir les méchants s’amender. Hurler avec les loups : s’accommoder aux manières, aux mœurs, aux opinions de ceux avec lesquels on vit on avec lesquels on se trouve, quoiqu’on ne les approuve pas entièrement et faire chorus avec eux. Les loups ne se mangent pas entre eux : les méchants ne font pas de mal aux méchants cette locution trouve sa justification dans l’état social actuel, où les maîtres évitent de se dévorer les uns les autres, même lorsque d’idées opposées, ils paraissent le plus se combattre. Quand il s’agit de duper ou d’exploiter le peuple, tous les politiciens se mettent d’accord.
L’homme est un loup pour l’homme : (Homo homini lupus) pensée de Plaute (250–184 av. J.-C. ; Asinaria, II, 4, 88) reprise et illustrée par Bacon et Hobbes, et qui revient à dire que l’homme fait beaucoup de mal à son semblable. Avec l’organisation actuelle de la propriété et l’Etat qui en est la conséquence nécessaire, l’homme est, en effet, un loup pour l’homme. La Fraternité est un mot vain, quand les produits du travail des multitudes peuvent être appropriés par quelques-uns ; car les possédants doivent pour conserver leurs privilèges, sans cesse lutter contre la tendance révolutionnaire des non possédants ; ceux-ci, pour pouvoir seulement subsister, doivent lutter aussi sans un instant de répit contre les exigences du maître toujours et nécessairement insatiable, d’où un état d’instabilité permanent, de drames affreux, de douleurs sans cesse renouvelées, où succombe le plus faible, souvent le meilleur. L’homme est un loup pour l’homme ! Pour que l’homme s’élève à son expression véritable d’homme, il faut qu’il renonce à dominer ses pareils et qu’au lieu de chercher à les assujettir à son autorité, il leur tende une main solidaire.
LOUP
Demi-masque de velours ou satin noir, que mettaient autrefois les dames lorsqu’elles sortaient et qu’on met encore aujourd’hui au bal masqué, en temps de carnaval. — Faute, erreur dans un travail. Agglomération de matière mal fondue qui se forme dans le minerai en fusion. — Constellation australe, comprenant 51 étoiles ; certaines se voient à l’ouest et au-dessous du Scorpion.
— A. LAPEYRE
LOYAUTE
n. f.
Franchise, bonne foi, fidélité à ce que l’on a librement promis, voilà les éléments dont est faite la loyauté. C’est assez dire qu’elle tient peu de place dans notre société où le mensonge, la fourberie, le faux-semblant règnent en maîtres. Masque trompeur qui, sous une illusoire bienveillance cache souvent de très noirs desseins, la politesse n’est qu’un ensemble de formules consacrées, de gestes rituels vides de tout sens profond. A la sympathie qu’affirment les lèvres, le cœur ne souscrit pas ; la fraternité des attitudes contredit la froideur des sentiments. Le système pédagogique, en usage dans nos écoles, incite d’ailleurs l’enfant à tromper les autres avec impudence ; car distancer les concurrents, voilà l’essentiel, bien faire reste accessoire. Aussi de quelles fourberies l’élève devient-il capable, lorsqu’il s’agit d’être premier ou dans un bon rang : copiage discret sur des notes microscopiques, faux renseignements glissés au voisin, insidieuses démarches pour connaître d’avance les sujets de composition. Savants, artistes, écrivains donnent l’exemple. Certaines sommités secrètent la jalousie comme l’abeille distille le miel ; seules leurs idées sont bonnes et malheur au téméraire qui se permet d’en douter. On prodiguera les insinuations malveillantes, quand il s’agira d’un égal, et l’on n’hésitera pas à briser sa carrière si l’on est en présence d’un inférieur ; puis tous les détenteurs de prébendes officielles se dresseront sournoisement contre le jeune dont ils devinent le talent. Dans les salons mondains, potins, cancans, intrigues sont monnaie courante ; devant la personne, on multiplie politesses et mots flatteurs, à peine s’éloigne-t-elle que chacun daube férocement sur son dos. Alors pleuvent les allusions perfides, les coups sournois ; dans ces luttes au poignard certaines femmes excellent.
« Cérémonies religieuses, soirées de bienfaisance servent de prétexte à des rendez-vous galants ; et les quêtes charitables concèdent aux demoiselles le droit de mettre en relief nichons et mollets. Aux jeunes mâles liberté totale de faire la noce en lutinant les femmes ; mais des vieux l’on exige que, en bons soutiens de l’ordre, ils cachent leurs débordements, car le peuple trop simpliste ne comprendrait pas. Pour jouer un rôle politique, il suffira qu’à leurs anciens vices ils joignent l’hypocrisie ; presse, église, haute administration, dont leur caste s’assure la complicité, se chargeront de les travestir en vertueux citoyens. » (Le Règne de l’Envie)
La franchise brutale du peuple est préférable. Chez lui disparaît ce vernis des convenances qui, sous des apparences honnêtes, dissimule les pires dépravations. Pour cacher ses amours aux regards indiscrets, il ne dispose ni d’hôtels confortables ni de jardins soigneusement clos ; et ses ribotes, tapageuses comme l’auberge où elles s’étalent, ne peuvent prétendre au silence tarifé des boites où le champagne coule à flots. Par la crudité d’un langage étranger à l’art de feindre, il offense la pudeur de belles dames, indignées dès qu’on veut traduire en paroles ce qu’elles accomplissent si volontiers en action. Du moins les humbles ne connaissent pas les calculs hypocrites de la dévote ou de l’homme politique ; dans l’ensemble, il y a chez eux plus de loyauté vraie que chez les riches ; les intellectuels et les gens d’église. Cependant qui ne déplore de rencontrer parfois dans les milieux d’avant-garde, une discordance fâcheuse entre les déclarations doctrinales et la façon de se comporter pratiquement ? Quelle force obtiendrait le mouvement de libération, entrepris par ceux qui l’acceptent et être « ni maîtres, ni esclaves », s’ils joignaient toujours l’exemple à l’enseignement ! C’est à leurs procédés charitables, autant qu’à leurs croyances, que les premiers chrétiens durent de triompher des persécutions de la Rome impériale. N’avons-nous pas, comme eux, à lutter contre toutes les puissances humaines coalisées ? Aux buissons épineux du chemin, aux durs cailloux de la route, ne laissons-nous pas des lambeaux de notre chair ? N’est-ce pas à des traces sanglantes, que se reconnaît le passage des meilleurs de nos frères ? Hélas ! Pourquoi faut-il que les embûches soient tendues, parfois, par ceux-là mêmes qui se disent nos amis ; pourquoi faut-il qu’aucune main ne s’offre pour soutenir le voyageur qui tombe épuisé ? Alors surtout que nos doctrines ont cet avantage sur beaucoup d’autres de n’exiger aucune révolution générale, aucune transformation de la société actuelle pour pouvoir être vécues, du moins par quelques-uns, ceux, encore rares, qui les comprennent. « Lorsqu’elles s’accompagnent de sincérité, les plus graves divergences d’idées s’harmonisent aisément dans une mutuelle et respectueuse estime ». Pour une doctrine, pour un mouvement, l’absence de discussions serait, non un signe de vitalité, mais la preuve d’un dangereux arrêt. Toute marche en avant demande que l’on secoue le poids des conceptions qui paralysent, que l’on brise la chaîne des traditions qui rivent au passé. Mais pourquoi supposer que recherches et discussions sont exclusives de l’esprit de fraternité ? « L’humble savoir de la raison a définitivement vaincu l’orgueilleuse prétention des dogmes immuables : énoncer des vérités définitives n’est qu’une preuve de vanité ou d’ignorance ». Le jour où les milieux d’avant-garde opposeraient l’exemple de leur loyauté à la fourberie ambiante, où pratiquement ils réaliseraient, autant qu’il est possible à l’époque actuelle des foyers de libre fraternité humaine, ce jour-là le triomphe de leur idéal n’apparaîtrait plus aussi lointain. Par contre, quel mal font à l’idée ceux qui ne la soutiennent théoriquement que pour la contredire en fait !
— L. BARBEDETTE
LUCIDITÉ
n. f. (de lucidus, lucide)
Que la claire vue de l’esprit soit troublée, qu’un nuage l’obnubile, qu’un prisme déformant s’interpose entre ses yeux et le réel, voilà qui arrive aux cerveaux les plus sains. Dans un essai que je viens d’écrire, Par delà l’intérêt, j’ai voulu mettre en lumière combien nous sommes aveugles lorsqu’il s’agit de nous-mêmes, combien perspicaces à l’égard des vices ou travers d’autrui. Dupe de lui-même, de ses craintes, de ses désirs, l’homme se joue la comédie et par des raisonnements fallacieux, arrive à croire vrai ce qui est manifeste erreur. Vous supposez sans prétention à la beauté, cette malitorne bancale, rouge et borgne ? Dix fois par jour elle demande au miroir de la renseigner sur des charmes, jalousés fortement, elle le soupçonne du moins. Qui, dans son entourage n’a rencontré de ces éternels grincheux, dogues toujours prêts à mordre tyrans dans leurs maisons, sans cesse en dispute avec les voisins ? Ils s’indignent en observant qu’on les fuit, mais impossible de leur faire comprendre qu’ils sont cause de cet éloignement. Mille bonnes raisons légitiment leur fureur continuelle : négligence du laitier, ton hautain de la concierge, impolitesse du locataire d’en face qui ne les ayant pas vus n’a pu les saluer, audace d’un chien qui les regarde sans sourciller, et la pluie quand ils voudraient du soleil, et la gaieté des passants lorsqu’ils broient du noir. En semblable occurrence, avouez qu’un accès de colère est tout indiqué : on n’est pas femmelette que diable ! Chacun doit apprendre qu’on se pique en vous touchant. N’insinuez pas qu’une telle attitude engendre l’isolement, ni qu’on a tort d’avoir perpétuellement raison ; vous seriez jugé, de suite, tête sans cervelle ou faux ami. Car l’homme reste de bonne foi en s’illusionnant avec des arguments frelatés ; dans son for intérieur, il s’attribue d’éclatants mérites, insoupçonnés même de ses intimes et, pour se disculper d’évidents méfaits, sa conscience a la subtile adresse du plus retors des avocats. Juge sans bienveillance lorsqu’il s’agit des autres, nous devenons, quand nous sommes en cause, celui qui plaide éternellement non-coupable. L’égoïsme s’avère créateur d’illusions plus profondes ; les prêtres le savent qui promettent l’immortalité bienheureuse au fidèle qui les sert. Et leurs dupes sont nombreuses tant leur vaine assurance répond aux désirs secrets de beaucoup. Notre moi chéri disparaître, se fondre dans l’ensemble, devenir un impersonnel élément du tout ! Volonté de vivre, instinct de conservation se révoltent contre pareille éventualité ; notre amour de nous-mêmes ne peut s’y résigner. Que les personnages anciens dont partent les livres, que les indifférents de notre entourage soient morts définitivement, nous le croirions sans peine ; nous croyons ainsi l’animal à jamais disparu. Mais que parents, amis, que notre moi s’éparpillent anonymes dans l’immense univers, voilà qui contredit trop notre égoïsme foncier. Aussi, comme il avait fait de dieu le résumé de nos ignorances, le théologien prévoyant concrétisa notre infini besoin de vivre dans la notion d’immortalité. Et la raison chercha des arguments pour légitimer nos désirs : le résultat posé d’abord, une logique illusoire imagina de prétendues démonstrations.
Par contre notre esprit devient d’une lucidité incroyable s’il s’agit de découvrir les faiblesses d’autrui. Sur ce point les enfants mêmes sont extrêmement adroits ; rapidement ils savent ce qui, chez leurs parents, provoque colère ou sourire et, avec une candeur qui n’exclut pas la rouerie, ils évitent les points douloureux ou jouent de la corde sentimentale. L’homme diffère de l’enfant par une méchanceté accrue, ainsi que par un plus large emploi du mensonge, mais les méthodes restent identiques au fond. Ces graves messieurs, vautours de la finance, de la politique ou de l’académie, crâne chauve et l’œil cerclé d’un monocle d’or, épient sans douceur les faiblesses de leurs partenaires : celui-ci n’est qu’une outre gonflée de vent, celui-là sert de caniche à une maîtresse acariâtre, ce troisième d’intelligence redoutable est à vendre au plus offrant. Et, tandis que les bouches n’ont que miel à répandre, quand de partout s’élèvent des congratulations mutuelles et générales, chacun songe au meilleur moyen de frapper celui qu’il encense. Avec les attitudes différentes exigées par le milieu, paysans madrés ou maquignons apoplectiques cherchent, eux aussi, les faiblesses de l’adversaire. Ils savent le pouvoir de l’alcool ou du vin sur les têtes légères, l’importance d’un cadeau fait à point, comment on gagne les bonnes grâces de la fermière, comment on amadoue les vieux. Pour capter l’héritage d’un oncle resté garçon, le neveu de campagne n’est pas inférieur à celui de la ville ; et l’accorte soubrette, pourvu qu’il soit généreux, a vite fait de savoir où le bât blesse chez le galant soit rustre, soit policé. Ce gandin qui donne du « cher maître » aux badernes falotes de Sorbonne ou de l’Institut, attend le succès de leur vanité satisfaite, non de ses mérites personnels ; ce mignon lieutenant, qui fait la roue dans le boudoir de la générale, sait que les galons, souvent, s’acquièrent dans d’amoureux combats. Par les dames, ses ouailles de prédilection, l’Eglise est quasi toute-puissante, même dans les Etats catalogués anticléricaux : l’une d’elles, épouse, cousine ou maîtresse, extorquant sans peine au ministre nominations et décrets conformes aux vœux de leurs chers curés. Elles devinent ce qu’on cache, entendent ce qu’on ne dit pas et dament le pion au plus rusé diplomate ; le prêtre aura des triomphes faciles tant qu’elles resteront ses alliées.
La passion, l’intérêt, voilà les causes ordinaires qui font perdre à l’homme normal sa lucidité. Tout contrôle rationnel est alors écarté. « Logique et clairvoyance s’en vont, comme j’écrivais dans A la recherche du bonheur ; chez l’être aimé tout devient adorable : s’il est prodigue c’est générosité, s’il est avare c’est prudence. Le raisonnement se subordonne au but fixé d’avance, l’idée n’est qu’un prétexte, la critique un complément d’illusion. Un travail de même genre, quoique moins profond, s’observe dès que s’interpose l’intérêt. Quelle ingéniosité déploie la mère pour se tromper sur son enfant, le malade sur sa situation ! Certains littérateurs trouvent moyen de légitimer les pires injustices actuelles ; Aristote fit de même pour l’esclavage antique... Des contes de nourrices se muent ainsi en histoires authentiques, des lampions font figure de soleils ; l’athée devient clérical, le possédant réacteur. Doctrine commode pour harmoniser croyances et intérêts, mais philosophie de snobs et de petits maîtres, aussi absurde que superficielle. Prendre ses désirs pour la réalité, fermer les yeux en folâtrant sur le bord d’un gouffre, danser sur un navire qui coule, n’épargne ni ne retarde un malheur. Amour et lumière résument le bonheur ; la raison en est l’indispensable artisan conjointement avec le cœur ». La partialité dont les historiens font habituellement preuve, les incroyables erreurs dont fidèles et politiciens se gargarisent, les coutumières aberrations de l’esprit de parti, ont également leur source dans un intérêt souvent mal compris.
* * *
Chez le dément, chez l’individu atteint de troubles mentaux graves ou légers, la lucidité devient sujette à des éclipses passagères ou définitives. Quand l’esprit est malade, idées, sentiments, volitions n’obéissent plus aux lois normales de la pensée. Sans paralysie des cordes vocales, et malgré ses efforts, le patient ne pourra dire un mot dans l’aphasie ; dans la surdité verbale, il lira, écrira, mais ne comprendra plus le sens des paroles entendues ; dans l’agraphie sa main refusera d’écrire ; au contraire il parlera, écrira, sans pouvoir se relire ni comprendre la signification des lettres, dans la cécité verbale. D’après Charcot le malade conserverait parfois un jugement intact dans les diverses formes d’aphasie ; on admet aujourd’hui qu’elles s’accompagnent toujours d’une démence plus ou moins profonde et qu’elles répondent à des lésions temporales et pariétales du cerveau. Certains aliénés sont incapables soit de former, soit de remémorer un souvenir. Rarement l’oubli s’avère total dès le début : en premier lieu il atteint les souvenirs récents et les noms propres, pour s’étendre graduellement aux anciens souvenirs et aux noms communs. Le vieillard qui radote narre avec précision les récits de son enfance, mais il répète indéfiniment la même chose parce qu’il oublie de suite ce qu’il vient de dire. Parfois l’amnésie porte simplement sur un système de souvenirs : une veuve ne sait plus rien de son mari défunt, un ouvrier de son métier, un musicien de son art, un savant de ses études. Elle peut englober toute une période : à l’état de veille, le sujet ignore ce qu’il fait et dit pendant les crises de somnambulisme ou d’hypnose. Résultat de chutes, de blessures, de peurs, elle rétrograde sur un temps plus ou moins long, proportionnel à l’importance du choc perturbateur : un officier tombé de cheval perd les souvenirs des trois dernières journées et ne les recouvre que graduellement. Un trouble profond peut même supprimer la remémoration des souvenirs récents : pendant plus de quatre ans une dame ne garde pas trace, dans son esprit, des plus graves événements qui surviennent en sa présence ou l’affectent personnellement. Nombreuses aussi les maladies de la personnalité, parfois bénignes, mais qui d’ordinaire aboutissent à la désagrégation de l’esprit. Unité, identité, pouvoir d’initiative ne sont pas des propriétés primitives de la vie mentale ; ce sont des résultats acquis et toujours fragiles, que la maladie a vite fait de détruire. Alors que certains ignorent, même dans un âge avancé, la vieillesse psychologique, les débiles mentaux gardent toujours une personnalité infantile ; le grand nombre s’arrête au stade du moi égoïste et menteur. Dans les démences séniles ou la dégradation de la personnalité, on constate un retour des formes supérieures aux formes inférieures. La médiumnité, si prisée des amateurs de sciences occultes, consiste dans une altération de l’activité psychologique, faible dans le cas des tables tournantes, déjà forte s’il s’agit d’écriture automatique, très anormale et dangereuse quand elle va jusqu’à l’altération ou au dédoublement de la personnalité. Chez l’homme ordinaire, le contrôle rationnel intervient dès qu’une action implique des conséquences sérieuses ; chez le médium, comme chez le somnambule, l’activité inconsciente, ou du moins subconsciente, prend un développement exceptionnel. Certaines personnes sont sincères en affirmant qu’elles n’ont pas remué la table, qu’elles n’ont rien écrit ; pourtant c’est leur main qui a fait mouvoir la table, qui a tracé les lettres, mais inconsciemment en dehors de toute intervention volontaire et réfléchie. Les messages reçus ne viennent pas d’une mystérieuse entité, ils ne doivent rien aux morts, même en l’absence de supercherie ; ils dérivent de l’activité subconsciente d’individus vivants. Et, dans ses manifestations les plus extraordinaires, je m’en suis convaincu par une enquête approfondie, la fameuse lucidité médiumnimique requiert seulement des forces humaines, absolument dépourvues de tout caractère surnaturel. Sans parler des jongleries, monnaie courante dans le monde du spiritisme, de l’occultisme et de la théosophie. Pas plus qu’au christianisme je n’ai trouvé de base sérieuse à ces religions, dont les adeptes sont parfois sympathiques.
Parmi les altérations graves de l’activité mentale, citons : l’asthénie, trouble des sensations musculaires et viscérales ; la dépersonnalisation qui fait dire au patient : « j’ai perdu mon individualité, ce n’est plus moi qui parle, ce n’est plus moi qui marche, je suis mort » ; les transformations de la personnalité : une femme se croit changée en lionne, un jeune homme se figure être général, roi, dieu. Dans l’égotisme le malade étale inlassablement sa personnalité, ne parle que de lui, du rôle qu’il prétend jouer : le résultat est identique qu’il s’agisse de la folie des grandeurs ou des délires d’humilité. Le trouble psychique peut aller jusqu’à une division de la personnalité. Mary Reynolds a son existence partagée en deux états distincts sans communication entre eux : dans l’état un, elle est triste et lente, dans l’état deux vive et joyeuse ; dans le premier état elle ignore tout du second, dans le second tout du premier. Une personne ou un objet doit lui être présenté dans les deux états successifs pour qu’elle en garde une notion continue. Chez Félida, observée par le docteur Azam, de Bordeaux, la division entre les deux personnalités successives est moins profonde : dans les états premiers elle se rappelle toute sa vie antérieure. Au lieu d’être successives, les personnalités peuvent être simultanées, se manifester en même temps : les prétendues possessions démoniaques rentrent dans cette catégorie. Ce sont des soins médicaux, non de l’eau bénite, qu’il faut pour ces malades.
L’hallucination, perception sans objet, qu’il ne faut confondre ni avec l’erreur ni avec l’illusion des sens, est l’indice d’un état pathologique permanent ou passager. Chez les hommes sains d’ordinaire, les hallucinations de la vue sont les plus fréquentes ; chez les déséquilibrés celles de l’ouïe occupent le premier plan, dans bien des cas. Quand elles se multiplient et que le malade devient incapable de distinguer entre eux : perceptions, souvenirs, conceptions imaginaires, il y a folie. Désordre partiel ou total des facultés, la folie présente des formes extrêmement nombreuses qui peuvent être classées de bien des manières. Il paraît impossible d’établir une ligne de démarcation nette entre l’esprit lucide et celui qui ne l’est pas, lorsque les troubles mentaux sont légers. Beaucoup de familles en profitent pour faire interner, avec la complicité d’un médecin, des hommes excentriques mais dont le cerveau reste parfaitement sain.
A l’heure des dissolutions finales, quand la mort arrive, la lucidité mentale disparaît chez beaucoup ; la raison perd tout contrôle, habitudes et croyances enfantines reviennent à la surface. L’Eglise en profite, aidée par les parents, les femmes, ou une autre personne aimée du moribond, pour arracher des rétractations dont elle devrait rougir, puisqu’ elles émanent d’un cerveau en décomposition. Et, sur le cadavre de son ennemi terrassé, elle multiplie signes de croix et bénédictions. Comment imaginer spectacle plus écœurant, lorsqu’on réfléchit !
— L. BARBEDETTE
LUCIDITÉ (PATHOLOGIE)
C’est en psychiatrie que le problème de la lucidité trouve sa place.
Il est sous la plume du neuropsychiatre à tout instant, car la pathologie a délimité des états où l’aliénation mentale n’est pas incompatible avec la lucidité. La contradiction n’est qu’apparente si l’on conçoit que l’unité de l’âme n’est qu’une billevesée de scolastique et qu’il en est des multiples fonctions de la personnalité, ce qu’il en est d’autres fonctions complexes.
Le cerveau est pour l’observateur moniste sur le même plan que le foie ou les reins. On peut donc concevoir l’automatisme de certains centres nerveux tels que d’autres centres, préposés au contrôle, y assistent, de façon lucide, mais impuissants.
Tous les aliénistes connaissent des fous lucides qui apparaissent comme psychiquement dédoublés. Prenons pour exemple le kleptomane qu’il ne faut pas confondre avec le voleur. Cet obsédé qu’un appétit formidable entraine vers la possession urgente et immédiate d’un objet qui n’est pas son bien propre, a la parfaite notion qu’il n’a point le droit de prendre, que son appétit est parfaitement déplacé, qu’en prenant, il va risquer sa réputation, et encourir des sanctions légales. Il le sait, il le déplore, il veut et ne veut pas simultanément. La lutte qui s’engage en lui témoigne de sa lucidité. Il cherche à apaiser une impulsion qu’il sait immotivée, car l’appétit qui l’étreint ne rime à aucun besoin réel.
Et pourtant il sent qu’il va succomber. Il succombe et aussitôt, malgré le regret qui le hante, il éprouve une satisfaction organique qui n’a aucun rapport logique avec la possession d’un objet sans intérêt.
Au lieu du kleptomane prenons le dipsomane qu’il ne faut pas confondre avec le buveur. Ce dipsomane est pris d’une soif morbide qui le pousse à absorber des boissons qu’il sait dangereuses et dont au fond il ne veut point. Il jouit d’une parfaite lucidité, se gourmande, supplie même qu’on lui lie les mains. Et pourtant il succombe et il succombera de nouveau tant que durera l’accès.
En pathologie mentale, lucidité ne marche pas de pair forcément avec conscience. On peut être conscient d’un état sans porter sur cet état un jugement conforme à la vérité. Voici un aliéné qui s’expose avec tout le comportement d’un potentat ou d’un grand de la terre. Il a une conscience tellement nette de son cas qu’il en discute avec une puissance curieuse de raisonnement. Il accumulera toutes les raisons, bonnes et surtout mauvaises, de vous convaincre qu’il est milliardaire quand il n’a pas un sou ; il étalera sa puissance à l’aide de mille signes extérieurs. Il est conscient mais il n’est pas lucide, car il se trompe et vous seul le savez.
Sur le terrain de la psychologie normale les deux vocables conscience et lucidité sont du reste en parfaite concurrence. Car personne n’est en possession de la vérité qui est toujours relative, et le signe de la certitude est toujours introuvable.
Il y a chance seulement d’effleurer un peu plus de vérité, si l’on se soumet à la discipline très dure qui consiste à objectiver ses jugements. Le malheur est que la plupart des hommes qui tout naturellement naissent subjectifs, restent fidèles à la méthode subjective et s’en rapportent à eux comme étalons de vérité. C’est burlesque et cette façon de raisonner entraine chaque jour les plus étranges conflits.
Pour être lucide, ou tout au moins, pour être sur la voie d’un peu plus de lucidité, il faut rechercher une commune mesure si conventionnelle qu’elle puisse être un type étalon, auquel on rapporte ses jugements Où sont les critères, où est la collection de critères qui permettront à l’homme de se rapprocher de l’absolu ? Il y a encore du travail pour les psychologues.
— Dr LEGRAIN
LUMIÈRE
n. f. (du latin lumen, rad. lux, même sens, ou bas latin luminaria)
Agent qui produit chez les animaux pourvus d’yeux, la sensation de la vision ; cause de la visibilité et de la coloration des corps. Eclat particulier des corps incandescents qui permet de distinguer les objets placés dans leur rayonnement ; la lumière des astres, de l’électricité, etc. Flambeau, jour (expression métaphorique qui prend ici la cause pour l’effet). Désigne aussi, poétiquement, la vie ; Châteaubriand écrit :
« Pourquoi la lumière a-t-elle été donnée à un misérable, et la vie à ceux qui sont dans l’amertume du cœur ? »
Au figuré, il caractérise l’éclat physique ou moral, et surtout : intelligence, clarté, savoir, connaissance, et, en général, tout ce qui éclaire ou dirige l’esprit. « On distingue les lumières naturelles et les lumières acquises ». Il n’y a que deux choses dit Bastiat, qui puissent sauver la société : « la justice et la lumière ». L’ignorance est le milieu familier de la servitude. Eclairer les esprits, c’est surtout en préparer la conscience, en rythmer intelligemment les élans... Aux ténèbres de la foi, qui paralysent l’essor de l’homme, le maintiennent dans la peur et l’obéissance doivent succéder les lumières de la raison, qui l’émancipent et agrandissent son domaine.
On dira, pour marquer que sa personnalité a brillé sur son temps par quelque qualité rare, par son éloquence, par ses connaissances ou son génie, qu’un écrivain, un savant fut une lumière du siècle, un avocat, une lumière du barreau, etc. Pour caractériser leur aisance, leur beauté, leur compréhension spontanée, on qualifie de lumineux tel esprit, idée, pensée ou discours...
LUMIÈRE
n. f. (bas latin luminaria)
Newton admit que les corps lumineux émettaient des particules matérielles, animées d’une grande vitesse, dont le choc sur la rétine produisait l’impression visuelle ; et il tenta d’expliquer tous les phénomènes optiques par le mouvement de ces particules, que l’on supposait pointues par un bout, arrondies à l’autre et douées d’un mouvement de rotation sur elles-mêmes. Quand elles rencontraient un obstacle par leur partie arrondie, il y avait retour en arrière ou réflexion ; si la rencontre avait lieu par la pointe, il y avait pénétration et réfraction ; ce dernier phénomène s’expliquait par une différence de vitesse dans les divers milieux. Les expériences de Foucault démentirent la théorie de l’émission ; Young mit en relief les analogies qui existaient entre le son et la lumière, analogies confirmées ensuite par les travaux de Fresnel. Aussi croit-on présentement que la lumière résulte du mouvement vibratoire d’un milieu infiniment élastique et répandu partout, l’éther : c’est la théorie des ondulations. Un écueil a surgi depuis qu’Einstein a développé sa doctrine de la relativité. Selon ce dernier, et contrairement aux conclusions des adeptes, à la fois, de Newton et de Fresnel, la lumière ne se propage pas en ligne droite. Sur ce point trois faits expérimentaux confirmeraient la doctrine du grand théoricien : le déplacement du périhélie de Mercure, la déviation de la lumière des étoiles par le Soleil et le déplacement des raies solaires vers le rouge. L’anomalie constatée dans le mouvement de Mercure s’explique, dans la thèse classique, en donnant au Soleil une forme très peu différente d’une sphère ; dans la thèse d’Einstein le déplacement de 43 » par siècle, dans le sens voulu, est normal et n’exige aucune explication complémentaire. Selon Einstein, il y aurait déviation du rayon lumineux qui passe au voisinage d’un corps de grande masse ; déviation qui l’incurverait, tel la trajectoire d’un projectile lancé au voisinage de la terre. Une expérience tentée lors d’une éclipse totale du Soleil aurait donné des résultats presque d’accord avec la théorie einsteinienne. Enfin les mesures effectuées auraient vérifié dans l’ensemble le déplacement des raies spectrales solaires vers le rouge, par rapport aux raies produites sur la terre, comme le veut la même théorie.
D’autre part l’éther, agent de transmission des ondes lumineuses, subit-il un entraînement comme il arrive dans le milieu propagateur des ondes sonores ? D’après Fizeau l’éther éprouverait un entrainement total ; d’après Fresnel un entrainement partiel seulement. Et, contrairement à Newton qui supposait implicitement des actions instantanées, ce dernier physicien tenait compte de la durée de transmission des ondulations qui se propagent de proche en proche dans un milieu adéquat ; il appliquait les idées de Newton à la théorie de Huygens. Lorsqu’il s’agit de déplacement, il faut introduire une nouvelle variable : le temps. Or les calculs tout théoriques de la doctrine relativiste concorderaient aussi avec les résultats expérimentaux ; de plus l’interprétation relativiste présenterait l’avantage d’être purement cinématique et de n’exiger aucune hypothèse sur la constitution de l’éther. Appliquée à l’étude de l’influence du déplacement de la terre par rapport à l’éther supposé immobile, la doctrine einsteinienne a fait l’objet d’une confrontation expérimentale basée sur les phénomènes interférentiels, à l’aide du dispositif de Michelson et Morley. Les résultats furent négatifs. Est-ce parce qu’il s’agit de grandeurs de l’ordre du cent millionième, non mesurables expérimentalement, ou parce que la source lumineuse, le dispositif optique et l’observateur sont entraînés dans le mouvement de la terre ? Les partisans d’Einstein le prétendent, mais ses adversaires ne le croient pas.
A côté de la lumière visible des sept couleurs de l’arc-en-ciel qui par leur superposition donnent la lumière blanche et dont chacune répond à une longueur d’onde différente, il existe des radiations obscures qui n’impressionnent pas du tout la rétine. Les plus connues sont les rayons infrarouges, c’est-à-dire en deçà du rouge dans le spectre solaire, et les l’avons ultraviolets c’est-à-dire au-delà du violet. Les premiers ont une grande action calorique, mais une action chimique négligeable ; les seconds, au contraire, provoquent de multiples actions chimiques mais ne déterminent pas d’élévation thermométrique sensible. Maxwell, dont les vues théoriques, furent confirmées par les expériences d’Hertz, a fait rentrer la lumière dans la série des ondes électromagnétiques. On sait que les ondes lumineuses vont d’une fréquence de 400 billions par seconde et d’une longueur d’onde de 0,75 micron, dans le rouge, à une fréquence de 800 billions et à une longueur d’onde de 0,35 micron, dans le violet. Elles constituent la partie perceptible par l’œil de la gomme électromagnétique, qui se continue, d’un côté, par l’infrarouge et les ondes hertziennes, pouvant atteindre des kilomètres d’amplitude, et, d’un autre côté, par l’ultra-violet, suivi d’ondes de plus en plus courtes mais de plus en plus rapides, puisque ces deux éléments sont toujours inversement proportionnels. Les ondes des rayons X et Y sont les plus courtes que nous connaissions à l’heure actuelle. Toutes les ondes électromagnétiques comportent d’ailleurs un spectre, se réfractent et se dispersent ; comme la lumière, elles résultent de sources vibrantes, les électrons, dont les effets sont comparables à ceux du diapason dans le monde sonore. Par l’étude des séries de lignes qui suivent au-delà de l’ultraviolet on arrive à connaître la structure de l’atome ; optique, électromagnétisme, étude des rayons cathodiques et de la radioactivité aboutissent, pris séparément, aux formules mathématiques de la thèse ondulatoire.
Descartes croyait à la propagation instantanée de la lumière ; mais Rœmer en 1676 reconnut l’erreur à la suite d’observations sur les satellites de Jupiter. Fizeau avec la méthode de la roue dentée. Foucault avec celle du miroir tournant ont permis de préciser la vitesse de cette propagation ; elle est de 300.000 kilomètres par seconde environ, Ce problème a conduit Einstein à transformer les anciennes conceptions de l’espace et du temps. Vitesse limite, celle de la lumière ne pourrait être dépassée, ni même atteinte par aucun corps matériel. D’après la relativité, la durée du battement d’une horloge, animée d’une vitesse égale à celle de la lumière, serait infinie parce qu’elle serait proportionnelle à cette vitesse. En fait, on constate que les particules émises par les corps radioactifs n’atteignent jamais la vitesse de la lumière bien qu’elles en approchent beaucoup. En astronomie, les distances sont si énormes qu’on les calcule souvent en années-lumière : l’année-lumière représentant la distance franchie par la lumière au cours d’une année. Ainsi, Centaure, l’une des étoiles les plus proches, est à 4, 3 années-lumière ; la plupart ont une distance au moins égale à 100 années-lumière ; il en est dont les années-lumière se comptent par centaines ou par milliers.
On a beaucoup étudié ces derniers temps, l’action chimique des radiations ultraviolettes et suivantes. Action variable avec les longueurs d’onde ; c’est ainsi que l’ozone, généré de l’oxygène sous telle longueur d’onde, sera détruit sous telle autre. Certaines radiations sont destructives de la matière vivante ; elles tuent promptement champignons, microbes et spores, d’où l’action bienfaisante de la lumière solaire. Les rayons ultraviolets peuvent déterminer des conjonctivites très douloureuses et les rayons X ont causé trop de victimes pour qu’il soit nécessaire d’insister. Phénomènes de fluorescence, de résonance optique et d’ionisation dans certains gaz, sont actuellement l’objet de nombreuses recherches. Grumbach a découvert récemment que ces radiations modifiaient la tension superficielle des liquides fluorescents. A Luxeuil, grâce à M. Royet, qui poursuit des expériences approfondies sur ce sujet, j’ai pu apprécier la valeur de ce nouveau domaine ouvert aux physiciens. Ce dernier a montré que les liquides les plus sensibles présentent une fluorescence marquée et que la tension superficielle était d’autant plus modifiée que la longueur d’onde des radiations employées était plus courte, ouvrant ainsi la voie à des recherches nouvelles sur les rayons X. L’optique n’est certes pas la partie la moins avancée de la physique ; mais beaucoup reste à faire, car la science ne prétend pas nous donner, du premier coup, des vérités définitives ; plus modeste que le dogme, parce que moins imaginaire, elle est heureuse dès qu’une découverte lui permet d’abandonner de vieilles erreurs et d’avancer d’un pas dans la connaissance de l’univers.
— L. B.
LUNE
n. f. (latin luna)
La lune qui réfléchit la 618.000ème partie de la lumière solaire n’est qu’à 384.436 kilomètres, distance franchie par le rayon lumineux en une seconde un quart. Elle marche à raison de 1 kil. 17 mètres par seconde sur son orbite longue de 2.400.000 kilomètres et tourne autour de la terre en 27 jours 7 heures 43’ 11 » en lui montrant toujours la même face, la force centripète tendant à l’emporter sur la centrifuge à la petite distance qui nous sépare d’elle. Mais comme, pendant l’accomplissement de sa révolution sidérale, la terre a continué son mouvement de translation autour du soleil, la lunaison, intervalle entre deux nouvelles lunes, se trouve être de 29 jours 12 heures 44’ 3 ».
Le volume de la lune est 49 fois plus petit et son poids 81 fois plus léger et se calcule par la part qui lui revient dans l’action qu’elle exerce avec le soleil sur les marées qui lèvent l’eau de l’Océan deux fois par jour. Le diamètre de la lune vaut moins que le quart de celui de la terre et sa surface qui est à peine la 14e partie de celle de la terre est de 38 millions de kilomètres carrés. Mais comme l’astre qui éclaire nos nuits nous montre constamment le même côté, nous ne connaissons que 21.833.000 kilomètres carrés de sa superficie totale.
Les phases de la lune sont déterminées par sa position relativement au soleil. Lorsqu’elle passe entre lui et nous, nous ne la voyons pas, parce que son hémisphère non éclairé est tourné vers la terre : c’est la nouvelle lune. Lorsqu’elle forme un angle droit avec le soleil, nous voyons la moitié de son hémisphère éclairé ; c’est le premier ou le dernier quartier et lorsqu’elle est à l’opposé du soleil, c’est la pleine lune et nous voyons toute sa surface éclairée.
La superficie de l’hémisphère de notre satellite que nous voyons au moment d’une pleine lune est constituée aux trois-quarts par des montagnes et pour l’autre quart par des plaines, anciennes mers desséchées.
Parmi les montagnes les plus rayonnantes nous citons Tycho, Copernic, Kepler, Aristarque et parmi les sommets les plus élevés ce sont les monts Leibniz et Dœrfel qui atteignent 7.600 mètres. Pour établir ici une comparaison entre ces altitudes et celles des plus hautes montagnes de la terre, ces dernières doivent être mesurées, non du niveau de la mer, mais des plus grands creux de l’Océan ce qui, au lieu de 8.800 mètres donnerait environ 18.000 pour les plus hautes cimes de l’Himalaya.
A toutes ces curiosités la topographie lunaire s’ajoute un phénomène bien extraordinaire dans ces régions polaires, où les sommets des montagnes restent perpétuellement éclairés par le soleil. Ce caractère physique, surprenant, s’explique par ce fait que, par suite de la position de la lune dans l’espace, le soleil ne descend jamais que de 10,5° au-dessous de l’horizon de l’un ou l’autre pôle lunaire et qu’en raison de la petitesse de la lune une élévation de 600 mètres suffit pour voir au-dessous de l’horizon vrai. Or, il y a, juste à la place du pôle boréal et austral, des montagnes de 2.800 à 4.000 mètres.
Citons encore avant de quitter notre satellite ses éclipses qui se produisent au même moment physique, c’est-à-dire, par exemple, à minuit à Paris et à 7 heures du soir, à New-York, quand il entre, en partie (éclipse partielle) ou complètement (éclipse totale) dans le cône d’ombre de la terre. Ce cône d’ombre se termine en pointe à une distance de 108 fois et demie la longueur du diamètre de la terre.
A la distance moyenne de la lune, l’ombre de la terre est encore 2,2 fois plus large que la lune, ce qui fait que la plus longue durée d’une éclipse totale de la lune peut être de 2 heures. L’éclipse de lune a toujours lieu au moment de la pleine lune et est visible au même instant dans tous les pays, où la lune se trouve au-dessus de l’horizon. Mais, grâce à la réfraction des rayons solaires, la lune ne disparaît presque jamais complètement dans les éclipses totales. Elle n’est absolument devenue invisible que pendant les éclipses de 1642, 1761, 1816 et celle du 12 avril 1903.
Mais ce qui différencie le plus la lune de notre terre et des planètes de notre système solaire, c’est son absence totale d’air qui ressort de la constatation qu’il n’y a pas de crépuscule sur la lune et qu’on trouve une égalité parfaite entre le calcul et l’observation lorsqu’une étoile disparaît derrière le disque.
Ce manque d’atmosphère entraîne l’absence du son, du crépuscule et des aurores et seule la lumière zodiacale annonce sur ce monde lugubre l’arrivée du soleil, qui met une heure au lieu de deux minutes un quart comme chez nous, à se lever.
La lumière cendrée que nous voyons n’émane pas de la lune, elle n’est que de la lumière terrestre, c’est-à-dire le reflet d’un reflet qui va frapper la lune. C’est grâce à elle, qui reflète parfois les contours du continent australien, que Castelli, l’ami de Galilée, a pu deviner en 1637, l’existence de l’Australie longtemps avant sa découverte.
Vue de la lune, où le manque d’atmosphère permet aux étoiles de continuer à briller le jour comme la nuit dans un ciel noir et profond au milieu de l’éternel silence, notre terre présente un premier croissant pendant le jour, un premier quartier au couchant du soleil, la pleine terre au milieu de la nuit, son dernier quartier au lever du soleil et son dernier croissant le matin. Lorsque nous avons nouvelle lune il fait pleine terre sur la lune et les parages de notre satellite sont alors éclairés d’une intensité égale à 14 fois notre pleine lune...
... Darwin a dit quelque part qu’il y a 54 millions d’années que la lune était née des entrailles alors ignées de la terre, d’où il s’ensuivrait que notre planète aurait environ 200 millions d’années et le soleil 22 milliards. Nos connaissances actuelles nous permettent d’affirmer que ces chiffres sont bien au-dessous de la vérité et que quelques milliards d’années ont dû s’écouler depuis que le soleil a accouché de ce qui est devenu notre incohérente planète sublunaire.
Quoiqu’il en soit, il est certain qu’actuellement la lune est inhabitée dans le sens que nous donnons à ce mot, parce que l’analyse spectrale atteste que l’eau et l’air font absolument défaut sur notre satellite. Si maintenant nous envisageons ce qui se passe sur la planète Mars, notre sosie dans l’espace, mais où la vie organique paraît à son déclin, nous tirons de l’unité constitutive de l’univers, la conclusion, ou plus modestement l’hypothèse présente, que toutes les planètes qui peuplent l’infini des mondes solaires sont, ont été ou seront habitées, mais que la vie simultanée sur les planètes d’un même système solaire doit être assez rare.
La lune plus jeune, plus petite et plus vite refroidie que notre terre, est aujourd’hui un cadavre. Elle était animée et à son apogée quand notre terre était un petit soleil, mais maintenant, privée de feu, d’eau et d’atmosphère, elle est le pays au sol ravagé de crevasses, rides de vieillesse, de désagrégation et de silence sans fin et où des nuits glaciales, longues de plus de 300 heures terrestres, alternent avec des jours brûlants, au-dessus duquel les étoiles brillent nuit et jour, sans scintiller, dans un ciel sombre de velours noir.
La lune est aujourd’hui ce que notre terre apparaît devoir être elle-même dans un lointain futur... avant de se dissoudre pour retourner à l’éther et renaître sans doute quelque jour, comme le phénix de la légende égyptienne, à une vie analogue, renouvelée et rajeunie...
— Frédéric STACKELBERG
LUTTE
n. f. (du latin lucta, dérivé de luere, pris dans le sens de solvere, laxare, parce que, dans la lutte, il est question de relâcher les liens dont les membres de l’antagoniste enveloppent le lutteur)
Combat corps à corps et sans armes, de deux hommes qui cherchent à se renverser. C’était un des principaux exercices des anciens et leur spectacle favori. Ils connaissaient trois sortes de luttes : la lutte perpendiculaire (érecta), la lutte horizontale et l’acrochisme. Dans la première, la plus pratiquée, on se proposait de renverser l’adversaire et de le terrasser.
« Pour arriver à ce résultat, la ruse et la force étaient également employées par les athlètes, qui s’empoignaient réciproquement les bras, se tiraient en avant, se poussaient et se renversaient en arrière, s’enlaçaient les membres, se prenaient au col, se serraient la gorge jusqu’à s’ôter la respiration, se pliaient obliquement sur les côtés, se soulevaient en l’air, se heurtaient le front comme des béliers. Le croc-en-jambe était admis. Enfin l’un d’eux se laissait renverser ; alors commençait la lutte horizontale (volutatis lucta : la roulée sur le sable). Dans cette seconde phase de lutte, les deux adversaires combattaient courbés sur la terre, roulant l’un sur l’autre et s’entrelaçant de mille façons, jusqu’à ce que l’un des deux prît le dessus et forçât l’autre à crier merci. Dans l’acrochisme, les athlètes ne se prenaient que par l’extrémité de la main et par les poignets, se les tordaient et tâchaient de se renverser ainsi. »
Avant la lutte, les athlètes se faisaient frotter le corps d’huile, ce qui contribuait à donner de la souplesse aux membres. Mais comme ces onctions, en rendant la peau trop glissante, leur ôtaient la facilité de se prendre au corps avec succès, ils remédiaient à cet inconvénient, tantôt en se roulant sur la poussière du palestre, tantôt en se couvrant réciproquement d’un sable très fin, réservé pour cet usage dans les xystes, ou portiques des gymnases. Les combats de la lutte remontent à la plus haute antiquité ». Chez les Grecs, les vainqueurs étaient chantés par les poètes et représentés par les sculpteurs. (A Rome, la lutte fut beaucoup moins pratiquée et ne figure dans les jeux que par exception). Homère a célébré, dans l’Iliade, la lutte d’Ajax et d’Achille ; Ovide celle d’Hercule et d’Achéloüs dans ses métamorphoses ; Lucain, celle d’Hercule et d’Antée ; Itare, celle de Tydée et d’Agilée... Les Lutteurs, groupe statuaire que l’on voit à Florence, au palais des Offices, attribués Céphissodote, sont parmi les plus belles des sculptures antiques qui exaltent la lutte et sa plastique...
Parmi les jeux qui font appel à la force physique, la lutte, confrontant des athlètes aux puissantes musculatures, conserve quelques indéniables beautés d’attitude et de rythme. Mais elle a vu, depuis quelques décades surtout, sa vogue décroître rapidement. Pratiquée encore un peu partout, mais sans conviction, elle est regardée comme un sport trop « mou », mièvrement courtois et désespérément inoffensif, par les spectateurs modernes, revenus au goût des émotions violentes et au « sport » de domination. Le public a cessé de se passionner pour un Constant le Boucher ou un Laurent le Beaucairois. Il ne trépide plus qu’aux carnages du ring, lorsque des brutes échangent ces coups d’assommoir qui tuméfient les chairs et font, en quelques rounds « palpitants » s’écrouler les corps comme des masses anéanties. Les Carpentier, les Dempsey, les Tunney, encensés d’ailleurs par les trompettes « littéraires » de la démagogie journalistique sont — selon la réussite du droit ou de l’uppercut — ses idoles du jour. Et la boxe, autrement bestial, est parée pour lui du nom d’ « art » ! ...
Le jiu-jitsu est un système particulier de lutte importé du Japon, qui permet le triomphe de l’adresse et de l’agilité sur la force brutale. Le lutteur s’emploie à atteindre, avec plus ou moins de violence, certaines parties du corps plus particulièrement sensibles, dans le but de mettre l’adversaire hors de combat : coups du tranchant de la main à la tête, au cou, à l’avant-bras ; coups de coude à la figure, à l’estomac ; coups de genou au bas-ventre ; pressions douloureuses de la carotide ; torsion des jambes, des avant-bras, des poignets, des doigts, etc.
Par extension : Rixe dans laquelle on se prend corps à corps.
Figuré : Combat, guerre, dispute, controverse, conflit : sa vie entière fut une lutte et il fut infatigable. La douleur me tuerait ; il y a trop de lutte en moi contre elle (Mme de Stad). La doctrine de Luther occasionna une lutte violente entre les théologiens (Besch). La lutte du bon et du mauvais principe : Ormusd et Ahriman, dans le Zend-Avesta de Zoroastre...
Faire quelque chose de bonne lutte : la faire honnêtement, franchement. Emporter quelque chose de haute lutte : Venir à bout de quelque chose par force, par autorité. La lutte amoureuse : ébats et plaisirs de l’amour.
Lutte de classes : v. classe.
Lutte universelle : Titre d’un ouvrage très intéressant, de Félix le Dantec, qui porte en exergue : « Etre c’est lutter, vivre c’est vaincre », et qui établit d’une manière remarquable que la vie universelle n’est qu’une façon de traduire la lutte universelle, et vice-versa.
« C’est, en effet, dans des phénomènes qui peuvent être ramenés à des luttes, à des « corps à corps » que se rencontrent toutes les particularités auxquelles on s’est adressé pour déclarer que les corps bruts sont vivants ; pour raconter ces « corps à corps », il faut naturellement douer de personnalité tous les objets qui nous entourent. Ce n’est là, sans doute, qu’un artifice de langage, mais qu’est-ce qu’un système philosophique sinon une manière de s’exprimer ?
L’idée de lutte est tirée de l’observation des hommes, ou, tout au moins, des animaux ; quand deux hommes ou deux animaux luttent ensemble, c’est pour conquérir un certain avantage ; la notion de lutte est inséparable de la notion d’avantage, de bénéfice, notion qui ne saurait elle-même se passer de l’idée d’individu, de personne. Si donc l’on veut étendre à tous les corps de la nature une manière de parler primitivement réservée aux animaux, il faut douer de personnalité, d’individualité, les corps bruts aussi bien que les corps vivants.
L’idée de lutte résultant de l’observation des animaux, c’est chez les êtres vivants que nous devons essayer d’abord d’en préciser la signification. Il faudra d’ailleurs dès le début, faire intervenir des corps bruts dans la question, car le phénomène immédiat de la lutte se passe entre l’individu et son ambiance, bien plus souvent qu’entre l’individu et un autre individu. On peut même définir la vie : « l’envahissement du milieu par l’être vivant » ou tout au moins « la résistance de l’être vivant aux actions destructives du milieu ». C’est là une lutte au sens rigoureux du mot.
Surtout dans les espèces dépourvues de squelette, la vie apparaît nettement comme une lutte de tous les instants entre l’hérédité gardienne des formes ou des propriétés individuelles et les actions extérieures destructives. La conservation de la vie établit le triomphe de l’hérédité, mais ce triomphe n’est jamais complet ; l’être vivant évolue. La vie est un compromis entre la tradition conservatrice et les influences révolutionnaires ; c’est ce compromis que l’on désigne d’un mot : « l’habitude » ; vivre c’est s’habituer.
Si l’on passe de la vie individuelle à la vie spécifique, l’évolution, la transformation de l’espèce, empêchent également de considérer comme complet le triomphe des corps vivants sur les corps bruts ; l’hérédité rigide est corrigée par la transmission des caractères acquis. Il y a toujours lutte, il y a toujours victoire, tant que la lignée n’est pas interrompue, mais cette victoire ne s’obtient qu’au prix de concessions inévitables.
Ainsi, l’étude des êtres vivants, si elle fait naître immédiatement en nous l’idée de lutte, nous montre aussi que cette lutte n’entraîne jamais un triomphe absolu. L’évolution enlève fatalement à l’hérédité ce que celle-ci a de trop précis ; l’hérédité n’est qu’une loi approchée. »
Alors que les autres animaux, hormis des circonstances exceptionnelles, pratiquent le respect de l’espèce, la lutte, au sein de l’humanité, jette les uns contre les autres individus et peuples, parfois pour le besoin, le plus souvent par convoitise avide et passion de lucre. Au lieu de diriger hors de l’espèce, pour garantir leur existence, des efforts conjugués et intelligents, les hommes s’entredéchirent, se ravissent entre eux jusqu’aux biens vitaux, accumulent et thésaurisent sans but, poussent l’illogisme imbécile et criminel jusqu’à laisser périr de famine des provinces entières, alors que les denrées salutaires pourrissent, amoncelées, dans les docks des accapareurs.
A la « lutte pour la vie » (pour la non-disparition), naturelle et normale, qui met aux prises les espèces, est venue s’ajouter, chez les humains, (la déformant et l’exacerbant, en décuplant la violence, sournoise ou brutale) la lutte pour le privilège et la prépondérance, pour la mainmise sur les richesses et le pouvoir sur les hommes. Dans cette lutte, les anarchistes ont leur place marquée sous le signe d’une logique équité. Ils sont avec le faible contre le fort, avec le pauvre contre le riche : ils sont contre les institutions et les mœurs qui consacrent un antagonisme absurde, douloureux et tenace. Ils s’efforcent de développer dans la conscience des opprimés la notion d’un droit primordial identique et de hausser leur volonté à une attitude en accord avec ces convictions intimes. A la lutte interhumaine, ils tendent à substituer une entraide avisée, une lutte commune pour le développement et le bonheur des hommes.
Dans l’Initiation individualiste anarchiste, E. Armand, considère ainsi le problème :
« La réaction au sein du milieu ou la rupture d’équilibre en un milieu donné constitue très probablement la forme élémentaire de la vie, dans tous les cas sa manifestation incontestable. Dans un milieu donné, répétons-nous, que nous supposons idéalement uniforme, apparaît un bouillonnement, une agitation, une fermentation. C’est un signe de réaction, le symptôme d’une forme de vie autre que celle du milieu : il ya rupture d’équilibre. Or, cette vie s’affirmera dans et par la lutte qui va désormais se livrer entre l’ambiance réfractaire, apathique, et cette activité nouvelle. Ne l’oublions pas, en effet, vivre c’est combattre, c’est batailler, c’est s’affirmer et là où la lutte cesse, la vie et le mouvement cessent aussi. »
Et enfin, voici pour conclure, du même ouvrage, une page qui vaut pour tous les anarchistes :
« Leur lutte, c’est celle d’une poignée d’hommes — car les individualistes anarchistes ne sont qu’un petit nombre — contre le reste des hommes.C’est à la lutte que s’expose quiconque fait profession d’idées individualistes, quiconque s’efforce un tant soit peu de les mettre en pratique.
L’individualiste se tient autant à distance des discoureurs édulcorants et des orateurs miel-et-sucre que des agents provocateurs ; les uns et les autres font œuvre d’émasculation et de superficialité, quand ils n’émargent pas aux mêmes fonds secrets.
L’individualiste, pour commencer, est combattu au sain de sa propre famille ; il n’est pas toujours compris de ses camarades ; il est mal vu de son patron, de ses voisins ; il jouit de la déconsidération générale. Il en prendra son parti, voilà tout.
La prison le guette à tous les pas. Il est toujours plus ou moins sous la surveillance de la police. Les mouchards le font souvent jeter à la porte de l’emploi qu’il occupe. S’avise-t-il de faire un peu de propagande agressive : poursuites et années d’isolement.
Et la rébellion contre les préjugés moraux ? A commencer par la jeune fille que, de son plein gré d’ailleurs, l’individualiste initiera aux premières caresses, acte naturel entre tous et qui l’exposera à de ridicules poursuites pour détournement de mineure. A continuer par la menace constante d’être jeté sur le pavé s’il affecte ou se contente de mener silencieusement une vie qui jure plus ou moins avec les idées reçues en matière de respectabilité, s’il se permet de porter des vêtements peu à la mode ou de fréquenter des gens qui déplaisent à sa concierge. A finir par être renié de tous, considéré comme l’opprobre du monde, comme le rebut de ce qui respire.
Point de possibilité de conciliation entre l’individualiste et une forme quelconque de société reposant sur l’autorité, qu’elle émane d’un autocrate, d’une aristocratie, d’une démocratie, d’une dictature de classe. Point de terrain d’entente entre l’anarchiste et tout milieu réglementé par les décisions d’une majorité ou les vœux d’une élite.
Contre lui se dresse la société tout entière. Lutte pour la liberté d’exposer son opinion, lutte pour la liberté de la vivre, lutte pour le pain, lutte pour le savoir ; une lutte, certes, qui ne se poursuivra pas sans joies profondes et au cours de laquelle il aura l’inappréciable satisfaction de voir tomber quelque pierre angulaire et peut être vaciller l’édifice social, mais lutte quand même.
On voudrait que l’individualiste conclue une trêve, qu’il concède quelques points, se montre moins intraitable, moins acharné, moins intransigeant dans son œuvre de critique, qu’il ait pitié de ceux qui détiennent en leurs mains la puissance administrative, ou intellectuelle, ou monétaire. On lui propose de jouer un rôle de dupe et, en échange de sa tranquillité relative, de se faire le complice de gens intéressés au maintien de la société actuelle.
L’individualiste n’accepte pas. Sa vie sera une lutte, soit. Sa grande préoccupation désormais, c’est de la faire durer le plus long temps possible. »
— A. LAPEYRE
LUXE
(du latin : luxus)
Le luxe est caractérisé par la surabondance et la somptuosité dans les biens. Il représente l’extrême opposé du dénuement, qui implique la privation totale. On emploie fréquemment le mot luxe comme synonyme de superflu, qui représente ce qui est au-delà du nécessaire. Cependant, entre les deux termes, existe une légère différence de signification, qui mérite d’être signalée : le superflu n’est pas forcément coûteux, le luxe n’est pas forcément inutile. Un bibelot encombrant, qui n’est même pas beau, et dont on ne se servira jamais dans un intérieur, parce qu’il déparerait la pièce est du superflu, même s’il fut acheté à bas prix.
Mais un manteau de coupe impeccable et d’étoffe précieuse, pour être un article de luxe, n’en demeure pas moins fort utile lorsqu’il s’agit de se préserver du froid.
La limite entre ce que l’on désigne couramment par ces mots : « l’utile » et « le superflu » n’est pas très aisée à établir de manière satisfaisante pour tout le monde. Elle varie selon les individus, leurs habitudes, leur éducation. Ordinairement chacun décrète qu’est utile ce qui satisfait ses besoins, et superflu ce qui ne lui convient point, sans tenir compte de l’extrême variété des goûts chez ses contemporains. J’ai vu, une fois, un ouvrier morigéner sa fille parce qu’elle s’était permis de coudre après sa pauvre robe quelques menus ornements. Mais lui ne jugeait pas superflu de bourrer une pipe après les repas. Pour nous-mêmes il arrive que le point de vue change avec les années. Certaines satisfactions, dont nous ne faisons pas état, parce que nous n’avions guère eu l’occasion de les apprécier, deviennent par la suite, avec l’accoutumance, des éléments non négligeables de notre félicité, alors que d’autres, jugées plus grossières, perdent notre estime.
Le seul moyen de nous mettre d’accord serait de reconnaître cette vérité : est, sinon du superflu, du moins un luxe, tout ce qui n’est pas indispensable à la conservation de notre existence. Nos ancêtres les plus éloignés, qui logeaient dans des cavernes, buvaient l’eau des sources, se nourrissaient d’aliments crus, et ignoraient la vêture, ne possédaient certainement aucun luxe. Celui-ci a été une conséquence de la recherche du beau et de l’agréable. Il est né lorsque les femmes ont commencé à parer de fleurs et de coquilles leurs chevelure, lorsque les hommes ont pris souci d’agrémenter le gîte familial d’images gravées dans la pierre ; lorsque l’on a connu la douceur du vêtement, le réconfort du feu, la saveur de quelques apprêts culinaires.
Grâce au progrès scientifique et industriel, tout ceci s’est considérablement développé au cours des âges, et pas seulement pour le profit de quelques privilégiés, mais aussi pour l’ensemble de la population, quoique avec des inégalités choquantes, et de scandaleuses injustices dans la répartition. Non seulement pour la classe riche et la classe moyenne, mais encore pour quantité de travailleurs manuels et d’ouvrières aux ressources modestes les parures, les spectacles, l’esthétique du vêtement et un certain confort dans l’ameublement, représentent des avantages acquis dont ils ne pourraient plus aisément se passer, parce qu’ils contribuent, dans une notable proportion, à rendre la vie digne d’être vécue.
Le goût du luxe — tout au moins d’un luxe relatif et non malsain — est trop ancré dans les mœurs, et depuis trop longtemps, pour que l’on puisse songer à le faire disparaître. A part un très petit nombre d’ascètes naturistes — dont il n’y a d’ailleurs pas lieu de se moquer, et qui ne dédaignent pas totalement les bienfaits de la civilisation — personne n’éprouve le désir de revenir à la vie primitive. Rien n’est plus de nature à éloigner les foules modernes d’un idéal collectiviste ou communiste que cette sorte de monasticisme laïque dont ont fait preuve tant d’auteurs, influencés sans doute par les enseignements religieux ne leur enfance. Présenter, comme tableau du futur, l’existence d’une famille nombreuse de travailleurs dans ce qu’elle a de plus parcimonieux ; jeter l’anathème sur toute fantaisie, presque toute distraction n’ayant pas un but sociologique ; attendre des femmes qu’elles renoncent aux jolies toilettes et aux bijoux, et des hommes qu’ils jettent à terre leurs dernières cigarettes, c’est se condamner à prêcher indéfiniment l’absolu de sa doctrine devant l’absolue indifférence du grand nombre.
Le peuple n’aspire aucunement, en plein XXème siècle, à vivre dans des phalanstères prolétariens, à réminiscences de casernes ou de couvents, une existence terne de petit fonctionnaire à retraite assurée. Ce qui le séduit comme perspective, c’est l’aisance moyenne actuelle, dans un home convenable, en échange d’une tâche modérée ; et les superbes monuments, les vastes avenues, les grandioses réjouissances publiques, ne lui déplaisent point. Avec une organisation plus rationnelle que la nôtre, il pourrait, dans un proche avenir, bénéficier de tout ceci, et il n’y aurait pas à lui en faire grief. Le luxe n’est à proscrire que lorsqu’il comporte d’avilissantes débauches. Il n’est blâmable que lorsqu’il s’alimente de la misère des faibles. Il n’y a pas lieu de rééditer à son égard les hypocrites imprécations de l’Eglise, mais d’en généraliser, dans toute la mesure du possible, les agréments, en même temps que l’on en modifiera, dans un sens plus intellectuel et plus social, le caractère et l’inspiration.
— Jean MARESTAN
LYNCHAGE
(du mot anglais Lynch)
Ce que l’on nomme aux Etats-Unis « la loi de Lynch », d’où le terme français « lynchage », est une forme de justice sommaire et primitive, non reconnue par la législation officielle, mais qui est demeurée jusqu’à présent dans les mœurs populaires de la grande république américaine. La foule saisit le coupable — ou présumé tel — le juge, le condamne, et l’exécute séance tenante, ordinairement par pendaison, à moins qu’elle ne le fasse brûler vif, lorsqu’il s’agit d’hommes de couleur accusés de meurtre, ou de cet attentat particulièrement grave qu’est le viol d’une femme blanche. Voici quelques exemples de lynchage tels qu’ils ont été rapportés dans la presse :
-
Le 1er décembre 1927, une centaine d’automobiles, bondées d’hommes armés, s’arrêtent devant la prison de Whitesburg, dans le Kentucky, où se trouvait incarcéré le noir Léonard Woods, accusé d’avoir assassiné un blanc. Les portes de la prison sont enfoncées ; le noir, tiré de son cachot, est ligoté et traîné sur la place publique. Là, il est arrosé de pétrole et transformé en torche vivante, devant une foule énorme « qui couvrait de ses vivats les hurlements du supplicié ».
-
Le 30 juillet 1928, à Brookhaven, dans l’Etat de Mississipi, la foule se rue à l’intérieur de la prison, dans laquelle se trouvaient deux nègres, deux frères, qui avaient blessé à coups de revolver un créancier blanc. L’un d’eux est attaché par le cou derrière une automobile, et traîné jusque dans la banlieue, où il est pendu à un arbre, tandis que son frère était pendu à un ponceau des environs.
-
Le 2 janvier 1929, à Clarksdale, dans l’Etat de Mississipi également, un nègre nommé Shepherd, ayant enlevé une jeune fille blanche, sous menace de mort, après avoir tué d’une balle le père de cette jeune fille, qui tentait de la défendre, la foule s’empare du meurtrier, le lie à un poteau, au sommet d’un énorme bûcher, et s’exerce, tout d’abord, à tirer sur lui, en prenant grand soin de ne pas le tuer. Puis il est arrosé de pétrole, et le feu est mis au bûcher, mais de telle manière que la mort ne vînt qu’avec lenteur. Deux mille personnes assistaient à ce spectacle.
Les Etats-Unis se sont fait, de nos jours, une triste spécialité de ce genre d’exécutions, perpétrées avec des raffinements de révoltante cruauté, et la complicité, ou presque, des forces de police. Mais les scènes de violence, dans des conditions analogues, sont de tous les temps et de tous les pays. En France même où, à l’ordinaire, les mœurs sont relativement douces, il est des circonstances où la foule exaspérée lynche, ou tente de lyncher des coupables, alors même qu’ils sont déjà entre les mains de l’autorité judiciaire.
-
Le 16 novembre 1927, l’égorgeuse de Saint-Thégonnec, Marie-Jeanne Pouliguen, transférée à Brest sous escorte de gendarmerie, fut, dans toutes les gares, l’objet de manifestations hostiles, auxquelles ses gardiens eurent beaucoup de peine à la soustraire. À Landerneau, notamment, la foule essaya de s’emparer d’elle pour la lancer, vivante, dans le foyer de la locomotive !
-
Le 9 juin 1929, à Paris, un soldat déserteur nommé Imbard, étant entré, en plein jour, dans un café de la rue Cadet, pour obliger, sous la menace du revolver, le propriétaire de l’établissement à lui remettre le contenu de son tiroir-caisse, la foule mit en lamentable état ce malheureux, qui n’avait même pas osé faire usage de son arme, et elle l’aurait probablement tué sans l’arrivée des agents.
Ces faits ne sont malheureusement pas très rares, surtout dans les périodes de surexcitation publique et de fièvre. Au début de la guerre furent commis, un peu partout, à l’égard des étrangers et des suspects, des actes immondes, et cela de la part d’individus appartenant à toutes les classes de la société.
Ces quelques exemples suffisent à montrer que l’autorité, dans ce qu’elle présente d’injuste et de barbare, n’est pas seulement en fonction de l’existence du policier, du juge et du bourreau. Avec leur suppression peut coïncider la, mort d’une certaine forme d’autorité jusque là consacrée. Mais, si subsistent entre les hommes des motifs de compétition, elle persiste sous l’influence déterminante des événements, quoique dans des conditions qui peuvent être différentes de celles du passé. Pour ne point se présenter avec l’appareil classique de Thémis, la tyrannie n’en conserve pas moins force et vigueur là où se substitue à un pouvoir judiciaire défaillant le régime de l’arbitraire individuel et de la violence anonyme.
Aux excès qui résultent de ceux-ci, il est un remède : l’éducation. On devrait enseigner, principalement à l’enfance, en y insistant, qu’il ne faut jamais se hâter de porter sur autrui des jugements téméraires et que, s’il est légitime de se défendre, il est honteux, par contre, d’infliger à l’ennemi vaincu d’inutiles souffrances.
— Jean MARESTAN
LYRISME
Le mot lyrisme vient de lyre. La lyre dont la fable attribue l’invention à Orphée est encore de nos jours, malgré l’invasion du jazz-band, l’emblème commun de la poésie et de la musique, ces deux sœurs qui vont si rarement de pair. La poésie fléchit quand elle est accompagnée de la musique, et la musique quand elle veut régler son vol sur celui de la poésie. La lyre symbolique élevée par un génie vers le ciel, domine le faîte de notre Opéra.
Les poétesses sentimentales qui se recrutent encore sous les charmilles des jardins ou des parcs en province se montrent à nous, les doigts sur leur lyre et les yeux tournés vers leur Muse. Avec cet indispensable instrument, et sous l’aile de cette inspiratrice, souvent rebelle et parfois bossue, elles sont de la phalange. La lyre n’en est pas moins démodée, de même que sa variante : le luth. Le lyrisme reste le plus noble et le plus beau record de l’inspiration. Il est rare, car il est difficile.
Une foule, accourue de toutes parts sur le passage d’un héros, attend son grand homme qui tarde à se montrer. Elle frémit, elle acclame et l’acclamation ne lui suffisant plus, elle chante.
Un avion roule sur le terrain de l’aéroport, la vitesse de sa course, la puissance vibrante de son moteur font qu’il s’enlève. A cet instant précis où le sol est quitté, où le terre-à-terre finit, où l’attraction du normal est vaincue, le lyrisme commence. Son essor assure un libre champ à ses ébats. Factice, le lyrisme est odieux. Qu’il soit ivre de sa liberté, mais fou et titubant dans les airs, il est ivrogne, et combien de fois, incapable d’un vol soutenu, il tombe en vrille et s’écrase sur le terrain plat. Boileau a écrit ce vers didactique et qui ne casse rien :
Retenons de ce précepte indirect que le poète, même lyrique, ne doit pas perdre le contrôle de son altimètre, ni jouer imprudemment avec son gouvernail de profondeur.
Le mot lyrisme n’a pas exactement le même sens dans la musique et dans la poésie. L’œuvre musicale est dite lyrique quand elle est descriptive de sentiments qui agitent l’âme, et ne se modèle pas sur le thème d’une action. Ainsi l’hymne, la cantate. L’expression : théâtre lyrique, plus éloignée encore de la source dont elle dérive, désigne un théâtre qui joue des pièces revêtues de musique.
La prose même a son lyrisme : témoin Chateaubriand. Ce lyrisme tient à l’enthousiasme de l’auteur quand son style bout, ou lorsque, sur la surface d’une eau tranquille il porte comme un fleuve des idées généreuses ou des idées générales ; il n’est pas un cours d’eau de plaisance ; j’oserai dire qu’il irrigue avec une véhémence tranquille et sûre d’elle-même le domaine qui est le patrimoine de l’humanité. Le diminutif de ce lyrisme est l’éloquence : son écueil est l’emphase. Emile Zola atteint au lyrisme quand il décrit dans Germinal l’émeute de la grève et le déchaînement des travailleurs courroucés.
Séparant les poètes des musiciens, nous placerons ici, dans des médaillons trop étroits, les bustes des poètes lyriques les plus justement célèbres.
TYRTÉE
Il était né en Grèce, dans la petite ville d’Aphide, au VIIème siècle avant notre ère. Les Lacédémoniens, en guerre pour la seconde fois avec les Messéniens, avaient interrogé l’oracle pour le succès de leurs armes. « Demandez un général aux Athéniens », répondit le Dieu. Athènes, par dérision, offrit à Lacédémone Tyrtée. Mais les oracles sont infaillibles, pourvu qu’on interprète avec astuce leur sens caché ou qu’on s’en remette aveuglément à leur sagesse qui prend le masque de la folie.
Ce boiteux, cet homme de petite taille, disgracié et contrefait — il louchait par surcroît — fut un Esope d’une autre trempe. Il enflamma les combattants par ses harangues ; il les éleva au-dessus d’eux-mêmes par ses chants. Il arracha du ciel la Victoire. Il fallut Epaminondas, il fallut les batailles sanglantes de Leuctres et de Mantinée pour briser le joug de l’hégémonie spartiate.
Tyrtée n’est pas mort tout entier, il reste de lui quelques fragments que les hellénistes ont recueillis. Horace le cite et le place aux côtés d’Homère. Le nom de Tyrtée est resté populaire, il est classique. Il est tant d’auteurs célèbres dont la gloire est d’autant plus solide qu’on ne les lit plus !
PINDARE
Pindare, né à Cynocéphales en 521 av. J.-C., domine toute la série des poètes lyriques. Le XVIIème siècle était à genoux devant lui. Pourtant, nous ne pouvons lire de son œuvre que le recueil le plus spécial, celui qui s’intitule : Epinicia. Les Epinicia sont des Odes qui célèbrent les athlètes vainqueurs dans les Jeux. L’antiquité classique fut sportive, comme nous dirions aujourd’hui. C’est presque un miracle de la justice immanente que le poète soit illustre, et que la renommée triomphale des champions victorieux se soit fanée comme se sont desséchés leurs lauriers.
Toute l’histoire atteste le sublime génie de Pindare, la beauté de ses évocations, l’audace heureuse de ses fictions et de ses images, la richesse, la pompe même et l’ordonnance de la composition et de son décor.
HORACE
Horace a le privilège d’attirer à lui tous ceux qui sont versés dans les lettres latines et tous ceux qui, pour aimer les charmes de la grâce, pour se plaire à l’étincellement de l’esprit, ne se croient pas obligés de savoir le latin. Mais pour ceux qui peuvent aborder dans son texte une œuvre immortelle et délicieuse, pour ceux qui pénètrent facilement le mécanisme agencé de ces vers dont chaque mot est le mot juste avec sa nuance exacte, d’un coloris inimitable, quelle joie ajoutée à l’agrément de la lecture !
Horace ne s’attarde pas : pour employer une expression de Victor Hugo, sa flèche jouterait avec l’éclair. Sa malice sourit, sa philosophie s’illumine, sa rhétorique s’affine et son élégance patricienne s’affirme sous la plénitude du bon sens et sous le couvert d’une santé morale, toute romaine. Qu’il regimbe devant Mécène, qu’il défende son indépendance, qu’il revendique son droit de descendre vers la mer si les champs albins se poudrent de neige, qu’il flâne sur ce boulevard de son temps qu’était la voie sacrée, qu’il se laisse faire la leçon par son pendard de valet, je veux dire par son esclave, il se révèle à nous comme le plus brillant et le plus aimable des parisiens avant la lettre,
Ses odes sont sages, mais étincelantes, non pas à jet continu, mais par de soudaines émissions radieuses, elles sont grandioses, souvent, quoiqu’elles semblent faites avec rien d’une main négligente. Elles empruntent leur grandeur à la majesté des traditions de Rome, à sa légende sacrée, à son histoire primitive, à la mythologie qui entoure ses dieux. Elles commémorent et surtout quand il s’agit de Mécène, dont les ancêtres étaient des rois, elles répondent au désir ou à la nécessité d’une délicate flatterie. La Fontaine qui s’était teinté d’Horace, mais dont le naturel avait survécu à ce traitement pédagogique, avait cependant retenu la manière de tourner la fable en allégorie et d’honorer l’Olympe pour exalter les grands.
A l’Horace des Odes, la postérité préfère, à juste titre, l’Horace des Epîtres et des Satires.
Le Romantisme est né des audaces de la Révolution et des platitudes de la Restauration. La grande rénovation mondiale a suscité, tant en Allemagne qu’en France, les plus grands poètes modernes, et à la fois ou presque ensemble dans un espace de cent ans.
S’il est difficile de considérer Goethe et Schiller comme des poètes lyriques, à proprement parler, on ne peut traiter du lyrisme sans s’incliner devant Faust, et des poèmes qui ne sont pas des odes : le Chant de la Cloche, par exemple, sont des œuvres lyriques de grande beauté.
VICTOR HUGO
Est-il un poète lyrique ? Par les odes des Odes et Ballades, il réclame ce titre, mais on peut dire que son lyrisme est ailleurs ou, pour parler plus exactement, qu’en lui il est partout. Lorsque l’auteur des Contemplations et des Feuilles d’Automne célèbre les premiers jours du monde :
Lorsqu’il s’adresse à son cœur :
Lorsqu’il nous montre les cloches et les canons éclatants à la fois en volées et « la nuit, dans le ciel des villes en éveil » fait monter les gerbes étoilées, quel poète lyrique a porté plus haut le lyrisme ?
N’a-t-il pas, dans les Orientales, fait s’écrouler devant nos yeux les cités impures si voluptueusement étendues dans leur mollesse avant que ne passât la nuée aux flancs noirs :
Allait, tout parfumé, de Sodome à Gomorrhe. »
La gloire de Victor Hugo ne saurait s’obscurcir, et pour comprendre la grandeur du monde de poésie qu’il a créée, il faut se rappeler ce qu’était la poésie avant lui. Elle en était à Delille, à ses exploits de virtuosité sur les cordes d’un violon ronronnant et phtisique, à la traduction des Géorgiques au poème des Jardins. Elle en était aux poètes académiciens que Rostand a raillés dans Cyrano.
Il est évident toutefois que cette gloire du « Maître » du « Dire », n’ensoleille plus notre siècle comme le sien. Le nom d’Hugo resplendit au firmament, mais son œuvre semble se détacher de son nom et glisser dans la constellation des vieilles lunes. Ce qui la démode comme l’intérieur d’un palais ancien, cette œuvre, c’est son ameublement : ces draperies opulentes aux fenêtres monumentales, ces ors sur les colonnes, ces peintures dans les caissons qui plafonnent les moindres pièces, tandis que, dans leurs âtres, brûlent, jetant des flammes vives, les arbres entiers fournis par la forêt profonde.
Nous avons le goût des appartements clairs, un peu nus, sans ornements, des meubles en bois précieux mais terminés par des arêtes vives, des vitres claires et sans rideaux à long plis.
La Muse d’Hugo (ancien style) a pour cheveux tous les rayons de l’aurore du jour et du crépuscule. Depuis Sarah, « belle d’indolence » la chevelure des femmes et même celle des Fiérides s’est raccourcie.
Il n’en est pas moins vrai que, passent les soleils et meurent les étoiles, Hugo demeure :
« Entre les plus beaux noms son nom est le plus beau. »
HENRI-AUGUSTE BARBIER
Que la plus large place lui soit donnée parmi les poètes inspirés ! L’indignation a fait son vers, la Liberté l’a pris dans ses bras, une liberté qui n’était pas une duchesse du noble faubourg Saint-Germain, mais une prolétaire aux fortes mamelles : le jour où le soleil chauffait les grandes dalles, il a chanté la grande populace et la sainte canaille.
Il les a vues « se ruer à l’immortalité ».
Il exhale en imprécations, fougueuses et en cris de triomphe cette pitié, cette tendresse humaine, ces « pensers nouveaux » qu’ANDRÉ CHÉNIER a répandus en vers antiques d’une admirable douceur et d’une adorable pureté. Mais Chénier, de par ses Elégies et ses Idylles n’est pas un lyrique. Est-il bien certain cependant qu’à ce point spontané et jaillissant sous les coups du malheur, le sentiment n’atteigne pas aux sphères extra-terrestres du lyrisme ?
LAMARTINE
Le cygne de Mantoue, c’est Virgile. Je ne sais quel mauvais épigraphiste affubla de ce surnom le poète magnifique salué par ses contemporains d’un autre nom : les délices du peuple. L’épigraphiste bel esprit aurait pu appeler Lamartine le Cygne du Lac, car le Lac de Lamartine et la Tristesse d’Olympia, le poème d’Hugo, sont deux sommets dans la chaîne ininterrompue et sans fin de la production poétique, depuis qu’il y a des hommes et qui souffrent, et qui chantent nos douleurs. L’amour est la floraison de ces montagnes altières, une floraison si vite recouverte par des neiges éternelles. On ne dira pas la défroque de Lamartine comme on a dit la défroque d’Hugo ; Lamartine est plus proche de l’Harmonie sans fioritures, et ses Méditations, plus que les Contemplations s’agenouillent, sans coussin de velours, sur le prie-dieu devant la fragilité de l’homme et l’infini de l’Univers.
Lamartine est un cygne, mais qui de ses ailes puissantes et cadencées, loin de s’attarder aux barcarolles, franchit des espaces d’azur, à travers les mélodies éoliennes.
Le lyrisme, comme les grandes pensées, ne doit pas venir du cerveau mais du cœur.
— Paul MOREL