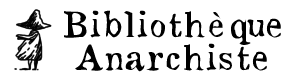L’Encyclopédie anarchiste — C
C
PARTI COMMUNISTE (BOLCHEVISATION DU)
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)
ACTION INTERNATIONALE DE LA C. G. T.
5. DANS LE DOMAINE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE
6. DANS LE DOMAINE SCIENTIFIQUE
Organisation pratique et immédiate du contrôle ouvrier
COOPÉRATIVES (SOCIÉTÉS) DE CONSOMMATION
CABALE
n. f.
On désigne sous le nom de cabale, une menée, une intrigue conduite par les partisans d’une doctrine, d’une coterie. Ex. : Lorsqu’un politicien devient trop puissant, ses collègues, jaloux de sa bonne fortune, ne manquent pas de monter une cabale contre lui, pour le faire tomber. Les cabales sont très fréquentes dans le monde politique. Le mot cabale est aussi employé tout particulièrement pour désigner une association formée pour faire subir un échec à un auteur dramatique. Ex. : Une véritable cabale fut organisée contre Henry Bataille, lorsqu’il fit jouer l’Animateur, pièce où l’écrivain glorifiait Jaurès et stigmatisait Léon Daudet. Il faut prendre garde de ne pas se laisser influencer par les cabales qui peuvent parfois s’attaquer à un homme intègre que certains trouvent gênant, justement à cause de son intégrité. Au sens propre, le mot cabale a un tout autre sens qu’il sied de ne pas ignorer. Venant de l’hébreu Kabbalah (tradition), il est chez les Juifs, une interprétation mystérieuse de la Bible, transmise par une chaîne continue d’initiés. (Il prend alors une majuscule.) Elaborée dans les deux siècles qui précédèrent le christianisme, exposée dans les livres tels que le Sephir-Jetzira et le Zohar, la Cabale est littérale et accacérique ; elle attribue un sens symbolique aux caractères de l’alphabet et aux chiffres, et en interprète les combinaisons. La Cabale a exercé une grande influence non seulement sur le judaïsme, mais sur l’esprit humain en général. Elle a compté parmi ses adeptes : Philon, Avicenne, Raymond Lulle, Pic de la Mirandole, Paracelse, Reuchlin etc... ; Elle a fini par donner dans la théurgie et la magie.
CABOTINAGE
n. m.
Action de cabotin, c’est-à-dire de personne qui joue une comédie bruyante pour se faire valoir ou arriver à ses fins. Les politiciens sont passés maîtres dans l’art du cabotinage. Il ne faut pas oublier que tout cabotinage décèle un manque plus ou moins grand de sincérité. Il ne faut donc jamais donner créance aux cabotins.
CACHET
(lettre de)
La lettre de cachet, employée jadis au temps de la royauté absolue, était un pli fermé d’un cachet du roi, et qui contenait ordinairement un ordre arbitraire d’exil ou d’emprisonnement. Les rois de France n’hésitaient pas à employer la lettre de cachet contre tous ceux qui leur avaient déplu d’une façon ou d’une autre. Le courtisan maladroit se voyait exiler dans ses terres. L’homme libre se voyait enfermer à la Bastille pour le restant de ses jours, sans qu’aucun jugement ou simulacre de jugement ne soit intervenu. Aujourd’hui, la lettre de cachet n’existe plus. Mais les puissants, plus hypocrites, savent bien, par des accusations mensongères et des jugements de complaisance, se débarrasser de leurs adversaires lorsqu’il leur en prend l’envie.
CACOPHONIE
n. f. (du grec kakos, mauvais et phônê, voix)
On appelle cacophonie, une rencontre de mots ou de syllabes qui blessent l’oreille. Exemple classique : Ciel, si ceci se sait, etc... Les meilleurs écrivains sont parfois tombés dans la cacophonie. Tel Voltaire écrivant :
Non, il n’est rien que Nanine n’honore...
Par extension on appelle cacophonie un mélange désagréable de sons discordants. Ex. : La Chambre des députés est en général le domaine de la cacophonie. La cacophonie produit toujours une mauvaise impression. Aussi faut-il se garder, dans les discussions, les controverses, les meetings, de parler plusieurs à la fois, à moins qu’on ne veuille pratiquer l’obstruction contre un orateur.
CADASTRE
n. m.
On appelle cadastre un registre public qui porte le relevé détaillé des propriétés territoriales d’une contrée, d’une commune, présentant leur situation, leur étendue et leur valeur, pour permettre l’assiette de l’impôt foncier. C’est Charles VIII qui eut la première idée du cadastre général de la France. L’exécution du cadastre donne lieu à des opérations confiées à des géomètres et à des opérations d’expertises effectuées par des contribuables (classificateurs), assistés de contrôleurs des contributions directes. Les premières ont pour objet le lever du plan ; elles comprennent : la délimitation et la triangulation de la commune, l’arpentage parcellaire et la vérification. Les secondes consistent à évaluer le revenu ; ce sont : la classification (division en classes, des diverses natures de propriétés) ; le classement (distribution des parcelles entre ces classes) ; le tarif des évaluations (détermination du revenu de chaque classe). Le résultat de ces opérations est reporté au nom de chaque contribuable sur les matrices cadastrales, dont les rôles sont des copies et qui doivent mentionner les changements de propriétaires et les translations de propriété (mutations). Le cadastre date de 1807. Les lois des 17 mars 1898 et 13 avril 1900 se sont occupées à le réviser. Comme on le voit, le cadastre est le livre de la Propriété. La bourgeoisie y marque les terres qu’elle s’est partagées, y limite artificiellement les portions de sol dont elle s’est emparée et interdit ainsi à quiconque de jouir librement de quelque chose qui devrait être à tous. Le cadastre est, en quelque sorte, la sanction légale du droit de propriété. Les anarchistes se comporteront donc avec lui de la même façon qu’ils se comporteront avec la Propriété (Voir ce mot).
CADRAN
n. m. (du latin quadrans ; de quadrare, être carré)
On désigne sous le nom de cadran, une surface portant les chiffres des heures, etc... et sur laquelle courent les aiguilles d’une montre, d’une pendule, etc... Ou bien encore une surface analogue qui porte les divisions d’un instrument de physique : manomètre, galvanomètre, etc... ou rose des vents. On appelle cadran solaire, cadran lunaire, une surface plane sur laquelle des lignes indiquent les heures que le soleil ou la lune marquent en projetant successivement sur ces lignes, l’ombre d’un style ou tige implantée dans la surface. Les cadrans solaires, qui servaient jadis à déterminer l’heure, furent connus des Egyptiens.
CADRE
n. m. (de l’italien quadro, carré)
On appelle cadre une bordure de bois, de bronze, etc... qui entoure une glace, un tableau, un panneau, etc... Le même mot sert aussi à designer toutes sortes de châssis. Enfin, le mot cadre est très employé au sens figuré, notamment pour désigner le tableau des services et des fonctionnaires d’une administration (ex. : être rayé des cadres), ou bien l’ensemble des gradés et des employés spéciaux d’une troupe militaire (ex. : les cadres d’un régiment). Tous les systèmes sociaux autoritaires aiment à parquer les individus dans des cadres où ils obéissent à une discipline méthodique et avilissante. Pour les communistes — encore plus peut-être que pour les bourgeois — l’organisation par le cadre est l’organisation rêvée ; c’est elle, en effet, qui transforme le plus sûrement l’homme en un instrument passif et docile dont on peut retirer un rendement maximum. L’esprit d’initiative et d’indépendance — ces forme si dangereuses de l’esprit ! — sont peu à peu annihilées, et les gouvernants peuvent agir en toute tranquillité sans craindre un réveil de la masse. Il faut donc que le peuple refuse rigoureusement de se laisser enfermer — et peu à peu étouffer — dans les cadres que les puissants s’efforcent d’entourer d’avantages trompeurs. Tout cadre est un collier pour une catégorie de citoyens. Les anarchistes doivent donc briser les cadres comme ils briseraient des chaînes.
CADUCITE
n. f.
La caducité et l’état de ce qui est vieux, faible, cassé, décrépit. Le mot s’emploie aussi bien pour l’homme que pour les choses. L’homme devenu caduc, est souvent un obstacle au progrès ; les idées hardies l’effraient facilement, et il préfère la routine aux initiatives osées. Or, les gouvernements sont en général composés de politiciens déjà fort âgés et ce fait explique que, en dehors de la nocivité des principes gouvernementaux, les dirigeants d’un pays soient toujours réfractaires aux suggestions généreuses et larges. Ne nous en plaignons pas, d’ailleurs, car leur intransigeance et leur étroitesse d’esprit permettent au peuple de mieux mesurer leur ignominie. Un manque de libéralisme est, en effet, toujours plus dangereux qu’un autoritarisme brutal, car il parvient souvent à tromper la multitude naïve et confiante. Mais la caducité de l’homme n’est pas la seule qui soit à craindre. La caducité des institutions, des lois et des morales est bien plus dangereuse encore. Les vieillards néfastes qui sont a la tête des gouvernements, par crainte d’une innovation qui pourrait être une libération, renforcent des lois décrépites qui emprisonnent les individus dans un tissu de menaces. Les mœurs ont beau changer avec les siècles, les lois demeurent toujours les mêmes, toujours plus oppressives. De même les morales officielles. De même les institutions. Tout le bric-à-brac de l’autoritarisme, tout ce matériel vieillot d’abrutissement tout l’héritage désuet du passé, tout cela est rafistolé tant bien que mal par les politiciens en exercice, — et les classes travailleuses doivent supporter ce fardeau de Jour en Jour plus intolérable. Espérons que l’heure est proche où les spoliés se refuseront à endurer plus longtemps l’emprise d un passé tyrannique. Ce jour-là s’écrouleront toutes les entités caduques qui barrent la route du progrès social et, enfin, nous pourrons instaurer une vie nouvelle où, seules, prévaudront les choses saines, vigoureuses et fécondes.
CAFARDISE
n. f.
On appelle cafardise une action ou une parole de cafard ; c’est-à-dire d’hypocrite prêt a toutes les délations. Pour obtenir une récompense ou pour se faire bien voir du maitre, patron, etc... , le cafard n’hésite pas à dénoncer le camarade qui a enfreint un quelconque règlement, et lui attire ainsi une sanction plus ou moins grave. La cafardise est en général une conséquence de la mentalité d’esclave. C’est une action des plus viles, et celui qui s’en rend coupable mérite le mépris absolu de tous. Celui qui est capable d’une petite cafardise peut être capable d’une grande trahison. On ne peut guère descendre plus bas dans l’infamie.
CAGOTISME
n. m.
Le cagotisme est le caractère de celui qui est cagot, c’est-à-dire qui affecte une dévotion hypocrite et outrée. Synonyme de bigot (voir ce mot).
CAHIER
n.m.
On appelle cahier un assemblage de feuilles de papier cousues ensemble. Autrefois, le mot cahier servait à désigner un mémoire de doléances ou de remontrances adressé au souverain. (Ex. : Les cahiers du tiers.) De nos jours on entend encore par cahier des charges, l’ensemble des clauses imposées à un adjudicataire ou à un acquéreur. Le cahier des charges est déposé dans un lieu public où chacun peut en prendre connaissance, et il en est donné lecture avant la réception des offres. Dans les ventes faites par autorité de justice, le cahier des charges est destiné à faire connaître les conditions de vente aux futurs acquéreurs.
Enfin, le mot cahier est employé aujourd’hui dans l’expression cahier de revendications. Le cahier de revendications est l’ensemble de légitimes exigences d’un syndicat ou d’un certain groupe de travailleurs. C’est ce cahier que les ouvriers lésés présentent au patron pour lui arracher d’infimes améliorations de leur travail : journée de huit heures, adaptation des salaires au coût de lit vie, etc... Souvent, hélas, pour faire accepter ce cahier de revendication, les travailleurs sont obligés de recourir à la grève. La mentalité patronale est telle, en effet, que les ouvriers ne peuvent faire aboutir une revendication que s’ils savent l’imposer. Les exploiteurs, ne connaissant qu’une chose : la force, obligent leurs adversaires à en user. Mais le jour n’est pas loin, espérons-le, où plus ne sera besoin de cahiers de revendications. Ces améliorations de leur sort qu’on leur dispute si âprement, les travailleurs sauront les conquérir de haute lutte sur les parasites de l’industrie, de la politique ou du commerce. Et l’on ne verra plus d’arrogants jouisseurs marchander une bouchée de pain à des familles laborieuses.
CAIMAN
n. m. (caraïbe : acayouman)
Le caïman est une espèce de crocodile des fleuves d’Amérique et de Chine à museau long. Au sens figuré, on dit de quelqu’un que c’est un caïman lorsque, avide et sans scrupules, il n’hésite pas à exploiter ses semblables de la plus ignominieuse façon. Ainsi est un caïman le patron qui fait travailler ses ouvriers 10 ou 12 heures par jour, à des salaires de famine, pour pouvoir agrandir sa fortune. La classe ouvrière, aujourd’hui, est malheureusement victime d’innombrables caïmans de ce genre, qui s’engraissent du sang et de la sueur des travailleurs. Aucune pitié n’est à attendre de pareils monstres. De même que pour les caïmans des pays exotiques, la force seule peut venir à bout de ces caïmans humains — ou plutôt à forme humaine seulement, puisque tous les sentiments nobles de l’homme leur sont inconnus... C’est pour cela que les anarchistes haussent les épaules quand des réformistes proposent une entente du peuple avec ses bourreaux. On ne parlemente pas avec une bête féroce !...
CALAMITE
n. f. (latin calamitas)
On appelle calamité, un grand malheur qui atteint toute une catégorie d’individus. Exemple : La guerre, source de bénéfices pour les dirigeants, est une calamité pour les peuples. Notre société actuelle abonde en calamités de toutes sortes et de toutes grandeurs. Sont des calamités pour les travailleurs : la finance, la politique, l’armée, la diplomatie, le capitalisme, etc... etc... Il est des calamités naurel1es que la volonté de l’homme est impuissante à combattre : tremblements de terre, inondations, cyclones, etc... Mais les calamités que nous avons citées plus haut sont purement artificielles et peuvent être évitées par la volonté ferme des classes laborieuses. Le jour où le peuple se débarrassera de ceux qui vivent du malheur public, ce jour-là les calamités artificielles disparaîtront automatiquement.
CALOMNIE
s. f.
Faux bruit, invention malveillante que certains individus colportent, imputant de mauvaises actions à des gens qu’ils veulent discréditer. La calomnie est une arme vile et abjecte employée de tous temps par les envieux, les esprits bas et sans scrupule, les gens d’église, de politique et de Pouvoir à l’égard de ceux qui militent en contempteurs de toute autorité, et qui ne peuvent se résoudre à garder pour eux seuls une vérité bienfaisante à tous.
Tour à tour, les premiers chrétiens, les Juifs, les protestants, les socialistes et les anarchistes furent en butte aux accusations les plus stupides, en même temps que les plus ignobles, de la part de ceux dont ils dérangeaient les plans et contrariaient les appétits. C’est ainsi qu’à Rome, quand les disciples de Paul de Tarse eurent fait d’assez grands progrès moraux dans la population, le gouvernement de Néron fit circuler sur leur compte mille histoires horribles. On les accusait de tuer les petits enfants, de manger de la chair humaine, de comploter contre la vie des gens, de prêcher le vol, le viol et le meurtre. Ce qui faisait que grâce à ces légendes, le peuple était heureux d’aller au cirque pour assister aux supplices des chrétiens. Quand Néron ordonna l’incendie de Rome, il réussit pendant près d’un an à faire croire au peuple que c’étaient les chrétiens qui avaient commis ce crime, tant était grande la puissance de la calomnie savante et réitérée des caudataires du César. Lorsque, grâce à la conversion de Constantin, les chrétiens parvinrent à partager avec l’empereur l’autorité toute-puissante, les prêtres de la nouvelle église oublièrent totalement le martyrologe de leurs devanciers.
À leur tour ils manièrent de main de maître la calomnie. Ce furent tout d’abord les Juifs qui furent choisis comme victimes ― et l’on peut dire qu’en cette occasion, le travail des prêtres réussit au-delà de toute espérance, car aujourd’hui encore on colporte sur les hébreux les pires infamies ― même dans les milieux qui échappèrent depuis à l’emprise catholique, on fait du mot « juif » un terme de mépris. Cette campagne persévérante eut quelquefois de sanglants résultats : les pogroms russes et polonais sont les plus frappants exemples de l’état d’égarement dans lequel l’église catholique sut plonger les crédules. Plus tard, ce furent les protestants qui subirent l’assaut. À cette occasion se forma une secte qui devint célèbre. Un ancien soudard espagnol : Ignace de Loyola, créa la « Compagnie de Jésus », qui avait comme but initial l’affermissement de la puissance ecclésiastique. L’arme principale de cette association fut naturellement la calomnie. On connait le discrédit qui s’attache maintenant aux disciples de Loyola, et le terme « jésuite » signifie la plus forte expression de répugnance que l’on puisse émettre quant à la valeur morale d’un individu. Caron de Beaumarchais, en créant son Don Bazile, a campé admirablement le jésuite, et l’axiome « Calomniez, calomniez ! il en restera toujours quelque chose » est devenu justement célèbre.
Ensuite, ce furent les républicains, puis les socialistes qui supportèrent lourdement le poids de la calomnie officielle. Et enfin, depuis une quarantaine d’années, ce sont les anarchistes qui se voient le plus implacablement chargés de tous les méfaits imaginaires. Les anarchistes sont davantage accablés, parce que, adversaires implacables de tous les charlatans, ils voient se liguer contre eux toutes les forces religieuses et politiques. Il n’est pas un crime, pas un méfait qui ne se commette sans qu’on essaie de prouver que le ou les auteurs de ce crime ou méfait est un anarchiste.
Disons que malgré cela, petit à petit la vérité se fait jour grâce à l’inlassable propagande des militants et que les exploités commencent à comprendre que les anarchistes sont encore leurs meilleurs et leurs seuls véritables amis.
Mais il n’y a pas que sur le terrain politique ou philosophique que la calomnie est employée. Journellement, dans .les rapports les plus intimes, pour les motifs les plus futiles (quelquefois, même, sans motif aucun), l’arme empoisonnée est dirigée contre quelqu’un qui n’en peut mais ! Les méchants, les jaloux, les êtres faibles et nuls manient avec vigueur cette incomparable auxiliaire de la vilenie, de l’envie et de la médiocrité. Le plus souvent la calomnie _ rampe lentement et met un temps infini à parvenir aux oreilles du calomnié. C’est d’abord un racontar, une incrimination qui, au fur et à mesure qu’elle s’éloigne de son point de départ se mue en affirmation, puis en accusation. De bouche en bouche, le bruit, faible d’abord, ne tarde pas à devenir un tonnerre. Alors, le mal fait est Irrémédiable. Comme il est rare que l’on puisse remonter à la source exacte d’une calomnie, on lui prête une quantité infinie d’auteurs et, en vertu de ce proverbe inepte : Il n’y a pas de fumée sans feu, les gens qui se sont faits les récepteurs de la calomnie y croient dur comme fer et ne se privent pas de la transmettre « sous le sceau du secret »... pour qu’elle circule plus vite. Et le plus terrible, c’est qu’aucune preuve, si magistrale, si péremptoire fût-elle, ne peut détruire l’ouvrage monstrueux accompli par le propagateur de ragots... C’en est désormais fini pour le calomnié. S’il n’a pas eu l’heur de trouver le calomniateur au début du méfait, il verra toute sa vie empoisonnée par la flèche venimeuse qu’un criminel lui aura lancée et que la stupide crédulité et la lâche passivité des autres auront ancrée en lui.
Pour être calomniateur, point n’est besoin d’avoir inventé la basse besogne. Pour avoir sur la conscience le poids d’une vilenie, nul besoin n’est d’être soi-même l’auteur de cette vilenie. Celui qui entend une accusation monstrueuse contre un autre est aussi un calomniateur s’il n’exige pas des preuves et se rend, par cela même, complice de la calomnie. Point n’est besoin. même, de s’être fait le propagateur d’une affirmation infamante pour avoir droit à l’épithète de calomniateur. Il suffit simplement d’avoir entendu une accusation contre quelqu’un, et de ne pas avoir prévenu la victime, de ne pas avoir essayé de mettre en face l’accusateur et l’accusé, pour s’être, par un silence passif, fait le complice de la mauvaise action. Et c’est souvent pire qu’une mauvaise action, c’est un véritable crime que la calomnie. Toute une vie de labeur, de droiture et d’abnégation peut être détruite par une assertion, et la victime terrassée n’a plus qu’a essayer la besogne titanesque de réduire à néant l’œuvre infâme. Elle en sortira meurtrie, broyée et sanguinolente, elle aura connu toute l’amertume des reniements d’amitié, toute la douleur de se voir trahi et sali et l’horrible, l’indescriptible souffrance de se sentir injurié, suspecté, même dans les actions les plus nobles et les plus désintéressées. Car la mentalité de nos contemporains est ainsi faite qu’elle accepte difficilement un récit montrant quelqu’un comme un être d’élite, mais qu’elle accueille avec une avidité déconcertante tout ce qui tend à avilir et à dégrader un quelconque personnage. Et c’est là une constatation qu’on peut faire personnellement : les noms des criminels restent gravés dans la mémoire des gens, mais ceux des savants, des bienfaiteurs de l’humanité s’effacent aussi vite qu’ils ont été enregistrés, si tant est qu’ils le furent. Aussi, peut-on dire, sans crainte d’être taxé d’exagération, que la calomnie est un véritable crime.
Elle est la cause de grands et terribles drames, et c’est assurément la calamité qui a, à son compte, le plus grand nombre de victimes.
Il faut travailler de toutes nos énergies à enlever de nos mœurs cette dégradation de l’être. Pour cela, il nous faut habituer les gens à la franchise, il nous faut, toutes les fois que nous le pourrons, arrêter net la calomnie à ses débuts. Quand nous entendons quelqu’un lancer une accusation contre un autre, forçons l’accusateur à confirmer ses dires devant celui qu’il veut accabler ; demandons, exigeons des preuves formelles, sinon, n’hésitons pas à le flétrir et à s’écarter de lui comme on s’écarte d’un pestiféré, comme on se sépare d’un mouchard : car le calomniateur dépasse quelquefois le mouchard en vilenie. N’accueillons pas les racontars, ne ramassons pas les accusations à la légère. Disons-nous bien que celui qui voyant se perpétrer un crime ne fait rien pour l’empêcher devient aussi criminel que l’auteur du crime. Et mettons-nous bien cette pensée dans la tête : que le calomniateur est l’être le plus vil, le plus lâche, le plus ignoble, le plus abject et le plus criminel qui puisse être. Et pour arrêter à jamais le règne infâme de la calomnie, faisons de la franchise un devoir dans nos relations humaines, et nous aurons bien travaillé pour l’avènement d’une société dans laquelle la vérité sera le principal pilier de la fraternité entre tous les hommes.
Louis LORÉAL
CALOTIN
n. m.
Homme appartenant à la catégorie des bigots, cagots (voir ces mots).
CALVAIRE
n. m.
Le Calvaire (avec une majuscule) du Golgotha est une montagne, près de Jérusalem, où, d’après la légende, fut crucifié Jésus-Christ. (Sur son emplacement s’élève aujourd’hui la basilique du Saint-Sépulcre.) Par dérivation et au sens propre, le mot calvaire (sans majuscule) sert à désigner une petite élévation sur laquelle on a établi une représentation figurée de la Passion, ou une simple croix. C’est au Moyen-Age que l’on conçut l’idée de figurer dans le voisinage des églises paroissiales, les principales scènes de la Passion. Ces petites mises en scène sont une excellente occasion de processions et de quêtes pour l’Église. Au sens figuré, et par allusion aux souffrances endurées par Jésus-Christ gravissant la montagne du Calvaire, on appelle calvaire une cruelle douleur morale extrêmement pénible à supporter. Exemple : une heure sonnera où les peuples se lasseront de gravir leur calvaire sans murmurer.
CALVINISME
s. m.
Doctrine de Calvin et de ses sectateurs ; réforme religieuse telle que l’entendait Calvin. Les dogmes essentiels du Calvinisme, peuvent se réduire à six principaux, savoir :
-
Dans le sacrement de l’eucharistie, Jésus-Christ n’est pas réellement dans l’hostie ; nous ne le recevons que par la foi ;
-
La prédestination et la réprobation sont absolues ; l’une et l’autre dépendent de la pure volonté de Dieu, sans égard au mérite ou au démérite des hommes ;
-
Dieu donne aux prédestinés la foi et la justice, et ne leur impute point leurs péchés ;
-
La conséquence du péché originel est l’affaiblissement de la volonté de l’homme, au point qu’elle est incapable de faire aucune bonne œuvre méritoire de salut et même aucune action qui ne soit vicieuse ;
-
Le libre arbitre consiste à être exempt de co-action et non de nécessité ;
-
Les hommes sont justifiés par la foi seule ; en conséquence les bonnes œuvres ne contribuent en rien au salut ; les sacrements n’ont d’autre efficacité que d’exciter la foi.
Calvin n’admettait que deux sacrements : le baptême et la Cêne ; il rejetait absolument le culte extérieur et la discipline de l’Église catholique.
Né du libre-examen, Calvin nia la liberté. Il affirma la prédominance de la raison individuelle, sur les autres raisons. Mais le Calvinisme après la mort de Calvin, ne tarda pas à revenir à son point de départ et à apporter le secours de la raison, à la foi. La religion en souffrit, car naquirent des protestants : les libres-penseurs, dont l’analyse ne s’était pas arrêtée au culte catholique, mais s’attaqua à la base même des religions, à Dieu.
Calvin, né à Noyon, mort à Genève (1509–1564), étudia la philosophie, la théologie, puis le droit, passa au protestantisme en 1534, publia en latin (1536) puis en français (1541), son livre de l’Institution chrétienne, d’une langue ample et forte, et s’installa à Genève, dont il réforma les idées et les mœurs de manière à en faire la citadelle du protestantisme. Ses disciples reçurent, en France, le nom de Huguenots. Le calvinisme est répandu surtout en Suisse, en Hollande, en Hongrie et en Écosse. En Angleterre, il a produit le puritanisme et la plupart des sectes non conformistes. Quoique moins hypocrite que le catholicisme, le protestantisme n’en est pas moins néfaste comme toutes les religions.
CAMARADE
Mot qui s’est substitué, chez les cabotins de la politique, au mot « citoyen », qui était usé et ne rendait plus. Tout candidat à la députation se croit obligé de commencer ses discours par l’expression « camarades », c’est plus familier, plus démocratique. « Citoyens », c’était encore trop bourgeois. Il a donc fallu inventer un terme nouveau, ou plutôt utiliser un terme ancien pour flatter le peuple et l’endormir. Camarades a été ce mot là. Il a fait son entrée dans la politique, est devenu à la mode et il n’est guère aujourd’hui de groupements, de réunions, de « meetings » où il ne soit employé par les dirigeants d’un parti. Sommes-nous plus heureux, moins « légalisés », moins accablés d’impôts, moins prisonniers de l’autorité depuis qu’un tel mot a été introduit dans le jargon politicailleur ? Au contraire, il n’y a jamais eu moins de « camaraderie » dans les groupements où les premier venus emploient ce mot sans y croire, le galvaudant, l’abaissant au niveau de leur mentalité d’arrivistes.
Pseudo-camarades. Quand on prononce le mot « camarades », on est porté naturellement à croire qu’il traduit une affinité d’esprit, des liens de sympathie, d’amitié, d’entraide, d’estime, d’affection, entre esprits pensant la même chose et agissant dans le même but. L’expérience nous démontre malheureusement qu’il n’en est pas toujours ainsi, et que ce mot ne correspond nullement à son sens véritable. On est tout étonné de rencontrer parmi les « camarades », des êtres indifférents, hostiles, et même dangereux. C’est un mot dont on a beaucoup abusé et dont on abuse encore. Il faudrait mettre un terme à cet abus. Ce mot ne devrait pas être employé à tout propos. Parce qu’ils se sont serré la main en se disant : « Camarades », des gens croient avoir prouvé leur attachement à la cause et mis en pratique leurs idées. Il n’en est rien. Nos pires ennemis se recrutent souvent parmi nos camarades. Ceux-ci, connaissant nos secrets, car nous nous confions à eux alors qu’ils oublient de se confier à nous, sont bien placés pour nous trahir. On se demande d’où viennent les coups qui nous frappent. C’est souvent un camarade, rencontré la veille, qui vous témoignait de chaudes marques de sympathie, et que vous n’auriez jamais soupçonné d’une vilaine action, qui vous a joué ce tour.
Un peu moins de poignées de mains, et un peu plus de solidarité, ce serait mieux. Soyons camarades autrement qu’en paroles. Il est fâcheux d’avoir à se méfier quand un inconnu vous interpelle : « Camarade ! » Il est souvent préférable d’avoir affaire à un bourgeois qui vous dit « Monsieur » et vous aborde poliment, qu’à des camarades qui vous tutoient ; ne se mettant bien avec vous qu’a fin de mieux vous trahir. Si la méfiance entre camarades est un mal, la trop grande confiance en est un autre, car il est des camarades indésirables, qu’on a de justes raisons de redouter. Il faut avoir assez de flair, de perspicacité, de psychologie pour savoir discerner les vrais camarades des faux. On voit les camarades à l’œuvre, quand on est dans la peine ou dans l’embarras : ils vous lâchent ! Tant qu’on n’a pas besoin de leurs services, ils sont à vos côtés. Il ne faut pas compter sur eux s’il vous arrive le moindre ennui. C’est une véritable calamité d’avoir affaire à certains camarades. Ils s’attachent à vos pas, vous suivent partout, non par sympathie, mais parce qu’ils ne savent à quoi employer leur temps. Que font-ils ? On n’en sait rien. On ne l’a jamais su, et on ne le saura jamais. Vous avez beau leur faire comprendre que vos instants sont précieux, ils ne vous lâchent pas d’une semelle. Que veulent-ils ? Quel but poursuivent-ils ? De quoi vivent-ils ? C’est louche. Il est des camarades qu’il est bon de ne pas fréquenter, ils sont vraiment compromettants ; ils cherchent à vous attirer dans une sale affaire, sachant bien qu’ils en sortiront indemnes. Ils se conduisent comme des policiers (il y a des chances pour qu’ils fassent partie de cette corporation). Vous marchez : vous êtes pris. Dès qu’il s’agit de faire un beau geste, il n’y a plus personne. Ces camarades tarés, qui agissent dans tout ce qu’ils font comme d’ignobles bourgeois, sont extrêmement dangereux. Pour se tirer d’embarras, Ils n’hésitent pas à vous dénoncer. Cette « camaraderie » qui est la raison d’être des groupements d’avant-garde existe souvent moins dans ces groupements, que, partout ailleurs. Ce qui est déplorable chez les communistes ou les individualistes, c’est la méfiance entre camarades. Ils se surveillent, s’épient. Aucune confiance ne règne parmi eux. Chacun se cache, dérobe à l’autre sa pensée, ses sentiments, ses moyens d’existence. On a vu des groupements dont les programmes étaient généreux, manquer de cette harmonie qu’il préconisaient. Combattant toutes les superstitions, exaltant par-dessus tout le beau, le bien et le vrai, ces « camarades » qu’un idéal élevé aurait dû rendre meilleurs passaient leur temps à se soupçonner, se jalouser, se nuire, dissimulant leurs pensée, agissant sournoisement en-dessous. Triste constatation !
Des camarades introduisent dans les « milieux » la politique. Ils prononcent des excommunications alors qu’ils devraient être les premiers excommuniés. Leur tyrannie est insupportable. Avec eux, impossible de discuter. Ils n’admettent pas la contradiction. Leur autoritarisme est sans bornes. Rien ne les distingue plus des bourgeois. S’il n’y avait pas dans les groupes, ces camarades tarés à tous les points de vue, ces groupes pourraient faire de la bonne besogne, tandis qu’il n’en sort que de la mauvaise. Intellectuels ou manuels, de tels camarades font la pire des besognes, semant la haine, la calomnie, la jalousie, l’envie, la discorde partout où ils passent. Il est des camarades insupportables par leur pédantisme. Ils veulent à tout prix que vous épousiez leurs idées, alors qu’ils n’en ont pas. Ils ne cessent de vous agacer avec leur pseudo science, les formules prétentieuses dont ils usent : ils prétendent tout savoir, et ils ne savent rien. Ils se croient supérieurs, et dans n’importe quelle circonstance, vous vous apercevez de leur infériorité intellectuelle et morale. Le pédantisme fait ses ravages dans les milieux dits avancés autant que dans les autres. On voit des camarades venir à des causeries, conférences, réunions, avec l’idée fixe de vous contredire, à propos de n’importe quoi et avec n’importe quels arguments. Quant à s’instruire, ils n’en ont cure. Ils sont contents d’être applaudis par leurs copains et d’avoir pu prouver au « conférencier », en criant et en gesticulant, qu’ils sont plus forts que lui. Ils viennent avec l’idée de troubler une réunion, quel que soit le sujet qu’on traite. Ils vous font des objections qui ne tiennent pas debout. Ils cherchent à se rendre intéressants par n’importe quels moyens. Ou bien encore, ils vous salissent ou vous font salir par d’autres camarades dans les feuilles plus ou moins libertaires. Procédés que les bourgeois eux-mêmes hésitent souvent à employer. Les chapelles d’admiration mutuelle sont aussi néfastes que les parlottes de dénigrement mutuel. Il n’y a dans l’un et l’autre cas aucune camaraderie. La seule façon de mettre un terme à ces mœurs intolérables provenant d’une fausse conception de la camaraderie, c’est la réforme de l’individu. Que les individus bannissent l’envie, la vanité et l’hypocrisie de leur cœur. Qu’ils s’améliorent, soient plus tolérants, moins injustes, et la fausse camaraderie aura vécu. Cela vaudra mieux que des discours, des paroles en l’air et même des écrits. La camaraderie exige des actes.
Anciens camarades. ― Que sont devenus les anciens camarades dont l’enthousiasme vous réchauffait, avec lesquels vous aviez combattu à vingt ans ?
Un beau jour, on ne les a plus revus. Ils ont disparu de la circulation. Ils se sont embourgeoisés. La plupart sont casés. Ils ont épousé une femme riche ou fait fortune. Ils vous reprochaient votre tiédeur, vous n’étiez jamais assez avancés pour eux. Vous étiez un « sale bourgeois ». N’empêche que vous êtes toujours le même, et qu’ils sont autres. Ils sont passés de l’autre côté de la barricade, dans le camp des repus, des satisfaits. ― « Oui, disent-ils, j’ai changé. Quand on est un homme honnête, on doit abandonner ses opinions si on reconnait que l’on s’est trompé. J’étais anarchiste je ne le suis plus, voilà tout. J’estime qu’il faut faire son devoir. On ne vit pas dans les grèves. On vit en société. J’ai changé, et je m’en trouve bien ». Il a suffi d’une place, d’un titre, d’un bout de ruban, quelquefois moins, pour qu’ils évoluent. Ils vendent de la mélasse ou palabrent dans les salons de l’Élysée. Ils ne parlent plus de tirer sur les officiers ni de voler le coffre-fort des capitalistes. Ils sont rangés, rangés, vous dis-je, rangés, rangés jusqu’à leur mort. C’est que leurs convictions étaient peu solides. Ils n’attendaient qu’une occasion pour s’en défaire. Mes anciens camarades sont devenus des bourgeois bien pensants, d’honnêtes commerçants, de braves militaires, d’excellents fonctionnaires et de parfaits « maquereaux ». Ce sont de bons pères de famille et de valeureux patriotes. Ils ont trouvé leur voie. Qu’ils y restent ! Ils sont devenus ministres, ou sous-ministres. Ils arborent à leur boutonnière les palmes académiques ou le ruban de la Légion d’honneur. Vraiment, beaucoup de nos anciens camarades ont mal tourné. On connait les « camarades ». On sait ce dont ils sont capables. Ils ne se préoccupent guère de mettre leurs actes en harmonie avec leurs théories. Leur camaraderie n’est qu’un bluff. C’est le plus souvent une exploitation.
N’exagérons rien cependant. Ne soyons pas pessimistes. Ne décourageons personne. Soyons justes. Il y a de bons camarades, d’excellents cœurs, qui répondent : « Présents ! » chaque fois qu’il le faut. Ils sont rares, ils ne courent pas les rues, mais enfin on en trouve. Ceux là méritent d’être aimés. Un bon camarade est aussi rare qu’un véritable ami. Que dis-je, n’est-ce pas le « type » même du véritable ami ? Un bon camarade vous éclaire sur vos défauts comme sur vos qualités. Il est le conseiller, le guide, ne cherchant à imposer ni ses conseils ni sa manière de voir, mais seulement à vous être utile. Un bon camarade ne vous trahit point. Il agit avec le plus pur désintéressement. Il est sincère, et loyal. Il vous regarde en face et vous tend la main sans arrière-pensée. Il ne vous abandonne jamais aux heures difficiles. Il est là, tout près, qui vous soutient, moralement et physiquement. Il sait les paroles qu’il faut prononcer, les actes qu’il faut accomplir, sans bruit, sans ostentation. Il se donne selon ses moyens, selon ses forces, mais il se donne entièrement. Le peu qu’il fait, c’est beaucoup. Il nous défend si on nous attaque. Il partage avec vous son repas, son lit. Il vous donne tout ce qu’il possède. Nobles cœurs, combien vous êtes rares ! Connaissons-nous beaucoup de gens qui méritent ce beau nom : « camarades » ? On hésite vraiment à l’employer avec certaines brutes. Des camarades qui vous salissent, vous traînent dans la boue, vous assassinent lâchement par derrière, on en trouve partout, à chaque instant, mais des camarades loyaux, sincères, généreux, désintéressés, quand vous en rencontrez un sur votre route, dites-vous bien que vous avez trouvé un trésor.
Causerie entre camarades : causerie familière, sur un sujet intéressant, concernant telle ou telle question d’ordre moral ou politique, et qui peut contribuer à l’éducation des groupes et des individus.
En camarade : expression par laquelle une femme : vous fait comprendre qu’elle se promènera ou déjeunera avec vous, sans aller plus loin. Certaines femmes veulent bien être votre camarade, mais non votre maîtresse (il y a une nuance). C’est leur droit. Elles veulent bien entretenir avec vous des relations intellectuelles, mais non des relations sexuelles. Ce sont des relations purement amicales. Ces femmes estiment que l’amitié est préférable à l’amour, et qu’elle engendre moins de déboires. Elles peuvent parler librement pendant des heures avec un homme, ― ou des hommes ― de la question sexuelle, de l’amour libre, du sexualisme révolutionnaire et autres questions connexes, sans que cela leur fasse de l’effet. Aucune conversation ne les intimide. Véritables garçons, du moins sous ce rapport de la chair, et on se sent tout de suite à l’aise en leur compagnie. Elles consentent à vous accompagner n’importe où, à partager vos jeux, vos sports, vos distractions, quant à se donner, elles s’y refusent. La camarade expire où commence la maîtresse. De telles femmes peuvent être fort agréables ; cependant, certains hommes trouvent que ce n’est pas suffisant, ils ne peuvent se contenter de la camaraderie. Il leur faut davantage.
Camaraderie amoureuse : On désigne sous ce nom, une conception de l’amour qui n’a pas cours dans les milieux bourgeois. C’est sous des formes hypocrites, dissimulées par la légalité que les bourgeois pratiquent une pseudo-camaraderie amoureuse. La camaraderie amoureuse consiste en ceci : qu’une femme ne doit pas plus se refuser à l’homme qui la désire que celui-ci ne doit se dérober à son invite. Cependant, il faut tenir compte, dans le pluralisme sexuel, du tempérament et des préférences. Se donner comporte un choix. Il y a des femmes qui refusent de se donner au premier venu, qui ne se préoccupe guère si la chose leur agrée ou non. En somme, la camaraderie amoureuse consiste en ceci : « Nous nous plaisons, unissons-nous, sans consulter personne ». La camaraderie amoureuse offre des difficultés pratiques, et elle n’est pas à la portée de tout le monde. Elle suppose des esprits affranchis, ayant banni de leur cœur la jalousie, et consentant à ce que leur compagne ― ou leur compagnon ― dispose de sa personne comme on entend le faire soi même. L’amour plural est impossible sans réciprocité, consentement mutuel.
― G. DE LACAZE-DUTHIERS
CAMARADERIE
Qu’on considère l’anarchisme sous l’angle qu’on voudra, au point de vue le plus farouchement individualiste ou le plus largement communiste ; qu’on le regarde comme une éthique purement individuelle ou comme une conception uniquement sociale, sa réalisation est et restera toujours d’ordre « humain », c’est-à-dire qu’en Anarchie, il existe et il existera des « rapports entre les hommes » comme il en a existé et existe dans tous les milieux sociaux, quelle que soit leur importance.
Nous savons qu’en Anarchie, ces rapports ne sont pas déterminés par la contrainte, la violence, la loi ; nous savons qu’Ils ne sont pas soumis à des sanctions disciplinaires ou pénales ; nous savons qu’ils ignorent l’empiètement sur l’évolution d’autrui, la malveillance, l’envie, la jalousie, la médisance ; nous savons qu’en aucun cas ces rapports ne sauraient être basés sur le contrôle des actions individuelles, leur « standardisation » à un étalon-règle de conduite unilatéral, applicable dans tous les cas et convenant à tous les tempéraments. Il est essentiel, en effet, que tout cela soit inconnu « en anarchie », si l’on ne veut pas que ressuscite ou reparaisse ― sous sa vraie figure ou sous un masque ― l’Autorité, c’est-à-dire l’État et le gouvernement.
Reste donc à nous demander quelle forme « en anarchie » revêtent ou revêtiront les rapports des humains entre eux.
À mon sens, ils ne peuvent, ils ne pourront s’établir que sur une certaine façon, une manière spéciale de se comporter les uns, à l’égard des autres que je dénommerai camaraderie. C’est un de ces mots dont on a beaucoup abusé pratiquement, et j’en sais quelque chose, Ailleurs, j’ai proclamé que la camaraderie était d’ordre individuel et je ne m’en dédirai point ici. La camaraderie est affaire d’affinités individuelles, c’est exact ; il est évident que là où les affinités font défaut ; la camaraderie est une piètre chose, si on veut qu’elle descende des brumes de la théorie. Je concède qu’il est difficile d’imaginer une camaraderie d’ordre très intime entre nomades et compagnons appréciant le confort d’un intérieur ― entre pratiquants de l’unicité en amour et pratiquants de la pluralité amoureuse ou du communisme sexuel ― voire entre partisans d’un régime alimentaire exclusif. Mieux vaut que ceux qui tiennent à la réalisation d’un aspect spécial de la vie en liberté se groupent entre eux. La souplesse de la conception anarchiste de la vie qui permet tout autant à l’isolé qu’à l’associé de vivre « sa » vie, qui laisse les associations fonctionner chacune à sa guise et se fixer librement n’importe quel objet ― la souplesse de la conception anarchistes, disons-nous, implique une telle diversité d’unions et de fédérations d’unions qu’il reste et restera loisible à n’importe quelle unité de se réunir à qui il lui convient davantage.
Mais tout ceci exposé, il reste encore à définir ce qu’il faut entendre par camaraderie. Sans doute, c’est une expérience comme tous les incidents de la vie individuelle, sans doute ce n’est ni une obligation ni un devoir ; mais ce n’est pas seulement une expérience, c’est une disposition d’esprit, un sentiment qui relève de la sympathie, de l’ordre « affectif » et qui, généralisé, constitue comme une sorte d’assurance volontaire, de contrat tacite, que souscrivent entre eux les « camarades » pour s’épargner la souffrance inutile ou évitable.
À mon sens, une association de camarades anarchistes, c’est un milieu anti-autoritaire dont les composants ont décidé, entre eux, de se procurer la plus grande somme de joie et de jouissances compatible avec la notion anarchiste de la vie. La tendance dune association ou union d’anarchistes, toujours selon moi, est qu’en son sein se réalise la satisfaction de tous les besoins, de tous les désirs, de toutes les aspirations que peuvent éprouver et ressentir des êtres qui, tout en niant les dieux et les maîtres, ne veulent être des dieux et des maîtres pour aucun d’entre eux.
Je ne trouve pas de meilleur synonyme pour le terme camaraderie que le vocable bonté.
On peut exposer que tout recours à l’autorité étant écarté pour régler les rapports entre êtres humains, il va de soi que le recours au raisonnement s’impose pour la solution des difficultés qui peuvent surgir dans le milieu anti-autoritaire. N’est capable ― semble-t-il au premier abord ― de se passer d’autorité extérieure que celui qui se sent apte à se servir lui-même et de loi et de coutume. Sans doute. Dans tout milieu actuel ou à venir où on ignore les institutions étayées sur la contrainte, il est évident qu’on aura recours à la raison, à la logique pour résoudre les conflits ou les désaccords qui peuvent ou pourront malheureusement survenir ou subsister parmi ceux qui le constituent. Toujours ? Cet éternel, ce continuel appel à la froide raison ou à la logique implacable est insatisfaisant. Pareil milieu ressemblerait, à y réfléchir sérieusement, à une salle d’hôpital ou à un couloir de prison cellulaire bien entretenue.
Non, la raison, la logique ne suffisent pas à établir, à régler les rapports entre les hommes lorsque le recours à la violence ou à l’action gouvernementale en est exclu. Un facteur autre est indispensable, et ce facteur, c’est la bonté, dont la camaraderie est la traduction concrète. Force ici est de se rappeler que l’humain assez conscient pour écarter l’autorité de ses rapports avec ses semblables, n’est pas seulement doué de puissantes facultés d’analyse ou de synthèse, n’est pas seulement un mathématicien ou un classificateur ; c’est un être sensible, compréhensif, bon. Bon, parce qu’il est fort. On peut suivre une marche désespérément rectiligne et être un faible ― plus qu’un faible ― un pauvre hère qu’une excursion hors de la ligne droite désorienterait irrémédiablement. Le logicien imperturbable est souvent un déficient qui perdrait toute faculté de se conduire s’il était transporté hors du cycle de ses déductions. La logique indistinctement appliquée à tous les cas trahit souvent un manque de compréhensivité, de la sécheresse intérieure. Or, voici, pour moi, comment se définit la camaraderie, mise en pratique de la bonté : essayer, s’efforcer, tenter de saisir, de comprendre, de pénétrer, voire de s’assimiler les désirs, les aspirations, la mentalité en un mot, de celui, de celle, de ceux avec qui les habitudes ou les imprévus de la vie quotidienne nous mettent en présence ou nous laissent en contact.
Quoiqu’en prétendent les secs doctrinaires, je maintiens que la bonté reste sinon le principal, du moins l’un des principaux facteurs qui président aux relations entre les composants d’un milieu d’où est bannie toute autorité ― la bonté qui se penche sur la souffrance que l’existence engendre chez les vivants, la bonté qui n’est pas envieuse, la bonté que ne rebute pas une apparente froideur, la bonté qui ne s’irrite point et qui ne soupçonne point le mal, qui use de patience et de longanimité, la bonté qui revient plusieurs fois à la charge si elle a des raisons de supposer que son geste a été faussement interprété, la bonté qui espère et qui supporte ; la bonté qui sait tout le prix, toute la valeur d’une parole qui apaise, d’un regard qui console ― oui, la bonté en action, c’est-à-dire la camaraderie.
Nous pensons que c’est l’autorité qui est la cause de tous les maux dont se plaignent les individus et dont se lamentent les collectivités ; nous pensons que la « douleur universelle » est la résultante des institutions coercitives. Un milieu sans autorité, un milieu camarades, c’est un milieu où on ne doit plus souffrir, un milieu où on ne saurait rencontrer un cerveau qui s’atrophie faute de culture, un seul estomac qui se contracte faute de nourriture, un seul cœur saigne faute d’amour ― car où tout cela manque, fait défaut la possibilité de liberté de choix. ― Un milieu anti-autoritaire qui ne fait pas, qui ne ferait pas tout son possible pour assurer cela à ses constituants nous est, nous serait une pénible déception, une désillusion cruelle, n’aurait avec « un milieu de camarades », que des rapports vraiment trop lointains.
On peut objecter qu’il est des souffrances inévitables ; qu’en supposant même que toute autorité soit bannie des groupes où l’on évolue, il n’est pas certain qu’on se comprenne, les uns les autres sur tous les points. J’en conviens. Mais je demande à mon tour si le raisonnement aride, âpre et dur est à même de réduire à un nombre toujours moindre, les cas de douleur évitable ? Je maintiens que la bonté souple, flexible, assimilatrice réussira là où échouera l’implacable logique. Le monde de nos aspirations ― celui où nous souhaitons nous développer, croitre, nous sculpter ― le milieu de camarades, le milieu nouveau après lequel languissent et notre chair et notre esprit, c’est une ambiance sociable, où ne seront plus trouvées rancœur, amertume, insatisfaction. C’est un monde nouveau pour de vrai. C’est un monde où un effort constant, inlassable, est voulu pour réduire à un minimum toujours plus restreint les occasions de souffrance inévitable. C’est un monde de camarades. Eh bien, selon moi, dans ce monde nouveau, la bonté joue, jouera un rôle plus décisif que la raison pure. Et c’est ce rôle déterminant de la bonté, rôle volontaire, qui résume, à mon sens, toute la camaraderie.
― É. ARMAND
CAMARILLA
n. f. (mot espagnol diminutif du latin camera, chambre)
La camarilla est la coterie influente qui règne à la Cour d’Espagne. Par extension on se sert du mot camarilla pour désigner le groupe des courtisans qui dirigent les actes d’un chef d’État, d’un prince, d’une haute autorité quelconque. Dans un État, la camarilla est d’autant plus puissante que le chef est plus faible. Autant que le chef ― et parfois plus que lui ― elle est responsable des guerres et autres calamités qui s’abattent sur les peuples. Composée d’arrivistes et de jouisseurs sans scrupules, la camarilla n’a qu’un but : satisfaire ses intérêts, fût-ce en provoquant la ruine d’une nation. Pour citer des exemples récents, rappelons le rôle criminel des camarillas qui entourèrent Guillaume II et Nicolas II. Les camarillas sévissent dans tous les états, aussi bien dans les états républicains que dans les états monarchiques. Et elles sont aussi néfastes dans les uns que dans les autres. Seul un énergique assainissement pourra délivrer les peuples de ces coteries de parasites. Et seule la Révolution pourra réaliser cet assainissement.
CAMBRIOLAGE
n. m.
Action qui consiste à s’introduire dans la demeure d’autrui, pour y dérober ce qui lui appartient.
De même que le vol, l’escroquerie, le meurtre, le crime, le cambriolage est un fruit de l’arbre social actuel, il est un des vices qu’engendre le capitalisme.
La bourgeoisie et sa justice prétendent que le cambriolage est fils de l’oisiveté, de la paresse, etc..., alors qu’en réalité il est souvent déterminé par la misère et le désir de vivre d’une façon normale en se procurant les ressources indispensables que n’assurent pas les salaires du travail « honnête ».
Le cambriolage est réprimé dans tous les pays du monde, comme une atteinte à la propriété privée, individuelle ou collective, et cela se conçoit puisque tout l’ordre social est élaboré sur ce principe de propriété. La sévérité avec laquelle la justice sévît contre les cambrioleurs, se comprend d’autant plus, qu’en général, ceux-ci sont issus de la classe pauvre, et n’ont pas acquis, par l’instruction et l’éducation, les moyens d’user de procédés légaux, tels que le commerce, l’industrie, la banque, l’assurance, pour s’approprier le bien du prochain ; d’autre part, le cambriolage s’exerçant, d’une façon presque exclusive, au détriment d’individus appartenant à la bourgeoisie, cela suffirait à expliquer la férocité de la répression.
Vu ses risques, le cambriolage nécessite un certain courage physique, et une énergie indéniable ; il ne peut cependant pas être présenté, sur le terrain de la lutte de classe, comme une doctrine de révolte ou comme un moyen de libération sociale. Durant les périodes de trouble, et plus particulièrement à l’aube de l’Anarchisme, certaines individualités se réclamant de l’Anarchie se livrèrent à cette action dans un but totalement désintéressé. En Italie, en Espagne, et surtout en Russie, sous le régime tsariste, lorsque la répression s’exerçait violente contre les révolutionnaires et que la propagande engloutissait les faibles ressources du mouvement, des hommes se dévouaient et, au péril de leur liberté et même de leur vie, s’attaquaient à la propriété bourgeoise pour étendre financièrement les moyens de lutte. L’expérience a démontré, depuis, l’inopérance de ces actions, pour assurer la vie d’un grand mouvement qui doit s’appuyer sur le peuple et ne vivre que par la sympathie et l’effort des opprimés ; et l’on peut dire que le cambriolage, du point de vue anarchiste, n’est plus aujourd’hui qu’un accident.
L’État et les gouvernements se réservent cependant un droit au cambriolage. Celui-ci prend alors le nom de perquisition. (Voir ce mot.)
En conséquence, déterminé par le capitalisme, le cambriolage ne disparaîtra qu’avec lui.
On lira avec intérêt, les déclarations de l’Anarchiste Jacob, devant la Cour d’assises de la Somme, et qui furent publiées en brochure sous ce titre : « Pourquoi j’ai cambriolé ».
― J. CHAZOFF
CAMÉLÉON
n. m. (du latin camelus, chameau ; leo, lion)
Le caméléon est un petit reptile habitant les contrées les plus chaudes de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique. Certains naturalistes le classent dans la famille des lézards, d’autres l’en séparent. Ce reptile a le corps de forme triangulaire, et son dos qui se termine en lame de rasoir semble parfois devenir tranchant ; sa peau est recouverte de petits tubercules, ses yeux très gros lui sortent de l’orbite, et sa queue retournée lui permet de s’accrocher aux branches. Comme le chameau, très sobre de sa nature, le caméléon se nourrit de mouches qu’il attrape en dardant sur elles sa langue très longue ; mais il peut rester de longs mois sans absorber aucun aliment. Absolument inoffensif, le caméléon est très lent à se déplacer et est en conséquence victime de tous les animaux qui veulent l’attaquer, car il est totalement dépourvu de moyens de défense, c’est ce qui explique probablement ses longues stations sur les arbres. Il est considéré, avec raison comme un animal utile, sa nourriture comme nous l’avons dit plus haut ne se composant que d’insectes nuisibles.
Un des traits caractéristiques du caméléon est la faculté qu’il possède de changer de couleur à volonté, et de passer ainsi inaperçu par ses ennemis. C’est pourquoi depuis longtemps déjà on compare au Caméléon, les hommes politiques sans scrupules qui n’hésitent pas à changer la couleur de leurs opinions pour s’attirer les sympathies et les faveurs du peuple.
La Fontaine disait : « Les Caméléons politiques abondent » et il n’avait pas tort. Malheureusement les hommes et plus particulièrement ceux qui appartiennent à la classe ouvrière, se laissent toujours séduire par les belles couleurs de la politique sans s’apercevoir que si celles-ci changent, les résultats restent toujours négatifs.
Une des autres qualités du Caméléon est de se gonfler d’air au point de doubler son diamètre. Encore une autre raison, de prêter son nom, aux ambitieux et aux hypocrites.
En résumé, si le Caméléon-animal est utile aux populations des pays qu’ils habitent, le Caméléon politique est un être nuisible qu’il faut combattre comme un fléau social.
CANAILLE
n. f. (de l’italien canaglia, troupe de chiens)
On appelle canaille un ramassis de gens méprisables. La canaille est souvent aux honneurs. Depuis le banquier et le mercanti, jusqu’au politicien et au militaire, la canaille règne en maîtresse dans la société actuelle. De petite ou de grande envergure, suivant qu’elle a plus ou moins bien réussi, elle exploite et dupe de toutes les façons, la masse des travailleurs. Aucun scrupule ne l’embarrasse. Pour arriver à ses fins, pour assouvir sa soif d’argent ou de pouvoir, elle est prête à tous les crimes. Tous les moyens lui sont bons. Les accapareurs affameront le peuple pour arrondir leurs revenus et réaliser de scandaleux bénéfices. Les soudards galonnés enverront à la mort des milliers de jeunes garçons pour se tailler une sanglante gloire. Les politiciens feront de leur talent le plus vil commerce pour satisfaire leur ambition. Les prêtres exploiteront et monnayeront sans vergogne le besoin de mysticisme de l’homme. Et cette canaille opprimera le monde jusqu’au jour où les travailleurs, enfin conscients de leurs droits, se refuseront à être plus longtemps des instruments passifs de bourgeoisie. La canaille sera emportée par le flot régénérateur de la Révolution sociale.
CANDEUR
n. f. (du latin candor, blancheur éclatante)
Ingénuité, confiance naïve. L’homme candide est sans défiance et accepte aveuglément ce qu’on lui dit. Si la candeur dénote une bonne nature, elle n’en est pas moins un défaut, car elle permet à une caste d’intrigants d’opérer impunément par le mensonge et la tartuferie. Le peuple est, hélas, affligé de beaucoup trop de candeur. Malgré qu’il ait été trompé mille et mille fois, il suffit qu’un charlatan se présente pour qu’il se laisse de nouveau berner. Il accepte comme argent comptant les promesses les plus fantaisistes et les déclarations de foi les plus suspectes. Rien ne décourage sa confiance tenace. Parfois une brève colère le fait se dresser quand il s’aperçoit qu’il vient d’être dupé, mais que, l’instant d’après, le même homme qui l’a trompé vienne lui donner de fallacieuses explications et voilà de nouveau le peuple prêt à écouter des boniments. Candeur : voter pour des politiciens de droite ou de gauche qui cherchent uniquement à satisfaire leur ambition. Candeur : accepter les discours de soi-disant « ministres de Dieu sur la terre ». Candeur : se figurer que les guerres ont pour objet de défendre la « patrie » alors que seuls sont en jeu des trusts ou des compétitions financières. Candeur : croire exactes des informations que publie une presse vendue aux puissances capitalistes. Candeur : considérer comme des actes de justice les jugements partiaux et criminels d’un tribunal ou d’un jury. Etc... Seule la candeur de la foule permet à certaines institutions de continuer leur besogne néfaste. Le jour où tous les hommes jugeront sainement, en pesant soigneusement les arguments, en examinant froidement les choses et les gens, ce jour-là ils se demanderont comment ils ont pu être les victimes de mensonges aussi grossiers. Leur candeur aura fait place à une raison saine et clairvoyante. Le règne des charlatans aura vécu.
CANDIDAT
(du latin : candidatus, blanc)
L’origine du mot laisse supposer, qu’un candidat, qu’elle que soit la place, le titre, la fonction qu’il postule doit être « blanc » de toute souillure, vierge de tout reproche. Vulgarisé, le mot a dépassé sa valeur étymologique.
On s’inscrit comme candidat pour subir un examen, pour obtenir un diplôme, mais le mot candidat s’applique surtout aujourd’hui à celui qui se présente pour obtenir des électeurs un mandat politique, ou une charge publique : « candidat au Parlement, candidat au Conseil municipal, candidat au Conseil général, candidat au Conseil d’arrondissements, etc. ».
Pour tout homme raisonnable et logique, un candidat est un homme moralement discrédité ; car, pour obtenir de ses électeurs les suffrages qu’il réclame, il est obligé d’user d’intrigues et de bassesses. La corruption des candidats n’est pas nouvelle et certaines lois romaines du reste inopérantes, édictées cinq siècles, avant l’ère chrétienne prévoyaient des mesures pour assurer la loyauté des candidats et la propreté des élections. En étendant son champ d’action, la politique a également étendu son champ de corruption, et le candidat n’hésite pas à affirmer les monstruosités les plus invraisemblables, à employer la délation, la diffamation, le mensonge, pour abattre un adversaire, qui n’est du reste d’ordinaire pas plus intéressant que lui. Les procédés les plus ignominieux sont employés par le candidat pour assurer son succès. Il ne recule devant aucune promesse, même les plus ridicules, les plus irréalisables, pour s’attacher les faveurs de l’électeur sollicité et, si cela ne suffit pas, il ne répugne pas à acheter les consciences, de même qu’il est prêt à vendre la sienne.
Les exemples de candidats qui ont trahi sont innombrables et nombre de pays offrent un curieux assemblage d’hommes de toutes classes, qui, entrés dans la politique par la porte de gauche, se trouvent, quelques années plus tard, les plus farouches adversaires de la classe ouvrière. On se demande qui est le plus à blâmer : de l’électeur naïf et par trop crédule, ou du candidat retors et menteur. L’électeur est la cause dont le candidat est l’effet ; ce n’est que celui-ci qui peut supprimer celui-là. (Voir Électeur. Élection.)
CAPITAL
n. m.
Dans les milieux ouvriers, on confond facilement « Capital » et « argent », bien que ce soient deux choses tout à fait différentes. L’argent n’est qu’un intermédiaire, en usage pour faciliter l’échange d’un produit contre un autre produit (voir Argent), alors que le capital est la source de toute la production du globe.
Sa définition pourrait être très brève : « Le capital est la matière inerte qui, soumise à l’influence du travail humain, prend contact avec la vie et donne naissance à toute la richesse sociale du monde », Dans le langage courant, le terme est employé différemment et sert à désigner l’ensemble des produits accumules, un somme d’argent destinée à une entreprise, le dépôt initial d’une banque ou le principal d’une rente ; mais, quelle que soit la signification qu’on lui donne, on peut dire que le travailleur est dépourvu de capital et que celui-ci est entièrement entre les mains des puissances capitalistes.
Même si l’on considère comme Capital la puissance de travail de l’homme, il faut immédiatement reconnaître que ce capital est improductif s’il n’a pas à sa disposition un champ d’expérience où il puisse s’exercer. On ne peut en effet concevoir le travail d’un laboureur qui n’aurait pas de terre à ensemencer ou celui d’un forgeron dépourvu d’acier ou de fer. Même dans le domaine intellectuel, le capital « pensée » est improductif s’il n’arrive pas à s’extérioriser et à se matérialiser. Or, tout le capital matière, le capital visible, palpable a été accaparé par une minorité qui, par la ruse et par le vol, s’est rendue maîtresse de toute la terre et de tous les moyens de production. Les outils, les machines, les banques, les journaux, les champs, sont la propriété d’une poignée de jouisseurs, et le travail manuel et intellectuel ne peut se dépenser qu’autant que les possesseurs du capital, consentent à livrer leurs richesses à l’exploitation, et ils ne la livrent qu’à l’unique condition, que le capital travail leur réserve la part du lion.
Il est évident, que si le travailleur, refusait de louer ou de livrer son capital, celui des possédants serait également improductif ; nous croyons donc juste et logique notre définition du capital, lorsque nous disons qu’il est le composé de la matière, de la pensée, de l’intelligence et du travail.
Malheureusement par la vitesse acquise, par la routine, par les siècles et les siècles d’asservissement qui se sont succédés, le travailleur, totalement dépourvu de capital matière, ‘est incapable de se refuser à vendre à vil prix sa force productrice. La nécessité brutale et quotidienne l’oblige, s’il veut manger, à travailler en cédant la moitié ou les trois quarts de son capital travail et c’est ce qui produit, le bénéfice de celui qui, l’exploite. Alors que les stocks accumulés permettent aux détenteurs du capital d’attendre durant les périodes de trouble des jours meilleurs, le producteur est contraint par la faim de livrer sa seule richesse à un prix réduit.
La détention du capital par une poignée de privilégiés est donc une source de misère et de souffrance pour les uns et de bien-être pour les autres. Pourtant non pas seulement au point de vue anarchiste, mais en respect de la logique la plus élémentaire, le capital ne doit appartenir à personne, mais à tous. Il est le travail de générations entières qui ont souffert et fait effort pour nous léguer cet immense héritage et personne ne peut dire : « Ceci est à moi ».
Kropotkine écrit :
« Science et industrie, savoir et application, découverte et réalisation pratique menant à de nouvelles découvertes, travail manuel ― pensée et œuvre des bras, ― tout se tient. Chaque découverte, chaque progrès, chaque augmentation de la richesse de l’humanité a son origine dans l’ensemble du travail manuel et cérébral du passé et du présent. Alors de quel droit quiconque pourrait-il s’approprier la moindre parcelle de cet immense tout et dire : Ceci est à moi, non à vous ? »
Certes, Kropotkine a raison, avec tous les Anarchistes. Il s’est trouvé pourtant, en dépit de toute raison, des hommes pour affirmer : « Ceci est à moi » et d’autres pour se laisser déposséder.
Il est donc facile à comprendre qu’une nation, une province, une contrée, une famille, un individu, ne sont pas riches par la somme d’argent qu’ils possèdent et qui ne représente qu’une faible partie de leur capital, mais surtout par l’étendue des domaines productifs et exploitables qu’ils ont acquis : terrains cultivables, voies ferrées, bateaux, immeubles, fabriques, usines, manufactures, magasins, comptoirs, etc...
Avant la guerre, la France était une des nations qui avaient le plus de capital argent, et cependant elle était loin d’atteindre l’Allemagne, l’Angleterre ou les États-Unis, au point de vue du développement industriel et commercial. La raison en est simple. C’est que la France était un pays de petits capitalistes, de petits paysans qui conservaient leur capital argent dans leur bas de laine, et le laissait improductif. (Voir : Capitalisation.) Le numéraire n’a qu’une valeur relative et représentative alors que le capital a une valeur réelle. Les États-Unis d’Amérique ne doivent pas leur prépondérance mondiale uniquement à la somme de dollars qu’ils détiennent mais surtout au capital qui est représenté par les mines, les exploitations agricoles, le machinisme, et surtout par le pétrole dont ils ont le monopole. L’Angleterre est puissante parce qu’elle contrôle 75 % de la production du caoutchouc, produit indispensable en notre siècle de l’automobile et de l’aviation. Voilà ce qu’est réellement le capital ; les travailleurs, eux, qui produisent toutes ces richesses, qui donnent leur sueur, qui vieillissent avant l’âge, sont la source de tout ce capital et se font même tuer pour le défendre alors que celui-ci ne profite qu’à quelques potentats avides, incapables de défendre leurs richesses pendant que le travailleur périt parfois de misère.
Les Anarchistes qui affirment ― et ils ne sont pas les seuls ― que l’on pourrait se passer d’argent, ne sont donc pas, comme on se plaît à le chanter, les adversaires du capital, c’est-à-dire de la richesse sociale. Mais ils s’élèvent contre la classe qui l’a accaparé, qui se l’est approprié, et qui entend le conserver et continuer à en tirer tous les profits. Les Anarchistes demandent que le Capital soit mis à la disposition de tous. Ils veulent :
« Que ce riche outillage de production, péniblement obtenu, bâti, façonné, inventé par nos ancêtres, devienne propriété commune, afin que l’esprit collectif en tire le plus grand avantage pour tous. ― Il faut l’expropriation. L’aisance pour tous comme but, l’expropriation comme moyen » (P. KROPOTKINE).
Hélas ! nous savons trop que ceux qui détiennent la richesse sociale et sont les maîtres de l’ordre économique ne se laisseront pas déposséder de bon gré. C’est pourquoi les Anarchistes sont révolutionnaires, non pas pour détruire le Capital mais abolir le capitalisme.
― J. CHAZOFF
LE CAPITAL
Titre de l’œuvre maîtresse du grand sociologue allemand Karl Marx, qui a développé dans ce formidable ouvrage toutes les variations, les transformations et l’orientation du capital. L’ouvrage de Marx n’est pas à la portée du travailleur. D’une lecture ardue et toute scientifique il s’adresse plutôt à l’école des philosophes qu’au manuel. Les disciples de Marx ont cependant vulgarisé son œuvre et certains résumés du capital, accessibles à tous les cerveaux, seront lus avec intérêt par la classe ouvrière.
CAPITALISATION
n. f.
La capitalisation est l’action qui consiste à entasser du numéraire, de l’or, de l’argent, des billets de banque, ou à ajouter les bénéfices réalisés sur un capital quelconque à ce même capital.
Exemples :
-
Un paysan possède un terrain qui lui rapporte 1.000 francs par an. Il n’en dépense que 900 et conserve 100 francs dans son bas de laine. Il capitalise 100 francs par an ;
-
Un rentier a un capital X placé dans une banque, qui lui rapporte à raison de X % 1.000 francs de revenus annuellement. Il n’en dépense que 900 et ajoute à son capital X cette somme de 100 francs qui, à son tour, étendra ses intérêts. Il fait de la capitalisation ;
-
Un propriétaire possède une maison, dont la location lui rapporte annuellement une somme supérieure à celle qui est nécessaire à ses besoins. Au bout d’un certain nombre d’années, les bénéfices réalisés lui permettent d’acheter une autre maison. Il fait de la capitalisation.
Il y a donc plusieurs façons de capitaliser. En l’espèce le paysan fait de la capitalisation improductive, puisque son argent est retiré de la circulation et ne lui procure aucun bénéfice, alors que le rentier, le propriétaire ou l’industriel fait de la capitalisation productive. Naturellement plus l’individu capitalise, plus il peut capitaliser et plus il peut grossir ses revenus. Les bénéfices ajoutés au capital initial lui permettent d’étendre son domaine et de poursuivre son exploitation sur une plus grande échelle.
Quelle que soit la forme de capitalisation, elle est contraire à la saine morale et ne peut être réalisée que sur le travail d’autrui.
Supposons que notre paysan qui travaille seul son champ ait au bout de 10 années réussi à capitaliser 1.000 francs. Cette somme est absolument nulle et incapable de lui assurer un certain bien-être s’il cesse de travailler. Au contraire, qu’il achète avec cette somme capitalisée un autre champ et le fasse travailler par un ouvrier en se réservant une part de bénéfice, sa capitalisation lui sera utile et profitable, mais uniquement par le jeu de l’exploitation. Donc le profit sera de source impure.
Il en est de même de toutes les formes de capitalisation, et il est ridicule de dire que l’économie seule est source de richesse.
Un ouvrier travaillant 8, 9 ou 10 heures par jour, qui va, chaque semaine, porter quelques francs à la Caisse d’épargne, verra son avoir rapidement englouti si, par malheur, la maladie s’installe à son foyer ou s’il est entraîné dans un mouvement de grève. Et en admettant même l’impossible, que durant 25 ans il économise, en rognant sur le nécessaire, sur l’indispensable, qu’à force de privations, il réalise un petit capital, celui-ci ne lui permettra pas de vivre à l’heure où la fatigue et la vieillesse l’obligeront à abandonner son labeur. La capitalisation n’est rendue possible que par le travail accaparé de son semblable et est, en conséquence, néfaste à la société en général.
S’il est exact que selon la forte expression d’Anatole France, « Le militarisme crèvera d’obésité », la capitalisation, qui est une autre maladie des sociétés modernes, périra de la même mort, entraînant avec elle la fin du capitalisme.
CAPITALISME
n. m.
Nom donné au régime ou ordre économique en vigueur dans les sociétés modernes. « L’ordre économique capitaliste est sorti des entrailles de l’ordre économique féodal » dit Karl Marx ; en effet, le capitalisme se substitua au régime féodal qui ne répondait plus aux exigences internationales du commerce et de l’industrie naissantes. La féodalité, qui courbait sous le joug du seigneur non seulement le paysan, mais même le boutiquier et l’artisan, entravait l’évolution du commerce qui étouffait du manque de liberté. Ce ne fut pas brutalement que la transformation se produisit ; ce fut une lutte sourde, lente et de longue haleine, car le seigneur avait intérêt à voir se perpétuer un régime qui assurait à la hiérarchie de propriétaires, et aux possesseurs de titres nobiliaires, tous les privilèges et toutes les richesses sociales.
Grâce aux machines, aux inventions, aux progrès des sciences appliquées, le capitalisme latent devait sortir victorieux de ce conflit et la lutte contre la puissance seigneuriale, commencée par Louis XI devait se terminer par l’éclatante révolution de 89 et 91. Mais, pour que le capitalisme puisse percer et s’étendre durant cette longue période de gestation, il lui fallait le concours des éléments laborieux qui étaient emprisonnés dans les corporations, leurs maîtrises et leurs jurandes. Aucun grand mouvement historique ne s’accomplit sans la participation du peuple. Aussi, sous couvert de libéralisme, le capitalisme embryonnaire cherchât-il à capter la confiance et la sympathie du producteur. Après trois siècles de batailles, au cours desquelles les corporations furent dissoutes et reformées à plusieurs reprises, le dernier pilier de la féodalité s’écroula, lorsque la loi du 17 mars 1791 supprima définitivement les corporations.
Le capitalisme était né.
Le producteur était affranchi de la tutelle du seigneur, mais se transformait en salarié et devenait la proie de l’exploiteur. Rien n’était changé dans la forme. La liberté du salarié n’était qu’une illusion, et le capitalisme allait spéculer sur cette illusoire liberté, pour agrandir sa puissance et étendre ses pouvoirs ; détenteur de tous les moyens de production, de tout le capital inerte, il fallait que le capitalisme devînt le maître du travail humain, pour pouvoir exploiter son domaine, et la tâche lui fut relativement facile, puisque le travailleur, dépourvu de toute richesse, ne pouvait et ne peut produire qu’à la condition d’avoir l’autorisation de se servir du champ, de la charrue, de la machine ou de l’outil qui appartient au capitalisme.
De même que le seigneur, exigeait du paysan une redevance, le capitalisme exige une redevance du travailleur. « Les formes ont changé, les relations sont restées les mêmes ». Pour le capitalisme, le travail est une marchandise, tout comme le minerai ou le coton, et il l’achète selon ses besoins. Le travailleur n’a pas à pénétrer dans ses intentions, il n’a pas à chercher qu’elle sera la destination de sa production ; il vend son travail pour une somme qu’on prétend librement acceptée de part et d’autre, et le capitalisme réalise sur ce travail, le bénéfice qui lui convient. C’est sur cette formule arbitraire de liberté que s’est échafaudé le capitalisme. Ce régime odieux est arrivé à faire admettre par les populations ouvrières cette invraisemblance que l’ouvrier était libre alors qu’en réalité, il est esclave et obligé d’accepter, s’il ne veut pas crever de faim, les conditions que veulent et peuvent lui imposer ses exploiteurs.
Le capitalisme, aidé dans son évolution par l’application des nouvelles méthodes de production devait acquérir, en un laps de temps extrêmement court, une puissance colossale ; l’emploi de la machine à vapeur, la captation des forces naturelles, la vulgarisation du téléphone et du télégraphe dans le commerce, de l’énergie dans l’industrie, ajoutèrent une force inouïe à son développement. Petit à petit, il se trouva à la base de tous les grands organismes ; aujourd’hui, en se servant d’hommes de paille qu’il place et déplace, selon ses intérêts, à la tête des gouvernements, il dirige les parties essentielles du système social. Il contrôle tous les rouages de la société, et par l’association de la finance et de l’industrie, forme les cadres d’une franc-maçonnerie dont les grands capitalistes sont les martres absolus.
Mais toute médaille a son envers et tout ce qui a commencé a une fin. Le capitalisme renferme en lui le mal qui le tuera. Si, à ses origines, il eut besoin des sympathies du producteur, ce dernier ne tarda pas à s’apercevoir que ses destinées et ses intérêts étaient diamétralement opposés à celles de ses maîtres. Considéré comme une marchandise, le travailleur, à mesure que sa conscience s’éclairait, devenait de plus en plus exigeant, et par les lois de l’offre et de la demande, réclamait chaque jour un nouvel avantage à son exploiteur. Le machinisme, écarta ce premier danger en rendant inutile une certaine partie de la main-d’œuvre. Mais un autre danger fit place au premier. Ne trouvant plus à s’employer, le capital humain restait improductif et ne fournissait plus aux travailleurs ce qui était indispensable à leur existence et à celle de leur famille. Conséquences, le chômage, la grève, la révolte.
Or, le capitalisme qui est arrivé aujourd’hui à son apogée, évolue dans un cercle vicieux, duquel il ne peut plus sortir. Pour assurer sa vie et ne pas s’écrouler sous le poids de la misère humaine, il est obligé de fournir du travail à celui qui en réclame, et n’a que cela pour subsister. D’autre part, il ne peut fournir ce travail que s’il est assuré que la production soit écoulée. Si l’accumulation est profitable au capitalisme lorsqu’il entend imposer un prix et retire alors ses produits du marché, elle lui est néfaste si elle est rendue obligatoire par le manque d’acheteurs. Il faut invariablement, méthodiquement, mathématiquement, que le capitalisme écoule ses produits ou qu’il périsse. Il est donc contraint de s’étendre toujours et sans s’arrêter. Une halte et il est perdu. Il lui faut trouver des débouchés et comme il ne peut les trouver dans l’intérieur d’un pays, il est obligé de les chercher dans d’autres contrées. De là le capitalisme national et le jeu de la concurrence qui entravent l’unification du capitalisme international, et amène la formation des cartels, des trusts qui se combattent, dans l’espoir de rester seuls maîtres du marché. C’est de cette division que se meurt le capitalisme. Il ne retrouve, provisoirement, ― heureusement ― son unité et sa force que lorsqu’il est en lutte avec son adversaire le plus redouté et le plus dangereux : le travail.
Les conflits internationaux, les guerres coloniales n’ont pas d’autres origines que la nécessité, pour le capitalisme, de trouver l’écoulement de ses produits. Lorsque la diplomatie est inapte à régler un différend où sont en jeu les intérêts commerciaux ou industriels d’un capitalisme national, celui-ci a, alors, recours à la force brutale, à la violence, à la guerre.
Certains politiques, prétendent que la guerre est voulue par le capitalisme pour détruire une certaine partie de la main-d’œuvre, lorsque celle-ci devient trop encombrante. Le raisonnement est simpliste. C’est ce que l’on pourrait qualifier de philosophie pour classe pauvre. Si le capitalisme n’a pas intérêt à la surpopulation, il souffre cependant nationalement de la dépopulation, et, si la marchandise humaine n’apparaît que sur une faible échelle dans son budget, il faut cependant que la disponibilité du capital travail soit assez élevée pour atteindre les prix les plus bas possibles.
En réalité, la guerre fait partie du régime ; elle est un des membres dont le capitalisme est le corps, mais c’est un membre malade dont les capitalistes voudraient bien faire l’ablation. La guerre, elle est dû justement au développement intensif du commerce, de l’industrie, et plus particulièrement de l’industrie métallurgique, du pétrole et du caoutchouc qui a divisé le capitalisme en trois castes concurrentes à la tête desquelles se trouvent les grands potentats de la finance. Si quelques individualités assez aveugles puisent dans la guerre une source de profits, le capitalisme, en tant qu’ordre économique ne peut qu’y perdre, car elle ébranle les bases sur lesquelles est échafaudé le régime ; elle est inévitable pourtant et constitue avec la Révolution, les deux événements historiques qui détruiront cet ordre économique.
Le capitalisme disparaîtra donc. En égard des connaissances humaines, le développement intellectuel des travailleurs se poursuit méthodiquement, et la classe ouvrière cherche, par son action, à arracher au capitalisme ce qui fait sa puissance : son capital, dans le but de l’exploiter librement au bénéfice de tous.
Les économistes bourgeois ne sont pas sans voir le danger, et cherchent à détourner le cours de l’orientation capitaliste. Ils n’y arriveront pas, il est trop tard. Le capitalisme est perdu. Surpris lui-même par la rapidité de son extension, il a tout détruit sur son passage et s’est livré à une centralisation qui l’étouffera. Et pourtant il ne peut pas revenir en arrière. Obligé, pour vivre, en période de désaxage économique, de faire face aux exigences toujours grandissantes des classes laborieuses, il constate qu’il lui est Impossible de subsister s’il n’accorde pas aux travailleurs, surtout dans les pays de production intensive, un bien-être relatif, qui assurerait une paix momentanée, et lui permettrait de reprendre du souffle.
Et déjà les grands seigneurs américains consentent à accorder à leur prolétariat certaines satisfactions économiques, à la condition que celui-ci abandonne la prétention d’établir un ordre nouveau.
En vérité, le problème serait résolu, provisoirement toutefois, si le capitalisme n’était pas comme nous l’avons dit plus haut, animé par des intérêts qui se combattent, et n’était pas obligé pour la circonstance, surtout dans des pays comme la France, l’Italie ou l’Espagne, de sacrifier une grande partie des petits industriels, des petits commerçants, dont les intérêts particuliers dépassent les intérêts de classe, et qui ne veulent pas servir d’agneau pascal sur l’autel du capitalisme.
Quoi qu’on dise et quoi qu’on fasse, rongé à l’intérieur, luttant à l’extérieur, le capitalisme est arrivé au point culminant de sa trajectoire et après son ascension rapide commence sa descente effrénée. Certains sociologues, préconisent une nouvelle forme de capitalisme, qui assurerait l’égalité économique de tous ; le Capitalisme d’État. (Voir : Collectivisme, Socialisme, Bolchevisme.)
Les Anarchistes sont contre tout capitalisme, même d’État. Ils conçoivent que celui-ci ne peut s’élever que sur les piliers de l’Autorité. Par l’établissement de la Commune libertaire, ils espèrent rénover l’humanité et élaborer une société de libre production et de libre consommation où l’individu ne sera plus soumis à l’emprise d’un oligarchisme qui emprisonne les facultés et détruit toute liberté d’expansion et d’extension sociale.
― J. CHAZOFF.
CAPITALISTE
(la classe)
Fraction de la collectivité qui détient toute la richesse sociale. Minorité qui possède tout le capital. Je ne connais dans l’État que trois classes d’homme : les salariés, les mendiants et les voleurs. (MIRABEAU.)
En réalité, la société peut se partager en deux camps : d’un côté, ceux qui peinent, qui souffrent, pour arracher à la matière brute ce qui est indispensable à la vie de l’homme ; et, de l’autre, ceux gui prélèvent sur ce travail, sans avoir dépensé aucune énergie utile, la plus grande partie de la richesse produite. Ces derniers composent la classe capitaliste.
De même que le capitalisme a pris la place occupée antérieurement par la féodalité ; les capitalistes ont remplacé, dans l’ordre économique et politique, les seigneurs d’antan. Ils représentent la nouvelle noblesse : la noblesse d’argent. S’ils ne peuvent se réclamer de leurs ascendants et se réclamer de leurs titres nobiliaires, par la transmission même des richesses acquises, par le jeu de l’héritage, ils forment une noblesse héréditaire qui se perpétue et donne naissance à un esprit de caste, de race, de classe.
Les économistes bourgeois présentent comme un axiome que chacun, par le travail et l’économie, peut, dans nos sociétés démocratiques, sortir de sa situation inférieure et acquérir non seulement le bien-être, mais la fortune. Il serait presque inutile de souligner cette erreur intéressée. S’il est vrai que, de nos jours, aucune loi n’interdit à quiconque de faire fortune, la classe capitaliste est, en fait, aussi impénétrable pour le plébéien, le travailleur, que ne l’était l’ancienne noblesse, du fait même que la richesse ne fut et ne sera jamais la conséquence du travail, de l’honnêteté et de la sobriété, mais le produit de l’exploitation et du vol.
Les capitalistes forment donc bien une classe, à la tête de laquelle se trouve une aristocratie qui dirige, en leur nom, tous les rouages économiques, administratifs et politiques de la Société.
La ploutocratie exerce une telle ascendance sur le monde moderne, que, dans les pays où l’esprit du peuple est encore subjugué par les mots et les titres ronflants ― telle l’Angleterre ― le monarque ne manque jamais d’ennoblir un capitaliste influent. En France, déjà au XVIe et XVIIe siècle, les gros commerçants étaient considérés comme étant d’essence supérieure, et Louis XIV, le roi Soleil, déclara les marchands en gros capables d’être revêtus des charges de secrétaire du roi « ce qui donnait la noblesse ».
Maîtresse absolue des moyens de production, la classe capitaliste subordonne toute la population du globe. Seule détentrice de la fortune publique, seule, elle a la possibilité d’instruire et d’éduquer les enfants issus de sa classe, et c’est ce qui explique que tous les hommes occupant un poste élevé sur l’échelle sociale, travaillent à son profit : à leurs profits.
Malgré l’illusion démocratique (voir Démocratie), elle gère, à sa guise, à sa fantaisie et selon ses intérêts momentanés, tout ce qui a trait à l’économie et à la politique. Les gouvernants sont des pantins à sa solde et les parlements sont à plat ventre devant-elle, et toutes les lois sont élaborées à son avantage. En plus de son argent et des stocks de marchandises accumulées, qui peuvent lui permettre, dans une certaine mesure, d’attendre et de résister durant les périodes de trouble ou de révolte prolétarienne, elle a, pour se défendre, toutes les organisations policières, militaires, juridiques, pénitentiaires, dont la seule raison d’être est de faire respecter la propriété et les privilèges accaparés par le capitalisme. La grande Presse, ce poison quotidien qui déverse lentement, le mensonge et l’erreur dans le cerveau humain, est une arme terrible dont elle se sert à merveille pour étouffer tout sentiment de libéralisme ou de fraternité ; et le savant, le philosophe, le penseur, qui refusent de se prostituer à la cause de la classe capitaliste, sont impitoyablement écrasés et acculés à la misère la plus atroce.
Tout appartient à la classe capitaliste, rien ne lui échappe. Elle est un centre d’attraction pour tout ce qui peut être une source de bien-être moral et matériel et détruit ou tente de détruire tout ce qui peut présenter à ses yeux une menace immédiate ou future.
Si Louis XIV disait :
« L’État, c’est moi ». La classe capitaliste peut dire : « Le Monde, c’est moi ».
Devant cette puissance colossale, établie sur des siècles et des siècles d’ignorance, de servilité et de servitude, certains se demandent s’il sera un jour possible d’en ébranler les assises et d’en finir, une fois pour toutes, avec la cupidité et l’impudence de cette minorité qui entrave l’évolution et arrête la marche en avant de l’humanité.
C’est un lieu commun de dire, que la classe capitaliste n’est forte que de la faiblesse de la classe ouvrière ; c’est cependant la vérité la plus simple.
Par la vitesse acquise, la classe capitaliste se main tient encore, mais elle chancelle sur ses bases. Une poussée et le château féodal s’écroule. Sa vie est subordonnée à la volonté et au courage des opprimés. De l’énergie des exploités et des opprimés dépend tout l’avenir des exploiteurs et des oppresseurs.
La faiblesse de la classe capitaliste est que son unité n’est qu’apparente, et qu’en réalité elle est divisée. La classe ouvrière peut, elle, trouver son unité, car ses intérêts sont « uniques ».
Il est difficile de tracer une ligne de démarcation entre les diverses catégories de la classe capitaliste, il est cependant évident que l’esprit qui anime le petit commerçant est différent de celui du gros industriel et que, si leurs intérêts de classe sont solidaires, leurs intérêts individuels sont en concurrence.
À mesure que le Capital se centralise, il se crée une lutte intérieure dans la classe capitaliste, et cela nuit à la bonne harmonie indispensable à sa vie ; nous sentons déjà qu’elle est menacée en raison des divergences et des intérêts contraires qui se heurtent.
De même que tout ce qui est né doit mourir, la classe capitaliste doit disparaître. Elle a vécu plus qu’elle ne vivra. Elle se désagrège petit à petit, mais cherche à se raccrocher au radeau, comme un malheureux perdu dans l’océan. Elle ne peut cependant échapper au tourbillon qui l’engloutira.
Le capitalisme a parcouru sa route à pas de géant, il a gravi la montagne, mais il n’échappe à personne que sa maison est bâtie sur des neiges et que sa philosophie est basée sur une erreur. Or, l’humanité veut et cherche la vérité. Aveugle parfois, elle s’égare ; elle tâtonne comme un enfant qui hésite à faire son premier pas ; mais une fois qu’elle a conquis l’assurance, que la lumière éblouissante est venue l’éclairer, alors elle retrouve une énergie indomptable ; elle pénètre partout pour y écraser le mensonge, arrache le masque de tous les fantoches, de tous les pantins et termine la comédie qui a duré parfois des siècles.
La classe capitaliste moribonde se défend contre l’ouragan. Elle élève des digues puissantes pour échapper à la tempête ; elle torture son cerveau pour inventer les monstres géants, mécaniques et scientifiques qui lui permettront de retarder l’échéance fatale. Tout lui échappera cependant, car la vérité est en marche et la vérité doit vaincre l’erreur.
― J. CHAZOFF
CAPITULATION
n. f.
En langage militaire : action d’abandonner une place forte, une armée, entre les mains de l’ennemi. « La Capitulation de Sedan. »
Au sens bourgeois et patriotique, la capitulation entraîne toujours le déshonneur de celui qui la décide. En vertu des lois militaires ― plus ridicules encore que les lois civiles ― une armée doit se faire hacher jusqu’au dernier homme, plutôt que de se rendre, quelles que soient les forces supérieures qui lui sont opposées. Déposer les armes et capituler est une « lâcheté », Bien des généraux et des chefs d’État s’en sont cependant rendus coupables : La Capitulation de Bazaine, la Capitulation de Napoléon III et, plus récemment encore, durant la guerre russo japonaise, la Capitulation des généraux russes, à Port Arthur.
Il n’y a pas, hélas, que des capitulations militaires. Il y a aussi les capitulations d’ordre moral. Combien y a-t-il de gens dont la loyauté ne peut être mise à l’épreuve sans qu’ils capitulent pour satisfaire leurs appétits et leur soif de jouissance ?
Le monde politique nous offre un terrain propice à la recherche de ces éléments. Les parlements fourmillent de tristes individus qui capitulèrent pour obtenir une place, un poste, une charge, et ces hommes trouvent toujours des excuses pour légitimer leur capitulation.
Si la capitulation militaire peut parfois arracher à la mort certaine sur les champs de bataille des milliers de pauvres bougres déguisés en soldats, la capitulation de conscience est un acte indélicat et immoral, profitable uniquement à celui qui le commet, et il faut mettre celui qui s’y abaisse au ban de l’humanité.
CAPTATION
n. f.
Action qui consiste à subordonner la volonté d’autrui dans le but d’obtenir des avantages.
Captation d’héritages ; captation de suffrages.
La Captation est donc un acte malhonnête au sens propre du mot, dont sont victimes plus particulièrement les êtres faibles. Elle ne tombe pas sous le coup de la loi. L’ancienne législature française avait bien introduit dans son droit, un article qui annulait tous les avantages, profits ou privilèges acquis par suggestion, flatterie, artifice, subordination, CAPTATION, mais la jurisprudence actuelle n’est pas armée pour réprimer les captateurs, et cela se comprend.
La Captation étend ses ravages dans tous les domaines : le commerce, l’industrie, la finance, la religion, la politique ne peuvent se perpétuer qu’avec l’aide de l’abus de confiance, qu’une poignée de jouisseurs exercent sur la grande majorité des hommes. Par le verbe enjôleur et mielleux, la religion capta la confiance de millions de pauvres hères ; par le mensonge et les promesses le candidat capte les suffrages des candidats naïfs. L’appât du gain, le désir d’augmenter indéfiniment ses bénéfices fait du commerçant ou de l’industriel, un captateur qui trompe l’acheteur sur la valeur réelle de la marchandise vendue, et du financier un escroc qui induit en erreur le malheureux qui lui confie ses économies.
En notre siècle de ploutocratie, d’amoralité, la captation est considérée comme un acte normal de la vie courante, puisque les sociétés modernes sont construites sur le mensonge. Elle ne peut, par conséquent, être frappée par les lois.
Étant un des effets dont le capitalisme et l’autorité sont les causes, la captation ne prendra fin que lorsqu’aura vécu la société bourgeoise.
CAPTIEUX
adj.
Se dit des individus ou des idées qui, sous une apparence de vérité ou de sincérité, se signalent complètement faux à l’analyse.
Un discours captieux ; des raisonnements captieux. En mathématique, une démonstration par « l’absurde » : une démonstration captieuse.
Les captieux sont nombreux, et de même que les captateurs, ils agissent ordinairement en vue de buts intéressés. Que de discours vides de sens ; que de mots creux et sonores sont employés par les captieux pour convaincre un auditoire qui se laisse griser par les belles paroles, sans vouloir pénétrer le fond des idées bellement exprimées !
Il faut éviter les captieux, conscients ou inconscients ; car ils sont un danger social, et ne jamais s’arrêter à la présentation ou à l’enveloppe d’une idée, mais rechercher ce qu’elle contient.
CARACTÈRE
s. m. (du grec Kharassein : graver)
Empreinte, marque, figure tracée sur une surface quelconque avec un burin, une plume, ou de quelque autre manière, et à laquelle on attribue une certaine signification. Se dit particulièrement des lettres et autres figures dont on se sert dans l’écriture ou dans l’impression. Titre, dignité, qualité, puissance, attachées à certains états. Être revêtu du caractère d’ambassadeur. Son caractère sacré. Dans les sciences naturelles, ce mot désigne certaines marques essentielles qui servent à distinguer un animal, une plante, une substance, de toute autre, ce qui individualise un être, fait qu’il a quelque chose bien à lui, distinct des autres êtres ; ce qui est sa personnalité. Le caractère des individus, est un produit de l’hérédité, du milieu et de l’éducation ; c’est dire que le caractère subit des évolutions et peut être amélioré par une bonne éducation.
CARDINAL
n. m.
Dans l’église catholique, le plus haut dignitaire après le pape. Le cardinal ne fut pas de tous temps le personnage influent qu’il est aujourd’hui ; à l’origine était ainsi dénommé le prêtre chargé de l’aumônerie de l’église ; et, bien que supérieur au curé ordinaire de la paroisse, dans l’ordre hiérarchisé, son influence était pour ainsi dire nulle.
À cette époque, c’étaient les membres de l’épiscopat, nommés par le peuple du diocèse qui étaient chargés de veiller à l’application des saintes doctrines de l’église chrétienne. Ils avaient le titre d’évêques et étaient les plus hauts dignitaires de l’église, tout en n’ayant pas la puissance qu’ils surent acquérir par la suite.
À mesure que la papauté étendit sur le monde son ascendance, les cardinaux de Rome qui étaient en contact direct avec le saint Père et étaient chargés de l’assister dans la célébration du Saint Office, surent acquérir certains privilèges qui leur donnèrent une certaine prédominance sur le reste du clergé. Ce ne fut pourtant que lorsque la papauté devint toute puissante que, s’élevant avec elle, les cardinaux prirent et conservèrent la première place dans la hiérarchie ecclésiastique.
Lorsque, arrivée à son apogée, la Papauté fut considérée non pas seulement comme une puissance spirituelle, mais encore temporelle, par presque tous les grands États d’Europe, les cardinaux furent chargés de représenter le chef de l’église auprès des monarques étrangers et on commença à les qualifier « princes de l’Église ». Leur activité prit de l’extension et, loin le s’adonner spécifiquement aux devoirs de leurs charges spirituelles, ils pénétrèrent dans la politique, et on les vit à la tête des gouvernements où ils cumulèrent les hautes fonctions civiles et religieuses : Richelieu, Mazarin, Alberoni, furent ministres et cardinaux.
Antérieurement, le pape était nommé par le clergé et par le peuple, mais depuis le Concile de Latran (1179) seuls les cardinaux ont le droit de participer à cette élection ; leur pouvoir est très étendu et, au cas de division d’opinion sur le dogme ou la discipline religieuse, seuls ils ont la faculté de convoquer l’assemblée des évêques pour trancher les différends inhérents à l’Église.
De nos jours, les progrès de la science et de la philosophie ont évidemment diminué l’influence des princes de l’Église. Cependant, il est peu de pays au monde qui ne conservent des relations diplomatiques avec le Saint Siège, et comme au temps jadis, les cardinaux font office de ministres du pape auprès des Pouvoirs civils. Les cardinaux sont nommés par le pape qui doit, auparavant, prendre l’avis du sacré collège (assemblée des cardinaux).
Il est d’usage que la barrette, bonnet que le pape envoie aux cardinaux après leur nomination, leur soit remise par le chef de l’État intéressé ; et même en France, le président de la République ― parfois de religion opposée ou farouche anticlérical ― ne se refuse pas à cette grotesque cérémonie. C’est dire que malgré les coups qui lui furent portés par la raison, l’Église est une force avec laquelle il faut encore compter et ses princes des suppôts de l’État bourgeois.
CARÊME
n. m. (du latin : quadragesima. Quarantième)
Le Carême consiste en quarante jours de jeûne ou d’abstinence, prescrit par l’église catholique, avant les fêtes de Pâques. On ignore son origine, mais certains théologiens le font remonter au temps des apôtres. Ce ne fut qu’au Concile de Nicée, en l’an 325, qu’il reçut le sceau légal de l’Église. Durant ces quarante jours, il est interdit de manger d’autre chair que celle du poisson, à laquelle on peut ajouter des œufs, des fruits et des légumes. En vérité, de nos jours, le carême n’est plus observé que par de vieilles bigotes, et encore pas toujours, car il est des accommodements avec le ciel, et l’Église ne refuse jamais, moyennant finance, d’accorder des dispenses aux fidèles qui en demandent.
En un temps, le carême eut sans doute une certaine utilité et répondait à une nécessité sociale. À l’époque où l’ignorance régnait en maîtresse sur le monde, il est possible que le législateur religieux ait prescrit le jeûne et l’abstinence, pour réfréner les bas instincts de l’homme, en imposant un peu d’hygiène et de décence publique. Durant le carême, il n’était pas seulement interdit de manger certains mets, mais il fallait se priver également, selon les lois de l’église, de tout amusement, sortie, récréation, et s’abstenir de tout contact charnel. De cette dernière mesure subsiste encore l’interdiction de se marier durant le carême.
Des prescriptions similaires se retrouvent dans toutes les religions. Les Juifs doivent également jeûner plusieurs jours par an ; les Mahométans ont le « ramadam », et les Bouddhistes exercent les mêmes pratiques. Il semble donc bien que le carême n’est pas d’essence spécifiquement chrétienne, mais qu’il fut institué bien avant le Christianisme et avait pour but d’élever le moral de l’espèce humaine.
En vertu de vieilles coutumes, entretenues par certains intérêts commerciaux, on continue dans certains pays à ne pas manger de viande le Vendredi Saint, précédent le dimanche des Pâques. En dehors de ce jour, le carême religieux a vécu. Mais il est des malheureux que leur situation oblige à faire carême d’un bout de l’année à l’autre. Le travailleur est contraint par la société de s’abstenir de manger à sa faim, cependant que les magasins regorgent de vivres, de vêtements, de nourriture. Si le carême religieux a disparu, le carême social subsiste, et il faut le détruire comme le premier. Ce sera l’œuvre des Anarchistes.
CARENCE
n. f.
Faire défaut. Manquement. « Dresser un procès de carence », c’est-à-dire dresser un acte qui constate qu’à un lieu donné, l’officier public n’a pas trouvé ce qu’il attendait : meubles, argent, etc... Le terme est également usité dans le langage social et politique. Il signifie : se dérober à une discussion, à une controverse, à un débat ; ou encore l’incapacité où l’on se trouve, pour combattre les arguments opposés par un adversaire. La carence des politiciens est légendaire. Ils évitent toujours de se mesurer sur un terrain solide et logique ; ils aiment mieux faire défaut, que de subir un échec qui nuirait à leur renommée.
La carence d’une personne sur laquelle on comptait pour accomplir une action, ce qui revient à dire le manquement de cette personne à tenir ses engagements ou ses promesses.
CARICATURE
n. f. (de l’italien : caricare, charger)
Reproduction grotesque, exagérée des traits et des manières d’une personne, dans le but, généralement, de la ridiculiser en faisant ressortir les défauts de sa tournure ou de ses manières. La caricature n’est pas à la portée de tous ; c’est un art subtil et fin qui nécessite, non pas seulement du talent, mais du génie. Il faut au caricaturiste de l’intelligence, de l’esprit, de la psychologie et de l’observation, pour que son crayon puisse reproduire sur le papier, souvent en quelques traits, les tares et les vices d’un individu. La caricature est dangereuse, car le ridicule tue ; de même que le pamphlet elle est une arme redoutable. Elle s’inspire surtout de politique et, de nos jours, il n’est pas un organe de presse qui n’ait recours à elle pour provoquer la risée et la moquerie contre un adversaire que l’on veut abattre. C’est donc une arme à double tranchant. Si par son mordant, sa finesse, son ironie, elle flagelle et dénonce les faiblesses et les infirmités morales de certains, en se faisant l’auxiliaire de la bourgeoisie elle accomplit souvent une besogne peu louable. Il reste pourtant certains caricaturistes, véritables artistes qui surent et qui savent conserver leur indépendance, et se refusent à prostituer leur crayon. Il faut citer parmi les plus célèbres caricaturistes : Daumier, Gavarni, Cham, Caran d’Ache, qui ont produit de véritables chefs-d’œuvres.
CARMAGNOLE
(La) n. f.
Sorte de vêtement qui fut très à la mode pendant la Révolution française et qui était porté surtout par les Jacobins. La Carmagnole est plus connue à présent par la chanson à laquelle elle a donné son nom et qui fut composée en 1792 après l’arrestation de Louis XVI. L’auteur est resté inconnu. Le refrain de même que les couplets ne sont ignorés de personne, il est donc inutile de les citer.
La Carmagnole marque une époque de la Grande Révolution française. Abandonnant les partisans de la Monarchie absolue, en 1789, le peuple, assoiffé de liberté, réclamait une Constitution, mais la trahison de Louis XVI, sa fuite et son arrestation allaient ouvrir les yeux de la populace. La Constitution ne lui parut pas suffisante ; c’est la République qu’il voulait. Et la « République », dans son lointain, semblait belle à ceux qui demandaient « du fer, du plomb, et puis du pain », « pour travailler, pour se venger et pour vivre ».
C’est au chant de la Carmagnole que l’on se battait pour sauver la République en danger. Elle était un hymne de guerre contre les tyrans, mais elle était aussi un hymne joyeux, et on l’entendait dans les bals, les théâtres, les fêtes et les places publiques. C’était l’époque héroïque de la République triomphante.
Hélas ! Ce ne fut qu’un rêve. Le peuple, trop jeune encore, ne sut pas enfoncer son couteau jusqu’au fond de la plaie sociale. Bonaparte apparut, général d’abord, Premier Consul ensuite. Fatigué, le peuple laissa s’implanter la dictature. La lutte pour la Liberté prit fin. Le chant de la Carmagnole sonnait mal aux oreilles du futur empereur. Il la fit rayer du répertoire. Le peuple accepta, et avec la Carmagnole disparurent, pour un temps, ses espoirs de libération.
CARNAGE
n. m. (de l’italien : carnaggio)
Massacre, tuerie, assassinat collectif. Les carnages ont coûté la vie à des millions et des millions d’individus. Il n’est pas besoin de rechercher bien loin et de remonter bien haut ; la guerre de 1914–1918 nous offre le spectacle du plus grandiose et du plus horrible des carnages. Quelles que soient les causes qui le déterminent, le carnage est toujours une monstruosité, car c’est une orgie de sang qui ne répond à aucune utilité ou nécessité sociale. D’autre part, ce sont toujours les mêmes qui en sont victimes. Le peuple est une proie facile et inconsciente. S’il acceptait de verser librement la cent millionième partie du sang qu’il a donné involontairement, au plus grand bénéfice de ses bourreaux, les carnages disparaîtraient de notre globe. On peut affirmer que les carnages sont toujours organisés au profit du capitalisme. Que ce soit l’Église qui s’en rende coupable ou complice, comme durant l’Inquisition ou les guerres de religion ; que ce soit un gouvernement, qui, comme sous le régime tsariste, organisait des pogroms où périrent des milliers d’innocents, que ce soit une guerre défensive ou offensive, nationale ou coloniale, le carnage est toujours un désastre pour la classe ouvrière et n’a pour but que la défense des privilèges capitalistes.
On reproche aux révolutionnaires de provoquer des « carnages ». C’est un argument intéressé de la bourgeoisie qui lui permet de faire vibrer la corde sentimentale de certains pacifistes ignorants, et de critiquer les mouvements insurrectionnels.
C’est une malice cousue de fil blanc. Les révolutionnaires sont les adversaires irréductibles de la tuerie, et jamais au cours des Révolutions le sang ne fut versé inutilement et par plaisir ou soif de vengeance. Ce ne sont pas les communards de 71 qui exécutèrent lâchement 40.000 malheureux sans défense. C’est la bourgeoisie, représentée alors par Thiers, qui porte à son passif cet ignoble carnage.
Les révolutionnaires veulent la paix. Ils ont horreur du carnage et c’est pour le voir disparaître qu’ils veulent élaborer une société harmonieuse où l’intérêt particulier, faisant place à l’intérêt collectif, le carnage n’aura plus de raison d’être et ne troublera plus la quiétude de l’humanité.
CARNIVORE
adj. et n. (du latin : caro, carnis, chair et vorare, dévorer)
Se dit de tous les animaux qui se nourrissent particulièrement de chair ; ceux qui ne mangent que des végétaux sont nommés herbivores.
L’homme, le chien, et presque tous les animaux domestiques sont omnivores ; c’est-à-dire qu’ils se nourrissent de chair et de végétaux. Le lion, le tigre, sont des carnassiers (synonyme de carnivore). Les carnivores et les omnivores se signalent par leur appareil dentaire qui est différent de celui des animaux ne se nourrissant que de végétaux. II existe une secte, très répandue en Angleterre et en Amérique, qui combat le carnivorisme, et milite pour enrayer la consommation de la viande par l’homme. Ceux qui se réclament de cette doctrine se nomment végétaliens ou végétariens. (Voir les mots : Végétalisme, Végétarisme.)
Nous pensons que, depuis les temps les plus reculés, l’homme fut, par nature, carnivore, et sa mâchoire est belle et bien composée de canines, de molaires, et d’incisives qui lui permettent de déchirer et de mâcher la chair.
CARTEL n. m.
Le Cartel est l’une des formes de concentration de l’industrie moderne. Le Cartel est d’origine allemande. Il suivit de près la formation des trusts américains. Il est légèrement différent de ceux-ci. Tandis que les trusts américains ont pour but de grouper les firmes de même industrie ou les exploitants de matière première de même nature pour la défense des intérêts mis en commun, les Cartels, selon la forme allemande, n’associent les fabricants que pour la vente par les soins d’un syndicat chargé d’établir les prix, de rechercher et de servir les clients, d’opérer la répartition des commandes entre les firmes syndiquées, tour en laissant autonomes les fabricants participants au Cartel.
Ces Cartels sont connus sous le nom de concentration en largeur.
Depuis la fin de la guerre, quoi qu’elle fût depuis longtemps en gestation dans l’esprit d’Hugo Stinnes, une nouvelle forme de Cartel a été réalisée. Il s’agit de la concentration en hauteur ou en profondeur.
Ce Cartel a pour but de réunir en une seule main toutes les industries qui concourent à l’exécution d’un même produit final, depuis les matières premières initiales : combustible, minerai, bois, etc., jusqu’à l’objet utilisable par le consommateur : locomotive, lampe électrique, machine agricole, etc...
Et comme, en général, il vient s’y ajouter encore la participation disciplinée de fournisseurs d’éléments divers entrant dans les transformations successives de la matière, on peut dire que cette forme (le Cartel est une concentration industrielle à trois dimensions. Ces Cartels perfectionnés sont appelés, en Allemagne, Konzerns.
Les premiers trusts furent ceux de l’acier et du pétrole constitués respectivement par Morgan et Rockefeller. Ils prirent naissance en Amérique en 1896 et 1907. Nous y reviendrons lorsque nous étudierons ce mot.
Les Cartels allemands datent de 1898–1900. Ceux de l’acier, du fer, du minerai, des constructions navales turent les premiers qui se constituèrent. Augustin Thyssen en fut l’initiateur. Stinnes fut d’ailleurs son élève et collaborateur. Thyssenet Krupp étaient les maîtres de l’acier et du fer et de toutes les fabrications qui découlaient de l’emploi de ces matières. Ballin, le grand maître des constructions navales, le Président du Conseil d’administration de la “Hambourg America“ s’était réservé cette branche spéciale.
Bien entendu, ces Cartels dépassent, en général, le cadre national et donnent naissance à des groupements internationaux plus connus sous le nom de : Consortiums.
Le Cartel de l’acier et du fer d’Allemagne avait, par exemple, comme associé, en France : Schneider ; en Belgique :Cockerill ; en Angleterre : Armstrong.
Ensemble, ils exploitaient les mines de l’Ouenza, en Algérie, et nombre d’autres gisements de minerai.
Ce n’est que plus tard que le Cartel prit naissance en France, vers 1911.
Le premier Cartel, plutôt moral que matériel, fut constitué par les grands réseaux de chemin de fer, sous le nom de “Comité de Ceinture”. Puis le Comité des Houillères, le Comité des Forges, celui des Armateurs, le Consortium de l’Industrie textile, suivirent de près dans le domaine matériel. Aujourd’hui, toutes les industries et principalement les plus récentes : celles du cycle, de l’automobile, de l’aviation, de l’électricité (force et produit) sont, elles aussi, cartellisées.
Le Cartel est devenu une force industrielle qui exerce une telle influence sur les marchés nationaux et mondiaux, qu’il est impossible aux industriels de s’y soustraire. S’ils persistent à rester isolés, ils sont complètement écrasés et ruinés.
II y a aussi dans tous les pays le Cartel des Banques (grandes, moyennes et petites), celui des journaux, ceux du blé, de la meunerie, des transports fluviaux, etc...
On peut dire que les Cartels, Trusts et Consortiums, avec leurs formes diverses de concentration, se partagent, chacun dans leur sphère, l’hégémonie économique, dirigent les États, font l’opinion, disposent de l’ensemble de la production.
Le Cartel est né le jour où les firmes importantes ont compris tout le danger que présentait pour eux le jeu de la concurrence. Aussi, au lieu de se combattre, les rivaux décidèrent de s’unir pour lutter en commun et conquérir ensemble les marchés.
Une coalition de cet ordre fut rapidement victorieuse de ses concurrents directs qui n’eurent plus, pour échapper à la ruine, qu’à s’entendre avec leurs con-currents de la veille pour la fixation des prix communs.
Bien entendu, ces ententes qui allèrent sans cesse en s’élargissant, ne se bornèrent bientôt plus aux produits manufacturés. Il était normal de les étendre aux matières premières elles-mêmes. Ce fut vite fait.
De cette façon, les industries de base et de transformation se trouvèrent à tous les échelons cartellisées.
Ceux qui étaient à la tête pouvaient à loisir fixer le prix des matières premières ou des objets fabriqués, puisqu’ils disposaient, en fait, de l’ensemble de la matière ou du produit.
Les petites quantités qui échappaient à leur contrôle ne pouvaient en rien “fausser“, les prix établis par le Cartel, que ce soit pour l’achat de la matière ou la vente du produit.
Nous vivons en fait sous la dépendance de ces organismes tentaculaires et rien au monde, dans quelque domaine que ce soit, n’échappe à leur direction, leur contrôle. Ce sont, dans tous les domaines, les vrais maîtres des pays.
Par le Cartel des industries ou du négoce, les dirigeants de ceux-ci font, quand ils le veulent, la hausse ou la baisse de tel ou tel produit. Ils stockent pour revendre en masse à un moment choisi par eux ou laissent perdre parfois d’énormes quantités de produits de toutes sortes pour provoquer des paniques au cours desquelles ils réaliseront des gains scandaleux. Et, bien entendu, ceci se passe sur le plan international aussi bien que sur le plan national. Ces Cartels ont leurs marchés spéciaux, pour chaque catégorie de matières ou de produits. C’est là, sur ces places, qu’ils fixent les cours pour les importations. Rotterdam, Le Havre, Bordeaux, Hambourg, Gênes, Anvers, Glasgow, Londres, etc., sont des marchés internationaux de ce genre. Les cours nationaux ainsi fixés d’après une échelle internationale, les cours locaux ou régionaux sont fixés par les Bourses de Commerce, principaux auxiliaires des Cartels, Trusts, etc...
Tout cet ensemble est manœuvré par le Cartel des Banques qui le dirige de haut et l’administre en fait. Les campagnes de presse appropriées sont également dirigées par les Banques qui contrôlent les grands journaux et forment l’opinion, la trompent ou l’aiguillent. dans le sens désiré par les maîtres de l’économie nationale et mondiale pour la réussite de leurs machiavéliques combinaisons.
Le public, qui ne comprend rien à toutes ces affaires ténébreuses, est proprement écorché. Il crie, gesticule, tempête, mais paie. C’est d’ailleurs tout ce que lui demandent les industriels et les négociants et les banquiers.
Il n’est pas une richesse au monde qui ne soit de nature, pour son exploitation, à donner lieu à la constitution d’un Cartel où se réunissent exploitants, fabricants et financiers.
Bien que ces Cartels ou formations similaires aient trouvé le moyen de mettre l’univers entier en coupe réglée, ils ne sont pas arrivés à établir entre eux l’harmonie, Souvent, pour ne pas dire toujours, des groupes rivaux se créent pour se disputer la possession de la matière ou la vente du produit. C’est la nouvelle forme de la concurrence. Le public n’en bénéficie d’ailleurs que fort peu de temps. Lorsque les adversaires s’aperçoivent que cette concurrence devient désastreuse pour eux, et surtout s’ils sont d’égale force, ils ont tôt fait de conclure des ententes ou de s’allier définitivement en fondant un cartel plus large.
Et, de proche en proche, le nombre des concurrents diminue jusqu’à ce que tous les exploitants industriels ou négociants fassent partie d’un même groupement qui exercera son hégémonie sur une région, un pays, plusieurs pays, l’univers.
Il en est ainsi pour toutes les grandes branches de l’industrie ou du commerce : Pétrole, Houille, Minerai, Fer, Coton, Coke, etc., etc...
Hugo Stinnes, mort en 1925, alla plus loin.
En se rendant maître du charbon, du minerai, du fer, des ateliers de construction, des banques, des transports par eau, des chantiers maritimes, des navires, en y ajoutant la possession des chemin de fer, il mit debout un appareil d’une formidable puissance économique à laquelle s’ajoutait une égale puissance politique par la possession de la presse.
Il avait ainsi réalisé le maximum de puissance, d’harmonie et d’économie et de perfectionnement dans la production par une concordance d’efforts variés dirigés par un seul cerveau, le sien. Par cette combinaison, il se débarrassa de son concurrent : Walter Rathenau. Il supprimait ainsi les concurrences entre fabricants, les heurts, les conflits entre exploitants, le stockage superflu en instituant l’émulation entre tous les exécu-tants, la fabrication en grande série, la standardisation poussée au maximum, la vente développée des produits jugés les plus avantageux.
En même temps, les recherches scientifiques et techniques étaient poussées avec méthode, avec des moyens extrêmement puissants qui ouvraient chaque jour des voies nouvelles au progrès des fabrications.
Une telle organisation est un véritable État dans l’État. Elle le domine réellement.
Le Konzern Stinnes a subi une si forte crise, après la mort de son fondateur, qu’on ne sait encore s’il la surmontera. Il a contre lui les grandes banques indépendantes qui veulent s’affranchir d’une tutelle qu’ils estiment insupportable. Par contre, la Reichsbank et l’État prussien cherchent à éviter le krach, dont l’importance prévue dépasse 1 milliard et demi de francs. Cette situation est due à une grosse erreur d’appréciation commise par les fils Stinnes qui ne surent pas distinguer entre l’inflation et la stabilisation et ne se débarrassèrent pas à temps des valeurs dites de combat ou de réalisation pour ne conserver que les valeurs actives du Konzern, aujourd’hui menacé dans ses bases. En tous cas, qu’il se liquide ou qu’il vive, le Konzern de Stinnes aura marqué dans l’histoire du capitalisme. Son expérience servira aux grands manieurs d’hommes et de capitaux. Les Konzerns vont se généraliser et s’internationaliser. Ce semble devoir être la forme dernière de la concentration industrielle et capitaliste. C’est contre ces formidables appareils que le prolétariat aura, en définitive, à lutter pour assurer la suprématie du travail.
En dehors de leur activité économique de premier plan, les Cartels ont aussi — et c’est forcé — une activité sociale considérable qu’il convient d’examiner.
* * *
Les Cartels sont doués d’une formidable vitalité. Ils dépensent une énergie considérable pour maintenir socialement leur suprématie.
En dehors des guerres qu’ils provoquent pour acquérir soit des débouchés, soit des champs d’exploitation plus vastes, dont nous avons déjà exposé le caractère en traitant du Brigandage , les Cartels ont organisé un appareil de combat social extrêmement souple et puissant opérant à l’échelle internationale. Son siège est actuellement à Berlin. Non seulement cet organisme fixe les prix d’achat et de vente des matières et produits, contingente les marchandises, série les efforts en vue de les faire porter sur tel ou tel point du globe, mais encore il détermine la valeur des salaires, organise l’émigration et l’immigration, jette ici une quantité de bras énorme pour provoquer une grève dont l’importance varie de la localité à la région ou la nation, provoque là le chômage et pousse à la surproduction ou au malthusianisme suivant le cas et ses intérêts.
Il n’est pas un conflit social qui ne soit provoqué par cet appareil de direction capitaliste, que ce soit grève ou lock-out.
Généralement, le Cartel opère par industrie et par région. Lorsqu’il veut, par exemple, provoquer un conflit dans le Nord, abaisser les salaires, il réduit le prix de série du travail aux pièces imposé presque partout. Il arrive un moment où les ouvriers ne peuvent plus atteindre le salaire normal. Si un mouvement a lieu, le patronat, qui a constitué un stock peut attendre 25 jours, 3 semaines, davantage si c’est nécessaire. Il vit sur ce stock ou bien même fait exécuter dans une autre région les commandes qu’il reçoit.
Il fatigue et vainc ainsi, tour à tour, toutes let régions, toutes les industries. Il réussit d’autant plus facilement que les ouvriers ignorent généralement la composition du Cartel, ne savent pas qu’ils contribuent à l’échec de leurs camarades en effectuant leur travail, qu’ils luttent contre leurs frères des autres régions.
L’insuffisance actuelle de l’organisation du mouvement mondial ne permet pas aux ouvriers de lutter contre leurs adversaires à armes égales.
Non seulement, les industriels agissent ainsi sur le terrain national, mais cette entente se poursuit et se développe sur le plan international. Si le Cartel a décidé d’englober tout un pays dans un mouvement de lock-out ou de grève, il a soin, en dehors des stocks nationaux préalablement constitués, de mettre à la disposition des industries du pays visé des stocks étrangers qui alimentent la clientèle.
Les mineurs, en particulier, sont souvent victimes de cette tactique et le textile, la laine, la métallurgie, en ont eux aussi, fait très souvent la triste et décevante expérience.
Il en sera ainsi tant que la classe ouvrière n’aura pas modifié la structure de son organisme de lutte, tant qu’elle n’aura pas adapté ses organes par l’instauration du contrôle ouvrier syndical, tant que ses Fédérations d’industrie seront dans l’incapacité de connaître les composants des Cartels et d’opposer force à force.
Lorsque nous examinerons le Contrôle ouvrier, nous exposerons le caractère, le fonctionnement et le but de tous ces organes qui manquent au syndicalisme et sont devenus nécessaires pour lui permettre de résister d’abord et de vaincre ensuite son adversaire.
Au Cartel industriel des Patrons, il faut opposer le Cartel des Ouvriers par industrie et sous industrie, utilisant des formations de lutte analogues, se mouvant avec une force et une aisance égales. C’est toute une organisation nouvelle qui s’impose, non plus sur le plan du métier, de la profession, mais sur celui de l’industrie.
L’idéal serait de former des syndicats qui auraient sur notre plan le même caractère que le Konzern Stinnes, un syndicat qui grouperait les extracteurs, les transformateurs, les transporteurs, les vendeurs d’un même produit fini.
C’est dans cette voie que les ouvriers doivent diriger leurs efforts. Ce n’est qu’en opérant ainsi qu’ils possèderont quelques chances de rétablir un équilibre que leur incompréhension, leur évolution trop lente, voire même leur conservatisme, ont singulièrement compromis.
Pierre Besnard.
CASERNE
(zer-ne) n. f. (du lat. : quaterna, logement pour quatre)
Tout a été dit ou presque sur la caserne. Depuis plus de trente ans, de nombreux articles, de multiples brochures, voire même de gros livres ont été publiés sur ce sujet qui menace d’être toujours d’actualité.
Nous ne saurions, comme le Larousse, nous contenter ici d’une trop courte définition qui ne définirait pas grand chose. Tout le monde sait, en effet, que la caserne est un bâtiment affecté au logement des soldats. On sait également qu’en France, les premières casernes datent
du XVIème siècle et que c’est l’ingénieur militaire et maréchal de France Vauban, qui fit adopter au XVIIème siècle un type uniforme de bâtiments, modifié en 1788, puis à plusieurs reprises de nos jours. À l’origine, la caserne n’était pas destinée à préparer la guerre. Elle servait à protéger les bourgeois contre les déportements des mercenaires, gens de sac et de corde. Elle avait un rôle de prison (murs de clôture, corps de garde). Au XIXème siècle, la caserne sert au repos, entre deux campagnes d’Afrique. Les exercices dans la cour n’ont pour but que de maintenir les soldats en main. On y donne même des leçons de danse, de lecture et d’écriture et l’on joue aussi au loto. Il faut tuer le temps ! ― occupation essentielle ― en attendant de tuer des hommes dans des guerres coloniales. Enfin, la caserne a aussi un autre rôle : occupant les points stratégiques des grandes villes elle constitue le château-fort élevé par le Gouvernement pour mâter l’émeute. Gambetta et de Freycinet avaient songé à supprimer la caserne, parce qu’elle ne prépare nullement les soldats à la guerre. M. de Freycinet a formulé sur la caserne une opinion peu élogieuse : Elle rend l’individu paresseux, menteur et faux, ce qui est l’expression même de la vérité. Et c’est ici qu’il importe de multiplier les citations, citations empruntées à des écrivains, à des sociologues et à des hommes politiques d’opinions et de croyances différentes :
Jules Delafosse a dit de la caserne « qu’elle est un agent de déclassement social et de dépravation universelle, qui disperse la famille, déracine la jeunesse, dépeuple les campagnes, engorge les villes. » Étienne Lamy, l’académicien décédé en 1919, pensait que « le service militaire déprave les mœurs du soldat. » Le comte de Mun, cet autre académicien réactionnaire, mort en 1914, quelques semaines après le déclenchement du massacre européen, disait que « la caserne obligatoire est l’abus poussé jusqu’au despotisme, jusqu’au mépris des droits les plus respectables. » Selon le marquis de Voguë ― encore un académicien ! ― « les fils de nationalistes reviennent du régiment avec la haine de l’état militaire ». Cette appréciation est juste sous cette réserve que si les fils de nationalistes ont la haine du métier militaire ― parce qu’ils peuvent, dans une certaine mesure, en souffrir ― ils regardent d’un assez bon œil les fils de prolétaires partir pour l’armée. D’aucuns, même, très « patriotes » estiment que la durée du service militaire n’est pas assez longue ! La définition de la caserne qui me semble la meilleure est celle d’Urbain Gohier. De son livre célèbre : L’Armée contre la Nation qui renferme des pages vengeresses contre l’institution si chère au cœur de nos patriotes, j’extrais le passage suivant relatif à la caserne :
« Elle est seulement l’École de tous les rires crapuleux : de la fainéantise, du mensonge, de la délation, de l’impudeur, de la débauche sale, de la lâcheté morale et de l’ivrognerie. Depuis que l’Europe entière subit le fléau du militarisme, l’espèce humaine y a descendu de plusieurs degrés. La vitalité surprenante et les progrès en tous genres de la race anglo-saxonne dont on cherche des explications plus ou moins ingénieuses, proviennent assurément de ce qu’elle échappe à l’action corruptrice et dégradante de la caserne.
L’alcoolisme universel qui gangrène la race française ne remonte pas si haut ; il est un produit de la caserne. La multiplication infinie des débits et des brasseries, où la nation entière, sans distinction de situations sociales, s’empoisonne maintenant, coïncide avec l’encasernement de la jeunesse. Au régiment, boire est le seul divertissement ; boire davantage est l’objet de toute émulation ; payer à boire est la source de toute considération. À ce régime, un peuple jadis réputé pour sa sobriété a contracté la maladie de Coupeau. Il faut, aux Français, des débits de boissons, même en chemin de fer ; ils vont de Paris à Versailles en buvant. La caserne pourrit la France d’alcoolisme et de syphilis. Et qui donc l’impose au peuple ? CEUX QUI N’Y VONT GUÈRE ET CEUX QUI N’Y VONT POINT. »
La belle page qu’on vient de lire n’exprime-t-elle pas, en peu de mots, tout ce qu’on peut dire, tout ce qu’il faut dire sur la caserne ?
Il est étonnant de nos jours, ― à une époque où, pourtant, l’antimilitarisme a fait des progrès, ― de constater le prestige qu’exerce encore, aux yeux des Jeunes, la caserne. Être pris au conseil de révision, constitue pour le conscrit, un titre de gloire ! Quant aux ajournés et aux réformés, ils sont l’objet, bien souvent, des plus stupides moqueries et du plus violent mépris, de la part des camarades déclarés « bons pour le service ». Regardez passer ces jeunes gens, au sortit du conseil de révision. Ils paraissent heureux de leur sort. Arborant cocardes et rubans, ils parcourent rues et boulevards en braillant des inepties. Avant que la journée ne se termine, ils sont ivres !
Je n’ai jamais pu comprendre l’exubérance de ces petits malheureux, à l’annonce qu’ils étaient reconnus aptes au service militaire et le spectacle de ces bandes chamarrées de décorations de pacotille aux multiples couleurs m’a toujours profondément attristé. Je me souviendrai toute ma vie du 12 avril 1915. J’avais, à cette époque, un peu plus de dix-neuf ans et je n’étonnerai personne en affirmant que, bien longtemps avant mon incorporation, mon dégoût pour tout ce qui touchait au militarisme était profond. Jeune encore, j’appréhendais l’instant où il me faudrait tout quitter : mère, famille, amis, maîtresse, pour rejoindre la quelconque caserne d’une ville perdue, dans laquelle, bon gré mal gré, je serais contraint de résider. Donc, le 12 avril 1915, mon baluchon sous le bras, nanti de quelques provisions dues à la prévoyance maternelle, je m’acheminai, à pas lents, vers la Gare Montparnasse, où devait avoir lieu l’embarquement.
J’aurais bien voulu retarder le moment fatal ! Il était neuf heures du matin. Déjà, aux abords de cette gare, une agitation inaccoutumée et sans cesse grandissante emplissait les rues, les avenues et les boulevards avoisinants. Je n’étais, hélas ! pas le seul à partir ! Nombre de jeunes gens de ma classe ― la classe 16 ― qu’une feuille d’appel avait désignés pour rejoindre les garnisons de la région Ouest menaient, aux abords de cette maudite gare, un tapage infernal.
J’avais une mine d’enterrement. Et mon allure contrastait avec celle de ces jouvenceaux dont beaucoup, par leur attitude débraillée et leur turbulence inapaisable, faisaient preuve d’une inconscience coupable. Tout autour de la gare, c’était un grouillement de « conscrits » qui gesticulaient, criaient, chantaient, s’interpellaient et même s’injuriaient avec une aisance et un entrain surprenants. La terrasse qui borde la rue du Départ était « noire de bleus » ― si j’ose m’exprimer ainsi ― qu’accompagnaient leurs familles résignées. J’avais peine à concevoir qu’en pleine guerre, alors que depuis huit mois, le sang de leurs pères, de leurs frères, de leurs amis, rougissait les tranchées du front, des jeunes gens de dix-neuf ans fussent assez légers, assez inconscients, assez fous, pour partir avec le sourire, quand l’avenir se montrait sous un jour si sombre et si incertain ! Jeunesse inéduquée, sans doute, mais tout de même ! Cependant, l’heure de quitter ma bonne ville de Paris allait sonner. Je devais rejoindre Laval. Non sans regret et le cœur chargé d’angoisse, je montai, au hasard, dans le premier wagon qui s’offrit. Je n’avais pas le choix : tous étaient bondés. J’aurais bien voulu m’isoler pour réfléchir profondément : impossible. À ma grande déception, dans mon compartiment, une bande d’énergumènes donnaient libre cours à une joie bruyante : la joie d’entrer à la caserne et d’être soldats ! Sur les banquettes, dans les filets, ce n’étaient que victuailles entassées et les nombreux litres de « pinard » et d’alcool qui garnissaient les musettes des voyageurs ne laissaient subsister, dans mon esprit, aucun doute sur la capacité d’absorption de mes compagnons de route. Le train s’était à peine ébranlé que déjà ― sans doute pour ne pas faire mentir Urbain Gohier ― tout ce monde buvait à la régalade ne cessant cet exercice que pour reprendre en chœur des refrains idiots tirés du répertoire de l’époque. Avant Versailles, les cerveaux n’avaient pas la moindre lucidité, tant et si bien qu’entre Versailles et Rambouillet, on eut à enregistrer et déplorer, dans notre train, une série d’accidents. En effet, pendant la marche du convoi, les plus énervés de mes pauvres camarades circulaient sur les marche pieds, escaladaient le toit des wagons, passant de l’un à l’autre, pour « épater » les camarades, se tenant debout sur lesdits toits, pour amuser la galerie. Ce qui devait arriver arriva. Ces équilibristes amateurs perdirent l’équilibre et tombèrent sur la voie ; d’autres se fracassèrent la tête contre le tablier des ponts, nombreux sur la ligne. Entre Coignières et Le Perray, m’étant accoudé à la portière pour admirer le paysage, je comptai, non sans stupeur, plusieurs cadavres de ces imprudents, couchés en bordure de la voie ...
• • •
Je passe sur les détails de notre arrivée à Laval. Le lecteur devine dans quel état arrivèrent à destination les jeunes conscrits de la classe 16.
• • •
Ce 13 avril 1915, vers dix heures du matin, nous franchîmes le seuil de la caserne Schneider, située dans le haut de la ville.
Le temps était maussade. Il avait plu, au cours de la nuit et, dans le ciel d’un gris sale, passaient, très bas et avec rapidité, de gros nuages noirs. Toute l’eau du ciel semblait s’être concentrée dans la cour de la caserne : ça et là, de larges flaques d’eau qu’il fallait prudemment contourner pour éviter un bain glacé et ne pas glisser dans la fange. Mais ce tableau, déjà sinistre, devait s’enrichir d’une teinte plus sombre dans cette cour, circulaient, mélancoliquement, les bras ballant, bourgeron blanc et tête rasée, des êtres qu’on eût pris volontiers pour des forçats.
C’étaient les recrues de Bretagne, arrivées de la veille ou de l’avant-veille à la caserne, appartenant, elles aussi, à la classe 16, comme nous les Parisiens !
Aucune expression dans notre langue pourtant si riche en locutions heureuses et justes ne saurait rendre tout le dégoût qui s’empara de mon être lors de ce premier contact avec le « régiment ». Et cet autre tableau du « réfectoire » lorsqu’une heure après notre arrivée, peut-être, on nous fit « déjeuner ».
Je revois encore cette horrible chambrée du rez-de-chaussée dans laquelle nous prîmes notre premier repas. Je ne suis pourtant pas difficile et j’imagine que vous me croirez sur parole si j’affirme n’avoir jamais festoyé à la table des rois ! Non, je ne suis pas difficile. Sans doute, comme pas mal de mes contemporains, j’aime ce qui est bon, mais je ne suis pas exigeant quant au renom des mets qui me sont présentés. J’aime surtout prendre mes repas dans un cadre sinon riant, du moins propre. Oh ! ce réfectoire ! Quand nous arrivâmes, la table ou plus exactement une planche reposant sur ses deux tréteaux et qui faisait office de table, était d’une saleté repoussante : des débris de pain, des fragments de « patates » cuites, traînaient parmi de gros morceaux de « gras », lesquels nageaient dans du vin qu’on avait renversé et qui inondait la planche. Tous ces débris hétéroclites constituaient les restes du « repas » qu’avaient fait, peu de temps avant notre entrée, les recrues bretonnes. Je n’insiste pas sur le haut-le-cœur que j’eus à ce spectacle. Je n’eus guère d’appétit ce jour-là. Au reste, je n’avais pas faim, j’avais d’autres préoccupations...
• • •
Les mois, lentement, trop lentement, s’écoulèrent. Je ne vous étonnerai pas, cher lecteur, en vous certifiant que je n’ai supporté que bien difficilement le régime de la caserne. Onze ans se sont écoulés depuis, mais j’ai conservé de la cour du quartier, de la chambrée et du champ de manœuvres de trop douloureux souvenirs qui, je puis l’affirmer, ne s’effaceront jamais. Durant tout mon séjour à la caserne, j’ai souffert moralement bien plus que matériellement.
La vue seule de la caserne provoque chez l’être libre, jaloux de sa liberté, et conscient des idées d’émancipation qu’il défend, un profond sentiment de tristesse et de dégoût ; la vue seule de ces bâtiments uniformes et froids lui serre le cœur ; c’est là, désormais, qu’il lui faudra vivre, c’est dans une de ces chambrées ignobles dont les fenêtres s’ouvrent sur la triste cour du « quartier » qu’il devra passer ses nuits !
• • •
Que le lecteur me permette encore quelques souvenirs personnels qui illustreront mieux cet exposé. Incorporés en avril 1915, les « bleus » de la classe 16 séjournèrent à la caserne jusqu’en novembre de la même année, avant leur envoi dans des centres d’instruction, situés dans la zone des armées. C’est ainsi que nous passâmes, mes camarades et moi, tout l’été et presque tout l’automne à Laval, dans cette maudite caserne Schneider. Le matin, vers cinq heures, le clairon sonnait le réveil. Maudit clairon, combien de fois ai-je entendu sa voix aiguë et désagréable qui m’arrachait aux douces illusions du rêve ! Affreux clairon détesté, que de fois m’a-t-il fait reprendre contact avec la dure réalité ! Le « réveil », à la caserne, fut toujours pour moi un supplice. Ne marquait-il pas, en effet, le début d’une journée semblable aux précédentes, une journée comme les autres qu’il faudrait subir, bon gré mal gré ? Et après ce séjour odieux de la caserne, ce serait l’Inconnu, c’est-à-dire la guerre et peut-être la mort ! Douce perspective ! Le « réveil » m’était pénible pour une autre raison, et mes camarades de chambrée fournissaient, eux aussi, des éléments à mon dégoût. Rien n’est plus écœurant qu’un « réveil » à la caserne. Imaginez cette horrible salle, nue et maussade, qu’est la chambrée, dans laquelle sont alignés une vingtaine de lits, dix de chaque côté environ, mes souvenirs, quant au nombre, ne sont pas très précis. Dans ces vingt lits dorment, chaque nuit, vingt êtres d’origine, de condition, de langage et de mentalité différents. Le clairon sonne. Presque aussitôt, c’est une explosion bruyante de propos grossiers, d’interpellations choquantes et d’exclamations déplacées. De lit à lit, on s’injurie parfois, se distribuant force bourrades parce qu’on est à la caserne et qu’on est soldat ! Ajoutez à cela l’atmosphère écœurante de la chambrée, aux fenêtres closes, cette odeur de chaussettes sales et de pieds mal lavés, ou pleins de sueurs qu’on respire, sans compter les nombreux hoquets éructés par les ivrognes de l’escouade, par ces éternels assoiffés qui, buvant sans cesse, buvant le jour, buvant la nuit, se libèrent parfois du trop-plein de liquide qu’ils ont ingurgité... sur la couverture d’un camarade, et quelquefois même ― oh ! par inadvertance ― sur le visage d’un voisin de lit !
Non, rien n’est plus stupide, rien n’est plus répugnant que ces « réveils » en fanfare où la brute humaine se montre sans fard et sans artifice !
La caserne est bien l’école de la brutalité et de la grossièreté.
• • •
L’été 1915 fut, je me le rappelle, particulièrement chaud. Chaque matin, nous allions au tir ou en patrouille contre des ennemis imaginaires. Naturellement, ces divers exercices n’intéressaient nullement l’antimilitariste que j’étais et que je suis plus que jamais. Les marches, par contre, m’ennuyaient moins parce que, chemin faisant, mon esprit vagabondait. Je m’évadais, par la pensée, du milieu. Si je songeais avec regret au passé, je pensais aussi et surtout à l’avenir, terriblement problématique. Le soir, quand, au lieu de rentrer à la caserne, nous cantonnions à quelques kilomètres de Laval, dans un village de quelques centaines d’habitants, je profitais des quelques heures de liberté relative qui nous étaient accordées avant l’extinction des feux dans les granges où nous devions passer la nuit, pour m’isoler et réfléchir dans la campagne, d’où s’exhalaient les parfums pénétrants des foins et des fleurs.
J’éprouvais alors une sensation de bien-être, loin des clameurs, loin du bruit... Malheureusement, ces marches n’avaient lieu qu’une fois par semaine. Les autres jours de la semaine, exercices ! exercices ! exercices ! L’après-midi, à la caserne, était consacré au sommeil et, vers quatre heures, quand le soleil était moins chaud, à l’exercice sur le terrain de manœuvres. De midi à quatre heures, vaincus par la chaleur, mais bien plus souvent par désœuvrement, nous ronflions, étendus sur nos lits. Ce sommeil avait le don de nous plonger dans l’abrutissement le plus complet. Pour ma part, je me souviens qu’à mon réveil, j’étais littéralement abruti : durant une minute, je ne savais plus où j’étais ni quelle heure il était ; la notion du temps avait disparu et si l’on m’avait demandé à quelle phase de la journée nous étions, j’aurais été dans l’incapacité de répondre d’une façon précise. La caserne est l’école de la paresse et de l’abrutissement.
• • •
Nous n’allions sur le terrain de manœuvre qu’une heure environ. Ce terrain était situé derrière la caserne. L’air avait le don de faire disparaître cet engourdissement du cerveau et des muscles dont j’ai parlé plus haut. Sous la direction du lieutenant et parfois du capitaine, quelquefois même du commandant qui suivait nos évolutions, monté sur son cheval, nous exécutions des exercices idiots. (En principe, tous les exercices sont idiots.) À la pause, je contemplais le vaste horizon inaccessible et je m’évadais ― toujours par la pensée ― du triste milieu dans lequel je vivais. Parfois, j’apercevais, au loin, le vaguemestre, lequel, se dirigeant vers le point où nous évoluions, nous apportait des nouvelles de Paris. À sa vue, un peu de cette joie, rare à la caserne, inondait mon pauvre cœur ulcéré. Je bondissais, prenant ma place dans le cercle qui, déjà se formait pour entourer ce messager tant aimé ! Les lettres ! C’était mon unique réconfort et quelle mine piteuse je faisais quand ― cela m’arriva plus d’une fois ― j’avais été oublié ! À la caserne, le soldat attend non sans impatience les lettres du pays. Mais n’attend-t-il pas, au reste, toujours quelque chose ? Le matin, au réveil, on attend l’infect « jus ». Ensuite, on attend la « soupe » ; après la soupe, on attend le courrier du matin ; après le courrier du matin, on attend celui du soir ; après le courrier du soir, on attend la soupe de cinq heures ; après la soupe du soir, on attend que le « quartier » soit déconsigné pour sortir en ville. Mais ce qu’on attend avec le plus d’impatience encore, quand on n’est pas une brute, c’est la « classe » ; la « classe », c’est-à-dire la fuite, sans retour ! Cependant, on trouve des soldats qui « rengagent ». Ça se voit.
• • •
Ah ! ces sorties en ville, le soir, qui en dira la monotonie ! Dès six heures, la soupe vite avalée, les caboulots sont pris d’assaut. Pris d’assaut par ceux qui ayant en poche quelques maravédis, veulent se donner l’illusion de la liberté. D’aucuns, les paysans plus particulièrement, restent au « quartier ». Dans les chambrées, se réunissent les « gars » d’un même pays ou d’une même contrée. Et là, groupés autour d’une bougie qui n’éclaire pas, les parties de cartes succèdent aux parties de cartes, jusqu’à l’heure de l’extinction des feux. Souvent, le vin ou la « gniole » y contribuant, cela finit par des disputes, des coups de poing, quelquefois même des coups de couteau. La chambrée, le soir, quand tout est calme, a un aspect lugubre. Les soirs de rixe, elle devient sinistre...
La cantine ; elle, regorge toujours de clients. Clientèle de paysans. Sur chacune des tables poisseuses de l’infâme débit réglementaire, quelques verres, accompagnés d’un litre de « rouge » ou de cidre, sont placés en évidence. Autour des tables, deux, trois ou quatre occupants, en treillis, qui tirent sur leur pipe sans mot dire quand ils ne jouent pas aux cartes ou ne « lèvent pas le coude ». Là aussi, cela finit quelquefois par des disputes et des batailles. La « clientèle » qui préfère s’abreuver en ville ne vaut guère mieux. Les débits de boisson, bien achalandés, distribuent à profusion vins, café, alcool, etc., etc...
Le lupanar, lui, fournit le reste. J’ai frémi plus d’une fois en songeant à l’horrible chose que devait être le rapprochement éphémère, rapide du « gars » de caserne, ivre et brutal et de la fille de bordel, lasse et résignée. La caserne est l’école de l’alcoolisme et de la débauche sale.
• • •
Il y a aussi les soldats qui par impécuniosité se promènent dans les rues de la ville, sans but, attendant l’heure de rentrer au « quartier ». À ces malheureux est réservé un sort peu digne d’envie : véritables automates ils sont tenus de saluer ― le règlement l’exige ― tous les gradés qu’ils croisent sur leur chemin, depuis les caporaux jusqu’aux maréchaux de France, en passant par le caporal fourrier, le sergent, le sergent fourrier, le sergent major, l’aspirant, l’adjudant, l’adjudant chef, le sous lieutenant, le lieutenant, le capitaine, le commandant, le lieutenant colonel, le colonel, le général de brigade, le général de division, le général de corps d’armée et le général d’armée ! Ouf !... Mués en machines à saluer, les pauvres soldats de deuxième classe doivent constamment avoir la main au képi ― il y a tellement de gradés ! ― Malheur à qui oublie ce devoir essentiel : la salle de police et la prison sont là pour les rappeler au respect de la discipline ! Les promenades en ville sont monotones et dépourvues du moindre charme. On les rencontre souvent par deux, les petits soldats, le nez au vent, traînant avec eux l’ennui. En les voyant, on pense à ce refrain fameux :
D’vant les monuments
Tous les deux, on s’promène
Ça vous fait passer l’temps...
Évidemment !
• • •
Neuf heures tintent tristement à l’horloge de la caserne. Individuellement ou par groupes, ils rentrent, les petits soldats, sous l’œil inquisiteur du sergent de garde.
Les godillots résonnent lourdement dans les sombres escaliers conduisant aux chambrées. Des refrains obscènes sont repris en cœur par des chanteurs amateurs. Toute la caserne est en effervescence. Le tapage est infernal. Chut ! Voici le sergent de semaine qui, une liste à la main, va procéder à l’appel. Tout le monde se tait. Il a terminé. Il part. Les joueurs de cartes continuent la partie interrompue. Et les chants reprennent de plus belle, tant pis pour les dormeurs ! Le moment est venu, grâce à l’ombre complice, de faire subir mille brimades aux plus faibles et aux pauvres « gars » ― des « innocents » parfois ― choisis comme têtes de turcs. La caserne est l’école de la lâcheté.
•••
Il me reste un mot à dire des chefs.
À mon sens, les chefs ne sont ni meilleurs, ni plus mauvais que les hommes qu’ils sont appelés à commander. Ce sont des hommes, de pauvres hommes comme les autres. Bon nombre de soldats de 2e classe n’ont qu’un désir : conquérir des galons. Leur rêve satisfait, ils deviennent aussi mauvais que leurs supérieurs contre lesquels ils s’indignaient étant simples soldats. À vrai dire, un gradé qui applique le règlement avec modération et qui s’efforce d’être juste envers ses subordonnés ― n’oublions pas qu’un gradé n’est-pas un anarchiste ― est bien moins mauvais que le soldat de 2e classe qui fait subir à un camarade plus faible, de ridicules et dures brimades. La plupart des chefs, dans l’armée, sont victimes de cette déformation professionnelle qui fait des moins mauvais des imbéciles ou des tyrans. Donnez à un homme un bout de galon, un morceau de ruban ou une croix : neuf fois sur dix, vous transformerez cet homme à son désavantage. Le type caractéristique du gradé, c’est l’adjudant « Flick », le héros immortel de Courteline. On ne connait que trop ce « chien de quartier » rôdant dans la cour de la caserne, fourrant son nez partout, se cachant pour mieux surprendre ses inférieurs en défaut, afin de pouvoir leur infliger une punition exemplaire. Ce type existe encore, hélas ! et si la guerre en a fait disparaître quelques-uns, il fleurit encore dans les régiments de France et de Navarre et pousse dans les cours de caserne comme le champignon sur le fumier. La bêtise de l’adjudant Flick est incroyable. Les motifs qu’il porte au registre des punitions prouvent son incurable imbécillité. Il y a quelques années, dans une caserne de France, un soldat, pour s’éviter la peine de descendre la nuit aux w.c. ― c’était en hiver ― avait trouvé plus simple de se... libérer par la fenêtre. L’adjudant Flick, ou un de ses dignes collègues, avait surpris l’imprudent en plein... épanchement. Naturellement, après l’envoi à la salle de police du coupable, le motif suivant avait été rédigé sur le champ : « Pissait par la fenêtre en faisant des zigzags et sifflait un air d’opéra pour amortir le bruit de la chute. » Courtelinesque mais authentique. Il ne m’est malheureusement pas possible d’énumérer tous les « bons motifs » dont, j’ai eu connaissance, il me faudrait plusieurs colonnes de l’Encyclopédie. Mais la bêtise de l’adjudant Flick est suffisamment connue pour qu’il soit inutile d’insister.
Comme conclusion à cette modeste étude, je pourrais citer le mot d’Anatole France : « La caserne est une invention hideuse des temps modernes ». En effet, elle prend le jeune homme à l’âge où celui-ci éprouve le désir de tout voir, de tout connaître et d’acquérir l’expérience nécessaire de la vie ; elle le soumet à une discipline de fer, féroce et barbare à laquelle il doit se soumettre aveuglément. La caserne ne dégourdit pas l’homme de vingt ans, comme certains esprits rétrogrades se plaisent à le dire et à le proclamer. Ou plutôt elle le dégourdit dans le mauvais sens du mot. Elle le dégourdit par des distractions malsaines, sur les bancs crasseux de la cantine et sur les canapés défraîchis du bordel.
La caserne prend le jeune conscrit et le transforme en un être abject : brutal envers ses camarades plus faibles, lâche et menteur selon que cette attitude favorise ses desseins, hypocrite devant ses chefs, ivrogne au besoin et contaminé trop souvent. De plus, elle brise, compromet sa situation sociale. Mais la caserne a de chauds partisans et d’ardents défenseurs parmi les députés qui saisissent avec empressement l’occasion qui leur est offerte de défendre leur meilleur électeur : le bistro. La caserne n’est même pas défendable du point de vue de la défense nationale ― problème qui ne saurait cependant intéresser les sans patrie que nous sommes. On l’a bien vu au début de la guerre, en 1914. La jeune classe 14 fut envoyée au feu, trois mois après son incorporation et, naturellement, si elle s’y fit tuer, comme les réservistes, il n’en est pas moins vrai qu’elle « tint le coup » pour parler un langage outrageusement jusqu’au-boutiste. Oui, la caserne est inutile et néfaste à tous les points de vue. Elle est la forteresse d’où la classe capitaliste lance ses forces contre la foule en révolte. Mais elle est aussi un bagne dans lequel on comprime les meilleurs sentiments, une géhenne dans laquelle on mate les plus généreuses aspirations de la jeunesse.
• • •
De tous les camarades que j’ai connus à la caserne, j’en sais qui ont eu le privilège ― c’en est un ― de rentrer dans leur foyer, la guerre terminée. D’autres, le plus grand nombre, sont couchés pour toujours dans la boue de Verdun ou sous la terre crayeuse de Champagne. Lamentable sort qu’ont eu ces derniers ! Leur jeunesse s’écoula entre les murs austères et rébarbatifs de la caserne. Et quand ils quittèrent celle-ci, ce ne fut que pour marcher au-devant de la Mort qui les prit à vingt et un ans ou vingt-deux ans ! De la Vie ils ne connurent que la face grimaçante, de cette Fée versatile et fantasque, ils n’obtinrent jamais le moindre sourire. Quittant l’École pour la Caserne, leur jeunesse fut monotone et triste et l’on peut dire qu’ayant délaissé la Chambrée pour la Tranchée au fond de laquelle ils rendirent le dernier soupir, ils furent dans la situation du condamné à mort qui quitte la Prison pour se rendre à l’Échafaud.
Sans doute, ils furent victimes inconscientes du Drame dans lequel ils jouèrent un rôle de premier plan ― sinon profitable. Leur jeunesse et leur inexpérience furent leur seule excuse.
Nous, les Survivants de l’odieux Massacre, notre devoir est tout tracé : discréditons de toutes nos forces le Militarisme et la Caserne ; croyons à l’évolution des Esprits. Et puisse cette opinion du général Langlois trouver bientôt sa justification :
« La caserne développe l’antimilitarisme. »
― Lucien LÉAUTÉ.
CASSATION (COUR DE)
Juridiction suprême, composée de hauts dignitaires de la magistrature et dont le rôle consiste, ainsi que son nom l’indique a casser les sentences rendues par les diverses Chambres, si les formes de la procédure n’ont pas été respectées et s’il a été commis durant le jugement certaines violations de la loi. Cette jurisprudence fut établie par la loi du 27 novembre 1790. La Cour de Cassation comprend : un premier président ; trois présidents de Chambre ; 48 conseillers ; un procureur général ; six avocats généraux ; un greffier en chef ; quatre commis greffiers ; huit huissiers. Le nombre des avocats à la Cour est de 60. C’est toute une nuée de fonctionnaires inutiles et grassement rétribués, qui vivent sur le travail de la collectivité. Ce ne serait cependant là qu’un demi-mal si leur rôle nuisible ne s’étendait pas plus avant. La Cour de Cassation ne s’occupe jamais du fond de l’affaire qui lui est soumise. Elle n’a pas le pouvoir d’augmenter ou de diminuer une peine. Elle annule un jugement si elle y constate des vices de forme, et renvoie l’affaire devant un tribunal compétent qui la juge à nouveau. Là se bornent ses attributions. Il faut, pour que la Cour puisse se prononcer, la présence d’au moins onze juges et ses décisions sont prises à la majorité des suffrages. Les audiences à la Cour de Cassation sont publiques.
On peut se pourvoir « en Cassation » à la suite d’un jugement du tribunal correctionnel, de la Cour d’appel, de la Cour d’assises ; mais il faut dire tout de suite que pour les Anarchistes ou tous ceux qui s’occupent du mouvement social de gauche, il n’y a aucune chance de bénéficier de la faveur ou de l’indulgence de ces hauts magistrats issus de la bourgeoisie et au service du capital.
De même que la Cour d’appel (Voir : Appel (Cour d’)), la Cour de Cassation est un lieu de repos où s’en vont terminer leur existence les anciens présidents des tribunaux correctionnels ou des Cours d’assises, et le législateur fut bien mal inspiré, en 1790, lorsqu’il crut garantir l’application de la loi, au nom des libertés républicaines.
La loi et la magistrature ne seront jamais des organes de défense sociale et vont à l’encontre du but poursuivi, même si l’on admet la sincérité qu’anime le législateur et le magistrat. Comme toutes les institutions bourgeoises, la Cour de Cassation est un des piliers du capitalisme qu’il faut combattre pour le bien de l’humanité libre.
CASTE
n.f.
Se dit des catégories, des classes entre lesquelles une nation est partagée par la loi civile et religieuse. Par extension, se dit aussi de certaines classes de personnes pour les distinguer du reste de la nation à laquelle elles appartiennent, et, dans ce sens ne s’emploie guère que par dénigrement. Ex. : Il a tous les préjugés de sa caste.
Il n’y a plus de pays, aujourd’hui divisés en castes, l’Inde exceptée, et encore, le mouvement gandhiste tend-il à faire disparaître cette vieille organisation. Dans l’Inde, ainsi d’ailleurs qu’en Egypte on retrouve dans la plus vieille antiquité, trace des divisions nationales, par castes. Dans la Perse, les castes ont été moins marquées ; les Juifs n’ont connu que la caste sacerdotale ; elles n’ont existé en Chine qu’accidentellement et le bouddhisme les a détruites partout. En Egypte, avant l’établissement des monarchies, la nation était divisée en trois castes : les prêtres, les guerriers et le peuple. Dans l’Inde, selon le Législateur des Indous, Manu, ils doivent à Brahma leurs lois et leurs usages ; Krishna, fils de Brahma, divisa la nation en quatre castes principales, qui n’ont entre elles aucun rapport et qui ne se mêlent jamais par des alliances. Ce sont :
-
Les Brahmanes, sorti de la bouche de Dieu ;
-
les Kchatryas, formés de ses bras ;
-
les Raysiahs, de ses cuisses ;
-
les Sûdras de ses pieds.
La première de ces castes, celle des Brahmanes fut destinée au sacerdoce ; elle occupa aussi les emplois les plus élevés, ministres, conseillers, etc. Les Kchatryas furent destinés au métier des armes. Aux Raysiahs fut confiée la direction de l’agriculture, du commerce, de l’industrie, le soin d’élever les troupeaux. Enfin, les Sûdras exercèrent plusieurs métiers et furent laboureurs, domestiques, parfois esclaves. Cette dernière caste, avec sa sous-caste ou tribu des parias est de beaucoup la plus nombreuse et compte les neuf dixièmes de la population de l’Hindoustan.
Chaque caste a ses privilèges tant au point de vue du costume et des préséances qu’à celui de la nourriture. Nul ne peut sortir sa caste, soit pour monter, soit pour descendre, sans crime. La caste des parias notamment est tenue dans une abjection incroyable, une ignorance crasse, qui sont la honte de l’Inde.
En Europe, les nations furent longtemps, sans qu’il y ait des démarcations aussi rigoureuses, divisées en castes. Les seigneurs qui monopolisaient les richesses et le savoir, avec les prêtres ; d’autre part, les serfs et esclaves, monopolisant le travail, la misère et l’ignorance, formaient bien deux castes ou classes et plus tard, trois, grâce aux « affranchis » devenus bourgeois. Il est à noter que partout, la caste première, est celle des prêtres, qui partout monopolise les développements de l’intelligence et s’en sert pour maintenir dans le servage le plus grand nombre possible de membres de la nation. Mais la nécessité « d’affranchir » des serfs pour faire travailler les autres serfs les oblige à laisser l’instruction se répandre chez les affranchis. Ceux-ci s’enrichissent de biens mobiliers, affranchissent à leur tour d’autres esclaves et quand ils se sentent assez forts, se débarrassent de l’autorité de la caste des prêtres et des seigneurs.
Ainsi, peu à peu, avec les développements de l’intelligence et la découverte de l’imprimerie, les castes se sont fondues. Il n’y a plus que des possédants et des non-possédants, mais les uns passent dans l’autre classe et il y a une tendance sociale à la communisation des avoirs.
— A. LAPEYRE.
CASTRATION
n. f.
Mutilation atroce qui consiste à retrancher les deux glandes qui secrètent la semence. Cette opération fut surtout répandue en Europe vers le XVIème siècle. On sait que l’ablation des organes sexuels chez l’homme, lui procure une voix claire et aiguë qui peut se conserver avec l’âge, et c’est pour satisfaire aux besoins de l’église et fournir aux chapelles des papes des chanteurs à la voix de soprano, que des parents, aveuglés par un fanatisme criminel, et aussi par intérêt, n’hésitaient pas à sacrifier tout l’avenir de leurs enfants. De l’église, les castrats se répandirent dans le théâtre ; le métier fut pendant un certain laps de temps assez lucratif. Ce n’est qu’en 1851 lorsque les armées françaises occupèrent Rome que le pape Pie IX, se vit contraint de rendre un décret abolissant définitivement l’usage de la castration.
En Orient la castration se pratique encore mais sur une moins grande échelle. Elle fournit les eunuques chargés de veiller sur les harems des pachas et des sultans. Elle disparaît cependant à mesure que progresse la liberté féminine et que la civilisation abolit les préjugés qui étouffent le vieux monde.
La femme est, elle aussi, sujette à la castration, mais dans un ordre tout à fait différent. Elle ne se pratique qu’en cas de maladie. Il en est cependant qui n’hésitent pas à subir cette opération terrible et douloureuse, et se font retirer les ovaires pour ne pas avoir d’enfants. Ces cas sont tout particuliers et très rares, car la complicité d’un homme de science est indispensable, et on peut dire que de nos jours la castration ne se pratique plus que sur les animaux domestiques dont on veut éviter la reproduction.
CASUISTIQUE
n. f.
La casuistique est une science religieuse, qui a la prétention de traiter des devoirs de l’homme et d’établir des règles déterminant les responsabilités dans les divers conflits d’ordre moral. Comme tout ce qui se rapporte à l’église et qui est d’essence jésuitique, la casuistique fut un moyen entre les mains des hauts dignitaires du Christianisme pour asservir le peuple, et accumuler des richesses. En opposition avec leur morale de pauvreté, de chasteté et d’abstinence, les casuistes, avides de domination, de luxure et de bien-être, accaparaient tous les biens laïques, que les peuples, par naïveté, ignorance et faiblesse, n’osaient même pas défendre. C’est vers le XVIIème siècle que la casuistique atteignit son apogée. À cette époque elle devint l’objet de l’aversion populaire, en raison des crimes, des exécutions accomplis en son nom au cours des cinq siècles précédents.
La casuistique, objet de discussion sur tous les conflits ou crimes d’ordre religieux, véritable code barbare dont les maximes furent soutenues et défendues par la papauté, justifia les actes les plus ignobles et les plus monstrueux. Les casuistes n’hésitèrent pas à qualifier de sages et salutaires les massacres de la Saint Barthélémy. Ce furent eux qui conseillèrent la révocation de l’Édit de Nantes.
Au sens général on fait de la casuistique, lorsque l’on parlemente à perte de vue sur des cas de conscience ou lorsque l’on se plaît à embrouiller, pour les besoins d’une mauvaise cause, un débat ou une discussion.
CATACLYSME
n. m. (du grec : kataklusmos, déluge)
Au sens géologique, révolution qui bouleverse et transforme la surface du globe. Le cataclysme est un phénomène d’ordre naturel et malheureusement l’humanité ne peut rien, ou presque, pour en arrêter les effets désastreux. Chacun a encore présent à la mémoire le terrible cataclysme, qui ravagea le Japon en 1923 et qui coûta la vie à plusieurs centaines de milliers de malheureux. Les éruptions volcaniques, les inondations qui, à périodes indéterminées, viennent désoler les populations sont des cataclysmes.
Avec les progrès de la science, l’observation et l’aide d’appareils d’enregistrements ultra-sensibles les savants arrivent parfois, sinon à prévenir, du moins à prévoir un cataclysme, ce qui permet plus particulièrement pour les éruptions volcaniques d’évacuer les populations qui habitent dans les environs de la « Montagne de feu ».
Rien ne permet hélas d’espérer que la petite chose qu’est l’homme, arrivera à vaincre la puissante nature qui, détachée des faiblesses et des mesquineries humaines, poursuit son évolution en vertu des lois différentes de celles qui nous régissent.
Il semble que la brutalité de la nature ne soit pas suffisante à l’homme et que celui-ci, animé par un instinct de destruction, provoque souvent des cataclysmes ; et au sens social on peut considérer comme cataclysme toute transformation brutale de l’humanité. La guerre, erreur des sociétés modernes, est un cataclysme néfaste qui engendre cependant des cataclysmes bienfaisants. La Révolution russe de 1917 fut un cataclysme vengeur du régime d’opprobre et d’impérialisme tsariste.
La Bourgeoisie et le Capital s’écrouleront bientôt dans un formidable cataclysme.
CATÉCHISME
n. m. (du grec : Katechismos)
Au sens général : instruction élémentaire d’une morale religieuse. Il serait pourtant erroné de penser que le catéchisme ne se borne qu’à l’enseignement de la foi chrétienne. Une telle définition du catéchisme serait incomplète. De nos jours où la religion chrétienne, ou plutôt les religions dites « révélées » perdent de leur influence, et sont remplacées par des religions plus modernes, le nombre des catéchismes s’est multiplié. Chaque doctrine a le sien, dans lequel on s’attache à pénétrer l’esprit de l’enfant d’une foi, qui n’admet, naturellement, ni réplique, ni analyse. Les catéchismes varient selon les besoins de la cause.
Nous savons que durant la guerre, son Éminence le Cardinal archevêque de Paris, afin de concilier ses vertus très saintes et ses devoirs patriotiques de Français n’hésita aucunement à retrancher du catéchisme chrétien ces paroles du Christ : « Tu ne tueras point ». Dans le domaine patriotique et national, le catéchisme que l’on enseigne aux enfants dans les écoles, s’applique à faire naître dans les jeunes cerveaux malléables, l’amour du pays où l’on est né et la haine de l’étranger. Il prépare moralement les boucheries futures. « Tu tueras et tu mourras pour sauver ton pays ». Ce pourrait être le frontispice du catéchisme nationaliste. Il y a également des catéchismes révolutionnaires et nous assistons malheureusement au spectacle douloureux d’hommes sincères et dévoués qui, catéchisés par des maîtres en la matière, croient fermement défendre les intérêts de la classe ouvrière, de leur classe, en s’inspirant d’un catéchisme qui n’est souvent composé que d’un tissu d’erreurs et d’aberrations. L’enseignement catéchistique est donc contraire à la science et à la logique et ne peut former, au point de vue intellectuel, que des individus aveugles et fanatisés.
CATÉGORIE
n. f. (du grec : Kategoria, attribut)
Classification des objets, des idées et des individus de même espèce. La catégorie est le résultat de recherches, d’inventaires et doit frapper par sa clarté et par sa précision. Un homme et un arbre sont de catégories différentes. Pourtant les catégories peuvent, à leur tour, donner naissance à des subdivisions. De même qu’il y a plusieurs catégories dans le domaine philosophique il y en a plusieurs dans le règne végétal ou animal. Si l’on peut ranger tous les humains dans la même catégorie, relativement aux plantes, on peut ensuite classifier par couleur, par race les divers habitants de la terre et former de la sorte des catégories humaines. Il en est de même pour les animaux et les végétaux. On ne peut évidemment associer dans une même catégorie le végétal et l’animal et en conséquence il est assez facile de tracer une ligne de démarcation entre les diverses catégories.
CATHOLICISME
n. m.
Voir : Religion, et aussi, Église, Jésuites, Papauté.
CAUSALITÉ
n. f.
Affirmation et notion de la cause ; vertu par laquelle une cause produit un effet. Il n’y a entre ces choses aucun rapport de causalité. Principe de causalité : Principe en vertu duquel on rattache un effet à sa cause. ― Une des catégories de Kant, comprise dans la relation. Chez la plupart des philosophes qui ont embrassé dans leurs spéculations l’ensemble de l’intelligence et qui ont construit ou tenté d’édifier un système complet, nous trouvons la catégorie de causalité. Ces catégories sont les idées nécessaires, sans lesquelles la pensée ne saurait s’exercer. La Causalité a donc toujours été considérée comme un des modes les plus importants, les plus essentiels de l’esprit.
CAUSE
n. f. (du latin : Causa)
Principe d’une chose, ce qui fait qu’elle existe. Ce mot exprime une idée essentielle, une des idées fondamentales de l’esprit humain, et, par la notion qu’il représente, il appartient au langage philosophique. Une cause est tout ce qui est capable de produire un mouvement déterminé. On ne peut parler de « cause première » dans le domaine de la matière qui présente un enchaînement de causes et d’effets. Or, dans ce domaine où tout est successivement effet et cause, la cause première, si elle était, serait indépendante, absolue, donc éternelle et donnerait naissance à d’autres causes, dépendantes, relatives, ce qui est absurde. La matière présente donc l’image de l’indépendance éternelle et elle ne renferme ni cause première, ni cause finale, mais seulement des équilibrations transitoires formant les divers êtres. La matière est en éternelle transformation, allant des formes les plus illimitées aux formes les plus limitées, de corps faisant des forces, et transformant les forces en corps. Tout mouvement provoque un mouvement. Il n’y a pas de mouvement premier, il ne saurait y avoir de mouvement dernier. La « limitation » qui gênait tant les spiritualistes, et leurs principes de causalité, s’explique parfaitement aujourd’hui, grâce aux expériences de Gustave Le Bon et à son livre l’Évolution de la matière. Tous les corps se réduisent en forces identiques. Il n’y a pas de différence d’essence entre les êtres de la série, mais de forme seulement. Le cristal et la cellule sont composés de même, mais ayant une forme différente et un moyen de reproduction ainsi que d’accroissement particuliers, ils donnent naissance à des êtres apparemment opposés.
CAUSER
v. a.
Être la cause de... Exemple : Ce maladroit a causé un accident.
CAUSER
Ce mot n’a aucune communauté de sens ni d’origine avec le précédent, il nous vient du latin causare qui signifiait plaider. En français, causer, c’est s’entretenir familièrement d’un objet. Il faut se garder d’employer le verbe causer pour le verbe parler. La demoiselle du téléphone commet un barbarisme quand elle dit : « Ne quittez pas : on vous cause. » Par négligence on donne quelquefois au mot causer un sens péjoratif. Exemple : « Cette femme a fait beaucoup causer » pour dire que des bruits malveillants ont circulé à son sujet. Cette négligence est admise et c’est regrettable car nous avions déjà le mot jaser qui est le péjoratif de causer. Larousse dit fort justement :
« Savoir parler ce n’est que savoir parler ; savoir causer c’est savoir parler et écouter. »
Donc, causer, c’est parler en gardant une disposition à écouter.
CAUSERIE
n. f. Même origine que le mot précédent.
Dans la pratique la causerie est l’intermédiaire entre la conversation et la conférence. ( Voir ce mot .) La conversation est généralement imprévue et improvisée et l’objet de l’entretien est souvent inattendu. Pour la causerie, au contraire, on a préalablement convenu de quoi l’on s’entretiendra. On peut donc dire que la causerie est une conférence plus intime ou destinée à des auditoires réduits à un petit nombre. La causerie comporte le plus souvent un orateur, mais celui-ci parle en s’attendant aussi à écouter, en guettant sur les visages de ses auditeurs ce qui convient à satisfaire la curiosité et les besoins de chacun. Pendant que la conférence s’adresse à l’auditoire en masse parce que la quantité d’auditeurs ne permet pas qu’il en soit autrement, la causerie permet à l’orateur et lui impose même de viser chaque auditeur individuellement ; Pendant que le conférencier parle indépendamment des auditeurs devenus anonymes par le nombre, le causeur vit avec chacun des individus de son auditoire. Le conférencier touche un plus grand nombre de personnes ; le causeur touche plus profondément chaque auditeur parce qu’il lui est moins étranger.
On commettrait une faute grave contre ce merveilleux moyen qu’est le verbe en supposant la préparation d’une causerie moins nécessaire que celle d’une conférence : le causeur peut et doit se permettre un langage plus simple, de façon à se confondre le plus possible avec son auditoire ; mais c’est précisément parce que des interruptions peuvent se produire, sollicitant une précision, un éclaircissement, un complément d’explication, que le causeur devra s’être plus solidement préparé. La causerie est la forme oratoire la plus exigeante ; car, en même temps qu’elle impose à l’orateur une connaissance profonde du sujet, une préparation solide du discours, elle exige le don d’improvisation : l’orateur doit se tenir prêt à répondre brièvement et clairement à toute question et ramener habilement au sujet son auditoire qui, sans cela, se livrerait aux plus folles digressions.
Tout en étant intime, voire familier, le causeur doit demeurer courtois, affable et même respectueux.
* * *
La causerie fut un art très athénien ; outre que le philosophe grec enseignait, sous forme de causeries faites non à ses disciples, mais avec ses disciples, dans l’antique Athènes les hommes allaient volontiers chez le barbier parce que l’on y causait. La causerie est devenue un art très français parce que le Français est né causeur ; mais il ne faudrait pas croire que la causerie n’exerce sa séduction qu’en France : la vérité est que la langue française, par ses finesses et ses subtilités, donne à la causerie toute la valeur de son charme ; mais les Français qui ont voyagé savent que, dans tous les pays du monde, la causerie demeure le meilleur moyen d’expansion des idées.
Pour nous en tenir à notre définition, il faut considérer que c’est aux environs de 1610, en l’hôtel de Rambouillet, que naquit la causerie française. On ne peut considérer comme causeries les controverses religieuses qui les auraient devancées ; car, orateurs papistes et réformistes faisaient des conférences contradictoires et non des causeries. C’est la jeune marquise de Rambouillet qui, peu après sa vingtième année, provoqua la formation et l’évolution des causeries. Instruite, intelligente et sociable, elle avait réuni dans son hôtel de Rambouillet les esprits les plus cultivés de son temps : Voiture, Vaugelas, Condé, Mme de Longueville, Mme de Scudery, Benserade, Corneille, La Rochefoucauld, tant d’autres encore. Il est fort probable que de tous les personnages illustres qui fréquentèrent chez Julie (Julie d’Angennes, marquise de Rambouillet), c’est Vaugelas qui fut le plus « causeur » au sens que nous donnons ici à ce mot. Mais les bonnes et précieuses leçons de syntaxe qu’il donna aux familiers de la maison firent commettre à certains de ridicules exagérations dans les soins donnés au « bien parler » et ces exagérateurs des préceptes du grammairien Vaugelas reçurent l’épithète de « précieux » et « précieuses ». Molière ne les épargna point, il fut même dur pour l’Abbé Cotin dont il fit le Trissotin des Femmes Savantes, ce qui est injuste car Charles Cotin était non seulement latiniste mais aussi helléniste et hébraïste ; c’était donc un savant lettré.
Les causeries de l’hôtel de Rambouillet avaient certainement débuté sous la forme de verbiages littéraires, par la suite oncausa philosophie, arts, sciences. Molière nous montre, surtout dans Les Femmes Savantes et dans Les Précieuses Ridicules, les petits côtés des effets de ces causeries. Julie d’Angennes semble aussi être la créatrice de ce qui fut appelé « faire ruelle ». On nommait alors ruelle la partie de la chambre où se trouvait le lit. Nous dirions aujourd’hui l’alcôve. La marquise recevait au lit et aussi pendant que ses caméristes procédaient à sa toilette compliquée, des courtisans qui, pour lui plaire, poussaient la conversation sur son terrain favori. Ces « ruelles » devinrent aussi des causeries, littéraires le plus souvent. Selon que la dame qui recevait était insignifiante et superficielle ou cultivée et d’esprit élevé, les visiteurs étaient des lettrés et philosophes ou des oisifs. Dans ce dernier cas, la causerie déviait de la littérature au sentiment, sentimentalisme plutôt, et fats et faquins discutaient sur la fameuse « carte du Tendre ». Dans l’autre cas, les visiteurs étaient des érudits et des penseurs ; de la littérature on passait à la philosophie et les causeries philosophiques s’orientèrent rapidement vers la politique et s’attaquèrent à l’astucieux et puissant Mazarin. C’est dans les salons, ruelles et embrasures de fenêtres que naquirent les deux Frondes (1648–1649 et 1649–1653) où nous retrouvons Broussel, Condé, Beaufort. Madame de Longueville fut célèbre parmi les jolies frondeuses.
L’Académie Française elle-même est née de causeries et, en dépit de la légende, Richelieu n’en fut pas le fondateur : elle existait de fait quand il s’en empara. En 1629, Chapelain, Godeau, Gombault, Giry, Habert, l’abbé, de Cérisy, Malleville et Cérisay, prirent l’habitude de se réunir chez leur ami Valentin Conrard pour s’entretenir des travaux qu’ils préparaient. Le cardinal de Richelieu, ayant appris l’existence de ces causeries, proposa aux causeurs de former une compagnie. L’Académie était née, car Chapelain fit prudemment remarquer à ses compagnons qu’il était sage de ne pas déplaire au Cardinal. La signature royale consacra l’existence de l’Académie Française, le 29 janvier 1635. Mais un siècle plus tard, les causeries prendront une ampleur féconde et prépareront la révolution, parce que, dans les « salons où l’on cause » auront fréquenté les encyclopédistes. Qui sont ces encyclopédistes dont le verbe préparera la chute du trône le plus élevé d’Europe ? Diderot, d’Alembert, l’abbé de Prades, Voltaire, Helvétius, le chevalier de Jaucourt, l’abbé de Condillac, Rousseau, l’abbé Morellet, d’Holbach, l’abbé Raynal. Où se réunissaient-ils ? — Dans les salons de quelques grandes dames. Ces cénacles étaient très organisés, voire disciplinés : chaque maîtresse de maison avait son jour et chaque jour avait sa matière. Chez Mme de Tencin, le lundi on causait, arts, le mercredi lettres. Chez Mme Helvétius, le mardi, on causait sciences, philosophie, sociologie ; mais abrégeons en nommant les dames qui tinrent les salons les plus célèbres, c’est-à-dire qui présidèrent aux causeries les plus retentissantes : Mme de Longueville, Mme Geoffrin, Mme du Deffand, Mlle de Lespinasse, Mme Necker... Il y a danger d’être injuste quand on cite des noms : nous allions oublier Marmontel dont les causeries eurent leur part d’influence. Mme Marmontel aussi tenait salon. Acceptons d’être incomplet et, pour cette époque, résumons : elle fut fertile en causeries fécondes.
Nous avons fini pour l’époque, mais à côté de l’époque, dans ce temps-là, dans un coin de province, sous une tonnelle de rosés, dans le jardin d’un estaminet de la banlieue d’Arras, des causeurs se réunissaient et fondaient une société. L’objet de leurs causeries était la poésie ; le nom de leur société, emprunté à la tonnelle, était les Rosati. Ces jeunes poètes amateurs étaient avocats, officiers, bourgeois ; les noms des causeurs : Joseph Le Guay, Lazare Carnot, Maximilien Robespierre !
Les grandes favorites organisèrent aussi des causeries ; la marquise de Pompadour, alias la fille Poisson, sut en tirer parti de façon remarquable. Pendant la période révolutionnaire tout prend des proportions si grandes que la causerie fait place à la conférence. Elle ne meurt pas tout à fait et Joséphine de Beauharnais en est une preuve. Plus tard, quand Bonaparte la délaisse pour sa maîtresse : la gloire, elle réunît les beaux esprits et la causerie survit dans son salon, mais pour ne renaître réellement qu’en la deuxième partie du siècle.
On fait un abus du mot causerie jusqu’à s’en servir pour désigner une conférence, un cours, voire un article de journal. Les causeries de Sainte-Beuve ne sont autre chose que des cours. Il en est de même de ce qu’à tort encore on a nommé les causeries d’Edmond About. Par contre, quelques conférences de La Bodinière (oh ! très peu !) furent de réelles causeries. La plupart des conférences et des cours des Universités Populaires furent aussi des causeries. Les clubs actuels : Faubourg, Tribune des Femmes, Insurgés, etc., ne sont pas des milieux où l’on cause. Nous les retrouverons à l’article Conférence .
Nous devons, à ce propos, mettre en garde nos groupements d’étude et de propagande et leur recommander d’apprendre à discerner les qualités de leurs orateurs pour confier les causeries aux causeurs et les conférences aux conférenciers ; il est exceptionnel que le même homme réunisse les qualités des deux emplois. Encore une recommandation d’ordre pratique : si le causeur doit posséder de solides qualités, les auditeurs doivent s’imposer une certaine discipline à cause du danger de la digression et de la confusion. Il ne faut pas que, sous prétexte de la liberté d’interpeller l’orateur, tout le monde parle à la fois. La grande qualité de l’auditeur de causerie doit être la discrétion. Les auditoires de causeries se recrutent parmi l’élite des auditoires de conférences.
Raoul ODIN.
CAUSTICITÉ
n. f.
Substantif qui sert à désigner une nature acerbe, mordante, satirique, et le plaisir qu’éprouvent certains individus à poursuivre un adversaire, par l’invective et l’ironie. La causticité est un état maladif et dénote un caractère hargneux, méchant ; elle est plus brutale que la satire, et plus dangereuse ; elle est aussi moins spirituelle. Il faut se méfier et s’éloigner des esprits caustiques.
CAUTELEUX
adj.
Qui use de ruse, de finesse, pour arriver à ses fins. Se dit d’un individu sournois et plat, dénué de franchise et ne prenant que des chemins détournés pour atteindre le but qu’il se propose. Un homme cauteleux n’hésite pas à tromper ses semblables, si son intérêt l’exige. « Des mains cauteleuses ont su la diriger vers un autre but. » (Mirabeau.)
CÉLÉBRITÉ
n. f.
Ce qui est connu du grand public, qui a de la réputation. La célébrité d’un savant, la célébrité d’un roman, la célébrité d’un bandit. Il y a une nuance entre la célébrité et la gloire et il ne faut pas confondre l’une avec l’autre. On peut devenir célèbre en accomplissant une mauvaise action de grande envergure. Un grand criminel, un grand général qui fit massacrer des millions d’individus sur les champs de bataille, peuvent devenir célèbres ; mais ils ne seront jamais glorieux qu’aux yeux des populations serviles, nationalistes et patriotes. Les terribles « Chauffeurs de la Drôme » furent célèbres. Le nom de Poincaré est célèbre ; celui de Pasteur est entouré d’une auréole de gloire incontestable.
En notre siècle de mercantilisme où tout se négocie, la célébrité s’acquiert avec de l’argent. De la publicité autour du nom d’un mauvais romancier, et le voici devenu célèbre. De grands savants, des bienfaiteurs de l’humanité resteront obscurément abandonnés durant toute leur existence, tandis que des charlatans, grâce au bruit fait autour d’eux, seront universellement connus et fêtés. Un homme célèbre n’est donc pas obligatoirement un grand homme et c’est avec raison que Mme Necker a dit :
« Il y a des célébrités factices auxquelles on travaille toute sa vie et qui finissent à la mort. Il y a des célébrités qui commencent au tombeau et ne finissent plus. »
CÉLIBAT
n. m.
Est considérée de par la loi comme célibataire toute personne d’âge nubile et qui n’a pas été mariée légalement, alors même qu’elle vivrait en ménage depuis des années sous le régime de l’union libre, et posséderait une nombreuse progéniture.
Pour ceux qui n’attachent point à la célébration du mariage officiel une importance capitale, et ne la considèrent que comme une concession à certaines nécessités de la vie sociale présente, le célibat est l’état des hommes, ou des femmes, qui, soit volontairement, soit par suite de circonstances fâcheuses, vivent dans l’isolement sexuel, au lieu de faire association, avec une ou plusieurs personnes de leur choix, dans une existence commune durable, en vue de l’amour et de la procréation.
Dans les sociétés antiques le célibat était flétri par l’opinion publique comme une situation anormale, non sans quelque raison d’ailleurs. Car ceux qui, ayant reçu la vie, refusent de la donner, et répugnent à l’union conjugale, sont, du point de vue de l’espèce, comparables à des fruits secs ou à des arbres morts.
Mais la tendance naturelle de persistance et d’accroissement de l’espèce n’est pas seule à considérer en cette matière. Non soumise au contrôle du savoir et de la raison, elle aboutit au surnombre et à son élimination inévitable par la famine ou le massacre. Elle donne lieu aussi à d’imparfaites sélections, par le moyen barbare de compétitions brutales.
Le rôle des humains éclairés est, en matière de reproduction, de prévenir à toute époque, par la procréation limitée aux moyens de subsistance acquis, les luttes meurtrières résultant du surnombre. C’est aussi de substituer, à l’insuffisance et à la cruauté de la sélection établie sur le triomphe des plus aptes, les procédés non douloureux de la sélection rationnelle, basée sur l’observation scientifique, et qui consistent, tant en un choix judicieux des types humains les plus capables de contribuer à l’embellissement de l’espèce, qu’en une mise à l’écart, par la stérilité volontaire, des éléments disgracieux, morbides ou gravement tarés.
Le célibat, considéré comme renoncement à l’union sexuelle en vue de la procréation, ne peut donc être apprécié comme une, faute vis-à-vis du genre humain que lorsqu’il s’agit d’êtres qui, par leur beauté et leur santé, leurs brillantes qualités morales ou intellectuelles, auraient pu donner au monde une heureuse descendance, et s’y refusent, pour le plus grand profit de la multiplication des médiocres ou des infirmes.
Le célibat ainsi considéré, lorsqu’il est dicté par la conscience de l’inaptitude à une saine procréation, est un sacrifice à l’intérêt social, d’autant plus digne de louange, qu’il peut être à certains fort pénible de s’y résoudre.
Il est des circonstances où le célibat ainsi compris trouve encore et tout autant sa justification. Lorsqu’il s’agit de personnes dont le caractère est impropre à l’existence permanente en commun, et qui ne pourraient que s’y trouver malheureuses, tout en rendant pénible à autrui leur présence. Lorsqu’il s’agit, en outre, d’hommes ou de femmes qui se proposent un apostolat rendu dangereux par les conditions de la vie sociale actuelle.
On peut, en effet, être doué de très sérieuses qualités mais, pour l’étude, la méditation, ou le travail, avoir besoin d’un isolement tel qu’il est peu compatible avec les nécessaires concessions, et les petits tracas journaliers de l’existence en famille. C’est le cas de beaucoup de savants, d’artistes et d’écrivains, aventureux et instables par tempérament, ou bien hypnotisés par leur labeur.
Il est à considérer, d’autre part, que notre conduite, à l’égard de ceux que nous aimons, doit s’inspirer logiquement de la situation dans laquelle ils se trouvent, et non de celle qui pourrait leur être faite dans : une toute autre organisation sociale.
Or, il est présentement impossible de compter sur la société pour élever de façon convenable des enfants, en l’absence de leur père et surtout de leur mère. Et, pour ce qui est des jeunes filles et des femmes, elles sont, pour la plupart, dans l’incapacité de se suffire à elles-mêmes par leur travail. Qu’elles aiment avec sincérité, ou qu’elles n’aiment point, presque toutes sont dans la nécessité de compter, pour vivre sans trop de misères, sur l’appui de l’homme qui les invite à partager son foyer, légalement ou non.
Si donc nous conservons tous, à chaque moment, le droit d’encourir, pour une noble cause, l’extrême dénuement, la prison et la mort, ceci devient beaucoup plus contestable lorsqu’il est question d’entraîner à notre suite, dans de terribles épreuves, des êtres qui , dépendent de nous, que nous avons appelés à la vie, ou auxquels nous avons promis le bonheur, et qui n’ont peut-être ni la ferveur de notre vocation, ni la force de notre résistance.
Avant de se résoudre à quelque héroïque sacrifice, un homme consciencieux et bon, une mère au cœur tendre, songeront toujours à assurer pour le moins la sécurité de ceux qui, demain peut-être, seront à l’abandon. On ne s’appartient plus entièrement lorsqu’on a pris charge d’âmes. Et c’est pourquoi ceux qui rêvent à de grandes actions pleines de périls feraient-ils bien de se résigner à la solitude, et à n’avoir que de stériles amours.
Jean MARESTAN.
* * *
CÉLIBAT
S’il était une « Vérité », elle serait anarchiste ; et l’on pourrait affirmer a priori que, ce qui nuit à l’État favorisant l’anarchie, l’idéal, résiderait dans le célibat, c’est-à-dire le défaut d’union légale ou non, entre l’homme et la femme. Mais les libertaires n’admettent rien sans discussion et confrontent sans cesse les faits avec les principes.
Dans tous les temps et dans maints pays, les gouvernements ont sévi contre le célibat et infligé des amendes aux réfractaires au joug conjugal. Autrefois les Grecs et les Romains considéraient que l’absence de famille et de progéniture portait atteinte au culte des aïeux, menacé de s’éteindre faute de postérité déférente, et à la prospérité de l’État, compromise par la diminution des effectifs militaires et de la masse taillable et corvéable à merci.
Les monarchies et républiques contemporaines, la France entre autres, suivent la même ligne de conduite et frappent d’une peine pécuniaire leurs ressortissants non mariés. Cependant les motifs ne sont pas tout à fait les mêmes ; le culte des dieux lares, la nécessité de perpétuer le foyer ancestral n’inquiètent guère le législateur moderne, plus prosaïque, surtout soucieux de remplir son coffre-fort et de pourvoir les casernes de chair à canon. L’État n’exige ni encens, ni prières, mais de l’argent pour alimenter ses privilèges et des soldats pour les défendre.
A la réflexion, la loi contre le célibat se montre arbitraire et particulièrement odieuse de nos jours. Car, maintenant, bien des gens ne se marient pas par impossibilité de fait et non par aversion pour le mariage ; ils voudraient, ne trouvent pas, ne peuvent pas. Depuis que, dans une crise de stupide fureur anti-populaire, les gouvernements ont volontairement déchaîné la guerre et fusillé par millions leurs sujets mâles, beaucoup de femmes soupirent en vain après une union légale. Les maîtres perçoivent un impôt sur les défaillants à un hymen impossible, mais oublient hypocritement d’autoriser la polygamie et de l’encourager par des exonérations fiscales. Ils veulent des enfants légitimes ou illégitimes, mais sans les payer.
Suivant en apparence une autre voie que les puissances temporelles, le christianisme, à son origine, marqua à ses adeptes son éloignement pour le mariage où il voyait une atteinte dangereuse au culte exclusif de Dieu. « Celui qui n’est point marié s’occupe des choses du Seigneur, cherchant à plaire au Seigneur , mais celui qui est marié s’occupe des choses du monde, cherchant à plaire à sa femme (St-Paul, « lre Epître aux Corinthiens ») ». C’est que, au début, la religion nouvelle était surtout une morale, une discipline de perfectionnement intérieur, ne visait pas à la domination matérielle, ne prévoyait ni finances ni armée. Malgré les séductions de la vertu, les premiers catéchumènes ne purent se résoudre à la continence ; les prêtres et évêques eux-mêmes continuèrent à vivre en union légitime ou en concubinage jusqu’au XIe siècle, où, par la force, le pape Grégoire VII imposa, le célibat aux ecclésiastiques, en invoquant que « l’Église ne peut se libérer de la domination des laïques si les clercs ne se délivrent pas de leurs épouses ». L’humble christianisme primitif, devenu le catholicisme triomphant, ambitionnait le pouvoir intégral, la primauté universelle. Afin de l’obtenir, il décrétait la chasteté pour son clergé militant auquel la pureté assurerait vigueur physique et force morale ; mais il préconisait les conjonctions prolifiques pour les simples fidèles dont la masse grandissante apporterait un copieux tribut. Et aujourd’hui on voit les prêtres de toutes les confessions se faire les complices des gouvernements meurtriers et pousser leurs ouailles à repeupler à outrance les champs de bataille.
A la fin de sa pièce « L’Ennemi du Peuple », Ibsen, conclut : « L’homme vraiment puissant est l’homme seul ». Il signifiait par là que société, parents, amis, influencent et diminuent la personnalité de l’individu, l’entravent dans son développement propre ; la vie sociale et familiale oblige à des concessions constantes, souvent si étendues qu’elles entraînent le caractère le plus droit à s’exprimer et à agir contre son sentiment, contre sa volonté. Le grand dramaturge voyait juste ; chaque jour permet de vérifier comment le souci de ménager l’opinion publique, la crainte de nuire aux intérêts des siens, le désir d’éviter de la douleur aux êtres aimés, amènent le militant le mieux doué à de puériles capitulations, à de tristes renoncements, à de funestes défaillances, parfois à l’avilissement et la trahison. L’homme réellement libre, l’homme véritablement fort, c’est l’homme seul. Mais à quoi lui servirait sa liberté s’il ne pouvait l’aliéner au service des esclaves incapables de se libérer seuls ? Quel usage ferait-i1 de sa puissance, s’il ne l’exerçait pour le bonheur de ceux à qui leur faiblesse ne permet pas de vivre seuls ? Au contact de la société, dans la famille, ce surhomme devient un être humain, simplement. Que le plus pur des anarchistes lui jette la première pierre, s’il l’ose !
Il n’y a pas sur un arbre deux feuilles pareilles, ni dans le monde deux personnes identiques. Pure chimère que la recherche d’un autre soi-même pensant et agissant dans une étroite communion, sous une impulsion analogue. Néanmoins cette recherche devient passionnante parce qu’elle conduit à d’étonnantes découvertes. En un perpétuel et stérile narcissisme, l’homme se poursuit en vain dans le regard de ses semblables ; il saisit dans le miroir des yeux une vivante et singulière lueur et non un pâle reflet, une fière solitude et non une banale sujétion. Nul ne rencontre l’âme-sœur, ni la femme faite à son image. Chaque être reste seul, éternellement. Unir deux solitudes, c’est créer de la douleur, et aussi des joies. La souffrance, plus que l’amour, anime l’esprit, élève la pensée, exalte le poète ; ou plutôt l’amour est souffrance. Et l’homme ne peut échapper à l’amour.
Comment le solitaire, l’anarchiste aura-t-il l’amour ? Tout dans la nature, végétaux et animaux, se pare pour la recherche sexuelle, fleurit, embaume, roucoule, fait la roue, courtise. La véritable possession ne réside pas en un viol,, mais en un choix, parfois rapide, parfois différé, toujours consenti. Il y a consentement, il y a union : passagère, temporaire, durable ou définitive. L’amour n’existe pas sans union. Peut-être dans la vie des troupeaux, la fécondation se fait-elle d’autorité, sans dilection ? Apparence ; l’union devient plurale, persiste sous la superficielle passivité. D’ailleurs le libertaire se targue de ne pas vivre selon le monde grégaire. Ni chef, ni sujet. En amour, il ne prend, ni n’impose ; n’achète, ni ne se vend ; ne débauche, ni ne se prostitue. Il demande et il s’offre. Il ne fornique pas, il aime. Aimer c’est unir deux corps, deux tendresses, deux souffles, deux existences. Union d’un jour, union d’un ,an, union à vie ? Nul ne sait dès l’abord combien resteront unis ceux qui se sont joints une fois ; ni si leurs affinités et leurs dissemblances ne les sépareront pas, ou si elles les fixeront.
Pour échapper à l’étreinte de deux bras blancs, à l’emprise d’un regard énigmatique et charmeur, pour s’assurer un destin libre de toute contrainte morale et affermi contre la moindre compromission, l’anarchiste, le militant, l’apôtre se dévouera au célibat absolu, à la continence complète. Il ne connaîtra ni épouse, ni compagne, ni camarade, ni passante, nulle femme. Ses nuits seront sans caresses, ses jours sans abandons. Il ira beau, puissant, sublime, mais seul. Bien peu changeront la faiblesse de leur union contre la force de cette solitude.
Dr ELOSU.
CELLULE
n. f. (lat. Cellula)
Petite chambre d’un religieux ou d’une religieuse. — Petite chambre dans la prison, où le détenu vit seul, et qui est disposée de manière à empêcher toute communication avec les autres prisonniers. Les prisons modernes se font toutes avec des cellules. — Par analogie : Petite alvéole où l’abeille, dépose son miel et son couvain. Les cellules de même espèce se ressemblent entre elles et offrent une régularité frappante ; elles sont toutes de forme hexagone. — La cellule est une masse de matière vivante ou protoplasme, limitée par une membrane et ayant une sorte d’indépendance, une vie propre, assimilant et désassimilant pour son compte. Quand elle est complète, elle renferme un autre élément cellulaire plus petit, un noyau, où l’activité vivante de la cellule atteint ordinairement son maximum de puissance. En. outre, il arrive souvent, surtout chez les végétaux, que la surface extérieure du corpuscule cellulaire se durcit ; cette surface durcie constitue alors ce qu’on appelle la membrane cellulaire.
La cellule peut affecter diverses formes, elle peut être globulaire, conique, étoilée, etc..., mais les lignes qui la limitent sont des lignes courbes. Or, lorsque les minéraux sont constitués d’éléments de structure bien définie, ces éléments qu’on appelle cristaux sont toujours terminés par des lignes droites.
La cellule emprunte continuellement au milieu extérieur les substances qui lui sont nécessaires ; ces substances pénètrent dans le protoplasme (matière vivante) à travers la membrane et en assurent l’accroissement. Toutes les cellules constituant une plante ou un animal se comportent de la même manière, l’être vivant subit le même mode d’accroissement. Les êtres vivants s’accroissent par pénétration ou intussusception, c’est ce qu’on a appelé le phénomène de l’osmose. Tout être vivant emprunte constamment au milieu extérieur les substances nutritives et lui restitue constamment les déchets.
Certaines conditions sont indispensables à la vie. Le milieu doit fournir au protoplasme :
-
de l’eau ;
-
de l’oxygène ;
-
de la chaleur.
Tout être vivant, naît, grandit, se reproduit, atteint son développement maximum, perd de son énergie et meurt. Tout être vivant descend d’un être auquel il ressemble : la cellule, vient d’une cellule, la souris d’une souris, etc...
Lorsqu’une cellule a atteint les dimensions qu’elle ne peut dépasser, elle se segmente et donne naissance à deux autres cellules. Celles-ci, à leur tour, vont grandir et donner naissance à deux nouvelles cellules, et ainsi de suite. Si en se divisant, une cellule donne naissance à deux cellules, qui, au lieu de vivre isolées, restent attachées, nous assistons à la constitution, non plus d’un être unicellulaire ou protozoaire, mais d’un être pluricellulaire ou métazoaire. Les cellules d’un être métazoaire se disposent d’une certaine façon qui leur est imposée par les lois physiques et les conditions spéciales du milieu dans lequel elles se développent. D’après les places qu’elles occupent, elles subissent des influences différentes auxquelles elles réagissent, de sorte que la forme des cellules d’un être métazoaire peut varier dans le même être d’un endroit à l’autre ; certains groupes de cellules s’adaptent à remplir certaines fonctions, d’autres groupes s’adaptent à d’autres fonctions ; ces groupements de cellules deviennent des organismes.
CENSURE
n. f (du latin : Censura)
Droit de suspension, d’interdiction, d’examen, sur les écrits, les journaux, les livres, les pièces de théâtre, préalablement à leur publication ou à leur présentation.
La censure est une très vieille institution et était considérée comme un des premiers ordres de la magistrature chez les Romains. Son rôle avoué était de corriger les abus que la loi n’avait pas prévus ; son rôle réel — comme de nos jours du reste — était d’étouffer les protestations des adversaires du pouvoir.
En France, la censure subsiste toujours bien qu’elle ait été légalement brisée en 1791, puis rétablie à plusieurs reprises ; mais elle ne s’exerce préventivement que durant les périodes de trouble. Pendant la dernière guerre, la censure permit aux gouvernements du monde de poursuivre la boucherie, tout écrit devant être soumis à son autorité pour obtenir l’autorisation d’être publié. La suppression de la censure préventive n’implique pas la liberté d’écrire ou de penser, et ceux qui se permettent, en France, comme dans les autres pays, de s’attaquer aux institutions établies, en vertu de principes jugés subversifs par les lois bourgeoises, sont victimes de la répression. Ce n’est par conséquent qu’une question de mesure, et lorsque les gouvernants des Etats bourgeois considèrent qu’il est de leur intérêt de supprimer totalement la liberté de la presse, ils n’hésitent jamais à ressusciter la censure préalable. C’est donc le principe même de la censure qu’il faut combattre, car elle est un abus dont usent les maîtres du pouvoir pour emprisonner la pensée, et écraser toute liberté individuelle ou collective.
CENTRALISME
n. m.
Deux méthodes ont toujours lutté l’une contre l’autre, au sein des sociétés ; c’est la méthode autoritaire, qui veut tout rassembler sous la direction d’une personne, d’une coterie ou d’une caste, laquelle inévitablement s’en sert pour ses intérêts particuliers contre l’intérêt général ; et c’est la méthode libertaire, qui veut au contraire que chaque être humain soit son propre maître, s’associe ou se sépare librement de sorte que, aucune contrainte n’existant, l’exploitation et la tyrannie disparaissent. Autorité et liberté sont les deux pôles d’attraction opposés : autorité préconisée par les maîtres du jour ou les maîtres de demain (en état d’opposition provisoire seulement) ; liberté, préconisée par les exploités désireux de s’émanciper, les révoltés de toutes les époques et de toutes les régions.
A ces deux mots d’autorité et de liberté correspondent exactement ceux de centralisme et de décentralisme : fédéralisme ou libre-associationnisme. Indistinctement, et quelle que soient leur étiquette ou leur couleur, tous les partisans du pouvoir sont pour la centralisation. Tout centraliser, tout ramener à un centre directeur, est la théorie chère à ceux qui sont ou veulent être les maîtres. Les théories centralistes sont toutes basées sur la même affirmation : « l’incapacité du peuple à s’administrer librement, autrement dit sa bêtise, donc la nécessité de le faire diriger par des hommes supérieurs. » Et elles aboutissent toutes au même résultat : la constitution d’une caste, d’une aristocratie ; hier, les nobles, aujourd’hui les bourgeois, demain peut-être les soi-disant intellectuels et les fonctionnaires, qui commencent à s’assurer une existence confortable par la consolidation des privilèges acquis ou l’instauration des privilèges nouveaux. Le centralisme aboutit inévitablement au parasitisme, à la contrainte, à l’inégalité, à l’injustice. D’ailleurs, en enlevant aux intéressés, aux dirigés, les moyens de s’administrer par eux-mêmes, il entretient soigneusement l’infériorité apparente ou réelle des administrés. Ceux que la centralisation place à la tête des organismes sociaux sont d’ailleurs des humains comme les autres, ni plus ni moins compétents et moraux. L’exercice de l’autorité leur crée une mentalité spéciale et des désirs de jouissance vaniteuse qui sont des maux redoutables dans une organisation sociale.
Le centralisme n’a jamais résolu aucun des problèmes posés devant l’espèce humaine, ou, s’il les a résolus, ce fut toujours au détriment des masses, au profit des détenteurs du pouvoir. La seule utilité arguée en faveur du centralisme est celle des bienfaits de la coordination dans les efforts humains. Mais par le fait qu’il aboutit à l’autorité, il provoque presque toujours le contraire ; l’ambition, la haine, la division, les déchirements entre les aspirants au gouvernail, et l’écrasement des couches sociales inférieures. Or, cette coordination peut s’obtenir, aisément et sans risques de tels maux, par la libre fédération des individus et des groupements. Le fédéralisme s’oppose pratiquement au centralisme. En laissant à chacun la liberté dans sa propre association, et la liberté des groupements au sein de fédérations plus vastes, il parvient à l’équilibre raisonné, à l’harmonie, sans laisser prise aux méfaits et aux conséquences néfastes du centralisme autoritaire. Il laisse la faculté aux initiatives isolées ou groupées de se développer ; et par là les stimule ; il ne permet point la contrainte ni l’exploitation ; il est donc l’expression même, du point de vue pratique, de la lutte pour l’émancipation. Le centralisme politique a conduit à des tyrannies abominables et à des guerres sanglantes. Le centralisme économique, qui a son expression dans les cartels et trusts capitalistes, vise à asservir matériellement l’humanité. Quant aux doctrines socialistes ou communistes, rêvant d’un centralisme intégral, d’une dictature, elles sont condamnées par l’expérience que les milliers d’observations ont consommée ; elles ne peuvent aboutir qu’à une tyrannie nouvelle, valant l’ancienne. Les peuples révoltés et conscients se débarrasseront de l’autorité et du centralisme, sa forme d’organisation.
Georges BASTIEN.
CERVEAU
n. m.
La célèbre proposition de Carl Vogt : « Le cerveau secrète la pensée comme le rein secrète l’urine », soulève à peine aujourd’hui la surprise par la trivialité de sa comparaison et de fortes réserves sur son exactitude physiologique. Naguère, il y a quelque cinquante ans, elle provoqua un véritable scandale et ameuta la science officielle contre son auteur. Si l’on tenait pour à peu près indiscutable que le cerveau fût le siège, le substratum, le soutien de la pensée, il apparaissait sacrilège d’attribuer à cet organe matériel l’élaboration de principes subtils et immatériels comme l’intelligence, l’esprit, l’âme. Les animaux ont un système cérébro-spinal parfois très développé et cependant ne possèdent pas cette faculté d’abstraction, d’évocation, de création, que Dieu a réservée à son œuvre de prédilection, l’homme. L’âme émanait du souffle divin.
Un illustre parrainage couvrait les pontifes du XIXe siècle ; et, longtemps avant eux, un des plus grands philosophes de l’antiquité, Aristote, allait jusqu’à renier au cerveau tout rôle dans la vie intellectuelle, plaçait dans le cœur le centre de la pensée ! La doctrine aristotélicienne, si puissante au moyen-âge, paralysa presque entièrement l’esprit de recherche et le goût de l’expérimentation ; on croyait à la parole du maître. Pourtant, Galien reconnut les principales fonctions cérébrales, et Hérophile et Erasistrate, de l’École d’Alexandrie, les avaient étudiées « sur des condamnés à mort qu’ils ouvraient tout vivants pendant qu’ils respiraient encore. (Celse, cité par Lhermitte). »
En réaction contre l’enseignement d’Aristote, Descartes soutint la conception mécaniste de la physiologie humaine, l’appliqua au système nerveux, établit le premier la réalité de l’are réflexe et localisa l’âme dans la glande pinéale. Puis Willis, et ensuite Gall et Spurzheim étudièrent la structure de la matière cérébrale, précisèrent son agencement et sa répartition, tentèrent les premières localisations fonctionnelles que les savants contemporains ont enfin déterminées.
Dès lors quelles sont, à l’heure actuelle, les connaissances les plus précises, les plus valables concernant le système nerveux ? Et les conditions aujourd’hui connues de son fonctionnement permettent-elles de le regarder comme une manifestation étroitement spécialisée des phénomènes physicochimiques qui dominent toute la biologie ?
L’anatomie macroscopique, l’exploration à l’œil nu font pressentir du premier coup la haute noblesse, la puissante différenciation de l’axe cérébro-spinal. Chez l’homme, le cerveau se présente comme l’organe le plus volumineux, après le foie, et le plus riche en vaisseaux sanguins. Son poids atteint la cinquantième partie de celui du corps entier. Chez les individus et dans les races, son développement, ainsi que celui des circonvolutions dont il est sculpté, répondent au degré d’évolution intellectuelle : plus grands dans les hommes et les groupes ethniques et d’éducation supérieure ; moindres chez les ignorants et les peuplades arriérées. Dans la série animale, la même gradation marque le passage d’une classe à l’autre, d’un embranchement inférieur à un supérieur. Le poids relatif du cerveau va du cinquantième chez l’homme au cinq centième chez l’éléphant ; au trois millième chez la baleine. L’indice pondéraI, calculé sur 10.000, monte de 1,8 chez les poissons, à 7,8 chez les reptiles ; 42,2 chez les oiseaux ; 53,8 chez les mammifères ; 277,8 chez l’homme. L’observateur libertaire verra là une nouvelle confirmation de cette loi d’ontogenèse générale : la fonction modelant l’organe. Et, en regard, combien s’avère encore une fois puérile et inféconde la conception théologique d’un Créateur façonnant les êtres selon les caprices de sa bonne ou de sa mauvaise humeur !
La section longitudinale ou transversale du cerveau le révèle composé d’une masse molle, où l’œil distingue déjà une substance grise et une substance blanche non mélangées au hasard d’une mosaïque irrégulière mais disposées en conglomérats de forme et de volume bien tranchés, dont la configuration générale se retrouve à peu près identique chez tous les animaux suffisamment évolués. Ainsi, la partie la plus externe du cerveau est formée par une couche régulière et continue de substance grise appelée « manteau », « pallium » ou « écorce ». Des ilots ou bandes de substance blanche séparent le pallium de noyaux de substance grise situés à la base du cerveau et dont les plus importants sont la « couche optique » ou « thalamus », le « corps strié » ou « noyau caudé », le « bulbe olfactif ». L’étendue et l’épaisseur du manteau croissent au fur et à mesure qu’on s’élève sur l’échelle zoologique : chez l’amphibie, la pallium est plus petit que le corps strié, tandis que chez l’homme l’écorce comporte une masse bien supérieure aux autres formations grises qu’elle recouvre d’ailleurs presque complètement. À I’opposité, le bulbe olfactif, si développé chez les reptiles, subit une régression marquée chez les mammifères et surtout, parmi ceux-ci, chez les Primates.
Grâce à l’histologie, ou anatomie microscopique, il a été possible de pénétrer la structure intime du système cérébro-spinal, formé presque en entier par deux éléments très caractéristiques et tout à fait particuliers : la cellule nerveuse ou « neurone » et la fibre nerveuse. ― Au nombre de près d’un milliard rien que dans l’écorce grise, les neurones présentent une texture spécifique adéquate à leur fonction différenciée dans l’organisme, et leur protoplasma renferme des formations qui leur sont propres : neuro-fibrilles, canaux de HolmgrenGolgi, pigment ocre ; corpuscules chromophiles. Leur taille varie de cinquante millièmes de millimètre à cent quarante millièmes de millimètre (moelle de bœuf) ; ces dernières sont visibles à l’œil nu. ― Enfin, caractère hautement distinctif, les neurones rayonnent autour d’eux des prolongements filamenteux plus ou moins nombreux que l’étude histo-physiologique a divisés en deux sortes : les uns, très ramifiés, à surface rugueuse, au nombre de cinq à six, s’appellent « prolongements protoplasmiques » ou « dendrites » et conduisent les excitations de toute nature vers la cellule (conduction cellulipète) ; les autres, au nombre d’un par cellule, sont lisses, plus ténus, moins ramifiés et transmettent les impulsions issues du neurone (conduction cellulifuge) ; on les nomme « cylindre axe » ou « axone ». — Dendrites et axones peuvent atteindre un mètre de longueur : tels ceux qui relient les cellules nerveuses de la moelle épinière à l’extrémité du membre inférieur.
Les fibres nerveuses constituent purement et simplement la suite ininterrompue des dendrites et axones ; et les nerfs sont le prolongement périphérique du neurone. À une certaine distance de sa cellule d’origine, la fibre nerveuse se recouvre d’une substance particulière, la « myéline », constituée en partie par des filaments spiralés dont l’ordonnance rappelle celle des condensateurs électriques.
Avec son corps cellulaire et sa double catégorie de prolongements, le neurone apparait comme une unité anatomique et physiologique, et se montre en effet tel dans toute la série animale. Mais, dans cet appareil, quelle formation spéciale conditionne l’élaboration de l’activité nerveuse si différente des autres fonctions organiques ? Aucune ; la diversité des phénomènes vitaux n’est qu’apparence due à la multiplicité des formes engendrées par les éléments cellulaires types dans leur adaptation plus étroite à un travail déterminé. Comme le neurone, tous les protoplasmas possèdent l’« irritabilité », c’est-à-dire la propriété générale d’être impressionnés par une excitation extérieure (température, lumière, électricité, contact) et de réagir par une manifestation d’activité ordonnée. Celle-ci, minime et microscopique chez une infusoire, amplifiée chez l’homme jusqu’à l’évidence grossière, traduit les modifications physicochimiques se produisant, sous l’influence de causes Internes ou externes, dans l’intimité de la matière vivante en état perpétuel de gravitation (voir article : « biologie »). « Dans les organismes inférieurs, tous les éléments anatomiques accomplissent au même degré la totalité des fonctions physiologiques. Tous sont identiques entre eux et, par suite, ils peuvent être séparés les uns des autres sans que leur existence soit compromise. C’est ce qui a lieu chez les Protozoaires en colonies. Au contraire, dans les organismes plus élevés, chaque élément choisit pour son compte, dans le travail physiologique total, une fonction déterminée et se cantonne exclusivement dans cette fonction : il s’y adapte pleinement et la remplit avec d’autant plus de perfection qu’aucun autre soin ne l’en détourne. Certains éléments anatomiques s’adaptent à la digestion des aliments, d’autres conservent en propre l’irritabilité ; d’autres sont spécialement contractiles, tandis que cette propriété disparaît plus ou moins dans les autres cellules. Mais, par contre, la division du travail fait naître entre les divers éléments une solidarité plus grande, car chacun est utile à la vie de tous, et de même la réunion des éléments associés réalise un ensemble de conditions tel, que chacun ne peut être séparé sans être exposé à mourir. (Rémy Perrier, « Zoologie »). »
Manifestation de l’énergie cosmique, activité, spécialisée issue des phénomènes intra-cellulaires d’ionisation et de diastase, l’irritabilité se traduit, en fonction différenciée, par l’élaboration et la circulation de l’« influx nerveux », de cette force coordonnée qui, déclenchée par une excitation périphérique ou une impulsion centrale, aboutit à une contraction musculaire, une sécrétion, ou une pensée. L’étude expérimentale de l’influx nerveux a déjà donné des précisions fort intéressantes et l’a montré soumis aux lois générales de la matière. Ainsi, depuis Du Bois-Reymond, on savait déjà qu’un courant électrique appelé « courant de démarcation ou de lésion », sensible au galvanomètre, existait entre la surface d’un nerf et la tranche découverte par une section. Cependant cette réaction n’avait rien de spécifique et appartenait à maint autre tissu ou corps matériel. Mais elle permit d’en provoquer une nouvelle plus démonstrative : le courant de lésion se trouvait modifié et réduit lorsqu’on portait sur le nerf, bien au-dessus du point de section, une excitation chimique, mécanique, thermique ou électrique. Cette variation négative du courant de lésion révélait le passage d’un « courant d’action » apparemment identique à l’influx nerveux, puisque les mêmes excitations de nature diverse, appliquées soit sur les nerfs, soit sur les centres nerveux eux-mêmes, faisaient agir muscles et glandes de l’organisme aussi bien qu’elles provoquaient une variation négative, contrôlable, sur le courant électrique d’un nerf sectionné. ― Il fut aussi établi que toutes les conditions qui influencent la rapidité ou la force de l’influx nerveux affectent de la même manière l’intensité et la vitesse du courant d’action (Lhermitte).
Quelle que soit l’intensité de l’excitation, la vitesse de l’influx nerveux atteint 28 à 30 m. par seconde chez la grenouille : 117 m. à 125 m. chez l’homme. Elle s’élève avec la température et diminue par la réfrigération ; se trouve proportionnelle à la surface de section de la fibre nerveuse, plus rapide dans les gros conducteurs que dans les petits. ― L’intensité de l’influx nerveux varie évidemment selon la force, la fréquence, le rythme, la nature du stimulant initial. Mais pour une excitation identique, elle augmente ou s’amoindrit suivant le nombre des fibres contenues dans le conducteur. C’est ainsi que les appareils physiologiques les plus actifs, les plus sensibles, les plus délicats, les plus adaptés à leur fonction reçoivent le plus grand nombre de fibres leur apportant quantité d’influx nerveux : 80.000 fibres pour le membre supérieur contre 39.000 pour le membre inférieur ; 25.000 fibres pour le seul muscle droit externe de l’œil.
De quelle nature est cet influx nerveux mesurable dans sa vitesse et son intensité ? Certains caractères le classent parmi les phénomènes chimiques : par exemple, durant son travail, la fibre nerveuse s’échauffe, consomme de l’oxygène, élimine dé l’acide carbonique, voit grandir sa vitesse d’influx du double pour chaque 10 degrés de température en plus, en conformité avec la loi de Van’t Hoff sur les réactions chimiques. Mais d’autre part, la quasi infatigabilité du conducteur nerveux, la présence d’un courant électrique entre sa surface et sa tranche de section en font un phénomène physique. Dès lors une conclusion s’impose : comme la vie elle-même, l’influx nerveux s’avère d’essence chimique et physique à la fois, apparaît comme une modalité particulière de l’énergie universelle.
Voilà donc maintenant connue l’unité fondamentale du système nerveux : une cellule différenciée et adaptée, le neurone, recevant par son ou ses prolongements protoplasmiques, ou dendrites, les impressions périphériques ou internes qu’elle transmet par son cylindre-axe unique soit directement aux organes de mouvement ou de sécrétion chez les êtres de structure rudimentaire, soit aux dendrites d’autres neurones interposés dans les formes plus évoluées. Fibres réceptrices, ou dendrites, cellule nerveuse et fibres effectrices, ou cylindre-axes, sont parcourues par l’influx nerveux, issu des réactions propres du neurone spécialisé aux excitations de toutes sortes provenant du milieu extérieur ou intérieur.
Avec une netteté saisissante, l’anatomie comparée permet de suivre, dans toute la série zoologique, l’apparition et le développement du système nerveux, c’est à dire la multiplicité croissante la complexité progressive de groupement et d’agencement des neurones, depuis la méduse avec sa couronne ombrellaire de cellules nerveuses déclenchant une mobilité fruste et limitée, jusqu’à l’homme avec son cerveau à texture compliquée, propre à toutes les opérations de l’intelligence, forme extrême de l’irritabilité primordiale du protoplasma vivant. Au début, l’arc réflexe, ou passage de l’influx nerveux du point d’excitation au lieu de la réponse motrice ou sécrétoire, s’inscrit tout entier dans une seule et même cellule nerveuse chargée à la fois de la mission réceptrice et émettrice du système. Puis, résultat d’une adaptation plus parfaite, un second neurone s’intercale dans le circuit réflexe, laissant au premier sa fonction de récepteur sensitif, prenant pour lui le rôle effecteur ou moteur. Ce nouvel élément ajusteur « non seulement proportionne, régularise, suspend ou décuple les réponses, mais encore garde le souvenir des influx qu’il a transmis. Et il n’est probablement pas excessif de voir poindre en cet élément le rudiment de la conscience organique. (Lhermitte). »
Sous l’influence des modifications incessantes de l’ambiance, de ses sollicitations constantes et toujours plus précises, l’organisme animal acquiert une structure encore davantage complexe. Entre le neurone récepteur et le neurone moteur, un troisième prend place, en charge d’association mieux établie et de renforcement d’activité, pour réagir à des excitations fortes, diverses, variables par une action ample, adéquate, extensive. Ainsi se constitue un centre nerveux des réflexe « inter-segmentaires » ; car, à ce stade de développement, l’être vivant se trouve en état de segmentation définie et de différenciation fonctionnelle (vers).
À un degré supérieur d’évolution somatique correspond une disposition nouvelle des cellules nerveuses. Une solidarité générale s’établit qui nécessite un appareillage spécial. Les réflexes inter-segmentaires, issus de l’état parcellaire, sont conditionnés par des neurones « supra-segmentaires » qui n’ont de lien direct ni avec la cellule sensitive, ou réceptrice ni avec la cellule motrice mais seulement avec le neurone d’association des réflexes inter-segmentaires. Cet appareil supra-segmentaire ne se contente plus de transmettre l’influx nerveux, d’associer, d’amplifier, de diversifier les réflexes ; il présente la propriété de les suspendre, les inhiber, de les refouler pour les mieux adapter. Son activité n’est plus mécanique ; elle est presque réfléchie, psychique. Le groupement des neurones supra-segmentaires constitue l’ébauche du cerveau (arthropodes).
Jusqu’ici, et par conséquent chez les invertébrés, l’étude du développement du système nerveux repose sur les constatations anatomiques et histologiques et sur les données fournies par l’observation de la manière d’être des animaux lorsqu’on modifie les conditions habituelles de leur activité. Les fourmis, devant un obstacle à leur cheminement processionnaire, hésitent d’abord, se reprennent ensuite, et finissent par tourner ou supprimer la difficulté. Elles sont munies d’un centre supra-segmentaire, d’un cerveau déjà grand par rapport à leur taille et peuvent ainsi donner preuve d’intelligence en adaptant leur réponse réflexe à la diversité des excitations extérieures. ― Chez les vertébrés, les proportions plus grandes de leurs organes permettent en outre l’expérimentation physiologique : la pratique des ablations partielles ou totales du cerveau occasionne dans le comportement réflexe et instinctif ou adapté et individuel, des déficits proportionnels à l’importance du segment enlevé.
Ainsi chez les poissons, la décérébration du pallium ou manteau comporte peu de troubles apparents. Car leur activité se règle surtout par les centres segmentaires et inter-segmentaires.
L’ablation du cerveau au-dessus du thalamus ne diminue chez la grenouille que son habileté à la capture de la proie et laisse intactes toutes les autres fonctions. La décérébration sous-thalamique rend la bête inerte ; celle-ci flotte et ne nage plus. De même les reptiles souffrent peu de la suppression du pallium.
Amputé du cerveau, le pigeon s’alimente et se meut à peu près normalement. Mais il a perdu la faculté de reconnaitre les objets, le sentiment de ses besoins sexuels, le discernement du danger.
Un chien, auquel Nothmann extirpa le cerveau, vécut trois ans ; Il était aveugle, mais non sourd, buvait, mangeait et digérait, se mouvait, ne reconnaissait personne et n’avait pas de désirs sexuels, se montrait incapable d’éducation.
L’expérimentation physiologique corrobore donc les conclusions de l’anatomie. Plus un animal comporte un cerveau développé, plus ses actions cessent d’être automatiques, pour devenir réflexes et instinctives d’abord, puis individuelles à un degré élevé d’évolution. De même l’ablation du cerveau, à peu près indifférente pour le comportement des vertébrés inférieurs, devient très nocive pour celui des vertébrés supérieurs. En une série d’actions et de réactions entre l’animal et le milieu, d’une part le système nerveux se complique et perfectionne son agencement pour mieux répondre aux sollicitations de l’ambiance ; d’autre part, la complexité structurale et la haute précision de son fonctionnement confèrent au système nerveux la faculté d’agir sur l’ambiance et de la modifier au gré de ses besoins nouveaux.
Splendide épanouissement de l’appareil supra-segmentaire, le cerveau humain porte à la dernière puissance les possibilités d’intégration, d’adaptation, de transformation des excitations périphériques ou des impulsions internes. Dans ses manifestations psychiques les plus élevées, il se montre l’aboutissant de la longue évolution multi-séculaire durant laquelle, en une série de phases bien déterminées, l’espèce s’achemina de l’état protoplasmique uni-cellulaire, avec son irritabilité fruste et globale, jusqu’à la forme achevée de Primate intelligent avec un système nerveux d’une sensibilité exquise et d’un fonctionnement étroitement différencié.
Cette lente ascension de l’obscure impression élémentaire à la clairvoyante pensée apparaît en un raccourci saisissant dans le développement du cerveau chez le fœtus et chez l’enfant. Dans l’embryon, le système segmentaire (moelle, bulbe, protubérance) se forme le premier, bien avant l’appareil supra-segmentaire qui, pendant les quatre premiers mois de la vie intra-utérine, présente une structure très rudimentaire. Les mouvements fœtaux commencent au deuxième mois ; deviennent perceptibles vers le cinquième ; peuvent être provoqués, chez un fœtus prématurément expulsé, par des excitations de la peau et des tendons. Même la succion et la déglutition se produisent dans la matrice bien avant la naissance. Mais toute cette activité fœtale est seulement réflexe, comme lé prouvent, d’un côté l’inexcitabilité du cerveau et l’excitabilité de la moelle, et d’un autre côté la possibilité de ces mouvements même après une section du cerveau du fœtus au-dessous du thalamus. Et l’inexcitabilité du manteau ou pallium persiste jusqu’à la naissance. « Le fœtus humain, jusqu’à son expulsion à terme, est plongé dans un sommeil sans rêves ».
Le nouveau-né présente un cerveau très différent de l’adulte et dont le développement se fera graduellement suivant un rythme identique à celui de la formation progressive du système nerveux dans la série animale. Il agit d’abord d’une façon réflexe comme les êtres à centres neuroniques inter-segmentaires dépourvus d’écorce cérébrale. « Sourd, aveugle, anosmique, l’enfant à sa naissance ne présente qu’un comportement automatico réflexe auquel s’associent quelques réactions bien imparfaites de caractère instinctif. (Lhermitte). » À six semaines seulement le nourrisson suit les objets du regard, et vers le quatrième mois sourit en « voyant » sa mère. L’odorat et le goût s’affirment plus rapidement. « Dès les premiers mois, l’enfant reconnaît sa mère à l’odeur de son lait, et, dès la naissance l’odeur désagréable de l’« asa fœtida » provoque une expression de dégoût. (Kussmaul). » Les mouvements, les cris, les sanglots, les vomissements du nouveau-né sont réflexes puisqu’ils existent aussi nets chez les enfants dépourvus d’hémisphères cérébraux, les « anencéphales ». Ceux-ci ne vivent qu’un ou deux jours ; mais ils sucent, avalent, crient, remuent les membres. Par conséquent ces fonctions élémentaires sont indépendantes du cerveau. Au fur et à mesure que les neurones se multiplient dans les noyaux gris (thalamus ou couche optique, corps strié) d’abord, dans l’écorce grise ensuite, les manifestations instinctives apparaissent ; l’enfant réagit, quoique maladroitement, aux pressions, pincements, variations de température. Enfin l’entrée en jeu du manteau cérébral fait apparaître les actes imitatifs ou expressifs, sous leur caractère individuel : le sourire, le baiser, les pleurs, les câlinements (Lhermitte).
Ainsi, l’étude anatomique et histologique du cerveau du fœtus et du nouveau-né, l’observation des agissements des enfants normaux et des anencéphales montrent d’une façon surprenante comment la complexité des organes se produit et s’élève avec le perfectionnement des fonctions, et combien l’individu se développe avec précision selon le plan même de l’espèce.
L’élaboration fœtale et post-natale de l’appareil supra-segmentaire conditionnant la vie psychique aboutit chez l’homme adulte à la constitution de deux groupes neuroniques superposés : l’un, inférieur, comprenant les corps opto-striés (thalamus ou couche optique et corps strié) ; l’autre, supérieur, replié en nombreuses circonvolutions, modelant l’écorce cérébrale ou manteau. Pour leur étude, aux recherches normales d’anatomie macroscopique et microscopique, s’ajoutent les données fournies par les lésions consécutives aux maladies et les résultats obtenus par une expérimentation prudente et inoffensive effectuée dans quelques cas favorables sur des trépanés pour blessures ou maladies du crâne et de l’encéphale. Par ces moyens, la physiologie est parvenue à établir la localisation anatomique, matérielle d’un certain nombre d’importantes fonctions intellectuelles et continue la poursuite de découvertes nouvelles afin d’arriver à une connaissance de plus en plus complète de la bio-psychologie humaine.
Les corps opto-striés jouent un rôle très important dans les opérations sensitives et motrices du cerveau. Ainsi, le thalamus ou couche optique reçoit les faisceaux collecteurs de la sensibilité du corps tout entier, arrête les impressions reçues pour les transmettre soit directement au corps strié, centre moteur de l’activité automatique, soit à l’écorce, centre de l’activité consciente. Une lésion du thalamus entraîne d’abord l’insensibilité, puis au bout d’un temps variable, des impressions de douleur, même après la plus légère excitation superficielle. ― Le corps strié préside à l’activité motrice spontanée (déglutition, insalivation, phonation, mimique faciale), règle la vitesse et la précision des mouvements volontaires. Le malade atteint d’une lésion de ce groupe neuronique avale et parle avec difficulté, présente un masque rigide, figé, marche avec raideur et hésitation, perd en partie ses forces musculaires. ― Les corps opto-striés forment donc la première réalisation de l’appareil supra-segmentaire, élèvent les réflexes à l’état d’automatisme instinctif ; le thalamus accuse une obscure conscience sensible, origine de ses douleurs lésionnelles ; le corps strié commande l’automatisme moteur élémentaire, l’automatisme alimentaire et enfin l’automatisme mimique et expressif. « Ce serait donc une grande méprise que de refuser l’intégration des corps opto-striés à la base de la vie psychologique et de ne pas y voir vraiment les humbles serviteurs de la pensée (Lhermitte) ».
Plissée en multiples circonvolutions, creusée de sillons profonds, l’écorce ou manteau se présente comme une gaîne continue de substance grise enveloppant les deux hémisphères et composée de six couches d’innombrables cellules nerveuses superposées et disposées en strates parallèles de la superficie à la profondeur. Les rangées neuroniques sont parcourues à diverses hauteurs par des faisceaux de fibres nerveuses qui se réunissent en stries parallèles ou perpendiculaires à la surface. Cette multitude série de formations cellulaires et fasciculaires ne se trouve pas répandue dans toute l’écorce d’une façon uniforme ; elle se divise au contraire en groupes bien tranchés, d’architecture anatomique et histologique particulière à chacun d’eux. Il a été possible d’identifier un grand nombre de ces territoires corticaux, que l’on a relevés en une véritable carte du manteau cérébral. Et l’expérimentation physiologique a précisé la fonction spéciale afférente à chaque territoire cortical. Pour y parvenir, elle emploie deux méthodes : l’excitation artificielle des territoires délimités par l’anatomie microscopique chez l’homme et les animaux ; l’étude des troubles consécutifs aux lésions spontanées chez les hommes et les animaux, et aux lésions provoquées chez les animaux.
Ainsi a été découverte une zone corticale sensible aux courants électriques, I’« aire précentrale », formée par une série de foyers bien distincts dont l’excitation électrique suscite des mouvements séparés non seulement pour les membres, la face et le tronc, mais encore pour chaque segment de ces organes et même, affirme Forster, pour chaque muscle isolé. Cette aire est sensible aussi aux actions mécaniques et chimiques. Mais le phénol demeure sans effet sur elle, tandis qu’il déprime l’excitabilité des cellules de la moelle épinière : preuve de la constitution physiologique différente des centres moteurs cérébraux et médullaires. ― Chez l’homme la destruction de l’aire précentrale n’amène pas la perte totale de la mobilité. « Seuls les mouvements les plus différenciés, les plus délicats, les plus humains sont atteints ; tandis qu’au contraire apparaissent exaltés les mouvements automatiques primaires dont les centres se situent dans les corps striés ».
L’« aire précentrale intermédiaire » ou « psychomotrice » est placée à côté de la précédente. Non excitable par le courant électrique d’expérimentation, elle ne commande pas les mouvements mais détermine leur coordination, leur adaptation à un but donné. La destruction n’empêche pas le malade de remuer ses membres, tout en lui enlevant la capacité de les utiliser pour accomplir un acte précis, volontaire ou commandé.
L’« aire postcentrale » a des fonctions exclusivement sensitives. L’excitation électrique de ses divers foyers provoque des sensations de choc, de chaleur, d’engourdissement dans les régions correspondantes des membres. La destruction abolit la sensibilité.
L’« aire postcentrale intermédiaire » ou « somesthéso-psychique » est à la zone précédente ce que la zone psycho-motrice est à la zone électro-motrice : un centre d’intégration supérieure surajouté à l’autre. La lésion ne supprime pas la sensibilité ; elle la rend confuse, trouble, erronée. La sensation persiste, mais la perception fait défaut. Ainsi, les yeux fermés, le malade sent un objet placé dans sa main, mais il n’en peut apprécier exactement ni le poids, ni le volume. Il s’apercevra qu’on le touche sans pouvoir déterminer le lieu de la pression. L’aire somesthéso-psychique apparaît vraiment comme la région de la « pensée sensitive ».
Cependant un objet peut être senti par la main, le poids et le volume en être appréciés, sans que le malade puisse le reconnaître, l’identifier. Les sensations sont perçues sans prendre leur signification, sans former image ; elles ne parviennent plus au seuil de la connaissance intellectuelle. Cette « agnosie tactile » suit la destruction de l’« aire pariétale », autre centre anatomique, matériel, spécial d’une fonction psychique bien déterminée.
L’« aire striée » ou « sensorio-visuelle » élabore les sensations fournies par la rétine. « L’expérience de la guerre, grâce aux lésions très limitées que produisent les projectiles, a montré l’exactitude parfaite de la projection rétinienne sur l’aire corticale visuelle en apportant de nombreux faits de cécité partielle de la surface de la rétine correspondant au point cérébral détruit par le projectile (Pierre Marie et Chatelin) ». Lorsque la destruction porte sur la totalité des deux aires striées, elle cause une cécité complète souvent ignorée du blessé lui-même. Contrairement à l’aveugle par lésion directe des rétines ou des nerfs optiques, l’aveugle par lésion de l’écorce cérébrale est aveugle pour sa cécité. « Ce fait s’explique fort bien si l’on se souvient que la vision du noir ne se confond nullement avec l’absence de sensations visuelles et que la sensation de noir répond à une clarté moins intense, laquelle n’apparaît que par contraste. Or, les sujets atteints par une lésion destructive de l’aire visuelle corticale sont absolument et à jamais privés de tout élément visuel sensoriel. Au contraire, les malades dont la cécité est d’origine périphérique gardent indéfiniment les éléments dont est faite l’activité sensorielle de leur cerveau et, en conséquence vivent dans la conscience des ténèbres extérieurs (Lhermitte) ».
A côté de cette cécité corticale, il existe, par lésion de l’« aire occipitale ou visuo-psychique », une cécité psychique : le sujet distingue les couleurs et les formes, mais ne peut identifier les objets.
Il y a quelques années, au début des études crânio cérébrales, les « lobes frontaux » passaient pour être la partie noble de l’encéphale, le siège de la plus haute pensée. Les recherches modernes n’ont pas confirmé cette conclusion exclusive. Chez les blessés de guerre, les mutilations de la zone frontale causent de la maladresse, de l’incoordination dans les mouvements, des troubles de l’équilibre et de l’orientation, de l’apathie et des défaillances de la volonté, de la difficulté à fixer l’attention volontaire, de la propension aux songes, à la rêverie. Comme le dit Pierre Janet, les lobes frontaux apparaissent, à la lumière des faits anatomocliniques, comme un des appareils essentiels, et peut être le plus important, qui règlent et soutiennent la tension psychologique.
La localisation sur le cerveau d’une « zone du langage » se montre particulièrement intéressante, très étudiée et très suggestive. C’est que le langage constitue la fonction psychique par excellence, celle qui permet d’exprimer ses sentiments, ses idées et de connaître ceux d’autrui. Les idées elles-mêmes sont une sorte de « langage intérieur » puisqu’elles se présentent à l’esprit sous leur forme verbale ; et si la parole n’est pas toute la pensée, puisqu’on peut penser par images, elle en apparaît la manifestation la plus importante. Comprenant la parole, l’écriture, la musique, le langage possède son centre spécial autour de la Scissure de Sylvius dans une région du cerveau bien délimitée par l’étude des lésions anatomiques correspondant aux divers troubles de la fonction du langage appelés « aphasies ». Chez les adultes, ce centre se situe pour le droitier sur hémisphère cérébral droit. Chez l’enfant, il n’existe pas avant la neuvième année, comme le prouve ce fait qu’aucune lésion, même profonde. de cette région du cerveau n’entraine de trouble du langage. Celui-ci n’est donc pas inné ; son centre, non préformé, ne se développe que sous l’influence de l’audition ; les sourds de naissance restent muets. ― Nouvelle réalisation, après des millions d’autres, de ce phénomène biologique général : l’organe créé par la fonction, elle-même déterminée par les interréactions de l’individu et de l’ambiance.
Parmi ces aphasies, l’observation attentive des sujets atteints a permis de dissocier des modalités caractéristiques et différenciées répondant chacune à une lésion précise d’une partie donnée de la zone globale du langage. ― Parmi ces variétés d’aphasie, il faut distinguer :
-
L’« aphasie de réception » ou perte absolue ou relative de la compréhension de la parole et de l’écriture (surdité verbale et cécité verbale). Le malade entend le son de la voix mais ne reconnaît pas le sens des paroles, voit les caractères imprimés sans en comprendre la signification. Il peut lui-même parler et écrire, mais d’une manière confuse, trouble, désordonnée, puisqu’il a oublié la valeur des mots.
-
L’« aphasie d’expression » ou « aphémie », perte de l’expression de la pensée verbale. Le malade est incapable de prononcer la plus grande partie des paroles et d’écrire aucun mot.
-
L’« aphasie globale », combinaison des deux précédentes : le malade ne reconnaît ni les sons ni les caractères ; ne peut ni parler, ni écrire, même au hasard.
Mais la maladie produit parfois des lésions encore plus limitées et par conséquent des troubles encore plus singuliers : la « surdité verbale pure », rare d’ailleurs, où le malade lit, écrit, parle, sans comprendre la signification des mots entendus ; la « cécité verbale pure », où le sujet saisit le sens des paroles, parle lui-même, écrit, mais ne lit ni ne se relit ; I’« aphémie pure », qui supprime la parole, les autres modes d’expression restant intacts ; l’« agraphie pure », où s’évanouit le don de l’écriture.
Chacune de ces aphasies se superpose à la lésion d’un centre anatomique exactement localisé à la surface des hémisphères cérébraux. Tous ces centres constituent donc le support organique de la pensée verbale. « Reliés et articulés entre eux, ces différents centres concourent, à l’état physiologique, par leur harmonieuse synergie, au développement de la pensée verbale ; et en eux repose le solide fondement sur lequel s’appuie, pour se développer en d’infinies virtualités, l’intelligence du langage, support de l’intelligence spéculative (Lhermitte) ».
L’étude des « amusies » ou troubles du langage musical a révélé l’existence dans le cerveau de centres spéciaux et distincts de ceux du langage verbal. « Lorsqu’un de ces centres vient à être altéré, il en résulte non pas la perte complète du langage des sons, mais l’abolition soit de la compréhension de l’écriture musicale (cécité ou alexie musicale), soit de la signification symbolique du rythme des tons et de la mélodie (surdité musicale), soit enfin de la faculté d’exprimer par le chant (avocalie) ou les instruments le sentiment musical (amusie instrumentale). Mais il y a plus, et il existe d’assez nombreux exemples qui attestent que la surdité musicale peut, elle-même, être dissociée. Chez tel sujet, la compréhension de la valeur symbolique des tons et de la mélodie demeure conservée tandis que la signification du rythme est perdue. Un malade observé par Forster, prend la marche funèbre de Chopin, dont le rythme est si expressif, pour une chanson ; un andante pour une valse. Un autre sujet ne saisit plus le sens du rythme de la valse, mais danse correctement quand on lui indique de quelle danse il s’agit. Inversement, la notion du rythme musical peut être intégralement conservée, tandis que celle des tons de la mélodie s’est effondrée. Deux sujets observés par Brazier furent pris subitement d’amnésie mélodique, le premier pendant un chant, le second pendant un concerto de piano. Il est des cas où, malgré la conservation de l’audition musicale et de la lecture des notes, l’expression musicale est abolie. Le cas de Charcot est resté célèbre, de cet exécutant qui capable de lire correctement la musique, était hors d’état de se servir de son trombone. Une malade, observée par Wurtzen, ne pouvait jouer à l’aide de la main gauche seulement, bien que les fonctions de compréhension musicale fussent conservées. Fait plus curieux encore, un sujet étudié par Finhelburg, capable de jouer du violon ne pouvait utiliser son piano (Lhermitte) ». Il y a donc un appareil mécanique et psychique de la fonction musicale, appareil monté pièce à pièce par l’éducation spéciale et que peut détruire en un coup un traumatisme ou une maladie frappant son support cérébral.
Il n’est pas jusqu’à la joie et à la tristesse, au rire et aux pleurs qui, déclenchés dans certaines maladies en dehors de toute cause adéquate, ne viennent démontrer l’existence « d’un mécanisme physiologique individualisé des expressions émotionnelles ». Les malades, lésés dans cet appareil, présentent un rire ou un pleurer spasmodiques en dehors de tout sujet de gaité ou de désolation : Or bien, « rire est le propre de l’homme » ; mais la pathologie prouve qu’il devient acte réflexe, animal, lorsqu’il est troublé dans son contrôle.
Dans la région ventrale du ventricule médian du cerveau on est parvenu à localiser un centre régulateur du sommeil et de la veille. Jusqu’alors, une opinion assez unanimement accréditée attribuait le sommeil à la fatigue et à l’intoxication du système nerveux. L’observation cependant plaidait contre cette explication, puisqu’il y a des gens qui peuvent réfréner leur envie de dormir, que d’autres dorment quand ils veulent, que beaucoup enfin peuvent se réveiller à une heure déterminée. Ces faits témoignaient déjà en faveur d’une « fonction du sommeil » en partie soumise à la volonté. La clinique confirma la réalité de cette fonction en précisant la zone cérébrale dont la lésion entraîne l’« hypersomnie », c’est-à-dire le sommeil prolongé, impérieux, irrésistible. Elle prouva ainsi que ce centre est un « appareil de veille » maintenu en activité par des stimulations externes ou internes, détendu sous l’influence de la fatigue, marchant au ralenti dans le calme de la nuit excité par des impulsions internes, supprimé par l’effet de certaines maladies génératrices de léthargie. Le sommeil se définit donc comme le repos du système nerveux supra-segmentaire exclusivement ; car, pendant sa durée, les réflexes segmentaires et intersegmentaires continuent à s’effectuer sans relâche, puisque le dormeur respire, retient l’urine, les matières et même peut agiter ses membres. Le rêve marque bien la persistance d’une vie psychique mais confuse, désordonnée, élémentaire. La pleine conscience exige l’intégrité et l’activité de tous les centres anatomiques rassemblés dans l’encéphale.
Les physiologistes contemporains ont émis l’opinion que le cerveau devait posséder, en même temps que le commandement de l’activité réfléchie, le contrôle des fonctions de la vie végétative et automatique : digestion, circulation, urination, défécation. Et en effet, l’expérimentation animale et la clinique humaine confirment la présence de deux centres distincts pour l’innervation de la vessie, et un centre pour l’innervation du rectum. L’excitation de certaines régions de l’écorce provoque des contractions de l’estomac et de l’intestin, et la destruction de quelques autres modifie les sécrétions salivaires et sudorales. Là réside la preuve de l’unité élémentaire, primordiale, du système nerveux de la vie psychique, l’axe cérébro-spinal, et du système nerveux de la vie organique et végétative, le sympathique. Corps et âme sont deux expressions consacrées par l’usage et conservées pour la facilité de l’étude, mais forment un seul organisme déterminé d’une façon identique dans son apparition, son développement et ses destinées.
Y a-t-il un « centre des centres » ; un « cerveau du cerveau » ; un régulateur des appareils psychiques intriqués, juxtaposés, superposés dans la masse encéphalique ; un substratum anatomique de la personnalité avec son intelligence, son caractère, son tempérament, avec ses réactions propres ? La logique biologique autorise à le croire et des recherches récentes tendent à le déterminer. Donnée curieuse et cependant rationnelle, ce centre ne se trouve pas sur l’écorce, mais à la base du cerveau, au carrefour où convergent et d’où divergent les voies issues des centres suprasegmentaires ou se rendant vers eux, dans cette région où se situent les centres de la vie organo-végétative. Il est le point de jonction, l’appareil de liaison entre les faits psychiques purs descendant de l’activité corticale, et les manifestations instinctives remontant des appareils inter-segmentaires et segmentaires. Là serait le siège de l’« âme », pour appeler cette chose par son vieux nom. En effet, une lésion portant à ce niveau produit des perturbations de l’humeur et de l’intelligence en même temps que des troubles dans les secrétions (menstruation, urination, fonction thyroïdienne).
Aujourd’hui, hardiment, on peut conclure. Le cerveau ne sécrète pas la pensée comme le rein sécrète l’urine, liquide excrémentiel, nocif rejeté hors de l’organisme. Mais il recueille, intègre, élabore les impressions venues de l’extérieur ou de l’intérieur pour les transformer en mouvements, sécrétions ou pensées, comme le tube digestif saisit, absorbe et assimile les aliments pour les transformer en travail et en chaleur. La phylogénèse en surprend la première apparition dans la cellule neuro-épithéIiale des cœleutérés (hydres et méduses) pour en suivre le développement progressif jusqu’à l’encéphale des Primates supérieurs, comme elle laisse voir le cytostome des Infusoires ciliés devenir graduellement l’estomac des Hominiens. L’ontogénèse montre le système nerveux de l’homme partir de l’état rudimentaire dans l’embryon, passer par la phase segmentaire et inter-segmentaire chez le fœtus pour s’épanouir en appareil supra segmentaire chez l’adulte. Organe différencié de la primitive irritabilité élémentaire, issue elle-même de l’action de l’énergie cosmique, le cerveau s’avère fonction du mouvement et facteur de mouvement. Il constitue une merveilleuse manifestation de la vie universelle.
― Dr F. ELOSU.
BIBLIOGRAPHIE :
VAN GEHUTCHEN. ― Les centres nerveux cérébro-spinaux. 469 p. (Uystpruyst Dieudonné, Louvain, 1908.)
LHERMITTE. ― Les fondements biologiques de la psychologie. 241 p. (Gauthier-Villars et Cie, Paris, 1925.)
PIÉRON. ― Le problème physiologique du sommeil. (Masson, 1913.)
PIÉRON. ― Le cerveau et la pensée. (Alcan, 1923.)
BÜCHNER. ― Force et matière. (Schleicher, Paris, 1906.)
CHAMBRE (LA)
n. f.
Diminutif par lequel on désigne une des deux assemblées législatives. Il y a en France deux Chambres : la Chambre Haute et la Chambre Basse. La Chambre Haute ou Sénat est composée de membres élus au suffrage restreint, et la Chambre Basse, ou Chambre des députés, qui tient ses assises au Palais Bourbon, est composée de membres élus au suffrage universel. Cette assemblée politique a porté, selon les époques, des noms différents. Après les Etats généraux de 1789, elle se dénomma Assemblée nationale, puis Assemblée constituante, ensuite Corps législatif et Chambre des représentants et, en dernier lieu, Chambre des députés. Si, dans les Etats despotiques, le pouvoir législatif appartient au monarque ou au chef du gouvernement ; dans les Etats démocratiques le pouvoir appartient aux Chambres législatives. C’est donc à la Chambre des députés et au Sénat qu’incombe la charge de faire les lois. En vertu même des principes qui régissent les démocraties et qui sont puisés dans les domaines de l’illusion, la Chambre ou Parlement (voir Parlement) agit au nom du peuple qu’elle représente et par qui elle est nommée ; elle est supposée défendre et soutenir, par l’intermédiaire de ses composants, les désirs de la majorité de la population, — ce qui serait déjà une erreur car les minorités seraient sacrifiées — mais en réalité elle est subordonnée à une infime minorité qui tire les ficelles et anime les pantins que sont les députés.
Notre ami Bertoni, dans son étude sur l’Abstentionisme (voir Abstentionisme) a signalé, d’une façon claire et précise, les raisons qui militent en faveur des thèses soutenues par les Anarchistes qui refusent de participer à la formation de ces repaires d’hommes indélicats et roués, que sont les assemblées législatives.
Et même, en supposant qu’au point de vue doctrinal, la Chambre soit vraiment issue du peuple, au point de vue pratique, au point de vue des faits, l’expérience a démontré l’inopérance d’une assemblée législative, et son incapacité à résoudre un problème social quelconque. Composée d’avocats sans cause, de médecins sans clientèle, de charlatans à la recherche d’une situation,d’êtres incapables et ambitieux, elle offre le spectacle de luttes oratoires stériles, où les représentants se déchirent en apparence, mais où tous sont d’accord pour tromper et leurrer le pauvre peuple. Il suffit d’avoir assisté quelque peu à des séances de la Chambre pour se rendre compte de son incapacité. En outre des lois qu’elle a le pouvoir de promulguer, c’est la Chambre qui à la charge de trouver les ressources de l’Etat et de contrôler les dépenses des gouvernements. On sait trop comment elle accomplit son devoir. Ce n’est pas elle qui nomme les gouvernants, mais ceux-ci, en vertu d’une coutume, qui fait force de loi, ne s’imposent jamais à une assemblée législative, et se retirent s’ils n’obtiennent pas un vote de confiance. Au nom de la république des camarades, elle fait et défait les ministères, afin que chacun de ses membres puisse, à tour de rôle, prendre place autour de l’assiette au beurre. Si la Révolution française déclara que « la loi est l’expression de la volonté générale, et que tous les citoyens ont le droit de concourir, personnellement ou par LEURS REPRÉSENTANTS à sa formation », elle ne se doutait pas que, par les vices mêmes qui sont à la base du régime démocratique, les représentants du peuple trahiraient et la loi et le peuple. Bien qu’ignorante des intérêts et des besoins de la collectivité, la Chambre entend s’occuper, non pas seulement politiquement, mais économiquement, de tout ce qui compose le domaine social. Elle discute, parlemente, légifère, avec la même impudence sur toutes les questions qui lui sont soumises. Jamais elle ne se déclare incompétente. Elle sait tout, elle connaît tout. En agriculture ou en pédagogie, en matière d’armement ou d’hygiène, elle ne se contente pas d’émettre un avis ou une opinion, elle se prononce, elle décide, et c’est ce qui explique qu’elle est toujours obligée de faire et de refaire des lois, qui ne répondent jamais aux nécessités sociales. Elle exerce parfois ses pouvoirs d’une façon tyrannique. C’est la Chambre servile de 1815, dénommée « Chambre introuvable » qui vota le bannissement des conventionnels ; c’est la Chambre de 1894 et 95 qui, par peur et par lâcheté, vota les ignobles lois « dites scélérates ». C’est la Chambre de 1914, qui se mit à plat ventre devant les conquérants ; c’est la Chambre de 1922 qui, durant 26 mois, se courba sous l’autorité du petit homme Poincaré ; c’est la Chambre de 1924 — Chambre rouge pourrait-on dire — qui est incapable de redresser une situation née du dernier cataclysme. La Chambre, c’est tout le mensonge, c’est toute l’erreur, c’est toute la corruption, toute la bassesse d’un régime qui se réclame du peuple et ne cherche qu’à l’asservir.
Et pourtant, elle est l’endroit sur lequel l’homme porte les yeux. C’est de là qu’il espère voir apparaître un jour, la liberté et la fraternité ! Par quelle aberration, par quel illogisme, l’individu peut-il encore croire en la valeur de ces assemblées qui ont donné des preuves suffisantes de leur inutilité ? Depuis plus de 75 ans que le peuple français nomme des députés, et qu’il est supposé diriger la chose publique ; depuis le temps que le parlement fait des lois qui devaient assurer son bonheur, qu’a-t-il obtenu de cette Chambre toute puissante, qui continue à régner en maîtresse, et n’apporte que des désillusions et des déboires ?
Combien de temps encore le peuple devra-t-il être trompé pour comprendre que la Chambre est une institution au service de la bourgeoisie et du haut capital, où se débat les intérêts d’une faible minorité qui spécule sur la bêtise des masses ? Il n’y a pas lieu pourtant de désespérer ; chaque jour la Chambre se discrédite un peu plus, et la confiance populaire se détache des assemblées législatives. Le nombre grandissant des abstentionnistes en est une preuve. Les temps sont proches où, balayés par le vent des révolutionnaires, les Chambres ne seront plus qu’un souvenir et les hommes conscients, éduqués se chargeront eux-mêmes de traiter leurs affaires.
CHANGE
n. m.
Troc d’une chose contre une autre.
Opération qui consiste à échanger de la monnaie d’un pays contre celle d’un autre pays, de l’or pour de l’argent. Prix auquel on accepte les devises des différents Etats par rapport à leur valeur-or. Change (lettre de). Mode de paiement employé de préférence par les personnes ayant des règlements à effectuer en pays étrangers. Les lettres de change évitent les déplacements onéreux de fonds et réduisent les opérations de banque. Dans le passé, le mot change n’éveillait pas dans l’esprit une idée capitale. Il ne représentait que les différentes opérations que nous venons d’énumérer. Le cours des changes n’intéressait que les milieux commerciaux, industriels et financiers. La grande masse de la population se désintéressait totalement de cette question qui paraissait plutôt d’ordre technique. Depuis la guerre, au contraire, le crédit et l’inflation, procédés ruineux auxquels tous les gouvernements ont dû recourir, ont porté cette question à l’ordre du jour et comme le prix du pain, du charbon, du sucre, du café, du coton, de la laine et de tous les objets de consommation et de première nécessité dépend directement du cours du dollar, de la livre ou du franc, tous, du banquier richissime à l’humble travailleur, s’intéressent passionnément à cette question des changes, car le mot change, de nos jours, éveille dans notre esprit des idées de bien-être relatif ou de misère noire. Examinons donc les causes de cette crise des changes, puisque probablement de longtemps (si le capitalisme s’en sauve), pareille crise ne se produira plus.
Le mal a son origine dans la guerre. Dépourvus de ressources et contraints à des dépenses prodigieuses, les divers gouvernements entrés dans le conflit mondial durent prendre, au petit bonheur, au hasard des compétences et des circonstances, toutes sortes de mesures toutes plus dangereuses les unes que les autres. La première de ces mesures consista à retirer l’or de la circulation et à décréter le cours forcé des billets de banque émis par l’Etat. Cette mesure étant générale aux principaux Etats, leur situation respective, par rapport à la situation d’ensemble, ne pouvait pas paraître désavantageuse. Cela permit d’attendre l’ouverture de crédit, car, la quantité de billets en circulation augmenta rapidement, dans la plupart des cas, de 400 à 500 %. Une deuxième mesure consista à émettre des emprunts aussi longtemps que l’on pu trouver des prêteurs. Ces procédés imposés par les nécessités de la guerre, ruinaient les Etats ; mais tous en étant au même point, cette opération n’agissait au détriment d’aucun d’eu ; seuls, les habitants de chaque pays continuaient à en supporter le poids ; car, entre temps, le coût de la vie avait augmenté dans la même proportion que la quantité de billets de banque. Chacun comptait sur la victoire de ses armées pour faire payer aux vaincus tous les frais de la guerre, comme cela était dans les coutumes depuis longtemps établies et toujours respectées. Les imbéciles qui faisaient faire la guerre n’avaient oublié qu’une chose : se rendre compte si le vaincu aurait la capacité de payer. Mais, malgré la haine idiote, la guerre s’arrêta ; les peuples reprirent une certaine indépendance économique ; l’élément des affaires l’emporta sur l’élément militaire et c’est alors qu’à la guerre tout court succéda la guerre des financiers pour la domination des grands marchés, du monde. La tuerie mondiale avait fait naître et se développer prodigieusement de puissantes industries qu’il fallait à tout prix ne pas laisser disparaître, sous peine de voir disparaître aussi les scandaleux profits. De là, de suite après l’armistice, partit la crise des changes. Il ne s’agissait plus de déterminer la richesse de chacun en tenant compte de ses bonnes intentions, il s’agissait de ruiner l’adversaire pour rester maître du marché de la production et des échanges. Les premières offensives furent dirigées contre les pays vaincus. Le mark et la couronne perdirent journellement des points. La spéculation réalisa des bénéfices formidables. L’Allemagne et l’Autriche furent littéralement vidées par le haut et le bas mercantilisme international, achetant, à l’aide de marks sans valeur tout ce qu’il était possible de revendre avec un bénéfice de mille pour cent dans les pays à change favorisé. Italiens, Français, Espagnols, Américains, Anglais, Belges, Suédois, Hollandais, Danois, Russes, Japonais, Chinois, et jusqu’aux Allemands eux-mêmes, tous les mercantis du monde participèrent, à la curée avec une égale frénésie. Cela aboutit à la ruine définitive et complète des Allemands et Autrichiens (1922–1925). Se voyant irrémédiablement compromis, les Allemands, de beaucoup plus puissants et conduits par des financiers habiles, surent exploiter cette situation désespérée, et ils réussirent à payer une bonne partie de leurs dettes en fabricant, intensément et aussi longtemps qu’ils purent les faire accepter, des billets sans valeur. Cela cependant n’alla pas sans provoquer des ruines innombrables, sans déterminer une crise économique effroyable, sans bouleverser de fond en comble le système des rapports sociaux établis, sans occasionner des misères terribles et des troubles dangereux. C’est lorsque ces troubles éclatèrent, et qu’ils jugèrent la situation trop critique, que les gouvernants allemands, soutenus par leurs anciens ennemis, décidèrent de rétablir une monnaie or afin de barrer la route à la révolution. Mais si le gouvernement allemand fut acculé à la faillite, l’Allemagne ne fut jamais ruinée. Ses richesses naturelles et industrielles avaient pris, pendant la crise, un essor considérable. Seuls, les petits épargnants, possédant quelques milliers de marks, se trouvèrent complètement ruinés après la banqueroute de l’Etat ; car les gros porteurs, très experts en la matière, avaient depuis longtemps mis leur avoir à l’abri. Ainsi on peut conclure que seuls, ces petits porteurs et les salariés qui, durant toute la crise, furent payés avec du papier sans valeur, supportèrent le poids des quelques centaines de milliards engloutis dans la catastrophe.
Contrairement à une opinion générale, les choses ne se sont pas passées partout comme en Allemagne. Non, une foule de petits Etats étaient trop faibles pour employer avec succès les procédés qui avaient réussi au Reich. Entièrement asservis au capitalisme international, la plupart de ces petits pays ne pouvaient tenter une restauration financière que dans la mesure où celle-ci servait les intérêts de ce capitalisme. C’est ainsi que l’Autriche ne put stabiliser sa couronne qu’avec l’appui d’un consortium de banquiers anglo-saxons créé à cet effet. Naturellement, de tels consortiums ne prêtent que contre des garanties de premier ordre, telles que l’exploitation des chemins de fer, des postes, monopole des tabacs, des allumettes, etc., etc., et cela, comme on le conçoit, ne va pas sans de sérieux désavantages pour l’ensemble de la population du pays qui doit accepter de pareilles conditions. Mais c’est là la rançon du capital et il faut la payer.
En 1926, d’autres pays, tels que l’Italie, la Belgique et la France, moins appauvris que l’Allemagne et plus puissants que les petits Etats qui ne peuvent sauvegarder leur indépendance, sont encore en pleine crise et à la recherche d’une solution satisfaisante. Le poids formidable de leur dette intérieure et extérieure, ajouté aux dépenses énormes qu’exige leur politique terriblement impérialiste, provoque une baisse continuelle et dangereuse de leur monnaie respective. A la suite de cette baisse, ces pays ont dû suspendre ou réduire leurs paiements. Cela n’a fait qu’aggraver la crise et c’est la course rapide vers la ruine. Mais de quelle ruine s’agit-il ? Pas de la ruine définitive de l’Etat qui, même après sa faillite, saura encore trouver ses moyens d’existence, mais comme toujours de celle des petits porteurs et des salariés qui ne pourront recourir à aucun moyen efficace pour se garantir contre la dépréciation.
Cependant, pour sauver les apparences, des efforts sont tentés. L’Italie, pour stabiliser son change, a signé des accords avec ses principaux prêteurs. Aux termes de ces accords, elle doit, pendant plus de soixante années, rembourser intérêts et principal, ce qui représente, étant donné l’importance des dettes, une dîme terrible à prélever durant plus d’un demi siècle sur le malheureux peuple italien. De façon que le travailleur de ce pays devra, durant sa vie entière, payer au financier international, la redevance que jadis il payait au seigneur. Mais peut-on au moins dire que ces accords ont amélioré la situation passagère en réalisant la stabilité momentanée des changes ? Non, car d’ores et déjà, on peut affirmer que le sort de la lire reste lié à la politique du gouvernement et qu’elle ne se maintiendra que dans la mesure où celui-ci pourra contracter de nouveaux emprunts pour souscrire aux engagements pris ; car, malgré qu’il soit saigné blanc, le peuple italien ne peut, à lui seul, fournir à l’Etat toutes les ressources dont celui-ci a besoin pour équilibrer ses budgets. Le sort de la lire reste donc indécis. Sur ce point, comme sur tant d’autres, le gouvernement fasciste se montre aussi impuissant que n’importe quel autre.
En Belgique, ce sont les socialistes qui ont tenté la stabilisation de la monnaie nationale. Dans ce but, ils ont négocié et obtenu une garantie de cinq milliards or. Forts de cette garantie, ils décrétèrent que le billet de cent francs ne vaudrait plus que X, mais que désormais, il serait, comme avant 1914, remboursable en or. Et c’est à l’aide de ce procédé que, durant quelques semaines, on parvint à arrêter la dégringolade du franc belge. Mais au dernier moment, les banques devant avancer les cinq milliards or y mirent de telles conditions que celles-ci furent jugées inacceptables. Et le franc belge reprit sa course vers l’abîme. La crise économique déterminée par les fluctuations constantes du change n’était pas atténuée. La solution socialiste (si toutefois on peut l’appeler de ce nom), aboutissait au même fiasco que la solution fasciste. En proie aux mêmes difficultés, au moment même où ces diverses tentatives de restaurations financières échouaient si lamentablement, la France, au lieu de rechercher un remède à ses maux, reste complètement désorientée, mais, sans pour cela renoncer aux dépenses fabuleuses qu’exige sa politique impérialiste. Elle attend, et cela semble devoir lui suffire ; toutefois, cela ne suffit pas à ses créanciers qui réclament et savent exiger des comptes, en faisant baisser sa monnaie. C’est ainsi que la situation prend un caractère subit de gravité.
Le franc qui, depuis 1920, ne perdait du terrain que pied à pied, descend brusquement à trois sous sur les places les plus favorisées. La crise économique vient doubler la crise financière. Des impôts accablants et toujours insuffisants contribuent largement à la hausse précipitée des produits. En quelques semaines, la puissance d’achat des salariés et des petits rentiers diminue de moitié, et les patrons et l’Etat, ne voulant rien entendre pour augmenter salaires et pensions, l’état de misère générale augmente chaque jour. Partout, à l’usine ou dans la rue, chez le vendeur et chez l’acheteur, il n’est question que du prix de la livre et du dollar. Cela peut-il durer indéfiniment ? Non ; il faudra bien trouver une solution quelconque. Attendre encore devient impossible. Que fera-t-on ? Décrétera-t-on que le billet de cent francs n’en vaut plus que de dix, mais qu’il sera remboursable en or ? Par ce procédé, dépouillera-t-on les petits des neuf dixièmes de leur avoir ? Etablira-t-on une nouvelle monnaie or, au risque de paralyser complètement le commerce et l’industrie ? Continuera-t-on, au contraire, la politique d’inflation, afin de ruiner totalement la petite épargne ? Peu nous importe. Entre ces procédés, également mauvais, nous ne voulons pas choisir : tous tentent à replâtrer un système périmé.
L’annulation des dettes, de toutes les dettes, le retour à une politique de sagesse et d’économie, la collaboration fraternelle des peuples pour l’œuvre de reconstruction des ruines, sont les seuls moyens propres à mettre un terme définitif à l’effroyable crise économique qui ravage le monde. Mais de cette solution, indiquée par le bon sens, égoïstes et aveugles, défenseurs maladroits des privilèges et des richesses mal acquis, les gouvernements ne veulent point entendre parler.
A première vue, il semble que la situation n’est pas aussi tragique que nous l’indiquons et que de pareils faits se sont reproduits sans inconvénients graves au cours de l’histoire. Cela n’est vrai qu’en apparence. La faillite de la banque de France sous Louis XV, la machine à fabriquer les assignats sous la Révolution française, les faillites des banques nationales de divers Etats d’Europe et d’Amérique ne dépassaient guère le cadre national et, l’auraient-elles dépassé, elles n’atteignaient jamais qu’un ou deux pays et ne troublaient jamais beaucoup la situation de I’ensemble. De plus, en ces temps lointains, les rapports internationaux étaient encore presque nuls. A cette époque, en l’absence de monnaie stable pour déterminer la valeur, on pouvait avantageusement utiliser le troc et cela se pratiquait d’ailleurs couramment, dans le commerce avec les Indes, l’Afrique et l’Amérique. Dans ces conditions, les fluctuations constantes du papier monnaie n’avaient aucune répercussion grave. En 1926, il n’en est plus de même. D’abord parce que la crise financière est générale, ensuite parce que la facilité des transports, la rapidité des relations, le développement prodigieux de la science, de l’industrie, du commerce ont créé des rapports et des besoins que nous sommes forcés de satisfaire. L’Europe, de nos jours, forme un ensemble plus compact et plus facilement pénétrable que la France de Napoléon ou une province sous Louis XIV. De là, la différence fondamentale entre la situation d’alors et celle d’aujourd’hui.
Au surplus, il faut ajouter que, vainqueurs ou vaincus de la grande guerre, tous ont également souffert de leur incommensurable folie ; c’est ainsi que les pays riches sont précisément ceux où le prolétariat est le plus misérable, parce que machines et usines s’arrêtent pour la raison bien simple que les actionnaires des grandes usines et des grandes industries préfèrent faire fabriquer dans les pays à change bas. Quant aux pays à monnaie dépréciée, ils sont littéralement mis au pillage par ces mêmes capitalistes qui rendent ainsi la vie impossible à ceux qui doivent y travailler et y vivre.
Ainsi le mal pénètre partout, il atteint tous les pays, mais nulle part cependant il ne frappe les privilégiés de la fortune : défiant le destin, ceux-ci peuvent toujours se mettre à l’abri du malheur. Partout, ces privilégiés s’opposent aux accords généreux, aux solutions intelligentes qui mettraient fin à une si lamentable situation. Comme les poux sont faits pour vivre dans la saleté, ils sont faits pour vivre des profits que leur rapportent l’exploitation et le gaspillage des deniers publics. Et, en dehors de la Révolution sociale, rien, absolument rien, ne peut nous débarrasser de ces parasites dangereux qui empoisonnent l’air que nous respirons.
— S. FÉRANDEL.
CHANSON
La chanson est une forme assez aimée des poètes. Elle est aussi une forme assez connue de la poésie pour que ne lui soit point contestée la place qu’elle mérite dans la littérature universelle des peuples.
La Chanson est populaire partout. Il n’est point de pays où elle soit ignorée. On pourrait même dire qu’elle est pour certains peuples l’unique littérature.
Les ignorants, les illettrés de partout — même s’ils ne savent chanter — aiment la Chanson.
Il est probable que la Chanson a devancé, dans certains pays, la littérature nationale. Mais on peut dire également qu’elle figure honorablement parmi, les chefs-d’oeuvre de la littérature de divers pays et particulièrement de la France.
N’est-il pas, en effet, de nos chansons françaises qui sont de parfaits petits poèmes par leur forme même, par leur expression heureuse, permettant de les interpréter sans musique bien qu’ils soient destinés à être mis en musique et à être chantés ? Evidemment, la Chanson réclame l’union intime de la musique, même si le rythme des vers semble pouvoir s’en passer. Une musique et une poésie bien adaptées l’une à l’autre se donnent mutuellement une valeur qui sont le charme même de la chanson.
Mais si, dans une œuvre littéraire, il y a, en plus de la perfection de la forme, le sujet qu’exprime cette œuvre, dans le petit poème qu’est la chanson n’est-ce pas le sentiment joliment exprimé qui en fait la valeur ?
Or, la Chanson est belle et riche quand elle sait exprimer l’état d’une civilisation ; quand elle évoque des événements ou des faits d’une époque ou d’une nation, d’une personnalité pu d’une région ; quand elle dépeint un état d’âme ; quand elle contribue à perpétuer les fastes historiques d’un règne, d’un peuple, d’une nation ou qu’elle les critique.
Et n’est-ce pas là, justement, l’origine de la Chanson ? Elle a devancé l’Histoire et suppléé la Presse.
La Chanson est une forme d’art qui, mieux que la peinture et la sculpture, nous donne la plus réelle image du passé tant on la sent intimement mêlée à la vie de ce qu’elle raconte ou rappelle, critique ou glorifie !
C’est la chanson, dans sa naïveté, qui nous a conservé fraîche et vraie l’image des mœurs d’autrefois et nous a tracé, en traits rudes ou fins, des caractères qui révèlent une époque et marquent les évolutions d’une race.
Dans nos vieilles chansons de France, pieuses ou gaillardes, c’est bien le visage du passé, c’est bien l’âme du peuple aux siècles antérieurs à celui que nous vivons qui se présentent à notre esprit et réveillent les souvenirs que nous pouvons avoir des lectures et des études où nous avons eu l’illusion de revivre le passé. La chanson souvent nous désillusionne de l’histoire en nous montrant, sous des traits plus caractéristiques, certains événements et certains personnages. La chanson française, pour peu qu’on- se plaise à l’étudier, nous montre bien la pensée populaire de la France. Elle nous la fait revivre à chaque époque de notre histoire, tantôt inquiète et fanatisée, tantôt sceptique et spirituellement moqueuse, enfin, tour à tour primesautière et profonde, mélancolique et passionnée et, au seuil de la grande époque révolutionnaire, passant soudain d’une chanson grivoise pleine d’insouciance à la menace des chants précurseurs du bouleversement de 1789.
La chanson populaire est celle qui reflète le mieux — même si elle s’éloigne des règles de la littérature proprement dite — par ses fréquentes évocations des caractéristiques du peuple, les états d’âme collectifs faits d’espoirs, d’amours et de joies qu’on aime tant dans les vieilles chansons. Bien souvent, ces chansons sont vraiment œuvres collectives. Il en est, dont on ne connut jamais le ou les auteurs. Cet anonymat est curieux. Ainsi, un bon bougre soupire ou sanglote et, pour se consoler, rime tant bien que mal sa peine ou son amour ; et voilà que sa chanson passe de bouche en bouche sans qu’on sache ni d’où ni de qui elle vient. Mais si, au lieu de l’homme saignant sa vie, c’est un autre, ivre de joie, vibrant d’espoir qui clame son bonheur devant une bouteille de bon vin, c’est encore une chanson qui se répand, s’enrichissant de termes nouveaux, d’images drôles et familières et d’un accent de terroir qui s’accordent et s’harmonisent aux rythmes consacrés, se transmettant aussi de bourg en bourg, de village en village, de ville en ville, de cité en cité, de province en province et devenant une chanson nationale se transmettant de siècle en siècle.
C’est bien la chanson populaire simple, rudimentaire, parfois puérile, souvent charmante, œuvre de tous et de personne, ne se transformant que pour mieux s’adapter, qui est venue jusqu’à nous et qu’on se plaît à entendre et à chanter soi-même. Est-ce un chef-d’œuvre ? Quelquefois. Par l’expression du sentiment, la chanson touche du coup la pure beauté littéraire.
C’est ce qui, sans doute, la faisait juger ainsi par Montaigne quand il écrivit : « La poésie populaire et purement naturelle a des naïvetés et grâces par où elle se compare à la principale beauté de la poésie parfaite selon l’art : comme il se voit ès villanelles de Gascogne aux chansons qu’on nous rapporte des nations qui n’ont connaissance d’aucune science, ni même d’écriture. »
Ainsi, en marge même de toute littérature, une chanson populaire peut atteindre au chef-d’œuvre par sa grâce, sa naïveté, sa fraîcheur, sa franchise.
C’est surtout du XVe siècle que nous viennent les chansons les plus accessibles à la compréhension actuelle de ce qu’on désigne, même parmi les amateurs le belles-lettres, sous le nom de gros ou grand public. Il est de fait que la période antérieure au XVe siècle nous fournit, certes, de belles chansons, mais il faudrait plus de texte à l’explication et plus d’annotations pour les rendre intelligibles qu’il ne faudrait de place pour les publier.
D’ailleurs, c’est au XVe siècle seulement que, non seulement en France, mais dans plusieurs pays de l’Europe, on vit la plus riche éclosion de la poésie populaire. Cette poésie, dit Gaston Paris, dans la préface à un recueil de chansons populaires, se distingue nettement de l’époque précédente. Elle est, ajoute-t-il, restée la base et le modèle de la poésie populaire qui a suivi et de celle qui se produit encore. Par une réaction remarquable, elle s’est dégagée à l’époque ou la littérature proprement dite est la plus éloignée de la nature, de la simplicité et du sentiment vrai.
Par le sujet ou par l’expression, les chansons du XVe siècle se rattachent bien à la tradition poétique antérieure. Bien que d’inspiration populaire, la forme de certaines d’entre ces chansons révèlent des poètes habiles et délicats dont les noms sont restés ignorés de nous. Toutes ces chansons du XVe siècle contiennent, mieux que celles des époques suivantes, une véritable poésie.en même temps qu’une image fidèle de ce siècle et de ses mœurs. Il faudrait, pour s’en convaincre, ayoir sous les yeux les chansons d’amour et les chansons satiriques ou historiques, ainsi que les pastourelles et les rondes dans leur variété. En voici une qui se chante sur un air qui est du XVe :
L’amour de moi s’y est enclose
Dedans un joli jardinet
Où croit la rose et le muguet
Et aussi fait la passerose ;
Ce jardin est bel et plaisant ;
Il est garni de toutes fleurs ;
On y prend son ébattement
Autant la nuit comme le jour ;
Hélas ! il n’est si douce chose
Que de ce doux rossignolet
Qui chante au soir, au matinet ;
Quand il est las il se repose.
Je la vis, l’autre jour, cueillir
La violette en un vert pré,
La plus belle qu’onques je vis
Et la plus plaisante à mon gré.
Je la regardai une pose :
Elle était blanche comme lait
Et douce comme un agnelet,
Vermeillette comme une rose.
Dans le même genre mignard, voici une autre chanson dont le premier vers fait aussi le titre :
Vrai Dieu, qui m’y confortera
Quand ce faux jaloux me tiendra
En sa chambre seule enfermée ?
Mon père m’a donné un vieillard
Qui, tout le jour, crie : « Hélas ! »
Et dort au long de la nuitée.
Il me faut un vert galant
Qui fût de l’âge de trente ans
Et qui dormit la matinée.
Rossignolet du bois plaisant,
Pourquoi me vas ainsi chantant,
Puisqu’au vieillard suis mariée ?
Ami, tu sois le bienvenu :
Longtemps ah ! que t’ai attendu
Au joli bois sous la ramée.
Toutes ces chansons du xv° siècle ont le même charme et l’on ne sait vraiment laquelle choisir pour en donner échantillon.
Je me garde bien de citer celles qui ont une tendance historique ou guerrière, mais dont l’originalité fait la seule valeur en dehors de la forme qui est bien celle de la chanson facile à retenir malgré son nombre considérable de couplets. Ce sont des sortes de complaintes ou plutôt les complaintes que nous connaissons semblent être une mauvaise imitation de ces chansons. Elles étaient un moyen de répandre la gloire de héros légendaires ou inconnus et de raconter les hauts faits de seigneurs et autres batailleurs, des époques où la presse n’existait pas, pour entretenir les peuples dans le mensonge et l’admiration de ce qu’ils n’avaient ni vu ni connu. Les trouvères et les troubadours étaient les auteurs et les interprètes de ces chansons populaires.
Mais la vraie chanson du XVe siècle est heureusement venue, souvent très courte, mais combien jolie, telle celle-ci encore :
Voici la douce nuit de mai
Que l’on se doit aller jouer,
Et point ne se doit-on coucher :
La nuit bien courte trouverai.
Devers madame m’en irai,
Si sera pour la saluer
Et par congé lui demander
Si je lui porterai le mai.
Le mai que je lui porterai
Ne sera point un églantier,
Mais ce sera mon cœur entier
Que par amour lui donnerai.
Ces spécimens de la chanson au XVe siècle peuvent donner une idée de la façon poétique de tourner un couplet et de former une chanson qui ne peut déplaire à quiconque aime la chanson pour elle-même.
* * *
Le chant populaire, au XVe siècle se développe avec une abondance telle que Rabelais, dans son Pantagruel en peut énumérer environ deux cents sur des airs populaires.
Parmi ces chansons, il en est de bien gaillardes. Elles n’en sont pas moins belles et ont alors un accent de franchise et de liberté qui compense leur libertinage.
Chaque province a fourni ses chansonniers et les chansonniers gaillards sont de partout. Ne contribuent-ils pas à donner au peuple de chaque siècle ce rayon de gaité qui lui fait oublier sa misère ?
La chanson se perfectionne durant tout le XVIè siècle.
Les airs populaires sont en faveur et cela donne naissance au genre de la « chanson musicale » où les airs connus, reproduits avec leurs paroles, servent de thème à de véritables compositions de musique, ordinairement traitées à quatre parties vocales par des musiciens de profession avec tous les raffinements du contre-point.
Nous sommes alors au temps des guerres de François Ier avec leurs gloires et leurs horreurs ; il y a dans tout le pays des bandes armées qui ravagent les villes et les campagnes du doux pays de France ; il y a les troubles affreux de la Ligue et d’autres calamités encore pour le peuple qui trime. Les chansons de cette époque évoquent souvent tout cela. Les poètes s’en inspirent en des poésies suggestives. Les chansonniers font de même et leurs œuvres ne sont pas sans valeur historique et littéraire. Au début du siècle, quelques chansons font bonne figure dans la littérature. Par exemple, il est des chansons charmantes qui ne sont rien de moins que des poésies signées du bon poète Clément Marot et qui sont réellement chantées. Des œuvres célèbres des poètes de la Renaissance sont de véritables chansons. On en possède les airs et elles furent très populaires et ne contribuèrent pas peu à la gloire des chansonniers dans maintes provinces de France. Toute la pléïade a contribué à la gloire de la chanson, comme la chanson a contribué à la leur. Ronsard, Rémy Belleau, Clément Marot d’abord ; Le Roux, de Lincy, Claude de Pontoux, ensuite ; puis, Gilles Durant, Desportes, Marie Stuart et Henri IV lui-même, sont les signataires de belles chansons du XVIè siècle, sans porter cependant le moindre préjudice à la chanson anonyme des XVe et XVIe siècles, la vraie chanson populaire.
Une fois encore, laissons de côté la chanson historique, trop longue pour être citée, et ne reproduisons que celle-ci, bien courte et bien belle, de Clément Marot :
Plus ne suis ce que j’ai été,
Et plus ne saurais jamais l’être :
Mon beau printemps et mon été
On fait le saut par la fenêtre ;
Amour, tu as été mon maître,
Je t’ai servi sur tous les Dieux :
Ah ! si je pouvais deux fois naître,
Comme je te servirais mieux !
Il y a encore celle de Ronsard, trop connue de nous et pas assez de tant d’autres :
Mignonne, allons voir si la rose
Qui, ce matin, avait déclose
Sa robe de pourpre au soleil
A point perdu cette vêprée
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vôtre pareil.
Las ! voyez comme en peu d’espace,
Mignonne, elle a dessus la place,
Las ! las ! ses beautés laissé choir !
O vraiment marâtre Nature,
Puisqu’une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au, soir !
Donc, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que votre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté
Cueillez, cueillez votre jeunesse :
Comme à cette fleur, la vieillesse
Fera ternir votre beauté.
Le dix-septième siècle est celui où l’on a beaucoup chanté, paraît-il, dans toutes les classes de la société. Dans l’aristocratie on cultiva le chant. Les airs vont avec les paroles ; ils sont « précieux », et affectés à la cour.
Ce genre maniéré n’est pas celui du peuple, qui conserve à la chanson son allure gracieuse et libre, se ressentant pourtant des chansons de la cour et de celles du Pont-Neuf ; Celles-ci étaient souvent fort grossières, mais toujours satiriques et elles valaient à leurs auteurs des ennuis judiciaires — comme aujourd’hui un article de journal d’avant-garde en vaut à son rédacteur.
A cette époque, s’épanouit la Brunette genre de chanson galante et champêtre sur des thèmes de tradition populaire, mais les couplets en sont soigné stylisés ; pourtant, ils gardent leur primitive naïveté.
C’est le siècle de Malherbe et de La Fontaine ; c’est celui du pauvre Scarron ; c’est celui de Bussy, Rabutin et de Haguenier ; puis, encore, de Marigny et de Quinault ; de Coulange, Chaulieu, Regnard, Lainez, La Fare, Fontenelle, Dufresny, etc., etc.
Autant de poètes semblent vouloir concurrencer les chansons si populaires que sont les brunettes, les rondes et les légendes mises en couplets par tant d’anonymes aussi glorieux qu’inconnus, car ils sont le Peuple lui-même chantant ses chansons. Le Peuple est chansonnier, sachons-le ; sa production est féconde et traverse les âges. Il nous a chanté et nous chante le Passé pour nous distraire, nous instruire et nous réconforter. Il chante le Présent et il chante l’Avenir, traduisant nos espoirs, nous entraînant vers nos destinées. Il chante toutes les ivresses de la vie, mais il chante aussi l’Histoire dans ses événements les plus douloureux et les plus héroïques..
C’est ainsi que le dix-huitième siècle, malgré les tendances si diverses qui se partagent l’âme française, se trouve exprimé tour à tour par la chanson. Ce sont d’abord les chansons de tendresses bachiques ressemblant assez aux contes licencieux de certains écrivains de la cour du roi Louis XV. Il y a de l’esprit, de la sécheresse de cœur, du scepticisme.
Piron, Collé, Gallet, Pannard, tous les chansonniers du Caveau rivalisent de verve, de gaîté, de malice.
Puis, c’est la romance qui traduit la sensiblerie ambiante du Trianon avec ses bergeries.
Mais voici maintenant, se faisant la traductrice fidèle des sentiments populaires, la chanson enthousiaste, menaçante, vengeresse qui accompagne le Peuple sur la route ouverte à son affranchissement par la Révolution Française.
Voilà que, subitement, les chansonniers libertins, buveurs, paillards se découvrent une mission sacrée d’entraîneurs, de susciteurs d’énergie, d’apôtres d’une foi nouvelle. Ils traduisent en chants les plus beaux sentiments d’émancipation humaine exprimés par les philosophes au cours de ce grand siècle et de ceux qui l’ont précédé.
Les chansons frivoles se taisent. On oublie : « II pleut, il pleut, bergère », de Fabre d’Eglantine, pour ne plus chanter que la Marseillaise, de Rouget de l’Isle. C’est la Révolution !
Les idées sociales vont naître, puisque les idées politiques sont en pleine maturité. Ces idées révolutionnaires qui se sont manifestées par la Chanson vont continuer. Les chants révolutionnaires maintenant ne disparaîtront plus de la chanson française. Le dix-neuvième siècle en sera tout imprégné malgré les secousses politiques de réaction produites pour ramener le Peuple au bon temps de la Monarchie absolue. Ce ne sera pas le siècle de la Révolution, ce sera celui des révolutions.
Cela n’empêchera pas les chansonniers du Caveau de renaître, ni Béranger, après Désaugiers, d’entretenir la Chanson française.
La chanson populaire est plus que jamais représentée en ce dix-neuvième siècle. Béranger fait sa propagande républicaine par le Roi d’Yvetot. Et Bérat, égale Chateaubriand par Ma Normandie.
Pierre Dupont chante Les Sapins, Les Bœufs, le Chant de l’Ouvrier. Puis, Xavier Privas fait aimer l’Amour et la Beauté en chantant la Bonté. Viennent alors les chants révolutionnaires, écrits avec des larmes et du sang, par de véritables poètes qui sont du Peuple et veulent, avec une conviction farouche, son bonheur intégral par la Révolte collective des prolétaires ! Il est bien difficile de faire un choix parmi tant d’oeuvres et de chefs-d’œuvre de la Chanson contemporaine.
Aussi, résumons-nous.
La chanson n’a d’autre genèse que celle expliquée en ces quatre vers par un poète chansonnier, nommé Ernest Chebroux :
Un Dieu dut t’envoyer sur terre
Pour faire oublier la misère
Dont le genre humain est doté.
De tout temps, répétons-le, les hommes ont chanté. Les plus doux sauvages des temps anciens et des régions inconnues comme les plus barbares civilisés de la plus haute antiquité ont certainement exprimé leurs sentiments par des accents rythmés sur des tons plus ou moins harmonieux. On peut croire et dire, avec Julien Tiersot, que « la chanson est la première forme sous laquelle les peuples ont conçu la poésie et la musique ». Et l’on peut ajouter, avec Georges Normandy, « que non seulement vers et mélodie sont nés ensemble d’une même inspiration, engendrés en quelque sorte l’une par l’autre », mais encore que la chanson n’a pas été inventée et qu’elle est née toute seule, avec le sentiment dans l’animal humain, sous toutes les latitudes et à toutes les époques.
Les Peuples se sont rués les uns sur les autres en chantant de rauques chansons. Leurs chefs guerriers ont été déifiés par la chanson, comme au cours des siècles ils ont été critiqués, menacés, exécutés en chantant.
La Chanson a gouverné. On a pu dire qu’en France l’ancien gouvernement, déchu par la Chanson avant de l’être par l’action, fut « une monarchie absolue, tempérée par des chansons ».
La Fronde fut connue du Peuple et entretenue par la chanson.
Les femmes du peuple s’en furent à Versailles en chantant, pour ramener à Paris affamé le Boulanger, la Boulangère et le petit Mitron.
La chanson a évolué avec le Peuple. Elle est toute la poésie de l’évolution du Peuple et l’on peut dire que si les mœurs ont influé sur la chanson, celle-ci a également influé sur les mœurs.
La Chanson accompagne toujours le Peuple dans son évolution. C’est elle qui note et traduit les sentiments, les colères et les révoltes du Peuple.
C’est elle qui exalte ses espoirs et lui fait marquer le pas sur le chemin de son émancipation. Elle pleure, chante, rit, gronde avec lui. Elle est fille des grands cœurs et des beaux esprits.
Elle est gaie, elle est triste, selon les variations humaines puisqu’elle est la compagne fidèle du bon Peuple qu’elle berce, qu’elle encourage, qu’elle anime, qu’elle instruit.
Les bons chansonniers ont raison de vouloir que la Chanson du Peuple soit au Peuple, car le Peuple l’aime. Il est né avec elle ; il a grandi, lutté avec elle.
Le Peuple et sa Chanson, c’est l’avenir.
Georges Yvetot.
CHANTAGE
n. m.
Manœuvre qui consiste à abuser de la confiance de quelqu’un, et à lui extorquer des fonds sous la menace de révéler des secrets qui peuvent lui être préjudiciables. Le chantage est un acte indélicat au plus haut point et avilit celui qui en use. Il est cependant entré dans les mœurs de la vie courante, et s’il constitue un délit puni par les tribunaux, il est surtout pratiqué sur une grande échelle par ceux qui prétendent être les défenseurs de l’ordre et de la morale.
Toute la presse bourgeoise vit de chantage. Chantage individuel, collectif, national, diplomatique, politique. Que de journaux puisent le plus clair de leurs ressources dans le chantage ! Il leur suffit de connaître ou de soupçonner les dessous d’une affaire financière véreuse, un traité diplomatique de nation à nation que les gouvernants intéressés veulent garder secret, les vices ou les travers d’un homme politique influent, pour qu’immédiatement, sous la menace de révélations scandaleuses, on fasse chanter les intéressés.
Que de drames, que de crimes, que de réputations salies, que de vies brisées ont été déterminés par le chantage ! Il n’y a pas grand-chose à faire pour se défendre contre lui, car le maître chanteur est un être sans scrupule pour lequel la fin justifie les moyens, et l’oreille populaire écoute plus facilement la calomnie que la raison. Engendré par la boue capitaliste, le chantage exerce une puissance formidable et pénètre partout. Il faut le combattre comme toutes les armes jésuitiques et s’éloigner des individus assez malpropres pour s’en servir.
CHARITE
n. f.
Les deux premiers sens indiqués par Littré sont :
-
« Amour du prochain » ;
-
« Acte de bienfaisance, aumône »,
Pour que la seconde signification ait pu dériver de la première, il a fallu que l’idée d’amour, alourdie d’on ne sait quoi de grossièrement protecteur, glissât un peu bas le long du concept de pitié. Aujourd’hui, la charité — parfois on précise et on dit la charité chrétienne — n’est plus nommée qu’avec dégoût par les êtres un peu dignes. Ils ne veulent ni la recevoir humblement ni la faire dédaigneusement. Pourtant, ce mot qui sent la soupe distribuée aux portes d’un couvent, fut beau et parfumé en sa prime jeunesse. Charité découle du grec charis, comme le nom même des Grâces, ou, pour répéter nos poètes du XVIème siècle, des Charites. Avant d’être rendu nauséeux par l’abjection chrétienne, il disait non la pitié mal penchée, le secours dédaigneux et l’inégalité dégradante pour le bienfaiteur comme pour le protégé, mais l’amour d’autrui avec son cortège de sourires ravis, de charmes émus, d’attentions discrètes. Dans ce premier sens, il est la création des stoïciens. Cicéron nous explique comment ils opposaient la vaste « charité du genre humain », caritas humani generis moins aux amitiés choisies et exclusives des épicuriens qu’à la défensive et offensive solidarité civique vantée par les péripatéticiens et les autres esclavagistes. A l’odieuse formule d’Aristote : « L’homme est un animal politique », ils opposaient la vraie maxime de large et égale charité : « L’homme est, par nature, ami de l’homme ».
Certains mots ont traîné, hélas dans trop de boue pour qu’on les puisse laver. Comme au sac d’une ville meurt la femme violée par trop de soldats, les chrétiens ont tué de trop de souillures un terme qui fut souriant et profond, que nul effort ne fera revivre.
— HAN RYNER.
CHARLATANISME
n. m.
User de ruses et d’artifices pour exploiter la crédulité publique et s’attirer la sympathie ou la confiance des foules. On appelle « charlatans » les opérateurs, les droguistes, les « dentistes » qui, sur les places, les marchés et les foires, débitent des paroles et surtout des produits de provenance et d’efficacité douteuses.
Il est des charlatans plus dangereux et, naturellement, mieux cotés. On les rencontre dans les académies, les officines, les laboratoires et les parlements. Ceux-là jouissent de l’estime publique.
La médecine, qui devrait être une science au service de l’humanité, n’est souvent que du charlatanisme. Le pauvre malade, animé par l’instinct de conservation se laisse facilement convaincre par tous ceux qui spéculent sur la santé d’autrui, et lui assurent la guérison et c’est ce qui explique le succès du charlatan qui trouve toujours des dupes.
Dans les prétoires, dans les cours de justice, ce sont les avocats, ces « défenseurs de la veuve et de l’orphelin », qui prennent la place du charlatan médical. Le pauvre bougre qui est pris dans les mailles de la justice est une proie facile, qui ne cherche qu’à être convaincu, et les belles paroles de l’homme de loi brisent toutes ses hésitations.
C’est aussi à l’église que s’exerce le charlatanisme et c’est ensuite sur les tréteaux électoraux où les candidats menteurs et sans vergogne promettent n’importe quoi et à n’importe qui, pourvu qu’ils obtiennent les suffrages des électeurs abasourdis et grisés d’illusions.
Combien sont inoffensifs les petits camelots qui débitent leur marchandise sur les places publiques et, tout en vivant modestement, ne font de tort à personne, à côté de ces charlatans légaux qui accomplissent leur besogne à l’abri des lois !
Dans une société où tout se vend et tout s’achète, il est normal de considérer le charlatanisme comme une qualité et il n’y a pas lieu de s’étonner de la place qu’il prend dans la vie sociale.
CHARNIER
n. m. (du latin carnarium ; de caro, carnis, chair)
Anciennement, cimetière. Endroit dans lequel on enterrait ceux à qui leur fortune permettait d’être séparés du commun des morts. Aujourd’hui, le mot n’est plus usité dans ce sens, mais sert à désigner un amas de cadavres, consécutif à une catastrophe, un cataclysme ou une guerre. Le mot charnier est entré dans le langage courant pour symboliser les effroyables catacombes issues des horribles carnages, tueries et massacres en masse qui caractérisent plus spécialement les guerres.
CHARPENTIER
L’antérieur rudimentaire coupeur de bois, le bûcheron, charpentier primitif, est le plus ancien artisan qui employa le bois brut aux huttes et aux simples usages, plus tard aux constructions, en l’équarrissant et en le joignant par des assemblages. De vieilles images et gravures imaginatives représentent quelques constructions et des intérieurs ; mais ce ne sont pas des documents positifs des choses telles qu’elles existèrent, comme se le sont imaginé des illustrateurs. Les vieux écrits gravés sur la pierre des asiatiques et des égyptiens nous renseignent un peu mieux ; ils indiquent que les charpentiers exécutèrent, avant les civilisations grecques et romaines, de sérieuses constructions en bois. Il en est de même des époques gallo-romaines et gallo-françaises qui ne nous laissent aucune attestation en bois ; nous ne sommes renseignés que par de vieux parchemins, qui marquent que les maisons royales, romaines et gauloises, occupaient des charpentiers pour la construction et l’entretien des ouvrages divers : ponts, bateaux, faîtages, portes, bancs, charrues, chariots, roues d’une seule pièce, etc. Après Dagobert la documentation écrite est plus précise et depuis Charlemagne le charpentier est affirmé dans sa science.
L’époque romane nous laisse, supposer que les entrées des temples et des édifices avaient des portes en bois, que des poutres et des arbalétriers en soutenaient les parties. Les vestiges des XIIème et XIIIème siècles montrent que le travail du charpentier dans les pays de l’Europe Centrale et Occidentale a peu progressé depuis les premiers siècles. Le bois est encore et presque entièrement équarri et travaillé à la cognée et à la hache. Il faut arriver au XIIIème siècle et au gothique pour avoir des pièces de bois rongées par le temps qui nous renseignent sur le charpentier avec des outils transformés qui permettent de raboter, équarrir, assembler, moulurer et sculpter. Les maisons en bois du XVème siècle qui existent encore dans les vieilles villes, attestent qu’à la fois la science et l’art de la charpente atteignirent un développement considérable, qui se continua dans les beaux travaux des cathédrales, des châteaux et des maisons civiles de la Renaissance. Puis, les métiers se différencièrent, se spécialisèrent ; le charpentier abandonnait en partie la gouge et les petits outils au menuisier, pour ne construire que les combles, les escaliers, les encorbellements et les échafaudages qu’utilisaient les tailleurs de pierre, maçons, sculpteurs. Depuis 1850 où la charpente en fer fut employée aux petites et aux grandes constructions, la technique de l’ouvrier charpentier est en décroissance. Les syndicats y suppléent dans une louable mais trop faible mesure en créant des cours professionnels, afin que l’ouvrier ne soit pas ravalé aux degrés inférieurs, et que le simple levageur et monteur puisse connaître les secrets scientifiques, que se réserve de plus en plus l’élite des techniciens, fils de bourgeois qui poursuivent leurs études jusqu’à 18 et 20 ans.
Les classes inférieures des sociétés gallo-romaines, gallo-franques et du Moyen-Âge étaient tenues dans une servitude dont s’affranchirent sur plusieurs points les corps de métiers des tailleurs de pierre et des charpentiers. Du Vème au XIIIème siècle, dans la société féodale, le roturier payait au Seigneur une redevance pour la terre à laquelle étaient attachés les serfs de la glèbe qui ne pouvaient librement disposer de leur personne, ni s’éloigner du domaine du maître roturier.
Au Xème siècle, dans les châteaux féodaux et dans les abbayes, des fermes et des ateliers se créèrent pour construire et entretenir les bâtiments et le matériel ; les charpentiers y eurent leur place.
C’est au Moyen-Âge que les corps de métiers s’organisèrent sous la direction des pontifes ; ils acquirent une indépendance relative, toute religieuse, hors de la Seigneurerie de laquelle ils dépendaient. Dès le XIIème siècle, les charpentiers ainsi que les tailleurs de pierre menèrent une vie nomade, voyageant en troupes pour construire des ponts, des églises, des maisons, des châteaux, etc. Le compagnonnage affirma l’esprit de corps et eut pour résultat de soustraire les charpentiers à la servitude, en créant l’émulation dans le travail. Le compagnonnage fut une force qui marqua alors une ère de progrès ; il se divisa vers 1400 à la construction des tours de la cathédrale d’Orléans ; il y eut, alors, des batailles entre les compagnons partisans de l’un ou de l’autre des deux architectes qui dirigeaient les plans. Ceux qui ne voulurent pas se soumettre et qui furent obligés de fuir dans la Loire sur des gavautages, se dénommèrent les Gavots, ceux qui restèrent furent les Devoirants ou du Devoir. Chez les charpentiers ces deux ordres tinrent étroitement toute la corporation jusqu’au milieu du XIXème siècle, où fut fondée une société compagnonnique indépendante qui mit fin à une partie des rites et des secrets, tout en conservant un esprit rétrograde vis-à-vis des profanes non affiliés. Jusque vers 1860, les maîtres charpentiers patrons, n’embauchaient que les compagnons affiliés à leur rite respectif ; dans les villes où les patrons étaient tous du même ordre compagnonnique, le compagnon d’un autre rite ne pouvait s’embaucher ; aussi il y eut des luttes meurtrières entre les compagnons.
Par la religiosité du compagnonnage, les ouvriers étaient dociles et soumis à l’autorité patronale. Même dans le compagnonnage, la hiérarchie existait, l’apprenti n’avait pas le droit de manger à la table des compagnons ; s’il était reçu compagnon, deux parrains étaient responsables de sa conduite vis-à-vis des patrons et de la mère qui était l’hôtesse désignée où il logeait et prenait ses repas. La soumission qui longtemps empêcha toute idée d’émancipation et de révolte contre l’autorité fut très funeste à I’esprit novateur ; c’est ainsi que jusqu’en 1880, la corporation des charpentiers fut en retard dans le mouvement d’émancipation sociale.
D’abord labeur simple, primitif, naturel, le travail du charpentier avec les nécessités et les besoins nouveaux se développa et devint une science de calcul et de géométrie : étude de la résistance sous le poids et les différentes pressions, tracé de géométrie descriptive pour les nombreux assemblages des pans, des limons d’escaliers, des arbalétriers, etc. La science compliquée du charpentier jointe à la pratique, presque jusqu’à la fin du XIXème siècle, fut exigée pour avoir le droit de compagnon (ouvrier accompli). Elle tend de plus en plus à disparaître chez les manuels, qui ne sont en général que des monteurs-levageurs. Maintenant le tracé est fait par des techniciens qui sortent des écoles centrales d’arts et métiers ; la mise au point, faite par des spécialistes, est exécutée avec Ies machines à bois qui remplacent le travail à la main pour le planissage, le découpage et les assemblages. L’ouvrier charpentier relégué de plus en plus au rang de simple manœuvre, a le devoir de connaître la technique du travail qu’il met debout. Face à la science d’une caste qui l’oblige à n’être qu’automate, il doit chercher à savoir ce que les conducteurs ont appris aux Ecoles. Ces connaissances jointes à celles de la sociologie qui incite l’homme à se connaître lui-même et à désirer l’égalité sociale dans le Beau, dans le Bien-Etre par l’universelle fraternité, l’empêcheront d’être la brute, esclave salarié, que les capitalistes, maîtres de l’heure, croient avoir indéfiniment à leur entière disposition et qu’ils dominent par la puissance de la chose fictive et volée : l’argent.
Le travail uni au savoir est seul positif et substantiel. Il ne sera libéré que par les individus conscients, révolutionnaires qui démoliront les préjugés et les tutelles du vieux monde.
— L. GUÉRINEA
CHARRON
Le charron est l’artisan qui construit les véhicules pour transporter des charges diverses : chars, voitures, tombereaux, charrettes, camions, brouettes ainsi que les charrues. Ce que l’on connaît de plus ancien c’est le char. Suivant les écritures bibliques le roi Salomon s’en servit ainsi que les Assyriens. Les Grecs et les Romains en avaient pour leurs jeux olympiques. Il est évident que le métier spécial n’existait pas à ces époques, les ouvriers du bois en général façonnaient les chars et les charrues. Ça n’en est pas moins là qu’il faut trouver les primitifs charrons. Plus tard, en Grèce et à Rome, les transports se firent avec des voitures à deux roues ; les gallo-romains en eurent à quatre roues, on continua avec des variantes d’utilité ou de luxe jusqu’au XIIème siècle. Au XVème siècle c’est la voiture à quatre roues, puis le carrosse suspendu qui commence. Au XIXème siècle ce sont les petits omnibus, les diligences et les chemins de fer. Au XXème siècle, les tramways, autobus, métros et les automobiles de toutes sortes qui remplacent de plus en plus la force animale pour la traction. Au XIIIème siècle le charron est classifié dans les divers métiers, le travail de la voiture se perfectionne et exige des connaissances spéciales. Les bois les plus employés furent le charme, le frêne, I’acacia, l’orme, le hêtre, le chêne, à la fois durs et résistants.
Comme tous les métiers du bois, depuis 1870, le charronnage s’est divisé en spécialités : ouvriers de la roue ; de la carcasse, du train, des brancards, etc. Ceux de la voiture sont les menuisiers en voiture. L’automobilisme supplante en grande partie ces spécialités ; le métal est substitué au bois dans l’ensemble et dans les roues. Le compagnonnage y eut les mêmes influences que dans les métiers du bâtiment ; techniquement l’étude du dessin n’y fut pas très développée. Ce fut un métier de gros efforts et de fatigue, les buveurs s’y comptaient nombreux et longtemps les salaires furent inférieurs à ceux dès autres corporations du bois. Le syndicat des ouvriers de la voiture réussit avec beaucoup de peine à faire un peu monter les salaires. L’heure, depuis 1880, s’est stabilisée à 0 franc 70, vers 1900 à 0 franc 80 jusqu’à la guerre de 1914. Les carrossiers-menuisiers en voiture eurent un salaire supérieur de 10 et 15 centimes à celui des charrons. A présent, l’automobile remplace de plus en plus les voitures de toutes sortes et crée des spécialités nouvelles.
— L. G.
CHARTE
n. f.
Dans le langage courant : pacte qui consacre les privilèges, les prérogatives, les attributions, d’un individu, d’une collectivité ou d’une société. Contrat qui stipule le rôle d’une association ou d’une organisation. Ce mot n’a pas toujours eu le sens qu’on lui prête actuellement. Dans le très lointain passé il était synonyme de prison publique ou privée. Au temps où la seigneurie était toute puissante et avait des pouvoirs très étendus, le seigneur n’avait aucun scrupule à détenir quelqu’un en « charte privée », c’est-à-dire sans avoir recours à la justice pour condamner le prisonnier. Par la suite, ce mot désigna les actes de la grande chancellerie qui attribuaient un droit perpétuel, tels que les édits, les lettres de grâce émanant du pouvoir royal. C’est en vertu de chartes que les bourgs qui, avant Louis le Gros de France, étaient asservis à la seigneurie, obtinrent certaines libertés. Ce n’est pas par amour du peuple que la royauté par ses chartes lui accorda certains privilèges mais simplement pour dominer plus facilement la noblesse et le clergé. La première charte de commune fut accordée à la ville de Laon par le roi Louis XV qui avait besoin d’argent. Vint ensuite le tour de la ville d’Amiens, et petit à petit presque toutes les villes et bourgs de France obtinrent leur « Chartes de Communes ». Si les chartes laissaient aux communes une certaine liberté d’organisation intérieure, les habitants étaient, en échange des privilèges accordés, obligés de payer, moyennant finance, la liberté accordée par le roi. De plus, en période de guerre, il leur fallait fournir un certain contingent d’hommes d’armes. Néanmoins la charte fut le premier pas vers la libération des serfs, et lorsque plus tard la royauté, effrayée de l’agitation qui régnait, voulut retirer aux communes les dons dont elles avaient été gratifiées, ce fut en vain. La lumière avait pénétré dans les consciences et il fut impossible de l’éteindre.
Le mot charte, n’est plus de nos jours usité au sens politique. Les contrats qui règlent la vie, les droits, les devoirs des citoyens dans un pays sont des constitutions. Les peuples naïfs ont cru qu’en supprimant le mot, ils supprimaient les causes et les effets, et si les chartes furent des édits royaux, violés lorsque les besoins ou les désirs du monarque l’exigeaient, les constitutions qui sont des chartes nationales, ne sont pas plus respectées par les gouvernements démocratiques modernes, lorsque la cause de la bourgeoisie et du capital sont en jeu. Il n’y a aucune charte qui puisse concilier les intérêts opposés du Capital et du Travail. Il n’est pas de contrat possible entre des éléments dont les buts poursuivis sont si différents et vont à l’encontre l’un de l’autre. Dans le mouvement social et syndical, on a donné le nom de charte, aux motions qui stipulaient les buts poursuivis par le prolétariat et les moyens à employer pour assurer sa libération. La plus célèbre est la charte d’Amiens élaborée en 1905 par le Congrès national des organisations ouvrières et qui aujourd’hui encore sert de base à tout le mouvement syndical qui refuse de se laisser subordonner par les partis politiques. (Voir : Confédération Générale du Travail.) Hélas ! Si, au point de vue politique, une constitution ou charte nationale peut être violée, grâce à la veulerie de la population : sur le terrain syndical, la Charte d’Amiens — qui, pendant près de 80 ans fut le flambeau éclairant le mouvement ouvrier français — fut violée à son tour par ceux qui auraient dû en faire respecter les attributions. Le sentimentalisme des uns, l’ambition des autres, l’ignorance de la grande majorité et la faiblesse de tous permirent cette ignominie. La Charte d’Amiens est devenue lettre morte, respectée par personne, et la classe ouvrière, déchirée, arrachée, simple jouet entre les mains des politiciens, vogue à la dérive. Une charte est inutile si elle n’est pas l’émanation d’une conscience, capable de la respecter. Elle est un vulgaire chiffon de papier que l’on commente, que l’on discute et que l’on déchire, si elle n’a pas pour la soutenir et la défendre la force morale et intellectuelle de ceux qui l’ont élaborée.
CHASTETE
n. f.
On dit couramment de la chasteté qu’elle est la vertu des personnes ennemies de tout ce qui offense la pudeur. Cette définition n’est point entièrement satisfaisante. D’abord parce que les sentiments de honte, de modestie ou de décence, dont s’inspire la pudeur, ne se constatent pas seulement à l’occasion de circonstances où sont en jeu l’amour passionnel et la volupté des sens, tandis que l’état physique et moral qui nous occupe appartient exclusivement au cadre de la sexualité. Ensuite parce que la chasteté, lorsqu’elle n’existe que dans les apparences, c’est-à-dire dans les paroles et dans la tenue, et s’efforce d’en bannir tout ce qui pourrait provoquer chez autrui des pensées de luxure, n’à que l’importance d’une réserve polie, estimable dans une certaine mesure, mais trop souvent proche de l’hypocrisie pour représenter, dans toute l’acception du terme, la chasteté.
La véritable chasteté n’est pas seulement, en effet, dans l’expression et dans l’attitude. Elle est encore et surtout dans la nature de nos pensées. Or, comme il ne dépend point de la volonté que nous ne soyons brûlés par tous les feux du désir, lorsque notre organisme réclame l’étreinte qui perpétue l’espèce, il s’ensuit que la seule véritable chasteté c’est l’absence de préoccupations sexuelles.
Est chaste l’enfant ignorant de la loi de procréation, dont les organes sont encore sans exigences, et qui se montre nu sans songer à mal, parce qu’il ne soupçonne même pas ce que peut être l’obscénité.
Est chaste la jeune fille — en est-il beaucoup ? — seulement inquiète de platonique amour, et qui, songeant à son fiancé, ne s’égare jamais en imagination jusqu’à évoquer ce que peut être sa nudité au-dessous de la ceinture, ni des scènes licencieuses dont elle ne saurait, en public, esquisser la description.
Sont chastes encore les époux — sont-ils très nombreux ? — qui boudent aux mignardises de l’alcôve, et ne souhaitent les rapprochements charnels que par obéissance au commandement biblique de croître et de multiplier.
S’il est en ceci, pour les adultes, une vertu, ce ne peut être qu’une vertu d’anémiques, de précoces vieillards, ou d’amoureux transis.
Car elle n’est que de façade la chasteté telle qu’elle se pratique dans les sociétés influencées par la religion chrétienne, celle qui consiste à n’afficher ni maîtresse ni amant, et conserver devant le monde une retenue sévère à l’égard du culte d’Aphrodite, cependant que la pensée qui ne s’exprime point garde licence d’errer dans de suaves jardins secrets, et le sexe faculté de s’assouvir loin des regards curieux.
On confond souvent, comme identiques, la chasteté et la continence, alors qu’il s’agit en vérité de synonymes que séparent des différences notables. Si la chasteté est l’absence de préoccupations sexuelles, et le mépris ou l’ignorance du libertinage, alors même que l’on se soumettrait à des devoirs conjugaux, la continence est, par contre, l’abstention de tout rapport comme de tout plaisir sexuel, alors même que l’on souhaiterait vivement en éprouver la sensation. On peut donc être continent sans être chaste, et la réciproque est vraie.
Un prisonnier, répugnant à la sodomie comme à l’onanisme, et séparé d’une femme passionnément aimée, peut demeurer continent pendant des mois, tout en se complaisant dans des rêves dont la chasteté est exclue, tout en étant rendu demi-fou par des ardeurs dont il n’éprouve nulle honte. A l’opposé, une personne frigide, instruite dans le fanatisme religieux ; et qui considère comme tentation démoniaque toute invitation au plaisir des sens, peut, en mariage dit « légitime », cesser d’être continente, par respect pour les mœurs et pour la loi, tout en demeurant chaste par principe et par tempérament.
Ajoutons qu’une telle monstruosité n’est possible que par suite d’anomalies physiologiques, coïncidant avec une passion de l’irréel proche de l’aliénation mentale. Les personnes de cette catégorie allient le plus souvent à un cœur sec et à un esprit étroit, un sang peu généreux.
Cependant je pressens, de la part du lecteur, une question : Si l’on doit adopter les définitions qui précèdent, quelle peut être la portée, pratique du vœu de chasteté, que la religion catholique impose à ses prêtres et à ses religieux ? Je réponds donc avec impartialité : la doctrine catholique exige des ecclésiastiques qu’à défaut d’une grâce divine leur conférant une parfaite candeur d’âme, et l’apaisement de la chair, ils luttent de tout leur pouvoir, avec l’aide des prières et des mortifications, contre les embûches de la luxure, et se refusent à lui prêter une oreille complaisante. En cela se limiterait la portée du vœu de chasteté — qui n’exclurait point les épousailles et la procréation — si la règle de l’Eglise n’imposait aux ecclésiastiques, par surcroît, le célibat, c’est-à-dire la continence, l’œuvre de chair n’étant autorisée qu’en mariage seulement.
Mais, si le lecteur curieux désirait savoir dans quelle mesure le clergé se conforme à des conditions d’existence aussi draconiennes, je me bornerais à lui répéter fidèlement ce que m’avoua un jour, en tête-à-tête, un sympathique abbé défroqué, qui, après avoir été jadis mon contradicteur, devint mon ami : « La plupart des prêtres ne se privent de rien, mais opèrent avec réserve et discrétion ; une minorité trouve des compensations dans les pratiques solitaires ou l’homosexualité ; un nombre infime, servi par l’âge ou l’exaltation mystique, est en mesure de tenir ses engagements. » Et sa conclusion était : « A force de vouloir faire l’ange ; on finit par faire la bête ! ». Cette conclusion fut aussi la mienne.
— Jean MARESTAN.
CHASTETE
Le préjugé de la chasteté vaut la peine qu’on l’analyse au point de vue de l’appui qu’il apporte à la conception étatiste et autoritaire du milieu social actuel. J’appelle la chasteté « préjugé » parce qu’en se plaçant au point de vue de la raison et de l’hygiène biologique, il est absurde qu’un homme ou une femme impose silence au fonctionnement d’une partie de son organisme, renonce aux plaisirs ou aux joies que ce fonctionnement peut procurer, refoule des besoins qui sont les plus naturels parmi les naturels. En se plaçant à ce point de vue, l’on peut hardiment affirmer que la pratique de la chasteté, l’observation de l’abstinence sexuelle est une anormalité, un expédient contre nature.
Dans une revue anglaise, disparue maintenant, The Free Review, une femme : Hope Clare, a décrit, dans les termes saisissants que voici, les conséquences de la chasteté sur la santé générale de l’élément féminin de l’humanité :
« Journellement, les preuves nous sont fournies des maux physiques qu’engendre une virginité longue ou constante. Le manque d’usage affaiblit, dérange tout organe. Seuls les constituants pervertis des civilisations décadentes s’interdisent l’exercice des fonctions sexuelles... Les primitifs sont, à cet égard, bien plus sages que les civilisés. La nature, c’est entendu, punit avec la même rigidité et l’abus et l’abstinence. Mais est-elle aussi impartiale en réalité ? Un dissolu peut poursuivre une longue carrière de débauche sans que sa santé s’en ressente beaucoup ; mais la vierge ne s’en tire pas aussi facilement. L’hystérie, la forme la plus commune de maladie chronique, est le résultat presque inévitable du célibat absolu ; on la retrouve bien plus fréquemment chez la femme que chez l’homme ; et les spécialistes les plus experts sont en majorité d’accord pour reconnaître que neuf fois sur dix la continence est la cause première de cette affection. La menstruation, qui joue un rôle tellement important dans la vie de la femme, ne s’accomplit pas sans troubles chez les vierges. Bien souvent elle s’accompagne de souffrances et il n’est pas rare qu’elle fasse défaut. L’altération profonde de la santé qui sévit chez de nombreuses femmes célibataires n’a pas d’autres raisons et il s’ensuit de très graves inflammations des organes de la reproduction. L’état de célibat est un état morbide : il prédispose le corps à la maladie et à la souffrance. L’anémie, la chlorose sont des résultats fréquents de la virginité continue. Chaque jour, dans les rues, vous croisez les victimes de cette violation de la nature, reconnaissables à leurs visages pâles ou au teint jaune terreux, à leurs yeux éteints, à leurs regards sans chaleur, à leur pas lourd, sans souplesse. Elles ressemblent à des fleurs qui se flétrissent prématurément faute d’un soleil vivifiant, mais qui s’épanouiraient et prospèreraient si elles étaient transportées à temps dans une atmosphère d’amour... »
Ces lignes justifient pleinement le qualificatif de « préjugé » appliqué à la chasteté et le tableau qu’elle brosse à sa contrepartie chez les rares hommes qu’on rencontre chastes.
Le préjugé de la chasteté peut être examiné aussi bien au point de vue religieux qu’au point de vue civil.
Les religions — de l’antiquité consacraient au culte de leurs dieux un certain nombre de prêtres et de prêtresses qui faisaient vœu de n’entretenir de relations sexuelles avec qui que ce soit, et la violation de ce vœu était puni de sanctions le plus souvent atroces. Il est évident que l’importance occupée par la vie amoureuse dans l’existence des hommes les éloigne des « devoirs » rendre à la Divinité, elle leur crée des obligations, elle leur procure des distractions qui portent préjudice au culte que les entités religieuses sont censées exiger de leurs créatures. Le naturel porte toujours tort au spirituel, le physique au métaphysique. C’est pourquoi les mystiques considèrent les gestes sexuels et l’amour en général comme contenant en soi un élément d’impureté, comme un « péché » — comme le péché par excellence : il fait descendre, il établit le ciel sur la terre, le divin dans l’humain. C’est surtout dans le christianisme que cette idée atteint son apogée : l’amour sexuel, charnel, c’est le péché et à ce titre il est désagréable à la sainteté de la Divinité. D’ailleurs le fondateur, supposé ou réel, du Christianisme, est un célibataire, du moins on nous le présente comme tel. L’apôtre St Paul, le grand propagandiste chrétien, admet bien, en dernier ressort, qu’il vaut mieux céder à l’impulsion sexuelle que de « brûler », c’est-à-dire se marier, mais aux yeux de Dieu le célibat, l’état de virginité est ce qu’il y a, de mieux. Comme il faut bien concéder à « l’œuvre de chair », ne serait-ce que pour assurer la continuité de l’espèce, on ne l’autorise qu’ « en mariage seulement » et le mariage devient alors un sacrement, l’union, de deux corps et de deux âmes en même temps, une union basée sur des vœux perpétuels de fidélité sexuelle, bénie par le représentant terrestre de la Divinité, dont l’unique but est la procréation et par voie de conséquence la famille, un milieu où la progéniture grandit dans la crainte du Seigneur et le respect de ses commandements.
La conception civile du mariage est une traduction laïque de l’idée que s’en fait la société religieuse. L’officier d’état-civil fait tout simplement fonction de prêtre laïque. Jusqu’à ce que le magistrat ait sanctionné les rapports sexuels, le citoyen ou le sujet de l’un et l’autre sexe doit théoriquement demeurer chaste. S’il se conduit autrement, il est en butte à la déconsidération du milieu social, spécialement en ce qui concerne l’élément féminin. L’Etat a un très grand intérêt en effet à ce que les relations sexuelles aient pour corollaire l’établissement de la famille, parce que celle-ci est l’image réduite de la société autoritaire. Autorisés par les lois à cet effet, les parents imposent aux êtres qu’ils ont mis au monde sans les consulter, un contrat dont il leur est interdit de discuter les termes et qui contient en germe tout le contrat social ; c’est dans la famille que l’enfant apprend à obéir sans discuter, sans critiquer, qu’il est mis dans la nécessité de se contenter de réponses évasives quand il demande une explication ou de pas de réponse du tout ; c’est dans la famille qu’on inculque à l’enfant l’intérêt qu’il y a pour lui à être bon écolier, bon soldat, bon ouvrier, bon citoyen. Quand il quitte la famille, le crâne bourré, pour en fonder une nouvelle, il possède toutes les aptitudes voulues pour être dominé, ou dominer, être exploité, ou exploiter, c’est à dire jouer son rôle de souteneur de l’Etat.
Or, la chasteté où la femme a été maintenue, où elle s’est maintenue elle-même la prédispose admirablement à jouer son rôle de bonne mère de famille, de bonne éducatrice, de bonne citoyenne. Ayant refoulé pendant un certain temps, pendant toujours peut-être, les impulsions légitimes de son organisme sexuel, son besoin de recevoir et de donner des caresses, elle est dans l’état voulu — mère ou éducatrice — pour enseigner à ceux sur lesquels elle exerce son influence qu’il y a des contraintes auxquelles il faut se soumettre sans murmurer, même quand elles violent les appétits les plus naturels, même quand elles portent tort à la santé individuelle. Dès lors que l’observation de ce qui est naturel risque de miner, de mettre en péril I’artificiel, c’est au naturel qu’il faut renoncer et à l’artificiel qu’il faut s’assujettir. Voilà à quoi aboutit la pratique de la chasteté chez la femme, une fois devenue éducatrice.
La chasteté enfin, pour se maintenir, sacrifie toute une portion de l’humanité féminine. Nous disons bien « pour se maintenir » car là où l’élément masculin ne sent plus peser sur lui la contrainte des lois ou des conventions, il donne libre cours à ses instincts et sans aucune réserve, la preuve nous en est fournie par la façon de se comporter du soldat en campagne ou de l’homme moyen dans certains cataclysmes physiques ou politiques. Quoi qu’il en soit, le fait est qu’il existe une catégorie de femmes qui s’étend de la fille richement entretenue à la péripatéticienne de nos voies publiques, en passant par la pensionnaire des maisons closes, dont la profession consiste à louer leurs organes sexuels contre rétribution variable selon la hiérarchie qu’elles occupent dans leur profession. Nous avons écrit ci-dessus que ces femmes étaient des « sacrifiées » et elles le sont bien — d’abord par la déconsidération dont elles sont l’objet de la part du milieu social où elles évoluent — ensuite à cause des réglementations policières auxquelles leur personne et leur commerce sont astreints — enfin parce que les femmes chastes ne leur savent aucun gré de protéger leur chasteté. C’est parce que l’exercice de la prostitution est tenu en si haut discrédit, c’est parce que les prostituées sont montrées du doigt comme un élément social indésirable, que la chasteté a fini par passer à l’état de vertu civique. En entretenant dans le milieu social ce point de vue de la prostitution, en lui assimilant plus ou moins les relations sexuelles non légalisées, l’Etat est parvenu à donner au mariage une valeur exceptionnelle, que le divorce ne détruit pas, puisqu’il exige, lui aussi, l’intervention du magistrat.
Il découle de soi que là où a disparu le préjugé de la chasteté, à l’individuel comme au collectif, les autres préjugés anti-naturels sur lesquels reposent les conventions sociales ne tardent pas à être battus en brèche. La prostitution recule également ; le milieu social n’éprouvant plus le besoin de consacrer une partie plus ou moins grande de sa population à permettre à une autre partie de ses constituants de vivre d’une existence anormale.
— E. ARMAND.
CHASTETE
Le « Dictionnaire de l’Académie Française » définit la chasteté : la vertu de celui qui est chaste, c’est-à-dire « qui garde une honnête retenue dans les relations conjugales, et particulièrement qui s’abstient des plaisirs d’un amour illicite. Le mot chasteté signifie quelquefois une entière abstinence des plaisirs de l’amour ». Les libertaires n’acceptent pas la première définition académique. Car ils s’imposent une seule retenue honnête, celle de ne causer de douleur ni physique ni morale, et ne se refusent ni ne refusent aucune des voluptés procurées par l’union conjugale ou amoureuse. La chasteté sera donc envisagée ici comme une entière abstinence des plaisirs de l’amour ; davantage même, comme une continence absolue, le renoncement à toute satisfaction de la zone génitale, coït sous toutes ses formes et dans toutes les positions, relations hétéro et homosexuelles, masturbation solitaire ou géminée. Dans ces conditions, apparaît-elle possible, se montre-t-elle souhaitable ?
Si on appelle instinct « une activité définie héréditaire et non acquise par l’expérience personnelle, un réflexe complexe mis en jeu par des excitants extérieurs qui éveillent une potentialité héréditaire (Ch. Féré) », l’acte de la reproduction répond bien à une telle sollicitation instinctive. En effet le rut ou appétit sexuel se révèle pour la première fois chez les animaux et l’homme en dehors de toute intervention consciente de la volonté, sous l’influence de l’odorat, de la vue ou du toucher, et en cristallisation du souvenir de voluptés non perçues jusqu’alors par l’individu mais transmises par le sens antérieur et atavique de l’espèce. Toutefois il constitue seulement un « instinct secondaire » réalisant la préservation de l’espèce, au fond indifférente aux procréateurs, et non un « instinct primaire », comme celui de la nutrition, assurant au premier chef la préservation de l’individu surtout anxieux de sa propre existence. Il apparaît plus ou moins tard, rarement avant quinze ans, chez l’homme ; disparaît plus ou moins tôt, souvent à la cinquantaine ; présente de grandes variations personnelles, depuis l’absence totale jusqu’à la prédominance exclusive. Certains vivent sans femmes ; d’autres vivent pour, par et de la femme. L’instinct d’amour ne possède donc pas le caractère de nécessité inhérent à la faim et à la soif.
C’est dire que le coït n’est pas un besoin primordial ; et la continence n’entraîne de trouble ni physique ni intellectuel. Les nombreux animaux domestiqués et tenus à l’attache ne souffrent nullement de la privation génitale ; ils restent aussi beaux, aussi forts, aussi résistants que leurs congénères en liberté. Et si quelques mâles manifestent, à l’époque du rut, une certaine férocité, cela tient davantage au caractère de la race qu’à l’inassouvissement d’un instinct. Beaucoup d’hommes vivent dans la continence sans la moindre diminution de leur santé ou de leurs aptitudes générales. La majorité des prêtres, des religieux, les prisonniers au régime cellulaire supportent la chasteté avec aisance et sans recours à la masturbation. Chez les personnes accoutumées à un coït régulier, la cessation occasionne au début une gêne, due surtout à une habitude non satisfaite ; puis le temps fait son œuvre, les sens s’assoupissent, les désirs s’apaisent, la vie s’écoule sans aucune révolte de l’organisme générateur.
L’éducation joue un grand rôle dans la question de l’amour humain. Poètes et prosateurs le magnifient ou le vitupèrent. Les parents en parlent ou s’en taisent, silence encore plus suggestif. L’enthousiasme éveille l’attention. Le mystère excite la curiosité, la lecture la nourrit et la précise. La surveillance occulte surprend les secrets, l’imitation les réalise. Beaucoup y prennent un goût très vif, qu’entretiennent l’habitude, les conversations, la littérature, les spectacles érotiques. Puis l’amour-propre s’en mêle ; la puissance génésique devient un orgueil, la forte virilité un enviable privilège, la suprématie sexuelle une principauté admirée. C’est un chapitre sur lequel les mâles aiment à se vanter et en font souvent plus avec la langue qu’avec le reste. L’amour brûle, parce que hommes et femmes, vestales dévirginisés, s’époumonent à souffler sur le feu sacré.
En réalité la génération ne constitue pas, de beaucoup, la fonction la plus importante des organes sexuels. Le rôle physiologique du testicule ou de l’ovaire est double. D’une part, une sécrétion externe, spermatozoïdes ou ovules, se déverse au dehors par les voies génitales, canal déférent, verge, ou trompe, utérus, vagin ; d’autre part une sécrétion interne, « hormones et hormazones », passe directement des cellules formatrices dans le sang. Or, la simple observation prouve que la continence, c’est-à-dire le défaut d’évacuation de la sécrétion externe par le coït, n’amène aucune conséquence funeste pour l’individu. Les spermatozoïdes s’éliminent par les urines ou sont absorbés par la circulation ; les ovules sortent avec les menstrues ou disparaissent par la digestion intra-cellulaire. Ni l’homme ni la femme n’en subissent la moindre atteinte dans leur état physique et mental. L’expérimentation renforce et précise cette constatation empirique. La section chirurgicale des conduits de la semence, canal déférent ou trompe, n’apporte aucune modification dans l’organisme des opérés ; ceux-ci conservent leur vigueur et leur intelligence, continuent à jouir de l’intégrité des désirs et de la puissance génésiques mais sans possibilité de reproduction. Bien plus, chez certains criptorchides (individus dont les testicules ne sont pas descendus dans les bourses), on constate l’absence complète des tubes séminifères, producteurs du sperme, mais la présence des cellules interstitielles, élaboratrices de la sécrétion interne ; or, ces sujets offrent un aspect normal, tous les caractères de la virilité avec une stérilité absolue. Au contraire, lorsque les testicules non descendus manquent à la fois de tubes séminifères et de cellules interstitielles, les criptorchides, comme les castrés, « ont l’apparence de femmes, sont gras, grands, ont la peau blanche et douce, la voix grêle ; ils ont peu de force et sont en général, malgré quelques exemples célèbres, d’intelligence médiocre... Leur vitalité générale parait diminuée, ils vieillissent assez vite, leur peau se ride très tôt, on observe de la canitie précoce. (Guy-Laroche) ». La physiologie normale .et pathologique démontre donc le peu d’importance, pour l’individu, de la sécrétion spermatique.
En résumé, le retard de son apparition, la précocité de sa disparition, la possibilité de son absence, les extrêmes de sa variabilité, l’innocuité de sa non-satisfaction, font de la sexualité un instinct d’ordre secondaire, exalté par l’éducation, servi par des organes dont la fonction primordiale est de contribuer au développement général de l’individu et non d’assurer sa reproduction.
Sans inconvénients biologiques, sauf pour l’accessoire fonction de reproduction, la chasteté comporte pour ses fervents d’incontestables avantages. Tout d’abord elle les met d’une façon presque certaine à l’abri des maladies vénériennes, c’est-à-dire de l’une des trois grandes causes, avec l’alcoolisme et la tuberculose, de la morbidité et de la mortalité précoces. La garantie vaut bien le sacrifice de Vénus et de tous ses risques. Car la blennorragie procure à ses victimes un présent et un avenir plein de souffrances, et la syphilis annihile à peu près fatalement l’être humain dans sa plus haute manifestation : l’intelligence.
Si le coït concourt à la préservation de l’espèce, la continence favorise la conservation de I’individu en le maintenant en santé et en force. Les éleveurs ont reconnu depuis longtemps que les animaux reproducteurs attestent de médiocres qualités de travail ; aussi sélectionnent-ils leur cheptel en deux catégories, l’une pour la saillie, l’autre pour le labeur. Après avoir couvert sa femelle avec frénésie, le lapin tombe inanimé et sans défense. L’araignée dévore le mâle, sitôt la fécondation terminée. L’antique allégorie de Samson et Dalila met en images l’influence déprimante des rapports sexuels ; la contemporaine pratique des sports réalise le vieil enseignement biblique. Personne en effet n’ignore que les athlètes, les équipes à l’entraînement, les acrobates, les chanteurs, les acteurs, en somme tous ceux qui fournissent un effort physique intense ou soutenu et désirent sauvegarder leurs aptitudes professionnelles, tous ceux-là s’abstiennent également d’alcool, de tabac et de femmes. Parce que le fonctionnement sexuel des organes génitaux exige une excessive dépense d’énergie, la chasteté s’impose aux gens soucieux de maintenir intactes leur vigueur, endurance et précision musculaires.
Quoique moins évidente et moins contrôlable, l’action déprimante du coït se révèle tout aussi profonde sur le rendement cérébral. Si les étalons font de mauvais chevaux de labour, les trousseurs de jupons se montrent de médiocres travailleurs de l’esprit. Depuis Antoine et Cléopâtre jusqu’à Louis XV et la Pompadour, l’histoire fourmille d’exemples de la déchéance mentale causée par une activité génésique exagérée. En contraste, l’expression proverbiale « travail de bénédictin » signifie l’intensité du labeur intellectuel chez les pratiquants de la chasteté. Les étudiants à grisettes échouent souvent à leurs examens et les hommes à femmes ne se distinguent jamais beaucoup dans les carrières scientifiques. Cependant, dira-t-on, de grands amoureux devinrent de grands poètes, l’amour exalta leur génie : Laure et Pétrarque, Dante et Béatrix ! Mais leurs amours furent souvent platoniques. Et d’ailleurs qui prend au sérieux les versificateurs ? On les aime, on les admire, on ne les suit pas.
Génitoires ou cerveau ? La plupart des simples mortels doivent se résigner au culte des uns ou de l’autre. Divins ceux qui peuvent, à la fois et avec honneur, servir et la chair et l’esprit.
— Dr F. ELOSU.
BIBLIOGRAPHIE :
Dr Ch. FÉRÉ. — L’instinct sexuel. In-18, 359 p. Alcan, Paris, 1902.
GUY-LAROCHE. — Opothérapie endocrinienne. In-8°, 256 p. Masson, Paris, 1925.
Paul GOY. — De la pureté rationnelle. Brochure, 51 p. Edition Maloine, Lyon.
Dr Roux. — L’instinct d’amour. In-18, 384 p. J.-B. Baillière, Paris, 1904.
CHATELET (LE)
n. m.
Un des deux édifices où, autrefois, se rendait la justice royale de la Ville de Paris. Il y avait le grand et le petit Châtelet. Le grand Châtelet semble avoir été bâti sous le règne de Louis le Gros ; mais en 1657 les bâtiments tombaient en ruine et un ordre du roi arrêta que le tribunal qui y siégeait irait, durant les réparations, s’établir dans le Couvent des Grands Augustins. Pendant un an les moines résistèrent à l’Edit royal et aux arrêts du Parlement et ce n’est que par la force qu’ils furent expulsés. En 1864 on ajouta de nouveaux bâtiments aux anciens et avant la grande révolution il ne restait plus que quelques vieilles tours entièrement désaffectées. En 1802 il fut complètement démoli. Les prisons du Châtelet se divisaient d’abord en neuf parties puis en quinze, dont les noms seuls évoquent la barbarie et la terreur. On s’imagine ce que devaient souffrir les malheureux emprisonnés dans les cachots dénommés : « Les Chaînes », « La Barbarie », « La Boucherie », « Les Oubliettes ». Dans un de ces cachots appelés « La Fosse », il paraît que l’on faisait descendre les prisonniers par un trou pratiqué dans le souterrain au moyen d’une poulie, comme un seau dans un puits. Dans un autre cachot, appelé Chausses d’Hypocras, les prisonniers avaient les pieds dans l’eau, et ne pouvaient rester ni debout ni couchés. Le cachot désigné sous le nom de Fin d’Aises était plein d’ordures et de reptiles. (Lachâtre).
Le petit comme le grand Châtelet fut le théâtre de scènes de carnage. En 1418, ses prisonniers furent massacrés par les Bourguignons. Ils tentèrent de se défendre à coup de pierres et de tuiles ; mais les assaillants les précipitèrent par les fenêtres et les malheureux prisonniers étaient reçus sur les pointes des piques. Par la suite, et jusqu’à la Révolution, le Châtelet devint le siège de la prévôté, institution qui jugeait en premier ressort les causes civiles des personnes attachées à la Cour du roi. Il ne subsiste plus rien aujourd’hui de cette construction hideuse dans laquelle s’accomplit tant de meurtres et de crimes. Hélas, si le Châtelet a disparu, comme la Bastille, d’autres châtelets et d’autres bastilles ont été construits et la souffrance humaine se perpétue à l’ombre des chambres de torture, qu’ignorent volontairement les grands de ce monde. C’est au peuple qu’il appartient, en transformant la société, de raser toutes les prisons, tous les bagnes qui ne sont que des Châtelets modernes, dans lesquels le capital et le Gouvernement détiennent ceux qui se révoltent contre l’Ordre établi.
CHAUVINISME
n. m.
Sentiment belliqueux, qui a pour base le culte fanatisé de la patrie. Le chauvinisme est l’exagération du patriotisme. De par son caractère et son esprit, le chauvinisme est une source de douleurs et de souffrances. Il donne naissance à tous les abus nationaux, et provoque par son aveuglement les plus horribles boucheries. Il se fait remarquer par ses pratiques stupides et son admiration pour tout ce qui a trait à la force brutale du militarisme, et son amour impondéré de la guerre. Aveugle et inconscient, le chauvinisme sacrifie tout à l’idée de patrie. Le droit, la liberté, la justice, ne sont que des mots pour le chauvin ; il se refuse à tout examen, à toute raison, à toute logique, et entraînerait son pays à la ruine, pour satisfaire le fanatisme de ses sentiments. Pourtant, si au nom de l’idée patriotique, le chauvinisme exalte les populations et les entraîne sur les champs de bataille, la plupart des chauvins ne se signalent pas par leur courage et s’ils envoient les autres se faire tuer pour défendre la « Nation menacée », ils se gardent bien de participer à la tuerie. On peut donc dire, que le chauvinisme n’est pas seulement un sentiment belliqueux qui éloigne l’ère de la paix, mais qu’il est également un sentiment intéressé, qui anime ceux qui ont intérêt aux grandes conflagrations humaines, et recherchent dans les hécatombes une source de revenus et de richesse. Ce sentiment est maintenu vivace par toute la caste des hobereaux et de militaires de métiers ayant intérêt à ne pas voir s’éteindre le feu ardent du patriotisme, qui leur permet de poursuivre leur vie d’inutiles et d’oisifs. Ce sentiment ne subsiste et n’exerce ses ravages que grâce à la bêtise, l’ignorance et la lâcheté des populations. Il disparaîtra avec les sociétés qui lui ont donné le jour.
CHERE (La vie)
La vie chère est un phénomène d’ordre économique, inhérent à l’ordre capitaliste, qui est caractérisé par une hausse de toutes les choses nécessaires à la vie et généralement, par une diminution de la capacité d’achat du consommateur.
Il y a le plus souvent à l’origine d’une crise de vie chère persistante, une guerre, un conflit social important, une situation économique et financière difficile. Très souvent encore, tous ces facteurs se trouvent réunis. C’est ce qui donne à la crise toute son acuité en même temps que la durée s’en trouve prolongée.
Il ne faut pas seulement mesurer l’étendue, la valeur chiffrée de la vie chère en se basant exclusivement sur le prix des denrées, des vêtements, du chauffage, etc...
Trois facteurs entrent en jeu pour évaluer la vie chère. Ce sont : le salaire nominal, l’indice du coût de la vie et le salaire réel.
On peut en effet toucher un salaire nominal très élevé par rapport à l’indice de base d’avant la crise, exprimé généralement par le chiffre 100, et n’avoir qu’un salaire réel, c’est-à-dire un pouvoir d’achat, très limité, si l’indice du coût de la vie est supérieur de beaucoup à celui du salaire. Nous le verrons tout à l’heure par des tableaux statistiques et des exemples concrets.
En période normale, avant la guerre de 1914/1918, la vie était stabilisée, en raison d’une longue période de prospérité économique et de paix.
Et, à peu près dans tous les pays, le coût en était identique.
Un facteur qui, en ce moment, joue un grand rôle, a détruit cet équilibre : c’est le change. Alors qu’avant guerre la valeur réelle de l’étalon monétaire était au pair, c’est-à-dire égale à l’unité de même valeur des autres pays, il n’en est plus de même aujourd’hui. La fluctuation continue des changes, les écarts existant entre la valeur réelle et la valeur nominale des étalons monétaires à rompu l’équilibre d’autrefois.
Immédiatement la dévalorisation de la monnaie à change bas a amené une augmentation du coût de la vie qui a, surtout au début, porté sur les produits importés, les denrées coloniales, achetés sur les marchés des pays à change élevé. Tout naturellement, les produits indigènes ont suivi la hausse et, insensiblement, ont atteint les prix des produits exotiques ou étrangers importés.
Parallèlement à cette crise des changes s’est tout naturellement développée l’inflation fiduciaire.
A mesure que le nombre des billets croissait, le pouvoir d’achat du consommateur diminuait, parce que la valeur du salaire réel ne suivait pas la courbe ascendante du coût de la vie. La vie déjà chère par le prix des denrées, du chauffage, du vêtement, de l’éclairage, devenait plus chère encore, parce que le pouvoir d’achat, du consommateur était diminué, parce que son salaire réel ne correspondait plus au coût de la vie en constante élévation.
Ce sont là les causes essentielles de la vie chère. II y en a d’autres et de nombreuses : la spéculation, la sous-production d’objets nécessaires, la surproduction des objets dont la fabrication est supérieure aux besoins, l’impossibilité d’achat à l’étranger par suite du change déprécié et le remplacement des productions étrangères par l’installation d’industries non adéquates au pays qui veut néanmoins se suffire à lui-même, le protectionnisme, les impôts.
1° La spéculation. — Au moment des grands conflits armés, des grandes crises sociales, les spéculateurs, la nuée de leurs courtiers, de leurs intermédiaires, de leurs raccoleurs, sont à l’affût. Dès qu’ils sentent de gros besoins, de grosses demandes d’une marchandise quelconque, ils se dépêchent de la rafler, de la stocker ou de l’acheter à terme chez le producteur ou le fabricant. En un clin d’œil toute la production est achetée et, généralement, par quelques individus seulement. Ceux-ci ont beau jeu pour ne la revendre qu’au prix qu’ils veulent et quand ils veulent. Il va sans dire que, les besoins étant supérieurs aux offres, le produit ou la marchandise subissent une forte hausse, et c’est presque toujours sur le cours supérieur, que se stabilisera, pour un temps, le prix à venir de ce produit ou de cette marchandise, avant de préparer le prix à une opération spéculative ou un coup de Bourse, ce qui revient au même.
Lorsque nous avons traité l’accaparement, nous avons aussi démontré, comment par le jeu de la resserre, de la cessation d’envoi, les mandataires aux Halles provoquaient la hausse des denrées de première nécessité et périssables. C’est encore une forme de la spéculation à la hausse.
La spéculation, en temps normal ne réussit pas toujours et souvent des groupes rivaux provoquent des baisses qui, en quelques jours, ruinent leurs concurrents non prévenus ou moins forts, moins soutenus par les Banques. Une spéculation à la baisse reste presque sans influence sur les cours du détail. Elle reste aussi inconnue au consommateur qui ne peut en bénéficier ; souvent encore elle n’est que le prélude d’une spéculation à la hausse lorsque la concurrence est supprimée et, alors, le consommateur connaît la hausse chez le détaillant, s’il n’a pu bénéficier de la baisse.
Comme on le voit, ce sont là des opérations assez compliquées, mais courantes. La spéculation est sans nul doute le principal facteur normal de la vie chère.
2° Sous-production d’objets nécessaires et surproduction des objets dont la fabrication est supérieure aux besoins.
Comme nous l’indiquons en traitant du chômage, la production est organisée non pas en vue de la satisfaction des besoins mais, au contraire, pour la réalisation des profits. Il en découle, forcément, que des productions utiles mais peu rémunératrices, sont délaissées au profit de productions moins utiles mais plus avantageuses ; que des produits, denrées, cultures diverses, indispensables pourtant, ne sollicitent pas l’effort, tandis que d’autres, moins nécessaires mais d’un meilleur rapport sont poussés au-delà des besoins.
Il est de toute évidence que les produits dont l’utilité, la demande est supérieure à l’offre, à la production sont vendus, même sans spéculation, à un prix supérieur à leur valeur réelle et provoquent ainsi une hausse partielle du coût de la vie. Si on considère que nombreux sont les produits et denrées pour lesquels il en est ainsi, on concevra facilement que cette organisation capitaliste de la production soit un facteur sensible de vie chère.
La contrepartie n’existe d’ailleurs pas pour les produits dont la production est supérieure aux besoins. Le développement de ces besoins d’une part, la spéculation, la destruction ou le stockage d’autre part, permettent aisément aux détenteurs, spéculateurs et intermédiaires de fixer le cours qu’ils veulent. Ainsi l’abondance du vin, depuis la guerre, en France, n’a pas fait baisser le prix de cette marchandise. Elle a tout simplement suivi le cours général des autres marchandises et, le consommateur n’a pas bénéficié, le moins du monde de cet excédent réel de production. Il a consommé davantage et c’est tout.
3° Impossibilité d’achat à l’étranger en raison de la dépréciation du change et installation d’industries de remplacement non adéquates au pays.
La dépréciation trop considérable de la monnaie d’un pays ne permet plus à ce dernier de s’approvisionner en denrées coloniales, en produits étrangers dans les pays à change haut.
Conséquemment, il doit chercher, dans la mesure du possible à vivre sur lui-même. Pour cela, il est obligé de créer de toutes pièces des industries de remplacement pour lesquelles il n’est pas outillé, pas préparé ni approvisionné en matière première.
En produisant des « ersatz », des objets ou marchandises qui lui font défaut, ou en s’approvisionnant en matières premières au lieu des produits finis, il arrive parfois à se suffire ou à peu près. Mais toutes ces installations, tous ces achats, faits, il est vrai, en monnaie du pays, n’en coûtent pas moins très chers et provoquent une augmentation du coût de la vie.
4° Le protectionnisme.
En protégeant, et souvent d’une façon extrêmement outrancière, les produits ou l’industrie du pays, les dirigeants obligent la population de ce pays à vivre sur ses ressources ; s’il arrive que la récolte ou la production soient déficitaires et qu’il faille acheter au dehors, le prix de la marchandise importée subit une hausse correspondante à l’importance de l’achat extérieur.
En outre, le cours de la marchandise du pays, dont la parité s’établit sur le cours extérieur, subit une hausse de même importance.
Parfois les gouvernements baissent bien les droits de douane pour la marchandise nécessaire, mais le vendeur, par représailles, tenant compte du droit normal, majore d’autant le prix initial. Enfin, la spéculation, agissant extérieurement et intérieurement, pousse à la hausse en tenant la dragée haute aux acheteurs directs, aux détaillants et ceux-ci, par répercussion, aux consommateurs.
Le protectionnisme est donc une cause certaine d’augmentation du coût de la vie et les droits prohibitifs dont sont frappés marchandises et produits retombent en fait sur le consommateur. Seuls le commerce et l’industrie du pays protégé en bénéficient, puisque toute concurrence extérieure devient impossible.
5° Les impôts.
Les impôts divers : chiffre d’affaires, taxe de soi-disant luxe et surtout les impôts Indi-rects, droits d’octroi, etc., sont aussi une cause permanente de vie chère. Rentrant dans les frais généraux des exploitants, fabricants, industriels et commerçants pour leur valeur réelle, ils sont majorés, plusieurs fois leur valeur et, en définitive, payés entièrement par le consommateur.
L’annonce de nouveaux impôts donne toujours lieu à une augmentation sensible du coût de la vie. Pour peu que les choses traînent en longueur, que le Parlement discute quelques mois de la nouvelle taxe, on peut-être certain que le consommateur subira trois ou quatre augmentations sur denrées, loyers, etc., etc., ce qui ne l’empêchera pas, au vote de la loi ou à la mise en vigueur du décret. de subir l’augmentation majorée comme il convient et cela parait normal aux vendeurs. Hélas ! le commerce comme la propriété, c’est bien le vol, a dit Proudhon !
Il y a enfin des causes locales ou régionales d’augmentation du coût de la vie. L’affluence de la troupe, le gros mouvement des affaires, les situations spéciales occupées par les stations balnéaires ou climatériques, la présence dans une localité d’une industrie neuve à gros bénéfices, payant de hauts salaires sont autant de causes de vie chère.
Le calcul du salaire réel ou pouvoir d’achat s’obtient de la façon suivante : nombre indice du salaire réel ; nombre indice du salaire nominal x 100 ; nombre indice du coût de la vie ce qui veut dire que le salaire réel s’obtient en divisant le nombre indice du salaire nominal multiplié par 100 (indice général de 1914), par le nombre indice du coût de la vie.
Statistiques indiquant : Le salaire nominal, le coût de la vie et le salaire réel des principaux pays.
| PAYS | DESIGNATION | 1914 | Juin 1920 | Oct. 1920 | Juin 1921 | Déc. 1921 | Mars 1922 | Juin 1922 |
|---|
| Angleterre | Salaire Nominal | 100 | 310 | 310 | 309 | 250 | 244 | 277 |
| Coût de la vie | 100 | 252 | 265 | 219 | 192 | 182 | 184 |
| Salaire réel (Capacité d’achat du consommateur-producteur) | 100 | 91 | 87 | 105 | 102 | 102 | 83 |
| France | Salaire Nominal | 100 | 400 | 400 | 414 | 400 | 390 | 385 |
| Coût de la vie | 100 | 379 | 450 | 363 | 349 | 323 | 366 |
| Salaire réel (Capacité d’achat du consommateur-producteur) | 100 | — | 133 | 105 | — | — | — |
| Belgique | Salaire Nominal | 100 | 403 | — | — | — | 413 | 362 |
| Coût de la vie | 100 | 461 | — | — | — | 387 | 366 |
| Salaire réel (Capacité d’achat du consommateur-producteur) | 100 | 87 | — | — | 107 | 106 | 99 |
| Suède | Salaire Nominal | 100 | — | 312 | — | 313 | — | — |
| Coût de la vie | 100 | 270 | — | 236 | — | — | — |
| Salaire réel (Capacité d’achat du consommateur-producteur) | 100 | — | 116 | — | 132 | — | — |
| Norvège | Salaire Nominal | 100 | 327 | — | — | 303 | — | — |
| Coût de la vie | 100 | — | 302 | 296 | 280 | — | — |
| Salaire réel (Capacité d’achat du consommateur-producteur) | 100 | 108 | — | — | 102 | — | — |
| Danemark | Salaire Nominal | 100 | 319 | 354 | 318 | 291 | 248 | 248 |
| Coût de la vie | 100 | 262 | 264 | 237 | — | — | — |
| Salaire réel (Capacité d’achat du consommateur-producteur) | 100 | 134 | 134 | 123 | 137 | 125 | 125 |
| Pays-Bas | Salaire Nominal | 100 | — | 267 | 278 | 277 | — | 248 |
| Coût de la vie | 100 | — | 221 | 210 | 208 | 192 | 187 |
| Salaire réel (Capacité d’achat du consommateur-producteur) | 100 | — | 121 | 146 | — | — | 133 |
| Etats-Unis | Salaire Nominal | 100 | — | 208 | — | 181 | — | 181 |
| Coût de la vie | 100 | 214 | 198 | 177 | 174 | 166 | 169 |
| Salaire réel (Capacité d’achat du consommateur-producteur) | 100 | 96 | — | 98 | — | 108 | 99 |
| Afrique Du Sud | Salaire Nominal | 100 | — | 153 | — | — | 120 | — |
| Coût de la vie | 100 | 179 | — | — | 162 | — | 133 |
| Salaire réel (Capacité d’achat du consommateur-producteur) | 100 | — | 85 | — | — | 90 | — |
| Australie | Salaire Nominal | 100 | 141 | 162 | 167 | 168 | 166 | 163 |
| Coût de la vie | 100 | 154 | 161 | 150 | 144 | 138 | 139 |
| Salaire réel (Capacité d’achat du consommateur-producteur) | 100 | 92 | 101 | 111 | 122 | 123 | 116 |
| Inde Anglaise | Salaire Nominal | 100 | — | — | 190 | — | — | — |
| Coût de la vie | 100 | — | — | 174 | — | — | — |
| Salaire réel (Capacité d’achat du consommateur-producteur) | 100 | — | — | 114 | — | — | — |
| Italie | Salaire Nominal | 100 | — | 383 | — | 449 | — | 384 |
| Coût de la vie | 100 | 438 | 384 | 405 | 447 | 490 | 458 |
| Salaire réel (Capacité d’achat du consommateur-producteur) | 100 | — | 100 | — | 111 | — | 83 |
|* NOTA — Ces chiffres sont ceux publiés par les services officiels des différents pays. Nous ne pouvons les contrôler en raison de l’absence de statistiques dressées par la classe ouvrière de chaque pays — ce sont des chiffres moyens pris par corporation. Ils s’appliquent à la métallurgie. *|
|* Statistique particulière à l’allemagne pendant la grande crise économique et financière de 1922 *|
| PAYS | DESIGNATION | 1914 | Avril 1922 | Juillet 1922 | Sept. 1922 | Oct. 1922 | Nov. 1922 | Déc. 1922 |
|---|
| Allemagne | Salaire Nominal | 100 | 2352 | 3879 | 9350 | 13557 | 23117 | 42500 |
| Coût de la vie | 100 | 3436 | 5392 | 13319 | 22066 | 44610 | 68510
| Salaire réel (Capacité d’achat du consommateur-producteur) | 100 | 68 | 72 | 70 | 61 | 52 | 62
|* Statistique particulière à l’Autriche pendant la grande crise économique et financière de Juin 1920 à Décembre 1922 *|
| PAYS | DESIGNATION | 1914 | Déc. 1920 | Mars 1921 | Juin 1921 | Oct. 1921 | Déc. 1921 | Mars 1922 | Juin 1922 | Sept. 1922 | Déc. 1922 |
|---|
| Autriche | Salaire Nominal | 100 | 5040 | 5730 | 13557 | — | 58460 | 154630 | 863500 | 779000 | 782400 |
| Coût de la vie | 100 | 6700 | 8100 | 9800 | 20500 | 77800 | 187100 | 1130600 | 930500 | 942500 |
| Salaire réel (Capacité d’achat du consommateur-producteur) | 100 | 75 | 71 | 67 | 74 | 75 | 75 | 83 | 76 | 80 |
On remarquera par l’examen des tableaux ci-dessus, que le pouvoir d’achat ou salaire réel a diminué, se trouve au-dessous de celui de 1914, pour l’Angleterre, la Belgique, les États-Unis et l’Italie, c’est-à-dire que sauf les neutres : Suède, Danemark, Norvège, Pays-Bas, tous les pays ayant participé à la guerre sont affectés par la vie chère et que le pouvoir d’achat du consommateur y a sensiblement diminué, ce qui cor-robore pleinement notre exposé objectif du début.
En ce qui concerne l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie, atteintes par des crises économique et financière, on remarquera de quelle façon a agi sur le salaire réel, la débâcle financière de ces pays, ce qui confirme également ce que nous affirmons.
Enfin, et bien que le gouvernement français s’abstienne soigneusement de nous renseigner, nous savons que la baisse du franc, l’inflation qui suivit, portèrent le coût de la vie à 470 alors que les salaires atteignent 380, ce qui ramène le salaire réel ou pouvoir d’achat du producteur -consommateur français à 89 % de sa valeur de 1914.
* * *
Les remèdes à une telle situation sont presque nuls ou empiriques. Les mesures gouvernementales contre la vie chère restent sans effet. Il ne pourrait y avoir qu’un palliatif — nous disons bien : palliatif — le développement des coopératives de consommation afin de « régulariser » le marché dans une certaine mesure. Ce remède ne pourrait être efficace que si ces coopératives pouvaient se soustraire à la pression des spéculateurs en s’approvisionnant directement dans des coopératives de production et chez le producteur libéré des spéculateurs.
Nous ne sommes pas près d’en être là. Le capitalisme ne permettra d’ailleurs jamais que nous atteignions ce stade qui marquerait la fin de son rôle. Ce n’est que par la transformation du système social qu’on pourra efficacement porter remède à un tel mal.
— Pierre Besnard.
CHIMIE
Voir Sciences naturelles.
CHOMAGE
n. m.
Le chômage est la période pendant laquelle une industrie est momentanément arrêtée. Le chômage peut être partiel ou total, local, national. Il se peut aussi qu’une usine, un atelier, une entreprise, une exploitation ne marchent qu’au « ralenti ». Ce moyen est souvent employé pour ne pas créer des troubles. Dans ce cas les ouvriers ne font plus qu’un certain nombre d’heures par jour et parfois par roulement, ne travaillant que quelques jours par semaines. Le chômage, c’est donc pour l’ouvrier, l’arrêt forcé du travail. Le chômage tient à des causes multiples : incapacité du capitalisme à organiser la production d’une façon rationnelle, limitation du capital-argent, mauvaise répartition des matières premières, spéculations sur celles-ci et sur les produits, afflux de main d’œuvre sur un point donné par voie d’immigration organisée par le patronat, fabrication intense de produits spéciaux et nouveaux dont l’offre arrive à dépasser la demande, sous-production des objets utiles, journées trop longues. Telles sont les causes générales et principales qui engendrent le chômage sous toutes ses formes et à toutes les époques.
Il convient cependant, dans les temps actuels d’y ajouter celles qui résultent de l’instabilité du change des monnaies, des écarts considérables qui existent entre ces changes et rendent presque impossible l’approvisionnement, en matières et en produits, des pays à change bas dans les pays à change élevé.
Cette crise des changes a produit après la guerre de 1914/18 un chômage intense en Angleterre et en Amérique, où des stocks de charbon, de fer, d’acier, de produits de toutes sortes restent inemployés et ne trouvent pas acquéreurs chez les acheteurs habituels trop appauvris.
Il y a enfin le protectionnisme qui joue, lui aussi, son rôle qui est considérable. Le protectionnisme va, en effet, en général à l’encontre du but qu’il poursuit. Une industrie protégée est enfermée dans le cadre national. Si des tarifs prohibitifs ferment en effet les frontières douanières aux produits étrangers, les pays qui se trouvent lésés dans leurs exportations et leur développement industriel usent de réciprocité en établissant des tarifs qui empêchent dans une très large mesure les produits de la nation protectionniste, d’entrer chez eux.
Bien entendu au bout de peu de temps les marchés nationaux sont engorgés, encombrés, l’offre reste sans demande et le chômage sévit dans cette industrie protégée.
Il y a encore, surtout en ce moment, en cette période de transformation du machinisme et de la technique, des chômages provoqués par l’utilisation beaucoup moins considérable de certains produits ou matières.
L’avènement de la vapeur a révolutionné les transports et fait disparaître sans qu’il y ait remploi immédiat des éléments employés en nombre d’industries ou de métiers ; celui du machinisme a eu les mêmes conséquences, parce que le déplacement industriel et agricole qui en est résulté n’a été ni réglé ni ordonné. L’application sans cesse plus considérable du pétrole et surtout de l’électricité, a produit des troubles profonds dans l’industrie minière en réduisant considérablement les besoins en charbon. L’utilisation de la houille blanche généralisée, produira des crises plus profondes encore, parce que le capitalisme est impuissant à réajuster et à réadapter les industries et les efforts humains.
Le chômage, qui atteint en Angleterre plus de 3 millions d’hommes en 1925 et frappe en Amérique un nombre presque égal d’individus, tient surtout à la crise des changes et à la sous-consommation du charbon dont l’utilisation s’est considérablement amoindrie.
Le chômage est un mal endémique en régime capitaliste. Il est la conséquence même de ce régime organisé pour la réalisation des profits au lieu de l’être en vue de satisfaire les besoins utiles.
Le chômage ne disparaîtra donc qu’avec le capitalisme lui-même. Il est facile de prévoir qu’il s’amplifiera sans cesse, à mesure que le capitalisme développera ses productions nouvelles et en raison de son impuissance à ordonner son effort industriel. Toutes les mesures prises pour l’enrayer resteront vaines.
Il serait encore plus grand, si, ne craignant pas pour la stabilité du système, le capitalisme laissait libre cours de s’exercer à la technique, à la science. Craignant d’être débordé par le progrès qui en résulterait, sachant d’avance que la ruine s’en suivrait pour nombre d’industries incapables d’évoluer assez rapidement, le capitalisme restreint, par l’argent, les recherches de la science et les applications de la technique.
Les causes du chômage sont, on le voit, extrêmement complexes et diverses. Revenons à celles qui sont essentielles et courantes, à celles qui sont exposées au début de cette étude.
1° Incapacité du capitalisme à organiser de façon rationnelle. — Le capitalisme, nous l’avons dit, dirige ses efforts en vue de profits à réaliser et non pour satisfaire les besoins utiles. Cette conception l’entraîne fatalement à surproduire dans certaines branches d’industrie et à sous produire dans d’autres.
Pendant que la surproduction, en jetant sur les marchés des quantités de matières ou de produits non utilisables, non demandés, engendre au bout de peu de temps l’arrêt de l’industrie ou des industries qui n’ont pas su limiter leur effort, la sous-production ne permet pas de satisfaire les demandes. Dans les deux cas, le chômage en résulte. Ici, afflux de main-d’œuvre, là, moins de main-d’œuvre, mais cessation de l’effort. Dans les deux cas, c’est le chômage pour l’ouvrier, l’arrêt ou la marche ralentie de l’industrie qui l’emploie.
Si l’effort capitaliste devait — et ce ne peut pas être — avoir pour but de satisfaire les besoins collectifs, il en irait tout autrement. La limitation de la production dans tous les domaines à la satisfaction des besoins, la stabilisation des marchés sur des bases statistiques solides, rendrait impossibles toute surproduction et sous-production. Ce serait ainsi qu’on verrait la fin du chômage. Seuls les ouvriers, par leurs syndicats, sont capables d’organiser la production sur ces bases parce qu’ils auront au préalable, fait disparaître l’intérêt particulier et donné naissance au véritable intérêt collectif.
2° Limitation du capital-argent. — Par la limitation des ressources dont il dispose chaque année, ressources qui sont déterminées par le volume des transactions avec bénéfices réalisés dans le cours de l’année précédente, le capitalisme, par son caractère individualiste, est obligé de limiter la production, les frais de celle-ci au chiffre de ses ressources.
Bien souvent, des besoins accrus, des bénéfices possibles seraient ou satisfaits ou réalisés par voie de développement si les industriels et les commerçants pouvaient étendre le cercle de leurs affaires et augmenter pour cela leur production ou leurs ventes.
L’une et l’autre restent stationnaires ou régressent souvent, parce que les exploitants ne disposent pas des ressources suffisantes.
Cette limitation des ressources entraîne forcément celle des frais généraux dans lesquels les salaires entrent pour une large part. Si l’industriel a travaillé à perte, il licencie en partie le personnel qu’il emploie ou fait appel à une main-d’œuvre moins onéreuse par voie de mise à pied. C’est le chômage pour le personnel ancien.
3° Mauvaise répartition des matières premières. L’absence totale de statistiques commerciales et industrielles fixant chaque année les besoins approximatifs de tous les pays et la quantité de matières disponibles, empêche que les industries soient approvisionnées en vue des productions nécessaires, tandis que d’autres reçoivent des quantités énormes de matières qui resteront inemployées.
Si les industries de transformation ne reçoivent pas ce que représente leur utilisation à plein rendement, c’est le chômage forcé des ouvriers dans cette industrie.
Si au contraire les industries de base, les exploitations d’extraction ont auparavant constitué des stocks et approvisionné les industries de transformation à leur pleine capacité, c’est le ralentissement chez ces exploitants et le chômage des ouvriers travaillant dans l’industrie de base.
On ne pourra remédier à cet état de choses que par la création d’offices nationaux et internationaux qui fixeront et les besoins de la consommation et le chiffre de la production. Ce n’est pas, encore, le régime capitaliste qui opèrera ces redressements nécessaires à la réalisation de l’équilibre du système incriminé.
4° Spéculation sur les matières premières et les produits. — Les matières et les produits n’étant pas l’objet d’appréciations exactes dans le domaine des disponibilités et des nécessités, la répartition rationnelle des matières premières étant impossible, il va de soi que la fabrication est chaotique, comme nous venons de l’exposer ci-dessous.
Mais cette conception de l’économie, favorable aux audacieux, aux coquins de toutes nuances et de tout acabit, à tous les « corsaires » de l’industrie et du négoce, permet aux uns et aux autres de spéculer sans vergogne sur matières et produits.
Quoi de plus facile, pour les grandes Firmes, pour les Cartels et les Trusts, que d’accaparer des quantités énormes de matières premières ou de produits, qui permettent de ralentir ou d’accélérer le rythme de la production.
C’est pour les spéculateurs une question de disponibilités liquides. Les banques se chargent de résoudre facilement semblable problème qui est, pour elles, d’ordre courant.
Bien entendu, en opérant ainsi, financiers et exploitants, commerçants et usiniers se moquent parfaitement de ce que deviendront leurs ouvriers et leurs employés. Si, par exemple, la spéculation donne des bénéfices supérieurs à ceux que permet de réaliser la fabrication, ils n’hésitent pas à ralentir ou à arrêter pour un temps l’extraction, la fabrication ou l’écoulement jusqu’au moment où leurs intérêts exigent la manœuvre inverse.
C’est ainsi que des hausses fantastiques se produisent, que le coût de la vie augmente pendant que la misère croît avec l’intensification du chômage.
La spéculation est un des principaux facteurs du chômage. Elle cause des ravages terribles dans tous les domaines. Elle fait, elle aussi, partie intégrante du capitalisme. Vouloir l’abattre et laisser debout le système qui l’engendre, c’est chevaucher la chimère.
5° Afflux de main-d’œuvre par voie d’immigration. — Pour faire échec aux revendications des travailleurs d’une industrie, soit dans une localité, soit dans une région, le patronat n’hésite pas à faire appel à la main-d’œuvre étrangère, à organiser dans les pays pauvres et à population très dense, un courant d’émigration avec la complicité des pouvoirs publics des deux pays intéressés.
Ces travailleurs importés sont bien embauchés suivant des contrats qui, théoriquement, respectent à peu près la législation du travail du pays où on les envoie, mais dès l’arrivée des émigrés les contrats sont violés. Ni le taux des salaires, ni la durée du travail ne sont respectés. Le patronat règne en maître sur ces malheureux esclaves du travail. Ils les nourrit comme des chiens dans ses cantines infectes et les loge comme du bétail dans ses baraques, tout en les payant un prix dérisoire et en leur imposant, avec l’aide de ses tâcherons, des journées de travail très longues.
Toutes ces pratiques réduisent naturellement au chômage les ouvriers indigènes, qui ne peuvent ni ne veulent accepter un semblable traitement, qui ont une famille à élever, des besoins normaux à satisfaire.
Et c’est malheureusement la lutte entre exploités pour la bouchée de pain. Ce sont les brimades et les rixes sur les chantiers, dont le patronat exploite sans vergogne le triste résultat.
Les moyens dont dispose la classe ouvrière pour remédier au chômage sont extrêmement précaires. Ne pouvant s’associer à l’œuvre de filtrage du gouvernement, ne pouvant par esprit de classe internationaliste, s’opposer à ce qu’un travailleur soit partout chez lui, quelle que soit son origine, le prolétariat est, en quelque sorte, désarmé devant l’immigration et tout ce qui en découle.
Ce n’est que par l’établissement de rapports constants entre les différentes Centrales nationales ouvrières, par le développement d’une propagande intelligente touchant sans cesse un plus grand nombre d’individus, qu’on parviendra, dans la Société actuelle, à limiter, mais à limiter seulement — les méfaits d’une telle utilisation des travailleurs.
6° Fabrication intense et exagérée de produits spéciaux et nouveaux dont l’offre dépasse la demande. Il est, en effet, à remarquer que dès l’application d’une découverte scientifique et l’industrialisation à laquelle elle donne lieu, les ouvriers, recherchés au début, par les chefs d’industrie qui fabriquent les produits ou par les commerçants ou industriels qui les écoulent ou les emploient, se précipitent nombreux dans cette profession. Bientôt, au bout de très peu de temps, celle-ci est encombrée à un tel point que le chômage ne tarde pas à y sévir avec intensité, jusqu’au jour où une nouvelle industrie viendra utiliser la main-d’œuvre en surcroît.
Il en fut ainsi successivement dans l’industrie mécanique et électrique, dans le cycle, l’automobile, l’aviation. Il en est de même dans la sténo-dactylo par exemple.
De même que les jeunes gens veulent tous être mécaniciens en quelque chose, les jeunes filles veulent toutes être sténo-dactylos. Et l’encombrement crée le Chômage et la dépréciation du salaire.
Les patrons se gardent bien de tarir une pareille source de recrutement qui leur procure à bon compte un personnel qualifié.
Mais ce n’est là qu’un des côtés de la question. En poussant intensivement une production nouvelle, en cherchant à réaliser au plus vite de gros bénéfices, les patrons encombrent, eux aussi, rapidement le marché et, bientôt, il y a pléthore de marchandises, crise d’achat, stockage forcé, et partant, chômage jusqu’au jour où le marché se stabilise, sous la poussée des nécessités où jusqu’à ce qu’une industrie nouvelle arrête, paralyse ou ralentisse l’essor de l’industrie en question.
Bientôt à la production exagérée succède la sous-production et ce tassement ne va pas sans inconvénient pour les ouvriers qui sont employés dans cette industrie et en supportent toutes les crises et fluctuations.
7° Les journées trop longues. — Par principe, par routine et aussi par calcul intéressé autant que par la tactique de combat, le patron est enclin à maintenir très longue la journée de travail. Soit qu’il refuse d’évoluer et d’appliquer les découvertes mécaniques, d’en généraliser l’emploi par esprit d’économie et de routine, le patronat maintient, malgré les lois sociales, la journée de travail au-dessus de la durée légale. Cependant petit à petit, pour soutenir la concurrence, il est obligé d’utiliser les machines qui produisent davantage et plus rapidement. Mais comme il prétend utiliser aussi le matériel humain à plein rendement, il ne diminue pas, pour cela, le temps de travail. Il se, trouve qu’il s’effectue ainsi une production anormale supérieure aux besoins, qui vient à nécessiter la mise en chômage d’une partie du personnel lorsque le stockage se fait important.
Si on réduisait la longueur de la journée de travail, en utilisant au maximum le machinisme, il est incontestable que tous les bras seraient employés.
En maintenant complet ce réservoir d’hommes en chômage dans lequel, il peut puiser, tout à son aise, pour briser toutes velléités de mieux-être de la classe ouvrière, on conçoit facilement que le patronat se soit opposé, dans tous les pays, avec tant de force et de persévérance à l’application de la journée de 8 heures.
Là, comme en toutes choses, seule la force ouvrière organisée intelligemment et puissamment, pourra faire disparaître le chômage qui découle des trop longues journées de travail.
Jusqu’à ce qu’il en soit ainsi, le chômage perdurera et, avec lui, toutes les misères qui en découlent, toutes les maladies, toutes les tares sociales qui en sont les conséquences.
Il y a une autre sorte de chômage, c’est celui qui est décidé par les ouvriers soit par protestation, soit pour participer à une manifestation quelconque. Le 1er mai est un jour de chômage de ce genre.
— Pierre BESNARD.
CHRISTIANISME
— Voir Religion
CITOYEN
n. m. Terme d’antiquité
Ce mot n’a jamais eu de féminin. Il n’a d’usage moderne que pour les ironistes conscients, politiciens ou non, et pour les imbéciles. Quelques bavards de réunion publique poussent la plaisanterie jusqu’à appeler leurs auditrices : citoyennes. La plaisanterie n’est pas beaucoup moins forte d’appeler citoyen n’importe quel homme d’aujourd’hui. Il arrive à tel orateur érudit de citer le mot d’Aristote : « Le citoyen se doit à l’État ».
Les pauvres gens qui font usage de l’argument d’autorité ont le droit de s’appuyer sur cette parole d’Aristote à peu près comme le naturaliste qui décrit le lézard a le droit de le comparer au plésiosaure. Le citoyen est une espèce qu’Aristote a connue mais qui est disparue depuis longtemps.
Le caractère spécifique du citoyen, c’est la participation aux fonctions de l’État. Or l’État, — nous enseignent Aristote et la pratique des anciens — a deux fonctions principales : légiférer et juger. Le citoyen, celui qui « appartient à l’État », c’est l’homme qui juge et qui fait partie de l’Assemblée législative. Un député est, pour quatre ans, un quart de citoyen : il ne juge pas et les lois qu’il vote n’ont de force que si elles sont approuvées par un autre ramassis de quarts de citoyens, le Sénat. Dans la classification que nous faisons d’après Aristote, le juge, animal supérieur, est un demi-citoyen. Quant à nous, pauvres gens, dont tout l’office social consiste à subir l’arbitraire des lois et des faiseurs de lois, et des appliqueurs de lois, Aristote constaterait en bouffonnant qu’on nous a châtrés des deux puissances du citoyen. Nous appliquer le beau titre historique, c’est proprement s’émerveiller devant la virilité des eunuques et les prier de remédier à la dépopulation de notre cher pays.
Mais, peut-être, à nous entendre nommer citoyens, le rire d’Aristote serait différent. Il se souviendrait de Diogène, allumerait sa lanterne, la promènerait devant nos visages et proclamerait qu’elle n’a éclairé que des faces d’esclaves.
Aux armes, citoyens...
HAN RYNER.
CIVILISATION
n. f.
La définition du mot est assez complexe, car au sens général il est employé par diverses écoles historiques et sociales de façon différente et c’est ce qui prête à confusion. La meilleure définition, malgré sa brièveté, nous semble être celle que nous empruntons à Lachatre : « Ce qui est civilisé, par opposition à la sauvagerie ». En effet, la civilisation est l’ensemble de la vie sociale, qui marque une époque d’évolution morale et de développement intellectuel et scientifique sur l’époque précédente. Elle doit être une course ininterrompue vers le progrès et une victoire constante de l’esprit sur l’égoïsme brutal qui anime trop souvent l’humanité. La civilisation est toujours relative à une époque et il faut la comprendre non pas dans le temps, mais dans son temps, et c’est ce qui explique que certaines populations, à des dates indéterminées de l’histoire ont été considérées comme les plus civilisées, alors que de nos jours elles seraient qualifiées de barbares. « L’humanité peut être comparée à un homme qui ne vieillissant jamais, ne mourant jamais, n’oubliant rien, avancerait continuellement dans la science et dans la raison » (Pascal). On peut donc dire de la civilisation, quelle est la marche en avant de l’humanité, abandonnant sur sa route les vieux préjugés néfastes à l’épanouissement de l’individu et de la collectivité, elle poursuit la réalisation du bien-être social. Son but — si toutefois la civilisation a un but — ne peut être que la fraternité, la liberté et l’égalité de tous les hommes. Tout ce qui s’oppose par les faits ou par les idées au bonheur des humains ou qui éloigne l’ère de leur libération est contraire à la civilisation.
La civilisation ne s’impose pas par la force brutale et c’est un paradoxe des temps modernes de prétendre que les nations les plus civilisées sont celles qui sont les plus fortes militairement. En vérité, l’étude et l’observation de l’évolution historique nous portent à affirmer que la plupart des civilisations passées se sont écroulées en abusant de la violence. Malheureusement, et de nos jours encore, la force a toujours triomphé dans une certaine mesure de la raison, du droit et de la logique et les civilisations furent souvent subordonnées à la brutalité et à l’ambition des hommes qui ne savaient ni maîtriser leurs instincts, ni mettre un frein à Ieur désir de dominer. C’est toute I’histoire de l’humanité qu’il faudrait écrire pour traiter de la civilisation ; c’est toute l’histoire des peuples et des nations qui, depuis des siècles et des siècles, nous lèguent en héritage le produit de leurs recherches et de leur savoir.
La civilisation ? C’est la Chine, aujourd’hui broyée sous les dents voraces d’un capitalisme international qui, il y a cinq mille ans, donnait déjà le jour à des savants, des philosophes, des agriculteurs, dont les connaissances n’atteignaient certes pas celles de nos savants modernes, mais qui défrichaient le terrain, permettant ainsi aux générations futures de s’acheminer vers un avenir meilleur. La, civilisation ? C’est la lumière qui, pendant trois mille ans, jaillissant de ce grand empire, par la sagesse, le travail, la courtoisie, l’austérité des mœurs de son peuple, illumina le monde, malgré les divisions régnant au sein de la nation, malgré les vices, les débordements, la licence, l’ambition des grands et des seigneurs qui, finalement, devaient avoir raison de toute cette population soumise et pacifiste. Les efforts du grand Confucius, philosophe qui chercha, 500 ans avant notre ère, à redonner à la Chine un caractère moral et sain, furent vains. La Chine, décadente, fut écrasée sous le talon de la soldatesque. Il ne reste plus rien aujourd’hui de sa civilisation ; depuis deux mille ans, la Chine fut le théâtre de bien des invasions contre lesquelles elle ne sut se défendre, car ce peuple de plusieurs centaines de millions d’individus, qui pourrait mettre sur pied des armées formidables, ne possède pas l’art de la guerre. Sa civilisation, qui fut réelle, s’orientait vers d’autres buts et, désemparée, elle fut la proie facile de tous les conquérants qui, au nom d’une fausse civilisation, entendaient accaparer ses richesses. C’est toujours sous le fallacieux prétexte de « civilisation » que, de nos jours, la France, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, toutes les grandes puissances qui, au sens bourgeois du mot, sont des foyers de civilisation, tuent et pillent d’innocentes peuplades qui ne réclament que du travail et de la tranquillité.
Quel fossé sépare les civilisés de cette caricature de civilisation moderne que l’on voudrait nous faire accepter ! La civilisation ne peut évoluer que par le travail et la liberté du peuple, alors que, de nos jours, nous assistons à l’étalage le plus ignoble de l’oisiveté et de la paresse. Il semble que l’on revive dans nos pays occidentaux l’époque de la décadence Romaine, où le peuple, se contentant du pain et du cirque, se laissait mener et conduire par les maîtres du pouvoir. Toutes les civilisations d’antan sont mortes de la même mort.
L’histoire serait-elle une éternelle répétition ? C’est dans la paresse et le vice que s’est éteinte la civilisation chaldéenne. Et pourtant, 2.700 ans avant l’ère chrétienne, Babylone était maîtresse du monde. La richesse de son architecture amoindrirait sensiblement la prétention de nos fabricants de gratte ciels américains. La renommée de ses palais, de ses jardins, traversait les océans. L’utile n’était pas sacrifié à l’agréable et si les Chaldéens surent construire des châteaux et des terrasses, ornant les larges voies de cette ville fantastique de 80 kilomètres de tour, ils surent aussi, pour fertiliser une terre sèche et aride, creuser des canaux dont la construction dépasse, vu l’époque, l’imagination humaine. Ils surent creuser, afin de garantir les populations, des lacs immenses dans lesquels, durant les périodes de crue, venaient s’écouler les eaux de l’Euphrate. De tout ce travail gigantesque, de toute cette force dépensée par des générations, il ne reste plus que le souvenir et un amas de ruines. La fausse civilisation, la guerre a passé là, pour réduire à néant l’effort productif de milliers d’années ; et, de même qu’elle a détruit la civilisation chaldéenne, elle a détruit celle de l’Egypte, celle de la Perse, de la Judée, de la Grèce, de Rome ; les deux dernières plus récentes nous ont laissé plus que les précédentes le produit de leurs travaux manuels et intellectuels et si, aujourd’hui encore, on peut lire les grands poètes et les grands philosophes, de la Grèce et de la Rome antique en peut également contempler les ruines de leurs arènes et de leurs palais qui rappellent un génie architectural tout au moins égal sinon supérieur à celui de nos civilisations modernes.
On ne s’inspirera jamais assez de cette idée : que les conquérants militaires, que les hommes avides de jouissance et de richesses et qui sacrifient tout le présent, tout le passé, tout l’avenir à l’assouvissement de leurs bas instincts, sont les irréductibles adversaires de la civilisation. Et dans l’actualité douloureuse, où la civilisation pourrait être triomphante avec ses chemins de fer, son téléphone, ses aéros, sa T.S.F, elle est encore en lutte avec tous les puissants de la terre qui, en voulant accaparer toutes les richesses sociales et bénéficier seuls des découvertes multiples, entravent la marche en avant de l’humanité.
Cependant, malgré la route jonchée d’épines, la civilisation suit progressivement son cours.
Elle marque parfois un temps d’arrêt, mais elle reprend son chemin et repart, lentement sans doute, mais sûrement, pour atteindre son but. Rien n’est perdu des idées auxquelles elles donnent le jour, et si, sur un petit coin de la terre, une nation est détruite, un territoire anéanti par un fléau, ce n’est qu’un accident dans le temps et dans l’espace, qui ne peut arrêter sa marche en avant. Contre tous la civilisation triomphera. Si une puissance peut se permettre, durant une période plus ou moins longue, d’asservir les populations d’une autre puissance ; si la ploutocratie domine toujours et si Ia guerre n’a pas encore disparue de la surface du globe, il n’en est pas moins vrai, que les progrès de la science appliquée et du machinisme, que les découvertes sensationnelles de nos savants, que les idées émises par nos penseurs, planent au-dessus de nous et que tout travaille à la réalisation d’une humanité meilleure, c’est-à-dire réellement civilisée.
Les apparences, sont parfois trompeuses. Il peut sembler aux pessimistes que tout dégénère et que l’humanité rétrograde, que la civilisation décline. Aux heures de lassitude et de doute, il faut jeter un regard en arrière, contempler toute la route parcourue depuis des siècles .et des siècles et considérer les transformations formidables des sociétés. Si Ia civilisation, c’est-à-dire l’idée dominante de fraternisation humaine, a su résister à tous les assauts ; si elle ne fut pas anéantie malgré les catastrophes, les carnages, les brutalités de la religion, de la patrie, de l’Etat, c’est qu’elle répond aux besoins et aux désirs des hommes et que, seule, elle peut assurer la paix au sein des collectivités. Il faut l’aider ; et plus elle est enveloppée des nuages obscurs de la réaction qui cherche à l’étouffer, au nom d’un passé glorieux et de l’avenir qui sera éclairé par ses flambeaux, plus il importe de la défendre. Il faut la défendre pour qu’elle réalise enfin l’idéal que nous, Anarchistes, nous voulons voir se matérialiser : le bonheur et le bien-être pour tous.
— J. CHAZOFF.
CIVISME
n. m.
Montesquieu appelait le civisme une « vertu politique » et ajoutait : « C’est un renoncement de soi-même. On peut le définir l’amour des lois et de la patrie. » On peut donc également ajouter en empruntant le mot à J.-J. Rousseau : « Les nations manquent aujourd’hui de civisme. » Et il ne peut en être autrement ; car il n’y a pas de vertus politiques ; il ne peut y avoir que des erreurs politiques, les qualités et la politique ne pouvant faire bon ménage. Le civisme n’est donc pas, selon nous, une vertu, mais une erreur, et le « bon citoyen », un homme aveuglé qui se laisse tromper par les apparences et leurrer par ses représentants.
Au lendemain de la Révolution française, on exigeait de toute personne voulant occuper une fonction publique, un certificat de civisme. De nos jours encore, pour avoir le droit de remplir ses devoirs « civiques », il faut faire preuve de son honorabilité et de son honnêteté. Ce qui n’empêche pas que nous soyons toujours et que nous serons toujours gouvernés par des coquins, malgré le civisme des électeurs. Le civisme est donc bien, comme le dit Montesquieu, une « vertu politique » mais elle est purement politique et nullement morale et logique. Pour nous, anarchistes, nous n’avons pas à nous embarrasser de civisme ; mais il faut s’attacher à en détruire l’esprit ; car l’amour des lois et de la patrie, est une qualité néfaste à l’évolution des individus et des sociétés.
CLAN
n. m.
Vient du mot écossais « Klaan » qui servait à désigner une tribu composée d’un certain nombre de familles. Les clans persistèrent fort tard en Ecosse et en Irlande et leurs mœurs étaient simples et pures ; mais vers le milieu du XVIIIème siècle, les populations paisibles des montagnes écossaises furent persécutées et assassinées par Georges II et, à dater de cette époque, disparurent les derniers vestiges du clan. A présent, dans le langage courant, le mot est employé pour désigner une fraction qui, au sein d’un parti ou d’une organisation, se singularise par une particularité quelconque qui la sépare du reste du groupe. Il se forme dans toute association des clans qui se combattent, s’opposent et parfois se déchirent. Généralement, les individus se groupent autour d’un homme : le chef de clan.
En Amérique, le Ku Klux Klan est une organisation réactionnaire groupant des milliers d’individus, et il peut être assimilé à nos organisations fascistes occidentales. Ses procédés et ses agissements sont semblables à ceux employés en Europe par les émules de Mussolini, le dictateur italien.
CLARTE
n. f. (du latin : clarus)
Ce qui éclaire, ce qui est lumineux ; lueur, lumière. Antidote de obscurité. La clarté du jour ; l’obscurité de la nuit. Une clarté pâle, une clarté rayonnante, une clarté joyeuse. Il y a aussi la clarté qui est la lumière de l’esprit, et cette clarté de l’intelligence est aussi utile que la clarté du jour. Elle permet à l’individu de se faire comprendre tout en étant bref, mais précis, et évite bien des contradictions et souvent des erreurs. La clarté, c’est l’ordre dans le cerveau. C’est « elle qui est la loi fondamentale du discours » dit d’Alembert avec raison. Avec de la clarté on exprime nettement et facilement ses idées ; elle est donc indispensable à celui qui veut défendre ou soutenir une cause, car la meilleure des causes est perdue si elle est soutenue de façon équivoque et ambiguë. Il faut également de la clarté dans le style, lorsqu’on se permet d’écrire et d’exprimer ses idées et ses opinions par la plume. Rien n’est plus insipide, indigeste, qu’une prose lourde et équivoque, permettant toutes les spéculations. La clarté doit être la qualité première du littérateur s’il veut œuvrer utilement.
Mais ce qui est indispensable au-dessus de tout, c’est la clarté dans les conceptions. Que de discussions évitées, que de temps gagné, et que de travail social on pourrait fournir, si chacun savait clairement ce qu’il veut ! Il semble que le manque de clarté dans nos conceptions est ce dont nous souffrons le plus. Combien de socialistes sont perdus dans leur collectivisme dont ils ignorent même l’A.B.C. Combien de communistes sont incapables de déterminer ce qu’ils entendent par communisme et, comme il ne faut pas être plus tendre pour soi que pour les autres, combien d’anarchistes manquent de clarté et confondent une chose avec une autre ! Il est donc nécessaire que le militant acquiert, s’il veut sincèrement poursuivre l’œuvre qu’il a ébauchée et atteindre le but qu’il s’est fixé, cette clarté sans laquelle tout travail demeure stérile. La clarté dans les idées ? C’est le plus sûr moyen de communiquer avec autrui, de lui exprimer sa foi et sa croyance, et de lui faire partager ses opinions. Plus que tout autre, l’anarchiste doit être clair car son idéal est un idéal de lumière.
CLASSES (Lutte des)
Dans ce problème d’ordre sociologique, nous nous trouvons en face de deux thèses fondamentales, opposées. La première est la thèse bourgeoise. Elle reconnaît l’existence de différentes classes au sein de la société moderne, elle en reconnaît aussi les antagonismes. Elle ne peut pas nier ces faits. C’est leur explication qui est caractéristique. Pour les théoriciens bourgeois, l’existence et l’antagonisme des classes, — de même que l’inégalité des hommes par rapport aux capacités, intelligence, etc., qui, disent-ils, en est la véritable cause — sont des phénomènes normaux et, partant, immuables. Ce n’est pas tout. D’après eux, l’existence, l’antagonisme et la lutte aiguë des classes sont loin d’avoir l’importance qui leur est attribuée par les doctrines socialistes, syndicalistes ou anarchistes. A côté des intérêts de classe, il en existe, disent-ils, bien d’autres, beaucoup plus importants, se plaçant bien au-dessus des premiers, pouvant et devant les aplanir : tels les intérêts nationaux, ceux de la société prise en son entier, ceux des individus pris séparément, etc. De là, leurs considérations d’ordre pratique, leurs conceptions politiques, leur justification du système capitaliste. Les intérêts et les avantages des classes possédantes sont, d’après eux, naturels et légitimes. La nature même des sociétés humaines exige des organisateurs de la vie nationale, sociale, économique. La classe bourgeoise est précisément cette grande organisatrice. Il faut donc qu’elle subsiste et qu’elle ait en sa possession les moyens nécessaires pour pouvoir exercer ses fonctions qui sont de première importance. Il faut qu’elle commande, qu’elle dirige, qu’elle gouverne. La classe capitaliste est loin d’être celle des parasites. Au contraire, elle travaille beaucoup : elle organise la vie des masses, elle assure leur existence, l’ordre et le progrès de la société entière dont elle est un élément indispensable. Elle manie les capitaux, elle fait des dépenses, voir même des sacrifices... Elle court des risques... Il est donc dans l’ordre des choses qu’elle veuille être récompensée pour son action. Il faut que cette action compliquée, difficile, chargée de responsabilités, soit dûment rémunérée. Si les autres classes lui en veulent, tant pis pour elles : c’est de la non compréhension, de l’égoïsme, de l’envie, de la démagogie... Les intérêts de différentes classes de la société peuvent être parfaitement réconciliés. Ceci ne dépend que de leur bonne volonté. C’est l’État qui est appelé au rôle de conciliateur, en se plaçant au-dessus des intérêts des classes. C’est l’État qui doit atténuer et dissiper les antagonismes surgissant entre elles. Plus l’État y réussit, plus son existence et sa forme sont justifiées. Ce fut la démocratie qui, au cours du dernier siècle, prétendait être le mieux appropriée à remplir cette tâche. C’est le fascisme qui, de nos jours, écartant la démocratie disqualifiée, se targue de la même prétention. Telle est la thèse bourgeoise.
Elle est vigoureusement combattue par la conception de la lutte des classes par excellence : la conception marxiste. Sa formule, établie par Marx lui-même, porte que toutes les luttes ayant eu lieu au sein des sociétés humaines au cours de l’histoire, étaient, au fond, des luttes de classes. Plus encore. Le marxisme considère la lutte des classes comme l’unique élément réel, déterminant, de toutes les manifestations de la vie humaine. D’après lui, l’intérêt de classe se trouve invariablement à la base de toutes ces manifestations. Non seulement la vie sociale, économique, politique, juridique des sociétés humaines est déterminée par cet élément primordial, mais aussi tous les phénomènes de la vie spirituelle et intellectuelle : les luttes religieuses, les conflits nationaux, les sciences, les arts, la littérature, etc., etc., ne sont, pour les marxistes, que des expressions et applications différentes des instincts, des intérêts, des aspirations ou des mouvements de telles ou telles autres classes de la société. Il n’existe pas d’intérêts « nationaux », ni de la « société entière », ni des individus pris séparément » : il n’existe, au fond, que des intérêts de différentes classes, en lutte entre elles. Le reste n’est que parure, un trompe-l’œil pouvant égarer les profanes. Les origines des classes sont à chercher dans les lointains progrès de la technique et de la productivité du travail, lesquels, ayant porté un coup mortel à la primitive communauté des clans, amenèrent à un surplus de produits, à l’inégalité et, partant, à la division en classes, les unes se partageant le surplus des produits, ou plus-value, les autres en étant privées.
L’aspect des classes, et aussi celui de leurs luttes, varient au cours de l’histoire ; mais le fond de ces luttes reste toujours le même : les classes accaparant la plus-value, cherchent à la conserver à tout jamais et à tout prix, à subjuguer et à dominer celles qui en sont privées, tandis que ces dernières s’efforcent à secouer le joug, à se libérer, à supprimer la plus-value et, finalement, les classes elles-mêmes. La domination d’une classe donnée de la société est toujours plus ou moins passagère. Elle correspond à une époque historique déterminée, à un certain état de développement des « forces productives ». L’antagonisme et la lutte des classes découlent des « rapports de production » donnés.
Donc, les classes de la société ne sont pas immuables. Ainsi, à notre ère, la classe féodale a dû céder sa place à celle de la bourgeoisie. L’évolution ultérieure amena à la naissance d’une nouvelle classe, celle des prolétaires, dont les intérêts sont opposés à ceux de la bourgeoisie, et qui est en lutte contre cette dernière. Conformément à la doctrine marxiste, la classe prolétarienne est appelée à renverser la bourgeoisie, à s’émanciper et à rétablir une société sans domination ni lutte de classes.
A cette conception théorique des marxistes, répondent leurs considérations d’ordre pratique, leurs thèses politiques, toute leur stratégie de la lutte de classes. D’après eux, la bourgeoisie qui, à un certain moment de l’histoire, a bien joué un rôle progressif, le perd, à son tour, au fur et à mesure du développement économique ultérieur, et finit par devenir une force régressive. Actuellement, elle est en décadence. Aujourd’hui, c’est une classe parasitaire. L’état présent de l’évolution économique exige une autre forme d’organisation sociale et demande d’autres organisateurs. Cette nouvelle forme d’organisation est « l’État prolétarien ». Cet organisateur, c’est la classe prolétarienne. La classe capitaliste disparaîtra à la manière de la classe féodale. L’État n’est nullement un conciliateur placé au-dessus des classes. Bien au contraire, il est l’instrument le plus qualifié entre les mains des classes possédantes. C’est à l’aide de l’État — indépendamment de sa forme — que la bourgeoisie opprime et exploite la classe prolétarienne. L’État n’est, donc, qu’un instrument de domination de classe. Afin de supprimer cette domination, de vaincre la bourgeoisie, le prolétariat doit briser l’État bourgeois et organiser l’État prolétarien. Le prolétariat n’ayant aucun intérêt à exploiter qui que ce soit, l’État servira entre ses mains, non pas comme instrument d’exploitation, mais uniquement comme moyen de dominer la bourgeoisie résistante, de la vaincre définitivement, de la supprimer et de mener à bien la tâche de la réorganisation complète de la société moderne : la suppression des classes et de la domination de classe, le rétablissement d’une organisation sociale libre et égalitaire. Telle est la thèse marxiste.
Il faut ajouter que la doctrine socialiste en général comprend d’autres courants d’idée opposés en quelque sorte à la théorie strictement marxiste. Tout en se basant sur les principes fondamentaux de la lutte des classes exploitées, ces courants s’opposent, néanmoins, à réduire tout le processus historique à ce facteur unique. Ils conçoivent l’histoire humaine d’une façon beaucoup plus large. Ils admettent la grande importance d’autres facteurs historiques, en dehors de celui de la lutte des classes. Ils tiennent compte d’autres forces et éléments de l’évolution humaine. Et ce qui importe surtout, ils comprennent la notion même de la lutte des classes d’une façon beaucoup plus ample que les marxistes. Ils apprécient autrement le rôle de la classe paysanne, de celle des intellectuels exploités. C’est pourquoi, ils ont aussi une notion différente de la « dictature du prolétariat » (après sa victoire sur la classe capitaliste) et de l’ « État prolétarien ». C’est pour la même raison que les partisans de ces courants parlent des « classes exploitées et opprimées », des « classes travailleuses » plutôt que de la « classe des prolétaires », « classe ouvrière ». Du reste, ces courants sont en désaccord avec le marxisme « orthodoxe », non seulement par rapport à la théorie de la lutte des classes, mais aussi sur d’autres points, d’ordre philosophique et sociologique : ils font plus grand cas des mouvements psychologiques, éthiques et autres, formulant des objections à la doctrine du « matérialisme historique ».
Ajoutons encore que les conceptions marxistes — et aussi socialistes en général — ne sont pas d’accord sur la façon dont les classes exploitées doivent mener leur lutte, les unes (le socialisme « réformiste » de la droite, le « menchevisme ») préconisant la conquête graduelle et lente du pouvoir politique dans l’État bourgeois, les autres (le socialisme « révolutionnaire » de gauche, le bolchevisme) insistant sur la méthode brusque et violente. (Voir aussi : Antiétatisme, Bolchevisme, Menchevisme, Collectivisme, Socialisme, Marxisme, Réformisme, Parti Communiste.)
* * *
Vis-à-vis des doctrines exposées ci-dessus, quel est le point de vue anarchiste ?
Constatons, tout d’abord, que la notion classe (notion sociologique) n’est pas encore définie scientifiquement. Comme on le sait, le manuscrit du troisième volume du « Capital » (de Marx) s’arrête précisément au commencement de l’analyse de cette notion. Et quant aux autres ouvrages de ce penseur (et d’Engels), le mot « classe » y est employé dans des sens assez différents, étant souvent confondu avec des notions telles que « caste », « corps », « profession ». De sorte que l’on y chercherait en vain, non seulement une définition scientifique, mais même une notion plus ou moins précise de la classe sociale. Les autres auteurs sociaux — qu’ils soient bourgeois, socialistes ou autres (A. Smith, Voltaire, Guizot, Turgot, Mignet, Saint Simon, Considérant, Louis Blanc, Spencer, Proudhon, Ch. Gide, Kropotkine, Jules Guesde, Jaurès, Kautsky, Lénine, pour ne citer que les plus connus), — emploient tous le mot classe dans des sens divers et imprécis. Un jeune sociologue russe, P. Sorokine, qui a commencé, en 1920, la publication (en russe) d’un ouvrage capital de 8 volumes (« Système de sociologie »), essaye de donner, dans le deuxième volume (le dernier paru tant que je sache), une définition précise de la classe sociale. Cette définition est étroitement liée à toute son édification sociologique, très personnelle. Elle ne pourrait être comprise sans qu’on tînt compte de toute cette édification ; elle devrait, en outre, avant d’être généralement admise, subir l’examen et la critique...
C’est en partie pour cause de cette imprécision de la notion fondamentale qu’existent les désaccords et les divergences d’opinions dans les problèmes s’y rapportant. Plusieurs écrivains bourgeois critiquent sévèrement ce manque de clarté. Ils se moquent de tous ceux qui parlent de la « classe », de la « lutte des classes », de « la conscience de classe », etc., sans savoir exactement ce que c’est qu’une classe. Ces bourgeois ont tort. D’abord, parce qu’eux-mêmes opèrent avec nombre de notions indéfinies (il suffit de noter celle de Droit), ce qui ne les empêche nullement d’en faire usage, théoriquement et pratiquement. Ensuite, parce que, — comme c’est presque toujours le cas dans le domaine social -, tout en n’étant pas encore définies scientifiquement, les notions classe, lutte des classes, etc., sont suffisamment nettes intuitivement et répondent à des phénomènes historiques et sociaux indéniables, connus. On comprend, généralement, sous le mot de classe, un groupe social caractérisé par certaines propriétés se rapportant à l’avoir, à la profession et à l’étendue des droits dont il dispose. La différence énorme entre les groupes ayant à eux tout l’avoir, tous les droits et tous les avantages au point de vue profession (jusqu’à l’avantage de n’en exercer aucune) et ceux qui, n’ayant ni avoir ni droits, n’ont pour eux qu’un travail meurtrier, exploité par les premiers, est un fait historiquement certain et démontré.
L’anomalie de ce fait, à tous les points de vue et, partant, la nécessité historique d’un redressement social, sont des vérités acquises à tout homme sensé. La résistance des classes avantagées à ce redressement, pourtant historiquement nécessaire, est un fait indéniable. La lutte des classes désavantagées et exploitées, intéressées à ce redressement, contre les classes privilégiées et exploiteuses, est un fait qui joue un rôle de plus en plus prépondérant dans les événements sociaux des siècles derniers. Cette lutte remplit de son fracas toute l’histoire moderne. Ce sont ses succès qui, conjointement avec les conquêtes techniques de notre époque, marquent le pas du progrès humain. Il n’y a que les aveugles pour ne pas le voir.
Comme nous l’avons déjà dit, le manque de précision dans tout ce qui se rapporte à la notion « classe », divise entre eux les socialistes en général et aussi les marxistes. C’est la même imprécision qui explique, en partie, les désaccords entre les socialistes et les anarchistes. C’est elle encore qui désunit quelque peu les anarchistes eux-mêmes.
Arrêtons-nous, d’abord, sur ce dernier point.
Les intérêts normaux caractérisant et guidant les hommes vivant à notre époque, sont surtout de trois sortes : intérêts de classe, intérêts largement humanitaires et intérêts individuels. Un problème qui préoccupe beaucoup les milieux libertaires, est celui-ci : la conception anarchiste, est-elle une doctrine de classe, une conception humanitaire ou bien une théorie individuelle ? Il existe des courants anarchistes qui y répondent comme suit :
-
la conception anarchiste est largement et strictement humanitaire. Elle n’a rien à voir avec la doctrine de classe ou de lutte des classes. Elle doit, par conséquent, éliminer tout ce qui s’y rapporte, cette dernière étant une doctrine rigoureusement marxiste. L’anarchisme ne doit se préoccuper que des problèmes et des intérêts concernant l’humanité comme telle, sans distinction de classes. La lutte des classes n’est pas de son domaine ;
-
l’anarchisme est une conception rigoureusement individuelle. L’individu est l’unique réalité. La solution des problèmes le concernant résoudra le reste. Classes, humanité, voir même société, ne sont que des abstractions, des fictions dont un vrai anarchiste n’a pas à s’occuper.
Nous dépasserions le cadre de cette étude, si nous voulions pousser ici à fond la critique de ces points de vue. (Voir pour cela : Communisme, Individu, Individualisme, Société, Syndicalisme, Révolution , etc.) Bornons-nous à dire qu’une doctrine qui ne tiendrait pas compte du fait social saillant de l’histoire humaine durant des dizaines de siècles : la lutte des classes ou mieux la lutte des classes exploitées pour leur émancipation comme force progressive de nos jours, une telle doctrine serait, précisément, une abstraction, une fiction qui ne saurait avoir aucune valeur, ni sociale, ni humanitaire, ni individuelle. Elle ne saurait être qu’une doctrine d’aveugles ne pouvant jamais nous démontrer de quelle façon l’humanité entière ou les individus qui la composent, auraient pu arriver su maximum de bonheur possible sur la terre, en dehors de la lutte salutaire des millions et des millions d’opprimés.
Hâtons-nous de dire que ces deux courants forment dans les rangs du mouvement anarchiste international une infime minorité. L’énorme majorité des anarchistes — ceux surtout qui se nomment anarchistes communistes — résolvent le problème posé d’une tout autre façon. Ils déclarent que l’anarchisme est justement, essentiellement la conception susceptible de concilier, de satisfaire, aussi bien théoriquement que pratiquement, les trois sortes d’intérêts paraissant contradictoires : ceux des classes exploitées, travailleuses, ceux de l’humanité et ceux de l’individu. Ces anarchistes affirment qu’il n’y a pas lieu d’opposer ces trois sortes d’intérêts, mais qu’il faut, au contraire, s’efforcer de les rapprocher, de les souder. Malheureusement, le manque de précision dont nous avons parlé, ne permet pas encore de résoudre ce problème avec le fini voulu. L’une des tâches les plus pressantes de l’anarchisme est celle d’apporter à la synthèse de ces trois éléments : lutte des classes, mouvement humanitaire et principe individuel, le plus de précision possible. Ce serait le moyen le plus sûr de mettre un terme à la dispersion des anarchistes, d’activer leur unification. Or, cette tâche exige préalablement la définition plus exacte des notions : « classe » et « lutte des classes ». Ce n’est que par cette voie qu’on pourra arriver à une formule plus nette et plus complète, qui réconciliera définitivement, dans une motion harmonieuse et entière, les trois éléments en question, et précisera leur rôle respectif : la lutte des classes comme méthode ; l’organisation sociale humanitaire comme résultat de la victoire et de l’émancipation des classes opprimées, et aussi comme base matérielle de tout progrès social et individuel ; la liberté, l’épanouissement illimité de l’individualité, comme le grand but de toute l’évolution sociale.
Naturellement, une tâche de ce genre ne pourrait être entreprise que dans un ouvrage spécialement consacré à ce sujet.
Ici, il nous reste à constater que la majorité écrasante des anarchistes font leur le principe de la lutte des classes et reconnaissent la lutte révolutionnaire des classes exploitées contre les classes exploiteuses comme l’unique voie de progrès social à notre époque.
La question surgit alors : « Qu’est-ce qui sépare, dans ce domaine, les anarchistes des socialistes en général et des marxistes ? » Ce qui les sépare, ce sont, d’abord, quelques considérations d’ordre théorique. Ce sont, ensuite et surtout, des considérations d’ordre pratique qui découlent des bases générales profondément différentes des deux conceptions : socialiste et anarchiste, c’est, notamment, la façon dont l’une et l’autre conçoivent les formes, la tactique, la stratégie de la lutte des classes travailleuses.
En ce qui concerne le côté théorique ou, plutôt, historique du problème, la conception anarchiste se rapproche de celles des socialistes anti-marxistes dont il a été question plus haut. D’accord avec ces socialistes, les anarchistes s’opposent à réduire tout le processus historique à l’unique facteur de la lutte des classes. Ils conçoivent l’histoire humaine d’une façon beaucoup plus large. Ils admettent la grande importance d’autres facteurs historiques, etc. Ils forment des objections à la doctrine du soi-disant « matérialisme historique », etc. (Voir plus haut la caractéristique des courants socialistes opposés au marxisme « orthodoxe »). Une réserve est, toutefois, nécessaire : tandis que les socialistes (et aussi les marxistes entre eux) sont en désaccord par rapport à la voie réformiste ou révolutionnaire de la lutte sociale, les anarchistes sont tous partisans de la conception révolutionnaire, à l’exception, peut-être, de la tendance dite tolstoïenne qui conçoit la révolution d’une façon toute spéciale.
Ajoutons que les opinions des anarchistes sur les origines et le développement des classes ainsi que sur le rôle passé « progressif » de la bourgeoisie, diffèrent de la conception marxiste. (Voir, surtout, État où le problème d’origine et du développement des classes est traité plus à fond.)
Mais ce qui est surtout typique pour la différence entre les conceptions socialiste et anarchiste par rapport à la lutte des classes, c’est le côté pratique de la question.
Tandis que les socialistes de toutes tendances conçoivent la lutte des classes comme une lutte politique, ce qui les amène logiquement à la formation d’un parti politique appelé à conquérir le pouvoir politique et à organiser, à l’aide de ce pouvoir, le nouvel « État prolétarien » — organisme essentiellement politique et autoritaire exerçant la « dictature du prolétariat », — les anarchistes affirment que la lutte des classes est, positivement, une lutte apolitique, essentiellement sociale, n’ayant rien de commun ni avec les partis ou le pouvoir politique, ni avec l’État, l’autorité, la dictature, etc.
Les anarchistes affirment que la voie politique (parti, pouvoir, État, autorité, dictature), que la lutte politique (comprise dans ce sens) sont contraires à la lutte des classes. (Voir : Politique) Ils prétendent que cette dernière est déformée, mutilée, meurtrie et réduite à l’impuissance complète par les moyens politiques. Ils citent le cas du bolchevisme en Russie dont l’épopée confirme, à leurs yeux, leur point de vue. Ils déclarent que la lutte des classes, que toute action de classe désirant aboutir à une victoire réelle, doit être menée par les intéressés — les classes travailleuses elles-mêmes — s’organisant et agissant eux-mêmes, directement, sur le terrain strictement social, économique et de classe, sans recours aucun aux partis politiques ni à leurs programmes politiques de pouvoir, d’État, de dictature, etc. Ils pensent que la Révolution vraiment victorieuse, sera celle qui ne sera politique que négativement : c’est-à-dire, qui tuera toute politique, tous partis politiques, tout programme politique, tout pouvoir, toute autorité, tout État, toute dictature, et qui, au point de vue positif, s’efforcera à établir la société nouvelle sur des bases apolitiques, sociales, économiques.
Logiquement, l’anarchisme nie : le parti politique, le pouvoir politique, l’État, l’Autorité, la dictature. Il considère le soi-disant « État prolétarien » ou la fameuse « dictature du prolétariat » comme des non-sens, estimant que tout État et toute dictature ne peuvent être que des institutions essentiellement bourgeoises exploiteuses, et que tout moyen politique est également un procédé bourgeois.
C’est pourquoi, les anarchistes prétendent que leur conception, leur idéologie, sont les seules qui, réellement, s’appuient sur la véritable lutte des classes comme le levier immédiat de la salutaire Révolution sociale.
* * *
La différence des conceptions fondamentales mène, logiquement, à celle de toutes les notions dérivées. Pour les socialistes, la conscience de classe consiste en ce que l’exploité se rende parfaitement compte de ce qu’il appartient à la grande famille, à la classe des travailleurs dont les intérêts sont opposés à ceux de la classe bourgeoise ; qu’il soit, par conséquent, conscient de la grande tâche sociale de sa classe ; qu’il prenne part activement à la lutte menée par sa classe ; qu’il soit prêt à sacrifier, à tout instant, ses intérêts personnels à ceux de sa classe, etc. ; et, surtout, qu’il adhère au « parti politique de sa classe », qu’il « soit conscient de la nécessité des méthodes politiques, qu’il reconnaisse les principes de là conquête du pouvoir politique, de l’établissement de l’ « État prolétarien » et de la « dictature du prolétariat ».
Étant d’accord sur tous les autres points, les anarchistes rejettent, naturellement, le dernier. Ils affirment juste le contraire. Pour eux, tout exploité se rangeant à la doctrine politique, manque de conscience de classe : il est trompé ; il perd le véritable terrain de la lutte des classes ; il n’en a pas la juste notion. Pour eux, la vraie conscience de classe implique la condamnation des moyens et des buts politiques. Ils considèrent la confusion de la « classe » avec le « parti politique » comme un manque de conscience de classe.
Les socialistes et les anarchistes sont d’accord sur ce que la justice de nos jours est une justice de classe habilement masquée par les serviteurs des classes possédantes. Mais : tandis que les uns s’apprêtent à lui substituer la « justice » organisée par l’État dit « ouvrier », les autres, estimant que tout État sera fatalement bourgeois et qu’un « État ouvrier » est une illusion ou une tromperie, en concluent, logiquement, que cette nouvelle « justice » ne serait autre chose que la justice des nouveaux privilégiés, encore plus habilement masquée et dirigée contre les éternels exploités. La « justice » fameuse, exercée de nos jours dans l’État soviétiste, leur donne entièrement raison. Ils estiment, donc, que la véritable justice humaine aura lieu, après la Grande Révolution, en dehors de tout État et dans des formes n’ayant rien de commun avec les procédés politiques, étatistes, juridiques.
Les uns et les autres — les socialistes et les anarchistes — savent bien que l’armée moderne est une armée de classe appelée à défendre la classe possédante. Mais, tandis que les socialistes prévoient, après la révolution, une nouvelle armée d’État(« Armée Rouge » en Russie) qui, d’après eux, devra défendre les travailleurs, les anarchistes affirment que toute armée d’État défendra les privilégiés contre les travailleurs. Ils conçoivent la défense de la révolution dans des formes non étatistes, par les forces organisées des travailleurs, établies sur d’autres bases que celles d’une armée d’État.
Nous pourrions multiplier les exemples de ce genre, en parlant de l’éducation de classe, de l’enseignement de classe, de lascience de classe, et ainsi de suite. Après tout ce qui précède, nous le tenons pour superflu.
* * *
Une objection est faite assez souvent aux anarchistes, surtout par les « communistes » autoritaires. Si ce ne sont ni le parti politique, ni le pouvoir politique, ni l’État ouvrier, ni la dictature du prolétariat qui guideront l’action, la lutte de la classe ouvrière, la révolution sociale, qui assureront leur succès, leur victoire et la solidité de celle-ci, qui sera-ce alors ? Quelles seront les forces, les éléments et les organisations qui mèneront au succès complet, toute cette lutte formidable, et compliquée des classes exploitées et opprimées ?
La réponse des anarchistes ne serait point difficile, surtout aujourd’hui.
Les forces et les éléments ? Mais ce seront, naturellement, les classes exploitées et opprimées elles-mêmes.
Les organisations ?... Il y a une quarantaine d’années, les anarchistes y répondaient : la lutte des classes et son point culminant et final : la Révolution, devant être l’œuvre de ces classes mêmes, celles-ci trouveront sûrement les formes de lutte appropriées et créeront certainement leurs organisations qui répondront aux besoins de l’heure. Aujourd’hui, cette prévision s’est déjà, en partie, réalisée. La réponse peut, donc, être plus précise encore : des travailleurs ont créé dans tous les pays leurs organisations de lutte et de combat : les syndicats révolutionnaires. Tout en n’étant pas sans défauts — comme, du reste, toutes les institutions humaines, à notre époque surtout, — et sans qu’on songe à réduire à elles seules toute l’action, toute la conduite de la lutte et de la révolution, les organisations syndicales sont les prototypes des organisations de classe appelées à prendre sur elles quelques tâches fondamentales de cette lutte et de cette révolution.
C’est le syndicalisme révolutionnaire qui, en dépit de ses quelques faiblesses naturelles, excusables et peu importantes, en dépit aussi de son recul momentané à la suite de la guerre et de ses conséquences, donne aux partis politiques une réponse concrète. Elle est celle-ci. Ce ne seront ni les partis politiques, ni les groupements anarchistes qui mèneront la lutte de classe, l’action ouvrière, toute la formidable révolution à la victoire et au succès complet : ce seront les masses elles-mêmes, les millions et les millions de travailleurs des villes et des champs rassemblés dans leurs organisations sociales de classe, et non de politique — syndicats et autres — qui s’en chargeront (voir Syndicalisme ).
Les anarchistes sont en grande majorité d’accord avec cette réponse. La vie, l’histoire, l’avenir prochain décideront.
— Voline
CLASSIFICATION
n. f.
Ordre dans lequel on range les objets, les personnes ou les choses. Il y a également la classification des idées.
« La classification des lois ; la classification des connaissances ; la classification des marchandises. » Les connaissances humaines, à mesure que nous avançons dans le progrès, sont si étendues déjà et s’enrichissent chaque jour à tel point, les variétés de la nature sont si nombreuses, qu’il est impossible à l’intelligence humaine d’embrasser tout l’ensemble de l’univers. On est donc obligé de s’arrêter aux particularités qui forment l’ensemble, de manière à ne pas s’égarer dans la diversité des phénomènes. De là la nécessité, pour ne pas se perdre, de ranger chaque chose dans un cadre particulier si l’on veut étudier les rapports qui existent entre un objet et un autre. Il en est de même pour les idées et la science qui sont, elles aussi, obligées de classifier leurs connaissances et de les ranger par catégorie. La classification est la voie la plus convenable pour obtenir des résultats. Elle est sœur de la méthode et, comme elle, engendre la clarté. Elle nous permet de partir de l’inconnu pour atteindre le domaine du connu. La classification est donc un bien, à condition cependant de n’être ni artificielle ni superficielle et de ne pas se perdre dans l’abstrait. Comme en toute chose, l’exagération est néfaste, et la manie de classifier devient un défaut au lieu d’une qualité.
De nos temps, tout se classe et, dans nos sociétés bourgeoises, on classifie même les individus de même race et de même nation pour en faire des sujets différents les uns des autres ; de là le terme « classe » pour désigner une partie de la collectivité appartenant à une catégorie sociale. Si la classification des objets en genre, en famille est utile ; si la classification des idées et des découvertes scientifiques est indispensable ; la classification des hommes est un des vices des sociétés à base capitaliste et cette erreur disparaîtra avec les causes qui l’ont engendrée.
CLERGÉ
n. m. (du latin : clericatus)
Tout ce qui compose la corporation sacerdotale ; les archevêques, les évêques, les chanoines, les vicaires, les aumôniers, appartiennent au clergé séculier, c’est-à-dire qui prend contact avec la population ; le clergé régulier est en grande partie composé de moines menant une vie monastique. Le clergé est également divisé en classes et on distingue le haut clergé et le bas clergé. Le premier groupe les hauts dignitaires et les princes de l’église, alors que le second ne groupe que les prêtre de rang inférieur et qui accomplissent les besognes courantes de la paroisse.
Avant la Grande Révolution française, le Clergé était un des ordres les plus importants de l’État et bénéficiait de très gros privilèges. Ce fut un des bienfaits de la Révolution de détruire sa suprématie et d’amoindrir sa force. Malheureusement, si le Clergé a perdu de sa puissance, il exerce encore une assez grande influence publique qui n’est pas à négliger ; il est soutenu par toutes les forces de réaction auxquelles il ne refuse jamais lui-même son concours. Cela se comprend. « Le prêtre ne peut être utile qu’en qualité d’officier de morale » dit l’abbé Saint Pierre ; mais si nous fouillons aussi profondément que possible dans l’histoire, nous voyons que jamais le Clergé n’a accompli le rôle qui lui était assigné par la doctrine et Helvétius nous apprend que déjà chez les Égyptiens « les prêtres formaient un corps à part, qui était entretenu aux dépens du public. De là naissaient plusieurs inconvénients : toutes les richesses de l’État se trouvaient englouties dans une société de gens qui, recevant toujours et ne rendant jamais, attiraient insensiblement tout à eux. » Il en fut ainsi de tous les temps et, de nos jours encore, le Clergé est toujours à l’affut des richesses. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il n’y a aucune espérance d’améliorer cet ordre qui n’a d’autre utilité sociale que de perpétuer une erreur pour maintenir le pauvre dans l’ignorance et défendre les intérêts des riches. Les crimes du clergé, quelle que soit la religion dont il se réclame, sont innombrables et seront traités d’autre part. (Voir Église, Inquisition, Papauté, Religion, etc., etc.) Il a régné pendant des siècles par la terreur et, dans les pays où il détient encore le pouvoir politique, il n’hésite pas à se servir de moyens monstrueux pour conserver sa force et son autorité. Ayant acquis sa puissance dans le meurtre et dans le sang, le clergé s’est à jamais discrédité aux yeux de l’homme civilisé et il faut espérer qu’il disparaîtra un jour prochain, méprisé de tous et ne laissant de regrets qu’au cœur des inconscients et des barbares. Sa disparition sera un grand pas de franchi vers la libération des humains, car elle marquera la mort de certains préjugés de croyance en une puissance immatérielle, et permettra à l’homme d’évoluer plus librement vers son entière émancipation morale, matérielle et intellectuelle.
CLÉRICALISME
n. m.
Il faut entendre par ce mot le mouvement politique et social qui considère la Religion, et plus spécialement la Religion catholique comme le fondement le plus sûr de « l’Ordre » basé sur le principe « Autorité » et sur le fait « Gouvernement », mouvement qui, par voie de conséquence, tend à attribuer la direction de la chose publique, plus encore : la domination universelle à l’Église catholique, apostolique et romaine et à placer cette domination entre les mains du clergé séculier et régulier composant le parti « Prêtre ».
Ce qui caractérise le cléricalisme, c’est son irréductible opposition à toutes les mesures et pratiques s’inspirant de la pensée laïque, favorisant et secondant le renforcement de celle-ci. C’est la constatation de cette intransigeante opposition à l’expansion laïque qui a arraché à Léon Gambetta ce cri de guerre : « Le Cléricalisme, voilà l’Ennemi ! » Le trait essentiel du cléricalisme, c’est la souplesse d’allures au service de desseins précis et de buts déterminés : « La fin justifie les moyens » déclare le Cléricalisme et, armés de cette devise, usant et abusant avec impudence de cette formule qui, par anticipation, a la vertu de tout justifier, voire de tout exalter, les adeptes du cléricalisme qu’on appelle communément « les cléricaux » font usage, le cœur léger et la conscience sereine, des agissements les plus indélicats, des procédés les plus criminels, des manœuvres les plus perfides, des crimes les plus abominables.
Un autre trait par lequel se distinguent les cléricaux, c’est la persévérance, l’obstination, l’opiniâtreté, la constance étonnante avec laquelle, quelles que soient les difficultés, ils poursuivent les fins qu’ils ont assignées à leurs efforts. Ont-ils vent en poupe ? Ils y marchent à toutes voiles ; s’ils ont vent contraire, ils louvoient, courent des bordées, disparaissent même un instant à l’horizon pour reparaître tout à coup, le cap toujours mis sur le but à atteindre.
Pour appartenir au parti clérical, pour faire son jeu, il n’est pas indispensable de porter capuchon ou soutane. Les cléricaux les plus dangereux sont ceux qui, pareils aux mouchards ― et mouchards en effet ― ne portent pas de livrée. Le Basile de la Comédie est un personnage antipathique, répugnant ; mais il n’est guère dangereux : son grand chapeau et ses tirades sur la calomnie le font trop aisément reconnaître. Le vrai Basile sait à merveille se camoufler. Il ne se démasque que le moment venu et en cas de besoin.
Le but que poursuit l’Église depuis le IVe siècle de l’ère chrétienne, c’est de mettre la main sur le mécanisme mondial et, sous couleur d’instaurer sur la terre le règne de son Dieu, d’y établir solidement celui de son clergé. Cette dictature à la fois spirituelle et temporelle, les cléricaux l’ont eue ; ils l’ont en partie perdue et ils ambitionnent de la reconquérir. Cette reconquête, c’est le but vers lequel ils marchent formant trois colonnes : la première est composée des ambitieux ; la deuxième des hypocrites et la troisième de la masse des ignorants, des crédules et des niais.
L’idéal inavoué des cléricaux, c’est le moyen âge, que leurs légendes qualifient de « bon vieux temps ». L’organisation politique qui a secrètement toutes leurs préférences, ce serait, si possible, la monarchie absolue et, au pis aller, la monarchie constitutionnelle ; de toutes façons, un pouvoir fort et centralisé constamment en état de contenir les aspirations populaires tendant à l’émancipation des masses laborieuses, et toujours en mesure de mâter ces aspirations aussitôt qu’elles prennent une tournure alarmante.
L’interprétation de l’Histoire, d’après l’esprit clérical, est tout à fait singulière. Elle mérite d’être notée. Voici comment s’exprime sur ce point le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle. « Vous croyez peut être qu’il s’est opéré, au XVIe siècle, une réforme qui, au prix d’un million de têtes, a émancipé la conscience humaine ? Vous avez peut-être lu quelque part que, deux siècles après, il a surgi du sol de France toute une cohorte de philosophes, Voltaire en tête, qui, sans autres armes qu’un flambeau et un fouet, ont chassé et refoulé dans les ténèbres du Moyen-Âge les fantômes sanglants qui tentaient d’en sortir. Et vous aurez sans doute entendu dire que, vers la fin de ce même siècle, il s’est trouvé toute une autre pléiade de grands hommes pour traduire dans les faits sociaux les conquêtes de la philosophie. Sous le nom de Révolution, ou plutôt d’Évolution, vous saluez l’ère nouvelle où, pour la première fois, le mot d’humanité a pris un sens ; où l’homme, devenu l’égal de l’homme, a pris possession de lui-même et a pu s’acheminer enfin, libre d’entraves, vers ses glorieuses destinées. La liberté matérielle et morale, le progrès des sciences, l’avènement du règne de la Justice, l’adoucissement des lois pénales, l’épuration des mœurs, tous ces fruits du travail de nos pères vous semblent beaux à l’œil, doux à la bouche ; vous trouvez, en définitive, que l’arbre de la science du bien et du mal ne mérite plus aujourd’hui les malédictions dont il fut couvert au temps de notre premier père ?
Eh bien ! Votre erreur est complète. Luther n’est qu’un suppôt de Satan, et Voltaire est Satan en personne. Le XVIe siècle que, dans votre naïveté, vous appelez le siècle de la Renaissance, n’est que le triomphe momentané de l’impiété et de la révolte contre Dieu, révolte justement punie par les sacs de Magdebourg et la Saint-Barthélemy. C’est aussi justement, depuis lors, que l’homme, privé de la lumière céleste, dont les bûchers de l’Inquisition n’étaient qu’un reflet, erre à tâtons dans la région des ténèbres. Le grand siècle, c’est le suivant : illustré par les Dragonnades des Cévennes, et par la bulle Unigenitus. Au XVIIIe siècle, le flambeau de la Foi parait s’éteindre ; Voltaire, Helvétius, le baron d’Holbach, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Diderot et les Encyclopédistes, toutes les portes de l’Enfer enfin vomissent contre la religion leur souffle empesté. Mais rassurez-vous, l’Évangile l’à dit, les portes de l’Enfer ne prévaudront pas contre elle. Dans ces temps mauvais, il se trouve encore quelques justes, en faveur desquels Dieu pardonne encore à Sodome et à Gomorrhe. Les saintes traditions sont continuées par l’abbé Dubois, Fréroz, Nonotte, Patouillet, Mme Dubarry et l’abbé de Bernis et les fidèles goûtent encore quelques consolations autour des échafauds de Calas et du Chevalier de la Barre. Les vengeances de Dieu éclatent par le déchaînement des passions révolutionnaires ; et contre ces scélérats de Bailly, de La Fayette, de Hoche et de Marceau, Dieu suscite les Macchabées de la Vendée, ces héros de la Foi qui ont sauvé la France malgré la Convention. »
Le morceau est un peu long. Mais il faut considérer qu’il est extrait du Grand Larousse Universel et qu’il emprunte à cette origine une saveur toute particulière.
* * *
J’ai dit, un peu plus haut, que le cléricalisme, autrement dit le Parti-Prêtre, travaille à la reconquête de l’hégémonie mondiale et que cette armée noire s’avance sur trois colonnes : celle des ambitieux, celle des hypocrites et celle des imbéciles.
Ces trois colonnes constituent un front étendu et compact dressé contre l’esprit des sociétés modernes, et ces trois colonnes forment une armée redoutable dont toutes les parties reçoivent les mêmes mots d’ordre et obéissent à la même direction. Ce sont les ambitieux qui donnent l’impulsion ; mais ils le font si discrètement, que les hypocrites n’aperçoivent que faiblement le point de départ et le but immédiat des mouvements ordonnés et que les imbéciles exécutent ces mouvements et subissent l’impulsion sans comprendre où on les mène. La grande habileté du Jésuitisme contemporain ― qui est l’âme du cléricalisme ― consiste à cacher sa main, à masquer son but, à ne plus parler autant de la gloire de Dieu et des intérêts supérieurs de l’Église, mais à rallier à sa cause les intérêts matériels en se faisant aussi mondain que le siècle. Son grand art consiste à faire peser sur les peuples des terreurs imaginaires et à s’ériger en défenseur des grands principes sociaux de la famille, de la propriété et de l’État. Les meneurs du cléricalisme ne manquent jamais d’envahir les avenues du Pouvoir, afin de se faire les distributeurs des honneurs, des bénéfices et des sinécures grassement rétribuées. En s’adressant à la gloriole idiote des uns et à la basse cupidité des autres, les cléricaux ont toujours la certitude de grouper autour d’eux, une nombreuse et fervente clientèle. C’est par de tels moyens qu’ils parviennent souvent, très souvent, trop souvent, à trouver des appuis et des complicités parmi ceux-là mêmes qui, dans leur jeunesse, ont reçu une éducation libérale et laïque et qui, appartenant à la bourgeoisie, sont initiés à tous les progrès de la science, des arts, de l’industrie, du négoce et de la finance. Ceux-là, ce sont les hypocrites, les composants de la deuxième colonne. Quant aux sots et crédules, superstitieux et ignorants, qui forment la troisième colonne, ils sont légion. Ce sont les « bonnes âmes » ― entendez par là les crétins ― des villes et des campagnes qui se marient à l’Église, vont a confesse, communient à Pâques, font maigre le vendredi, se rendent à la messe le dimanche, font baptiser leurs enfants, leur font apprendre le catéchisme et faire leur première communion et meurent enfin munis des Sacrements de l’Église. C’est toute cette race indécrottable de moutons de Panurge qu’on flatte en les qualifiant de « braves et honnêtes gens », bien qu’ils ne soient ni honnêtes ni braves, à moins que l’honnêteté ne réside dans la crainte et le respect du gendarme et du garde champêtre, à moins qu’il ne suffise, pour être brave de faire comme tout le monde et d’éviter de vivre en délicatesse avec le Code.
* * *
Sur la route du Progrès social, le cléricalisme multiplie les embuscades et les obstacles. Du haut des chaires innombrables dont dispose le clergé de toutes les religions, la parole de résignation et d’obéissance retentit et s’adresse à des auditoires considérables. Les homélies qui, des lèvres des curés, des missionnaires, des pasteurs et des rabbins, tombent en pluie de soumission sur les foules que le culte rassemble dans les lieux où l’on prie, ces homélies entretiennent dans les masses les préjugés et les erreurs, sur lesquels reposent et perdurent les sociétés autoritaires et capitalistes que la propagande et l’action anarchistes ont la mission d’abattre. La bourgeoisie voltairienne a-t-elle compris que le cléricalisme est le rempart qui protège et défend le plus solidement ses privilèges de classe ? La démocratie républicaine et laïque s’est-elle rendu compte que l’athéisme conduit directement et fatalement à l’Anarchisme et que, du jour où les hommes auront eu la sagesse de vider le ciel des béatitudes fallacieuses dont les religions s’ingénient à l’embellir, ils travailleront à peupler la terre des félicités que permettent, d’ores et déjà, de réaliser les applications de la science ? Il me paraît judicieux de répondre à ces questions par l’affirmative. Car bourgeois Voltairiens, républicains, laïcs, démocrates consentent bien à faire la guerre au cléricalisme, mais pas à la religion. Ils se disent et croient être anticléricaux ; mais ils ne sont pas antireligieux, Et pourtant !...
Actuellement, le Cléricalisme est moins un courant religieux qu’un parti politique, une organisation économique et un mouvement social.
Il garde sa doctrine religieuse qui est sa raison d’être, ses temples qui lui permettent de réunir ses adeptes et de les tenir dans sa main, ses écoles par lesquelles il assure le renforcement de son influence, ses œuvres grâce auxquelles il reste en contact, hors des cérémonies cultuelles, avec le public. Mais un observateur averti ne saurait être abusé : ce n’est plus la foi religieuse qui fait sa force et son action serait inopérante, si elle se cantonnait dans le domaine exclusivement confessionnel.
Même quand il est ostensiblement combattu par certaines fractions de la bourgeoisie, le Cléricalisme est sournoisement soutenu par ces fractions qui, escomptant son appui aux heures difficiles, sont contraintes à le ménager. Même quand il est publiquement attaqué par certains partis politiques dits « de gauche » il est défendu, indirectement et dans la coulisse, par ces mêmes partis qui ont intérêt à ne pas se rendre hostiles les masses électorales dont il inspire les suffrages.
Ces fractions et ces partis se doivent de ne pas heurter de front la Religion, parce qu’ils sont anticléricaux, mais ne sont pas antireligieux. Ils professent l’opinion que le « spirituel » et le « temporel » sont choses entièrement distinctes et qui peuvent rester étrangères l’une à l’autre. Ils prétendent que la religion est une affaire de conscience individuelle, et d’ordre privé et ― fait incroyable et pourtant exact ― c’est au nom même de la liberté, qu’ils proclament un principe sacré et inviolable, qu’ils se déclarent respectueux des sentiments religieux que chacun peut avoir.
Profonde et dangereuse est l’erreur de ces anticléricaux.
Tout d’abord, il n’est pas vrai que le « temporel » et le « spirituel » puissent pratiquement vivre dans l’ignorance, encore moins dans l’indépendance réciproques.
Pour le croyant attaché à une religion, le « spirituel » c’est tout ce qui a trait à l’âme et le « temporel » tout ce qui concerne le corps. Le croyant prie : fait spirituel ; il mange : fait temporel. Il songe à la vie éternelle et s’y prépare : fait spirituel ; il se préoccupe de la vie terrestre et des besoins immédiats et matériels qu’elle implique : fait temporel. Comme croyant, il est l’égal de tous, sans qu’il faille tenir compte de sa situation : position spirituelle ; mais, comme homme, il est riche ou pauvre, patron ou ouvrier, gouvernant ou gouverné : position temporelle.
Son existence se trouve, ainsi, et à tout instant, le fait d’un indissoluble amalgame du « spirituel » et du « temporel », des besoins de l’âme et des nécessités du corps, de l’égalité religieuse et de l’inégalité sociale.
Et il serait possible qu’une distinction, qu’une sorte de cloison étanche séparât, isolât sa vie spirituelle de sa vie temporelle ?
Le penser serait tout simplement absurde. Cet isolement peut-être conçu spéculativement, mais, pratiquement il ne peut exister.
« Car, pour être croyant, on n’en est pas moins homme. »
Pour le croyant, la vie n’est due qu’à l’union intime de l’âme et du corps et la séparation du corps et de l’âme, c’est la mort. En sorte que vouloir séparer ce qui intéresse l’âme (le spirituel) du croyant de ce qui touche à son corps (le temporel) ce serait le condamner à mort dès sa naissance. Ce serait, il faut l’avouer, apporter à ce problème délicat du « temporel » et du « spirituel », une solution aussi imprévue qu’insensée.
En dépit de la multiplicité de ses organes et de la complexité de ses besoins, l’individu est un. Il n’est pas, quoi qu’on puisse dire, un agrégat composé de deux éléments simples et de nature différentes : le corporel et l’incorporel. II forme un tout parfaitement homogène dont les diverses parties sont unies par une rigoureuse solidarité ; et si, pour satisfaire aux exigences d’une classification utile, voire nécessaire, on a groupé ses fonctions et ses besoins en spirituels et en matériels, ce n’est pas parce que cette classification correspond à une réalité, mais uniquement parce qu’elle favorise l’observation, facilite l’étude de ce qui est humain et fournit au langage des expressions qui qualifient des phénomènes d’un ordre distinct.
Le corps humain est une merveille de délicatesse et de complexité ; c’est aussi une merveille de solidarité, c’est-à-dire d’unité dans la diversité. On ne peut donc raisonnablement séparer ce que, dans le vocabulaire des religions on appelle le « spirituel » de ce qu’on dénomme le « temporel » ; encore moins est-il possible d’opposer ceci à cela : l’homme est un.
Il éprouve le besoin de penser comme celui de digérer. Il pense avec son cerveau et digère avec son estomac ; comme il voit avec ses yeux et entend avec ses oreilles. Mais si le cerveau, l’estomac, les yeux et les oreilles, sont les sièges et les organes de fonctions diverses, l’être qui pense est le même que celui qui digère, voit et entend.
Les anticléricaux qui veulent séparer, isoler le « spirituel » du « temporel » tombent, à leur insu, dans le piège que leur tendent les arguties théologiques. Ce sont des religieux qui s’ignorent.
Pour moi qui ai banni de mon esprit toute croyance religieuse et qui, partant, repousse cette idée du « spirituel », idée mystique, qui ne représente rien de réel ; pour moi qui ne sépare pas l’être humain en corps matériel et périssable et en âme immatérielle et impérissable ; pour moi qui, dans ces conditions, ne saurais admettre que l’âme prisonnière, dans le temps, de sa loque mortelle, soit appelée à entrer dans la vie éternelle, dès qu’elle aura cessé d’être captive, le problème de la confusion où de la séparation du « spirituel » et du « temporel » ne se pose même pas.
Mais il se pose pour les simples « mangeurs de curés » et pour les politiciens « de gauche », et je viens d’établir que la séparation qu’ils tentent est impossible, du fait que le croyant est un être soumis à toutes les nécessités naturelles. On peut même concevoir qu’il cesse d’être croyant sans cesser d’être un homme, tandis qu’il n’est pas possible d’imaginer qu’il cesse d’être un homme sans qu’il cesse, ipso facto, d’être un croyant. En d’autres termes, un homme peut vivre sans croire, mais il ne peut vivre sans boire, manger, dormir, respirer, etc., ce qui fait que, si l’individu peut négliger le « spirituel », il lui est radicalement impossible, quelque part qu’il accorde au spirituel, de négliger le « temporel ».
Le « temporel » peut, à la rigueur, ignorer le « spirituel » et n’en tenir aucun compte, alors que, par contre, le « spirituel » ne peut ignorer le « temporel » et est dans la nécessité d’en faire état.
Lorsque les anticléricaux, se disant respectueux du « spirituel », demandent que le croyant ne mélange pas le « spirituel » et le « temporel », ils demandent donc l’impossible.
S’il est impossible à un croyant, pris individuellement, vécût-il dans la solitude, de séparer pratiquement le « spirituel » du « temporel » il l’est, a fortiori, à l’homme vivant en société, à l’être social.
Ce croyant est plongé dans un milieu social donné ; il Y est comme dans un bain dont il subit la température et les propriétés. Allez-vous lui demander de rester indifférent au froid excessif ou à la chaleur exagérée du liquide ? Croyez-vous que, s’il gèle, il ne tentera pas d’élever la température de son bain et que, s’il cuit, il ne cherchera pas à l’abaisser ?
Pensez-vous que, s’il peut choisir entre un bain de vitriol et un bain d’eau parfumée, il ne préfèrera pas l’eau au vitriol ?
Soyez certain, absolument certain, qu’il mettra tout en œuvre pour que son bain soit d’eau parfumée et non de vitriol, de liquide propre et non sale, de température moyenne et non trop basse ou trop élevée. J’espère que vous n’en pouvez douter.
Eh bien ! Sachez, radicaux, francs-maçons, anticléricaux et libres-penseurs de toutes nuances et de tous groupements, que, pour le chrétien ― je parle du chrétien sincère, convaincu, désintéressé, loyal, du chrétien pour qui la religion n’est une question ni de bonne compagnie, ni d’avancement, ni de boutique, du chrétien qui aime véritablement son Dieu et qui, plutôt que d’abjurer sa foi est prêt à souffrir ― sachez, dis-je, que, pour ce chrétien, une Société sans Dieu, c’est l’eau sale, c’est le liquide brûlant ou glacial, c’est le vitriol ; sachez que l’eau propre, le liquide à température moyenne et l’eau parfumée, c’est la société chrétienne. Sachez que ce chrétien a le devoir impérieux de tout faire pour que l’eau de son bain se débarrasse de sa crasse et devienne propre, pour que la température cesse d’y être trop élevée ou trop basse et pour que l’eau parfumée remplace le vitriol. Sachez que s’il ne consacrait pas tous ses efforts, toutes ses ressources, tous ses moyens d’actions à obtenir, pour lui et ses frères, ce résultat, il encourrait la damnation éternelle. Sachez que, si sa conscience ne suffisait pas à lui imposer l’étroite obligation de travailler dans ce sens, il y serait poussé par les prédications de ses pasteurs, par les conseils ou menaces de son confesseur, par les journaux qu’il lit, par la propagande qu’il soutient, par le groupe chrétien dont il fait partie, par son entourage et par sa famille.
Rappelez-vous que, de tous temps et en toutes circonstances ― on ne saurait trop le répéter ― l’Église s’est mêlée aux événements temporels, que son action a constamment pesé sur les événements dans toute la mesure de ses forces, qu’elle a toujours, secrètement mais passionnément, ambitionné de tenir l’humanité sous son joug, que son histoire : toute de ruses, de mensonges, de manœuvres politiques, de despotisme et de violence atteste qu’elle a sans cesse été animée de l’irréductible volonté de modeler la société à son image et qu’elle a mis au service de ce but toutes les ressources de sa diplomatie, toutes les forces de son organisation et toute la puissance de ses trésors.
Conclusion : Si vous avez la ferme volonté de faire échec aux manœuvres du clergé, si vous êtes résolus à barrer la route aux desseins ambitieux des représentants de la Religion, ne vous bornez pas à combattre le cléricalisme, faites à la religion elle-même une guerre sans merci. Ne vous contentez pas d’être « des mangeurs de curés », attaquez-vous à Dieu lui même ; soyez antireligieux.
Le cléricalisme est un mouvement politique et social mais à base religieuse. C’est cette base qu’il faut saper hardiment et avec persévérance.
― SÉBASTIEN FAURE.
CLIQUE
n. f.
Ce mot ne s’emploie jamais de façon bienveillante et sert généralement à désigner une association ou un groupe d’individus méprisables et desquels il faut se méfier. Même lorsque l’on se sert de ce mot sans intention malveillante « une joyeuse clique », le qualificatif ne détruit pas le sens péjoratif du mot et laisse supposer que cette « joyeuse clique » est composée d’éléments peu recommandables. La clique désigne également la musique d’un régiment : la « clique militaire » et dans le jeu de cartes l’association de certaines figures.
CLOITRE
n. m.
Habitation religieuse pour hommes ou femmes voulant se livrer à la vie monastique. Le nombre des cloîtres a notablement diminué en France ; mais il en existe encore beaucoup en Belgique, en Italie et surtout en Espagne. L’institution du cloître remonte au VIème siècle environ ; cependant, les solitaires qui désiraient s’adonner à la vie contemplative se retiraient dans des couvents dits « couvents cloîtrés ».
C’est surtout en Orient que les moines se détachaient complètement de la vie extérieure et s’enterraient dans des « couvents cloîtrés ». En Occident, le couvent et le monastère servaient de refuge à ceux qui, tout en s’éloignant du monde, continuaient cependant à vivre en commun. (Voir Couvent et Monastère.) Le cloître occidental, à ses origines, eut donc les mêmes attributions que le couvent cloîtré en Orient ; mais il ne tarda pas à se transformer et à servir trop souvent de prison. Il fut le tombeau de quantité de jeunes gens qui étaient une gêne et une menace pour leur caste ou leur famille. Afin de se débarrasser de ses enfants pour laisser un titre et une fortune au premier né, bien des pères firent jeter leurs fils cadets dans des cloîtres, et ceux-ci furent également le refuge de quantités de femmes, victimes de l’autorité arbitraire du chef de famille, qui préférèrent la mort lente de la vie claustrale à la violation de leurs plus intimes sentiments. Les portes du cloître se fermèrent maintes fois sur des philosophes et des savants qui osaient s’attaquer au dogme de l’église et dont les idées étaient jugées subversives par l’Inquisition.
L’institution du cloître, on peut s’en rendre compte par les faits qui illustrent toute l’histoire du christianisme, produit des monstruosités. Quoi qu’il en soit volontaire ou contrainte, la vie claustrale est un crime contre la nature, et Diderot a, de son verbe violent, flagellé ceux qui s’y livraient.
« Faire vœu de pauvreté, c’est s’engager par serment à être paresseux et voleur ; faire vœu de chasteté, c’est promettre à Dieu l’infraction constante de la plus sage et de la plus importante de ses lois ; faire vœu d’obéissance, c’est renoncer à la prérogative inaliénable de l’homme : la Liberté. Si l’on observe ces vœux, on est criminel ; si on ne les observe pas, on est parjure. La vie claustrale est d’un fanatique ou d’un hypocrite. » (Diderot.)
CLUB
n. m.
Mot d’origine anglaise. Anciennement, le club était une association de bons camarades qui se réunissaient entre eux pour se distraire ; mais petit à petit il évolua et devint, aux époques troublées, un centre politique jouissant parfois d’une influence considérable. Le premier club politique français se forma en 1782 sous le ministère Calonne qui interdisait à ses membres de causer politique ou religion. Presque immédiatement, se créèrent d’autres clubs, mais ils furent tous dissous par ordonnance royale en 1789. Cependant, l’orage politique et social qui pointait à l’horizon ne permettait pas aux hommes qui allaient jouer un rôle dans la Grande Révolution et qui prévoyaient les événements, de se tenir éloignés les uns des autres. Un contact permanent leur semblait indispensable et, malgré l’ordonnance royale de 89, d’autres clubs se reformèrent presque aussitôt. Il en sortait de terre dans chaque centre, dans chaque quartier, dans chaque rue. Ce fut d’abord le club des Jacobins, le club de Montrouge qui comptait Mirabeau parmi ses membres, le club du faubourg Saint-Antoine, le club de Clichy, le club des Monarchistes, et combien d’autres. Mais les plus importants de ces clubs, et qui jouèrent un rôle de premier ordre dans l’histoire de la Révolution furent, sans contestation, le Club des Cordeliers et le Club des Jacobins.
Le premier comptait parmi ses membres des hommes comme Camille Desmoulins, Marat et Danton. On peut donc comprendre quelle fut sa puissance et qu’il dirigea pendant un certain temps toute la politique révolutionnaire. Il fut cependant supplanté par le club des Jacobins qui était animé par l’esprit et la force de Robespierre, et était, en outre, le centre d’un mouvement considérable. Un grand nombre de sociétés se rattachèrent à lui et il avait des branches dans tous les grands centres du territoire. Il avait son siège dans un couvent qui avait auparavant été habité par les moines jacobins et toutes les questions qui étaient présentées à la tribune nationale étaient, avant, débattues et discutées à la tribune du club. Il exerçait une telle influence, qu’il menaça à plusieurs reprises les pouvoirs constitués.
Quelles que soient les erreurs commises au sein de ces différents clubs qui se déchiraient en défendant chacun une politique différente, il faut cependant reconnaître qu’ils étaient animés d’un sincère désir de voir triompher la Liberté dont ils avaient, à notre point de vue anarchiste, une conception erronée. C’est ce qui explique peut-être, dans une certaine mesure, les ligues qui se formèrent contre eux et réussirent, à la fin, à les détruire. La Révolution écrasée, le Consulat, l’Empire et la Restauration ne tolérèrent pas l’organisation des clubs. Ils furent remplacés par des sociétés secrètes.
Après la Révolution de 1830, un grand nombre de citoyens essayèrent de former « le club du ménage » de la rue Montmartre ; celui-ci fut immédiatement fermé par ordre du gouvernement ; et ce n’est qu’en 1848 que nous voyons apparaître le club Blanqui et le club Raspail, particulièrement fréquentés par les socialistes révolutionnaires. Ils disparurent également avec la seconde république.
Le club est redevenu aujourd’hui ce qu’il était à son origine : une association ― le plus souvent d’aristocrates ― où se réunissent, pour occuper leurs loisirs, les hommes d’un même « monde ». Le club est presque devenu synonyme de cercle. Il y a, en Angleterre, des clubs ouvriers dont l’unique but est d’offrir des distractions collectives aux travailleurs, ou encore d’acheter, à meilleur compte, pour les fêtes de Pâques et de Noël, les marchandises indispensables au festin traditionnel. En France, il y a bien encore quelques clubs politiques, mais ils ne présentent pas le caractère des grands clubs du passé et n’exercent pour ainsi dire sur le public aucune influence.
COALITION
n. f.
Réunion de plusieurs individus, groupes, gouvernements ou États, pour la défense de leurs intérêts, contre un ennemi momentané. La coalition offre ceci de particulier : qu’elle n’associe pas des individus de même tendance ou de mêmes idées, des gouvernements de même nature, des nations de même race s’orientant vers un même but, mais qu’elle est formée le plus souvent d’adversaires paraissant irréconciliables et qui font une trêve lorsqu’ils sont menacés particulièrement par un danger commun ou que des intérêts immédiats les placent côte à côte. On a vu, en certaines circonstances, des hommes politiques les plus hostiles les uns aux autres, dont les doctrines étaient diamétralement opposées, s’associer pour combattre une force qui prétendait les écraser les uns et les autres. Les élections législatives de mai 1924, en France, donnèrent le jour à un bloc qui groupait des éléments de toutes tendances, sauf les Anarchistes naturellement, et qui n’était qu’une coalition des forces politiques de gauche contre celles de droite.
Il y a aussi les coalitions guerrières et, depuis l’entente qui fut conclue en 1124 entre Henri I, roi d’Angleterre et l’empereur Henri V, pour envahir la France, jusqu’en 1815 époque où Napoléon fut définitivement battu, de nombreuses coalitions se formèrent contre la France. La plus dangereuse ― et pour cause ― fut celle qui menaça la Révolution et qui était inspirée par la crainte et la terreur qui gagnaient l’aristocratie, la noblesse et les monarques de toute l’Europe qui voyaient leurs trônes chanceler. C’est aussi une coalition qui se forma en 1914 contre l’empire germanique qui eut à se défendre contre toutes les grandes puissances d’Europe, auxquelles vinrent se joindre certaines nations américaines et asiatiques. Mais la plus monstrueuse des coalitions modernes fut celle qui menaça, dès les premiers jours de 1918, le superbe mouvement révolutionnaire des travailleurs russes. Tout fut mis en œuvre pour étouffer en son berceau ce foyer qui illuminait l’Est et menaçait d’embraser tout le vieux Monde. Intervention militaire, guerre économique, rien ne fut oublié. Sans égard pour les femmes, les enfants ou les vieillards, la coalition de la bourgeoisie interdisait l’exportation en Russie de toute matière quelle qu’elle fût et c’est elle qui doit être tenue pour responsable de cette désastreuse et terrible famine qui décima une grande partie de la population slave.
À côté de toutes ces associations politiques et nationales, aux buts imprécis et éphémères, il y a cette constante coalition économique qui ne vise qu’à écraser la classe ouvrière, pour que le capitalisme puisse rester le maître absolu de toute la richesse sociale. Toute l’industrie, tout le commerce, toute la finance, au-dessus des diverses tendances politiques qui les animent, se coalisent contre l’ennemi commun : le prolétariat ; et tentent, en formant un bloc compact, d’endiguer l’évolution des classes inférieures qui prennent chaque jour un peu plus conscience de leur force et de leurs possibilités. La coalition de toutes les forces du capitalisme est la plus dangereuse ; car elle n’hésitera pas à abandonner toutes les luttes d’ordre politique ou national, pour se trouver unie et puissante en face dé la classe ouvrière, lorsque celle-ci, débordant des cadres de la légalité prendra le chemin de la révolution.
Il faut, pour triompher, se servir d’armes de valeur au moins égales à celles de ses adversaires et c’est pourquoi à la coalition des puissances d’argent la classe ouvrière, si elle veut sortir victorieuse des batailles qu’elle aura à livrer à la bourgeoisie, doit opposer la coalition solidement organisée de tous les exploités.
CODE
n. m.
On appelle Code le corps des lois qui régissent les sujets d’un même État. Les Codes se différencient suivant les matières qu’ils condensent dans leur système impératif.
De grandes sociétés ont pour leur action interurbaine ou internationale des règlements homogènes qu’on appelle Codes par assimilation et par métaphore : on dit le Code des Courses.
Enfin, on donne le nom de Codes :
-
à des tables de signaux ;
-
à des vocabulaires composés de mots abréviatifs ou de termes conventionnels, pour assurer le secret d’un texte transmis ou en simplifier la teneur. Nous ne nous occuperons que des Codes créés par le travail législatif.
I.
La France a cinq Codes fondamentaux.
On place en tête du Code civil les lois organiques, celles qui déterminent la forme de la constitution et qui en réglementent le jeu.
CODE CIVIL. ― Le Code civil se divise en livres, les livres en titres, les titres en chapitres, les chapitres en articles.
Le premier livre, est relatif à l’état des personnes et le second à la condition des biens.
Pour les personnes, le Code règle la jouissance et la privation des droits civils ; le mariage et le divorce ; la paternité et la filiation ; la puissance paternelle, la minorité, la tutelle et l’émancipation ; la majorité, l’interdiction et le Conseil judiciaire.
Pour les biens, le Code détermine la distinction entre les immeubles et les meubles, le droit de jouir et de disposer que confère la propriété, la manière légale dont elle s’accroît par l’accession, les démembrements qu’elle subit par l’usufruit, l’usage et l’habitation, les restrictions que lui imposent les servitudes. Le troisième livre comprend les différentes manières dont on acquiert la propriété : successions, donations, contrats ; la vente, l’échange, le louage, le prêt sont les principales obligations conventionnelles qui transmettent la propriété ou la possession. Des titres spéciaux déterminent les différents régimes du contrat de mariage et les droits respectifs des époux sur leurs biens propres ou communs ; d’autres titres réglementent le dépôt, le mandat, le cautionnement, le nantissement ; d’autres enfin les privilèges et les hypothèques, pour terminer par cette consécration artificielle de la propriété ou cette décharge légale de l’obligation qui s’appelle la prescription.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE. ― Le Code de procédure civile trace et jalonne la route qui conduit les parties à l’audience et, défaillante ou non, les achemine vers le jugement.
Il leur donne accès aux justices de paix, aux tribunaux inférieurs et, si le taux du litige le comporte, aux tribunaux d’appel.
Il règle la tenue des audiences, leur publicité et leur police, il distingue entre les différentes sortes de jugements suivant qu’ils préparent ou contiennent la décision fiscale ; il assigne à la compétence du juge ses limites, à l’extension de son examen et de sa sentence des frontières ; il organise le recours aux mesures d’instruction préalables (vérifications d’écritures ou enquêtes), et aux mesures d’exécution subséquentes (notamment les saisies).
Il consacre deux livres dans sa seconde partie, à certaines procédures particulières ; parmi celles qui ne dérivent pas du décès, nous citerons les plus usuelles, celles qui tendent à la séparation de biens, à la séparation de corps, à l’interdiction ; les plus spéciales concernent les appositions et levées de scellés, les opérations d’inventaire, les renonciations de femmes mariées ou d’héritiers.
Le dernier livre traite des arbitrages.
Le Code de Procédure civile a mauvaise réputation dans le monde profane. L’expression : « se jeter dans le maquis de la procédure » a fait fortune. Cette formule pittoresque doit son succès à son auteur : le bâtonnier Labori ; elle eût paru plaisante ou piquante en lui rappelant les coutumes corses familières à l’architecte du Code Napoléon. Nous croyons devoir mettre en garde les simplificateurs à outrance contre le danger des arasements.
Le Code de procédure est parti d’un principe qui intéresse la liberté. Nul homme ne doit être jugé par surprise, sans avoir été entendu ou dûment appelé, sans avoir eu loisir, licence et faculté de se justifier. La demande formée contre lui doit être déterminée et délimitée avant les débats. Vous ne pouvez m’attirer devant un juge pour me réclamer le prix d’un bœuf, et le juge me condamner, de complicité avec vous, pour menées anarchistes.
De là les précautions strictes prises par la loi pour que Ia citation soit régulière, pour que le jour d’audience ne soit pas arbitrairement ni clandestinement fixé, pour que les écritures qui précisent la demande et la défense soient respectivement échangées, pour que les adversaires sachent sur quel terrain ils combattent et que le juge ne puisse ni l’étendre ni l’excéder, pour que le défendeur défaillant soit admis à faire tomber un jugement qu’il a pu ignorer et pour que la condamnation civile soit exécutée quand celui qu’entame le glaive justicier a pu opposer tous les boucliers licites à toutes les entailles légitimes.
La loi suisse, dans ce souci de prudence et de préservation est encore plus exigeante et meilleure que la nôtre. Elle impose au demandeur, à l’appui de sa citation, la désignation de toutes les pièces dont il entend se servir.
Les dérogations au formalisme, quand ce formalisme est rationnel, dégénèrent facilement en abus. Nous avons vu récemment, dans une Cour d’appel du Sud-Ouest, un intime faire passer au juge vingt pages de conclusions qui développaient une argumentation sur laquelle s’est fondé l’arrêt, et qui était restée confidentielle faute d’avoir été signifiée, conformément à l’arrêt. Devant les Tribunaux de Commerce où la procédure est rudimentaire, afin d’être expéditive, il se produit chaque jour des courts-circuits fâcheux. Les juges, chargés du délibéré, reçoivent des dossiers contenant, outre les pièces, des notes qui constituent une plaidoirie écrite, soustraite à la vue de l’adversaire, et des jugements sont rendus sur des moyens non discutés, non prévus.
La Procédure n’est pas si dédaléenne, si tortueuse, si compliquée, si imbriquée, si byzantine, ni si casuiste qu’aiment à le croire les défricheurs. Arrachons ses broussailles, disent ils, et nous aurons devant nous la plaine ; qu’ils prennent garde à la forêt de Bondy ! Les vagues se heurtent ; le conflit des intérêts ne se résout pas tout seul dans l’amplitude rythmée des ondes que les vents capitalistes poussent vers le rivage. Il faut plaider et les plaideurs sont trop. L’étroitesse des portes les retarde plus que les degrés de l’escalier. Il y a, au Palais, des rôles encombrés, comme il y a, dans Paris, des carrefours embouteillés.
LE CODE PÉNAL. ― énumère les actes qu’il proclame coupables et punissables ; il les distribue en trois catégories : les contraventions, les délits et les crimes. Il leur assigne des peines proportionnées à leur gravité théorique ; il laisse aux juges le soin de se mouvoir suivant les espèces, mais en observant le tarif du catalogue, entre un maximum et un minimum applicable à la classe de l’infraction commise ou du forfait soit tenté soit accompli. Il va de l’amende à la peine de mort, et les plus généreuses protestations n’ont pu encore arracher la guillotine à ses dalles juridiques et judiciaires.
Deux lois salutaires et humaines ont tempéré la rigueur des textes primitifs : l’une fort ancienne, qui a permis l’admission des circonstances atténuantes, l’autre déjà vieille mais qu’ont souhaitée d’abord, qu’ont vu naître ensuite des juristes à barbe blanche : la loi sur la suspension des peines dite « loi Béranger ».
La sévérité des peines qui frappaient l’infanticide a été atténuée par des dispositions plus récentes encore ; les filles mères délaissées dont là faute et l’égarement attestaient l’égoïsme du mâle ont fait fléchir la sollicitude du législateur pour son protégé d’ordre public : l’enfant.
LE CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. ― Le Code d’instruction criminelle institue la poursuite et la répression. « La procédure criminelle, dit avec beaucoup de précision et de netteté, le répertoire juridique de Dalloz, présente trois périodes distinctes : « dans la première, elle recherche les traces du crime ou du délit et s’efforce d’en découvrir les auteurs ; dans la seconde, elle apprécie le caractère légal du fait et, après en avoir rassemblé les preuves, elle détermine, s’il y a lieu, le tribunal compétent pour en connaître ; dans la troisième enfin elle amène le prévenu devant ce tribunal, soumet l’accusation et la défense à des règles nécessaires, destinées à protéger leurs droits respectifs, et entoure le jugement des formes les plus propres à en assurer la maturité et la sagesse. »
Nous n’avons pas voulu tronquer cette citation orthodoxe ; nous voulons bien considérer que cet équilibre impartial entre l’accusation et la défense garantit la maturité et procure la sagesse des jugements : tel est du moins le vœu de la loi.
La loi n’est pas moins prudente quand elle tente de garantir les innocents ou les simples suspects contre les arrestations arbitraires, les détenus contre l’indifférence ou l’oubli qui les laisseraient macérer dans les geôles ; le droit essentiel, droit primordial de l’homme et son droit à la liberté. Mais, ayant satisfait à cette prudence préliminaire, le Code d’instruction criminelle ouvre au magistrat instructeur un crédit illimité.
Un professeur de droit, un savant criminaliste dont la Faculté de Paris a conservé avec estime le souvenir, aimait à poser, comme examinateur, une question qui prenait au piège l’étudiant irrégulier, celui qui n’avait pas suivi les cours du maître : ―Quel est, en France, le magistrat qui jouit du pouvoir le plus étendu ? ―Le Président de la République, répondait le candidat. ― , le juge d’instruction.
Ce pouvoir absolu a d’abord été mitigé dans la pratique par la collaboration et la surveillance du Parquet dont le juge ne saurait dépendre, mais dont il accepte l’autorité. La loi a tempéré elle-même l’autocratie d’un régime qui est en communication constante avec le régime cellulaire. Elle a rendu l’instruction contradictoire. Il faut entendre par là que l’inculpé ne peut être interrogé ni confronté sans l’assistance de son avocat, et que le défenseur est appelé à prendre connaissance, vingt-quatre heures avant ces actes judiciaires, des pièces réunies par l’information.
Le juge dicte au greffier la rédaction des témoignages reçus et des déclarations recueillies : le progrès des appareils qui inscrivent là parole permet de prévoir que des disques, pièces accessoires de conviction, enregistreront les paroles mêmes des comparants.
Quoique modérée, l’autonomie du magistrat instructeur reste encore autocratique. Par des enquêtes officieuses, il peut tenir en échec le contrôle de l’instruction contradictoire ; par la détention préventive, par les commissions rogatoires données en France ou à l’étranger pour auditions de témoins ou vérifications de mandats, par les perquisitions, par les saisies et notamment celle de la correspondance, il peut ruiner le crédit ou la réputation d’un prévenu, il peut faire d’un justiciable un cadavre effectif, avant qu’il ne soit un condamné étiqueté ou un condamné à dommage irréparable. C’est dans la conscience du juge que se trouve le régulateur de cette puissance inexorable ; il faut à cette conscience tant de sagacité, tant de perspicacité, une vigilance si persévérante qu’on aimerait à voir la loi française faire quelques emprunts à la législation anglaise et s’inspirer des principes que consacre l’« habeas corpus ». Il n’est pas téméraire de penser que tout prévenu, dont la détention préventive aurait dépassé deux mois, devrait être déféré à un jury qui, connaissance prise des charges relevées et des présomptions acquises, statuerait, par un avis motivé, sur la mise en liberté provisoire. L’avis motivé pourrait tenir la malignité publique en suspens.
Le Code d’instruction criminelle attribue au juge de paix, tenant l’audience de simple police, la connaissance des contraventions, sauf appel quand la condamnation dépasse un taux assez faible d’amende ou de réparations civiles. Nous n’entrons pas dans le détail de certaines extensions qui modifient cette compétence, notamment en matière d’injures ou de diffamations non publiques. Les délits contraventions et les délits, à charge d’appel dans tous les cas, sont déférés aux magistrats ordinaires qui forment le Tribunal correctionnel. Expliquons cette expression : magistrats ordinaires.
Le magistrat français a l’omniscience. Il s’adapte, sans préparation, à toutes les causes : le divorce ou l’hypothèque, la contrefaçon ou le louage d’industrie, la quotité disponible ou le dédit théâtral. Il ne naît pas civiliste ou criminaliste, il le devient, que ses aptitudes comportent ou non ce savoir et cet instinct qui préparent à la déduction ou à l’induction. S’il est nommé juge d’instruction, il s’en réjouit pour la facilité de sa carrière ; s’il est envoyé à une Chambre correctionnelle, il subit cette disgrâce passagère, car le droit criminel est le parent pauvre du droit civil. Il intéresse la liberté, l’honneur, l’avenir, la vie des citoyens. Peu importe. Vous serez jugés doctement si votre cheminée enfume le voisin ; vous serez jugés avec résignation et par complaisance si vos proches anxieux, vos ennemis vigilants, vos concurrents hostiles attendent que la justice vous ayant reçu pâle et blême vous renvoie blanc ou noir.
L’attention du public se porte surtout vers la Cour d’assises et nous devons rendre cet hommage au peuple que le jury est chez nous une institution populaire ; Elle ne s’est pas implantée sans résistance dans l’arène qui rappelle parfois encore au philosophe les combats de gladiateurs.
Au début, le législateur qui toléra le Jury, et qui sanctionna son concours, voulut que les jurés fussent appelés à se prononcer sur la culpabilité ou la non culpabilité de l’accusé. Ils ne devaient pas se préoccuper des conséquences pénales qu’entraînait leur verdict. Cette barrière paradoxale et d un équilibre instable n’est plus qu’une fiction. Il faudra toutefois une réforme législative pour qu’elle soit anéantie.
Plusieurs projets et notamment celui qui a pour auteur un ancien ministre, M. André Hesse, proposent de remettre au jury l’application de la peine ; les magistrats composant la Cour ne seraient plus que des directeurs de débats, des juges d’incidents, des prononciateurs d’arrêts.
Il semble qu’on puisse arriver à une conciliation. Un ancien député de Paris, M. Alfred Martineau l’a tenté, dans un projet de loi déposé, il y a plus de vingt ans, devant la Chambre des députés. M. Alfred Naquet, le père de la loi sur le divorce, a dit de ce projet qu’il était la première pierre d’une grande réforme. Dans toutes les affaires soumises à la Cour d’assises, la question posée au jury en cas de réponse affirmative serait ainsi formulée : « À quel degré l’accusé est-il coupable ? » Le premier degré comporterait la peine de mort puisque, hélas ! elle existe encore ; le second degré les travaux forcés à perpétuité ; le troisième degré les travaux forcés à temps ; le quatrième degré l’emprisonnement au-dessus de cinq ans ; le cinquième degré l’emprisonnement au-dessus d’un an ; le sixième degré l’emprisonnement moindre ; le septième degré l’amende de 1.000 francs à 20.000 francs.
Pour les crimes qui n’emportent pas, selon les dispositions actuelles du Code, la peine capitale ou la peine des travaux forcés perpétuels, les deux premiers degrés seraient enlevés de l’échelle soumise au jury ; dans tous les cas, il pourrait, selon la scélératesse du coupable ou l’indulgence que mériterait son acte, délimiter la peine que la Cour fixerait, désigner le casier où le juge pourrait puiser.
Cette notion du degré de culpabilité implique en effet une grande réforme, ―une réforme morale. Le Code a trouvé suffisante son admission des circonstances atténuantes et a déterminé les peines en fonction du délit, grammaticalement défini. Une saine justice veut que la peine soit déterminée par mensuration sur le coupable. D’où vient cet homme ? Quelles tares héréditaires ont affecté l’intégrité de sa conscience ? Quelle éducation, quelle instruction a-t-il reçues ? Que lui a donné la vie ? A-t-il eu le secours que lui devait la solidarité, le bonheur que lui devait l’égalité ? Quelle nécessité l’a courbé vers le mal ? Quel emportement l’y a entraîné ?
Le juge se prétend lié par la loi. Sans doute, la loi doit, dans certains cas, sacrifier l’intérêt particulier qui est contingent à l’intérêt public qui est permanent. Il est scandaleux qu’un père, s’il n’est pas dans les conditions où le Code permet le désaveu, élève, subisse le fils d’un amant et donne son nom à cet intrus qui n’en peut mais. La paix sociale exige néanmoins que les justes noces créent une présomption légale et que les berceaux ne soient pas exposés au péril des contestations infâmes. Mais les règles doivent tendre à s’assouplir pour mesurer les cas différents et les Codes se réduire de plus en plus au respect de cette maxime : « il n’y a pas de droit contre l’équité ».
CODE DE COMMERCE. ― Le Code de Commerce définit la profession de commerçant, ses obligations pour la tenue des livres de commerce ; parti d’un texte rudimentaire auquel se sont successivement incorporées, depuis la loi fondamentale du 24 juillet 1867, les lois les plus importantes, il règle la constitution des Sociétés ; il établit le statut des Bourses de Commerce, assigne leur rôle aux agents de change, aux courtiers, aux commissionnaires, statue sur le gage, consacre et réglemente la circulation des effets de commerce.
Son second livre est un véritable Code de commerce maritime : hypothèque maritime, saisie et vente des navires, obligations du capitaine, sa responsabilité, engagements des matelots, fret, assurances. Son troisième livre embrasse l’importante matière des faillites et des banqueroutes auxquelles se trouve adjointe, depuis la loi du 4 mars 1889, la liquidation judiciaire. Le quatrième livre est relatif à l’organisation et à la compétence des tribunaux de commerce.
CODE FORESTIER. ― Le Code forestier n’appartient pas au groupe de Codes que nous a donné le Gouvernement consulaire d’abord, impérial ensuite. Publié en 1827, ce Code n’intéresse guère que l’État, certaines municipalités ou communautés, certains usagers et des propriétaires de moins en moins nombreux.
Il distingue entre les forêts qui appartiennent au domaine de l’État, au domaine de la couronne, aux communes et aux établissements publics ; il édicte des restrictions au droit de propriété pour les bois appartenant aux particuliers.
Certaines de ses dispositions sont désuètes.
Les Français moyens ignorent qu’ils sont passibles d’une amende de 10 francs s’ils sont trouvés dans les bois, hors des routes et chemins ordinaires, porteurs de serpes, de haches et de cognées.
Sous peine d’une amende de 20 fr. à 100 fr. il est interdit de porter ou allumer du feu dans l’intérieur et à une distance de 200 mètres des bois et forêts.
Si cette prescription avait été plus rigoureusement observée, les sites de Franchard et d’Apremont n’auraient peut-être pas été dévorés par l’incendie.
* * *
Aux Codes anciens se sont adjoint de nouveaux Codes. Les lois sur la Presse, qui assurent sa liberté et en conditionnent l’exercice, qui répriment ses abus, qui définissent la publicité et ses moyens, qui punissent l’outrage, l’injure et la diffamation, ont formé le Code de la Presse.
Les lois sur la réglementation du travail, sur le travail des enfants dans les manufactures, sur les conseils de prud’hommes, sur les corps et conseils du travail, sur les accidents du travail, sur les bureaux de placement, ont formé le Code du Travail.
Les lois qui réglementent la circulation urbaine et routière ont formé le Code de la Route.
Les lois et arrêtés concernant les Douanes ont été réunis et ont donné le « Code des Douanes » ; de même, les lois et arrêtés concernant l’Enregistrement le « Code de l’Enregistrement », mais ces deux recueils doivent surtout leurs titres à leurs éditeurs.
L’unification de la justice nous semble la plus désirable des réformes. C’est avec tristesse que nous réservons ici sa place au Code le plus spécial de tous : le Code de Justice militaire. Il excède le droit commun, il excède le droit humain. Il a mérité son châtiment ; qu’il soit exposé au pilori d’abord, qu’il soit ensuite condamné au bûcher. Ces supplices de l’ancien droit sont bien dus à son archaïsme. Édicté en 1857, il a été modifié par la loi du 18 mai 1875. Il n’en reste pas moins indigne de la nation qui s’astreint au service militaire ou qui se lève en armes pour la défense de ses foyers.
Il contient, pour les délits militaires, un Code pénal effrayant. Les condamnations à deux ans de prison et aux travaux publics sont sa monnaie courante et surtout le déboursé courant des juges qui appliquent ses articles. Pour les délits et les crimes de droit commun, il se réfère au Code pénal ordinaire. Les tribunaux militaires sont les Conseils de guerre permanents et les Conseils de guerre aux armées.
Les Conseils de révision examinent le recours formé et peuvent annuler le jugement pour vice de forme, incompétence, ou fausse application de la peine. Ils ne connaissent pas plus que la Cour de Cassation du fond de l’affaire. Cette étroite et fragile garantie du recours, peut être suspendue, et le cas s’est produit pendant la guerre, pour les Conseils de guerre aux armées.
La guerre est une mauvaise école de droit international et de droit naturel. Justice militaire ! que de crimes ont été commis en ton nom.
Il n’y a pas à proprement parler un Code maritimeni un Code de justice maritime. La marine militaire et la marine marchande ont été organisées par des dispositions nombreuses et diverses. La police de la navigation a été assurée par le règlement fondamental du 7 novembre 1866.
La justice criminelle maritime a été réglementée par la loi du 4 juin 1858 pour la marine militaire et par le décret-loi du 24 mars 1852 pour la marine marchande.
Les crimes et délits sont jugés soit par des Conseils de guerre permanents, soit par des Conseils de guerre à bord.
Il existe des Conseils de guerre permanents dans chaque arrondissement maritime ; leur ressort qui s’étend à toute l’étendue du territoire de la République a été récemment déterminé à nouveau par un décret du 23 janvier 1889.
Les Conseils de guerre à bord sont constitués spécialement pour juger un crime ou un délit occurrents ; ils se dissolvent aussitôt après.
Les Conseils de justice constituent une juridiction disciplinaire. Il y a des Conseils de révision permanents et des Conseils de révision à bord.
En ce qui concerne la marine marchande, les peines disciplinaires sont prononcées par les commissaires de l’inscription militaire, les Consuls de France, les commandants des bâtiments de l’État, ou les capitaines de navires, sous certaines conditions.
Les délits maritimes sont déférés à des tribunaux maritimes commerciaux, les crimes sont jugés par les Cours d’assises.
Parmi les Codes éphémères et de circonstance, nous citerons seulement le Code noirpromulgué en 1685, l’année où fut révoqué l’Édit de Nantes. Il réglementait le sort des esclaves et des affranchis dans les colonies.
II
Aucun Code, à aucune époque, n’a été fabriqué de prime saut et de toutes pièces. Les mœurs créent les lois qui modèlent ensuite les mœurs mais qui ont bien de la peine à les discipliner. Dans son cours de politique constitutionnelle, Benjamin Constant fait observer que les constitutions s’introduisent graduellement et d’une manière insensible ; Montesquieu a, d’un mot, résumé le rapport des lois et des mœurs en intitulant son célèbre ouvrage : « l’Esprit des lois ».
Il y a eu, dans des circonstances exceptionnelles, des constitutions artificielles et contingentes. Ainsi celle que Locke confectionna ―il n’y a pas d’autre mot ―pour la Caroline, et qui était une copie de la constitution anglaise. C’était un article d’exportation. Le résultat ne se fit pas attendre. L’arbre implanté, le sol se bouleversa sous son couvert, mais il fallut vingt-trois ans pour démolir cet essai.
Les lois peuvent surgir sous la pression des événements, les constitutions ont besoin de calcul et des Codes de symétrie.
Le plus méritoire des législateurs fut Solon. Sa patrie se mourait. Dracon l’avait enfermée, au profit de l’aristocratie, dans une de ces cages de fer que les dompteurs ont inventées, mais que leur ont empruntées les tyrans. Athènes tourna ses regards vers Solon. SoIon était archonte ; quelques-uns, dit Plutarque, lui offrirent d’être roi ; il refusa.
Il rompit avec la tradition et les enseignements des philosophes. Il commença par soulager le peuple et la cité de leurs dettes ; il les diminua par une réduction proportionnelle. Que n’étudions-nous davantage l’histoire grecque ! Il mâta les nobles, il adoucit le sort des esclaves et interdit de les frapper ; l’oisiveté, dans les lois de Dracon, était punie de mort ; il supprima le châtiment suprême pour les oisifs, mais continua de les tenir pour des délinquants qui étaient déférés à l’aréopage et condamnés, Plutarque ne nous dit pas comment. Les pères qui n’avaient pas appris un métier à leurs enfants ne pouvaient exiger d’eux des aliments. Les assemblées du peuple furent réglementées. Les étrangers en furent exclus, l’âge fut fixé où le citoyen avait le droit de suffrage ; un Conseil de quatre cents membres préparait les lois soumises à la délibération du peuple, divisé en quatre tribus. C’est ainsi que Solon, dans la république athénienne, donnait à la liberté mieux qu’un temple : une citadelle et fondait la démocratie.
Un si brusque changement de régime étonna ceux qui en devaient éprouver le bienfait et suscita des mécontentements. Tes lois te paraissent bonnes ? dit un rhéteur au dictateur. Solon répondit doucement : les meilleures que les Athéniens puissent recevoir. Et il continua son œuvre.
Législateur, il avait à capter l’âme athénienne, mobile, ondoyante et vive, dansante comme une flamme, toujours prête à consumer son trépied. Il avait à redouter les factions, et elles s’organisèrent, et elles s’appelèrent à Athènes la montagne, la plaine et la côte, ―ne croirait-on pas que la Convention s’est inspirée de l’histoire ancienne ― et quand il mourut, il put se demander avec mélancolie si un factieux avide, audacieux, passionné, n’allait pas ruiner et confisquer à son profit la révolution si sagement consommée.
Xénophon nous a laissé un livre dans lequel il critique les lois de Solon, mais Xénophon prêche pour son maître. Xénophon est un disciple élégant et médiocre de Platon ; et Platon avait composé une République, République cérébrale et Irréalisable. Elle ressemble beaucoup à ces corbeilles dont parle le biographe d’Esope, ces corbeilles que des aigles soutenaient dans les airs et d’où émergeaient des enfants munis de truelles, prêts à construire un palais sans assises, pourvu qu’on leur envoyât du mortier.
* * *
Lycurgue eut moins de peine pour établir sur le roc Spartiate sa législation ; mais il l’avait longuement préparée. Dix ans, il avait voyagé, surtout en Égypte, voulant voir comme dit le poète, les mœurs de beaucoup d’hommes et leurs villes. C’est à la Crête qu’il fit son plus large emprunt.
Le pouvoir appartint aux rois dont le nombre était augmenté en cas de guerre. C’est d’abord et avant tout en vue de la guerre que Lacédémone fut organisée. Les femmes recevaient la même éducation que les hommes et principalement l’éducation guerrière. Mais le pouvoir des rois était subordonné à l’autorité du Sénat ; les sénateurs étaient choisis par le peuple et désignés par ses acclamations. L’intensité des clameurs était notée par des témoins auditifs, que l’on empêchait d’être oculaires en les enfermant ; les plus bruyamment accueillis parmi les candidats que l’on faisait défiler étaient élus. Lycurgue tendit surtout à l’égalité des biens et, pour la maintenir, il défendit, après avoir divisé les terres en trente-neuf mille parts, qu’aucun partageant n’aliénât de son lot, ni qu’il osât le cultiver. Les îlots étaient chargés de la culture. La seule monnaie permise était la monnaie de fer, son poids limitait la richesse.
Ces lois, qui, au dire de Plutarque, faisaient ressembler Lacédémone à un camp, où tout était commun, même les femmes avec leur assentiment bénévole, et où les enfants étaient à la patrie sans qu’elle se souciât de leur filiation régulière, peuvent bien s’être inspirées de Minos : il y avait une grande affinité entre les Crétois et les Spartiates, ―à la bonne foi près, ―mais on comprend que Lycurgue n’ait pas été admis comme Minos et comme Solon au nombre des sept sages ; imitateur, il ne pouvait prétendre à ce brevet, et créateur de servitude à ce diplôme.
* * *
Théodose II, empereur d’Orient, entreprit d’amalgamer dans la cuve du droit romain les désirs de l’Orientalisme et les préceptes du christianisme : le droit romain n’avait connu, n’avait prévu ni les uns ni les autres. Cent cinquante ans devaient s’écouler entre l’apparition du Code Théodosien et la prédication de Mahomet ; Clodion était le chef des Francs, mais cinquantehuit ans seulement devaient s’écouler jusqu’à la conversion de Clovis. Il avait fait un rude chemin dans le monde, l’obscur condamné de Pilate, le supplicié dont le souvenir était resté si longtemps perdu, et ce Jésus Christ dont Tibère avait sans doute ignoré le nom et qui devait aux prédications de ses disciples sa véritable résurrection.
Mais l’intérêt de l’œuvre entreprise par Théodose s’efface pour nous devant l’importance de l’œuvre accomplie par Justinien : quatre-vingt-onze ans séparent l’une (438) de l’autre (529). La résolution, la force, la puissance, le cynisme de Justinien ont imposé aux siècles futurs, le Digeste et les Institutes.
Les Francs et les Souverains d’Europe ont exploré ces monuments massifs ; ils y ont cherché les vestiges du droit le plus robuste, le plus logique, le plus rigoureux dans son souci d’équité pour les contrats civils, le plus absolu pour la fondation, la permanence et la continuité de la famille, le plus impérieux pour la soumission du citoyen à la République : le droit romain. Il fallait bien aller chercher sa tradition à Byzance.
Justinien-Erostrate, après avoir fait dépouiller par ses jurisconsultes dont le plus célèbre est Trébonien, ces auteurs qu’un historien moderne appelle les grands classiques du droit, avait fait brûler ce qu’il avait rebuté et ce qu’il avait accaparé, ce qu’il avait réformé et ce qu’il avait démarqué. Ainsi périrent Gaïus, Papinien, Paul, Ulpien.
C’est dans les édifices, construits en pierre et en brique par ce féroce compilateur que nos étudiants, aujourd’hui encore, retrouvent l’architecture du droit romain ; leurs maîtres ont sondé les murs et les caves de cette adaptation pour reconstituer les origines lointaines du droit français.
Féroce, imposant et fourbe, casuiste fervent, croyant tourmenté, obsédé par la thèse, assailli par le scrupule, autocrate et pusillanime, dialecticien, théologien, despote, cynique comme Néron, et parfois réformateur comme Antonin, défendant la doctrine contre un essaim d’hérésies, tremblant pour sa vie que mettaient en péril les séditions, en lutte contre les Ariens, en guerre contre les Vandales, créant l’art chrétien, étendant son empire sur les côtes de la Méditerranée, Justinien ne fut pas un grand législateur, mais un grand pétrisseur de lois. Il atteste qu’il faut comparer, confronter et condenser quand on légifère. La loi doit être une statue de bronze. Nos lois actuelles, nos lois journalières coulent comme de la fonte en fusion.
Comment se sont formés nos Codes ? Pour cette étude importante, il nous faut remonter le cours des siècles.
III
La plus grande brisure qui ait divisé jusque dans ses fondations le monde civilisé s’est produite en 395 à la mort de Théodose, quand l’Orient et l’Occident ont formé deux empires. Lointaine rivale de Rome, la Ville éternelle, Constantinople s’apprêtait à dresser ses minarets sous un soleil nouveau.
La civilisation avait changé de versant. Balayés par l’invasion des barbares, les champs de la culture latine avaient été envahis par la sauvagerie germanique. La race mérovingienne disparut sans éclat avec Childéric III que fit déposer Pépin le Bref.
Lorsque Charlemagne, vainqueur à Roncevaux, fut proclamé à Rome empereur d’Occident, il parut qu’une grande puissance territoriale et morale se reformait. Devant son épée « suspendue aux épaules par un baudrier de cuir », sous sa main qui tenait le globe d’or, ce chef des Francs, qu’il se tournât vers l’Ebre ou vers l’Elbe, vers le sanctuaire détruit de I’Irminsul, élevé jadis à la gloire d’Odin, ou vers le temple de Jupiter que baigne encore l’Arno, vit s’étendre des domaines immenses et des multitudes que dominait sa majesté.
Il assura la renaissance intellectuelle ; il appela auprès de lui les savants, il ouvrait l’École du Palais ; ignorant, il institua le culte des lettres ; mais il eut de mauvaises finances et ne veilla pas aux fondations de son trône. Il était sous le dais de l’Église, il contemplait son empire et ne vit pas qu’il perdait son royaume ; il émiettait son autorité et ses terres aux mains de ces compagnons d’armes, de ces leudes qui se multipliaient et qui grandissaient auprès de lui.
Louis le Débonnaire vit ses propres fils Lothaire, Louis et Pépin se révolter contre lui, Charles le Chauve soutint une guerre fratricide qui lui laissa la France, qui donna l’Allemagne à Louis le Germanique, la Lorraine et l’Italie à Lothaire. Et ce fut, par le traité de Verdun, le démembrement du royaume. L’ambition et le pouvoir des seigneurs, propriétaires terriens, grandissait.
En 861, Robert le Fort demanda et obtint le duché de France à titre héréditaire. Cet exemple ne fut pas perdu.
En 877, un événement capital se produisit. Charles le Chauve se laissa arracher la capitulation de Kiersy sur Oise qui consacrait l’hérédité des fiefs. Il était à la merci des nobles, ayant eu besoin de leur appui pour se faire sacrer deux ans plus tôt empereur d’Occident.
Le système féodal s’est créé au cours de la lutte engagée par Charles le Chauve contre ses frères.
Le système féodal a été consacré par la capitulation de Kiersy.
On parle beaucoup de la féodalité. Il convient de la définir comme état politique et comme système économique. La féodalité consiste essentiellement dans l’asservissement de l’homme à la terre, dans la dépendance dans laquelle l’homme est placé par rapport au domaine sur lequel il vit. Ce domaine est un fief et ce fief a un maître : le seigneur.
La formule « le serf est attaché à la glèbe » n’est pas une locution imagée. Les serfs sont un cheptel de fer attaché comme les animaux au service du fonds. Les êtres humains qui vivent sur le fonds sont assujettis à la loi du fonds. Et le fonds ne leur rendra pas un espoir de liberté plus grande en se morcelant. Grâce à la capitulation de Kersy, le fief restera intégral ; il est héréditaire, c’est-à-dire qu’il passe à l’aîné. Le roi de France, et cette conception s’accuse sous Hugues Capet, est le premier des seigneurs féodaux, mais il n’a droit de souveraineté que, comme les autres, sur les terres de son fief.
Entre les seigneurs féodaux, une alliance et une hiérarchie va s’établir, grâce à leur enchâssement dans l’Ordre de la Chevalerie qui leur impose ses lois quant au culte de l’honneur, ses lois quant à l’observation de leur dépendance mutuelle. Car la Chevalerie n’est pas une institution forcée, c’est un Ordre où l’on postule pour être admis : on naît noble ; on devient chevalier.
Le vassal est le possesseur de fief qui, désirant s’annexer parce qu’il ne trouve pas ses forces suffisantes ―telle est la raison la plus fréquente ―se met sous la dépendance d’un plus puissant seigneur et le reconnaît comme Suzerain. Il lui doit la foi et l’hommage ; il lui doit le service de guerre dit service de l’ost.
Le collier magnifique est bien formé : il est relié par une chaîne d’or : le roi est la pierre la plus brillante de ce collier, il n’est ni la plus grande, ni la plus riche.
Ce système terrien presque indestructible allait cependant être déconsolidé. Il fut ébranlé par le plus incroyable, le plus fabuleux des événements : les Croisades.
En 1095, Urbain II prêche la première Croisade aux Conciles de Plaisance et de Clermont.
Sans doute la chrétienté souffrait de voir le tombeau du Christ aux mains des infidèles, sans doute les hommes du moyen-âge étaient capables de partir comme les bergers de la Palestine pour suivre une étoile miraculeuse jusqu’à l’étable de Bethléem, mais la Papauté n’aurait pas encouragé Pierre l’Ermite à élever la voix et à déchaîner les foules, si elle n’avait eu ses desseins secrets.
Urbain II voulait établir à la face des souverains temporels sa puissance et leur prouver que son geste spirituel pouvait soulever la masse de leurs sujets.
Et nous ne connaissons rien de plus passionnant, rien de plus émouvant, ni rien de plus instructif que la lutte de la Papauté contre l’Empereur, du souverain chimérique contre le souverain temporel, du prêtre contre l’expansion du peuple, rien de tragique comme ce conflit qui prend notre race à son berceau et qui dure encore au nom d’un Messie dont les yeux seraient épouvantés s’il pouvait voir ce que ses prétendus serviteurs ont osé faire en abusant de sa doctrine, de sa croix et de son nom. « Ces deux moitiés de Dieu le pape et l’empereur », a écrit Victor Hugo.
Les papes disaient : Il Y a deux astres : le pape est le soleil, l’empereur est la lune. La lune reçoit sa lumière du soleil.
Lorsque les Barbares eurent dévasté l’Europe, l’Église fut inquiète ; elle pouvait se trouver dans la sujétion de Constantinople ; elle cherchait un pouvoir temporel qui offrit, pour le moins, un port à la barque de Saint Pierre. Elle s’accommoda des faibles Mérovingiens ; elle prit avec faveur Charlemagne sous sa tutelle dissimulée. Le fractionnement de l’empire carolingien et surtout la formation de la féodalité la mirent en grave péril. Elle ne mordait plus sur ces possesseurs de fiefs qui ressemblaient à un champ de lances aux pointes hérissées. Il lui fallait un maître qui la protégeât d’abord et qu’elle dominât ensuite. Elle jeta son dévolu sur Otton 1er, le jour où, ayant restauré la couronne des rois lombards, il la prit, puis la changea pour la couronne impériale. L’Église encouragea les destinées du Saint-Empire germanique. Elle menaçait d’être sa vassale, le pape Grégoire VII surgit !
Cette locution « aller à Canossa » est à la mode chez les érudits que sont nos parlementaires ; on la répète depuis surtout que M. de Monzie l’a donnée pour titre à une de ses brochures. On comprendra mieux le retournement que consacre cette humiliation célèbre, si l’on veut bien résumer en quelques lignes deux siècles d’histoire.
Au lendemain de « l’an mil », le pape, pour emprunter à M. Driault une expression heureuse, semble être devenu le chapelain de l’empereur.
En 1059, le concile de Latran confie l’élection des papes aux prêtres de Rome et aux cardinaux, en dehors de l’ingérence étrangère ; la querelle des investitures commencera quinze ans plus tard pour la collation des grades aux ecclésiastiques.
Henri IV, empereur d’Allemagne, dépose le pape, Grégoire VII ; le pape Grégoire VII dépose l’empereur.
Le souverain humilié se rend en Toscane, à Canossa ; il se prosterne en costume de pénitent devant le Pontife et, après trois jours de supplications, se voit rendre dédaigneusement son sceptre.
Le pape avait vaincu ; Grégoire VII pouvait mourir. L’empereur tenait sa couronne de Notre Saint Père le Pape ; Frédéric Barberousse essuya l’affront de cette déclaration insolente le jour où un légat bien stylé vint le saluer à Besançon, porteur des lettres papales où l’empire était déclaré un « bénéfice » accordé par le Saint-Siège.
Urbain II, avant même l’avènement de Frédéric Barberousse, mais après le triomphe de Canossa, lançait sur les routes inconnues de la Syrie les féodaux et leurs milices, au lendemain du jour où l’Église venait d’excommunier le roi de France, Philippe 1er.
Les seigneurs qui prirent la croix, qui se « croisèrent » à l’appel de Pierre l’Ermite, ou à la voix de Saint Bernard, cinquante ans plus tard, connurent des fortunes diverses : quelques-uns s’enrichirent d’un butin opulent, mais combien périrent et combien se ruinèrent ! Les fiefs en souffrirent ; il fallut pourvoir à la succession des seigneurs qui n’avaient pas d’héritiers directs ; la bienveillance du roi fut nécessaire pour trancher bien des cas épineux ; la souveraineté royale se trouva renforcée.
Les huit Croisades, ―accès de cette folie ont duré en tout cent soixante-quinze ans et ont déterminé huit expéditions, ―constituent la série d’événements qui a le plus contribué à désagréger la féodalité.
Mais, parallèlement une révolution se produisait. L’orgueilleux isolement du fief n’avait pu empêcher la ville de naître. Cette ville, bâtie sur la terre du fief, n’échappait pas à la loi du fief, mais elle avait une population ; ses artisans, par leur travail, arrivaient à l’aisance. Le jour vint où entre les habitants d’une ville l’idée de solidarité naquit. La ville comprit qu’elle pouvait former une commune.
La commune était essentiellement une fédération municipale constituée par une association mutuelle sous la foi du serment. L’acte fondamental de la commune était le pacte d’assistance réciproque, assistance jurée.
La cohésion une fois obtenue, la commune dressait ses cahiers de revendication contre les tailles injustes et les exactions. Elle pouvait alors négocier avec son seigneur suzerain. Elle lui offrait d’acheter l’indépendance au prix de redevances fixées ou de services déterminés.
Les communes qui se heurtèrent à un refus conquirent leur liberté les armes à la main.
Les communes, aussitôt qu’elles étaient soustraites à la suzeraineté seigneuriale, se plaçaient sous la protection du roi.
La royauté vit le parti qu’elle pouvait tirer de cette émancipation pour l’extension de l’autorité royale. Rapidement, à cet avantage, le roi ajouta un profit : les sommes annuelles que les communes s’engagèrent à lui payer pour prix de sa protection.
Ce grand mouvement de l’affranchissement des Communes semble être parti des Flandres et il est certain qu’il parvint sous Louis le Gros à son apogée magnifique. Louis le Gros le favorisa. Mais nous notons, dès 1073, trente-cinq ans avant son avènement, l’établissement d’une commune au Mans ; celles de Laon et d’Amiens se sont créées en 1111.
Nous avons vu combien Rome était hostile à la féodalité. Les prêtres entrèrent avec ardeur dans la croisade civique pour l’affranchissement des communes. Sous le régime féodal, il n’y avait que des nobles ou des gens d’Église ; se sont les communes affranchies qui ont donné la bourgeoisie et formé le Tiers État.
La Féodalité avait divisé le pays en duchés, comtés, vicomtés, marquisats.
Le front bourré de ruse sous son chapeau retroussé, le sourire enduit de fiel et de miel, dangereux compère, politique cauteleux et sans foi, Louis XI a comprimé la féodalité et l’Église dans sa main sournoise, pétrissante : il a fait l’œuvre d’un grand roi. Il avait senti que, pour tenir tête au pouvoir ecclésiastique, un souverain temporel devait s’attribuer le plus grand nombre possible de nominations ecclésiastiques, et il le fit.
Pour réduire la féodalité, il trancha dans les prérogatives féodales et il les raccourcit, notamment le droit de justice. Il confia des emplois enviés à des gens sans naissance. Il servait sa rancune, à vrai dire.
Dans le début du règne, les Seigneurs avaient formé contre lui la « Ligue du Bien public » qui fut l’Union sacrée des féodaux. Les intérêts de caste ou de parti prennent volontiers les couleurs et la devise du Bien public. Mais le joueur madré qui avait échappé à la souricière de Péronne, regardait plus loin que sa vengeance : on ne peut lui contester des vues profondes sur le présent, et des vues larges vers l’avenir. La carcasse du dévot tremblait ; le despote la menait loin.
Il y avait, au surplus, bien de la grimace dans la superstition de ce pêcheur impénitent, dans sa façon de toucher, sous son vêtement, des médailles, d’apaiser les saints par de riches offrandes, d’implorer et de quereller la vierge pour obtenir la faveur ou le pardon du ciel.
Opiniâtre, malgré ses prétendus remords, il se défiait même des compagnons qu’il s’était donnés, mais il surveillait ses ennemis. Lorsque Charles le Téméraire alla briser son étincelante armure contre les suisses de Morat, le roi de France, en chaussures de feutre, dans son château de Plessis-les-Tours, médita de déposséder les princes qui ne songeaient qu’à se partager le territoire. Quand la mort se présenta, effrayé par ses approches, le geôlier du cardinal la Balue ― cardinal conspirateur « auquel il ne manqua, en fait de vices, que l’hypocrisie », ―fit venir d’Italie Saint-François de Paule pour lui demander le miracle de vivre. Le sceptre échappa de la main qui voulait le tenir encore, mais à ce sceptre Louis XI avait conquis la royauté.
Mais, malgré le système féodal, autour des villes, s’organisa lentement la province. Gratien avait divisé la Gaule en 17 provinces d’après ses populations différentes ; la féodalité avait voulu effacer ces démarcations ; elles reparurent, profondément incrustées dans le sol. La configuration géographique des contrées, la particularité des mœurs, de la langue et des patois, l’affinité intérieure des coutumes et des habitudes, la spécialité de la culture ou du commerce font la province. Louis XIV savait bien ce qu’il faisait lorsque, voulant effacer des frontières intérieures, mais n’osant toucher aux provinces, il les remaniait cependant et les distribuait en quatre-vingt gouvernements.
Le morcellement de la France semblait devoir être éternel. Il a fallu la guerre de Cent ans, l’occupation étrangère, Paris au pouvoir des Anglais, la communauté du péril et de l’angoisse, pour révéler aux Français leur confraternité de race. Historiquement, le sacre de Charles VII à Reims a été le baptême de la patrie. Le moyen-âge finit, la féodalité succombe, les temps nouveaux sont commencés ; rien ne s’oppose à l’organisation de la royauté, et la royauté assume le devoir d’organiser la France : telle est la mission à laquelle elle a failli.
L’avènement d’un huguenot, apostat par intérêt : Henri IV et l’inertie ennuyée de Louis XIII rendront quelque espoir aux féodaux impénitents, mais Richelieu a compris le danger. Il abat les châteaux forts ; il veut empêcher les seigneurs de restaurer cette puissance qu’on nomme réellepar opposition à personnelle, qui est assise sur la terre, sur le fief. Le supplice de Saint Mars justifie la parole du cardinal « grand français » : je fauche tout et je couvre tout de mon manteau rouge. Louis XIV va pouvoir aménager Marly et créer ce fastueux jardin d’acclimatation : Versailles. C’est là que la noblesse apprivoisée sera réunie pour étaler le luxe chatoyant de ses plumes et pour prendre, sous l’œil du maître, ses dociles ébats.
IV
L’antiquité qui a étendu ses rayons sur la Renaissance intellectuelle de la France nous a fourni la préface du droit.
Les origines de la France nous permettront d’étudier l’origine de notre droit.
Divisons notre analyse en trois paragraphes :
-
Les Parlements ;
-
Les ordonnances royales ;
-
Les États généraux.
I. Les Parlements. ―Les seigneurs féodaux étaient tenus de rendre la justice à leurs vassaux et à leurs serfs. L’Assemblée de prélats et de barons qui composait cette Cour à la fois civile et criminelle est l’origine du Parlement.
Le roi, en tant que seigneur féodal, avait son parlement auquel il attribua une prépondérance ; il lui attribua la connaissance de certains cas dits royaux.
Le nombre des causes augmentant, les juges féodaux s’adjoignirent des clercs pour l’instruction et la préparation des affaires. Quand survint l’affranchissement des communes, il fallut examiner les litiges de la bourgeoisie et régler les questions qui intéressaient les communes.
C’était beaucoup de travail. Les juges s’en remirent aux clercs et se désintéressèrent des audiences ; ainsi les clercs se substituèrent aux juges. La royauté en profita pour transformer les clercs en juges qu’il nomma. En 1319, Philippe le Bel composant son parlement, exclut les prélats. Ils sont trop occupés, dit-il avec malice, pour que je les détourne de leur charge ; il admit un baron ou deux, pure condescendance à la tradition.
Le Parlement de Paris ―nous le prenons à l’époque où sa constitution est parfaite ― une juridiction immense, elle s’étendait de l’Ile de France jusqu’à la Picardie, jusqu’au Lyonnais, jusqu’au Rochelois. Elle couvrait toutes les provinces du Centre. Le Parlement connaissait, comme juridiction exceptionnelle de toutes les affaires qui intéressaient le roi ou la couronne, l’Université de Paris et les établissements hospitaliers.
Le Parlement avait un pouvoir judiciaire, un pouvoir politique et un pouvoir administratif. Sa Grand’ Chambre, sa Chambre criminelle (la Tournelle), sa Chambre des enquêtes, sa Chambre des requêtes, embrassaient et se partageaient les causes civiles et les causes criminelles.
Le pouvoir politique du Parlement s’exerçait sous trois formes :
-
Il avait le droit de remontrance, lorsque les actes législatifs du roi lui paraissaient donner matière à ses observations ;
-
Les ordonnances du roi n’étaient légalement exécutoires qu’une fois enregistréespar le Parlement ; le Parlement pouvait refuser l’enregistrement ; il fallait des lettres de jussion ou un lit de justice pour l’y contraindre ;
-
Le Parlement rendait des arrêts d’édit, ou comme nous dirions aujourd’hui des arrêts de principe. Réuni en Assemblée générale, il déclarait sa volonté de juger toujours en un sens déterminé ; sa loi équivalait ainsi à une loi.
La royauté devait porter a ce pouvoir de résistance et de contrôle deux coups funestes :
En 1566, la fameuse ordonnancé de Moulins prescrivit que le Parlement enregistrerait d’abord les ordonnances, quitte à exercer ensuite son droit de remontrance.
Au début de son règne, Louis XIV, jouant le rôle que lui avait soufflé Mazarin, se rendit dans la Grand’Chambre. Il venait de chasser à Vincennes. Des éperons aux bottes, le fouet en mains, il déclara aux Conseillers sa volonté : à l’avenir ils s’interdiraient de délibérer sur les affaires de l’État.
Mais le Parlement, quoique soumis, avait conservé sa vitalité. En 1771, Louis XV l’exila. Sous Louis XVI, ce furent ses protestations énergiques et son opposition au roi qui déterminèrent la convocation des États généraux.
Ajoutons que les Parlements de province avaient tous des pouvoirs identiques, égaux aux pouvoirs du Parlement de Paris, sauf la restriction des cas spéciaux. Mais en fait leur juridiction régionale n’avait rien de politique. Parfois, on leur demandait des services. C’est ainsi que les « provinciales » de Pascal durent être brûlées sur une condamnation prononcée par le Parlement d’Aix, mais quand le feu fut allumé, les fins magistrats provençaux firent livrer aux flammes, à défaut du précieux libellé, un vieil almanach des Jésuites.
II. Les ordonnances. ―Les ordonnances des rois émanent de leur pouvoir souverain. Elles contiennent des dispositions générales et d’administration ou des dispositions spéciales et de police. Elles ressemblent beaucoup à nos décrets modernes et très peu aux ordonnances royales qui, après la Révolution, ont été rendues pour assurer l’exécution des lois. Elles faisaient loi.
Elles sont le fruit de la volonté du prince. On se tromperait si on les considérait comme la fleur de son bon plaisir. Pour s’exercer, le bon plaisir avait mieux que les ordonnances. On comprend que les rois aient eu le désir de codifierleurs ordonnances, en les réunissant dans un recueil. Dagobert rassembla celles de Charlemagne en un volume qui s’appelle les Capitulaires.
Charles VII eut une vue plus haute. Il entreprit de réunir les Coutumes de France. Henri III eut la même idée, mais il échoua.
On le comprend. Quel intérêt pouvait avoir ce Digeste informe aux yeux de gens qui se pliaient à une coutume ou, par suite d’un changement dans leur état, se soumettaient à plusieurs sans espérance de les voir se concilier ou s’unifier ? C’est ici le lieu de préciser quel était le droit applicable en France.
À Rome, on distinguait entre le droit écrit et le droit non écrit. En France, le droit écrit était le droit romain. Il y avait les pays de droit écrit, et il y avait les pays de droit coutumier. Les coutumes différaient suivant les provinces ou les villes. Il y avait la coutume de Bordeaux, de Paris, de Picardie, de Normandie... On pouvait se marier d’après l’une, hériter d’après l’autre.
Nous verrons que le triage et la fusion de ces éléments ont formé la législation à laquelle les Codes ont donné un corps.
Parmi les ordonnances les plus utiles et les plus sages, il faut citer celles de Philippe Auguste, de Saint Louis et de Philippe le Bel.
III. États généraux. ―Les États généraux peuvent être définis : une Assemblée moitié plébiscitaire, moitié consultative, ―mais plébiscitaire sans le peuple et nationale avec trois éléments de la nation, les deux premiers formant la majorité contre le troisième. Ces trois éléments étaient : le clergé, la noblesse et le Tiers état, on le sait du reste : le clergé et la noblesse écoutaient debout la communication du roi, le Tiers État à genoux.
La première réunion des États généraux, ―la première tout au moins dont nous ayons la trace, ―eut lieu en avril 1302 à Paris. Philippe le Bel consultait les États sur ses démêlés avec Boniface VIII. Le bon sens « gallican » ―on peut employer le mot ―de ces français bien inspirés leur fit approuver la résistance du souverain temporel.
En 1308, ils délibèrent à Tours sur l’arrestation des Templiers, en 1317, à Paris, sur la loi salique. Mais, voici la guerre avec les Anglais ; ils sont appelés à voter les subsides ; ils en profitent pour réclamer en échange la suppression des gabelles, et la promesse de ne plus altérer les monnaies. Ils repoussent comme trop dur le traité conclu par le roi Jean avec les Anglais, et votent la levée d’une armée. En 1439, à Orléans, ils décident l’établissement d’impôts perpétuels pour une armée permanente. Ils reviennent aux délibérations politiques après la bataille de Castillon qui avait mis fin à la domination anglaise.
Sous Louis XI, ils décident que la Normandie ne peut être accordée à Charles, frère du roi. Ils décernent à Louis XII le titre de Père du peuple et se prononcent pour le mariage de sa fille avec François 1erde préférence à Charles Quint. En 1576, la prépondérance du clergé et de la noblesse leur fait réclamer la révocation de l’édit donné par Henri III aux protestants, et en 1588, fidèles à la même hostilité, mécontents de leur souverain, ils menacent de transférer la couronne dans la maison de Lorraine. Henri III coupe court à ces velléités en faisant assassiner le duc de Guise. Enfin, en 1614, les États, sont appelés à se prononcer sur la réunion à la France du Béarn et de la Navarre. C’est leur dernière assemblée, ils ne seront plus convoqués avant 1789.
V
Les esprits fermentaient, les encyclopédistes travaillaient, l’incrédulité coulait à pleins bords ; la gloire de Voltaire avait changé la couleur du soleil ; les œuvres de Rousseau si fausses, mais si séduisantes, qui semblent salubres et qui sont herbeuses, avec de grands horizons en trompe-l’œil, avaient démoli les charmilles, bouleversé les jardins et les pelouses de le Nôtre, ― je parle au figuré, ― inspiré aux femmes le désir d’un retour à la nature et convaincu les hommes que lorsque les idées ont leurs apôtres, l’heure où les revendications grondent n’est pas éloignée.
La fièvre de la richesse, l’insuccès de Necker, le mauvais état des finances, l’impopularité des ministres, la haine des jésuites à peine calmée par l’inutile édit qui les avait supprimés, avaient en cinquante ans ajouté des rancunes aux colères.
Comment Louis XVI, après l’Assemblée des notables à Paris, se décida-t-il à convoquer les États généraux dont la France semblait déshabituée ? Obéissance aux injonctions du Parlement, désir de consultation et de conciliation ? L’une et l’autre hypothèse semblent insuffisantes. Peut-être espérait-il comprimer son époque frémissante par le poids dont la noblesse et le clergé pourraient peser sur le Tiers état.
Un vote déçut cet espoir s’il le caressa. L’Assemblée décida que la vérification des pouvoirs, comme nous dirions aujourd’hui, s’opérerait par tête et non par ordre : la Révolution était faite.
La Révolution a brisé la trilogie artificielle qui représentait le pouvoir populaire, elle a fait surgir le peuple, elle a retrouvé le peuple, elle a dégagé le peuple. Elle a rasé, elle a défriché le champ social. Du peuple conscient il fallait faire un peuple organisé. Elle avait deux devoirs immenses à remplir :
-
Créer une constitution ;
-
Créer une législation.
C’est alors que jaillit une des plus belles pages qui soit sortie de la main d’un homme : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Elle a été rédigée par Robespierre qui s’était inspiré de Condorcet, mais l’éclair efface la lueur et le bond du héros dépasse la marche didactique du philosophe.
On voit, si on l’analyse, que la Déclarationest fondée sur la propriété.
L’homme est propriétaire de sa personne, et il lui est interdit de l’aliéner ; l’égalité est une condition de cette propriété, la seule qui empêche les empiètements injustes.
L’homme est propriétaire du fruit de son travail et de son industrie, propriétaire de ses biens et de ses revenus.
La déclaration de 1795, qui ajoute les devoirs aux droits, ne fait que donner une précision plus incisive à la pensée de la Déclaration maîtresse, celle qui est la charte de la liberté.
La proclamation précède la grande œuvre législative dont elle résume l’esprit.
On écrit communément que le Code civil a été l’œuvre du Tribunat : c’est fausser la vérité en la simplifiant.
Le 15 prairial an 2 (30 mai 1794), la Convention traçait le programme suivant :
« Les divers Comités de la Convention devront se concerter avec les commissaires pour les changements nécessaires, pour baser les lois sur les principes de liberté et d’égalité, les compléter et les rendre concordants. Chaque Code devra être présenté à la Convention aussitôt qu’il sera achevé. »
Les Révolutions évoluent. La Convention attendait les Codes : ils furent l’œuvre auquel Napoléon attacha son nom.
On pourrait croire qu’il les approuva de conscience et les timbra de son sceau sans les lire. Il prit au contraire comme consul et même comme empereur, une part active à leur conception. De tous les conquérants, il fut le plus soucieux du détail ; la quatrième coalition était formée par la Prusse contre la France ; le vainqueur d’Iéna était aux armées, il fit remettre sur le chantier le chapitre des faillites : le Tribunal s’occupait alors du Code de Commerce.
Voici quelle était la procédure adoptée pour l’élaboration des Codes.
La section législative du Conseil d’État rédigeait un projet qu’elle soumettait à l’assemblée générale du Conseil d’État. Ce projet, remis au Corps législatif, était obligatoirement transmis au Tribunal ou Assemblée des tribuns, et soumis ensuite, avec ses modifications, au vote du Corps législatif. Après ces tergiversations qui aboutirent à un retrait, les premiers livres du Code civil furent enfin présentés au Corps législatif.
« Législateurs, s’écriait Portalis, dans l’exposé des motifs, le vœu de la nation, celui des assemblées délibérantes est rempli. Des lois différentes n’engendrent que le trouble et la confusion... Désormais, nous ne serons plus Provençaux, Bretons, mais Français ».
Paroles trop faibles encore pour le grand événement qui s’accomplissait. Nous avons noté à Reims le premier bégaiement de la patrie. La patrie, devenue populaire, s’affirmait majeure et trouvait la conscience de son unité aux pieds de cette statue d’airain qui avait dominé les peuples antiques et que la France n’avait jamais érigée : la loi.
L’œuvre napoléonienne allait presque aussitôt recevoir un complément et subir une retouche que la Restauration ne fit pas attendre à l’usurpateur même avant les Cent Jours. Louis XVIII, le 4 juin 1814, daignait octroyer à ses sujets la Charte constitutionnelle. Charles X et Louis Philippe qui s’attaquèrent surtout à la presse, retranchèrent à l’œuvre législative des attributs et lui infligèrent des ornements qui ramenèrent tant bien que mal sa masse prodigieuse au style de leurs règnes. Les idées de la garde nationale se trouvèrent mélangés avec les principes de la Révolution.
VI
Quelle est l’économie de notre législation ?
La montagne se modifie chaque jour par les avalanches qui détachent de ses flancs ou de son sommet des rochers, par les couches nouvelles qui surchargent ses assises et qui amplifient ses contours. Mais considéronsla telle qu’elle s’est trouvée constituée au début du second empire.
Notre système législatif qui répond à notre système social, est un système en pyramide. Le peuple, supporte l’édifice. Sur des pavois successifs, s’étagent les hommes que leur force, leur ruse, la courte échelle de la faveur, l’appel du pouvoir et parfois leur mérite ont élevés aux situations supérieures. Le souverain au sommet à les épaules libres et laisse sa surveillance descendre jusqu’à la base. Il n’a qu’une crainte ; qu’un désordre ou un tremblement dans ces couches humaines successives l’entraîne sa chute.
La loi protège d’abord le souverain ; elle édicte des peines sévères contre quiconque oserait attenter à la vie du prince ou de ses proches, elle réprime l’outrage de lèse-majesté et pour décourager les indisciplinés elle protège la construction sociale elle-même, elle a inventé ce délit admirable : l’outrage à la morale publique. Comment définir la morale publique quand il est si difficile de définir la pudeur publique dont les femmes chaque jour changent les bornes et rétrécissent les frontières ?
Le maître a le pas sur le serviteur. Il est cru sur son affirmation si un différend s’élève quant au salaire qui est dû.
La femme est dans la main du mari. Les enfants et leurs biens sont à la merci du père. Le Code de Napoléon aurait eu mauvaise grâce à ne pas admettre le divorce dont la vie impériale lui fournissait un éclatant exemple, mais le divorce a été aboli par le retour des rois légitimes, descendant des rois très chrétiens. Enfin et surtout, la loi protège la fortune immobilière qui est la « propriété » la plus essentielle, les meubles et valeurs mobilières passant alors pour l’accessoire. Tel est le mont Ararat sur lequel l’arche est restée longtemps encastrée.
VII
Nous ne pouvons suivre le lent travail qui a tenté et qui tente tous les jours d’accommoder le mont aux nécessités de la vie moderne. Sa pointe est tombée ; plus de prince, comme dit le Code, plus de lèse-majesté. Plus d’outrage à la morale publique, plus de présomption légale pour l’affirmation du maître. Un pâle rayon d’indulgence est descendu sur ceux qui sont tombés au pied de la montagne, qui sont hors de ses échelons réguliers : les faillis de la vie, et les faillis du commerce. On a même supprimé la mort civile. L’excommunié jadis ne pouvait entrer en contact avec un chrétien et nulle main chrétienne n’était autorisée à lui tendre les aliments. Le mort civilement était pareillement retranché de la Société, ― « perinde ac cadaver ». Son mariage était dissous ; les actes de la vie civile lui étaient interdits, il ne pouvait même léguer ses hardes à son enfant.
Toute indignation rétrospective serait déplacée, mais l’esprit des lois est si persistant qu’on retrouve toujours dans le Code même épuré le parfum flottant du Code oblitéré.
Nous voudrions indiquer les grandes réformes, celles que nous considérons comme essentielles, qui ont vraiment entamé, au profit de la vie moderne, le bloc granitique.
* * *
La loi sur les expropriations. ―Ce fut une révolution et une renaissance. Ceux qui ont vécu au sein des campagnes, qui ont étudié l’histoire d’une province savent ce qu’était la vie rurale et ce qu’était la condition des paysans il y a cent ans. Le quart des terres était inculte, envahi par les joncs ou détrempé. Il était impossible d’établir un système rationnel ou suffisamment contenu pour l’irrigation ou pour l’épanchement des eaux. Il aurait fallu toucher à la propriété du voisin.
L’automne venu, les chemins étaient presque impraticables, coupés par des ravins étroits, rongés par leurs fossés. Il n’était pas rare qu’un voyageur téméraire appelé dans un village, vît sa voiture s’embourber, et qu’il fallût quérir des bœufs dans quelque étable lointaine pour le tirer du mauvais pas. Le métayer mangeait du pain de seigle et tuait un cochon dont la chair, salée dans un pot de grès, fournissait aux festins espacés de la famille. On appelle, dans certains pays, les beaux habits, les habits de fête, des habits à manger de la viande, tant ce luxe était rare.
On a osé toucher à la propriété, pour satisfaire à l’intérêt public, moyennant une juste et préalable indemnité. Des travaux d’intérêt public ont pu être entrepris, des routes créées, des établissements publics édifiés : l’expropriation est devenue d’usage si courant, quoique son emploi soit prudent, qu’on ne songe plus à ce que pouvait être la face des régions ou la forme des villes avant son invention.
Les lois du travail. ―Les lois sur la réglementation du travail, sur la limitation de sa durée, sur le repos hebdomadaire, sont une dérogation évidente mais bienfaisante et légitimeà la liberté des contrats, dans l’intérêt de la liberté.
La Déclaration des Droits de l’Homme a proclamé non seulement la liberté, mais aussi la sûreté, c’est-à-dire l’aide sociale à laquelle le citoyen doit prétendre pour la sauvegarde de ses droits reconnus.
Nos ancêtres qui ont planté des arbres de la liberté ont entouré l’arbrisseau d’épines pour le protéger ; leurs descendants doivent entourer l’arbre d’une grille solide pour le défendre contre ceux qui voudraient l’ébrancher, le meurtrir ou l’abattre.
Or, voici le phénomène qui s’est produit :
Les législateurs anciens ne connaissaient que les formes anciennes de l’absolutisme et de la tyrannie. Ils ont garanti l’homme contre les abus et les excès qu’ils ont pu prévoir ; ils ne connaissaient pas les valeurs financières et ne considéraient pas les quelques feuilles volantes éparpillées ou collectionnées par le commerce comme pouvant un jour se transformer, s’amonceler, constituer des fortunes dont la forme dépasserait celle de la fortune immobilière. Pour le dire d’un mot, ils n’ont pas prévu ce que nous appelons le Capital.
Le Capital, entre les mains de la Finance, du commerce et de l’industrie a pris la même consistance que la terre entourant le château-fort, quand elle était la propriété des seigneurs féodaux. L’usine est un fief, la mine est un fief, la grande maison commerciale est un fief. Ces fiefs asservissent ceux qui vivent et travaillent sur le fief. Ceux qui comparent le régime capitaliste à la féodalité ne savent pas toujours combien ils ont raison, à cette différence près que le seigneur féodal avait une tête et un visage, que le capitaliste peut n’en pas avoir. La société anonyme, la société par actions, la société en commandite même sont des entités, des personnes surhumaines et masquées ; la cote de mailles qui revêt ces puissants suzerains est formée de mailles nombreuses et la visière baissée, ils reluisent de tous les reflets extérieurs du coffre-fort.
La liberté des contrats n’existe que là où le consentement est libre ; le voyageur qui part pour une affaire urgente et qui prend son billet de chemin de fer ne conclut pas avec la compagnie un libre contrat de transport. Peut-il discuter le prix ?
L’ouvrier qui loue ses services au maître d’une fabrique, d’un chantier, etc., ne conclut pas un libre contrat de louage, alors surtout que, par une entente commune, les patrons ont unifié les conditions générales des contrats alors que, pour employer une formule familière mais énergique, c’est à prendre ou à laisser, alors que l’être humain qui a des bras mais qui a une bouche et d’autres bouches à nourrir outre la sienne, doit se soumettre, marcher ou mourir.
* * *
La loi sur les accidents du travail a jeté bas une des poutres les plus robustes de la charpente judiciaire.
Il était de doctrine et de jurisprudence que les dommages-intérêts prenaient leur source dans une faute commise. Le Code civil contient, même, à cet égard, deux dispositions caractéristiques du principe. Lorsque des marchandises arrivent avariées, une présomption de faute pèse sur le transporteur. La chose inanimée est inconsciente et ne peut fournir un témoignage. La personne accidentée peut et doit au contraire prouver la faute du transporteur. Lorsque, emporté dans un express, vous êtes la victime d’une catastrophe, pourrezvous prouver la faute du mécanicien ou la défectuosité de la voie ? La Cour de cassation, par des arrêts qui sont récents, a imposé au transporteur, dans tous les cas, une présomption de responsabilité.
L’ouvrier blessé devra-t-il aux termes de la loi prouver la faute du patron ou de ses préposés ? Non ; le travail, par les risques inhérents à son exercice ou à sa production, est considéré comme un coupable permanent. L’ouvrier accidenté reçoit une rente ou une indemnité par le seul fait de sa blessure, de son impotence ou de son infirmité si elles sont le fait du travail ou si elles sont survenues à l’occasion du travail.
La loi, à l’origine, distinguait entre les exploitations. Elle s’appliquait à celles qui emploient la forme motrice à l’exclusion des autres.
D’où cette conséquence bizarre que, si un comptable, dans un bureau, à Paris, s’entaillait le doigt avec un canif et que si la maison mère dont dépendait le bureau, avec siège social à Rouen, employait dans ses ateliers un moteur, le blessé avait droit à une indemnité ; sinon il ne pouvait rien réclamer.
Les députés qui avaient voté, en fin de législature, cette loi embryonnaire se séparèrent avec la crainte et le remords d’avoir ruiné la petite industrie. Ils n’avaient pas songé à cette institution souple et variée : l’assurance qui s’empressa de se poser sur les magnifiques territoires annexés soudain au continent des risques. Aussi, pour la première fois, fût-il donné de voir la jurisprudence travailler à étendre, au lieu de la restreindre et de la stériliser, une réforme démocratique. Et des lois postérieures ont appelé tous les travailleurs manuels au bénéfice de l’allocation : indemnité de demisalaire pour l’incapacité partielle et permanente, rente proportionnelle pour l’incapacité absolue et permanente. Le travailleur reçoit l’indemnité même si l’accident a été causé par sa faute ; sa faute inexcusable entraîne seulement une réduction de la rente et il est irrecevable à réclamer s’il a intentionnellement provoqué l’accident.
Démembrement du droit de propriété. ― La dévastation produite par la guerre, l’arrêt qu’elle a infligé à la construction, plus encore le développement du bien être et la multiplication normale des habitants ont produit la crise du logement. Le logement est une nécessité. Le législateur a dû intervenir et faire céder le droit absolu du propriétaire sur son immeuble. Il a maintenu les locataires en possession, à condition qu’ils fussent de bonne foi et pour des périodes différentes fixées par ses dispositions moratoires. Nous applaudissons à cette expropriation relative. Nous saluons cette atteinte que subit la propriété destinée à usage de location et qu’on oblige à subir comme une servitude sa destination profitable. Le législateur qui a voté la loi du premier avril 1926 ne s’est pas trompé sur la portée de son œuvre. Il a dit que ses prescriptions constituaient un démembrement du droit de propriété. Il affirme son désir de revenir au droit commun : le droit commun devrait toujours résider dans la subordination de l’intérêt privé à l’intérêt général ; les lois sur l’habitation contiennent en germe une révision du droit de propriété.
Le législateur sent bien que des raisons d’équité non moins impérieuses l’obligent à voter la loi sur la propriété commerciale. Il ne montre aucun empressement pour hâter l’éclosion de cette loi : il ne sait comment l’équilibrer avant de lui donner son vol.
Pour créer un fonds de commerce, il faut un local. Le propriétaire, par un congé intempestif, pourra-t-il reprendre au commerçant le local et ruiner le commerce, pourra-t-il, par le retrait du contenant, répandre dans le ruisseau le contenu ? L’avenir répondra : le monde se meurt d’une propriété immobilière implacable et d’une puissance financière effrénée.
La vie nouvelle. ― Les taudis du droit. ― Autour de la cité juridique, composée de ses bâtiments les plus robustes et les plus vieux, toute une ville nouvelle s’est construite, notamment par l’édification des lois sur les sociétés, sur les associations, sur les syndicats.
À côté de l’individu, personne privée, à côté des villes, mineures administrées, se sont créées des personnes morales collectives, réglementées et régies par un droit nouveau.
En revanche, le Droit est encore obligé de s’abriter dans des masures délabrées et désuètes dont la réfection s’impose. Les malades ne se doutent pas que le règlement fondamental de la pharmacie est encore la loi du 21 germinal an II, que toutes les « spécialités », aujourd’hui innombrables, vendues sous les enveloppes et les cachets les plus attrayants, sont mises dans le commerce par tolérance ; que, strictement, tout remède devrait être préparé par le pharmacien, dans son office, sur ordonnance et pour chaque commande isolément. M. Aristide Briand, lorsqu’il était simple député, avait déposé un projet de loi pour réorganiser la législation en ce qui concerne la pharmacie ; le Parlement n’a pas trouvé le loisir de discuter le projet.
Le Parquet recourt encore à la vieille loi de 1836 sur les loteries pour arrêter la hardiesse des dragueurs d’épargne lorsqu’ils réunissent des souscriptions pour leur affecter globalement le profit des tirages sans leur conférer la propriété des actions.
La loi de 1838 sur les aliénés est lamentablement rudimentaire et permet les séquestrations arbitraires : tel fils prudent a fait interner son père pour l’empêcher de faire un testament valable.
Quels cahiers les États-généraux des juristes pourraient rédiger !
L’état des personnes. ―Sont Français plus de sujets d’après leur lieu de naissance ou la nationalité de leurs auteurs. Le divorce a été rétabli ; la prohibition du mariage avec le complice a été supprimée ; la femme peut disposer des salaires qu’elle s’est acquis par son travail. On peut dire que la puissance paternelle a été démantelée. Le père tuteur ne peut plus disposer du bien de ses enfants mineurs : il est soumis au contrôle et à la décision du Tribunal. Le mariage a été facilité par la simplification de sa procédure propre ; en outre par la réduction au minimum des anciennes exigences pour l’autorisation des parents ou pour les sommations respectueuses. De même, l’adoption a été simplifiée et cette faveur a produit un curieux abus. On voit des personnes mêmes âgées se faire adopter pour recueillir un héritage en ligne directe à titre d’enfant adoptif. L’adopté échappe ainsi au prélèvement démesuré de l’État sur les successions attribuées au collatéral ou à l’étranger.
VIII
Nous venons de voir comment les Codes se sont créés en France. Cet exposé, pour être complet, devrait rechercher comment ils se sont créés dans les principaux pays d’Europe.
Il devrait également traiter du Droit international. Mais ces questions de droit comparé et de droit, des gens trouveront plus naturellement leur place au mot LOIS.
— Paul MOREL.
COÉDUCATION
n. f.
L’éducation en commun des garçons et des filles a, depuis longtemps, été l’objet de controverses passionnées et bien qu’elle ait gagné du terrain, surtout ces dernières années, n’est pas encore pleinement réalisée.
« Ce fut au XVIIIe siècle, en Écosse et en Amérique, que les filles furent, pour la première fois, admises à des écoles de garçons. Sur le continent, Coménius avait, dans la « Grande Didactique » (1630), proclamé le droit de tous, filles et garçons, à une instruction intégrale en commun. Par contre Fénelon (1680), insistant sur les besoins différents des deux sexes, souligna l’idée qu’il faut à chacun d’eux une éducation spéciale.
Le mérite d’avoir mis en honneur la coéducation revient à Pestalozzi. Sa conception : « l’École doit être l’image de la famille et par suite grouper filles et garçons », est un argument encore cher aujourd’hui aux partisans de la coéducation. Il l’appliqua à Stanz et en partie aussi à Berthoud ; à Yverdon, nous voyons filles et garçons des deux écoles différentes fraterniser, le soir, durant leurs loisirs. Son influence fut grande surtout dans les pays anglo-saxons.
J.-P. Richter s’attacha aux avantages moraux de la coéducation et écrivit ces mots restés célèbres : « Pour garantir les mœurs, je conseillerai la coéducation des sexes. Deux garçons suffisent à préserver douze jeunes filles ; deux jeunes filles, douze garçons. Mais je ne garantis rien dans les écoles où les jeunes filles sont élevées à part, encore moins dans une école où il n’y a que des garçons ». Enfin vers 1840, Horace Mann inaugura le régime de la coéducation dans les écoles américaines ». Hil. Deman, La Coéducation des sexes. Pour l’Ère Nouvelle, avril 1922.
* * *
L’Église catholique s’est toujours opposé à la coéducation.
La religion catholique qui a inventé l’histoire du péché originel, qui considère la femme comme un être inférieur, ― « os surnuméraire », disait dédaigneusement Bossuet, ― qui a ordonné le célibat des prêtres et condamné l’« œuvre de chair », ne pouvait qu’être favorable à une rigoureuse séparation des sexes.
Aussi ne faut-il pas s’étonner de voir toute la réaction en lutte contre toutes les entreprises coéducatives.
L’une des plus attaquées en France fut celle de Robin à Cempuis. Elle dura de 1880 à 1894. Mlle Félicie Numietska rappelle la lutte qu’elle eut à subir, dans un numéro spécial de l’Œuvre de décembre 1905.
La Patrie attacha le grelot en 1894 au nom de patriotisme ; Le Temps lança un mot qui fit fortune : « La Porcherie de Cempuis » ; La Libre Parole assura que « La pudeur naturelle à tous les animaux n’existe pas à Cempuis ».
« Les épithètes les plus amènes sont prodiguées aux orphelins, aux maîtres et par dessus le marché au système de la coéducation, « système contraire à tous les principes de la morale ». « Robin contamine les enfants du peuple en les initiant aux théories préconisées par Épicure et le marquis de Sade » ; cet ignoble polisson a converti l’orphelinat Prévost en maison de tolérance » ; « Tas de pourceaux » ; « L’aquarium de Cermpuis » ; « École municipale de Cythère » ; « Abominable fripouille dont la méthode soit-disant philosophique consiste à faire des expériences lubriques sur des petits innocents sans défense, sans appui, sans protection, etc... »
« N’est-on pas édifié par la vertueuse indignation de ces âmes pures ? Au fond, la morale est leur moindre souci. Ils sentent, et avec raison d’ailleurs, quel coup terrible le système de la coéducation, victorieux, porterait à la domination de l’Église ». F. Numietska : La Coéducation.
Une enquête fut ordonnée. « Enfin le 30 août 1894, le ministre de la Justice, M. Guérin, dont le fils fréquente l’école des frères, 44, rue de Grenelle-Saint-Germain » et M. Georges Leygues, qualifié en la circonstance comme ayant fait des études spéciales sur les dangers et... les charmes de la promiscuité, signent la révocation de Robin ». F. Numietska : La Coéducation.
À quelques années de là, la lutte des forces cléricales devait être plus violente encore contre Ferrer.
Il est vrai que ce fut à Barcelone, dans la catholique Espagne, qu’en mai 1901 Francisco Ferrer ouvrit « L’École Moderne » avec douze fillettes et dix-huit garçons. « L’École Moderne » grandit ; cinquante écoles analogues furent créés en cinq ans.
L’attentat de Morral contre Alphonse XIII fut le prétexte de la fermeture de ces écoles et de l’emprisonnement de Ferrer. Après treize mois de prison préventive, et à la suite de vives protestations qui se firent entendre par toute l’Europe, Ferrer, innocent, fut remis en liberté ; mais, à la suite de l’insurrection de Barcelone, à laquelle il n’avait cependant pris nulle part, il fut fusillé le 13 octobre 1909 à Monjuich. La réaction ne désarme et ne pardonne jamais.
* * *
Malgré l’opposition réactionnaire, et surtout sous l’influence des nécessités économiques, la coéducation a fait de sérieux progrès.
Aux États-Unis, elle est appliquée dans tout l’enseignement primaire avec un personnel féminin de 89 p. 100, à 95 p. 100 et des écoles moyennes officielles avec un personnel féminin de 73 p. 100. Certains pédagogues se plaignent des résultats obtenus dans ces écoles ; mais, selon d’autres pédagogues, la faute en serait à la trop faible proportion du personnel masculin et au fait que garçons et filles sont astreints à suivre un programme identique et trop encyclopédique.
La coéducation est également généralisée dans les pays du Nord : Norvège, Suède, Danemark, Écosse, mais le nombre des écoles mixtes diminuerait en Suède où l’on aurait constaté que les jeunes filles se surmènent. Ici encore la faute en serait à l’encyclopédisme et à l’uniformité des programmes.
En Russie, où les étudiants fraternisèrent toujours avec les étudiantes et où Tolstoï introduisit la coéducation intégrale dans son école de Jasnaïa Poliana, la coéducation est devenue obligatoire malgré quelques difficultés de début.
En Hollande et en Finlande, la coéducation est à peu près générale.
En Angleterre, en Allemagne et en Suisse l’enseignement primaire officiel est mixte à un pourcentage élevé, les jeunes filles peuvent accéder dans les écoles secondaires de garçons et à l’Université.
En Belgique, en France et en Australie, il y a un nombre de plus en plus élevé d’écoles mixtes.
En Italie, les écoles primaires rurales sont mixtes depuis 1911 et 90 pour cent des écoles secondaires sont ouvertes aux filles.
En Espagne, à Madrid, une école secondaire mixte est très florissante, les lycées de Madrid comptent 25 pour cent de jeunes filles.
* * *
La coéducation progresse, elle est soutenue par les partis avancés et les groupements féministes. La « Ligue Internationale pour l’éducation nouvelle » en a fait un de ses principes de ralliement.
Cependant elle a toujours des adversaires : réactionnaires de toutes sortes et aussi, qui l’eût cru, parfois des éducatrices.
Déjà en 1905 F. Numietska écrivait : « Une directrice d’école primaire, adressant un rapport officiel au Ministre de l’Instruction publique sur les Écoles d’Amérique, émet cette crainte que le garçon, répondant parfois moins bien en classe que telle ou telle fillette, ne se trouve devant elle en mauvaise posture, et que la future autorité du mari ne s’en trouve compromise ».
Mlle Loizillon qui présentait ce rapport a encore aujourd’hui des émules et c’est ainsi que Mlle Petitcol, sous-directrice, pour les jeunes filles, du collège mixte de Sarrebruck, soutient dans sa Revue Universitaire de décembre 1925, que l’institution des classes mixtes dans l’enseignement secondaire est regrettable, car, dit-elle, « les hommes sont faits pour agir, les femmes, pour subir. À voir les choses en gros, je dirai que, pour les uns, la « moelle », extraite à leur usage des belles œuvres, doit constituer une sorte de morale de l’action ; pour les secondes, une morale de soumission ».
Ainsi, pour Mlle Petitcol comme pour Mlle LoizilIon, le régime de la coéducation est mauvais, parce qu’il favorise l’émancipation de la femme.
* * *
Avant de prendre parti pour ou contre la coéducation et, le cas échéant, pour ou contre certaines formes du régime coéducatif, il est indispensable que nous précisions notre idéal éducatif :
« Nous voulons éduquer l’enfant pour qu’il puisse accomplir la destinée qu’il jugera la meilleure de telle façon qu’en toute occasion il puisse juger librement de la conduite à choisir et avoir une volonté assez forte pour conformer son action à ce jugement. »
Ceci veut dire que nous sommes respectueux de la personnalité de chaque enfant ; que nous nous refusons à préparer des croyants d’une religion, des citoyens d’un État et des doctrinaires d’un parti. Il en résulte évidemment que notre idéal n’est pas de modeler des enfants selon l’idée que nous nous faisons d’un enfant modèle, mais d’aider à l’épanouissement de chaque individualité enfantine en tenant compte de ses intérêts et de ses capacités.
Nous sommes donc contre l’école qui sépare les sexes pour pouvoir préparer les jeunes filles à la soumission, mais nous sommes aussi, pour la même raison, contre tout régime scolaire, même coéducatif, qui ne tient compte ni des différences entre les sexes, ni des différences individuelles entre les enfants du même sexe.
* * *
L’école actuelle, avec ses programmes surchargés, avec ses méthodes collectives, est loin d’être cette « école sur mesure » que réclament certains pédagogues. Cependant, si des difficultés réelles ne permettent pas d’envisager une adaptation parfaite de l’école à chaque enfant, il serait possible, en réduisant les programmes à un minimum, d’y faire place à quatre sortes d’activité :
-
Le travail individuel standardisé ;
-
Le travail collectif organisé ; portant sur le programme minimum imposé à tous.
-
Le travail individuel libre ;
-
Le travail collectif libre : travail librement choisi et exécuté en coopération par des groupes d’élèves librement formés.
Une telle organisation de travail scolaire ne laisserait plus de place à certaines critiques fondées sur les différences qui existent entre les deux sexes. Si, d ailleurs ces différences sont indéniables et justifient l’opposition à un enseignement entièrement uniformisé, il ne faut pas oublier que les différences individuelles entre enfants du même sexe ne sont pas moindres et que logiquement les partisans de la séparation des sexes devraient défendre une séparation des enfants de chaque sexe en de nombreuses catégories.
L’organisation scolaire que nous venons de recommander permet d’économiser bon nombre de ces catégories. Elle ne sera cependant pleinement satisfaisante qu’à la condition d’y adjoindre une organisation scolaire spéciale pour les surnorrnaux et pour les anormaux, c’est-à-dire pour un petit nombre d’enfants, qui profiteraient mal de l’enseignement collectif donné aux élèves moyens et parfois pourraient être une gêne pour ceux-ci. Par suite nous pensons qu’il sera nécessaire de conserver quelques écoles unisexuelles pour certaines catégories d’anormaux auxquels la coéducation ne convient pas.
* * *
Ainsi sauf de très rares exceptions, tous les enfants devraient être soumis au régime coéducatif.
Nous avons indiqué sommairement comment le régime scolaire pourrait respecter l’individualité enfantine et par conséquent tenir compte des différences individuelles.
Il nous reste à fournir quelques détails complémentaires sur ce sujet en remettant cependant à une étude sur l’enseignement ce qui ne concerne que l’adaptation scolaire aux différences individuelles.
Il ne faut pas oublier pourtant que la coéducation est aussi bien une question familiale qu’une question scolaire.
Trop souvent, dans certaines familles, les garçons sont favorisés par un régime spécial : on fait plus de sacrifices pour leurs études, on tolère leurs escapades, tandis que de toute façon on prépare l’épouse soumise de demain.
Si quelqu’un s’étonne de voir le garçon courir et s’amuser alors que la fillette aide la maman aux soins du ménage, de voir interdire à la sœur les livres qu’on permet au frère, plus d’une mère même ne comprend pas que la vie de famille doit préparer l’égalité entre les deux sexes, qu’il est bon que la jeune fille s’amuse aussi, qu’il est juste que le garçon prenne sa part des travaux ménagers et que ceci s’explique d’autant mieux que la femme d’aujourd’hui travaillant souvent au dehors comme son compagnon, devrait être plus largement aidée à la maison par ce dernier.
* * *
Félicie Numietska écrivait en 1905 : « Tout le monde admet, ne fût-ce qu’en théorie, que le garçon doit être vigoureux : il lui faut une poitrine large et des poings robustes. Chez la fille, au contraire, par une séculaire aberration, on s’applique à cultiver la gracilité, on lui inculque un idéal de beauté artificielle et « distinguée », les pâles couleurs de la chlorose, un air penché, une taille de guêpe. Si ces folies n’étaient contraires qu’à l’esthétique, il faudrait déjà les dénoncer, mais le mal est plus grand. Au risque d’être accusée de paradoxe, j’oserai soutenir que la femme, tout comme l’homme, a besoin de force et de santé. N’en faut-il pas pour subir l’épreuve de la maternité ? ».
Heureusement on discute moins aujourd’hui sur la nécessité de l’éducation physique de la femme, mais les adversaires de la coéducation y trouvent une raison nouvelle en faveur de la séparation des sexes.
Or il faut remarquer que la gymnastique d’aujourd’hui n’est plus athlétique comme autrefois et que la plupart des exercices d’assouplissement, de développement, et d’endurance conviennent également aux deux sexes. Il ne faut pas oublier non plus qu’il est des fillettes qui, à un âge égal, sont plus fortes, plus souples que Ides garçons du même âge et qu’en éducation physique comme en éducation intellectuelle, nous voulons nous rapprocher autant que possible de l’idéal de l’enseignement sur mesure.
Quelquefois on invoque contre la coéducation la violence que les garçons mettent parfois en leurs jeux, mais cette violence se constate bien moins souvent chez les garçons qui ont toujours été soumis au régime de la coéducation. On ne songe pas non plus aux tout-petits. La plupart de ceux-ci, jusque vers sept ans, et parfois plus tard encore, préfèrent jouer avec les fillettes et plus d’une fois nous avons vu des fillettes de douze ou treize ans se faire leurs protectrices, ce qui ne pouvait nous déplaire.
Dans-une des plus fameuses écoles coéducatives d’Angleterre, à Bédales, de peur de surmenage, on s’efforce d’éviter toute compétition directe entre les deux sexes dans les jeux et la gymnastique. C’est, croyons nous, une mesure un peu trop radicale et qui ne tient pas compte des avantages que la pratique commune des sports présente d’un autre côté. Un auteur anonyme écrit :
« Aussi la combativité que la femme acquiert dans la pratique des sports lui servira à faire accepter par son mari des droits que celui-ci pourrait être amené à lui contester. Et cette combativité, si elle se manifeste dans les préliminaires du mariage, convaincra le candidat de la valeur morale de celle dont il veut faire sa compagne. Cette épreuve sera décisive. S’il ne souhaite que l’épouse asservie des temps révolus, il ira chercher fortune ailleurs ; si au contraire il admet cette alliance loyale où aucun des alliés n’a le pas sur l’autre, il sera heureux d’avoir trouvé l’associée digne de lui.
Certains sports, en facilitant ainsi la fréquentation des jeunes filles et des jeunes gens, constituent un utile prélude à l’accord conjugal. Si le sport n’est encore qu’un prétexte pour les deux sexes à se rapprocher sans arrière-pensée, il contribue à ce que la jeune fille se familiarise avec l’élément masculin. Si l’on a vu autrefois tant de jeunes filles s’amouracher trop facilement d’un homme avec qui elles firent par la suite mauvais ménage, c’est que souvent cet homme était le premier qu’on leur ait permis d’approcher. Il représentait donc forcément l’homme en qui se cristallisaient aussitôt ses rêves cachés. Pour qu’une jeune fille puisse faire au contraire le libre choix de celui avec qui elle s’unira, il faut qu’elle ait la faculté de faire ce choix par comparaison. » (Les Cahiers anonymes : L’Accord conjugal).
* * *
L’un des griefs les plus souvent invoqués contre la coéducation est le danger où serait l’innocence des jeunes filles et celle des jeunes garçons. Aussi, certains qui admettent le régime coéducatif pour les petits le repoussent-ils pour les grands.
Des psychologues vous expliqueraient qu’au contraire, le rapprochement des sexes sublime l’instinct sexuel qui se trouve déformé par une séparation antinaturelle.
Les praticiens, mêmes hostiles à la coéducation, reconnaissent le peu de valeur des critiques adressées à la coéducation au nom de la morale. C’est ainsi que Mlle Petitcol écrit : « La morale, certes, n’est pas plus en danger qu’ailleurs dans une classe mixte... »
Marro, dans La Puberté chez l’homme et chez la femme, écrit :
« La trop longue séparation des jeunes gens des deux sexes dans des pensionnats spéciaux est au plus haut degré favorable au développement des tendances contre nature, et est nuisible au développement moral normal de l’un et l’autre sexe. Il est nécessaire que le caractère demeure dûment exposé à l’influence de tous les agents naturels qui concourent à sa formation et le plus puissant d’entre eux est certainement celui exercé par la présence des individus de sexe différent ».
Le pédagogue américain Stanley Hall, qui reproche à la coéducation de faire des abeilles ouvrières mais point de reines et lui est hostile à divers points de vue, affirme que la coéducation « favorise les idées saines du sexe, elle prévient d’une part les imaginations souterraines et basses, et, de l’autre une sentimentalité morbide ».
* * *
Si nous pensons que le régime coéducatif est plus favorable aux bonnes mœurs que le régime unisexuel, nous n’ignorons pas que le mal appliqué à la coéducation peut, à cet égard, présenter quelques dangers qu’il est assez aisé d’éviter :
-
La coéducation n’est pas un dogme et les quelques élèves anormaux auxquels elle ne convient pas doivent être élevés dans des écoles spéciales, ainsi que nous l’avons déjà fait observer.
-
Les enfants déformés par le régime unisexuel s’adaptent mal au régime coéducatif lorsqu’on leur impose ce régime aux approches de la puberté. Il est donc prudent de ne pas introduire dans les écoles coéducatives de grands élèves ayant fait un long séjour dans d’autres écoles.
-
Il faut tenir compte des instincts des enfants ou des jeunes gens soumis au régime coéducatif. Il est un âge où les garçons ne se préoccupent que des individus de leur sexe et pendant une certaine période, au moment de la crise de la puberté, les jeunes filles se détournent instinctivement des garçons. Il n’est point besoin cependant de revenir au régime unisexuel et de séparer les sexes. Le contact journalier ramènera plus tard un rapprochement que l’on compromettrait par cette séparation. Il serait d’ailleurs difficile de réaliser une organisation scolaire séparatiste pour cette seule période de crise qui est loin de commencer à un âge précis et dont la durée varie également suivant les individus. On compromettrait aussi le rapprochement futur si, pendant cette période, on voulait l’imposer en ne laissant plus aux jeunes gens la liberté de se grouper autrement qu’auparavant pour leurs jeux et certains de leurs travaux collectifs.
Si nous défendons la coéducation, nous y mettons donc toujours ces deux conditions : le régime coéducatif sera individualisé autant que possible et il sera, autant que possible également, un régime de liberté.
* * *
Aux deux conditions, que nous venons de rappeler, la coéducation ne peut avoir que de bons résultats en ce qui concerne l’éducation intellectuelle et l’éducation manuelle.
Certes les aptitudes et les intérêts des jeunes filles diffèrent de celles des jeunes garçons, et nous aurons l’occasion d’en reparler plus tard, mais les différences individuelles entre enfants du même sexe sont plus importantes encore et l’individualisation de l’enseignement serait presque aussi nécessaire dans les écoles unisexuelles que dans les écoles coéducatives.
Les faits prouvent suffisamment la supériorité du régime coéducatif à cet égard pour nous éviter de longs développements.
En Angleterre, les élèves des écoles mixtes obtiennent de meilleurs résultats aux examens que ceux des écoles où les sexes sont séparés.
En Amérique, l’installation du régime coéducatif a amélioré la quantité du travail intellectuel.
En France, Mlle Petitcol, hostile, ainsi que nous l’avons vu, parce qu’elle veut des femmes soumises, reconnaît que :
« Les études, bien loin de souffrir, puisent dans son atmosphère un stimulant nouveau. »
* * *
Enfin, on ne manque pas de faire valoir que l’école, devant préparer à la vie, doit être différenciée comme l’est le travail des deux sexes.
Cet argument a quelque peu perdu de sa valeur depuis que de nombreuses carrières ― soi-disant masculines ― sont occupées par des femmes.
Si d’ailleurs les écoles doivent être différenciées pour préparer à des métiers différents, cette différenciation doit se faire d’après la spécialisation et non d’après le sexe.
On peut aussi songer à la différenciation du travail de l’homme et de la femme au foyer domestique. Incontestablement cette différenciation existe. Elle n’existe souvent que trop et généralement aux dépens de la femme. On oublie que, là surtout où la femme travaille à l’atelier, l’homme peut et doit l’aider aux travaux ménagers. Il faut également penser aux célibataires, aux veufs et aux veuves, aux maladies, enfin à tous les cas où il est bon que l’homme soit capable de faire des travaux féminins et à ceux où la femme doit pouvoir exécuter une besogne d’homme.
Rien n’empêche cependant, que pour certaines études, plus utiles généralement à un sexe, on sépare exceptionnellement les sexes. Si par exemple on donne des leçons de puériculture aux jeunes filles seulement, cela ne mettra pas la coéducation en péril et n’ôtera pas toute valeur au rapprochement habituel des sexes.
La coéducation n’est pas un dogme et le rapprochement des sexes ne doit pas être une nouvelle tyrannie.
En éducation, ce qui importe le plus, c’est de favoriser le libre épanouissement des individualités et la coéducation bien comprise ne peut que contribuer à l’obtention de ce résultat.
― E. DELAUNAY.
COERCITION
n. f.
La coercition est la contrainte physique, matérielle, brutale, qui s’exerce contre les individus pour les obliger à accomplir un acte ou un geste qu’ils réprouvent. On confond assez fréquemment coercition avec répression et, cependant, ces deux mots ont une signification tout à fait différente. La répression sévit en vertu des lois et pour réprimer un crime ou un délit qui a déjà été commis, alors que la coercition n’est pas forcément répressive. Elle est toujours oppressive. Le juge d’instruction use de la coercition pour s’instruire sur un délit dont un individu est supposé s’être rendu coupable. Le policier n’use pas mais il abuse de la coercition et, malgré le silence complice de toute la presse, de toute la magistrature, c’est le secret de polichinelle que la police judiciaire, en France, emploie des procédés de coercition monstrueux, pour arracher des aveux aux malheureux qui tombent entre ses griffes. La bourgeoisie peut s’enorgueillir de tout son appareil judiciaire. Il rappelle les plus beaux jours de l’Inquisition. Mais tout cela, ce ne sont que des effets ; ce sont les causes qu’il faut détruire pour voir disparaître et la répression et la coercition.
COHABITATION
n. f.
Qu’au point de vue individualiste la cohabitation soit un non-sens, quel individualiste anarchiste le nierait sérieusement ? Que ce soit sous le rapport du renouvellement de l’émotion amoureuse, sous celui de la recherche de l’expérience effective pour l’expérience elle-même, sous le rapport, enfin, de la variété dans les sensations voluptueuses, la cohabitation implique toujours rétrécissement du champ des possibilités et des réalisations en matière amoureuse, appauvrissement de l’initiative sentimentale. Et non seulement cela : les cohabitants ― les observations le démontrent ― finissent par se co-pénétrer à un point tel de leurs manières de voir et de sentir, qu’ils finissent pas s’imiter, même en ce qui concerne les tics et les marottes !
La cohabitation ne saurait donc jamais être, au point de vue individualiste, qu’un pis-aller, un pis-aller que subissent certains tempéraments auxquels répugne la vie solitaire, ou qui ne peuvent donner toute leur mesure que dans cette situation (et ils sont plus nombreux qu’on se l’imaginerait tout d’abord) ― ou encore que peut justifier le plan défectueux sur lequel évolue la société contemporaine.
La tendance individualiste anarchiste est au « chacun chez soi » et c’est celle qui, logiquement, prédominera dans tout milieu individualiste digne de ce nom.
Envisagée donc actuellement comme pis-aller, prolongée ou de durée restreinte, la cohabitation à deux ou à plusieurs ― dans ce dernier cas, le péril de la fusion est moins grave ― se résume en une association d’un type très étroit dont les participants s’efforcent de donner à leurs facultés affectives et sentimentales, en vue de leur bonheur amoureux individuel, le maximum de rendement possible. Si cette union implique la mise en commun des joies et des jouissances mutuelles, elle entraîne également le partage des douleurs et des souffrances. Quoi qu’on fasse ou dise, la cohabitation n’est possible qu’au prix de concessions, elle appelle une volonté réciproque de compréhension et de pénétration intellectuelle, elle sous-entend un effort d’ordre éthique. La conformité des caractères ou des concessions n’est pas toujours de rigueur pour la réussite de l’entente. Les faits montrent qu’en maints cas, les expériences de cohabitation réussissent d’autant mieux que ceux qui y participent se complètent et se contrebalancent, beaucoup plus qu’ils ne s’amalgament. L’appréciation du caractère et des attributs de ceux dans la compagnie desquels on vit, l’exercice des qualités du sentiment jouent un rôle puissant dans le bon résultat des expériences de cohabitation.
Mais les anarchistes dénoncent vigoureusement ce fait trop fréquent : que, lorsqu’ils cohabitent, extra-légalement ou avec la permission de la loi, la femme ou l’homme, désormais considérés comme étant « en puissance » de leur conjoint respectif, voient s’écarter les amants et les amantes. À examiner la question de près, de quel aspect de l’anarchisme, de quelle tendance anarchiste peuvent bien se réclamer ceux ou celles qui, abusant de l’affection ou de la passion qu’ils peuvent momentanément inspirer à qui cohabitent avec eux, s’abstiennent ou négligent de leur faire connaître que « cohabitation » ne signifie, en aucun cas, « dépendance sexuelle » ― qu’en aucun sens non plus, au cas de cohabitation à deux, la fidélité sexuelle de l’un des constituants du couple n’entraîne forcément la fidélité de l’autre ?
Profiter qu’on vit en commun avec un ou plusieurs hommes, une ou plusieurs femmes, qu’on s’est créé « une famille » pour empêcher son ou ses cohabitants de faire l’amour hors du nid ― présenter la cohabitation comme une entrave à la liberté sexuelle des cohabitants ou de l’une ou l’un d’entre eux est indéfendable et illogique, individuellement parlant. Tout au contraire, c’est de celle, de celui, de ceux qui ont concédé au pis-aller de la cohabitation qu’il y a lieu d’attendre la pratique d’une « liberté sexuelle » ou d’une « camaraderie amoureuse » dont la sincérité et l’intensité compensent leur « faiblesse ».
― E. ARMAND.
COHÉRENCE
n. f.
Au sens propre, ce mot est synonyme de « adhérent ». Il signale l’état de connexion entre une chose et une autre et se dit des parties qui sont liées entre elles. « La cohérence des molécules. » Au sens figuré, le terme « cohérence » a à peu près la même signification et s’emploie particulièrement pour désigner les rapports qui existent entre une idée et une autre. Un discours cohérent est un discours dont toutes les démonstrations se déroulent d’une façon méthodique et logique et dont les arguments s’enchaînent les uns aux autres. Dans la discussion et le raisonnement, la « cohérence » est d’une utilité primordiale. Sans elle, aucun exposé démonstratif ne peut être poursuivi, et nous assistons souvent, dans les assemblées populaires, à la déviation d’un débat par le manque d’enchaînement des idées qui y sont développées. La cause réside dans l’absence de cohérence dans les idées et les arguments. La cohérence détermine la lumière et économise un temps précieux. Il faut donc être cohérent, si l’on veut arriver rapidement au but que l’on se propose d’atteindre.
COHORTE
n. f.
À l’origine, corps d’infanterie composé de quelques centaines d’hommes, formant la dixième partie d’une légion et dont l’organisation est attribuée au général Marius, 150 ans environ avant l’ère chrétienne. Il y avait également à Rome des cohortes urbaines dont le rôle consistait à assurer la sécurité de la ville. Le terme est assez peu employé à présent, sinon pour désigner une troupe de combattants ou de gens quelconques, mais il présente toujours un caractère agressif et guerrier. « De vaillantes cohortes. »
« Il voit des saints guerriers, une vaillante cohorte. » (Boileau)
COLLABORATION
n. f.
Action de travailler en commun ou de prêter son concours à une œuvre quelconque. Se dit surtout pour désigner l’association en vue d’une production intellectuelle. Une pièce de théâtre, une encyclopédie, un roman, peuvent être le produit d’une collaboration de gens de lettres ou de science. Les recherches scientifiques ont besoin de la collaboration de tous les savants. La collaboration abrège et simplifie la besogne à condition d’être cohérente. On la met en pratique en toutes occasions et, si chaque collaborateur à un ouvrage déterminé, possède à fond la matière qu’il a à charge de traiter, s’il travaille consciencieusement et sincèrement à l’œuvre entreprise, celle-ci sortira enrichie des capacités et des connaissances collectives. Malheureusement, en littérature, et en tout ce qui touche à l’art et qui se monnaye, la collaboration est devenue une source de revenus pour certains individus sans scrupules. Les collaborateurs de certains écrivains ― on les appelle des nègres ― fournissent la plus grosse part de l’effort intellectuel en vue d’une production, et une fois l’œuvre terminée, seul bénéficie de tous les avantages et récolte tous les profits celui qui, par sa célébrité, est appelé à la signer. Ce n’est plus de la collaboration, c’est de l’exploitation.
Pour tout ce qui a trait à la participation à quelque ouvrage d’ordre matériel : l’association en vue d’une exploitation industrielle, agricole ou commerciale, on se sert plus couramment du terme coopération.
Il faudra la « collaboration » de tous les travailleurs manuels et intellectuels pour ébranler le vieux monde et élaborer un nouvel édifice social libre et indépendant, où la « collaboration » intéressée aura disparu. L’encyclopédie Anarchiste est une œuvre entreprise en collaboration.
COLLABORATIONNISME
n. m.
Action de collaboration intermittente ou permanente pratiquée par un individu ou groupement à caractère politique ou économique avec un autre groupement de même nature on de caractère différent, avec un gouvernement, pour atteindre certains buts sociaux ou réaliser certaines améliorations immédiate ou rapprochées.
De nos jours, le collaborationnisme ou action de collaboration est pratiquée, sur le plan politique ou économique par les Syndicalistes et les socialistes réformistes qui se sont écartés de la doctrine du syndicalisme et du socialisme révolutionnaires, pour “aménager” la société présente au sein de laquelle ils prétendent faire entrer, par la réforme, le syndicalisme et le socialisme. Cette tendance, œuvre en accord avec les capitalistes démocrates. Il y a également une autre tendance du collaborationnisme : celle qui travaille en accord avec le capitalisme conservateur et qui est composée par les Unions chrétiennes, les Ligues civiques, les Unions Nationales des Travailleurs qui s’opposent et à la lutte de classe révolutionnaire et à la collaboration des travailleurs avec les démocrates.
Des deux tendances, la première est infiniment plus redoutable, plus dangereuse. En effet, si la seconde représente bien l’ennemi, le capitalisme outrancier, conservateur et rétrograde, ce qui suffit à éloigner d’une telle action les travailleurs un peu éclairés, il n’en est pas de même de la première.
C’est encore volontiers que les ouvriers croient à la vertu des réformes, aux promesses des démocrates. Malgré toutes les trahisons passées, malgré la multiplicité des promesses jamais réalisées, les reniements innombrables, les abandons retentissants de leaders syndicaux ou socialistes passant chaque jour dans le camp bourgeois, s’installant au pouvoir, devenant, par la suite, des gouvernants pis que les autres, la classe ouvrière ne s’est pas encore, et il s’en faut, détachée de cette idée de collaboration avec la bourgeoisie.
Il y a pourtant près de vingt ans, en 1906, à Amiens, que la classe ouvrière, dans un Congrès retentissant, a affirmé sa maturité sociale et prononcé son divorce idéologique, politique et économique avec la bourgeoisie, conservatrice ou démocratique, et toutes les institutions capitalistes. En même temps que le Congrès d’Amiens, qui eut une énorme répercussion dans le monde ouvrier international, prenait cette position de principe, il proclamait que les conquêtes ouvrières et la transformation axiale ne pouvaient être l’œuvre que de l’action directe des ouvriers et que l’ordre nouveau devrait reposer exclusivement sur les producteurs groupés ou associés dans leurs syndicats devenus les organes de production et de répartition, base de la réorganisation sociale.
On aurait pu croire qu’après ces affirmations solennelles, le réformisme, le collaborationnisme étaient morts.
Il n’en fut rien. Bien au contraire, la tendance réformiste gagna sans cesse du terrain et, aux abords de la guerre, tous les mouvements syndicaux européens et américains étaient gagnés, dans leur majorité, à cette tendance dont l’action politico-syndicale s’affirmait chaque jour dans le sens réformiste.
Depuis 1914, ce ne fut, partout, dans toutes les organisations centrales, qu’une longue suite de négociations, de contacts, d’actes qui engageaient sans cesse plus profondément les états-majors syndicaux et socialistes dans la collaboration avec les dirigeants démocrates, et quelquefois même, conservateurs d’un pays.
L’échec des grandes grèves qui suivirent la guerre, celui de la révolution allemande n’eurent pas d’autre cause.
Toute cette action sera, d’ailleurs, examinée avec toute la précision nécessaire lorsque nous dresserons, ici, l’étude du syndicalisme et du socialisme.
On peut, néanmoins, dire que les conférences de Leeds, de Londres pendant la guerre, celle de Washington, après le traité de Versailles, la participation au Bureau International du Travail, à la Société des Nations ont imprimé au collaborationnisme un caractère tel que, le désireraient-ils, ceux qui se sont laisses prendre à ce mirage en s’engageant dans une voie aussi dangereuse qu’illusoire et désillusionnante en fin de compte, ne peuvent plus revenir en arrière. Ils ont tourné le dos pour toujours à la lutte de classe, à l’action directe, à la révolution.
Détachés du prolétariat, qu’ils trompent encore pour un temps, ils sont, en fait, et souvent inconsciemment, les agents de la bourgeoisie, à laquelle ils s’incorporent lentement mais sûrement.
La participation des leaders ouvriers à toutes les commissions d’études, de réorganisation sociale sur les bases démocratiques, l’accès sans cesse plus grand dans les Conseils techniques nationaux, le rôle que les gouvernements leur confient dans les assemblées délibérantes ou pacifistes nationales ou internationales, interdisent, désormais, à ces hommes de penser à autre chose qu’à “aménager” la société présente.
De bonne foi, certains d’entre eux croient la chose possible. Ils se trompent grossièrement. Il ne peut y avoir ni socialisme, ni syndicalisme véritables dans le cadre de la société bourgeoise.
Les conquêtes apparentes faites dans cette voie ne sont que des compromis intervenant entre le socialisme et le syndicalisme défaillants et le capitalisme faible.
Dès que ce dernier aura repris sa force par l’afflux de sang nouveau que lui aura infusé la partie de la classe ouvrière qui acceptera de partager son destin, il retrouvera son arrogance et pratiquera la lutte de classe avec sa férocité du passé.
Le collaborationnisme ne peut servir qu’à détourner la classe ouvrière de sa mission naturelle en lui faisant miroiter de prétendues améliorations qui sont le fruit de ses capitulations et risquent de rendre impossible l’œuvre de libération humaine.
C’est la plus dangereuse illusion dont le prolétariat fut jamais victime.
Qu’il s’en détourne comme de la peste ; qu’il rejette loin de lui les suggestions des sirènes qui veulent capter sa confiance et l’enchaîner au char doré de son ennemi.
Quelques hommes peuvent y trouver : situation, honneurs, fortune, considération et satisfactions personnelles ; l’immense majorité, la presque totalité des ouvriers, n’y trouveront que : mensonges, misères, duperies, dégoûts, rancœurs et regrets de leur clairvoyance, de leur action de classe passées.
Ici, nous prononçons contre le collaborationnisme des classes, la condamnation la plus formelle et la plus définitive.
Nous disons aux travailleurs :
« N’attendez rien que de vous-mêmes, et moins du capitalisme démocratique que de quiconque. Ne comptez que sur vos efforts, n’attendez rien des interventions compromettantes de vos leaders réformistes avec les gouvernements, de leurs tractations louches avec le grand patronat.
» Rompez brutalement avec ces errements qui veulent que votre ennemi devienne l’artisan de votre salut et interdisez à vos militants de s’engager dans le pourrissoir patronal et gouvernemental où on leur promet — et leur donne — sinécures et prébendes, qui les éloignent de vous, de vos misères et de vos douleurs qu’ils ne comprennent plus, qu’ils n’entendent plus. »
Pierre Besnard
COLLECTIF (Le)
Grammaticalement, « le collectif » (nom collectif) se dit d’un mot qui, bien qu’au singulier, désigne un groupe ou un assemblage de personnes ou de choses. (Une nation, une armée, un nombre.) Dans le domaine économique et social, il a une toute autre signification.
Si, en biologie, on considère que la vie se présente comme une lutte constante entre deux facteurs, dont l’un est l’être vivant et l’autre le milieu ambiant et l’hérédité ; en sociologie, on peut admettre également, que la vie des sociétés se présente comme une lutte constante entre deux facteurs, dont l’un est le collectif et l’autre le particulier. Philosophiquement et scientifiquement, le « collectif » a, depuis longtemps, triomphé du « particulier » et il semblerait puéril de soutenir une thèse cherchant à démontrer que le concours de tous n’est pas nécessaire pour la vie harmonique des sociétés. Même dans la vie pratique de nos temps modernes, on a été contraint de donner certaines satisfactions, plus apparentes que réelles, il est vrai, mais qui marquent, néanmoins, une victoire, au collectif, et l’application de lois constitutionnelles, la prépondérance de l’esprit démocratique, même dans les puissances à régime monarchique, est une conquête du collectif sur le particulier.
Pour ceux qui ont, sociologiquement, « une croyance finaliste ». c’est-à-dire qui conçoivent un but à atteindre et luttent pour s’en approcher ― c’est le cas pour les anarchistes ― le collectif ne se manifestera que lorsque sera complètement vaincu « le particulier ». (Nous ne donnons pas, ici, au mot « particulier », un sens péjoratif et ne l’employons pas dans le sens commun. Il représente, comme nous le disons plus haut, un des facteurs de la vie des sociétés modernes. Nous n’en faisons donc pas le synonyme « d’individu », mais il signale à notre esprit l’élément qui s’oppose à la réalisation, dans le domaine économique et social, du bonheur de la grande majorité des individus.)
Il a suffisamment été démontré que toutes les richesse sociales, que tous les moyens de production sont détenus par une faible minorité qui tient courbé sous son joug tout le restant de la population mondiale, pour que nous n’ayons pas besoin d’insister ; or, du point de vue Anarchiste, l’on ne peut considérer que comme arbitraire cet ordre social et nous estimons que tout doit appartenir à tous, c’est-à-dire au « collectif ».
Il peut sembler paradoxal, que malgré le développement des idées, et des démonstrations philosophiques et scientifiques qui concluent nettement en déclarant que l’ordre social continuera à être troublé tant que l’ensemble des individus ne sera pas assuré de sa vie matérielle, on en soit encore au règne du Capital et de la ploutocratie et que les intérêts collectifs soient sacrifiés aux intérêts particuliers. Les raisons en sont pourtant bien simples. Les diverses écoles sociologiques ont toujours cherché à libérer le peuple politiquement sans vouloir comprendre que la liberté politique était subordonnée à la liberté économique et que jamais la collectivité ne sera libre tant qu’elle ne se sera pas rendu maîtresse d’elle-même en livrant à tous les moyens de production détenus par le particulier.
De là découlent toutes les erreurs, et si la démocratie qui prétend être le régime politique qui favorise les intérêts de la masse, bénéficie d’un si large crédit, c’est que la masse elle-même s’est laissée prendre à cette Illusion de la liberté politique.
D’autre part, l’individu est assez lent à assimiler les idées nouvelles. Il est attaché par l’hérédité et par l’ambiance aux vieux préjugés, et l’amour du calme et cle la tranquillité l’éloigne de tous les mouvements révolutionnaires qui permettraient à la collectivité de conquérir son indépendance. II faut, pour qu’une idée produise ses effets, qu’elle pénètre dans la grande majorité des masses. Une fois les masses convaincues, l’idée se matérialise ; sinon, elle est accaparée par ceux qui la déforment et n’en retirent que ce qui peut servir leurs propres intérêts.
Cependant, « le Collectif » gagne chaque jour du terrain. Si nous disons que le régime monarchique constitutionnel est un progrès sur le monarchisme absolue, et que la démocratie est un progrès sur le monarchisme constitutionnel, ce n’est pas par opportunisme, ni pour soutenir l’un ou l’autre de ces régimes. Les Anarchistes sont convaincus de la novicité de toute organisation sociale d’inspiration politique, et par conséquent d’essence autoritaire ; mais ils sont obligés de reconnaître que, au point de vue moral et intellectuel, l’esprit démocratique est une victoire partielle du collectif sur le particulier. La démocratie n’est que le « purgatoire » offert sur la terre aux masses populaires par les politiciens. Il faut donc, pour établir un ordre social stable et qui donne satisfaction non pas à une majorité mais à tous les individus, la victoire totale du collectif sur le particulier. Et cette victoire ne doit pas être politique, mais économique. Politiquement, la victoire de la collectivité ne peut être qu’un mirage, une illusion et ne peut que perpétuer l’asservissement de l’individu.
Certains anarchistes individualistes s’effraient de la victoire du collectif et sont adversaires du Communisme anarchiste. Nous ne pensons pas qu’il y ait là un danger pour l’individu ; car si, sur le terrain de la production du travail matériel, il est indispensable en vertu même des lois du progrès, de la science et de la nature, d’unir les efforts de tous pour amoindrir les efforts de chacun, il sied de reconnaître que dans le domaine des idées, des choses de l’esprit, le collectif peut être une source de contrainte et il faut laisser à chaque individu sa liberté pleine et. entière, qui ne peut être subordonnée à la volonté d’un groupe ou d’une association quelconque.
― J. CHAZOFF.
COLLECTIVISME
n.m. (du latin collectus, réuni, rassemblé)
Dans la lutte contre la propriété, deux écoles sont en opposition. C’est : d’un côté, l’école du Communisme libertaire et de l’autre, l’école du collectivisme ou socialisme autoritaire.
Le collectivisme s’est, en France, depuis 1920, au Congrès socialiste de Tours, divisé en deux fractions : l’une d’elles prétend réaliser le collectivisme par les moyens pacifiques de la réforme et du parlementarisme, et l’autre composée de communistes bolchévistes et se réclamant de la Révolution russe, entend, en provoquant et profitant de la révolte des masses, s’emparer du pouvoir et instaurer la dictature du prolétariat pour matérialiser son programme. Nous ne nous occuperons pas ici des moyens employés par ces deux fractions qui veulent atteindre le même but en empruntant une route différente ; elles sont animées l’une et l’autre par le même esprit politique et économique. Ce qui nous intéresse : c’est de savoir si le collectivisme peut résoudre le problème social, s’il peut libérer du patronat les classes productrices, s’il peut abolir l’exploitation de l’homme par l’homme, et s’il peut assurer à chaque individu le maximum de bien-être et de liberté.
D’accord avec les anarchistes, les collectivistes reconnaissent que la propriété privée est une source de conflits, de misères, de tyrannie, de spoliation, d’injustices ; mais alors que les Anarchistes considèrent que l’ordre social ne pourra être réformé que par la mise en commun de tous les moyens de production, les collectivistes veulent substituer à la propriété privée la propriété d’État et déclarent que, pour se libérer du patronat et de l’exploitation, les classes laborieuses doivent s’emparer de toute la richesse sociale et la remettre à l’État tout puissant, émanation de la volonté et des aspirations collectives.
Nous ne nous arrêterons pas, pour présenter le collectivisme et en souligner les erreurs, au socialisme original de Saint-Simon, qui pensait que le monde pouvait être rénové par un gouvernement d’hommes probes et sincères, et qui mettait tout son espoir entre les mains de certains dirigeants honnêtes. « Les chefs des prêtres, les chefs des savants, les chefs des industriels, voilà tout le gouvernement » (Saint-Simon). Nous ne croyons pas utile non plus de signaler les essais négatifs de Fourier, avec ses phalanstères et de Owen en Écosse et en Amérique, avec ses coopératives ; le socialisme a évolué avec une telle rapidité ces dernières années, que nous avons des points d’appui beaucoup plus sérieux, et nous pouvons nous éclairer à des expériences concluantes.
Pour atteindre son but, le collectivisme veut transformer en son entier le régime capitaliste, mais il entend cependant maintenir deux institutions de l’ordre actuel : le gouvernement et le salariat.
Le gouvernement serait l’organe de centralisation et de monopolisation de toute la richesse sociale ; il serait le moteur de toute l’activité économique, morale et intellectuelle de la nation ; il serait le pilote entre les mains de qui on abandonne toute la direction de la barque sociale. Un mauvais coup de barre et la barque chavire. L’exemple du passé a suffisamment démontré que le mal ne réside pas spécifiquement dans la propriété privée qui n’est qu’un effet, mais dans l’autorité qui est une cause. En maintenant dans un régime social un gouvernement qui, par essence et par définition, ne peut être qu’autoritaire, le collectivisme retombe fatalement dans les mêmes erreurs politiques et sociales que le démocratisme.
Traçons de suite, pour plus de clarté et aussi brièvement que possible, les attributions d’un gouvernement collectiviste. De nos jours, le rôle d’un gouvernement consiste à défendre et à soutenir les intérêts des classes privilégiées qui détiennent le capital et toute la richesses sociale.
Dam une société collectiviste, les fonctions d’un gouvernement seraient beaucoup plus lourdes et ses pouvoirs plus étendus, puisqu’au nom de la collectivité — tout ayant été étatisé — il serait obligé :
-
D’assurer et de contrôler la production nécessaire à la vie de la nation ;
-
De régler la répartition des vivres et de tous objets indispensables, utiles ou agréables à la collectivité ;
-
De gérer toutes les grandes exploitations agricoles, industrielles ou commerciales ;
-
De s’occuper de tous les grands services publics : gaz, chemins de fer, postes et télégraphes, hôpitaux, hygiène, etc....
-
D’administrer les banques, les compagnies d’assurances, les spectacles, enfin tout ce qui a trait à la vie de la nation.
En un mot, rien de ce qui intéresse la vie de l’individu et de la collectivité ne devra lui être étranger, et, à condition de travailler pour obtenir un salaire rémunérateur (nous nous occuperons plus loin de cette question), l’individu n’aura plus qu’à se laisser vivre comme en un pays de cocagne. Le gouvernement s’occupera de tout, et l’homme ne sera plus qu’une machine munie d’un appareil digestif.
Avouons qu’il faut posséder une réelle dose de naïveté et d’inconscience pour croire à la réalisation d’un tel programme : mais ne nous laissons pas entraîner par une opposition d’ordre sentimental et examinons si sa réalisation est possible et si elle changera quelque chose à l’ordre social que nous subissons actuellement. Sébastien Faure dans sa « Douleur Universelle » nous dit que « l’idée de Gouvernement renferme de toute nécessité, les deux idées suivantes « Droit et Force ». En effet, on ne peut admettre logiquement qu’un gouvernement puisse accomplir la tâche qui lui est assignée si on ne lui assure pas les moyens de 1’exécuter. Empruntons encore cette démonstration à Sébastien Faure : « Il est impossible de concevoir un système gouvernemental quelconque, sans avoir instantanément l’idée d’une règle de conduite imposée à tous les êtres sur lesquels il étend son pouvoir ; et il n’est pas plus possible d’imaginer cette règle d’action — quelle qu’elle soit du reste : bonne ou mauvaise, juste ou inique, rationnelle ou fausse, indulgente ou sévère — sans songer concurremment à la nécessité de garantir, par tous les moyens possibles, l’observance de cette règle par tous ceux auxquels elle est appliquée. » (Sébastien Faure, (« La Douleur Universelle », p. 200). Et voilà le collectivisme dans l’ornière. Gouvernement veut dire lois ; et les lois ne peuvent se concevoir ainsi que le démontre si clairement Sébastien Faure, sans magistrature, sans répression, sans prisons, sans police, sans parlement, etc, etc .... et, malgré le collectivisme social et humanitaire, nous voici revenus aux douces manifestations des régimes capitalistes.
« Nécessité absolue, pour que règne l’ordre dans la Société » affirment les collectivistes.
« La propriété de l’État et la monopolisation soumises au contrôle du gouvernement est un avantage sur la propriété privée. L’autorité gouvernementale en société collectiviste ne s’exerce pas au profit d’une minorité de privilégiés, mais au bénéfice de tous. L’action d’un gouvernement socialiste est une source de bienfaits pour tous et il faut se résigner à l’accepter » ; Voilà ce que dit le collectivisme. Examinons cet argument. Quant aux avantages matériels, ils sont bien difficiles à apercevoir. Le monopole octroyé à l’État aboutit presque toujours au développement du favoritisme, de l’incompétence et de l’arrivisme, vertus qui fleurissent admirablement dans les administrations publiques. « Les responsabilités sont moindres. C’est le règne de l’anonymat. Chacun a son petit intérêt personnel, envisagé sous l’angle le plus immédiat et le plus étroit. Dans cette ruée d’égoïstes féroces, on oublie forcément toutes les considérations utiles à la collectivité et il en résulte de pitoyables conséquences. Nul n’ignore que le gâchis le plus regrettable s’étale dans les administrations gouvernementales, que l’on y gaspille, que l’on y tripote à qui mieux mieux. Sur le terrain de la concurrence, l’État ne peut même pas lutter avec l’industrie privée. Il est battu d’avance. Fabriquant lui-même un produit quelconque, il dépense davantage et fait moins bien que son voisin ». (André Lorulot, Les Théories Anarchistes, page 194.)
Ces lignes furent écrites bien avant la guerre de 1914 et bien avant la Révolution russe. Aujourd’hui que le monopole d’État s’exerce sur une grande échelle en Russie, nous avons pour confirmer nos critiques sur le collectivisme, l’expérience de ses essais d’application.
La « Gazette du Commerce », un journal officiel du gouvernement russe, faisait remarquer, dans son numéro du 20 mars 1923, qu’avant la guerre les prix de détail ne dépassaient les prix de fabrique que de 26,6 % en moyenne, alors qu’à l’heure actuelle, avant d’être livrées au public les marchandises passent par la centrale coopérative, l’union du gouvernement, l’union du district et l’union cantonale. Le résultat est le suivant : augmentation sur les prix d’origine de 52,3 %.
Les journaux communistes russes nous offrent d’autres exemples encore sur les résultats de la monopolisation. Le « Troud » du 21 mars 1926 écrivait :
« Le défaut capital des coopératives gouvernementales, c’est la cherté des marchandises et leur mauvaise qualité. Le savon, pour ne citer qu’un exemple,est vendu sur le marché 17 kopecks, tandis que les magasins coopératifs le vendent 22 kopecks. Au marché, on peut acheter tout ce dont on a besoin, et pour des prix modiques. Les coopératives n’ont qu’un choix très restreint de marchandises, de mauvaise qualité, et elles les vendent à des prix inabordables. Le beurre est salé, le saucisson congelé et les souliers tombent en morceau à la moindre épreuve. »
Une dernière citation empruntée également à un journal communiste russe, et nous serons définitivement fixés sur les réalisations de l’État industriel et de l’État commerçant :
« D’octobre 1925 à février 1926, la rentrée des impôts ordinaires s’est élevée à un milliard 393 millions de roubles. Sur cette somme 562 millions proviennent des chemins de fer et des postes et télégraphes. Si l’on songe que parmi les recettes ne provenant pas de l’impôt, on compte celles que donnent les biens domaniaux (les forêts), il est clair que l’Industrie d’État ne donne à peu près aucun revenu. » (Ekonomitcheskaia-Jizn, 26 mars 1926.)
C’est l’aveu de l’impuissance collectiviste et étatiste et il n’est pas nécessaire d’y ajouter une ligne.
Il serait facile de mettre cette impuissance sur le compte des individus incapables. Le problème est beaucoup plus complexe. L’échec de la monopolisation ne se rattache pas à une question d’hommes ou de compétences, mais bien à la doctrine qui sert de base à tout édifice collectiviste. Les Anarchistes ont raison ; un gouvernement, quel qu’ils soit, ne peut pas assumer la lourde charge de la vie économique d’une puissance, et l’esprit et la pratique du centralisme et de la centralisation produit des effets contraires à ceux que l’on attendait.
D’autre part, le collectivisme affirme que, le capitalisme ayant disparu d’une société socialiste, cette dernière réalisera l’égalité économique de tous les hommes. En société capitaliste, ce qui caractérise le bourgeois, ce n’est pas seulement qu’il détient toute la fortune et la richesse sociale, mais surtout le fait qu’il vit en parasite du travail d’autrui. Nous avons démontré plus haut que l’existence d’un gouvernement exige l’organisation d’un nombre d’institutions s’y rattachant et que tous les individus évoluant dans les cadres gouvernementaux sont autant de parasites qui consomment sans fournir de travail utile.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets il est logique de conclure que le parasitisme sera un des vices de la société collectiviste et que sur ce terrain il n’y aura rien de changé.
Examinons maintenant la situation que le collectivisme réserve aux travailleurs.
« À chacun selon ses œuvres » telle est la formule collectiviste à laquelle les Anarchistes opposent la suivante :
« De chacun selon ses forces et à chacun selon ses besoins ».
La formule collectiviste dans sa brièveté renferme tous les éléments de reconstruction de la société capitaliste, et ainsi que le déclare Kropotkine dans sa Conquête du Pain :
« Si la Révolution sociale avait le malheur de proclamer ce principe, ce serait enrayer le développement de l’humanité, ce serait abandonner, sans le résoudre, l’immense problème social que les siècles passés nous ont mis sur les bras. »
Et Kropotkine conclut :
« C’est par ce principe que le salariat a débuté, pour aboutir aux inégalités criantes, à toutes les abominations de la société actuelle, parce que du jour où l’on commença à évaluer, en monnaie, les services rendus — du jour où il fut dit que chacun n’aurait que ce qu’il réussirait à se faire payer pour ses œuvres — toute l’histoire de la société capitaliste (l’État aidant) était écrite d’avance ; elle est renfermée en germe dans ce principe : « Devons-nous donc revenir au point de départ et refaire à nouveau la même évolution ? » Nos théoriciens le veulent ; mais malheureusement c’est impossible : la Révolution, nous l’avons dit, sera communiste ; sinon, noyée dans le sang, elle devra être recommencée. » (P. Kropotkine, La « Conquête du Pain », page 226.)
Ce qui précède serait suffisant pour conclure que le collectivisme fait fausse route, et les collectivistes eux-mêmes sont obligés de reconnaître que le salariat présente de sérieux inconvénients. Car, quelle que soit la forme dont on veuille se servir pour rétribuer le travailleur, que son heure ou sa journée de travail soit représentée par un bon divisible ou par des pièces métalliques ; du fait que l’on prête à ce bon ou à ce métal une valeur d’achat, du moment où cette valeur peut être accumulée et servir au moyen d’échange, c’est la réapparition du capital et avec lui de l’exploitation et de la misère. Mais nos raisons à l’opposition au salariat collectiviste sont multiples. Non seulement les collectivistes admettent la rétribution des travailleurs, mais il classe ces derniers en catégories distinctes, ce qui complique encore sensiblement leur programme. Ils affirment la nécessité d’une échelle de salaires et créent de ce fait une aristocratie ouvrière. En vertu de quelle logique, de quelle loi naturelle ou scientifique, un médecin gagnerait-il plus qu’un mécanicien et un pianiste qu’un cordonnier ? Cela est un mystère auquel les collectivistes ne veulent pas nous initier. En vertu, probablement, de ce vieux préjugé qui prête à l’intellectuel une valeur supérieure à celle du manuel.
En 1871, lors de la Commune, les membres du Conseil touchaient une somme de quinze francs par jour, tandis que les fédérés, qui sur les barricades payaient de leur sang et souvent de leur vie la cause qu’ils défendaient, ne touchaient que trente sous. Les collectivistes veulent ratifier cette vieille inégalité, et nous ne croyons pas qu’il soit utile d’insister davantage pour démontrer que tout l’esprit révolutionnaire condamne une telle conception et une telle pratique d’organisation. Les hommes qui la soutiennent se font sincèrement ou non, consciemment ou inconsciemment, les fossoyeurs de l’égalité et de la fraternité.
Un argument qui a une certaine importance attire cependant notre attention. Les collectivistes consentent à nous accorder que le salaire est un mal ; mais c’est un mal nécessaire, assurent-ils. Sans lui, personne ne voudrait travailler. Il est un stimulant, une récompense, qui obligera chacun à apporter son effort au travail commun et à collaborer au bien-être de la collectivité. Examinons ce sérieux argument, et voyons jusqu’à quel point il mérite d’être retenu. Tout d’abord, soulignons que si cette objection au travail librement consenti vaut pour le collectivisme, il a une valeur semblable pour la bourgeoisie qui peut invoquer la paresse naturelle des travailleurs pour légitimer tous ses méfaits. Le Capital ne manque du reste pas, chaque fois que le prolétariat réclame une augmentation de salaires ou une diminution d’heures de travail, de déclarer que le travailleur ne saurait que faire de ces améliorations, sinon d’en profiter pour boire plus que ne le permet la bienséance. Mais ne nous arrêtons pas à cette ridicule excuse intéressée de la bourgeoisie et poursuivons l’examen des conséquences du salariat et de l’argument invoqué par les collectivistes en sa faveur. Supposons que « le travailleur » refuse de payer son tribut travail à la société collectiviste et qu’en mesure de représailles cette société, en lui fermant les magasins de consommation, refuse de le nourrir ; qu’adviendra-t-il ? Il ne reste plus à ce « réfractaire », pour s’assurer la pitance, d’autre alternative que d’avoir recours à des moyens illégaux, et en particulier : le vol. Nous poussons les choses à l’extrême, et supposons un individu foncièrement paresseux, afin de ne pas affaiblir la thèse soutenue par nos adversaires. Nous ne voulons même pas envisager le cas où un travailleur refuserait — à tort ou à raison — de se soumettre à la loi d’airain de l’État-Patron.
Le vol ? Ce sont tous les rouages des sociétés modernes qui revivent. Le vol ? C’est la loi, c’est la magistrature, c’est la police, c’est la prison, etc., etc, .. et, une fois de plus, il ne nous reste plus qu’à demander anxieusement : qu’y aura-t-il de changé ? En outre, il faudrait démontrer que toute cette organisation du travail qui exigerait l’enrôlement administratif de millions de fonctionnaires arrachés au labeur productif, n’exigerait pas une dépense plus élevée pour la collectivité que le soutien de quelques milliers « de paresseux » systématiquement décidés à ne rien produire. Et le paresseux n’est-il pas inventé simplement pour les besoins d’une mauvaise cause ? Je ne crois pas pouvoirs mieux faire pour réduire à néant l’argumentation collectiviste, que de citer à ce sujet notre vieux P. Kropotkine.
« Quant à la fainéantise de l’immense majorité des travailleurs, il n’y a que des économistes et des philanthropes pour discourir la-dessus. Parlez-en à un industriel intelligent, et il vous dira que si les travailleurs se mettaient seulement dans la tête d’être fainéants, il n’y aurait qu’à fermer les usines ; car aucune mesure de sévérité, aucun système d’espionnage n’y pourraient rien. »
« Ainsi quand on parle de fainéantise possible, il faut bien comprendre qu’il s’agit d’une minorité, d’une infime minorité dans la société. Et avant de légiférer contre cette minorité, ne serait-il pas urgent d’en connaître l’origine. »
« Très souvent le paresseux n’est qu’un homme auquel il répugne de faire, toute sa vie, la dix-huitième partie d’une épingle, ou la centième partie d’une montre, tandis qu’il se sent une exubérance d’énergie qu’il voudrait dépenser ailleurs. Souvent encore, c’est un révolté qui ne peut admettre l’idée que toute sa vie il restera cloué à son établi, travaillant pour procurer mille jouissances à son patron, tandis qu’il se sait beaucoup moins bête que lui et qu’il n’a d’autres torts que celui d’être né dans un taudis au lieu de venir au monde dans un château. »
« Enfin, bon nombre de « paresseux » ne connaissent pas le métier par lequel ils sont forcés de gagner leur vie. Au contraire, celui qui, dès sa jeunesse, a appris à bien toucher du piano, à bien manier le rabot, le ciseau, le pinceau ou la lime, de manière à sentir que ce qu’il fait est beau, n’abandonnera jamais le piano, le ciseau ou la lime. Il trouvera un plaisir dans son travail, qui ne le fatiguera pas, tant qu’il ne sera pas surmené. » Et après cette démonstration claire et précise, Kropotkine conclut : « Supprimez seulement les causes qui font le paresseux, et croyez qu’il ne restera guère d’individus haïssant réellement le travail, et surtout le travail volontaire, que besoin point ne sera d’un arsenal de lois pour statuer sur leur compte. »
Ainsi s’effondre, avant la lettre pourrait-on dire, le collectivisme. « Pour transformer la propriété privée et morcelée, objet du travail individuel, en propriété capitaliste, il a naturellement fallu plus de temps, d’efforts et de peines que n’en exigera la transformation en propriété sociale de la propriété capitaliste qui, de fait, repose déjà sur un mode de production collectif » déclare K. Marx dans son Capital. Cette affirmation est toute gratuite. En tous cas, on connaît les difficultés de la bataille sociale ; aucun travailleur n’ignore au prix de quels sacrifices il peut obtenir certains avantages dans la lutte quotidienne contre le patronat, et il importe peu de savoir le temps qui doit s’écouler pour arriver à détruire un régime qui a à son actif un tel bilan de crimes sociaux. Ce qui importe, c’est de ne pas travailler en vain ; c’est de ne pas livrer inutilement à une expérience vouée à un échec fatal tout l’avenir de la Révolution.
Avoir travaillé durant des siècles et des siècles à la libération de l’humanité, avoir combattu pendant des générations une forme de société pour voir apparaître sur ses ruines, une autre organisation sociale présentant les mêmes tares, et engendrant les mêmes erreurs, ce serait admettre que tout est un éternel recommencement, que le bonheur de l’humanité est une utopie.
Et pour terminer, empruntons une dernière fois cette conclusion « Au Salariat collectiviste » de P. Kropotkine :
« Il n’en sera pas ainsi. Car le jour où les vieilles institutions crouleront sous la hache des prolétaires, on entendra des voix qui crieront : « Le pain, le gîte et l’aisance pour tous ! »
Et ces voix seront écoutées, le peuple dira :
« Commençons à satisfaire la soif de vie, de gaîté, de liberté que nous n’avons jamais étanchées. Et quand nous aurons tous goûté à ce bonheur, nous nous mettrons à l’œuvre : démolition des derniers vestiges du régime bourgeois, de sa morale, puisée dans les livres de comptabilité, de sa philosophie de « droit et avoir », de ses institutions du tien et du mien. En démolissant, nous édifierons, comme disait Proudhon ; nous édifierons au nom du Communisme et de l’Anarchie. »
— J. CHAZOFF.
COLLISION
n. f.
Au sens propre : rencontre brutale de deux corps ; se dit également de la rencontre de deux navires ou de deux trains de fer. « Cette collision de chemin de fer a eu des conséquences tragiques ». Socialement et politiquement, c’est surtout au sens figuré que ce terme est employé. Il signifie un choc entre deux parties adverses. Les collisions sont inévitables dans les sociétés modernes, agitées par divers courants et diverses tendances. Lorsqu’une situation est devenue trop tendue, les collisions renaissent nécessairement et ne peuvent être évitées. Elles empruntent parfois un caractère sanglant, surtout dans la lutte de la liberté contre le despotisme. Les collisions entre la troupe au service du Capital et la classe ouvrière ont souvent jonché le terrain de cadavres, et il en sera ainsi tant que la liberté sera étranglée et qu’une portion de la collectivité sera soumise à l’exploitation d’une autre portion. Les collisions sont parfois la conséquence du fanatisme et de l’erreur, et nous assistons au sein même du prolétariat au spectacle navrant de certaines fractions se combattant au lieu de s’unir contre l’ennemi commun : le Capital.
Les collisions entre travailleurs naissent d’une conception erronée de certains d’entre eux, de la liberté et de la vie sociale. Ce n’est qu’au jour où aura totalement disparu l’autorité et que la société harmonique unira tous les hommes, que disparaîtront les Collisions.
COLLUSION
n. f.
Accord ou entente entre une ou plusieurs parties au préjudice d’un tiers.
La collusion est entrée dans les mœurs et elle s’exerce dans toutes les branches de l’activité humaine. Dans une Société où tout se commercialise, où tout s’achète et se vend, où le succès légitime toutes les bassesses, où l’intérêt d’une classe ou d’un individu est subordonné à une autre classe ou à un autre individu, la collusion ne peut être qu’une arme courante. Que ce soit, dans le commerce ou dans la politique, la collusion exerce ses ravages. En commerce, c’est l’entente secrète inavouée entre plusieurs groupes de commerçants, d’industriels et de mercantis pour écraser un concurrent dangereux ; en politique, c’est l’association de divers éléments adversaires en apparence, mais qui, derrière le rideau, s’entendent à merveille pour tromper les électeurs. Que de fois les Anarchistes n’ont-ils pas signalé la collusion manifeste de certains candidats aux élections municipales ou législatives ! Lorsqu’un des aspirants députés voit ses chances disparaître, il hésite rarement à vendre le nombre des voix qu’il a acquises, même lorsque le bénéficiaire est un adversaire. Toute la politique ne repose que sur la collusion et, cependant, le prolétariat, qui en est la première victime, se refuse à voir clair, et accorde encore une certaine confiance à tous les fantoches qui se rient de sa misère. Dans la magistrature, il n’en est pas autrement, et l’indépendance des magistrats n’est que superficielle. Durant la dernière guerre de 1914, la collusion entre la « Justice » et le gouvernement s’étalait en plein jour, et ce scandale était accepté avec passivité par la population ; et même en période de paix, nous pouvons nous rendre compte que la condamnation des militants révolutionnaires n’est que la conséquence non seulement d’une collusion effective entre les gouvernants et les magistrats, mais aussi d’une collusion occulte entre ces derniers et les classes privilégiées. Il n’y a aucune disposition particulière à prendre contre la collusion. Tout ce que nous pouvons faire : c’est de nous éclairer, de nous instruire, de rechercher les causes du mal et de mettre le fer rouge dans la plaie. Tant que les hommes seront paralysés par leur ignorance, tant qu’ils se refuseront à avoir des yeux pour voir, et des oreilles pour entendre, ils seront les victimes de la collusion et des charlatans qui s’en servent pour dominer le monde.
COLONIE — COLONISATION
n. f.
Si vous cherchez dans les livres des géographes et des économistes, la définition de ces deux mots, et surtout du mot « colonisation », vous y trouverez à peu près ceci : « On donne le nom de colonisation à une forme particulière de l’émigration, par suite de laquelle le pays où s’établissent les émigrants est approprié et fécondé par leur labeur, et voit, grâce à eux, toutes ses ressources se développer de la manière la plus complète. La colonisation résulte donc de mouvements d’hommes civilisés à divers degrés et de diverses manières dans des contrées différemment traitées. » D’où il résulte, toujours d’après les géographes et les économistes, que cet effort peut donner naissance à deux sortes de colonies :
-
Les colonies de peuplement ;
-
les colonies d’exploitation.
Les premières comprennent celles dont les conditions de climat et de nature permettent l’établissement à demeure des immigrants, leur acclimatement et la fondation d’une famille.
Les colonies d’exploitation, au contraire, sont celles où le climat interdit de s’y fixer sans esprit de retour aux immigrants, qui doivent se borner à exploiter, par le commerce, et encore temporairement, les produits du pays. Avec un peu plus de franchise, certains économistes appellent ces dernières colonies de « conquête ».
Telle est dans son essence même, et avec toute son hypocrisie la doctrine adoptée par les Sociétés capitalistes et bourgeoises, commentée dans les livres et enseignée officiellement dans les écoles.
Telle n’est pas la doctrine de celui qui, l’esprit et le cœur épris de justice et d’humanité, a pénétré lui même jusqu’aux réalités qui se cachent dans cette phraséologie livresque.
Par son importance et les développements qu’elle exige, cette question, qui est toute la question coloniale, ne saurait être traitée en un seul article. Considérée ici dans sa généralité, elle sera reprise pour être épuisée aux mots : Guerre (coloniale), Impérialisme (colonial), Sadisme (colonial).
Avec ces trois mots, sera faite à peu près intégralement l’histoire de la colonisation capitaliste et bourgeoise.
Il suffira de dire aujourd’hui que, d’une façon générale, cette histoire, c’est-à-dire l’effort colonial des peuples prétendus civilisés, est tout entière dominée par l’abominable conception des races supérieures et des races inférieures : les premiers ayant sur les seconds tous les droits que donne la Force.
C’est au nom de cette conception, remplaçant celles d’Humanité et de Justice que l’on continue, et que l’on continuera longtemps à exploiter la faiblesse à imposer comme unique loi aux pays colonisés (lisez : conquis), le bon plaisir du soldat et comme unique régime : le massacre, la spoliation et le vol.
(Voir les mots Guerre, Impérialisme, Sadisme.)
P. VIGNÉ D’OCTON.
COMBATIVITÉ
n. f.
Selon Lachatre, la combativité est la faculté qui porte l’homme à repousser l’agression, à défendre sa vie, sa demeure, ses enfants ; son développement excessif annonce un esprit querelleur, aimant les rixes, la guerre, et pouvant pousser le courage jusqu’à l’extrême témérité. Selon nous, cette définition de la combativité n’est pas tout à fait exacte, et l’on peut pousser la combativité à l’extrême sans pour cela être animé par un esprit querelleur et guerrier. Cette définition de la combativité fut peut-être exacte à l’époque où seule la force brutale dirigeait le monde ; mais de nos jours, où la pensée, les idées exercent une certaine influence ― et non des moindres ― sur l’orientation des sociétés, la définition de Lachatre nous parait incomplète.
Et, en effet, la combativité ne se manifeste pas seulement dans le domaine physique, mais aussi dans le domaine moral et intellectuel. Il faut autant de courage pour se défendre contre l’adversaire qui s’adresse à vous, armé de toute sa science ou de tous ses préjugés, que pour lutter contre celui qui use de la brutalité et de sa force physique. Quelle que soit la façon et la manière dont il est attaqué, celui qui se défend, qui use de toute son énergie et dépense toute sa combativité pour résister à l’ennemi est un être combatif. La combativité est le corolaire de l’action, et l’homme combatif est un élément précieux dans une organisation politique et sociale. La combativité, c’est l’essence de toute vie, c’est la source de tous les progrès et aussi de toutes les espérances. C’est donc une qualité, et si elle n’est pas mise au service d’une mauvaise cause, de l’intérêt ou de l’ambition, on ne peut que souhaiter son développement dans les rangs de la classe ouvrière, qui a un rôle historique à remplir et qui ne triomphera que grâce à sa combativité, sa volonté et son énergie.
COMBINAISON
n. f.
Assemblage de plusieurs substances ou de plusieurs idées. Se dit au physique et au moral. Chimiquement, par exemple, le mot combinaison signifie « l’acte par lequel deux ou plusieurs corps s’unissent ensemble de manière à former un nouveau corps dont les parties, même les plus infimes, contiennent une certaine quantité des premiers ». Pour nous, c’est surtout au sens politique que le mot présente intérêt, la combinaison étant un des échafaudages sur lesquels reposent le parlementarisme et la puissance gouvernementale. Le parlementaire est passé maître dans l’art de combiner, lorsqu’il désire obtenir un quelconque résultat et, en France ― comme dans les autres pays d’ailleurs ― les couloirs et les salons de la Chambre des Députés et du Sénat sont le repaire où s’entendent les « combineurs » ― qui ne tiennent nullement à donner au public le spectacle de leurs louches tractations. C’est à la combinaison que l’on a recours pour former un ministère, et le terme fut tellement usité qu’on ne lui prête plus un sens péjoratif. On dit couramment « une combinaison ministérielle » sans vouloir remarquer que la composition d’un ministère n’aboutit jamais qu’à la suite de tripotages malpropres, et où chaque ambitieux cherche à obtenir la meilleure place et à écraser son adversaire.
Mme de Staël déclarait que : « L’histoire attribue presque toujours aux individus comme aux gouvernants plus de combinaisons qu’ils n’en ont ». Nous ne sommes pas de cet avis, bien au contraire ; et nous sommes convaincus, par l’exemple et par l’expérience, que tout gouvernement n’arrive à s’imposer que grâce à des combinaisons, et que sans elles la vie lui serait impossible. Ce ne serait du reste pas un mal, si nous considérons qu’un gouvernement n’est nullement utile à la vie des hommes et des sociétés et que ses uniques fonctions consistent à défendre les privilèges d’une armée de parasites.
COMÉDIEN
n. m.
Celui qui joue la Comédie sur un théâtre public. Le travail du comédien consiste à s’imprégner du rôle que joue, dans la pièce, le personnage qu’il interprète, à mettre en action toutes ses capacités pour copier ses vices, ses mœurs, ses travers ou ses qualités, afin de les présenter au spectateur aussi exactement et naturellement que possible. Il doit savoir faire naître l’émotion, la joie ou la tristesse, la gaîté ou la terreur. Il doit attacher et intéresser le public à la comédie qu’il représente, et tour à tour déchainer les rires et les pleurs. Un bon comédien est généralement un grand artiste et son art exige de réelles qualités d’adaptation.
De nos jours, le comédien est admiré et adulé, mais il n’en fut pas toujours ainsi, et il y a peu de temps encore il était écarté du reste dé la société, et ce ne fut qu’en 1789 qu’ils furent admis à jouir de leurs droits civils et politiques. Même à l’époque du Grand Molière, qui fut cependant admis à la table de Louis XIV, les comédiens étaient victimes d’une sourde hostilité, et n’étaient considérés que comme des bouffons chargés d’amuser l’aristocratie. La Révolution de 89 a effacé cette injustice, et ce fut un bien pour l’art théâtral. Libre, le comédien s’est perfectionné et est arrivé à traduire de façon parfaite l’œuvre éclose dans le cerveau du poète ou de l’écrivain. Certains acteurs ont acquis une célébrité mondiale vraiment justifiée. De notre temps, ceux qui ont eu le plaisir et la joie d’entendre Sarah Bernhardt, Réjane, Lucien Guitry ou le grand De Max (nous nous excusons de ne parler que de la scène française) en ont gardé un souvenir ineffaçable.
Malheureusement, le comédien ne se rencontre pas uniquement sur la scène du théâtre ; on en rencontre également à chaque tournant de la vie, qui n’est peut-être, elle aussi, qu’une grande comédie dont nous sommes les acteurs. Mais tous les acteurs ne sont pas sincères, et il en est qui se masquent et qui jouent avec une perfection remarquable le rôle qu’ils se sont eux mêmes attribué. Ces comédiens-là sont dangereux, d’autant plus dangereux qu’ils n’avouent pas être des personnages fictifs, mais qu’ils cherchent à convaincre leur public de leur réalité, alors que tout en eux n’est que convention et mensonge. Et de ces comédiens, on en rencontre partout ; ils pullulent dans les parlements, dans les cours judiciaires et jusque dans les organisations sociales et syndicales. Avocats, députés, magistrats, autant de comédiens qui jouent si bien leur rôle que le peuple se laisse prendre et qu’il est continuellement berné, malgré les conseils et malgré les exemples. Si l’acteur, par son art, agrémente notre vie et nous fait oublier parfois la tristesse et les difficultés de l’existence, s’il nous permet de nous éloigner de la triste réalité pour nous bercer un peu dans le rêve, s’il occupe nos loisirs et nous repose de la lutte quotidienne aride et féroce, s’il a droit en conséquence à toute la considération des hommes, le comédien politique et social est un être malfaisant dont il faut s’éloigner et qu’il importe de combattre de toute notre énergie.
COMITÉ
n. m.
Réunion de délégués chargés de déterminer un travail quelconque, d’en établir un rapport ou de pourvoir à son exécution. Le rôle du Comité consiste à simplifier ou à éclaircir un sujet, une question ou une affaire, avant de les présenter à une assemblée qui en délibère en dernier ressort. Le mot Comité est d’origine anglaise et ne fut importé en France qu’en 1789. Le premier des comités qui se réunirent en France fut celui de vérification et fut chargé en 1789, aux États Généraux, d’établir un rapport sur les élections. Le succès de Ce comité détermina l’Assemblée Générale et la Convention à se fractionner pour étudier séparément chacune des questions qui lui étaient soumises, et il se forma, de ce fait, un grand nombre de comités. Lorsque la Révolution fut menacée par les ennemis intérieurs et extérieurs, la Convention abandonna le Pouvoir exécutif à une minorité d’individus et cette réunion de délégués prit le nom de « Comité de Salut public ». Sans méconnaître les erreurs et les excès de ce Comité tout puissant, erreurs et excès presque inévitables en période d’orage et de lutte, il faut avouer que dans une certaine mesure, ce fut lui qui permit à la Révolution Française de vivre et d’abattre certains de ses ennemis. Les pouvoirs de ce fameux comité furent très étendus, trop étendus. C’était lui qui nommait ministres, généraux, magistrats, juges et jurés, et qui les destituait lorsqu’il les considérait comme impropres à servir la cause révolutionnaire. Par la « loi des suspects », le comité de Salut public disposait de toutes les personnes ; il faisait arrêter, juger, condamner et exécuter ― souvent arbitrairement ― tous ceux qu’il supposait comploter arbitrairement contre l’État. Y a-t-il lieu de s’étonner que, pourvu d’une telle autorité, le Comité de Salut Public en ait abusé ? Il ne faut pas demander à un homme d’être un Dieu, mais simplement un homme et accorder à un nombre restreint d’individus une trop grande puissance, c’est aller au désastre. C’est ce qui se produisit.
Depuis la Révolution Française, aucun comité n’exerça une aussi grande autorité que le Comité de Salut Public. Actuellement, dans les assemblées législatives, il se forme des comités officiels qui sont chargés de délibérer sur diverses questions « d’intérêt public ». Ces comités prennent le nom de « commissions » et sont composés de parlementaires recrutés au sein même de l’assemblée. Dans les grandes organisations sociales, dans les syndicats ouvriers, partout où une collectivité ne peut, à chaque instant, être présente pour s’entendre et discuter de ses intérêts, on fonde des comités qui sont chargés de préparer, de diriger ou d’exécuter certains travaux au mieux des intérêts généraux : « Comité directeur ; Comité exécutif ; Comité d’initiative ». Le comité est, jusqu’à présent, la meilleure forme de représentation collective ; et à condition que ses membres soient toujours soumis au contrôle de ceux qui les délèguent et que ces derniers n’abandonnent pas leurs droits et n’oublient pas leurs devoirs, sa fonction ne peut être qu’utile dans l’organisation sociale présente et servir de base à l’organisation sociale des sociétés futures.
COMMANDEMENT
n. m.
Action de donner un ordre ; de commander. S’exerçant toujours de « supérieur » à « inférieur », le commandement suppose implacablement l’autorité, car on ne peut concevoir le commandement sans qu’immédiatement s’y l’attache l’idée d’autorité. (Voir Autorité.) L’autorité est donc à la base du « commandement » et divise l’humanité en deux fractions : les maîtres, d’un côté, et les esclaves, de l’autre. Le commandement est aveugle, et le fait d’être investi du droit de commander n’implique nullement la capacité et la compétence ; il suffit uniquement, pour commander, d’être pourvu d’un appareil de répression, au cas où « l’inférieur » se refuserait à exécuter l’ordre du « supérieur ». Anciennement, on donnait, comme symbole de leur autorité, un bâton aux officiers investis d’un commandement. Aujourd’hui, le bâton a disparu, mais, hélas ! le commandement subsiste. Il y a une hiérarchie dans le commandement. À l’usine, au chantier, à l’atelier, elle prend naissance au chef d’équipe et s’étend jusqu’au directeur ou au Conseil d’administration ; dans la magistrature, elle part du simple agent de police pour aller jusqu’au président d’un quelconque tribunal ; mais c’est surtout à l’armée que cette hiérarchie de commandeurs accomplit ses tristes méfaits : du petit caporal au puissant ministre de la guerre, chacun s’empare d’une parcelle d’autorite qui retombe invariablement sur l’échine du pauvre troupier, et, du plus petit au plus grand, tout ce monde commande au nom de la discipline militaire.
Et, pourtant, y a-t-il quelque chose de plus stupide que ce commandement ? Selon les principes de l’autorité, l’ordre à exécuter ne doit pas l’être en vertu de son utilité ou de sa logique ; mais en raison directe de la qualité hiérarchique de celui qui le donne. Tout se déplace en vertu du pouvoir de commander : l’intelligence n’a plus son siège dans le cerveau, mais est relative au grade qui nous est conféré dans la vie civile ou militaire. Un caporal est plus intelligent qu’un simple soldat et un capitaine qu’un caporal, cela ne doit faire aucun doute. Il faut l’accepter comme axiome ; et, quels que soient les ordres donnés, aussi ridicules fussent-ils, il faut, sans discuter, les exécuter et s’incliner devant le commandement. Selon certains savoir commander est un art ; ce n’est pas un art, c’est une bassesse et une lâcheté, et il est encore plus méprisable d’exercer le commandement que de le subir. Du reste, tous ceux qui consentent à commander sont capables également de s’abaisser devant des supérieurs. Autant Ils sont féroces pour ceux qui sont placés au-dessous d’eux, autant ils sont généralement plats devant ceux qui occupent un poste plus élevé. Commander et obéir sont des crimes et l’homme libre se refuse à l’une et à l’autre de ces contraintes. (Voir Anarchiste.)
COMMÉMORATION
n. f.
Action de rappeler par une cérémonie ou par une fête le souvenir d’un événement. La plupart des fêtes qui nous sont imposées et que nous subissons dans la société bourgeoise sont d’origine religieuse et commémorent un événement qui appartient plutôt au domaine de l’imagination que de l’histoire ; telles sont les fêtes de la Noël, de Pâques, etc., etc... Du reste, le peuple ne s’ingénie nullement à rechercher l’origine et les causes de ces commémorations et il se contente simplement de profiter, pour se distraire, de ces repos périodiques.
Il n’en est pas de même pour toutes les fêtes. Celle du 14 juillet, par exemple, qui a dégénéré en une vaste bacchanale et qui est une occasion annuelle, pour tous les empoisonneurs patentés, d’écouler leur stupéfiants, devrait rappeler « au peuple souverain » qu’il y a plus d’un siècle ses ancêtres, las d’être tyrannises par la noblesse, levèrent l’étendard de la révolte, et s’élancèrent à l’assaut de la Bastille. Le geste du peuple en révolte n’avait pas seulement pour but de libérer quelques centaines de prisonniers, mais aussi de marquer son désir d’échapper à l’étreinte de l’autocratie. Que c’est près et que c’est loin, tout cela, et qu’il est triste de constater la faculté d’oubli de ceux qui souffrent ! La fête du 14 juillet n’est pas la commémoration de la prise de la Bastille, car d’autres bastilles se sont élevées sans que ceux qui, au son d’une musique barbare, chantent et dansent toute la nuit, songent à les détruire. Elle n’est plus qu’une immense beuverie, qui ne rappelle en rien le sacrifice de nos aînés.
Parmi les commémorations populaires qui ont conservé leur véritable caractère, il n’y a, en réalité, que le Premier Mai et l’anniversaire de la Commune. Commémorations douloureuses, qui nous font souvenir de la férocité de nos maîtres, qui nous initient aux tragédies passées, et qui, chaque année, ravivent en nous le désir d’en finir au plus tôt avec ce capitalisme qui repose sur des rivières de sang et des monceaux de cadavres. Il ne faut pas oublier. Il faut commémorer encore et toujours ces périodes de lutte, tant que la bête qui nous tient rivés au boulet de l’exploitation ne sera pas abattue. Il ne faut pas oublier, jamais, ce que nous souffrons, ce que nous avons souffert, en nous, en nos parents, en nos ancêtres, afin que nos enfants ne partagent pas notre triste sort et que leur vie ne soit pas tissée dans les larmes et dans la souffrance. Il faut se souvenir ; et c’est en se souvenant que nous préparerons l’avenir.
COMMERCE
Le Commerce est le négoce ou le trafic par voie d’échange auxquels donnent lieu les marchandises, soit entre particuliers, soit entre pays.
Au point de vue économique, il faut distinguer trois sortes de commerce : le commerce de gros, le commerce de demi-gros et le commerce de détail.
Le commerce de gros consiste à acheter aux producteurs de grandes quantités de marchandises pour les revendre, soit en gros, soit à des commerçants de demi gros ; quelquefois, mais plus rarement à des détaillants.
Le commerce de demi gros consiste à acheter de grosses quantités de marchandises pour les revendre au commerce de détail, et même directement parfois aux consommateurs.
Le commerce se divise aussi en commerce intérieur et commerce extérieur ou international.
Le commerce intérieur se limite aux échanges dans un même pays. Son chiffre approximatif se mesure par l’intensité du trafic des chemins de fer, des canaux et des routes.
Le commerce extérieur ou international, embrasse l’ensemble des échanges entre les nations différentes (exportation et importation). Il se mesure assez exactement par le contrôle des douanes, au moment du passage des marchandises aux frontières terrestres et maritimes.
Les droits de douane sont destinés soit à protéger les productions similaires du pays, soit à procurer simplement des ressources au Trésor public.
Deux régimes de commerce international s’opposent sans que l’un ou l’autre se soit définitivement imposé : ce sont le protectionnisme et le libre-échangisme. Le premier est généralement soutenu par les conservateurs de tous les pays, tandis que l’autre a pour champions les libéraux et démocrates sociaux.
Alors que le premier tend à protéger par des droits de douane très lourds l’industrie nationale, le second consiste à laisser le commerce extérieur aussi libre que le commerce intérieur.
Le protectionnisme a pour but d’accorder aux produits de l’industrie nationale le monopole du marché intérieur d’un pays, en frappant de taxes plus ou moins élevées les produits de l’industrie étrangère. Ces taxes ont pour objet d’augmenter le prix des produits. Il en résulte que les droits du consommateur se trouvent lésés au profit des fabricants. C’est donc un facteur important de vie chère et aussi de routine. On ne s’étonne pas, dans ce cas, qu’il soit âprement défendu par les conservateurs de toutes écoles.
Le libre-échangisme, au contraire, s’oppose à toute protection de l’industrie nationale, ses partisans admettent que la libre concurrence s’exerce sur le marché international comme sur le marché national.
Ils soutiennent, avec raison d’ailleurs, que l’avantage du consommateur ne doit en aucun cas être sacrifié ou subordonné à celui du producteur. Ils estiment que la population d’une nation ne doit pas être obligée de payer plus cher les produits dont elle a besoin par la seule raison que les fabricants ou producteurs d’un pays sont incapables de soutenir la concurrence de l’étranger. Le libre-échangisme est certainement une forme du progrès, un adversaire intelligent de la routine.
Généralement les pays qui pratiquent le libre-échange sont plus riches que les autres et plus avancés scientifiquement et socialement.
Le commerce, intérieur et extérieur, donne lieu à de nombreux actes, dits de commerce. Il a ses juridictions particulières, ses représentations spéciales, ses agents de propagande officiels à l’étranger.
Partout, la loi répute acte de commerce : tout achat de denrées ou de marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées ou transformées ou pour en louer l’usage (fonds de commerce, moyens de transports, etc.) ; toute entreprise de manufactures, de commissions, de transports terrestres, maritimes ou fluviaux ; toute entreprise de fournitures, d’agences, d’affaires, d’établissements de vente à l’encan, de spectacles publics ; toute opération de change, banque et courtage ; toutes les opérations des banques publiques ; toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; toute entreprise de construction, tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la majoration ou le transport intérieur ou extérieur ; entre toutes personnes les lettres de change ou remises d’argent ; toutes expéditions maritimes ; tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipage ; tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.
Le commerce embrasse en somme toute l’activité d’un pays. Il constitue l’ensemble des transactions auxquelles se livrent : négociants, commerçants, industriels, coopératives, banques et transporteurs divers.
Sont réputés commerçants tous ceux qui exercent en des actes de commerce ci-dessus indiqués et en font leur profession habituelle.
Les commerçants sont obligés de tenir des livres qui sont au nombre de trois : journal, copie de lettres et copie d’inventaires. Ils payent patente et sont obligés de rendre public leur régime matrimonial. Leurs actes sont réputés commerciaux et relèvent, en conséquence, des Tribunaux de commerce, qu’ils élisent et dont ils peuvent faire partie.
Il y a dans chaque pays un ministère du Commerce et de l’Industrie.
Les attributions de ce ministère sont très variées : la législation des poids, mesures et monnaies, celle de la propriété industrielle et commerciale, l’organisation de la pêche fluviale et maritime, le rôle de la marine marchande, etc.
Ce ministère est assisté :
-
D’un Conseil supérieur de l’Industrie et du Commerce qui émet des avis sur les projets de lois relatifs aux tarifs des douanes, sur l’application de ces tarifs, sur le système des encouragements à apporter aux grandes pêches maritimes et à la marine marchande. Il comprend une Commission consultative permanente qui donne son avis au ministre toutes les fois que celui-ci ne juge pas nécessaire de consulter le Conseil lui-même.
-
L’Office National du Commerce extérieur. ― Cet Office, rattaché au ministère du Commerce et de l’Industrie et déclaré d’utilité publique, a pour mission de fournir aux industriels et négociants tous les renseignements commerciaux, les renseignements et statistiques relatifs au développement du commerce extérieur et à l’extension de ses débouchés dans les pays étrangers, colonies et protectorats.
Les correspondants de cet Office portent le titre de Conseillers de Commerce extérieur. Ils sont nommés par décrets et choisis parmi les industriels et commerçants jouissant d’une grande notoriété dans les affaires d’Importation ou d’exportation.
Le commerce a aussi, et c’est sans doute son institution la plus importante, des chambres spéciales, dites Chambres de Commerce.
Les Chambres de Commerce sont auprès des Pouvoirs publics les organes des intérêts industriels et commerciaux.
Elles sont des Établissements publics et institués par décrets d’administration publique par le ministre du Commerce et de l’Industrie. Les membres de la Chambre de Commerce sont élus par les industriels et commerçants de toutes catégories d’une même région. Il y a aussi des Chambres de Commerce extérieur ou international qui sont composées de représentants élus par l’ensemble des Chambres de Commerce d’un pays.
Ce sont en fait de véritables parlements économiques qui dictent le plus souvent leurs volontés aux Parlements politiques. Cette institution reste sans contre poids ouvriers, sauf en Allemagne où il existe depuis longtemps des Chambres du travail. C’est le rôle qui incombe aux Bourses du Travail insuffisamment développées.
Tribunaux de Commerce. ― Les Tribunaux de Commerce examinent tous les litiges ou différends relatifs aux actes de commerce. Ils sont institués par décret en Conseil d’État. Ils comportent des tribunaux d’appels où siègent des magistrats dits consulaires, élus par les commerçants remplissant certaines conditions, selon les pays.
Par son caractère, son organisation, son pouvoir, le Commerce ― et l’Industrie et les Banques ― est en fait la seule puissance du pays.
Il est l’expression même du capitalisme. Et si, autrefois, on disait : le Commerce enrichit Carthage, on peut dire aujourd’hui qu’il est la forme d’exploitation de l’ensemble de la population d’un pays par une minorité d’individus sans scrupules. Il permet d’amasser par le vol des fortunes énormes, de spéculer, d’affamer, de pressurer, au nom de l’ordre, tout un peuple pour la satisfaction d’insatiables appétits. Le commerce va de pair avec la propriété. Comme elle, il est le vol organisé, légalisé ou toléré.
Il ne disparaîtra dans ce qu’il a de mauvais que par la disparition de la propriété dont il est le corollaire malfaisant, après qu’on l’aura remplacé par l’échange national et international, soit en nature, soit en utilisant une base d’évaluation existante et un étalon monétaire de même caractère.
― Pierre BESNARD.
COMMISSAIRE
n. m.
« Il vaut mieux avoir à faire à Dieu qu’à ses Saints » dit un vieux proverbe. Ce proverbe pourrait s’appliquer admirablement au Commissaire de police, qui, bien que placé au premier échelon de la magistrature, n’en est pas moins le plus redoutable et le plus dangereux des fonctionnaires. En apparence ses pouvoirs sont restreints et ses possibilités de nuire assez réduites ; en réalité, ils sont énormes car c’est lui que l’on voit apparaître en premier lieu, lorsque par malheur on se laisse prendre entre les griffes de la « Justice ». Examinons donc quels sont les « droits et les devoirs du commissaire de police ». Laissant de côté ceux d’importance secondaire, nous nous attacherons particulièrement à ceux qui en font de véritables autocrates contre lesquels il est presque impossible de se défendre.
« Ils sont chargés du maintien de l’ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes. Ils ont le soin de réprimer les délits ou les contraventions contre la paix publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d’attente dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’Assemblée publique, les bruits et attroupements qui troublent le repos du citoyen ».
Ce n’est déjà pas mal et nous sommes payés pour savoir de quelle façon le commissaire accomplit ce que, par ironie sans doute, on appelle ses « devoirs ». En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés et pour maintenir l’ordre, nous assure-t-on, le commissaire de police a le droit de pénétrer dans toutes les assemblées publiques, d’assister à tous les meetings ou conférences et comme c’est lui qui est chargé d’établir le rapport signalant les incidents qui se sont produits au cours de cette réunion, l’orateur et les assistants sont entièrement à sa merci. Que de fois agissant par ordre de ses chefs, et pour se débarrasser d’un militant considéré comme dangereux pour la « sécurité » publique, avons-nous entendu le commissaire de police lui prêter des propos jugés subversifs, alors qu’il était sincèrement démontré que celui-ci ne les avait pas prononcés ! Mais un commissaire de police ne se trompe pas et, étant assermenté, c’est-à-dire que légalement il est incapable d’un mensonge. On sait où tout cela nous entraîne.
« Ils exercent les fonctions de ministère public près le tribunal de simple police, et sont, en cela, de véritables substituts de procureurs généraux. Ils sont tenus, lorsqu’ils sont informés d’un crime ou d’un délit, de dresser des procès-verbaux tendant à constater le flagrant délit ou le corps du délit, encore qu’il n’y ait pas de plainte déposée. Ils peuvent dans ce cas décerner des mandats d’amener et retenir les inculpés à la disposition du procureur dont ils sont les auxiliaires ».
Voilà qui est mieux et le commissaire de police peut se vanter d’avoir, avec ses mandats d’amener, qui ne sont qu’une forme modernisée de lettre de cachet, fait d’innombrables victimes. Les révolutionnaires savent, lorsqu’ils sont pris dans une manifestation et qu’ils ont à subir la brutalité de la police, que ce n’est jamais, malgré le témoignage de centaines d’individus, celui ou ceux qui sont responsables, qui sont inquiétés ou arrêtés par le commissaire de police.
Ce n’est pas simplement sur le terrain social ou révolutionnaire que le commissaire de police est un être malfaisant. Il est également chargé de la délivrance des pièces nécessaires à l’obtention d’un permis de chasse, d’un passe-port, de certificats ouvriers ; c’est lui qui a pour fonction d’enquêter sur « l’honorabilité » des habitants de son quartier, et si, pour une raison ou pour une autre, ou encore sans raison aucune, il ne lui plaît pas que vous vous déplaciez, que vous alliez en Angleterre ou en Allemagne, il vous refuse purement et simplement les pièces demandées et vous n’avez qu’à vous incliner. Sur les déclarations fantaisistes ou réelles, de voisins intéressés, il vous permet de travailler ou vous oblige au chômage en fournissant sur votre compte des renseignements presque toujours inexacts et se fait l’auxiliaire de la bourgeoisie en pénétrant dans la vie la plus intime des individus et en dévoilant les secrets de votre existence. En un mot le commissaire est le bras qui exécute la plus basse des besognes pour le compte du capitalisme. Il y a, dans la magistrature, d’autres commissaires encore, mais leurs fonctions tout en étant aussi répugnante, sont particulières et seront traitées au mot « police ».
Dans certaines organisations on emploie le terme de « commissaires » pour désigner les membres chargés d’assurer lors des manifestations le bon ordre et la discipline et dans certains pays ce mot est synonyme de « ministre ».
COMMUNE
n. f.
Nom que l’on donne, en France, à une certaine fraction de territoire qui est administrée municipalement par des fonctionnaires recrutés en son sein.
La Commune a son origine dans la lutte contre le servage et au XIème siècle elle était formée de l’association des habitants d’une même ville désirant se gouverner eux-mêmes et se libérer des violences exercées par les seigneurs. Les communes furent pendant une certaine période soutenues dans leur affranchissement par le pouvoir royal, qui cherchait à amoindrir la puissance des grands barons. Mais une fois que les rois furent victorieux, petit à petit ils enlevèrent aux communes tous les privilèges qui leur avaient été accordés et, sous Richelieu et Louis XIV, toutes les libertés municipales furent abolies au bénéfice du Pouvoir central.
De nos jours il y a en France, exception faite de l’Alsace et de la Lorraine, qui sont gouvernées en vertu d’un statut spécial, 36 000 communes. Elles sont administrées par un Conseil municipal élu au suffrage universel, ayant à sa tête un maire, qui est le premier magistrat de la commune et qui est investi par ce Conseil du pouvoir exécutif, pour tout ce qui intéresse l’intérieur de la commune.
Si, en apparence, la commune est autonome, en réalité elle ne l’est pas et est soumise à l’autorité du Préfet représentant le Gouvernement et qui a la faculté, s’il le juge utile pour maintenir « l’ordre », de révoquer le maire, de lui retirer ses pouvoirs et même de dissoudre le Conseil municipal. C’est fréquemment, et plus particulièrement en période de lutte ouvrière que nous voyons un préfet, agissant sur l’ordre de son gouvernement, prendre entre ses mains la direction de la police et faire violence à la commune qui ne veut pas se soumettre à l’autorité et à l’arbitraire du Gouvernement. En vertu même des principes de centralisme qui régissent les sociétés modernes, la « commune » est écrasée par le poids de l’autorité qu’elle subit. Dans une société organisée selon les règles de la raison et de la logique, la commune libre sera la base de tout régime social. C’est en abandonnant le centralisme et en s’inspirant du fédéralisme que nous arriverons à ce résultat. (Voir Centralisme et Fédéralisme.)
LA COMMUNE
n. f.
Nous n’avons que des notions rudimentaires sur la préhistoire de l’humanité. Les recherches à ce sujet semblent conclure, ― d’où évidemment la légende du paradis, ― que pendant des siècles et des siècles les hommes primitifs vivaient relativement heureux dans la promiscuité sexuelle et la communauté de la cueillette et de la pêche.
Mais on ne socialise pas la misère et comme nos ancêtres étaient constamment exposés aux intempéries et aux attaques des bêtes sauvages, l’insécurité et la pénurie créèrent les dieux et la notion anti-sociale du mien et du tien, qui enfantèrent la ruse et la spoliation, le prêtre, le guerrier et le trafiquant et l’homme, tombant plus bas que les bêtes féroces qui le guettaient, se fit anthropophage.
Notre humanité, qui a mis des centaines de milliers d’années pour se dégager lentement et péniblement de l’animalité a à peine soixante siècles d’existence consciente derrière elle. Son histoire positive ne remonte guère qu’à la première Olympiade qui date de l’an 776 av. J.-C.
Depuis cette période, dite historique, trois phases caractérisent, à travers d’innombrables déchirements et des cruautés inouïes, la marche ascendante de notre espèce :
-
L’esclavage ou la libre et absolue possession du producteur par celui qui l’emploie.
-
Le servage. Il n’est qu’une légère atténuation de l’esclavage antique car il consacre encore la possession conditionnelle du producteur, agricole surtout, par son maître. Le servage, forme économique de la féodalité, n’a cédé la place qu’après quatre ou cinq siècles de luttes au salariat.
-
Le salariat. Ce dernier date seulement d’une centaine d’années et est la liberté théorique du producteur de disposer de sa personne.
Mais pratiquement cette liberté se réduit pour l’immense majorité des travailleurs à mourir de misère et d’inanition si les détenteurs des instruments de production n’ont pas besoin de la force cérébrale et musculaire du salarié et non-possédant.
Ce qui distingue le travailleur moderne de son aîné, le serf du moyen-âge et l’esclave de l’antiquité, c’est que sa liberté personnelle a accru son sentiment de dignité et sa capacité de révolte. Mais matériellement et par suite sous bien des rapports moralement l’ouvrier de nos jours est et restera esclave de fait aussi longtemps que subsistera le divorce entre le producteur et l’instrument de production, c’est-à-dire aussi longtemps que la matière première, sol, sous-sol et les forces productrices, usines, ateliers, fabriques, etc., etc., au lieu d’être la propriété indivise du genre humain, continueront à être possédés par une minorité de parasites et de maîtres.
Nous constatons qu’aussi bien dans les périodes cosmogoniques et géologiques, qui ont précédé l’apparition de l’homme sur la terre, que dans celles qui marquent les différentes étapes que l’humanité a parcourues depuis qu’elle est arrivée à la conscience d’elle-même, l’évolution progressive s’accentue, ― comme les corps qui tombent vers un centre qui les attire, ― et devient plus rapide au fur et à mesure qu’elle s’approche du but qu’elle est susceptible d’atteindre.
L’esclavage a mis plus de temps à se transformer en servage que le servage à se transformer en salariat. Nous concluons de là, que le salariat est appelé à disparaître plus vite que les formes économiques et sociales qui lui ont été antérieures.
Déjà les prodromes de sa fin prochaine se multiplient en laissant apercevoir à l’état embryonnaire, les contours que revêtira la société future.
Le capitalisme est son propre fossoyeur. En centuplant les forces productives, il a de plus en plus dépossédé de leurs champs et exproprié de leurs outils les cultivateurs et les artisans devenus à leur tour des prolétaires.
Les petites exploitations privées se trouvent pour la plupart entre les mains de quelques bailleurs de fonds et ne sont, en somme, que des intermédiaires chargés de la distribution des produits de la grande industrie.
Les petits propriétaires fonciers ne sont possesseurs que de nom et le lendemain de la Grand Guerre impérialiste de 1914–1919, qui n’a pas encore dit son dernier mot, sonne partout le glas de la petite bourgeoisie et des classes moyennes.
La lutte des classes, guerre constante des pauvres contre les riches, des possédés contre leurs possesseurs, des gouvernés contre les gouvernants, les maîtres, pour plus d’égalité et de liberté, pour plus de bien-être et moins d’autorité est la trame de l’histoire qui explique l’horrible cauchemar au milieu duquel nous nous débattons.
La légende des vaches maigres et des vaches grasses de l’Égypte des Pharaons et des pyramides, l’âpre lutte entre les Plébéiens et les Patriciens et la guerre servile des esclaves conduit par l’impavide Spartacus de la grande mais farouche et cruelle Rome antique, les sinistres bûchers qui éclairaient seuls la nuit opaque du moyen-âge sont les étapes glorieuses et lumineuses parcourues par la Pensée humaine et la Révolte sainte du passé !
Les communes du second moyen-âge étaient des associations formées par les habitants d’une même ville pour se gouverner eux-mêmes et se défendre contre les violences et les exactions des seigneurs féodaux. C’est là que la Révolution de 1789 prit ses racines. Les tentatives de soulèvement qui eurent lieu dans les campagnes furent promptement réprimées. Mais un grand nombre de villes, surtout dans le midi de la France, avaient conservé l’organisation municipale qu’elles avaient eu sous la domination romaine où elles s’administraient elles-mêmes et ne subirent point la souillure de la servitude. Les autres se lassèrent bien vite de l’oppression et opposèrent à leurs maîtres une résistance d’abord passive, ensuite armée. Tel fut le cas, en 1070, pour la commune du Mans.
Généralement les Communiers se réunissaient dans l’église ou sur la place publique et se prêtaient le serment, sur des choses saintes, de se donner les uns aux autres foi, aide et force. Par cet engagement la commune était établie et les communiers se formaient en milices et devaient, au signal du beffroi, se rendre en armes sur la place pour défendre leur ville ; ils nommaient des magistrats pour administrer les affaires et les revenus de la cité. Aussitôt la conjuration formée, si le seigneur ne l’acceptait pas, la guerre commençait entre lui et les communiers. Ceux-ci étaient-ils vainqueurs ? Ils forçaient le baron à leur octroyer une charte qui contenait surtout des règlements relatifs à la vie civile, aux libertés de l’industrie, à la sécurité des biens et des personnes.
Dans cette lutte entre les communiers et la féodalité, la royauté seconde, pendant un. certain temps, la bourgeoisie ― ou plus exactement la classe moyenne, car la bourgeoisie au sens que les socialistes donnent à ce mot n’existe que depuis l’ère capitaliste ― pour contre balancer la puissance des hauts barons. Mais lorsque les rois furent vainqueurs de la féodalité ils reprirent un à un tous les privilèges, une à une toutes les franchises accordées aux villes. Richelieu et Louis XIV achevèrent de confisquer, au profit du despotisme, toutes les libertés.
Du 14 juillet 1789 au 9 Thermidor an II (27 juillet 1794), la Commune de Paris absorba presque toute la puissance politique. Son histoire est un miroir fidèle de l’histoire de la Révolution, dont elle fut, la crête de la gigantesque vague révolutionnaire qui déferla sur la France, le Sinaï, pour parler avec Victor Hugo, bien plus que la Convention de la pensée et de l’action iconoclaste de l’époque, de cette époque unique, qui après avoir proclamé les Droits de l’Homme et du Citoyen, nous a laissé par le Manifeste des Égaux son testament : la réalisation de l’égalité de fait.
D’abord constitutionnelle, sous l’administration de Bailly, l’homme de la Constituante, ensuite franchement démocratique avec Danton pour substitut, la Commune se fit, le 10 août 1792, montagnarde et, dominée ensuite de plus en plus par les sections révolutionnaires de la capitale elle devint, après la grande lessive de septembre, l’âme même de la République et de la Révolution en inscrivant dans l’histoire universelle la plus belle page qui ait jamais illuminé la marche ascendante de l’humanité depuis ses origines. Sa défaite fut la mort de la République et ouvrit toute grande la voie aux saturnales sanglantes du premier Empire et aux monstrueuses ignominies de la terreur blanche.
Mais le temps « ténébreuse abeille, qui fait du bonheur avec nos maux » conspire pour nous et le capitalisme naissant ressuscita le prolétariat, toujours abattu et jamais vaincu. Le voici, en 1831, à Lyon de nouveau debout et le fusil à la main demandant « à mourir en combattant ou à vivre en travaillant », réclamant, en juin 1848, le Droit au Travail et préludant ainsi, par ces deux insurrections, à ce que Malon a appelé la troisième défaite du prolétariat, qui fut, en réalité sa première victoire par son lendemain dont l’aurore prometteuse se lève partout.
De toutes les dates qui marquent un effort du peuple pour secouer ses chaînes, une étape du prolétariat dans son long et dur calvaire pour arriver à l’Égalité et à la Justice, le 18 mars 1871 est, sans contredit, une des plus belles et des plus fécondes.
L’héroïque peuple de Paris, en balayant l’ignoble tourbe des traîtres, des capitulards et des assassins monarchistes, ne s’était pas soulevé dans un but égoïste de conquête municipale ou départementale. Il ne s’agissait pas seulement pour lui, comme l’ont prétendu depuis des politiciens aux abois, exploiteurs du mouvement de la Commune, d’obtenir des franchises municipales plus ou moins étendues et de déjouer le complot monarchiste qui se tramait à Versailles.
Relevant l’étendard des Canuts de Lyon de 1831 et des combattants de juin 1848, le prolétariat parisien lutta pendant 70 jours pour l’affranchissement complet, définitif de tous, pour la République égalitaire et sociale.
Comme Fernand Cortez brûlant ses vaisseaux, les fédérés portèrent une main hardie sur l’édifice séculaire de la servitude et de la faim, rompant d’une façon irrémédiable avec l’odieux passé monarchique, clérical et bourgeois.
L’abolition de la conscription et la suppression de l’armée permanente, la guerre à mort déclarée à l’Église, la guillotine brûlée en place publique, le retour au calendrier républicain de 93 et un commencement de justice rendu au monde du travail, attestent la victoire du prolétariat contre la bourgeoisie, du peuple contre ses maîtres.
Certes les réformes opérées sur le terrain économique par la Révolution du 18 mars étaient absolument insuffisantes, tout à fait au-dessous de ce qu’il était permis d’attendre d’elle.
Au lieu de s’emparer révolutionnairement des millions entassés dans la Banque de France qui auraient suffi, à eux seuls, pour assurer la victoire, au lieu de procéder à l’expropriation générale des patrons et des propriétaires au profit de la Commune, le pouvoir révolutionnaire se contenta de prélever une somme dérisoire sur la Banque pour rémunérer les gardes nationaux, d’interdire les amendes et les retenues dans les ateliers et les administrations ; de décréter la suppression du travail de nuit dans les boulangeries et d’ordonner que les ateliers abandonnés, par les patrons, soient, après enquête et réserve faite des « droits » des dits patrons, attribués aux associations ouvrières pour en continuer l’exploitation.
Néanmoins, nous ne croyons pas qu’il faille trop tenir rigueur à la Commune de ses fautes et de ses faiblesses.
Abandonnée à ses propres ressources, séparée du reste de la France par deux armées ennemies, la situation dans laquelle elle se débattait, était désespérée, sans issue.
Contraint à une lutte qu’il n’avait pas cherchée sitôt, le parti socialiste proprement dit qui ne formait que le quart des membres de la Commune, n’avait pas eu le temps d’organiser les forces populaires et de donner au mouvement parisien une impulsion consciente. De là ses tâtonnements, ce vague dans les aspirations économiques. Tous les combattants voulaient l’Égalité par l’universalisation du pouvoir et de la propriété (proclamation de Pascal Grousset), mais on recula devant la mise en pratique.
Certaines mesures de la Commune étaient cependant empreintes d’un véritable esprit socialiste. De ce nombre il faut notamment citer le décret accordant une pension de 600 francs à la femme légitime ou non du fédéré tué devant l’ennemi et une pension de 365 fr. à chaque enfant reconnu ou non jusqu’à l’âge de 18 ans.
La Commune, en mettant sur un pied d’égalité la concubine et l’épouse, l’enfant légitime et l’enfant naturel, portait un coup mortel à l’institution religioso-monarchique du mariage et jetait ainsi le premier jalon d’une modification profonde de la constitution oppressive de la famille actuelle.
En rompant en visière avec les pratiques de la vieille morale spiritualiste faite de souffrances et d’iniquités, la Révolution du 18 mars donnait à la femme les mêmes droits civils et moraux qu’à l’homme et effaçait à jamais la flétrissure infligée aux enfants nés en dehors du mariage.
Le déboulonnement de la colonne Vendôme fait aussi foi du même esprit socialiste. Cette mesure, tant reprochée aux fédérés par la bourgeoisie européenne, est une des plus pures gloires de cette sublime révolte populaire dont elle atteste le caractère véritablement démocratique et humanitaire.
En renversant la colonne impériale, symbole de prostitution monarchique et de conquête guerrière, la Commune affirmait, en face des armées versaillaise et allemande, son amour de la paix, la solidarité et la fraternité de tous les peuples ; sa haine des rois et des tyrans.
Aussi, les victimes de l’exploitation capitaliste et de la tyrannie gouvernementale de partout, comprirent-elles la portée internationale de la Révolution du 18 mars. L’idée qu’elle a semée a germé et muri.
Pendant les deux mois que la Commune avait été maîtresse absolue de Paris, pas un viol, pas un vol, pas un meurtre n’avaient souillé la vie publique de la métropole. La prostitution et le crime s’étaient enfuis à Versailles avec le gouvernement et les représentants de l’aristocratie, leurs protecteurs et complices naturels.
La Commune ne procéda à l’exécution d’aucun représentant de l’ordre capitaliste et le décret sur les otages, qui lui a été si niaisement reproché par des sentimentalistes imbéciles ne doit être envisagé que comme une mesure de légitime défense.
Venant après le double assassinat de Duval et de Flourens, il eut le mérite de mettre un frein à l’égorgement systématique des prisonniers faits par Versailles.
Les Versaillais, une fois entrés dans Paris, ne tinrent aucun compte de la modération excessive avec laquelle le peuple vainqueur avait traité ses ennemis.
Jamais ville conquise n’eut un sort aussi terrible que la capitale. Dans la semaine qui suivit le 21 mai et que le peuple a si justement nommé la Semaine sanglante, les massacres de Scylla et les atrocités de la Saint Barthélemy furent surpassées. Tous les crimes, toutes les horreurs et toutes les monstruosités du moyen-âge reparurent à la surface. Le triomphe du peuple avait fait peur à la bourgeoisie, et la bourgeoisie se vengeait d’avoir eu peur dans le sang des prolétaires.
Durant sept jours, une soldatesque ivre d’absinthe et grisée par la poudre, massacra tout ce qui lui tomba sous la main. Les maisons furent fouillées depuis la cave jusqu’au grenier.
Le moindre soupçon de sympathie pour la Commune entraînait une mort certaine. Le port d’une blouse pouvait devenir un arrêt fatal. Quant aux membres de la Commune qui tombèrent entre les mains des vainqueurs, leur affaire était réglée d’avance : on les tuait sans autre procédé. Tel fut le sort de Raoul Rigault et de Varlin.
Il suffisait même d’une vague ressemblance avec un personnage qui avait joué un rôle plus ou moins important dans l’insurrection pour être aussitôt passé par les armes.
C’est ainsi que périrent plusieurs citoyens pour avoir eu un faux air de Vallès ou de Billoray.
Le docteur Tony Moilin, qui n’avait jamais pactisé avec la Commune, fut exécuté uniquement pour ses opinions socialistes et pour avoir fondé une bibliothèque populaire.
Sur sa demande ― pourquoi m’arrêtez-vous ? ― L’officier qui conduisait les soldats chargés de l’arrêter, lui répondit sèchement : « Vous êtes un socialiste, il faut se débarrasser des socialistes lorsque l’occasion s’en présente ».
Millière qui, lui non plus, n’avait jamais fait partie de la Commune, fut aussi fusillé sommairement pour l’excellente raison que ses écrits avaient déplu au général Cissey et avaient fait couler des larmes de rage au faussaire Jules Favre. Le titre de représentant du peuple, qui rendait Millière inviolable aux yeux de la loi bourgeoise, ne put le sauver de cette fin tragique. Son assassinat sur les marches du Panthéon prouve une fois de plus que la classe dirigeante et dévorante, si respectueuse de la légalité lorsque cette légalité sert à combattre ses ennemis, n’hésite pas un instant à la fouler aux pieds quand son intérêt le commande.
Le chassepot n’allant pas assez vite en besogne, les Mac-Mahon, les Vinoy et les Gallifet installèrent des mitrailleuses dans les principaux quartiers de Paris pour procéder à l’exécution en masse des fédérés. Les femmes et les enfants ne furent pas plus épargnés que les hommes, et le hideux marquis de Gallifet acquit une sanglante célébrité par le massacre des vieillards au quel il présida à la caserne Lobau.
Le vieux républicain Delescluze, la droiture faite homme, tomba place du Château-d’Eau face à l’ennemi. Paris était littéralement à feu et à sang, plus de 25 000 fédérés jonchaient le sol, la mitrailleuse régnait en souveraine...
Ce n’est qu’après ces assassinats innombrables, perpétrés sur les défenseurs de la République Sociale, que quelques citoyens suivis par une foule exaspérée, se saisirent des otages. Quatre-vingt capucins, agents des mœurs, mouchards et autres bandits, tombèrent sous le feu des balles révolutionnaires.
La responsabilité de ces exécutions incombe toute entière à Thiers, qui avait refusé de livrer Blanqui en échange des otages.
Néanmoins, nous sommes, pour des raisons de défense humaine, loin de répudier la tardive explosion de colère populaire qui se fit jour à cette époque, et nous considérons, comme hautement symbolique la fin tragique de Darboy, Jecker et Boujean, ces trois représentants d’un régime de boue et de sang. Nous estimons en outre que le peuple a bien fait de renverser la colonne impériale, de brûler les palais de ses rois et de détruire les tabernacles de la prostitution monarchique.
Les révolutions ne se font pas en gants glacés et avec l’eau de rose. Une société qui ne vit que par des moyens répressifs et l’exploitation éhontée du prolétariat, ne peut être, hélas ! changée que par la force mise au service du Peuple et de l’Égalité sociale.
Si la Commune de Paris avait eu davantage conscience de cette vérité, elle aurait pris au collet la bourgeoisie par la main-mise sur la Banque de France et l’humanité n’aurait, peut-être, pas eu à enregistrer la plus épouvantable hécatombe de Républicains et de Communeux qui fut jamais :
30 000 fusillés, 42 000 arrestations, 13.700 condamnations, dont la plupart à vie, tel fut le bilan de la vengeance bourgeoise contre le Peuple de Paris, qui avait voulu poser les premiers jalons d’une société égalitaire assurant à tous, par le travail affranchi, le droit au bien-être et au savoir...
Plus d’un demi-siècle a passé sur ces événements tragiques.
D’autres plus tragiques et angoissants ont inondé l’Europe de boue et de sang.
La Guerre Mondiale, LA SCÉLÉRATE GUERRE IMPÉRIALISTE POUR TUER LE RENOUVEAU SOCIAL, a désaxé notre planète par ses 12 millions d’hommes fauchés à la fleur de l’âge et ses 40 millions de victimes.
La formidable Révolution Russe a allumé dans le cœur des spoliés et des sacrifiés une immense lueur et une grande espérance... mais la reculée du temps ne s’est pas faite sur elle d’une façon suffisante pour dire notre dernier mot et nous craignons d’être injustes en clamant nos déceptions... et nos craintes.
Partout la contre-révolution, qui veut nous ramener au moyen-âge, s’arme pour le combat décisif, car elle sent que la Révolution de demain, la plus profonde depuis les temps historiques, ne peut plus se contenter de demi-mesures.
Elle devra faire table rase du passé et labourer profond afin de mettre tout à sa place.
La planète et ses forces productives à ceux qui les font valoir, c’est-à-dire à l’universalité des êtres humains.
Les produits fécondés par la science et d’une abondance presque illimités à la libre disposition des consommateurs.
Elle libèrera aussi l’amour des tyrannies polygamiques et monogamiques en faisant de la femme l’égale de l’homme et de la mère le pivot du groupe affectif.
Elle répartira le travail, devenu attrayant, entre les adultes des deux sexes, majeurs dès la puberté et travailleurs jusqu’au retour d’âge.
Et elle réconciliera enfin l’homme avec la nature et avec lui-même et nos destinées seront accomplies.
Les hommes seront devenus des dieux et Dieu et le Diable seront morts et enterrés.
― Frédéric STACKELBERG.
LA COMMUNE (Histoire de)
18 mars-29 mai 1871
On connaît peu, même en France, l’histoire de « la Commune »,
En principe, et surtout dans les bourgades rurales, la population n’a de « la Commune » qu’une vague impression d’insurrection, de pillage, d’incendie, de violence meurtrière. Dans les centres importants et dans les agglomérations ouvrières, où la propagande socialiste, syndicale et anarchiste a plus ou moins profondément pénétré, on parle de « la Commune » avec un certain respect et l’opinion publique, longtemps égarée par la presse conservatrice, est parvenue à une appréciation plus saine de ce grand fait historique.
À Paris, à l’exception des milieux qui, systématiquement et par un instinct de classe, condamnent et haïssent tout ce qui vient du peuple, de la démocratie ou des classes laborieuses, le souvenir de la Commune provoque les plus ardentes sympathies et, dans le monde socialiste et révolutionnaire, l’enthousiasme le plus vif.
Chaque année, dans la seconde quinzaine de mai, le souvenir de « la Semaine Sanglante » est commémoré et c’est par dizaines et dizaines de milliers, que les manifestants défilent devant le Mur contre lequel, adossés, acculés, brûlant leurs dernières cartouches, tombèrent héroïquement les derniers combattants de « la Commune ».
À l’étranger, on connait moins encore cet événement de grande importance et celui-ci n’évoque quelque intérêt et ne suscite quelque émotion que dans les très grandes cités où les Partis socialistes, les organisations syndicales et les groupements anarchistes ont des adeptes assez nombreux.
L’existence de la Commune fut extrêmement brève : elle naquit le 18 mars 1871 et mourut le 29 mai de la même année ; elle n’a donc vécu qu’un peu plus de deux mois. Ce ne fut pas, à l’origine, un mouvement révolutionnaire. Le peuple de Paris venait de subir un siège long et douloureux. Toutes les privations, tous les deuils, toutes les angoisses, toutes les souffrances que peut connaître une population enfermée, durant plusieurs mois, dans un cercle de fer et de feu, lui avaient été imposés par un gouvernement militaire dont l’impéritie avait été si manifeste que, à diverses reprises, les assiégés avaient eu l’impression qu’ils étaient trahis.
Profondément patriotes, les habitants de Paris avaient été extrêmement mortifiés de la débâcle de l’armée française au cours de la guerre de 1870–71, qui n’avait été qu’une série de défaites à plate couture ; de plus, les mêmes individus : généraux, diplomates, membres du Gouvernement, qui avaient solennellement juré de mourir plutôt que de se rendre, venaient de signer une paix que les patriotes estimaient honteuse ; enfin, il était visible que le Gouvernement à la tête duquel était l’exécrable Thiers, ancien ministre de la monarchie de juillet, intriguait pour restaurer l’Empire, qui, le 4 septembre 1870, s’était écroulé sous le mépris public.
C’est dans ces conditions que Thiers, chef du pouvoir exécutif, résolut et donna l’ordre de désarmer ce Peuple de Paris qui paraissait déterminé à défendre la République et dont l’irritation n’était pas sans lui inspirer de vives inquiétudes.
L’ordre fut donné de reprendre à la Garde Nationale les quelques canons qu’elle avait encore sur la butte Montmartre. Cet ordre mit le feu aux poudres en portant à l’exaspération le mécontentement populaire. Le 18 mars, un combat s’engagea entre la Garde Nationale et les troupes régulières. Pris de peur, le Gouvernement quitta Paris et se réfugia à Versailles, emmenant avec lui les troupes régulières et se plaçant sous la protection de celles-ci. Aussitôt, le Comité central de la Garde Nationale proclama l’indépendance de la Commune de Paris et lança une proclamation invitant les autres villes de France à en faire autant.
Le 26 mars, le Gouvernement de la Commune fut élu et décida de soutenir contre le Gouvernement résidant à Versailles, une lutte sans merci.
De son côté, le Gouvernement de Versailles prit ses dispositions pour étouffer l’Insurrection. Tout d’abord, il sollicita et obtint de l’état-major prussien l’autorisation de porter à cent mille hommes, puis à deux cent cinquante mille, ses effectifs militaires. Et, à partir du 2 avril, les hostilités commencèrent et se poursuivirent, entre Paris et Versailles. Malgré un héroïsme vraiment incomparable, les troupes parisiennes ne cessèrent d’être défaites et décimées.
Le 21 mai, l’armée de Versailles entrait dans Paris, grâce à la trahison. Quartier par quartier, rue par rue, et, on peut le dire, mètre carré par mètre carré de terrain, les Fédérés résistèrent à l’envahissement. Mais écrasés par le nombre, l’outillage de guerre et les forces qui leur étaient opposés, ils furent vaincus, en dépit d’une vaillance extraordinaire et d’un combat grandiose.
Ce fut, de la part des vainqueurs, le point de départ de la répression la plus atroce, la plus implacable qu’eût enregistrée l’histoire. Les documents officiels accusent trente-cinq mille personnes fusillées sommairement. Des enfants, des femmes, des vieillards, furent sauvagement maltraités, sans interrogatoire, sur un simple soupçon, une dénonciation, une parole, un geste, un regard, pour l’abominable satisfaction de faire couler le sang, d’exterminer une race de révoltés et de servir d’exemple. Ce fut une incroyable orgie de meurtre, dont on ne peut, sans frémir, lire le récit.
Telle est, résumée dans ses grandes lignes, l’histoire de « la Commune ».
L’opinion la plus répandue et qu’ont tenté d’accréditer les historiens bourgeois du Mouvement Communaliste de mars-mai 1871, c’est que cette Insurrection a succombé sous le poids de ses propres excès.
De toutes les appréciations auxquelles puisse donner lieu « la Commune », celle-ci est incontestablement la plus inadmissible.
Non ! Bien loin que ce soit de ses excès, c’est, au contraire, de ses timidités, de sa modération, de son manque de résolution, de fermeté et d’audace que « la Commune » est morte.
Le Gouvernement de « la Commune » voulut être un gouvernement comme tous les autres : légal, régulier, respectant lui-même et forçant le peuple à respecter les institutions établies. Il fit de la générosité, de l’humanisme, de la probité. C’est ainsi qu’Il fit porter à Versailles, c’est-à-dire chez l’ennemi, sous escorte imposante, l’argent de la Banque de France. C’est ainsi qu’il manifesta, en toutes circonstances, un respect inimaginable de la Propriété et de tous les privilèges capitalistes. Il se flattait de rassurer par cette attitude, le Gouvernement de Versailles et de l’amener de la sorte à composition.
Il est équitable de reconnaître que le Gouvernement de « la Commune » était composé des éléments les plus divers et que, exception faite d’une petite minorité, représentant le Blanquisme et l’esprit de l’Internationale des Travailleurs, les membres de ce Gouvernement étaient imbus des principes d’Autorité et de Propriété et, au surplus, n’avaient aucun programme s’inspirant d’une Idée maitresse, d’une Doctrine directrice.
Pour tout dire, les chefs de « la Commune » : tous d’un patriotisme ardent, la plupart foncièrement républicains et quelques-uns seulement socialistes, n’eurent pas conscience de ce qu’ils auraient dû faire pour tenir tête à la racaille gouvernementale qui, de Versailles, commandait à la France entière, après avoir eu soin d’isoler Paris.
D’une part, les insurgés du 18 mars perdirent un temps précieux au jeu puéril d’élections régulières, alors qu’ils auraient dû organiser, sans perdre un jour, la vie économique de la Capitale dont la population était déjà épuisée par les rigueurs d’un siège prolongé.
D’autre part, ils auraient dû mettre la main sur le trésor enfermé dans les caves et les coffres de la Banque de France, confisquer les biens mobiliers et immobiliers des rentiers, propriétaires, industriels, commerçants et autres parasites et cette confiscation eût été d’autant plus facile, que la plupart de ces parasites, cédant à une frousse intense, avaient fui précipitamment Paris tombé au pouvoir des insurgés.
Ils auraient dû, enfin, répondre coup pour coup aux attaques des Versaillais, tenter l’impossible pour briser le cercle infernal dans lequel Thiers s’efforçait de les emprisonner, prendre et appliquer des mesures propres à semer la panique dans les rangs de la réaction versaillaise et à faire naître l’enthousiasme et la confiance dans la conscience des déshérités.
Malgré ses erreurs et ses fautes, « la Commune » a laissé dans l’histoire révolutionnaire de l’humanité une page lumineuse, pleine de promesses et d’enseignements.
Diverses décisions et plusieurs tentatives sont remarquables et à retenir tant en raison de la pensée qui les a inspirées que des indications qu’on en peut tirer.
Je citerai deux de ces tentatives, empreintes d’un caractère révolutionnaire.
La première est du 20 mars 1871 : c’est l’acte par lequel Paris s’affirme commune libre et convie les autres villes de France à se constituer, elles aussi, en communes indépendantes. Il faut voir là un premier jalon de la Révolution future : l’abolition de l’État centralisateur et omnipotent, la Commune devenant la base de l’organisation fédéraliste se substituant au centralisme d’État.
La seconde est du 16 avril. C’est un décret dont voici le texte : « Considérant qu’une grande quantité d’ateliers ont été abandonnés par ceux qui les dirigeaient, afin d’échapper aux obligations civiques, sans tenir compte des intérêts des travailleurs, et que, par suite de ce lâche abandon, de nombreux travaux essentiels à la vie communale se trouvent interrompus, l’existence des travailleurs compromise « la Commune » décrète que les Chambres syndicales ouvrières dresseront une statistique des ateliers abandonnés, ainsi qu’un inventaire des instruments de travail qu’ils renferment, afin de connaître les conditions pratiques de la prompte mise en exploitation de ces ateliers par l’association coopérative des travailleurs qui y sont employés. »
On a fait du chemin depuis le 16 avril 1871 et il est permis de taxer ce décret d’excessive timidité et modération. Il est évident que de nos jours, une insurrection victorieuse, disons mieux : la Révolution sociale n’aura pas la naïve faiblesse de procéder par voie de décret. Elle prendra possession brutalement et sans formalité des instruments de travail, des matières premières et de tous les moyens de production dont auront été dépossédés les détenteurs capitalistes ou que ceux-ci auront eu « la lâcheté » d’abandonner.
N’empêche que, dans ce décret ― si modéré, si timide qu’on le trouve et qu’il soit ― il y a la proclamation du droit ― et je dirai même du devoir ― qu’ont les producteurs de s’emparer sans autre forme de procès, de la terre, de l’usine, du chantier, de la manufacture, de la gare, du bureau, du magasin, en un mot de tout ce qui représente, à un titre quelconque, la vie économique dont ils sont les animateurs, les facteurs et les auxiliaires indispensables et souverains.
Organisation politique ayant comme base le noyau communal et comme méthode le fédéralisme.
Organisation économique reposant tout entière sur la production assurée et administrée par les travailleurs eux-mêmes, ayant mis la main sur tous les moyens de production, de transport et de répartition.
« La Commune », il est vrai, n’a pas réalisé ces deux points fondamentaux de toute transformation sociale véritable ; mais elle en a donné l’indication précieuse, essentielle et elle a, de cette façon, été une ébauche de ce que doit être, de ce que sera la Révolution sociale de demain.
Je ne veux pas terminer cet exposé trop court sans rendre hommage à la vaillance héroïque avec laquelle, jusqu’à la dernière minute, se sont battus les défenseurs de « La Commune ». Même à l’heure où tout espoir de vaincre était perdu, même à la tragique minute où ils savaient qu’il ne leur restait plus qu’à succomber, ils ont fait le sacrifice de leur vie, sans hésitation et le front haut, en regrettant la mort de « la Commune » plus que la leur.
Si les révolutionnaires et anarchistes se jettent, le jour de la Révolution, au cœur de la lutte, avec la même ardeur, avec la même farouche résolution, avec la même inébranlable détermination de vaincre ou de mourir, il n’est pas douteux que rien ne leur résistera.
― SÉBASTIEN FAURE.
COMMUNISME (LE)
n. m.
Le Communisme — qu’il faut se garder de confondre avec « le Parti Communiste » — est une doctrine sociale qui, basée sur l’abolition de la propriété individuelle et sur la mise en commun de tous les moyens de production et de tous les produits, tend à substituer au régime capitaliste actuel une forme de société égalitaire et fraternelle. Il y a deux sortes de communisme : le communisme autoritaire qui nécessite le maintien de l’Etat et des institutions qui en procèdent et le communisme libertaire qui en implique la disparition...
Le premier se confond avec le collectivisme (voir ce mot), le second n’est autre — plus spécialement sur le terrain économique — que l’Anarchisme. La plupart des personnes qui se réclament de l’esprit anarchlste sont communistes.
Dans une motion adoptée à l’unanimité par les anarchistes, réunis en Congrès, du 11 au 14 juillet 1926, à Orléans, on lit ceci : « Les anarchistes groupés au sein de« l’Union Anarchiste de langue française » se déclarent et sont communistes, parce que le Communisme est la seule forme de Société assurant à tous, sans aucune exception et, notamment aux enfants, aux vieillards, aux malades, aux moins bien doués physiquement et intellectuellement, une part égale de Bien-Etre et de Liberté ». Il ne faut pas perdre de vue que si le principe de liberté est le point central de leur doctrine sociale, les Anarchistes, voulant instaurer un milieu social qui assurera à chaque individu le maximum de bien-être et de liberté adéquate à toute époque, ont conscience qu’ils ne peuvent parvenir à la réalisation pratique de cette volonté qui les anime que par la mise en commun (le Communisme) de tous les moyens de production, de transport et d’échange. Seule, cette mise en commun, placée à la base du régime social, garantira à tous et à chacun le droit effectif et total de participer solidairement et fraternellement à tous les avantages des richesses et produits matériels et des progrès intellectuels et moraux constamment accrus par l’effort commun.
Il y a loin, bien loin, on le constate facilement, de ce Communisme libre, c’est-à-dire anarchiste au Communisme étatique et imposé des Bolchevistes (voir Bolchevisme), de leurs partisans et de leurs imitateurs.
A ce Congrès de l’Union Anarchiste française, tenu à Orléans, du 11 au 14 juillet 1926, certains délégués ont fait observer le discrédit dans lequel est tombé le mot « Communisme » perfidement usurpé et tristement galvaudé par le Gouvernement Bolcheviste et les tenants des divers Partis Communistes organisés nationalement et internationalement. Ces délégués estimaient que cette doctrine sociale « le Communisme » était à ce point disqualifiée, que, pour éviter toute confusion de principe et répudier formellement toute promiscuité avec les exploiteurs et falsificateurs du véritable Communisme, il était préférable que les Anarchistes cessassent de se dire « communistes ». Mais il a été répondu à ces délégués que les mots destinés à exprimer les idées les plus justes, les plus nobles vérités et les sentiments Ies plus généreux, tels que : liberté, justice, fraternité, paix, amour, ont été, eux aussi, et, plus que jamais, sont détournés de leur signification véritable, perfidement exploités et indignement galvaudés. Et, à la suite d’un échange de vues très approfondi, il a été décidé que, bien loin d’abandonner le Communisme à des Partis politiques qui trahissent celui-ci, les Anarchistes continueront à se proclamer Communistes puisque, seuls, ils le sont réellement, et puisque ceux qui composent « le Parti Communiste » ne le sont pas, soit qu’ils ne l’aient jamais été, soit qu’ils aient cessé de l’être.
— Sébastien FAURE.
OMMUNISTE (LE PARTI)
n. m.
Organisation internationale qui a pour but de remplacer dans le monde entier la société capitaliste où la propriété est individuelle par une société communiste où les produits appartiendront à la collectivité.
Cette société ne peut s’établir que par la révolution ; le parti communiste est donc révolutionnaire. La transition entre le capitalisme et le communisme doit se faire par la dictature du prolétariat, dans laquelle les classes ouvrière et paysanne deviennent classes dominantes.
Le succès du communisme assuré, la dictature du prolétariat s’efface ; l’Etat est supprimé comme inutile ; le Gouvernement des hommes est remplacé par l’administration des choses (Lénine).
Le parti communiste est dirigé par un Comité international (Komintern), qui siège à Moscou ; il comporte un présidium composé d’un nombre restreint de personnes et des délégués de tous les pays qui ont un parti communiste.
Le Komintern dirige effectivement les partis nationaux. C’est lui qui donne le thème tactique (thèses) sur lequel devra porter la propagande. C’est lui qui organise les cadres des partis nationaux ; exclue les leaders dont la politique ne lui semble pas conforme à l’intérêt du parti. C’est à lui qu’en appellent en dernier ressort les leaders exclus par leur parti national. Le parti national n’est qu’une section de l’Internationale Communiste.
Parti communiste russe. — Le parti communiste russe a été fondé en 1903 à la suite d’un Congrès national du parti social démocrate. Les minoritaires se groupèrent à part et prirent le nom des mencheviks, c’étaient les moins avancés ; ils correspondaient à peu près au parti socialiste de France. Les majoritaires formèrent le parti bolchevick de (bolche) plus. Ils formaient la gauche du parti.
Avant la guerre le parti communiste était peu nombreux. Son organisation était entièrement clandestine. Ses chefs, Lénine, Zénoviev, etc., vivaient surtout à Londres, Genève, Paris. Ils parvenaient à fonder des petits journaux tels l’Iskra (L’Etincelle), qu’ils envoyaient secrètement en Russie.
Contrairement au parti socialiste révolutionnaire, le parti bolchevick n’admettait pas la propagande par les actes individuels de terrorisme, c’est pourquoi il semblait, avant la révolution, un parti modéré. Mais il n’en est rien, malgré la violence de leurs moyens, les socialistes révolutionnaires russes ne sont guère plus que des républicains démocrates.
Lorsque les Bolcheviks eurent conquis le pouvoir, le parti communiste devint naturellement nombreux et fort : 600.000 membres en 1921. Les dirigeants pensèrent même que le parti était trop nombreux, ils soupçonnèrent une fraction de ses membres de n’y être entrés que par intérêt. Ils se livrèrent donc à des épurations et réduisirent les effectifs à environ 300.000. De semblables opérations ont lieu de temps à autre et l’entrée dans le parti communise russe est difficile. Il faut en général avoir un passé, pouvoir prouver qu’on a travaillé à la préparation de la révolution, être allé en prison sous le régime tsariste, etc...
Les jeunes gens qui ne peuvent encore avoir de passé entrent aux Jeunesses Communistes.
Les femmes ont une organisation spéciale avec Comité central. Mme Kollontaï a été longtemps la secrétaire générale de cette organisation. Elle l’a quittée pour devenir ambassadrice.
L’organisation des femmes a été instituée pour faciliter la propagande auprès des ouvrières et des paysannes qu’il s’agit avant tout de ne pas rendre hostiles au nouvel ordre de choses. Néanmoins les femmes indépendamment de leurs groupes spéciaux peuvent, aux mêmes conditions que les hommes, entrer dans le parti proprement dit.
L’unité de groupement du parti communiste est la cellule. Elle groupe les ouvriers d’un atelier, d’une usine, les employés d’un restaurant ou d’un magasin.
Après la cellule vient le rayon qui comprend un certain nombre de cellules d’une mëme région. Au-dessus sont les organisations centrales.
Les Congrès ont lieu assez souvent ; néanmoins l’autorité vient d’en haut et non de la masse des militants. Les leaders du parti communiste sont de véritables chets ; ils élaborent les thèses qui règlent la propagande et on les impose au nom de la discipline du parti.
Parti Communiste français. — Fondé au Congrès de Tours, en 1920, où s’est effectuée la scission du parti socialiste. La droite composée surtout des leaders, des parlementaires et des intellectuels, a continué l’ancien parti socialiste ; la gauche qui formait la majorité du Congrès, s’est constituée en parti communiste, section française de l’internationale communiste : S. F. I. C.
Cachin et Frossard, rapportaient de Moscou les 28 conditions d’admission du parti socialiste français dans le parti communiste. Ces conditions visaient à débarrasser le parti du réformisme électoraliste et à en faire un parti d’opposition violente qui préparerait la révolution sociale.
Outre les sections on prévit la constitution d’organisations illégales où seraient dressés des militants prêts au besoin à l’action violente. Un appareil de propagande clandestine dans l’armée était aussi en projet.
Aux vingt et une conditions, on en ajouta une vingtdeuxième par laquelle les adhérents s’engageaient soit à ne pas entrer dans la franc-maçonnerie, soit, s’ils en faisaient déjà partie, à en donner leur démission.
Le parti communiste russe considère en effet la franc-maçonnerie comme une société où se pratique la collaboration des classes et susceptible de détourner le prolétariat de la révolution.
Beaucoup de militants n’avaient pas adhéré sincèrement aux conditions de Moscou. Vieux politiques pour la plupart, habitués des Congrès, des Conseils nationaux, etc., ils espéraient qu’il en serait des vingt et une conditions comme de tant d’autres résolutions ; qu’on les oublierait vite et que le parti communiste pourrait continuer la politique de réformisme et de parlementarisme qu’il pratiquait avant la guerre sous le nom de parti socialiste...
Moscou ne l’entendait pas ainsi. La révolution russe, pour réussir, avait besoin de la révolution mondiale, il fallait donc à tout prix sortir les partis communistes des ornières politiciennes dans lesquelles ils avaient tendance à revenir et en faire des organismes d’opposition révolutionnaire irréductibles aux gouvernements bourgeois.
Le parti russe fit donc savoir sans ambages qu’il entendait diriger les partis communistes du monde entier. La Russie avait la première fait la révolution communiste ; c’était donc à elle qu’il appartenait de commander. Le Komintern n’était plus commme le bureau International du parti socialiste un centre de rapprochement et d’informations, mais un organisme de direction. Les partis nationaux ne devaient plus être, non seulement de nom mais de fait que de simples sections de I’Internationale communiste.
Cette prétention de Moscou à la direction effective mécontenta une partie des militants du parti français et le mécontentement s’exprima d’une manière d’autant plus énergique qu’il était surtout le fait des dirigeants du parti ; Intellectuels, anciens ouvriers vieillis dans l’administration du parti. Ils arguaient que Moscou était trop loin pour donner des directives. Chaque parti national devait être juge de ce qu’il avait à faire, parce que, seul, il connaissait de manière suffisante la politique de son pays. On cria à la tyrannie, au couvent, à la caserne, etc...
En réalité ce que l’opposition voulait c’était ne pas aller trop à gauche. Elle entendait rester un parti politique et non devenir une organisation de combat. D’ailleurs, l’état d’effervescence des esprits lors des premières années de l’après-guerre s’était calmé partout. Les ouvriers qui avaient accouru en masse (cent mille adhérents) dans les sections communistes, ne reprenaient plus leur carte. L’immense espoir qui les avaient soulevés lors de la prise du pouvoir par les bolcheviks, s’était changé en découragement lorsqu’Ils avaient appris que le communisme n’avait pu, en dépit de la domination bolchevique, s’établir en Russie.
A la révolte des leaders français, Moscou répondit par des exclusions. La plupart des orateurs et des écrivains du parti furent exclus ou se retirèrent pour former des organisations dissidentes. Les cadres furent peuplés de nouveaux venus entrés au parti après la guerre, jeunes pour la plus grande part. Des russes suffisamment versés dans la langue française furent envoyés de Moscou pour occuper les fonctions dirigeantes du parti.
Cependant le Komintern comprit qu’il était allé trop loin et qu’il fallait battre en retraite. A l’intérieur cette retraite se caractérisa par la Nep (nouvelle politique économique) qui permettait l’industrie et le commerce privés. A l’extérieur elle se caractérisa par le front unique. Moscou ordonna aux partis communistes nationaux de se rapprocher des partis socialistes afin de pouvoir faire un front unique contre la bourgeoisie.
Cette politique n’eut pas de succès. Les chefs socialistes répondirent par le dédain aux propositions des chefs communistes esclaves de Moscou. Le mot d’ordre fut alors d’aller aux masses par-dessus les chefs ; mais les masses suivaient leurs chefs ; le parti communiste avec ses velléités de violences leur faisaient peur ; la Russie avait cessé de susciter les espoirs ; pour cette fois encore la révolution ne se ferait pas.
Le Congrès de Bolchévisation se tint à Lyon en 1924.
L’armature du parti fut démolie complètement et le parti français fut organisé à la manière du parti russe : cellules rayons, présidium, etc...
La section qui correspondait à l’arrondissement et était avant la représentation proportionnelle une unité électorale, fut remplacée par la cellule qui organise les ouvriers sur le lieu de leur travail. Les réunions au lieu de se faire le soir après le diner eurent lieu à la sortie de l’usine.
On développa les groupes de jeunesse ; les groupes de pupilles. Les femmes furent organisées à part et eurent un journal spécial, L’Ouvrière.
Le sport ouvrier eut pour mission d’attirer les jeunes gens par l’attrait des exercices de plein air. Le Secours Rouge se donna le but d’aider les militants mis en prison pour la cause communiste.
Enfin on établit des cartes de sympathisants, organisant ainsi une sorte d’anti-chambre du parti pour les personnes qui, tout en ayant l’idéal communiste, ne croyaient pas devoir s’engager dans les liens de la discipline du parti.
Toute cette organisation très bonne en théorie avait le défaut de manquer d’âme. Pour engager résolument le parti dans les voies, de la préparation de la révolution, Moscou avait dû exclure toute la droite réformiste. Mais il se trouva que cette droite était formée des hommes les plus intelligents et les plus instruits. On avait « découronné » (Longuet), le parti.
Or, les masses n’étaient pas assez intelligentes pour pouvoir suivre avec persévérance une idée sans des hommes qui l’incarnent. De ces hommes il y en avait bien encore, mais peu.
Les leaders avaient été remplacés par des fonctionnaires, qui, en exposant la doctrine du parti, faisaient avant tout un métier ; la personnalité leur manquait complètement.
Les cellules des grandes usines réussirent assez bien.
Mais nombre de petits ateliers ne pouvaient grouper dans la cellule que quelques camarades ; les séances manquaient de vitalité, ils cessèrent d’y venir et les effectifs du parti diminuèrent beaucoup (30.000). A plusieurs occasions (transfert des cendres de Jaurès au Panthéon, élections) le parti communiste s’est rapproché des autres partis, notamment pour mettre en échec la réaction fasciste.
On peut prévoir qu’un rapprochement plus accentué se fera. Peut-être reviendra-t-on sur la scission du Congrès de Tours pour réunir à nouveau le parti communiste au vieux parti socialiste.
— Doctoresse PELLETIER.
PARTI COMMUNISTE (BOLCHEVISATION DU)
Pour débarrasser définitivement le parti de ses tendances parlementaires et lui donner une attitude définitive d’opposition irréductible à tout gouvernement bourgeois, il fut décidé de consacrer le Congrès national de 1924 tenu à Lyon à la bolchevisation du parti.
La bolchevisation consista à organiser le parti français à la manière du parti russe.
La section n’était guère qu’un Comité électoral. C’était pendant les élections que se faisait le plus fort recrutement, et nombre d’adhérents qui prenaient leur carte à la faveur de l’agitation électorale, cessaient ensuite de donner signe de vie. Les sections des circonscriptions où le parti avait un élu étaient toujours les plus nombreuses. Nombre de gens y adhéraient sans être nullement communistes, pour le seul avantage de coudoyer un député ou un conseiller municipal dont ils escomptaient des faveurs éventuelles.
A vrai dire le remplacement du scrutin d’arrondissement par la représentation proportionnelle et de l’arrondissement parisien par le secteur, avait modifié cet état de choses très sensiblement.
La cellule greffée sur une usine comme un ver rongeur, représentait bien l’opposition irréductible. Le groupe était non plus politique mais de subversion sociale. Dans l’atelier la cellule représentait la révolution et non plus l’élément d’une vague opposition parlementaire.
En entrant dans le parti on ne faisait plus seulement que payer une cotisation et prendre une carte rouge, on avait des devoirs. Devoir de prendre part aux manifestations, devoir de distribuer des tracts, d’amener au parti de nouveaux adhérents, etc... Le secrétaire de cellule, le délégué du rayon, n’étaient plus des mandataires toujours en coquetterie avec leurs mandants, c’était des chefs, il fallait leur obéir.
L’épithète de caserne détachée par les dissidents était un peu justifiée. Le parti bolchévisé prenait de la caserne la brutalité et aussi l’indifférence. L’idéal n’apparaissait plus, masqué par le fonctionnarisme et l’esprit de coterie. Si on avait marché à la révolution, on aurait passé sur tous ces frottements inhérents à toute collectivité, mais la révolution ne se faisait pas.
La bolchevisation, à l’usage, fit voir ses inconvénients.
De nombreux camarades que leur genre d’occupation ne permettait pas d’incorporer à une cellule furent rattachés à une cellule composée de camarades de profession différente. Dans certaines cellules, le nombre des rattachés était plus grand que celui des membres réguliers, ce qui faisait que la cellule perdait son caractère d’organisation de combat à l’usine. On créa donc des cellules de un ou de groupes de maisons, c’était revenir à la section.
— Doctoresse PELLETIER.
COMPAGNON
n. m. (Du latin Cum avec et panis pain)
Étymologiquement le mot « compagnon » veut donc dire qui mange du même pain ou qui partage son pain avec un autre. Mais la valeur du mot s’est sensiblement étendue et à présent il sert à designer une personne avec laquelle on est en relation assez fréquente sans, pour cela, être liés par l’amitié. « Un compagnon de travail, un compagnon de chantier ou de bureau ». On dit aussi un bon compagnon et un mauvais compagnon. Dans certaines corporations et plus particulièrement dans l’industrie du bâtiment, le mot compagnon, sert à désigner un ouvrier accompli ; l’apprenti prend le nom de « aide ». On dit un ouvrier tourneur et un compagnon maçon. Depuis le XIIIe siècle jusqu’à là révolution française, le compagnon était un ouvrier qui avait accompli un stage de plusieurs années chez un maître en tant qu’apprenti et qui avait justifié ses capacités par la production d’un chef-d’œuvre. C’était parfois cinq et même dix ans qu’il fallait travailler gratuitement pour obtenir le droit de se dire « compagnon ».
La révolution française a aboli le compagnonnage et a donné au travail une certaine liberté ; chacun aujourd’hui peut exercer un métier manuel sans être muni de brevets ou de diplômes attestant ses connaissances. Il n’y a que dans certains métiers d’ordre intellectuel que subsiste une certaine forme de compagnonnage. En exemple on pourrait donner la médecine, la pharmacie, le droit, etc. Tous ces métiers sont considérés comme étant exercés par une élite, appartenant naturellement à la bourgeoisie, et ces corporations sont pour ainsi dire fermées à la classe ouvrière.
Le mot compagnon s’emploie aussi comme synonyme de mari, d’époux. Ces deux derniers mots ont un caractère trop officiel et symbolise tellement l’autorité qu’en vertu de la loi l’homme a le droit d’exercer sur la femme, que dans certains groupements et par un grand nombre d’individus ils ont été totalement abandonnés. On ne dit plus ma femme ou mon épouse, mais ma compagne et mon compagnon. Il est évident qu’il ne suffit pas de changer le mot pour changer la chose et le véritable compagnon ne doit pas l’être seulement dans la lettre, mais aussi dans l’esprit. Il doit considérer sa compagne comme un individu qui a droit aux mêmes libertés que lui, qui est sensible aux mêmes émotions, et qui possède une personnalité propre qui ne doit pas être subordonnée à celle d’autrui. Un véritable compagnon doit être jaloux de sa liberté, mais il doit savoir respecter celle des autres.
COMPARAISON
n. f.
Action de marquer la ressemblance ou la différence qui existe entre deux choses. Qu’est-ce que comparer ? « C’est observer, dit Pierre Leroux, alternativement et avec attention l’Impression différente que font sur moi deux objets présents ou absents ». Cette observation faite, je juge, c’est-à-dire je rapporte exactement l’impression que j’aie reçue. Toute assertion sur le rapport des objets entre eux suppose comparaison de ces objets. La comparaison ne consiste pas essentiellement dans l’attention donnée à deux idées, ni dans la perception de l’idée de rapport qui la suit ; elle consiste dans le rapprochement des idées avec l’intention de saisir un rapport... Sans comparaison, pas de jugement. C’est donc une des facultés plus importantes de l’esprit humain, un des objets les plus intéressants que doive étudier la psychologie ».
Savoir comparer est donc une grande qualité. La comparaison nous permet d’acquérir une quantité de connaissances, et de nous éclairer sur le vif à la lumière des faits. C’est en comparant la richesse des uns et la misère des autres que l’on arrive à cette conclusion qu’il y a un vice de forme dans les sociétés modernes. C’est en la comparant à la tyrannie que l’on aime la liberté, et c’est en rapprochant chaque chose et en établissant la différence, bonne ou mauvaise, qui existent entre elles que l’on arrive à se faire une conception.
Celui qui n’a jamais étudié, qui n’a jamais cherché à connaître et à savoir, qui accepte comme des paroles d’évangile tout ce que lui raconte un personnage qu’il considère comme supérieur ; celui qui ne veut pas se donner la peine de regarder par lui-même et de comparer, est un être borné et étroit sur lequel on ne peut compter en aucune occasion. Ce qui singularise l’individu, ce qui lui donne une personnalité, c’est sa faculté de comparaison, et celui qui en est dénué ne sera jamais qu’un mouton qui légitimera le berger. Ils sont nombreux, hélas ! ceux qui, ne veulent pas comparer, et sans doute ne comprennent-ils pas qu’ils sont les meilleurs piliers de la société capitaliste. C’est un long travail qu’ont entrepris les Anarchistes d’ouvrir les yeux aux aveugles pour leur montrer ce qu’ils veulent pas voir ; mais chaque jour, un peu plus, la lumière pénètre dans les cerveaux et plus profonde aura été l’obscurité, plus violente sera la révolte lorsque le peuple enfin éveillé comparera son sort à celui de ses maitres.
COMPARSE
n. m.
Individu participant à une action, mais n’y figurant qu’au second plan. Autrefois, on donnait ce nom aux personnages qui figuraient dans les quadrilles ou dans les représentations théâtrales sans avoir à chanter ou à parler. Aujourd’hui, on désigne ces personnages par le mot « figurants », et l’on prête au mot « comparse » un sens plutôt péjoratif. « Cet escroc a des comparses. Ce criminel n’a pas agi tout seul, il fut aidé par des comparses. »
COMPATIR
v. n. (de cum, avec et pati, souffrir)
Avoir pitié des douleurs d’un autre ; être touché par les misères et les malheurs d’autrui sans y être directement intéressé. « S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit un retour vers nous-mêmes qui nous met en la place des malheureux, pourquoi tirent-ils de nous si peu de soulagement dans leurs misère ? » (La Bruyère). La compassion est peut-être un sentiment qui honore celui qui en est animé ; mais elle ne peut en rien soulager la misère collective, la misère en soi, qui a d’autres causes que la méchanceté des hommes. On peut la mettre, la classer dans le même ordre d’idées que la philanthropie et la charité qui, du reste, prennent leur source dans la compassion.
Compatir aux misères d’autrui est donc inutile ; ce qu’il faut, c’est en rechercher les causes et les détruire.
Il y a quantité de gens qui compatissent à la souffrance du peuple et qui se montrent affligés de la situation précaire qui lui est faite. Les cœurs compatissants soulagent quelques malheureux auxquels ils s’intéressent plus particulièrement ; cela change-t-il quelque chose ? Non, absolument rien. À une misère succèdent d’autres misères et aux malheureux d’autres malheureux. On est compatissant par instinct et non par raison, et on se laisse guider par ses sentiments sans se rendre compte que notre sentimentalité nous entraine à commettre des gestes et des actes qui perpétuent un état de choses qui aurait dû disparaître depuis longtemps.
COMPERE
n. m. (du latin cum, avec et pater, père)
Se dit d’un individu qui, d’intelligence avec un autre, le seconde pour commettre une mauvaise action ou pour tromper. Dans le langage populaire on appelle ainsi celui qui, « jouant » le client empressé, entraîne le public à acheter la marchandise présentée sur la place ou sur le marché par un camelot. Ces compères là ne sont pas dangereux, leur « tromperie » est bien inoffensive. Il n’en est pas de même des compères qui opèrent dans les rangs de la diplomatie et de la politique, et leurs arrangements déchaînent parfois des catastrophes. C’est à Poincaré, aide dans sa sinistre besogne par Iswolsky, son compère, qu’incombe une grande part de responsabilité dans la guerre de 1914. Ces deux « compères », secondés dans leur crime par un troisième filou du nom de Delcassé, ont sur la conscience la mort de millions d’innocentes victimes. « En fait de gouvernement, il faut des compères ; sans cela la pièce ne s’achèverait pas. » Napoléon Ier, l’empereur tragique devait en savoir quelque chose.
Grammaticalement « compère » fait au féminin « commère » ; mais ce mot n’est pas employé dans le même sens et a une tout autre signification.
COMPETENCE
n. f.
Au sens juridique, la compétence est la mesure du pouvoir de juger un délit ou un crime. « Ce tribunal n’est pas « compétent » pour cette affaire », c’est-à-dire qu’il n’est pas qualifié pour entendre la cause qui lui est soumise. Au sens général, la compétence est la connaissance, le savoir qui donne à un individu le droit de traiter certaines matières. « Cet homme a une compétence remarquable en astronomie ; mais il n’est pas « compétent » pour traiter des questions sociales. »
Il y a quantité de gens qui parlent de choses et d’autres, qui traitent de sujets dont ils ignorent totalement la valeur et la portée. C’est le désir de paraître qui les fait agir ainsi. Aux yeux des ignorants, ils peuvent exercer une certaine influence pendant quelque temps ; mais leur « incompétence » éclate bien vite, et ils se dégonflent comme des baudruches lorsque l’on soumet leurs démonstrations à l’analyse. Il est donc utile d’être « compétent » en une matière quand on veut en causer sans paraître ridicule.
COMPETITION
n. f.
Concurrence de plusieurs individus qui désirent le même objet ou qui poursuivent le même emploi ou la même charge. La compétition crée la rivalité entre individus, et cela se comprend. Lorsqu’il n’y a qu’une place à prendre et qu’il se trouve dix personnes sur les rangs pour l’obtenir, lorsque l’on aspire aux honneurs, aux dignités et que l’on constate que d’autres aussi prétendent aux mêmes avantages, on les considère comme des adversaires, et de là à employer des procédés d’une moralité douteuse pour arriver à ses fins, il n’y a qu’un pas.
La compétition est une des conséquences de l’inégalité sociale ; dans une société, où tous les individus seront libres et égaux et où les privilèges de toute sorte auront disparu, il n’y aura pas de compétition, et la haine et la jalousie, ainsi que la rivalité entre les humains, auront vécu.
COMPILATION
n. f.
Action de rechercher dans les ouvrages de divers auteurs, les parties que l’on juge intéressantes à une démonstration et en former un recueil. La compilation est une science ingrate, qui fut attaquée par bon nombre de grands penseurs ou écrivains. Montesquieu, par exemple, fut loin d’être tendre pour les compilateurs ; voilà ce qu’il en pensait : « De tous les auteurs, il n’en est pas que je méprise plus que les compilateurs, qui vont de tous côtés chercher des lambeaux des ouvrages des autres, qu’ils plaquent dans les leurs comme des pièces de gazon dans un parterre ; ils ne sont point au-dessus de ces ouvriers d’imprimerie qui rangent des caractères, qui, combinés ensemble, font un livre, où ils n’ont fourni que la main. » Montesquieu est injuste, et il semblerait que le mot « plagiaire » n’existait pas de son époque.
Ne commettons pas la même erreur, et ne confondons pas le plagiaire et le compilateur ; le premier est méprisable, car il cherche à profiter personnellement du labeur d’autrui ; tandis que le compilateur est utile, puisque, modestement, il recherche ce qui peut être intéressant dans les ouvrages des autres pour en faire profiter la collectivité.
À mesure que nous avançons dans le temps, le bagage des civilisations s’augmente, et il arrivera fatalement un jour où il sera impossible à l’intelligence humaine d’englober dans son ensemble tout l’héritage du passé. Il est donc indispensable de retrancher de la bibliothèque humaine tout ce qui ne présente qu’un intérêt secondaire et de ne conserver que ce qui représente un intérêt général. C’est en cela que consiste le travail de compilation intéressante et féconde. Évidemment, il faut que la compilation se fasse consciencieusement, et que le compilateur ne s’arrête pas à des fadaises. Sans la compilation, bien des auteurs, des philosophes et des scientistes n’auraient pu ériger leurs œuvres, et c’est avec raison que Lachatre fait remarquer que Montesquieu lui-même n’aurait pu traiter de l’Esprit des Lois sans la « compilation » des vieux codes.
COMPLAISANCE
n. f.
Qualité qui consiste à rendre service et à sacrifier un peu de soi même au bénéfice d’autrui. La complaisance ne doit jamais être intéressée, et il ne faut pas attendre en retour de la reconnaissance. On doit trouver dans la complaisance la satisfaction de son geste ou de son acte, et il est préférable qu’il en soit ainsi, car il est certaines personnes qui abusent de la « complaisance » d’autrui. Quoi qu’il en soit, une personne complaisante est ordinairement d’un commerce facile, et si cette vertu était un peu plus répandue nous assisterions un peu moins aux déchirements des individus.
COMPLEXITE
n. f.
Se dit de ce qui est « complexe », en opposition à ce qui est « simple ». Un nombre complexe est un nombre composé d’unités de diverses valeur ; exemple : 8 mètres 7 décimètres 5 centimètres. Ce n’est pas seulement dans ce sens arithmétique que ce mot est employé, et l’on s’en sert couramment pour qualifier un individu, un objet ou une idée. Dans ce sens, il a une signification différente et est presque synonyme de « compliqué ». La complexité d’une idée, c’est-à-dire son état, consécutif à la combinaison d’autres idées, est une source de malentendus. Il faut, pour être comprise par tous, qu’une idée soit claire, simple et non pas complexe. On dit aussi qu’un individu a un caractère complexe, c’est-à-dire incompréhensible.
COMPLICITE
n. f.
Action de participer à un acte commis par un autre. Au sens légal, la complicité implique la participation à un crime ou à un délit défendu, et puni par la police ; ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de complicité et de crimes en dehors de ceux prévus par la loi. Les déchaîneurs de guerre sont honorés et glorifiés, cependant que, de complicité avec les représentants de la ploutocratie, ils commettent les plus horribles crimes à enregistrer par l’histoire ; les policiers et les soldats qui chargent le peuple sont les complices inconscients de la bourgeoisie, et les magistrats qui jugent et condamnent tous ceux qui se révoltent contre l’ordre établi, agissent de complicité avec les représentants les plus autorisés du Capitalisme.
Il est aussi des complicités morales plus difficiles à déterminer au point de vue social comme au point de vue légal. Pourtant nous avons vu que des révolutionnaires furent condamnés pour « complicité morale », et il y a quelques années, afin d’écraser un mouvement de grève, la justice française, au Havre, n’hésita pas à condamner à mort un secrétaire de syndicat auquel on reprochait sa responsabilité morale à propos d’un incident de grève dans lequel on ne pouvait pas l’impliquer de « complicité effective ». Grâce à la protestation énergique de la classe ouvrière, le malheureux ne fut pas exécuté, mais il devint fou, et on peut dire que toute la bourgeoisie est « complice » de ce crime.
Si dans le grand crime social qui se commet chaque jour, les maîtres ne trouvaient pas de complicités dans la classe des esclaves et des exploités, il y a longtemps que les hommes auraient brisé leurs chaînes et vivraient en liberté.
COMPLOT
n. m.
S’entendre en secret avec une ou plusieurs personnes, dans le but de transformer l’organisation sociale ou politique d’un État, de changer brutalement de gouvernement en employant d’autres moyens que ceux autorisés par les lois constitutionnelles, de nuire ou d’attenter à la vie d’un monarque, d’un chef de gouvernement, etc., etc...
D’après Lachatre, le complot est « l’ensemble des voies illégales radicalement suivies pour renverser un gouvernement » ; et Lachatre ajoute : « Quand les conspirateurs réussissent dans leur projet, le crime change de nom, le “complot” devient une révolution ; quand ils ne réussissent pas, ils sont punis de mort. Telle est la moralité humaine ».
Le complot est un délit condamné dans tous les États ; car, quelles que soient les raisons politiques ou sociales qui animent les comploteurs, c’est généralement contre ceux qui détiennent les pouvoirs ou contre des membres influents et représentatifs qu’il est organisé.
Ce serait une erreur de penser que, du fait que les conspirateurs luttent et complotent contre une forme de gouvernement, ils soient déterminés dans leurs actes par un désir de bien-être collectif. La plupart des complots sont d’essence politique, et ceux qui les organisent ne sont conduits que par l’ambition de prendre le gouvernail de la chose publique et de remplacer au Pouvoir ceux qu’ils en auront chassés par la violence. Tel est le cas pour les complots organisés dans certains pays par les monarchistes pour renverser la République, et vice versa. Il est bien entendu que ces gestes de violence politique ne peuvent en rien intéresser les classes opprimées, sinon que dans la mesure où les troubles occasionnés par le Coup d’État consécutif au complot lui permettent, à la faveur des désordres, de créer un courant d’opinions déterminant non pas un changement de gouvernement, mais une transformation totale de l’ordre social établi.
S’il est des complots qui apeurent particulièrement la bourgeoisie, ce ‘sont ceux que l’on prête, à tort ou à raison, aux organisations d’avant-garde. Cela. se conçoit, car si les détenteurs de la richesse sociale savent qu’ils n’ont rien à craindre du changement éventuel de certaines personnalités, dans la direction d’un État, par contre ils sont convaincus qu’une révolution sociale triomphante les dépossédera des privilèges qu’ils détiennent arbitrairement au détriment de la collectivité.
Nous avons vu, et nous voyons encore chaque jour, qu’en Italie, en Espagne, en Pologne, en Bulgarie, etc., etc ... pays continuellement en effervescence, ou les politiciens de toutes couleurs se font une guerre acharnée et complotent à tour de rôle, les uns contre les autres, pour la conquête de l’assiette-au-beurre ; la bourgeoisie s’adapte avec une facilité remarquable et accepte d’être gouvernée par n’importe quel aventurier, à condition, cependant, que celui-ci respecte la propriété privée et ne s’attaque pas à la fortune particulière ; et, malgré les petits ennuis provoqués par sa quiétude momentanément troublée, elle ne proteste jamais avec vigueur contre les coups d’État et les complots organisés par les hommes issus de sa classe.
Mais, sitôt que l’on signale un « complot » contre le Capitalisme, ou simplement contre un monarque assassin ayant à son actif des centaines et des centaines de crimes, alors une frayeur sans pareille s’empare de tous les petits boutiquiers, des commerçants, des fonctionnaires, des petits rentiers, de toute cette organisation occulte et bassement égoïste, qui est la puissance formidable sur laquelle spécule l’association de malfaiteurs que l’on nomme « Gouvernement ». Il n’est pas de châtiments assez cruels que l’on ne réclame pour se venger de la terreur que l’on a éprouvée, et ce n’est que lorsque les comploteurs ont été mis dans l’impossibilité de « nuire » que la petite bourgeoisie, conservatrice et réactionnaire, reprend le cours normal de sa vie.
Pourtant, dans les pays où la liberté la plus élémentaires est férocement brimée, où il est impossible aux travailleurs de s’exprimer par l’organe de la presse, où le droit de réunion est interdit, où la dictature règne en maîtresse ; partout où tous les autres moyens se sont manifestés inopérants et où il est indispensable que la Révolution vienne, de son souffle énergique et puissant, balayer l’air pour en chasser les miasmes du despotisme, on ne voit pas quels autres procédés que le « complot », signe avant-courreur des révoltes fécondes, peuvent être employés.
La lutte en plein jour, face à face avec l’adversaire, peut encore se concevoir lorsque l’un d’eux use mais n’abuse pas de sa force, et n’écrase pas l’autre par la violence de son autorité. Et puis, la loyauté n’a jamais été le péché du capitalisme ; nous savons trop ses mensonges pour nous laisser prendre à son cruel sentimentalisme et réprouver le complot comme n’étant pas digne d’hommes sincères et courageux. Lorsque, poussée dans ses retranchements, tremblante de payer pour les crimes accumulés depuis des siècles et des siècles, la bourgeoisie terrifiée dépasse les bornes, étouffe et réprime outrageusement toute protestation émanant des classes opprimées, seule l’organisation secrète peut être efficace, seul le complot peut réveiller le peuple asservi et lui montrer la route de la libération.
Et c’est ce qui explique que les complots s’organisent surtout dans les pays où d’autres formes de lutte sont absolument impossibles.
D’autre part le complot est une arme dont savent à merveille se servir la bourgeoisie et les classes dirigeantes pour écarter de leur route les hommes trop gênants, et longtemps on se souviendra du complot ourdi par le dictateur italien Mussolini, et dont fut victime le député socialiste Matteotti, qui paya de sa vie sa sincérité et son courage. C’est la loi du Talion, brutale et féroce dans sa simplicité ; la bourgeoisie s’est la première servie du « complot », elle en sera victime à son tour. De quoi se plaint-elle ?
La France n’est pas le pays du complot, et les actes commis à diverses époques de l’histoire révolutionnaire moderne sont l’œuvre d’individualités courageuses qui surent se sacrifier pour une cause ou pour une idée qu’ils considéraient noble et belle ; mais les divers gouvernements qui se sont succédés depuis une trentaine d’années ont toujours, lorsque leur prestige était menacé ou que les difficultés quotidiennes de la vie faisaient gronder la voie du populaire, cherché à se débarrasser des dirigeants du mouvement révolutionnaire, en les impliquant dans d’imaginaires « « complots contre la sûreté de l’État ».
On se rendra compte des intentions bienveillantes des gouvernants, lorsque l’on saura que les complots politiques, en France, peuvent être punis de la déportation à vie dans une enceinte fortifiée.
Malheureusement .pour nos maîtres, ces genres de délit sont de la compétence de la Cour d’assises, où il faut quand même dans une certaine mesure compter avec les jurés qui ne sont pas des magistrats professionnels au service du gouvernement et qui ne sont pas aveuglés et corrompus par leurs fonctions. Les gouvernants ne furent donc jamais bien heureux dans leurs tentatives. D’autre part, comme ces complots n’ont jamais existé que dans les cerveaux atrophiés de ministres en mal de répression, il faut leur donner un semblant de vie, et c’est la police secrète qui est chargée de fournir les premiers documents indispensables à l’action judiciaire. Or, personne n’ignore l’intelligence et la sagacité de la police ; celle-ci ne s’embarrasse pas de préjugés et d’honnêteté sentimentale. Il faut des preuves, des documents. Elle les trouvera, et si elle ne les trouve pas, elle les fabrique ; mais elle les fabrique avec une telle grossièreté, qu’à la première analyse, le juge le plus obtus et le plus attaché par ses fonctions à rechercher les sympathies gouvernementales, est obligé d’avouer le faux et de classer l’affaire. C’est ainsi qu’en France se terminent certains complots contre la sûreté de l’État.
Ces supposés complots offrent pourtant certaines satisfactions aux maîtres de l’heure ; c’est de tenir emprisonnés pendant des mois et des mois les militants les plus actifs de la classe ouvrière ; c’est un résultat appréciable dont se contentent probablement nos gouvernants.
À côté de cette comédie — qui serait plutôt une tragédie — il y a la réaction toujours plus arrogante, il y a les monarchistes qui complotent ouvertement contre l’État républicain. Et la République se tait, ce qui démontre suffisamment que République, Réaction, Monarchie, sont trois têtes sous le même bonnet, et que ces trois têtes n’ont qu’un corps : le Capitalisme. Et pour détruire cet animal tricéphale, lorsqu’il deviendra trop dangereux et qu’il voudra encore rogner sur les libertés acquises par des siècles de privations et de lutte, il n’y aura qu’un moyen pour déchaîner et organiser la révolte des opprimés : « Le complot ».
— J. CHAZOFF.
COMPREHENSION
n. f.
Faculté de comprendre, de concevoir. Cette faculté n’est pas donnée à tout le monde, et il est quantité d’idées pourtant bien simples qui restent incomprises de ceux à qui elles s’adressent, parce que ceux-ci n’ont pas la « compréhension » aisée, facile. La faculté de comprendre rapidement n’est pas seulement une qualité qui offre à celui qui la possède une source de satisfactions et de joies, mais au point de vue social, c’est une arme sérieuse. Si les hommes avaient la compréhension de ce qu’est leur force, ils ne resteraient pas courbés sous le joug de l’exploitation et se refuseraient plus longtemps à être des esclaves.
COMPRESSION
n. f.
Physiquement : action de comprimer, de réduire un corps et d’amoindrir son volume sans lui enlever de sa force, de sa valeur ou de sa qualité. Les corps gazeux sont les plus compressibles. « Toute compression dégage du calorique. On remarqua qu’une masse d’air comprimé douze fois par un coup violent développe une chaleur capable d’allumer toute matière combustible. »
La compression offre un intérêt remarquable au point de vue scientifique, et des progrès énormes ont été appliqués, particulièrement en mécanique, grâce aux découvertes des savants.
La « compression », au sens politique, produit des effets diamétralement opposés. Elle encercle dans des limites étroites les libertés chèrement acquises ; elle interdit de se réunir, d’écrire, de parler ; en un mot, elle comprime tout ce qui fait de l’individu autre chose qu’un animal ou une plante. Si en physique la compression provoque l’explosion, il en est de même au sens moral et politique, et le despotisme, c’est-à-dire la compression poussée à son maximum, provoque la révolte et les révolutions. Mais ce sont là des lois que la bourgeoisie veut ignorer. Elle n’y échappera pourtant pas.
COMPROMISSION
n. f.
Se compromettre, c’est à dire entrer dans une affaire, dans une organisation, dans un parti ; participer à une action et s’y mêler de manière à se créer des embarras susceptibles de menacer sa réputation.
La compromission est donc l’action de se compromettre. Les compromissions sont nombreuses, surtout dans le monde politique étroitement lié au monde financier et industriel, qui trouve dans les « représentants » du peuple des agents qualifiés pour soutenir, moyennant salaires, ses intérêts dans les parlements.
Les compromissions de certains ministres ou hommes d’État, dans certaines affaires véreuses, ont parfois soulevé des scandales, et nous ont dévoilé les dessous de la politique. Il est peu de parlementaires, quelle que soit leur situation de fortune, qui se refusent à certaines compromissions pour toucher les scandaleux « pots-de-vin » que leur offrent les gros spéculateurs et les gros industriels à la recherche de contrats avantageux et de commandes importantes.
Mais les scandales n’ont pas arrêté les exploits de toute cette canaille qui ne cherche qu’à s’enrichir, pour qui le mandat politique arraché à la naïveté populaire n’est qu’une source de revenus et qui considère que la compromission n’est indélicate que dans la mesure où elle est dévoilée, puisque la fin justifié les moyens.
CONCEPT
n. m. (du latin : conceptus, conçu.)
Si physiologiquement la « conception » est l’action de donner la vie à un être ; philosophiquement, le « concept » est la résultante de la « conception » intellectuelle. Pris dans son sens absolu, le « concept » est une abstraction, c’est-à-dire qu’il se détache de tout ce qui peut être substantiel, pour n’être qu’une opération de l’esprit (voir abstraction). Ce mot est peu employé dans le langage courant du peuple ; toutefois, dans les milieux d’avant-garde, on s’en sert parfois au pluriel « les concepts », en en faisant le synonyme de « conception ». Le terme a cependant une toute autre signification, et il serait préférable de s’abstenir d’en user, à moins de lui donner sa valeur propre et de le ranger à sa place dans le domaine de la philosophie.
CONCESSION
n. f. (du latin : concedere.)
Accorder un privilège ; faire don à quelqu’un de propriétés, de territoires, etc, etc...
Commercialement, administrativement, gouvernementalement, la « concession », est le pouvoir accordé à une personne ou à une société d’exploiter, durant un temps déterminé ou indéterminé, un domaine qui ne lui appartient pas. Naturellement, ce sont toujours les mêmes qui profitent des concessions.
Les domaines d’État, les grandes administrations, les exploitations coloniales, sont d’ordinaire cédés à des concessionnaires qui en tirent d’énormes bénéfices, et bien souvent sans avoir même risqué le moindre capital dans l’entreprise qui leur a été concédée. Les chemins de fer, les mines ne sont que des concessions accordées par l’État à certains syndicats de financiers et d’industriels. Le public ne tire aucun profit de toutes ces concessions. Une seule et unique concession est accordée au peuple par les gouvernants : c’est celle de pouvoir pourrir et se décomposer après sa mort dans un domaine de l’État, le cimetière. C’est ce que l’on appelle une « concession gratuite ».
En rhétorique, la concession consiste à abandonner à un adversaire une partie de la discussion et reconnaître la valeur de certains de ses arguments. « Je vous fais cette concession que la République fut, à ses origines, acclamée par le peuple ; c’est qu’il en ignorait les rouages. » Faire des concessions à un adversaire politique, c’est dans une certaine mesure abandonner le terrain, mais lorsque ces concessions sont loyales et sincères, elles n’entachent pas l’honorabilité et la moralité de celui qui les fait. Il en est autrement lorsqu’un individu se désiste de ses opinions dans un but intéressé. Dans ce cas, la « concession » est blâmable, et l’on ne peut que mépriser celui qui l’accorde.
CONCEVOIR
v. a. (du latin : concipere)
Donner naissance à un être ; se dit en parlant des femmes et des animaux. « Concevoir dans la douleur ; à partir d’un certain âge, la femme ne peut plus concevoir. »
Dans un autre sens : comprendre facilement ; imaginer. « Concevoir un projet ; concevoir du mépris, de l’amour. » Une condition essentielle pour bien concevoir, c’est de se présenter toujours les choses sous les rapports qui leur sont propres (Condillac).
CONCILE
n. m. (du latin : concilium, assemblée.)
Assemblée régulière d’évêques et de docteurs en théologie pour décider des questions de dogme et de discipline. Il y a trois catégories de conciles : les œcuméniques, qui sont présidés par le pape ou par les légats, et auxquels prennent part les évêques catholiques de toutes les nations ; les nationaux et les provinciaux, qui ne réunissent que les représentants ecclésiastiques d’une nation ou d’une province.
Les décisions des évêques, réunis en concile, sont considérées comme émanant de l’Esprit Saint, et c’est ce qui explique cette formule : « Il a semblé bon au Saint Esprit et à nous... » (Actes des Apôtres, XV, 28).
Les plus importants des conciles se sont tenus entre le IVème et le XVIème siècles et l’influence qu’ils exercèrent fut considérable. C’est en 325 au Concile de Nicée que fut définitivement proclamée la divinité de Jésus Christ. À cette assemblée, Arius, Prêtre d’Alexandrie soutenait contre les théologiens les plus réputés de son époque que le Christ n’était pas Dieu et qu’il n’avait pas toujours existé ; son principal adversaire Saint Athanase soutint la thèse contraire et sortit victorieux. Arius fut solennellement excommunié et c’est sur la dispute de quelques philosophes que, depuis seize siècles, repose la divinité du Christ. Depuis 1549 il ne s’est pas tenu de concile international et il semble que cette attitude de l’Église soit due aux progrès constants de la science auxquels il est difficile d’opposer les lois ridicules et obscures du fanatisme religieux.
L’absence de conciles est un signe des temps et marque un recul de l’Église ; de toute évidence la foi disparait et si les peuples acceptent encore de se courber devant les lois civiles, ils se refusent à la discipline ecclésiastique et ne respectent nullement les règles du droit canon.
Les conciles n’ont donc plus aucune utilité puisque dans le passé on pouvait les considérer comme les États Généraux de l’Église ; et qu’aujourd’hui celle-ci aime mieux s’abstenir de les convoquer que d’avouer ouvertement son impuissance à faire respecter leurs décisions.
CONCILIATION
n. f.
Action de rapprocher des personnes séparées par des opinions ou des intérêts différents. « On fait toujours une sottise en rejetant les moyens de conciliation » déclare Rivarol ; cette affirmation est un peu osée. S’il ne faut pas s’obstiner à repousser, lorsque cela est possible, les tentatives d’accord, il est des cas où la conciliation est une concession qui amoindrit l’une des parties.
Lorsque l’on a raison et qu’un adversaire est de mauvaise foi, il est ridicule de vouloir concilier le vice avec la vertu. Nous serions plutôt d’accord avec Massillon qui dit : « que vouloir tout concilier, c’est tout perdre ».
Il est des intérêts qui sont inconciliables ; et du point de vue Anarchiste nous considérons que c’est un crime de vouloir concilier ceux de la bourgeoisie avec ceux de la classe ouvrière. Les hommes qui tentent la conciliation de ces deux contraires commettent une profonde erreur et il est regrettable que la classe ouvrière, ou plutôt une fraction de la classe ouvrière consente à collaborer avec ses exploiteurs dans l’espoir de concilier leurs intérêts communs. Espérons que l’expérience répétée de ces tentatives, et que les échecs successifs qui en résultent ouvriront les yeux de la classe ouvrière et que dans un avenir proche elle saura se libérer des conciliateurs, qui, ne sont trop souvent que des agents conscients ou inconscients du Capital.
CONCLAVE
n. m.
Réunion des Cardinaux pour l’élection d’un pape. C’est dans un concile tenu à Rome en 1059, et réunissant cent treize évêques que le privilège d’élire le pape fut déféré aux cardinaux. En 1274 au second concile général de Lyon il fut décidé que :
« Le dixième jour qui suit la mort du Pape, et le lendemain de la célébration des obsèques, les cardinaux présents à Rome, après avoir entendu en corps la messe du Saint Esprit, se rendront processionnellement dans le conclave. »
C’est toujours au Vatican que se réunit le conclave et les cardinaux sont, durant toute sa durée, enfermés dans une cellule de laquelle ils ne sortent que lorsqu’un des candidats à la papauté, ayant réuni les deux tiers des voix, est déclaré élu. Avant de voter, chaque cardinal prête ce serment ; je prends à témoin Notre Seigneur Jésus Christ, qui me jugera, que j’élirai celui que je crois devoir élire devant Dieu. » Ce qui n’empêche pas que l’élection d’un pape est plutôt une bataille politique que se livrent les diverses tendances de l’église catholique, et que les intérêts particuliers ne sont pas sans jouer un rôle dans ces élections. Selon les règlements primitifs, à mesure que se prolonge le conclave, la nourriture des cardinaux doit diminuer, ce qui fait qu’au huitième jour elle ne devrait se composer que de pain et de vin ; comme bien on pense ces règlements ne sont pas appliqués.
Tant qu’un candidat n’a pas réuni le nombre de voix exigé, le vote recommence et les bulletins du vote précédent sont brûlés avec une poignée de paille humide produisant une fumée guettée du dehors par le peuple, qui connaît ainsi les résultats du conclave.
Il arrive que les cardinaux soient longs à se mettre d’accord sur le nom d’un candidat ; lorsqu’il fallut nommer un successeur au pape Clément XIV, les cardinaux se disputèrent pendant près de trois ans.
De nos jours bien qu’entouré du même cérémonial, le conclave n’est qu’un événement d’ordre secondaire et ne présente pas le même intérêt que dans le passé. C’est une comédie qui se perpétue mais la papauté perd chaque jour de son prestige et elle s’éteindra bientôt, ne laissant derrière elle que le souvenir de ses crimes monstrueux et la stupéfaction d’avoir durant des siècles dominé l’Europe.
CONCLUSION
n. f.
Fin d’une affaire, d’un livre, d’un exposé, etc., etc... La conclusion de la Paix est l’acte qui met fin aux délibérations entre les belligérants. La conclusion d’un discours.
La conclusion d’un livre, d’un exposé, d’un discours, pour être persuasive doit être une conséquence logique et directe de ce livre, de cet exposé ou de ce discours. Elle doit être une récapitulation du travail présenté, et suffisamment claire, brève et précise, pour laisser à l’auteur ou au lecteur une impression favorable.
Dans le livre comme dans le discours, on doit s’attacher à la conclusion. Un discours sans conclusion est un corps sans âme, une maison sans toit. Certains littérateurs laissent au lecteur le soin de conclure personnellement ; en réalité dans un ouvrage sérieux la conclusion s’impose d’elle-même. C’est différent lorsque au point de vue social on présente au public un sujet quelconque ; il faut conclure sinon on ne produit qu’un travail inachevé et on laisse son auditoire dans l’indécision ; c’est ce qu’il ne faut jamais faire. C’est la faiblesse de quantité de militants de ne savoir terminer un exposé ; cela dénote une lacune car tout homme convaincu et sincère doit pouvoir en tenant compte de ses facultés oratoires ou intellectuelles donner une conclusion aux idées et aux conceptions politiques ou sociales qu’il défend. Si les idées sont claires la conclusion doit être facile ; si elles sont troubles la conclusion présente d’énormes difficultés. Tâchons en conséquence d’avoir toujours des idées claires.
CONCRET
adj.
(du latin : concretus, condensé.)
Ce qui est « concret » par opposition « abstrait » (Voir abstraction). En chimie les substances « concrètes » sont celles qui sont solides en opposition à celles qui sont fluides. On pourrait donner cette même définition du mot concret lorsqu’il se rapporte aux idées. Une idée concrète est une idée solide qui se rapporte à des substances existant dans la nature, avec les qualités qui leur sont propres.
CONCURRENCE
n. f.
Le terme « concurrence » étant employé à la fois par les économistes bourgeois et les individualistes anarchistes, il est de toute nécessité de bien définir ce que ces derniers entendent par « concurrence » ― d’autant plus qu’ils considèrent la liberté de l’exercer comme l’un des principaux facteurs de la sculpture de la personnalité, du développement de l’être individuel.
Pour les bourgeois, pas de doute, ce qu’ils entendent par « concurrence », c’est une course effrénée vers la richesse, c’est l’écrasement, l’annihilation de tout ce qui fait ombrage aux situations acquises ou volées par les gros privilégiés de l’ordre social, par les monopoleurs ou accapareurs d’envergure, dans tous les domaines de l’activité productrice. Il ne s’agit pas, pour eux, d’affirmation de la valeur éthique ou créatrice de l’unité individuelle, d’amélioration de l’aspect ou de la qualité du produit, ― mais bien d’un combat, le plus souvent déloyal, entre détenteurs de capitaux-espèces ou outils, entre capitaines d’industrie, combats où vainqueurs et vaincus se servent de l’exploitation des travailleurs pour se livrer bataille. C’est une lutte brutale, farouche, une curée, aucunement un moyen de sélection des plus aptes.
Au point de vue où se situent les individualistes anarchistes, ils font de la concurrence un synonyme d’émulation, de stimulant. Se basant sur la connaissance de la nature humaine en général, de l’être humain, en particulier ― l’être humain tel qu’il est et non pas une créature de rêve ou une chimère livresque ― ils considèrent la concurrence comme un aiguillon destiné à maintenir en éveil constant la pensée et l’activité individuelles, trop ordinairement portées vers l’indolence ou le sommeil.
Mais leur thèse de la concurrence se conçoit, bien entendu, étant inconnues ou abolies la domination de l’homme par l’homme, ou vice-versa.
Par I’ expression « liberté de concurrence », les individualistes anarchistes entendent donc la possibilité absolue d’affirmation ou de manifestation de l’individu, dans tous les domaines et dans toutes les circonstances ; autrement dit, la faculté pleine et entière pour tout être humain, associé ou isolé, dé présentation, de diffusion, d’expérimentation, de mise en pratique de toutes conceptions, méthodes ― de tous procédés visant ou poursuivant un but analogue ou différent ; ceci, sans avoir a redouter une réglementation ou intervention restrictive ou limitative quelconque s’exerçant au profit d’un État, d’un gouvernement, d’une administration, d’une unité humaine quelconque.
Dans la sphère économique, les individualistes entendent spécialement par « liberté de concurrence » la faculté pleine et entière pour le producteur, associé ou isolé, de déterminer, à son gré, son effort individuel ; c’est-à-dire de mettre en œuvre toutes ses ressources d’ingéniosité et de savoir-faire, de faire appel à toutes ses capacités de création ou d’initiative personnelle ― sans avoir à se heurter à une réglementation qui limite ou restreigne la confection ou les conditions de sa production.
Les individualistes anarchistes revendiquent, pour le consommateur associé ou isolé, la faculté pleine et entière de comparaison, de choix, de refus, aussi bien en ce qui concerne les utilités de première nécessité qui lui sont offertes ou proposées, que les produits de qualité supérieure ou de confection raffinée. Tout cela sans être exposé à être limité, restreint par une réglementation ou une intervention d’aucun ordre, s’exerçant en faveur de qui que ce soit, institution ou personne.
Les individualistes soutiennent cette thèse que toute entrave à cette faculté ou « liberté » a pour résultat d’accroître l’uniformité. Qui dit uniformité, dit stagnation, soit recul, régression, rétrogradation. Dans tout milieu d’où est exclue la concurrence : d’artisan en évolution vers l’artiste, le producteur rétrograde vers le manœuvre, en involution lui-même vers l’automate ― d’appréciateur en évolution vers l’artiste, lui aussi, ou l’amateur, le consommateur involue vers l’absorbeur, le gobeur, le bâfreur.
Dans toutes les sphères de la pensée ou de l’activité humaine, l’absence de concurrence produit l’involution de l’œuvre d’art ou du distinct vers le grossier ou le grégaire, du différencié vers l’aggloméré, du conscient vers l’inconscient.
La preuve évidente de la vérité de la thèse énoncée ci-dessus ne nous est-elle pas fournie par les résultats de la période que nous traversons, où la concurrence est restreinte à quelques monopoleurs et privilégiés, étatistes ou particuliers. Le stade actuel de l’évolution historique est remarquable. En effet, par l’existence d’une espèce humaine en voie de se vêtir, de se nourrir de la même façon d’un bout du monde à l’autre, de se loger en des habitations construites en tous lieux sur un modèle identique, le phénomène caractéristique du moment actuel, c’est une humanité en voie de penser d’une même manière sur tous les sujets, d’accepter une même solution pour tous les problèmes de la vie. Si on ne réagit pas vigoureusement, les personnalités tranchées, les tempéraments originaux, les esprits inventifs, les créateurs et les initiateurs deviendront une exception, une anormalité.
La concentration de la production manufacturée entre les mains d’un petit nombre de détenteurs, le travail en grandes masses dans les usines immenses et les fabriques-casernes, la fabrication en série, la conscription et les armées permanentes font rétrograder l’unité humaine vers la bête de troupeau : chair à bergers, chair à dictature.
Plus se réalisera la mainmise des accapareurs, des administrations sociales ou des États sur la gestion de la production ― et plus s’accélérera l’involution de l’ouvrier vers l’homme machine, de plus en plus incapable d’un travail autre que la conduite ou la surveillance d’un mécanisme automatique, produisant toujours la même pièce, la même parcelle d’objet.
Il n’y a aucune similitude entre la « concurrence », au sens où l’entendent les individualistes, et la « guerre ». La guerre est une lutte que se livrent dirigeants, monopoleurs, privilégiés, accapareurs politiques ou industriels dont les intérêts n’ont rien de commun avec le développement ou la sculpture de l’individualité humaine. L’« état de guerre » abaisse l’humain au degré de sous hommes, d’objet animé réquisitionnable à merci dans son être et dans son avoir, ne lui laissant aucune possibilité de résistance ou de protestation contre la situation qui lui est imposée. C’est, comme on voit, tout le contraire de « l’état de concurrence ».
L’exercice de la concurrence, au point de vue individualiste, est consécutif à la rationalisation de la production. Là où il y a surpopulation, l’émulation est illusoire. Ce qui se passe actuellement le démontre surabondamment : pas de concurrence possible, une lutte âpre entre appétits et besoins à assouvir, un combat aveugle où la valeur éthique de l’individu et la perfection du produit passent à l’arrière-plan. Et ce sont fréquemment les mieux doués cérébralement, les plus originaux, les plus aptes moralement qui succombent, écrasés, noyés, dans le trop plein d’une médiocratie surabondante.
Ici encore, le dessein de l’individualiste anarchiste ressort avec toute clarté : le développement de l’unité humaine ― associée, ou isolée ― porté à son maximum, de l’unité humaine et non d’une élite de privilégiés d’une espèce ou d’une autre.
Voilà, pourquoi les individualistes ne séparent pas l’exercice de la concurrence de la faculté pleine et entière, pour chaque isolé ou associé, producteur ou consommateur, de profiter, sans aucune réserve, des occasions d’apprendre, de connaître, de se perfectionner, de disposer du moyen de production, des facilités de déplacement, de publicité. Une fois pour toutes, pas de concurrence possible entre le cultivateur, qui possède de primitifs outils de culture, et le fermier propriétaire d’instruments aratoires perfectionnés. Celui-ci est toujours un privilégié par rapport à celui-là.
Tout état de choses, tout milieu individualiste qui ne garantit pas au moins à l’être individuel l’égalité au point de départ (et, dans certaines circonstances, le rétablissement de cette égalité en cours de route) est impropre au jeu de la concurrence.
Sans la faculté de concurrence entre eux des associations, des groupes à effectifs restreints, des isolés, tendant à une production toujours plus améliorée, perfectionnée, raffinée, différenciée, originale, on ne voit pas bien comment on peut éviter la « dictature » avouée ou dissimulée, qui tend, elle, et naturellement, vers l’uniformité, la stagnation, le conformisme.
― E. ARMAND.
CONCURRENCE
Le Larousse nous donne une définition plutôt brève de ce qu’est la « concurrence » ; qu’on en juge : Rivalité entre commerçants, marchands, etc., etc., et c’est tout. En réalité, la concurrence est autre chose qu’une rivalité entre commerçants ; si elle n’était que cela, et si ses conséquences n’exerçaient pas une influence dans tous les milieux, nous laisserions purement et simplement les rivaux se déchirer entre eux, assistant en spectateurs à la lutte, en nous gardant de prendre part au conflit. Mais puisqu’elle est une branche de l’arbre capitaliste et qu’elle marque une période d’évolution du commerce et de l’industrie, elle mérite une étude assez sérieuse et peut-être n’est-il pas inutile de la suivre dans ses diverses manifestations pour essayer, par son présent, de déterminer son avenir.
La concurrence est née en Europe à l’époque de l’affranchissement des communes, mais ce n’est réellement que depuis un siècle que, favorisée par intensification de la grosse industrie, due aux applications de la science, elle a envahi le domaine commercial et s’est, avec une rapidité inouïe, introduite sur tous les marchés nationaux et internationaux.
Les facilités avec lesquelles on se déplace, l’utilisation du téléphone et du télégraphe, et, plus récemment encore, les progrès de la T. S. F., qui permettent de transmettre, en quelques minutes, un ordre à l’autre bout du monde, ont transformé le commerce du tout au tout et, de nos jours, la concurrence n’est pas une lutte entre petits boutiquiers qui cherchent à vendre à un prix faiblement inférieur un produit de même nature, mais une guerre entre diverses fractions de puissants capitalistes, dont le but est de monopoliser à leur profit tout le commerce et l’industrie mondiaux.
Durant une période assez longue, on a accepté comme un axiome que la concurrence était un avantage pour le consommateur, en provoquant une baisse de prix sur les marchés ; nous verrons, par la suite, que cette affirmation ne reposait sur aucune base solide, et qu’au contraire, elle détermine une hausse constante du prix de la vie.
Le commerce est un vol autorisé puisqu’il consiste simplement à acheter un produit au plus bas prix pour le revendre au plus haut. Un bon commerçant doit donc posséder l’art d’acheter 10 francs ce qui en vaut 20 et de revendre 20 francs ce qui en vaut 10. Nous laissons aux économistes bourgeois le soin de démontrer la moralité d’une telle pratique ; mais, quels que soient les arguments invoqués, ils seront obligés de reconnaître que c’est là le principe élémentaire qui sert de base au commerce.
Dans le domaine de l’industrie, le problème se complique, car il entre en jeu un autre facteur : la fabrication, et le manufacturier est obligé non seulement de se procurer au plus bas prix les matières premières nécessaires au fonctionnement de son entreprise, mais encore de déterminer le prix du produit manufacturé en tenant compte de la main-d’œuvre utilisée pour la fabrication de ce produit.
Bien que le commerce et l’industrie soient étroitement liés, la lutte sur le terrain industriel, est donc plus ardue que celle menée sur le terrain purement commercial. D’autre part, le commerce n’est qu’une dérivation de l’industrie et de la manufacture, et c’est particulièrement à la base que se livre la grande bataille de la concurrence. C’est donc la concurrence industrielle que nous allons étudier tout d’abord.
La concurrence, nous dit Lachatre, est « l’acte par lequel plusieurs personnes cherchent à participer aux profits résultant de l’exploitation d’une même industrie ». Nous avons dit, plus haut, que c’est en raison directe des possibilités et des facultés du commerçant ou de l’industriel à se procurer à bas prix les produits indispensables à son entreprise, qu’il pourra concurrencer avantageusement un adversaire. Or, si la définition de Lachatre est exacte, la concurrence repose, à son origine, sur une inégalité, car les chances sont loin d’être égales pour tous les concurrents et, de toute évidence, celui qui possède une grosse fortune est sensiblement avantagé. La loi défend, nous dit-on, la concurrence déloyale ; il est pourtant difficile de concevoir la loyauté d’un commerçant ou d’un industriel qui oppose à son concurrent ne possédant que dix mille francs une fortune de un million. Sa loyauté nous paraît semblable à celle d’une troupe de guerriers qui, armée de fusils et de mitrailleuses, s’attaquerait à une autre troupe, armée simplement des lance-pierres préhistoriques utilisés par David contre Goliath. En conséquence, nous nous trouvons, en raison même de l’évolution de la concurrence, en présence de quelques groupes ou syndicats qui détiennent toute la richesse sociale et qui se combattent pour écouler leurs produits, rester les maîtres du marché et imposer leurs prix.
Étudions, premièrement, les résultats de la concurrence nationale et nous envisagerons plus loin ceux consécutifs à la concurrence internationale.
« La guerre de la concurrence se fait à coups de bas prix », nous dit Karl Marx ; cela ne veut pas dire que la concurrence détermine les prix les plus bas. Évidemment, c’est celui qui vendra le meilleur marché qui aura le plus de chance d’attirer la clientèle ; mais les procédés employés pour obtenir ce résultat sont tels que, loin d’abaisser les prix possibles de vente, la concurrence les augmente. Du reste, s’il en était autrement, la vie diminuerait chaque jour, le phénomène qui se produit est tout à fait contraire.
Pour plus de clarté dans la démonstration qui va suivre, nous simplifierons le problème, en ne présentant le marché que concurrencé par deux adversaires.
Supposons deux industriels possédant une fortune d’égale valeur, disposant du même outillage et fabriquant le même produit. En se procurant les matières premières aux mêmes conditions, le prix de revient du produit manufacturé sera inévitablement le même. L’industriel n’a donc d’autres moyens à sa portée, s’il veut lutter contre son concurrent, que de spéculer sur la main-d’œuvre de ses ouvriers en abaissant leurs salaires ; ou d’exiger d’eux une production supérieure durant un même nombre d’heures de travail. L’abaissement des salaires a une limite, car il faut que le producteur ait, tout de même, la possibilité de satisfaire ses besoins les plus élémentaires et ceux de sa famille. C’est donc sur la production intensive que le manufacturier peut espérer obtenir des résultats. Cette production intensive est le premier inconvénient de la concurrence, et la première victime en est le travailleur. Si la surproduction réduit le prix de revient d’un produit manufacturé, par contre, lorsque le capitaliste considère que son accumulation de marchandises est momentanément suffisante, il arrête sa production. Marx nous enseigne que : « Le système tout entier de la production capitaliste repose sur le fait que l’ouvrier vend sa force de travail comme marchandise et que, comme du papiermonnaie n’ayant plus cours, l’ouvrier devient invendable sitôt que la surproduction permet au capitaliste de se passer de ses services. L’inondation du marché par la main-d’œuvre inoccupée provoque donc fatalement une offre supérieure à celle de la demande et fait baisser le prix des salaires. »
La main-d’œuvre est peut-être la seule marchandise sur laquelle peuvent jouer l’offre et la demande. Dans le commerce, le capitalisme provoque la demande lorsqu’il veut faire hausser les prix ; sur le terrain du travail, cette possibilité n’est pas permise au prolétaire puisque ce dernier, s’il veut vivre, est obligé de vendre sa marchandise travail au jour le jour.
Nous voyons donc que la surproduction est nuisible à tous les points de vue, et, cependant, elle n’est que la première des conséquences de la concurrence.
Il arrive que les circonstances ne se prêtent pas aux exigences de la concurrence et que les travailleurs se refusent ou de surproduire ou d’accepter une diminution de salaires, et l’industriel doit avoir recours à un autre procédé : la fraude, qui consiste à employer dans la fabrication d’un objet des matières premières de qualité inférieure ; si, dans le premier cas que nous signalons, l’industriel vole le producteur, dans le second, il vole le consommateur.
Nous avons dit plus haut que le commerce était le vol autorisé. Le commerçant n’a donc aucune raison de se gêner et les divers moyens précités sont employés par tous ceux qui pratiquent le commerce ou l’industrie. Aucun scrupule ne peut animer celui qui accepte de vendre le plus cher possible une marchandise et qui ne consent à baisser ses prix que dans la mesure où il y est contraint par la concurrence.
Lorsque l’on a usé du vol, on peut user du mensonge, et c’est en vertu de cette logique toute commerciale que, dans le jeu de la concurrence, entre la publicité. Si, dans sa simplicité, la rivalité entre deux commerçants ou industriels peut amener une baisse dans le prix de vente d’une marchandise, la publicité agit dans un sens inverse et fait hausser, dans une proportion plus grande le prix des marchandises. On se demande avec stupeur, en lisant son journal et en constatant la place qui y est réservée à la publicité, en contemplant les murs des villes et des villages recouverts d’affiches multicolores vantant la qualité d’objets les plus divers ; on se demande, disons-nous, de combien le commerçant ou l’industriel est obligé de majorer les prix d’origine, pour arriver à récupérer les sommes fantastiques englouties par les contrats de toutes sortes et le battage organisé en faveur des produits offerts au consommateur.
Il est donc démontré que la concurrence sur le terrain national produit des effets contraires à ceux que le consommateur pouvait en espérer, puisqu’elle provoque le chômage, la baisse des salaires, la cherté de la vie, et la mauvaise qualité des marchandises.
Ainsi, dit Sébastien Faure : « La concurrence jette les uns contre les autres les capitalistes de toute taille, de toutes nations, de toutes races. Dans se choc violent sans cesse répété et qui, chaque jour, devient plus violent, les vaincus sont de plus en plus nombreux et ce n’est qu’en piétinant sur des cadavres s’amoncelant sans trêve ni merci, que les « FivesLille » et les « Creusot », pour l’industrie en France, et les « Louvre » et les « Bon Marché » pour le commerce parisien et même français, peuvent donner à leurs propriétaires ou actionnaires les bénéfices qu’ils attendent.
Le champ de bataille jonché de morts et de mourants reste donc à ceux qui disposent des bataillons les plus nombreux, des engins les plus terribles, des moyens de transport les plus expéditifs, des munitions les plus abondantes ; or, sur le champ de bataille de la concurrence, les munitions, les moyens de transport, les engins destructeurs et les bataillons, c’est l’agglomération ouvrière, c’est la condensation industrielle et commerciale, c’est enfin la concentration des capitaux de toutes natures.
Et, maintenant, est-il besoin de se demander quels seront fatalement les vaincus de cette lutte à outrance ». (Sébastien Faure, La Douleur Universelle, page 178.)
Certains esprits naïfs s’imaginent, malgré tout, que la concurrence pourrait être une source de profits et d’avantages pour le consommateur si des mesures étaient prises pour éviter la spéculation et soutenir le commerçant « honnête ». On a préconisé l’intervention de l’État, l’imposition de certains prix pour des matières de première nécessité, etc. Toutes les tentatives ont échoué lors de leur application et il n’y a pas lieu de s’en étonner. L’erreur consiste à vouloir considérer la concurrence comme une cause, alors qu’elle n’est qu’un effet.
Quant au commerçant « honnête », si, toutefois, nous voulons accepter cet euphémisme, nous allons étudier sur le vif quelle peut être son influence, en signalant un fait caractéristique qui s’est produit en Angleterre ― mais qui aurait tout aussi bien pu se produire ailleurs ― vers la fin de 1918.
Le gouvernement anglais avait fait une commande de plusieurs centaines de milliers de mètres de toile, à divers tisseurs de la Grande-Bretagne. L’ordre avait été passé, mais le travail n’avait pas été commencé lorsque la guerre prit fin. Cette toile, destinée à l’aviation de guerre, devenait inutilisable pour le gouvernement, et ce dernier demanda aux tisseurs de bien vouloir annuler la commande ; les tisseurs refusèrent, déclarant que l’ordre avait été régulièrement passé et accepté et qu’en conséquence, il serait exécuté. En passant, quoique ce soit hors de la question, soulignons le patriotisme de ces gros industriels.
Le travail fut donc exécuté et, quelques mois plus tard, les tisseurs proposèrent au gouvernement de lui vendre, avant sa livraison, la toile qu’ils venaient de fabriquer, au huitième de sa valeur. C’était une opération fructueuse de racheter un franc ce que l’on venait de vendre huit, alors que les marchandises n’étaient même pas sorties des magasins. Le gouvernement refusa et les toiles furent livrées.
Un an environ s’écoula, et, un matin, la presse annonça à ses lecteurs qu’un richissime Anglais, récemment débarqué d’Amérique, venait d’acheter comptant, au gouvernement, près d’un million de mètres de toile provenant des stocks de guerre, et que cette toile allait être offerte au public à moitié prix de sa valeur marchande.
Cette toile, qui souleva de l’autre côté de la Manche, un flot d’indignation lorsqu’on apprit sa provenance et le marché odieux qui avait été précédemment proposé au gouvernement par les fabricants, ne fut jamais mise en vente aux conditions indiquées ci-dessus. Elle fut vendue au prix du cours et en voici les raisons :
Tous les tisseurs anglais s’associèrent contre la « brebis galeuse » qui voulait ignorer les lois de la solidarité commerciale, et la menacèrent, « dussentils perdre tous les bénéfices réalisés durant la guerre, et qui s’élevaient à plusieurs centaines de milliers de livres », de jeter sur le marché de la toile de qualité supérieure et à un prix plus avantageux, toile qui aurait été vendue à perte par les fabricants, mais qui aurait empêché l’écoulement de celle fournie par le gouvernement. Et devant cette menace que les gros industriels britanniques n’auraient certainement pas hésité à mettre à exécution, le commerçant « honnête » se courba pour ne pas être écrasé. Tels sont les effets de la concurrence. Et aucune force politique ne peut empêcher ces faits de se produire. La concurrence est une force économique et c’est sur le terrain économique qu’il faut la combattre.
Nous avons dit, en traitant du « capital » que l’unité du capitalisme n’était qu’apparente (Voir Capitalisme), et que la division régnait au sein de cette classe. En effet, lorsque tous les terrains nationaux ont été explorés par les capitalistes, ceux-ci vont chercher à l’étranger d’autres filons à exploiter. Il se crée alors de nouvelles compétitions et de nouvelles concurrences.
Nous savons que pour se garantir de la concurrence étrangère, le capitalisme national exige des gouvernants qui ne sont au pouvoir que pour défendre ses intérêts, l’imposition de droits de douane sur les marchandises ou objets manufacturés qu’ils ne peuvent pas fournir à prix égal ou inférieur. D’autre part, il est indispensable à certaines nations d’exporter leurs produits en surabondance, si elles ne veulent pas être acculées à la misère et à la faillite. Or, les deux actions ne s’accordent pas et lorsque des droits de douane prohibitifs viennent protéger des marchandises de source nationale, ces marchandises ne peuvent pas être concurrencées par les produits de provenance étrangère et l’on peut dire que le marché national est fermé aux articles frappés par la douane.
Exemple ; Supposons que la fabrication d’une paire de chaussures revienne, en France, à 50 francs ; et que l’Angleterre, en raison de divers facteurs, puisse fabriquer ces chaussures pour 30 francs. Immédiatement, elle inonde le marché et l’industrie française de la chaussure n’arrive plus à écouler ses produits. Pour empêcher ce fait de se produire et assurer au capitalisme national les bénéfices qu’il réclame, les chaussures de provenance anglaise seront donc imposées d’un droit de douane d’au moins 20 francs, et si le capitalisme est satisfait de cette mesure, le plus clair de l’histoire c’est que les chaussures seront vendues au moins 20 francs de plus qu’elles devraient l’être en réalité.
Cela ne se passe pas cependant aussi simplement qu’on pourrait le croire, et il est des pays pour qui l’exportation est l’unique source de vie et qui n’accepte pas de se courber devant les exigences d’un capitalisme national. Chaque fraction du capitalisme en lutte, se défend par l’intermédiaire de son gouvernement et la concurrence de nation à nation est l’unique cause des négociations interminables qui se poursuivent depuis des années et des années. Le Capitalisme international cherche un terrain d’entente, et lorsque les intérêts particuliers n’ont pu se concilier autour du tapis vert de la diplomatie, alors on donne la parole au canon et c’est la guerre fratricide, criminelle, monstrueuse qui est chargé de régler le différend.
Voilà à quoi aboutit la concurrence. Les guerres coloniales n’ont également pas d’autres origines, et de l’étude de la Société capitaliste nous avons la ferme conviction qu’il ne peut en être autrement, tant que tous les rouages n’en auront pas été détruits et que les richesses sociales resteront détenues par une poignée de privilégiés.
Qui donc, aujourd’hui, en dehors de celui qui en profite, est assez fou pour trouver dans la concurrence, un phénomène utile à l’intérêt, au bien-être collectif ? Personne. Le commerce, la concurrence, le militarisme, le Capital en un mot, doivent disparaître et ils disparaîtront « crevant d’obésité ».
Par quel facteur nous remplacerons la concurrence ? Par la solidarité. Le Dantec peut dire que : « La biologie ne nous apprend que la nécessité de la lutte, et la noble utopie de justice, pour être ancrée dans la mentalité de l’homme, n’a pas de fondement scientifique » ; nous pensons que si la justice est en effet une utopie dans une société reposant sur l’autorité, que si l’égalité est un rêve lorsque, seule, dispose de la richesse sociale une minorité de parasites, la justice et l’égalité peuvent devenir une réalité lorsque les hommes enfin libérés du joug économique qui les écrase, n’auront plus à craindre la misère et la famine engendrés par le commerce et la concurrence.
Pour terminer, empruntons la conclusion de Pierre Kropotkine à son livre la Conquête du Pain :
« Pouvant désormais concevoir la solidarité, cette puissance immense qui centuple l’énergie et les forces créatrices de l’homme, ― la société nouvelle marchera à la conquête de l’avenir avec toute la vigueur de la jeunesse.
Cessant de produire pour des acheteurs inconnus, et cherchant dans son sein même des besoins et des goûts à satisfaire, la société assurera largement la vie et l’aisance à chacun de ses membres en même temps que la satisfaction morale que donne le travail librement choisi et librement accompli, et la joie de pouvoir vivre sans empiéter sur la vie des autres. Inspirés d’une nouvelle audace, nourris par le sentiment de solidarité, tous marcheront ensemble à la conquête des hautes jouissances du savoir et de la création artistique.
Une société ainsi inspirée n’aura à craindre ni les dissensions de l’intérieur, ni les ennemis du dehors. Aux coalitions du passé elle opposera son amour pour l’ordre nouveau, l’initiative de chacun et de tous, sa force devenue herculéenne par le réveil de son génie.
Devant cette force irrésistible, les « rois conjurés » ne pourront rien. Ils n’auront qu’à s’incliner devant elle, s’atteler au char de l’humanité, rouler vers des horizons nouveaux, entr’ouverts par la Révolution sociale ».
― J. CHAZOFF.
CONCUSSION
n. f. (du latin : concussio.)
Exaction commise par un fonctionnaire profitant de sa position pour percevoir des droits supérieurs à ceux prescrits par la loi.
Bien que cet acte indélicat soit considéré comme un crime et puni comme tel par la justice bourgeoise, on peut dire que ce ne sont pas les rigueurs de la loi qui effraient les concussionnaires. Chaque administration a les siens, et ce n’est pas dans la classe inférieure des fonctionnaires qu’il faut les chercher, mais parmi ceux qui occupent une place plus ou moins élevée sur l’échelle de la hiérarchie. Du reste, cela s’explique assez facilement, car lorsque par hasard les concussionnaires de haut grade sont pris entre les griffes de la justice, ils bénéficient toujours de l’indulgence des tribunaux ; et comment en serait-il autrement, puisque la magistrature n’échappe pas à la règle générale de la concussion et que certains magistrats pour augmenter leurs revenus, n’hésitent pas à spéculer sur leurs fonctions ?
Un conseiller municipal déclarait que celui de ses confrères parisiens qui ne gagnait pas cent mille francs par an était un imbécile.
Peut-on avouer plus cyniquement que l’on vend son mandat et qu’il y a toujours quelqu’un de prêt à l’acheter ?
Il n’y a pas grand chose à faire contre la concussion en particulier. Tant qu’il y aura des fonctionnaires qui auront, de par la forme de société à laquelle ils sont attachés, la possibilité de se servir au détriment des autres, la concussion existera. C’est l’arbre qu’il nous faut abattre si nous voulons que la sève ne monte pas pour nourrir les branches ; et c’est une rude besogne à laquelle doivent s’atteler tous les hommes de cœur.
CONDAMNATION
n. f.
Décision judiciaire par laquelle un tribunal contraint un individu à se soumettre et à subir une peine qui lui est infligée, en vertu de l’application de la loi.
Une condamnation est toujours arbitraire et ridicule. Arbitraire, parce qu’il n’appartient à personne, le droit de juger son prochain ; et ridicule, car il est impossible de déterminer la somme de souffrance et de peine qui peuvent réprimer un crime ou un délit.
Il est vrai que la loi bourgeoise prétend ne pas s’inspirer du talion, et que son désir n’est pas d’infliger au coupable une douleur égale à celle subie par sa victime, mais de rappeler à celui qui enfreint la loi, l’observation de ses devoirs sociaux ; elle ajoute que l’isolement du reste du monde est salutaire au coupable et que la réflexion et la méditation le guérissent de l’envie de fouler à nouveau les lois de la « Justice ».
Or, il a été maintes et maintes fois démontré que les condamnations à une détention plus ou moins longue, ne guérissaient pas un coupable et que, bien au contraire, une fois subie, la première peine était suivie d’autres délits et d’autres peines, et que par conséquent les bienfaits de la condamnation ne se manifestaient jamais.
Il y a diverses catégories de condamnations ; d’abord celles de droit commun et celles d’ordre politique. Les unes comme les autres sont infligées en vertu d’infractions à la loi bourgeoise, et c’est ce qui explique que les prisons ne sont peuplées en majorité que par de pauvres bougres, car ceux qui détiennent, ne serait-ce qu’une parcelle du Capital, ne subissent jamais de condamnations criminelles ; il leur arrive parfois d’encourir des condamnations civiles, qui ne sont jamais bien pénibles.
Dans le domaine du droit commun, la condamnation recrute ses victimes parmi les « voleurs », les « meurtriers » et encore parmi les ouvriers en révolte, qui, en vertu des libertés républicaines, se permettent de descendre dans la rue pour réclamer leur « droit à la vie ».
Dans sa brochure « Pourquoi j’ai cambriolé », Jacob souligne que celui qui possède la fortune n’a jamais besoin d’user de procédés illégaux pour arriver à vivre, et que par conséquent il ne peut jamais être condamné comme voleur. En effet, on ne s’explique pas pour quelles raisons M. de Rotschild ou M. Loucheur iraient cambrioler. Il en est de même pour le meurtre, qui, deux fois sur dix, a le vol pour mobile ; quant aux meurtres passionnels, qui ont quelquefois pour théâtre le terrain de la bourgeoisie, on connaît l’indulgence des tribunaux vis-à-vis des inculpés. Pour les grèves, ce sont encore les ouvriers qui en sont les victimes, et c’est sur eux que retombent toutes les responsabilités. On peut donc conclure en disant que ce n’est jamais la classe privilégiée qui subit les condamnations, mais les hommes issus de la classe opprimée.
Quant aux condamnations politiques, il arrive de temps en temps un accident aux représentants de la bourgeoisie, mais c’est excessivement rare, et en général ce ne sont que les révolutionnaires de gauche qui peuplent les prisons.
La condamnation est donc une arme bourgeoise, inutile en soi, car elle ne change absolument rien et ne maintient même pas l’ordre bourgeois, et son unique utilité serait peut-être de nourrir une armée de parasites qui ne sauraient que faire si on leur retirait le pouvoir de condamner.
CONDUITE (ligne de)
n. f.
L’homme est un animal complexe et, jeté dans la vie, il se perd parfois dans le tourbillon social ; arraché de droite et de gauche, il cherche sa voie et il lui arrive de traverser son existence sans la trouver. Incapable de prendre une décision, s’attachant à des niaiseries sans apercevoir les faits importants qui illustrent chaque jour l’histoire des sociétés, il est perdu dans le monde et dans les idées, subit l’influence des uns et des autres sans prendre de décisions propres et particulières ; en un mot, il est égaré et ne sait pas ce qu’il veut et ce qu’il peut. C’est un homme faible qui n’a pas de « ligne de conduite ».
Un homme fort doit se tracer un chemin. La ligne droite est le chemin le plus court d’un point à un autre. Il faut prendre la ligne droite si l’on ne veut pas se perdre dans les broussailles de la vie, et c’est ce que peu d’individus font en réalité. Il faut évidemment chercher sa voie, ne pas partir aveuglément ; mais une fois trouvée, une fois que l’on a la conviction d’être sur la bonne route, l’hésitation est un mal qui détruit tous les effets d’une inspiration heureuse et rend inutile toute l’énergie que l’on est à même de dépenser.
L’individu vient au monde chargé des vices et des tares de l’hérédité ; sitôt que sa raison est susceptible d’absorber quelque nourriture, il est accaparé par une société qu’il n’a pas conçue, qui lui applique ses lois, bonnes ou mauvaises, qui lui enseigne sa morale et qui cherche à en faire sa chose ; s’il est d’esprit assez éveillé, il regarde, il observe, il analyse et cherche à se détacher de ce milieu qui veut le comprimer ; mais dans une certaine mesure, il lui est impossible de ne pas subir l’influence du milieu.
S’il se laisse attacher et accaparer par ce milieu, c’est un homme perdu qui ira grossir le rang du troupeau, incapable de penser et juger par lui-même ; il deviendra une chose qui, associée à d’autres choses semblables, lui fermeront « la chose publique » qui se laisse gouverner par les coquins et les voleurs.
Renan nous dit : « La moindre action moléculaire retentissant dans le tout, et l’homme étant cause au moins occasionnelle d’une foule d’actions moléculaires, on peut dire que l’homme agit dans le tout d’une quantité qui équivaut à la petite différentielle qu’il y a entre ce qu’est le monde avec la terre habitée et ce que serait le monde avec la terre inhabitée. »
Et Renan a raison. Bien que l’homme soit déterminé, et en conséquence irresponsable, il lui incombe cependant, et aussi faible soit elle, une part de responsabilité dans tous les événements qui se déroulent, et si nous nous plaçons au point de vue social, c’est de sa ligne de conduite que dépend la transformation continuelle de la société.
Certes, il est bien difficile de définir ce que devrait être la ligne de conduite de chaque individu, surtout si nous nous plaçons sur le terrain philosophique, où nous sommes obligés de reconnaître que le bien et le mal n’existent pas. Pourtant, si nous nous plaçons sur le terrain de la sociologie, nous pouvons nous permettre de faire une petite entorse à l’absolu philosophique pour discerner — sans pour cela légitimer la répression quelle qu’elle soit -le bien du mal.
Considérons donc comme bien tout ce qui est utile à la collectivité et à l’individu, et mal tout ce qui est néfaste à l’une et à l’autre. Peu-être, de cette façon, sera-t-il possible de rechercher quelle doit être la ligne de conduite de l’individu.
Les Anarchistes veulent transformer le milieu social actuel, qu’ils considèrent comme mauvais. Plus que tous les autres, il est donc indispensable qu’ils aient une ligne de conduite conforme à leurs aspirations. On ne peut concevoir, par exemple, un individu luttant ou plutôt critiquant la forme d’exploitation actuelle, et qui lui-même se rendrait complice de cette exploitation ; on ne peut pas plus concevoir un ivrogne s’élevant contre l’alcoolisme et absorbant lui-même plus de liquide qu’il n’en peut contenir.
Nous n’ignorons pas que le milieu nous étreint et que nous sommes à tous moments obligés de lui faire des concessions ; celui qui se refuserait à toute concession envers le milieu n’aurait plus qu’à mourir. Mais cependant, chaque individu doit se tracer cette « ligne de conduite », minimum pourrait-on dire et, en la suivant, consentir le moins possible à la société moderne pour donner le plus qu’il peut à la société qu’il veut réaliser. La « ligne de conduite » de l’individu sain et sincère doit l’orienter vers le but qu’il poursuit, et il ne doit s’en détourner que lorsqu’il considère qu’il fait fausse route, et que l’expérience lui a démontré l’erreur de ses espérances.
Si chacun voulait adopter comme « ligne de conduite » : de ne jamais être nuisible à autrui, l’humanité serait bien vite réformée et les individus pourraient être libres et heureux. Hélas, les hommes en lutte constante les uns contre les autres se dévorent, et chacun ne recherche que son bonheur particulier sans se préoccuper de son prochain. C’est l’égoïsme qui domine en, notre siècle de luxe et de misère ; cependant, tous ceux qui peinent et qui souffrent, qui sont toujours les victimes d’une société marâtre seront bien obligés un jour de se tendre la main pour combattre l’ennemi commun. Et ce jour-là, la conduite des opprimés sera assez énergique pour que disparaissent à jamais de la surface du globe : l’exploitation qui abaisse et l’autorité qui tue.
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)
n. f.
La Confédération générale du Travail est l’organisme central du syndicalisme français. Elle est composée des Unions départementales et des Fédérations d’industrie. Son siège est à Paris. Elle a pour but de coordonner les efforts des ouvriers groupés à leurs syndicats, unions locales, fédérations et unions départementales pour l’action sociale du prolétariat. Elle adhère à l’Internationale syndicale pour prolonger sur le plan international l’action qui se déroule dans son propre pays, en liaison avec les Centrales Nationales des autres pays. Cette définition a cessé d’être exacte depuis la scission de 1921. Elle n’en reste pas moins celle qui, un jour prochain, sous la pression croissante des nécessités correspondra à nouveau à la réalité, lorsque les tronçons épars du groupement ouvrier français se seront ressoudés.
* * *
L’histoire de la C. G. T. c’est celle du syndicalisme avec ses luttes, ses victoires et ses défaites. Son évolution, qui est aussi celle de la société actuelle. Il faut rechercher l’une et l’autre à l’origine, même si cet examen doit faire double emploi avec celui que nous avons été obligés de faire pour exposer le caractère, l’évolution et l’action des Bourses du Travail, principal élément de la C. G. T., lors de sa constitution.
Nous renoncerons cependant à examiner les luttes séculaires des travailleurs toujours en révolte, à toutes les périodes de l’Histoire, contre leurs oppresseurs, quelque visage qu’aient ceux-ci et quelques forme qu’ait revêtue l’exploitation de l’homme par l’homme.
Si nous nous assignions ici une pareille tâche, c’est l’histoire du monde, depuis là plus haute antiquité jusqu’à nos jours, qu’il faudrait relater. Nous ne pouvons pour des raisons qu’on comprendra, entreprendre pareille tâche.
Il importe d’ailleurs assez peu qu’on fixe ici ou là telle époque ou à telle autre époque, l’origine exacte du mouvement syndical qui nous a conduits, de proche en proche, jusqu’à l’origine de la C. G. T.
Nous nous contenterons donc de prendre notre tâche — qui n’en reste pas moins vaste — après la Révolution de 1789, après l’évanouissement des corporations.
L’écroulement du vieux système social, provoqué par la Révolution, avait fait table rase des privilèges de toutes natures et supprimé toutes les juridictions qui s’interposaient entre l’individu et l’État. Après 1789, l’homme, quelle que soit sa profession, ne relevait plus d’un patron, d’un seigneur, d’un évêque ou du fisc. Il n’y avait, plus sujets du roi, des nobles, des clercs, des paysans, plus de classes, d’ordres, de droits, de dîmes, plus d’entraves, etc... Mais il n’y avait plus non plus, dit Proudhon dans sa Capacité politique des classes ouvrières (page 11) aucune de ces autorités locales, de ces chartes particulières, de ces parlements, de ces corporations, de ces prérogatives ou exemptions. Rien ne subsista que ces deux termes extrêmes : l’État et le Citoyen. Rien ne demeura non plus, pour amortir la domination directe du second par le premier.
Qu’arriva-t-il ?
Avec les dépouilles des biens de la noblesse et du clergé, se constitua une classe de propriétaires-paysans tandis qu’une immense majorité du peuple ne voyait rien changer à sa condition première. Les classes se formèrent presque spontanément, immédiatement. La lutte fut d’autant plus vive que les non-possédants, les travailleurs, se rendirent compte de la spoliation et de la trahison dont ils étaient victimes de la part de leurs alliés de la veille : la nouvelle bourgeoisie, qui avait utilisé au mieux de ses intérêts la force populaire et ne rêvait que de l’asservir à nouveau pour asseoir ses privilèges, cette classe dont l’appétit était d’autant plus grand qu’il avait été plus longtemps contenu par le régime disparu.
Il y avait désormais la Bourgeoisie et le Prolétariat, la première brimant le second, après avoir utilisé sa force libératrice et révolutionnaire. La structure de l’État se trouvait modifiée. Les formes constitutionnelles étaient changées, mais l’exploitation, pour différente qu’elle, était, n’en subsistait pas moins, plus brutale et plus cupide qu’avant. C’était tout le résultat qui restait d’une révolution politique, et qui n’avait pas modifié les termes généraux du contrat social.
Alors qu’on répandait partout, au dedans comme au dehors, des idées de justice, d’égalité, de fraternité, c’était entre deux catégories d’hommes une opposition sans cesse croissante qui se développait du fait d’une sujétion politique et d’une exploitation économique sans frein, que rien ne venait atténuer.
Doit-on, comme Jouhaux l’affirme dans son ouvrage Le Syndicalisme et la C. G. T. (page 25) dire que la loi Le Chatelier, votée en 1790, ne correspond pas réellement à l’esprit des hommes qui l’ont votée ? Nous ne le croyons pas. À notre avis, cette loi était bien l’expression de leurs sentiments exacts. Le fait qu’elle ait été votée par la Constituante au moment même où se produisaient à Paris, des cessations concertées du travail, nous permet d’affirmer qu’elle le fut en toute connaissance de cause.
On voulait museler les travailleurs, au moment même où les corporations disparaissaient ; le prolétariat était sans défense.
Le texte du manifeste adressé à cette époque aux ouvriers parisiens par le Conseil municipal le prouve avec évidence.
Voici ce qu’on y lit :
« Le Conseil municipal est instruit que les ouvriers de quelques professions se réunissent journellement en très grand nombre, se coalisent au lieu de s’employer à travailler et font des arrêts par lesquels ils taxent arbitrairement le prix de leurs journées. Tous les citoyens sont égaux en droit, mais ils ne le seront jamais en facultés, en talents et en moyens. La nature ne l’a jamais voulu. Il est donc impossible qu’ils se flattent tous de faire les mêmes gains.
Une coalition d’ouvriers pour porter le salaire de leurs journées à des prix uniformes et forcer ceux du même état à se soumettre à cette fixation serait donc évidemment contraire à leurs propres intérêts ; une pareille coalition serait une violation de la loi, une atteinte à l’intérêt général ».
Voilà ce qu’on osait écrire au lendemain de la Révolution. N’est-ce pas caractéristique d’un état d’esprit d’oppression ?
Combien de fois, depuis, avons-nous entendu tenir le même langage par te patronat et le « pouvoir » ? Combien de fois, hélas ! l’entendrons-nous encore, si, à la première occasion, nous ne proclamons pas d’abord les droits imprescriptibles du travail et des travailleurs, si nous renonçons à faire nos affaires nous-mêmes, pour les confier à des « génies, à des messies », à des maîtres nouveaux à qui nous remettrons le soin de faire notre bonheur politique en consacrant notre esclavage économique ?
Les révolutions de 1830, 1848 et 1871 ont pourtant, à cet égard, apporté une confirmation éclatante à ces faits de 1790, sans ouvrir les yeux, hermétiquement clos — il faut le croire — des travailleurs. En sera-t-il de même demain ? Il faut le craindre et faire l’impossible pour que cela ne soit point.
Comme on le voit, c’est au lendemain de la grande révolution française qu’il faut situer l’origine des classes et la naissance du mouvement syndical, placé hors des institutions soit disant révolutionnaires créées par la Bourgeoisie pour asseoir son pouvoir et conserver ses privilèges récents.
N’est-ce pas aussi à cette date qu’il faut placer la compréhension de la responsabilité ouvrière et l’affirmation de celui de la solidarité de classe ?
Dès cette époque, on avait de la liberté du travail, une idée exacte et on condamnait aussi sévèrement qu’aujourd’hui l’acte de l’homme qui travaillait pendant que les autres revendiquaient. C’est de ce moment que date la vraie morale ouvrière qui veut que « quiconque ne participe pas à un effort ne soit pas digne d’en recevoir le prix et qui condamne sévèrement, mais justement, toute action qui tend à briser l’action revendicatrice des ouvriers ».
Les ouvriers d’ailleurs ne tinrent aucun compte du manifeste municipal. Les charpentiers, notamment, constituèrent un syndicat bien organisé. Leur exemple fut suivi par plusieurs corporations du bâtiment qui défendirent vigoureusement leurs salaires, sans oublier de poser le principe de la réduction de la journée de travail, qui fut ramenée de 14 à 12 heures (repos non compris).
Voyons ce que disaient de leur côté les patrons :
« Le prix de la journée, disaient-ils, est ainsi augmenté d’un sixième ; malgré les fortes réclamations qui se sont élevées contre ce désordre, il n’a pas été réprimé ».
Ne croirait-on pas entendre nos patrons modernes protester contre l’application de la journée de huit heures et l’augmentation des salaires ?
De même que la défense des intérêts heurte aujourd’hui ceux de la bourgeoisie et les conceptions juridiques du patronat ; cette tentative d’organisation pour modifier le contrat social, heurtait l’esprit des récents bourgeois de la Constituante. Inutile de tenter ou de faire croire que la loi Le Chatelier n’était pas l’expression exacte de l’état d’esprit de ceux qui la votèrent. Ils n’étaient ni des niais, ni des inconscients. Tous leurs actes le prouvent,
Donc lorsqu’ils acceptaient le projet de Le Chatelier qui disait dans un des considérants de son rapport introductif ;
« C’est aux conventions libres d’individu à individu à fixer la journée pour chaque ouvrier ; c’est ensuite à l’ouvrier à maintenir la convention qu’il a faite avec celui qui l’a occupé ».
Le Chatelier exprimait une pensée concrète, claire pour tout le monde, a fortiori pour des représentants du Peuple.
Et lorsqu’il ajoutait « C’est à la Nation de subvenir aux besoins des individus et de leur assurer du travail » cela voulait dire, que grâce à la loi nouvelle, ainsi motivée, le seul organe nécessaire à la satisfaction des travailleurs c’était l’État.
Là encore, impossible de se tromper et ceux qui votèrent la loi Le Chatelier savaient parfaitement qu’ils mettaient ainsi hors la loi l’organisation spécifique des travailleurs livrés sans défense à l’exploitation du patronat et à la domination de l’État.
N’est-il pas suffisamment significatif cet article de la loi Le Chatelier qui énonçait :
« L’anéantissement de toutes espèces de corporations de citoyens d’un même État étant une des bases fondamentales de la constitution française... l’association ouvrière, sous quelque forme et sous quelque prétexte que ce soit, est prohibée ».
Et un, peu plus loin :
« Toutes les conventions tendant à réformer de concert ou à n’accorder qu’à prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, tous règlements ou accords ainsi fixés sont déclarés inconstitutionnels, attentatoires à la liberté ou à la déclaration des Droits de l’Homme et de nul effet ».
On avouera qu’il était difficile d’être plus cynique ou de se montrer plus réactionnaire.
Et, bien entendu, les délits étaient durement punis : amendes de 500 francs, privation de droits civiques, etc...
Enfin pour bien démontrer que ce texte avait un véritable caractère de classe, la loi accordait aux employeurs un scandaleux privilège. Le Chatelier disait « qu’il n’entendait pas empêcher les commerçants de causer ensemble de leurs affaires ». On sait ce que cela veut dire.
La loi consulaire de l’an XI (1803) instituait enfin le « livret ouvrier » qui n’était autre chose que la « mise en carte » des travailleurs.
À part la création des juridictions prud’homales, le régime impérial ne fit que systématiser la sujétion des ouvriers.
Les articles 414 et 416 du nouveau Code pénal, si durs pour les ouvriers, si indulgents pour les patrons, l’article 1781 du Code civil qui disait : Le maître est cru sur parole pour la quotité des gages, pour le paiement des salaires de l’année échue et pour les acomptes donnés pour l’année courante, complétaient cette domestication de la classe ouvrière, sans que la moindre législation lui permît de se défendre contre l’adversaire.
On comprend dès lors, les difficultés que devait rencontrer le prolétariat pour son organisation.
Quelles qu’elles aient été, la classe ouvrière sut cependant les vaincre dans une assez large mesure et, souvent, elle se dressa contre le pouvoir de l’État.
La période de 1848 à 1871, assez mal connue, a vu des révoltes terribles où le prolétariat a pu se croire enfin maître de ses destinées. C’est alors que naquit la Première Internationale et que vit le jour le socialisme utopique ou romantique.
Cette époque marque la fin de la bourgeoisie terrienne et l’avènement de la bourgeoisie industrielle et bancaire. L’introduction du machinisme créa de nouvelles conditions de vie sociale. En même temps qu’il cesserait les liens entre les ouvriers, il entraîna une technique nouvelle d’où découlèrent : le chômage et l’avilissement des salaires.
La misère atteignit des proportions effroyables. Il y avait une désaxation totale de l’activité et le capitalisme manifestait son impuissance à modifier les conditions de vie, à suivre le rythme nouveau imposé par le machinisme.
Les grands mouvements de 1831 à Lyon, dont les salaires furent réduits de 4 francs à 18 sous par jour marquent le point culminant de cette crise. C’est pendant les grèves sanglantes de cette époque que les Canuts de la Croix Rousse inscrivirent sur leur drapeaux cette devise restée de plus en plus d’actualité : Vivre en travaillant où mourir en combattant. Il en fut de même à Paris et en province. De nombreuses sociétés de résistance, auxquelles participèrent des chefs d’ateliers, se constituèrent un peu partout. Ce mouvement prit une « telle ampleur qu’il apeura le gouvernement qui, par la loi du 25 mars 1834, prit de sévères mesures contre les « Sociétés de résistance. ». (Syndicats de l’époque).
Ce vote alla à l’encontre du but poursuivi. Deux nouvelles insurrections éclatèrent presque aussitôt : l’une à Lyon, à la suite de poursuites pour faits de grèves, écrasée dans le sang, après 5 jours de lutte héroïque, et l’autre à Paris qui aboutit à un effroyable massacre.
Thiers, l’assassin des Communards fit peser sur la classe ouvrière un régime de terreur écrasant.
Rien n’arrêta pourtant l’élan du prolétariat et les journées de juillet verront le prolétariat se dresser contre l’État, serviteur de la bourgeoisie et massacreur des travailleurs.
C’est à ce moment que s’éveille la conscience du prolétariat. Il comprend qu’il n’arrivera à rien tant qu’il n’aura pas démoli le pouvoir de l’État et détruit l’exploitation nationale pour transformer la société.
Sous l’influence de Buonarotti survivant de la conspiration des Egaux, le socialisme gagne les classes ouvrières, encore qu’elles ne se reconnaissent guère dans le patois des doctrines Saint-Simoniennes, phalanstériennes et étatiques de Louis Blanc.
C’est alors que se produisit dans ce bouillonnement d’idées la Révolution de 1848 qui fut un triomphe passager du Peuple et porta au Pouvoir en la personne de Louis Blanc et d’Albert, le socialisme d’État.
Celui-ci ne tarda pas à marquer son impuissance. Une fois de plus les travailleurs furent trompés et déçus. Le salariat ne fut pas supprimé, comme ils l’espéraient dans leur naïveté. Les journées de février 1848 furent suivies d’une crise de chômage effroyable. Les revendications ouvrières en vinrent en fin de compte, à s’exprimer ainsi : « Le droit au travail ». Quelle aubaine pour le patronat !
Quelques mesures inopérantes, les unes platoniques, les autres vaines du gouvernement provisoire : la suppression du tâcheronat, la réduction de la journée de travail à dix heures à Paris et onze heures en province, n’étaient pas de nature à donner satisfaction aux réclamations des travailleurs et, moins encore, à solutionner les problèmes de l’heure.
C’est à ce moment, le 28 février 1848 que le gouvernement provisoire décida de créer les Ateliers Nationaux, pour parer au chômage grandissant.
Entreprise vouée à l’échec, voulue, d’ailleurs, tentée en pleine crise économique et sociale, les Ateliers Nationauxaboutirent à un lamentable fiasco qui prit fin le 19 juin 1848 par le vote de la loi Falloux qui ordonnait la dissolution desAteliers.
Cette dissolution qui ne laissait aux ouvriers d’autres alternatives qu’un chômage aggravé ou l’enrôlement dans l’armée, aboutit à l’insurrection du 23 juin 1848 qui fut réprimée avec une sauvagerie sans nom dont on ne retrouvera l’équivalente qu’en 1871.
Ces trois mois de misère du public trouvèrent leur épilogue dans les fusillades, l’emprisonnement, la déportation de milliers d’ouvriers, la suppression de la liberté de la presse. Œuvre d’une réaction qui ne devait plus cesser de s’aggraver.
Le rêve ouvrier était encore une fois à terre. Ainsi s’écroulaient à tout jamais les illusions du socialisme utopique fraternitaire, ayant foi dans la bonne volonté des classes adverses.
De même disparaissait de la scène le socialisme autoritaire qui attendait de l’action de l’État la réalisation de la justice sociale.
De cette longue et cruelle leçon devaient surgir les idées prolétariennes modernes : Proudhon a aidé considérablement à leur éclosion en publiant Les Contradictions économiques. Quelque jugement qu’on porte sur son œuvre si diverse, si touffue, si contradictoire, que certains ont pu dire de lui qu’il était le « Dieu de l’Anarchie », tandis que d’autres le traitaient de « petit bourgeois », il n’en est pas moins vrai que Proudhon exerça sur son époque, et longtemps après, une énorme influence.
Nous lui devons cette formule prophétique : « L’Atelier fera disparaître le gouvernement », dont la réalisation reste le souci du syndicalisme moderne. Apôtre de la liberté dont il avait le culte au plus haut degré, il lutta contre Marx et Engels qui étaient les apôtres de l’Autorité. Aussi, à peine ces hommes, doués les uns et les autres, d’une puissance de travail formidable, se furent-ils rencontrés qu’ils se séparèrent et s’affirmèrent d’irréductibles adversaires, comme le sont encore aujourd’hui les partisans de ces deux doctrines.
Le coup d’État du 2 décembre 1851 raffermit la réaction et il faut la venue d’éléments nouveaux pour que le prolétariat triomphe tant soit peu de la réaction. Le renouveau de l’action ouvrière ne se poursuivit qu’en 1862 après la visite des délégations ouvrières françaises à l’Exposition universelle de Londres, au cours de laquelle elle parut prendre contact avec les organisations anglaises.
L’année 1863 marqua une date importante dans le mouvement ouvrier français. C’est, en effet à ce moment que parut leManifeste des Soixante par lequel les ouvriers parisiens proclamaient la rupture entre le prolétariat et la bourgeoisie même républicaine.
Ce manifeste donna prétexte à Proudhon de publier son dernier livre : De la capacité politique des classes ouvrières. Pour la première fois, disait-il la plèbe a fait acte de personnalité et de volonté. Elle a bégayé « son idée ». C’était vrai.
En cette année 63, l’agitation ouvrière s’accrut fortement. Elle fut surexcitée par les poursuites dirigées contre les grévistes de la typographie parisienne. Le gouvernement dut céder devant les organisations et l’opinion, en faisant voter la loi de 1864 qui reconnaissait le droit de coalition. C’était la conquête du droit de grève encore que la loi s’efforçât d’en restreindre autant que possible l’exercice.
Dès lors, les événements se précipitent. En 1864, se constitue à Londres, la Première Internationale, l’Association Internationale des Travailleurs, fondée le 28 septembre après un meeting international à Saint-Martin’s Hall. Karl Marx en écrivit les statuts qu’on peut résumer ainsi : « Les travailleurs d’un même métier formaient une section, ces sections à leur tour une Fédération, et c’est de l’ensemble de ces Fédérations qu’était composée l’Internationale à la tête de laquelle se trouvait un Conseil central siégeant à Londres ».
La section française fut formée en 1865. Elle eut son siège rue des Gravilliers. Le premier congrès de l’Association Internationale des Travailleurs se tint à Genève en 1866.
Il fut remarquable de tenue et de clarté.
Pendant que la délégation française faisait admettre que le but de l’Internationale était : « La suppression du salariat et que celle-ci s’obtiendrait par l’association corporative des travailleurs, la délégation anglaise faisait accepter le principe de la journée de huit heures comme revendication générale du prolétariat ». On évoqua même, dès cette époque, l’idée de grève générale.
Le deuxième congrès se tint à Lausanne en 1867. Il resta dans la tradition mutuelliste ; il déclara en outre « Que l’émancipation sociale des travailleurs est inséparable de leur émancipation politique et que l’établissement des libertés politiques est une mesure d’absolue nécessité ».
Pour avoir osé émettre de semblables affirmations la section française fut poursuivie dans ce pays, sans que ces poursuites gênassent d’ailleurs en quoi que ce soit le développement de la Première A. I. T.
Les Congrès suivants : Bruxelles (1868), Bâle (1869), marquèrent une évolution très nette vers le collectivisme sous l’impulsion de César de Paëpe et de Karl Marx, dont l’influence ne devait pas tarder à se montrer prépondérante.
À Bâle on décida « que la propriété collective était une nécessité sociale, que la société avait le droit d’abolir la propriété individuelle du sol et de la faire rentrer à la Communauté ».
Cependant que décroissait « Mutuellisme » modéré français et que montait l’influence de Karl Marx, une autre tendance, celle des « fédéralistes » s’affirmait sous l’impulsion de Michel Bakounine.
Marx et Bakounine ne devaient pas tarder à s’affronter. Pendant que les Marxistes déclaraient que la révolution sociale ne peut s’accomplir que par la prise de l’État et affirmaient indispensable la constitution du prolétariat en parti politique, les fédéralistes, avec Bakounine, voulaient supprimer l’organisation bourgeoise, désorganiser l’État actuel et reprendre la reconstitution sociale à la base par la Commune, cellule initiale, ce qui ne diffère guère de ce que veulent accomplir les syndicalistes fédéralistes d’aujourd’hui avec les Bourses du Travail et les Unions locales.
En ce qui concerne le rôle des syndicats, la divergence n’était pas moins sensible. En effet, pendant que les premiers prétendaient que les syndicats devaient restreindre leur action à la seule défense des intérêts corporatifs, les seconds voyaient en eux non seulement un instrument de lutte, mais encore une institution durable, dont le rôle serait, la révolution accomplie, de continuer la production et d’organiser le travail. On ne dit pas autre chose aujourd’hui.
Ces divergences eurent pour conséquence la scission d’abord, la fin de l’A. I. T. ensuite. Lorsque Marx parvint à se débarrasser de Bakounine en dominant complètement le Comité central, l’Association Internationale des Travailleurs, qui avait suscité tant d’espoirs, alla s’éteindre obscurément en Amérique, à New-York.
Néanmoins, son influence et son rôle furent énormes. En le dotant de cette formule : L’Émancipation des Travailleurs sera l’œuvre des Travailleurs eux-mêmes, elle a imprimé au mouvement syndical son véritable caractère. En même temps qu’elle a précisé les aspirations et les idées du prolétariat, elle a défini le but final de ses efforts. Elle l’a aussi débarrassé de la gangue nationaliste. C’est un résultat qui compte.
L’Association Internationale des Travailleurs joua, en France, un rôle considérable. Elle servit de point d’appui solide au mouvement revendicatif. C’est sur elle que s’appuyèrent les grèves des textiles de Roubaix, qui tournèrent à l’émeute, et celles des mineurs de la Ricamarie (Loire) pendant les dernières années de l’Empire.
Puis ce fut la guerre de 1870–71 et la Commune où plusieurs des membres français du Conseil général de la Première Internationale, dont Varlin, jouèrent un rôle de premier plan.
Puis, après l’échec du mouvement communaliste vint la répression versaillaise avec Thiers et Galiffet qui exterminèrent, emprisonnèrent et déportèrent plus de trente mille personnes à Paris, cent dix mille dans la France entière.
Œuvre vaine, d’ailleurs, puisque les auteurs de ces méfaits abominables virent eux-mêmes se reconstituer presque aussitôt le mouvement qu’ils avaient cru détruire à jamais. N’y a-t-il pas là, dans cette résurrection, de quoi anéantir tout le pessimisme d’aujourd’hui ?
Les premiers qui tentèrent de reconstituer le mouvement ouvrier, sous l’état de siège et l’ordre moral, n’étaient certes pas des révolutionnaires. Mutuellistes, républicains, ils se donnaient comme but : la conciliation du capital et du travail, comme les démocrates sociaux d’aujourd’hui. Ils n’en furent pas moins traqués. Preuve suffisante pour démontrer que le capital et le Pouvoir pratiquent, eux, constamment la lutte de classe, même lorsque le prolétariat tend à collaborer avec eux.
Faible au début, ce mouvement n’en prit pas moins rapidement une certaine ampleur. Par ses moyens propres, il réussit à envoyer une délégation de 90 membres à l’Exposition Universelle de Vienne (Autriche), en 1873.
La même année, il crée le Cercle de l’Union Syndicale, lequel donne des inquiétudes au pouvoir qui le supprime aussitôt constitué. En 1875, il y avait 135 Chambres Syndicales qui purent à nouveau envoyer une délégation à l’Exposition Universelle de Philadelphie, en 1876.
C’est alors que cette délégation lança à son retour un manifeste qui rappelait celui des soixante de 1863. On y lisait ces lignes qui, aujourd’hui encore, ne manquent pas d’intérêt :
« Prolétaires, soyons bien persuadés que l’œuvre de la civilisation réside en nous et qu’elle ne s’accomplira que par nous. À l’œuvre, prolétaires ! Trop longtemps instruments de la puissance d’argent, tendons-nous la main et marchons, ainsi, à la conquête de nos instruments de travail, à la possession de la propriété qui, en toute justice, doit appartenir à nous ! Le Travail est le pivot de l’Humanité. Honneur aux travailleurs ! »
Quoique ce fût la pensée d’une minorité éclairée, assez faible, la tradition était renouée.
Les événements vont d’ailleurs se précipiter avec rapidité.
À peine la délégation des Chambres Syndicales était-elle partie pour Philadelphie que fut lancée l’idée d’un Congrès ouvrier, accueillie avec un vif enthousiasme dans le pays entier.
Il se tint le 2 octobre 1876. 94 groupements (76 de Paris, 16 de province plus 2 Unions Centrales constituées à Lyon et à Bordeaux, se réunirent) à Paris, salle des Ecoles, rue d’Arras ; 360 délégués y participèrent.
On a lu dans l’exposé historique des Bourses du Travail la façon dont Bonne (tisseur de Roubaix) ébauchait déjà le rôle à ce Congrès, le principal passage de la résolution qui y fut votée.
Certes, cette résolution n’était pas incendiaire. Loin s’en faut. Elle proclame cependant la nécessité de l’indépendance du mouvement ouvrier. De même elle se prononça contre le projet Lockroy, ce précurseur malhabile de Waldeck-Rousseau. Tranquillisés, les maîtres de l’heure purent croire que le mouvement ouvrier n’était plus à craindre. Ils se crurent débarrassés du « spectre rouge ». Ils devaient déchanter avant longtemps.
Les militants de l’école marxiste : Guesde, Lafargue, Chabert, rentrés d’exil, reprirent les doctrines du Conseil général de l’A. I. T. disparue. Ils tentèrent d’organiser un Congrès pendant l’Exposition Universelle de Paris, en 1878. Ils furent poursuivis et empêchés de le tenir.
Ils saisirent alors l’occasion qui leur était offerte de participer au 2° Congrès ouvrier qui se tint à Lyon, la même année. Malgré tous leurs efforts, les collectivistes ne purent influencer le Congrès qui ne se rendit pas à leurs idées.
C’est à ce Congrès que Balleret prononça son fameux discours contre l’électoralisme, la dictature et l’État, bien qu’il fut collectiviste. Il est vrai qu’à cette époque le collectivisme condamnait l’État, ce qui n’existe plus de nos jours chez les socialistes et les communistes qui ne voient de salut que dans une administration étatique centralisée.
Le 3ème Congrès se tint à Marseille, le 21 octobre 1879 : Les collectivistes y triomphèrent des mutuellistes qui furent écrasés.
Par 72 voix contre 27 le Congrès adopte pour but : la collectivité du sol, sous-sol, instruments de travail ; matières premières données à tous et rendues inaliénables par la Société à qui elles doivent retourner. Ce qui n’empêche nullement le Congrès d’invoquer la légalité et de déclarer que ce programme n’est réalisable que par la prise du pouvoir politique et de transporter dans l’arène politique l’antagonisme des classes. Décidément, dans un an, les collectivistes, parvenus à leurs fins, avaient fait du chemin, mais à rebours. C’est du Congrès de Marseille, en 1879, que date l’immixtion de la politique dans les syndicats. Ceux-ci s’en trouvèrent gênés jusqu’à la constitution de la C. G. T. en 1895.
L’unité ouvrière en fut retardée d’un quart de siècle. Et ce fut une suite de luttes terribles qui s’aggravèrent encore du fait des scissions qui se produisirent et se multiplièrent dans le Parti socialiste en se répercutant dans les Syndicats, comme aujourd’hui.
D’un côté, le socialisme faisant de l’État l’organe et la fin de la transformation sociale ; de l’autre, un assemblage de doctrines contradictoires qui s’efforçaient dans leur condensation difficile de se rapprocher du Bakouninisme et des Fédéralistes de l’Internationale.
Le fossé entre le Parti socialiste et les Syndicats se creusa sans cesse. Sentant que l’action politique compromettait leur unité et contrariait leur activité, les Syndicats s’en détournèrent.
Dans le Parti socialiste les choses se gâtèrent d’ailleurs rapidement. Une première scission se produisit en 1881. Brousse, Joffrin, Rouanet, Ferroul et Boyer se séparèrent des guesdistes pour former la tendance « possibiliste ».
Pendant ces déchirements socialistes, les Syndicats poursuivirent une existence obscure.
Pourtant un vaste travail en vue d’une organisation plus grande se faisait sur le terrain économique. En 1883, une organisation, la corporative du Ve Arrondissement de Paris, appelait les salariés à l’union « entre tous ceux qui voulaient l’affranchissement des travailleurs par eux-mêmes ».
L’année suivante, en 1883, un groupe d’ouvriers publia une brochure dont quelques formules sont remarquables pour l’époque
« Le Prolétariat, pour sa lutte émancipatrice, trouve aujourd’hui dans la corporation, sa base d’opération la plus sûre, comme jadis la bourgeoisie, pour son affranchissement, trouva la sienne dans la commune.
Il s’agit d’ouvriériser la Société, de façon que, sur les ruines d’un monde où l’on tenait à honneur de vivre noblement sans rien faire, il s’élève un monde plus juste où chacun puisse vivre en travaillant et ne puisse vivre autrement. La clef de la question sociale, c’est la corporation ».
N’y a-t-il pas dans cette idée, bégayée, comme le disait Proudhon en 1863, l’idée de la reconstruction sociale dont les Syndicats seront les cellules ? Bien que leur existence fût obscure, comme nous l’avons dit, l’organisation corporative ouvrière n’en progressait pas moins.
En 1881, on comptait en France 500 Chambres Syndicales ouvrières, dont 150 à Paris, avec 60.000 adhérents ; les patrons avaient à cette époque 138 Associations groupant 150.000 membres, si l’on s’en tient au rapport d’Allain Targé à la Chambre sur l’abrogation des arts. 414, 415 et 164 du Code pénal en 1881.
C’est en cette année 1881, que fut constituée la Fédération des Travailleurs du Livre. Celle des Charpentiers existait depuis 1880, de même que celle des mineurs. Les Fédérations lithographique et culinaire furent constituées en 1884. C’est à ce moment que le législateur sentit la nécessité d’introduire dans le Code la reconnaissance du droit syndical, de le codifier pour canaliser l’effort ouvrier, afin de faire des syndicats un contrepoids au patronat.
La loi du 21 mars 1884 fut l’œuvre habile de Waldeck-Rousseau.
Cette loi n’était, bien entendu, libérale qu’en apparence. Elle reconnaissait un fait sur lequel il était impossible de revenir. Elle établissait la séparation entre le droit de coalition et le droit syndical. De même, elle maintenait l’art. 414 et 415 du Code pénal — toujours en vigueur — sur les atteintes à la « liberté du travail » ; elle refusait le droit syndical aux fonctionnaires et ouvriers de l’État ; elle tendait à restreindre l’activité du groupement corporatif. Le seul fait nouveau était la reconnaissance légale des Syndicats.
Elle n’eut de valeur que par l’action tenace des ouvriers qui firent reconnaître leurs organisations par le patronat, malgré que celui-ci s’y opposât fortement. Elle permit au syndicalisme de se développer plus facilement et l’État ne perdait pas l’espoir d’utiliser cette force naissante contre le capitalisme industriel et bancaire qui tentait, chaque jour un peu plus de se substituer à lui.
La circulaire de Waldeck-Rousseau, adressée aux Préfets, montre bien tout le parti que le Gouvernement comptait tirer des Syndicats, s’il réussissait à les maintenir sous sa tutelle.
Pendant que le pouvoir tentait de réaliser ses desseins, le syndicalisme prenait force et vie. Les ouvriers acquéraient la notion de l’interdépendance des corporations. Ils saisissaient mieux aussi la généralisation indispensable de leurs Unions. Ils n’accordaient d’ailleurs à la loi de 1884 que sa valeur restreinte. Ils ne l’accueillirent que très fraîchement et en 1886, au Congrès de Lyon, ils la dénoncèrent comme un piège. Longtemps, ils ne s’y conformèrent que peu ou point.
D’ailleurs si cette loi n’est plus combattue aujourd’hui avec la même vigueur, cela tient à ce que le Pouvoir a laissé tomber en désuétude la plupart des dispositions restrictives qu’elle contient.
Nous sommes, aussitôt le vote de cette loi, en pleine confusion. À l’intrusion du Parti politique dans le mouvement syndical, il faut ajouter la scission du Parti socialiste, comme nous l’avons vu. Mais le morcellement ne devait pas s’arrêter là. Les « possibilistes » de la Fédération des Travailleurs socialistes devaient connaître une nouvelle scission. Les « allemanistes » sortirent de la Fédération pour former le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire.
Il est impossible d’étudier ici toutes les querelles qui opposèrent les unes aux autres les fractions socialistes, mais on doit les mentionner pour aider à comprendre l’histoire du syndicalisme et les difficultés qu’il rencontrera par la suite, à partir de 1920.
Si ces scissions eurent pour conséquence de gêner considérablement le développement du syndicalisme, elles empêchèrent, par contre, un Parti d’accaparer son action et de le mettre en tutelle.
Il serait puéril cependant de nier l’influence du socialisme de cette époque sur le syndicalisme à peine organisé. Il ne faudrait pas non plus surestimer cette influence. Les syndicats non socialistes ne tardèrent pas, par exemple, à reconnaître l’impossibilité de concilier les intérêts des travailleurs avec ceux des patrons. L’esprit révolutionnaire ne tarda pas à se développer chez eux.
Les divisions qui réduisaient le socialisme à l’impuissance eurent pour effet de rapprocher les ouvriers de l’action, spécifiquement syndicale qui prit sans cesse une plus grande place. Déjà, ils ne la subordonnaient plus aussi complètement à l’action politique, lorsque les « allemanistes » proclamèrent au X° Congrès, en 1891, « que l’action politique n’a guère que la valeur d’un moyen de propagande et d’agitation ».
Cette motion déclarait en outre : « Il y a nécessité d’envisager une levée en masse des travailleurs, qui par la grève générale nationale et internationale, donneront une sanction aux grèves partielles ».
C’était la première fois que l’idée de la grève générale était formulée d’une façon claire et nette. Elle devait faire son chemin.
À côté des « allemanistes », les « blanquistes » du Comité révolutionnaire central (fondé en 1881) avec Vaillant, tendaient à reconnaître au mouvement syndical une certaine autonomie pendant que les anarchistes-communistes, dont le rôle ne tardera pas à être prépondérant, affirmaient déjà la nécessité de l’indépendance du syndicalisme.
C’est sous de tels auspices que se réunit le Congrès de Lyon, le 11 octobre 1886. Alors que les socialistes pensaient que les Syndicats étaient acquis « au socialisme parlementaire », ceux-ci s’affirmèrent au contraire nettement « révolutionnaires ».
Pour différencier les deux sections du mouvement ouvrier, le Congrès décida la constitution d’une Fédération des Syndicats qui permettrait de distinguer les deux actions : économique et politique.
Il vota, à ce sujet la résolution suivante :
« La Fédération nationale des Chambres Syndicales se déclare sœur de toutes les Fédérations socialistes ouvrières existantes, les considèrent comme une armée tenant une autre aile de la bataille ; ces deux armées devront dans un temps peu éloigné faire leur jonction sur un même point pour écraser l’ennemi commun. »
À vrai dire c’était là une affirmation assez équivoque de l’autonomie des mouvements. La prédominance du Parti y était à peine masquée. On s’en aperçut bien au Congrès de Montluçon en 1887 et on le vit mieux encore lorsque la Fédération des Syndicats et groupes corporatifs ouvriers de France tint ses assises dans les mêmes villes et avec les mêmes éléments, en même temps que l’organisation politique à la remorque de laquelle elle traîna une existence peu brillante, malgré quelques velléités d’indépendance, comme à Bordeaux en 1888.
Elle disparut d’ailleurs assez vite de la scène. Sans programme bien à elle, machine politique au service de l’action électorale, elle était d’avance vouée à l’impuissance. Sa disparition fut encore hâtée par l’apparition des Bourses du Travail, fait capital de cette époque du mouvement syndical.
On a trouvé dans l’étude consacrée à la Bourse du Travail toute l’histoire de celle-ci et son origine. Nous n’y reviendrons donc pas ici. Nous nous bornerons à constater que la première Bourse fut créée à Paris en 1886, après l’adoption du projet Mesureur.
Les Bourses se multiplièrent rapidement. II y en avait 14 en 1892. Elles eurent tout naturellement l’idée de se fédérer entre elles et mirent leur projet à exécution à Saint-Étienne, le 7 février 1892.
Leur but, leur constitution furent définis à ce Congrès. De cette époque date la deuxième phase évolutive du syndicalisme qui va sans tarder affirmer son caractère de mouvement spécifique de classe.
Le Syndicat socialiste sentant le danger que représentait pour eux la jeune Fédération des Bourses, repoussa la proposition d’un Congrès commun à la réunion des Syndicats de la Fédération des Syndicats à Marseille en 1892.
Ce Congrès de Marseille de la Fédération des Syndicats eut à se prononcer sur la résolution votée à la Conférence régionale de Tours qui s’était tenue quelques jours auparavant et avait adopté la grève générale comme seul moyen révolutionnaire. Malgré tout le talent de M. Aristide Briand — qui depuis... — le Congrès de Marseille marqua sa rupture avec les Syndicats en repoussant leur suggestion.
C’est alors que se tint à Paris, en 1893, un autre Congrès des Bourses qui fut retardé en raison de la fermeture de la Bourse du Travail de Paris par Charles Dupuy, président du Conseil, à qui l’activité des Bourses portait ombrage.
Ce Congrès se tint le 12 juillet 1893. Il eut tout de suite le caractère d’une protestation véhémente contre le coup de force gouvernemental. Un grand nombre de délégués, y compris ceux représentant les Centres inféodés au Parti, y assistaient.
La discussion sur la question d’union des forces ouvrières se termina par le vote de la résolution ci-dessous :
« Tous les Syndicats ouvriers existants devront, dans le plus bref délai, adhérer à leur Fédération de métier ou en créer, s’il n’en existe pas ; se former en Fédérations locales ou Bourses du Travail, puis ces Fédérations et ces Bourses du Travail devront se constituer en Fédérations nationales.
À cet effet, le Congrès émet le vœu que la Fédération des Bourses du Travail de France et la Fédération nationale des Chambres Syndicales se fondent en une seule et même organisation.
Il sera fondé un Comité Central composé de deux délégués par Fédération de métier et quatre pour la Fédération nationale des Bourses du Travail et les Chambres Syndicales. »
Ce ne fut, hélas !, qu’un vœu. L’organisation unique ne devait surgir que deux ans plus tard, en 1895, après la disparition effective de la Fédération des Syndicats en 1894, après le Congrès de Nantes.
L’idée concrète de l’Unité au mouvement syndical n’en date pas moins de ce Congrès. Elle devait trouver sa matérialisation assez rapidement. Elle se fera pressante jusqu’au point d’apparaître comme la préoccupation dominante de la classe ouvrière.
Un recul suivit pourtant cette décision du Congrès de 1893.
Le Congrès avait bien nommé une Commission de neuf membres dite « d’organisation de la grève générale », mais elle fit aucun travail vraiment positif. Il convient d’ailleurs d’ajouter que le Parti ouvrier français ne lui ménagea pas les ennuis et il fit si bien qu’au Congrès de Nantes, en 1894, les deux Fédérations (Bourses et Syndicats), organisèrent deux Congrès séparés.
La Bourse du Travail, sollicitée par les deux groupements, leur déclara qu’il ne lui semblait pas nécessaire d’organiser ces deux Congrès et leur proposa de fusionner. Tandis que la Fédération des Bourses acceptait aussitôt, celle des Syndicats donna son adhésion d’assez mauvaise grâce, après avoir tenté de tenir son Congrès à Saint-Nazaire. C’était, pour le Parti ouvrier français un échec incontestable. Aussi, décida-t-il, pour la première fois, que le Congrès politique précéderait celui des Syndicats. Il espérait qu’en se prononçant contre la grève générale, il influencerait le Congrès des Syndicats. Il n’en fut rien.
Les éléments des Syndicats du Parti furent complètement défaits et c’est par 67 voix contre 37 que le Congrès se prononça contre la thèse du Parti ouvrier français.
La cassure était consommée et l’Unité, un moment entrevu semblait s’éloigner à nouveau.
Ces perspectives alarmantes disparurent assez vite en raison du rôle réduit que joua désormais la Fédération des Syndicats.
Ombre d’elle-même, elle tint un Congrès à Troyes en 1895. Elle anathématisa contre la grève générale et repoussa l’idée de la grève générale, mais elle ne put empêcher que la Confédération Générale du Travail naisse à Limoges en cette même année 1895.
D’autres faits allaient concourir à soustraire le mouvement syndical à l’influence des partis politiques. Guesde, en effet, réagit vigoureusement contre cette séparation du syndicalisme et du socialisme parlementaire, et le Congrès international socialiste de Londres (1895) eut à examiner longuement cette question.
Déjà, il avait pris la précaution, dans un précédent Congrès international tenu à Zurich, de faire voter avec ses amis de l’Internationale, une résolution qui excluait tous les adversaires de l’action parlementaire
Cette résolution disait :
« Toutes les Chambres Syndicales seront admises au Congrès, et aussi les Partis et les organisations socialistes qui reconnaissent la nécessité de l’organisation des travailleurs et de l’action politique.
Par l’action politique on entend que les organisations des Travailleurs cherchent autant que possible à employer ou à conquérir les droits politiques et le mécanisme de la législation, pour amener ainsi le triomphe des intérêts du prolétariat par la conquête du pouvoir politique. »
On comprend aisément qu’ainsi préparé, le Congrès de Londres ne fut qu’une violente réaction des politiciens contre le syndicalisme affirmant sa maturité. La bataille commence par la discussion sur la validation des mandats. Les politiques contestèrent ceux des délégués ouvriers en rappelant la décision de Zurich. Les deux thèses s’affrontèrent avec force. Ce fut Guesde qui engagea la bataille.
Tranchant comme à son habitude, il déclara :
L’action corporative est une simple interprétation de l’ordre capitaliste. La classe ouvrière ne peut se désintéresser du gouvernement. C’est au gouvernement, c’est au cœur qu’il faut frapper. Dans ce Congrès, il n’y a pas de place pour les ennemis de l’action politique. Ce n’est pas de l’action corporative qu’il faut attendri la prise de possession des grands moyens de production. Il faut d’abord prendre le gouvernement qui monte la garde autour du capitalisme. Ailleurs, il n’y a que mystification, il y a plus, il y a trahison... Ceux qui rêvent une autre action n’ont qu’à tenir un autre Congrès.
Comme on le voit, la condamnation était formelle, sans réplique. Aveuglé par son dogmatisme politique, Guesde ne pouvait comprendre que c’est par l’action simultanée de destruction du pouvoir bourgeois et de prise des moyens d’échange et de production que le prolétariat, toutes forces réunies, mettra fin au régime capitaliste.
Il n’en fut pas moins suivi par tous les représentants socialistes français : Jaurès, Gérault-Richard, Viviani, Deville, Rouanet et Millerand, dont la majorité devait, par la suite, faire une si brillante carrière dans le sein de la bourgeoisie, avec Guesde lui-même.
Les représentants socialistes étrangers ne furent d’ailleurs pas moins catégoriques. Nous sommes, proclament Wilhem Liebknecht, avec les « collectivistes », contre les « anarchistes ».
C’était le renouvellement des luttes de la 1ère Internationale, les mêmes que celles que nous connaissons aujourd’hui.
Les délégués syndicaux français se défendaient d’assister à ce Congrès en tant qu’anarchistes. Ils n’étaient que des délégués ouvriers et rien de plus, quelles que soient, affirmaient-ils, leurs pensées personnelles.
C’étaient, parmi les plus marquants, Pelloutier, secrétaire des Bourses ; Allemane, leader du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire ; Vaillant, député de la Seine ; Pouget, rédacteur du « Père Peinard » ; Guérard, des cheminots ; Tortelier, un des précurseurs du syndicalisme. Tous se réclamaient purement et simplement de leur mandat syndical.
Ce mandat se traduisait ainsi : S’abstenir de toute discussion, de toute déclaration politiques ; sur ce point, ils étaient neutres, si bien qu’ils s’abstinrent dans le vote excluant les anarchistes proprement dit. Ils ne voulaient faire que de l’action syndicale.
La délégation française se sépara en deux parties à peu près égalés : 57 contre, 56 pour.
Furieux, les socialistes français firent claquer les portes et se retirèrent, en dénonçant comme une manœuvre de la réaction — déjà — cette indifférence des syndicats pour la conquête du pouvoir qui livrait le socialisme à l’ennemi.
Le Congrès se montra lui-même, si possible, plus intransigeant encore.
La tendance politique s’y affirma nettement... « L’action législative et parlementaire » fut considérée « comme l’un des moyens nécessaires » pour arriver « à la substitution du socialisme au régime capitaliste ». En conséquence, déclarait Wilhem Liebknecht, dans sa motion, les anarchistes seront exclus.
Ces décisions du Congrès de Londres eurent pour résultat d’accentuer la séparation des deux mouvements en France. C’était le rôle que devait jouer le Ie Congrès de l’I. S. R. en 1922.
« Tous les militants de l’action syndicale, écrivait aussitôt Pelloutier, vont exploiter l’intolérance stupide de la majorité pour élargir le fossé qui séparait déjà les syndicats des politiciens ». Il en fut ainsi jusqu’en 1906, après que les partisans de l’action politique eurent multiplié leurs assauts jusqu’au Congrès d’Amiens en 1906.
La résolution de Londres n’eut pas des effets qu’en France. Elle paralysa longtemps, et jusqu’à la guerre, l’activité de l’Internationale syndicale. C’est un chapitre qui sera étudié plus loin.
* * *
CONSTITUTION DE LA C. G. T.
La constitution de la Fédération des Bourses du Travail n’avait fait qu’ébaucher l’organisation nationale du syndicalisme français. C’était certes, un commencement important, mais il était évident qu’une tâche considérable restait à accomplir.
Les Bourses du Travail réalisaient bien le lien social — le plus important — entre les Syndicats d’une même localité, la Fédération réalisait bien aussi ce lien au point de vue national, mais il était évident qu’il fallait aussi réaliser la liaison nationale entre les Syndicats d’un même métier.
Les Guesdistes avaient tenté de le faire avec leur Fédération des Syndicats, tandis, que par contre, ils n’avaient pas, par méconnaissance ou dogmatisme étroit, cherché à réaliser le lien social.
Il est fort probable que l’absence de ce lien qui favorisait l’action du Parti ou des Partis socialistes fut volontaire parce que les Guesdistes sentaient déjà que le syndicalisme, ainsi organisé socialement, ne tarderait pas à s’émanciper de leur tutelle. Il ne faut pas chercher d’autre raison à l’hostilité sans cesse accrue que les Guesdistes manifestèrent toujours à l’égard de la Fédération des Bourses du Travail, cellules de la Société de l’avenir.
Avortée dès sa constitution, la Fédération des Syndicats n’eut ni le programme sérieux, ni l’action vigoureuse capables d’attirer les travailleurs.
Ceux-ci, la sentant d’ailleurs placée sous les directives politiques, la boudèrent. Les querelles, les scissions dont le Parti socialiste fut l’objet les en détachèrent définitivement. Instinctivement, ils se rapprochèrent de la Fédération des Bourses et, y adhérant en grand nombre, lui donnèrent tout de suite une importance considérable, pendant que, sous l’influence et par le labeur acharné de Pelloutier, elles jouaient un rôle de plus en plus grand.
Ce ne fut, certes, pas l’œuvre d’un jour. Ce n’est qu’après bien des tâtonnements, des erreurs souvent graves, des incohérences forcées que, dans ces temps troublés, la Fédération des Bourses parvint à faire comprendre la neutralité politique que le Congrès d’Amiens devait proclamer comme la première condition d’Unité ; et que le mouvement ouvrier réussit à donner son organisation propre, de classe, indépendante de tous les partis.
Ce sont autant de difficultés que les militants durent vaincre, difficultés que ne comprennent pas toujours les hommes de notre époque qui ignorent, en immense majorité, comment s’est constituée la C. G. T.
Le syndicalisme actuel, dans ses organes comme dans ses idées — trop souvent inexprimées — n’est pas le résultat de l’application d’un plan, d’un système préconçu. Il est la conséquence d’une longue étude des faits sociaux, de leurs enseignements. Il résulte d’une longue et pénible évolution qui continue. Son aspect, ses caractéristiques particulières se modifient selon les nécessités du moment. Il en sera toujours ainsi parce qu’il est l’interprétation aussi exacte que possible de la vie en perpétuelle évolution. Le syndicalisme de l’an 2000 ne ressemblera pas plus à celui 1925 que celui-ci ne ressemble au mouvement de 1873. Il peut évoluer à l’infini, donner à toutes les périodes de l’histoire, satisfaction à tous les individus, quelle que soit leur philosophie. Il peut réaliser aussi bien le communisme organisé que le communisme libre associatif et momentané pour atteindre, un jour, au stade supérieur de l’Anarchie. Ceci est suffisant pour que tous les travailleurs y trouvent place et tentent dans son sein d’acquérir le maximum de bien-être et de liberté correspondant à chaque époque de l’histoire, à chaque stade de l’évolution. Le syndicalisme est un perpétuel devenir.
C’est ce que comprit Pelloutier lorsqu’il entreprit l’œuvre grandiose qui devait trouver son achèvement dans la constitution des Bourses du Travail et la constitution de la C. G. T. C’est ce qu’il précisa dans sa fameuse lettre aux anarchistes.
C’est sous l’empire de ces idées générales, mal assises, confuses peut-être, que délibéra le Congrès de Nantes en 1894.
Pelloutier proposait que le lien commun fût le Comité de grève générale ; d’autres comme Bourderon, qui représentait la Bourse du Travail de Paris, voulaient créer un lien national plus solide.
Il en sortit un Comité Syndical ouvrier mal venu, qui resta incompris, n’eut qu’une influence restreinte et, en réalité, ne fonctionna que peu ou même pas du tout. Il n’en formait pas moins l’embryon de la future C. G. T.
Le Congrès de Nîmes, en 1895, indiqua le développement de la Fédération des Bourses et la place de première importance qu’elle prenait dans le mouvement ouvrier. C’est ce Congrès qui appela Pelloutier au Secrétariat national de la Fédération des Bourses : Il le conserva jusque sa mort, en 1900.
Les militants, disait ce Congrès, sont à nouveau préoccupés de donner un organisme sérieux et durable au prolétariat français, ils sont préoccupés aussi de rechercher les moyens, les plus propres à unifier les organisations ouvrières, à coordonner les forces syndicales et à dresser, en face du capital, l’armée du prolétariat.
C’est à cette tâche que se consacra le Congrès de Limoges qui s’ouvrit le 23 septembre 1895.
À ce Congrès étaient représentées : 28 Fédérations, 18 Bourses et 18 Chambres Syndicales. La première question à l’ordre du jour était la suivante : Plan général d’organisation corporative, de l’action et des attributions des différentes organisations existantes.
Cette seconde partie de l’ordre du jour avait pour but de faire disparaître le chevauchement d’attributions dangereuses et qu’il fallait, autant que possible, délimiter. On n’y parvint d’ailleurs qu’assez mal.
Ce Congrès marqua la prépondérance incontestée de la Fédération des Bourses. Il marqua la nécessité de tenir l’action syndicale hors de l’action politique, il reconnut l’indispensabilité de séparer les deux mouvements : économique et politique.
Après une longue discussion, la Commission d’organisation corporative proposa les dispositions suivantes qui indiquaient les statuts primitifs de l’organisation Confédérale :
-
Entre les divers Syndicats des groupements professionnels, de Syndicats d’ouvriers et d’employés des deux sexes existant en France et aux Colonies, il est créé une organisation unitaire et collective qui prend pour titre : Confédération Générale du Travail. Les éléments constituant la Confédération Générale du Travail devront se tenir en dehors de toutes écoles politiques ;
-
La Confédération Générale du Travail a exclusivement pour objet d’unir, sur le terrain économique et dans des liens d’étroite solidarité, les travailleurs en lutte pour leur émancipation intégrale ;
-
La Confédération Générale du Travail admet dans ses rangs a) Les Syndicats ; b) Les Bourses du Travail ; e) Les Unions ou Fédérations locales de Syndicats de diverses professions ou de métiers similaires ; d) Les Fédérations départementales ou régionales de Syndicats ; e) Les Fédérations nationales de Syndicats de diverses professions ; f) Les Unions ou Fédérations nationales de métiers et les Syndicats nationaux ; g) Les Fédérations d’industrie unissant diverses branches de métiers similaires ;
Les articles suivants fixaient la constitution intérieure de la C. G. T., à la tête de laquelle se trouvait placé un Conseil National formé de délégués des Unions ou Fédérations, les attributions de celui-ci et des Commissions qu’il pourrait constituer, l’institution d’un Congrès annuel. À la vérité, tout cela était assez confus, mais correspondait à la complexité, à la diversité des organismes ouvriers de cette époque. C’était plutôt un « entassement » — le mot est de Jouhaux — qu’une organisation rationnelle.
Si imparfaite qu’elle soit, l’œuvre accomplie à Limoges est loin d’être négligeable. Elle marque un sérieux progrès sur ce qui existait auparavant.
La nouvelle organisation, pour primitive et imparfaite qu’elle fût, rencontra d’ardents défenseurs qui, avec raison d’ailleurs, ne se masquèrent pas leurs critiques.
Le 3ème Congrès National corporatif se tint à Tours, du 14 au 19 septembre 1896.
Il constata que la fusion des éléments participant à l’action confédérale (Fédérations d’Industrie et Bourses du Travail), était loin d’être accomplie, que l’unification n’était guère que théorique.
La Fédération des Bourses, en particulier, avait une assez grande méfiance à l’égard de la nouvelle organisation dont l’activité était restreinte. Elle tint un Congrès à Tours avant le Congrès Confédéral. Il s’ouvrit le 9 septembre.
Pelloutier voulait qu’on définît le rôle général des groupements locaux et par contrecoup la valeur de transformation du syndicalisme.
Il fut décidé de donner aux Bourses un programme de recherches méthodiques sur ces conditions économiques du travail, de la production, de l’échange, de façon qu’en étudiant les régions qu’elles embrassent en apprenant, avec les besoins, les ressources industrielles, les zones de culture, la densité de la population, en devenant des écoles de propagande, d’administration, d’études, en se rendant pour tout dire en un mot, capables de supprimer et de remplacer l’organisation présente, elles s’affirment comme une institution pouvant s’adapter à une organisation sociale nouvelle. N’est-ce pas là, concrètement définie, la pensée des syndicalistes d’aujourd’hui ? N’est-ce pas cette idée qui les a guidés lorsqu’ils voulaient substituer les Unions régionales économiques, au Congrès constitutif de la C. G. T. et, en juillet 1922, aux Unions départementales, délimitations politiques sans valeur pour le mouvement syndical ?
Le Congrès des Bourses définit ainsi son attitude en regard de la C. G. T. Le Congrès des Bourses du Travail accepte la constitution d’une Confédération exclusivement composée des Comités fédéraux des Bourses du Travail et des Unions locales de métiers, cette Confédération n’ayant pour objet que d’arrêter, sur les faits d’intérêt général qui intéressent le mouvement ouvrier, une tactique commune, et la réalisation de cette tactique restant aux soins et à la charge de celles des Fédérations adhérentes qu’elle conserve.
Ce n’était, évidemment, qu’une adhésion conditionnelle, réservée, mais telle qu’elle, elle marquait un grand pas en avant vers l’Unité réelle.
Le Congrès des Bourses régla ainsi qu’il suit les rapports des deux organisations (Bourses et Syndicats).
Pour arriver à diminuer la durée des Congrès, le 5e Congrès des Bourses est d’avis que :
-
Chaque Fédération Nationale doit supprimer de son ordre du jour particulier, toutes les questions d’intérêt général, l’étude de ces questions devant être laissée au Congrès général des Syndicats ;
-
Tous les Congrès administratifs doivent se tenir à la même époque et dans la même ville. Pour sanctionner ce vœu, il décide que les futurs Congrès des Bourses du Travail n’inscriront à leur ordre du jour que les questions intéressant les Bourses du Travail. Cette résolution fut acceptée par 25 voix contre 5. Ainsi fut défini le régime sous lequel devaient se tenir pendant 8 années les assises nationales du mouvement syndicaliste français.
Le Congrès de la C. G. T. s’ouvrit aussitôt après, avec 71 délégués représentant 203 organisations corporatives. Il discuta surtout l’attitude des syndicats vis-à-vis de la politique.
Les questions politiques disait Keufer, les rivalités d’école qu’on ne compte plus, ont dispersé les effets, augmenté les divisions et l’impuissance.
Ne se croirait-on pas en 1925 ? Les délégués furent unanimes à écarter des Syndicats « ce brandon de discorde », en même temps qu’ils précisèrent, comme suit, la mentalité, syndicale.
Le Congrès corporatif de Tours invite les organisations corporatives à se tenir à l’écart de toute action politique.
On aurait aujourd’hui grandement besoin de revenir à cette saine conception du syndicalisme.
Le principe de la grève générale fut aussi accepté à la presque unanimité avec une précision importante dont la valeur reste totale aujourd’hui.
La grève générale comme la grève partielle, sont des conflits d’ordre économique, et si, après les Syndicats, l’idée en a été propagée par des groupements politiques révolutionnaires, qui acceptent les décisions des Congrès ouvriers au lieu de les combattre, ils n’en conservent pas moins un caractère de lutte purement syndicale.
Le Congrès ne faisait pas, toutefois, de l’acception de ce principe, une condition formelle et absolue à l’admission à la C. G. T.
Tours marquait un très gros progrès sur les Congrès antérieurs. Il restait beaucoup à faire pour faire passer son œuvre théorique dans le domaine des faits.
Ce fut l’œuvre du Congrès de Montpellier en 1902. Entre temps, les deux organisations (Bourses et Syndicats) vécurent côte à côte sans cesser d’avoir leur vie propre, se querellant souvent, méfiante l’une vis-à-vis de l’autre. La Fédération des Bourses dominait manifestement, sous l’admirable impulsion de Pelloutier. Elle traduisait fréquemment ses craintes d’être absorbée par la C. G. T. À son Congrès de Toulouse, en 1897, elle se montra renforcée et agissante, désireuse d’étendre son action aux milieux ruraux et maritimes, dont Pelloutier avait pressenti le grand rôle dans la révolution économique.
Le Congrès des Syndicats, moins important, tenta, lui aussi, de définir les attributions et représentations des deux organismes au sein de la C. G. T.
Toulouse fut un essai d’unification qui aurait dû logiquement se continuer à Rennes en 1898. Ce fut le contraire.
Ce Congrès de Rennes aboutit en fait à la séparation des deux sections Confédérales. Aucun doute n’est permis lorsqu’on lit dans la résolution adoptée, ce passage significatif :
Les deux organismes constituant la Confédération (Comité National et Fédérations des Bourses) ne se réunissent qu’en cas d’événements imprévus et nécessitant manifestement une entente.
Si l’idée d’Unité subsistait, elle n’était pas moins en recul quant à la réalisation.
En somme, la C. G. T. ne constituait qu’une sorte de lien moral entre les deux Organisations qui la composaient. Des militants virent immédiatement le danger d’une telle situation. On sera obligé de les réunir à nouveau disait Braun (Fédération de la Métallurgie). « Le Congrès de Rennes n’a pas fait de bonne besogne ». La question de votation fut aussi posée au 10ème Congrès Corporatif National. Il s’arrêta au système du vote unitaire par Syndicat, quelle que soit l’importance numérique de celui-ci. Cette question reviendra d’ailleurs par la suite devant les Congrès suivants. Elle n’a pas cessé de se poser et continuera à l’être pendant longtemps encore.
À cette époque, nous étions en plein dreyfusisme, et le Syndicalisme ressentait fortement les secousses de l’agitation provoquée par cette affaire Dreyfus ainsi que par les crises industrielles qui se produisirent alors.
Aussitôt le Congrès de Rennes terminé, la grève des Terrassiers de la Seine, auxquels s’étaient joints un grand nombre de travailleurs du Bâtiment, battait son plein. 50.000 ouvriers au moins étaient en grève. Le moment parut propice pour engager la lutte et déclencher la grève générale.
Les Fédérations des Métallurgistes et des Cheminots se montrèrent très enthousiastes pour ce mouvement. C’est surtout de la Fédération des Cheminots que le signal était attendu pour ce mouvement, dont on escomptait beaucoup en raison de l’effet politique et économique qu’il ne devait pas manquer de produire, à la veille de l’Exposition Universelle de Paris (1900).
Le Gouvernement ayant intercepté les ordres de grève des Cheminots, l’échec fut complet dans cette corporation et, par répercussion, dans toutes les autres.
Lagailse, secrétaire de la C. G. T. et secrétaire adjoint des Cheminots, démissionna.
Par contre, les organisations du Bâtiment, mais elles seules, obtinrent de sensibles améliorations qui devaient, par la suite, largement contribuer au développement du syndicalisme dans cette importante industrie.
L’agitation au sujet de l’affaire Dreyfus sépara en deux groupes les forces ouvrières. Pendant que les unes étaient pour la révision, avec ceux qui suivaient Jaurès et Allemane dans le Parti socialiste, les autres se tenaient dans la neutralité. Les anarchistes participèrent, eux, activement à l’agitation « Dreyfusarde » avec Sébastien Faure, au premier rang de la bataille.
L’aboutissant de cette campagne fut le triomphe de la coalition des gauches et l’entrée de Millerand dans le ministère Waldeck-Rousseau, aux côtés de Galiffet le massacreur des Communards. Drôle de symbole qui prendra par la suite toute sa signification, lorsque Millerand arrivera au pinacle.
Et c’est à ce moment que s’ouvrit ce qu’on a appelé la période du Millerandisme, dont le but consistait à enrégimenter les forces ouvrières pour soutenir un pouvoir d’État chancelant. Le programme du Millerandisme fut exposé à Saint-Mandé en 1901, par son auteur.
Quoique habile, ce calcul n’eut pas les résultats attendus par les libéraux flanqués de Millerand-le-Renégat.
Toutes les prévisions de Millerand furent détruites et ses espoirs furent mis à terre par la grande grève du Creusot qui devait forcer 3.000 ouvriers à s’exiler et aboutit à la négation du droit syndical dans la contrée soumise au bon plaisir de Schneider.
L’incident sanglant survenu au cours d’une grève à la Martinique détourna définitivement les ouvriers du Millerandisme.
Entre temps, eut lieu, à Paris, le Congrès des Bourses, en 1900, ou 34 organisations étaient représentées. La question des rapports avec les partis politiques fut encore posée, mais sans succès pour ceux qui discutaient la fusion avec les groupes socialistes.
Après une belle démonstration de Pelloutier condamnant l’effet désastreux qui résulterait de cette fusion le Congrès adopta, à l’unanimité, la motion suivante de la Bourse de Constantine
Considérant que toute immixtion des Bourses du Travail dans le domaine politique serait un sujet de division et détournerait les organisations syndicales du seul but qu’elles doivent poursuivre : l’émancipation des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes. Décide : Qu’en aucun cas, la Fédération des Bourses du Travail ne devra adhérer à un groupement politique. Mais d’autre part, par un sentiment qu’on ne s’explique guère autrement, par une crainte de déviation qui aurait annihilé toute l’action et la propagande de la Fédération des Bourses, il fit repousser l’adhésion plus complète à la C. G. T.
« Ces deux organisations, dit le délégué de Lyon, doivent marcher de pair et faire chacune son travail, mais sans se confondre ».
L’œuvre incomplète de Rennes n’était pas achevée. Le Congrès de la C. G. T. se tint également à Paris, du 10 au 14 septembre 1900. 236 organisations y étaient représentées par 171 délégués.
La question des Fédérations d’industrie y fut agitée sans trouver de solution. Elle n’est pas encore solutionnée en ce moment.
La plus importante décision qui fut prise par le Congrès, fut la publication d’un journal syndicaliste La Voix du Peuple. L’abonnement de ce journal fut obligatoire. Il fit partie de ce qu’on a appelé : la triple obligation confédérale.
Lagailse fut remplacé au Secrétariat Confédéral par Renaudin (des Cuirs et Peaux), qui ne resta que quelques mois en fonctions et fut lui-même remplacé par Guérard (des Cheminots). Les deux Congrès Corporatifs (Bourses et Fédérations) se tinrent l’un après l’autre mais non dans la même ville.
Celui des Bourses se tint à Nice, le 17 septembre 1901. Pelloutier, mort en 1900, avait été remplacé par Yvetot. Niel qui devait, un peu plus tard, être appelé au Secrétariat de la C. G. T. et qui représentait à ce Congrès la Bourse du Travail de Montpellier, concluait, dans son rapport sur la question de l’Unité, à l’union immédiate des deux grandes organisations nationales.
Cela est incompatible avec l’unité ouvrière, disait-il ; cela crée un antagonisme d’idées et de personnes. Il faut donc que l’une des deux disparaisse en tant qu’organisation centrale et qu’elle se fonde dans l’autre.
Et à son avis, ce qui peut surprendre ceux qui ignorent les idées de Niel, c’était la Fédération des Bourses qui devait disparaître ou tout au moins renoncer à son côté dirigeant.
Le Congrès n’entendit pas ce langage et ne suivit pas Niel. Yvetot s’opposa à la fusion ainsi conçue et sur son intervention, le Congrès se prononça en faveur « d’une étude plus approfondie » du projet Niel.
Toutefois, les désirs et les besoins d’unité étaient réellement considérables. Ils allaient devenir bientôt décisifs. Le Congrès confédéral, le 6°, se tint à Lyon, du 23 au 27 septembre 1901.
Le projet Niel revint en discussion. Le plan du délégué de Montpellier fut ainsi esquissé : à la base, le Syndicat ; au-dessus, la Bourse du Travail ; après les Bourses, les Fédérations ; enfin pour couronner l’édifice syndical, la C. G. T., synthèse de l’action ouvrière.
Les superpositions de groupements subsistaient encore, mais elles étaient considérablement réduites.
Le projet fut remis et renvoyé à l’examen du Congrès de 1902 qui se tint à Montpellier du 22 au 27 septembre Une nouvelle explosion de grèves, le vote de la loi des 10 heures (Colliard-Millerand), les incidents qui en résultèrent incitèrent les militants à en finir.
Le Congrès des Bourses réunies à Alger, la semaine précédente, avait reconnu la nécessité de l’union. Un projet fut adopté dans ce sens et on confia à Niel le soin de le présenter au Congrès Confédéral.
Montpellier fut le véritable Congrès de l’Unité. Il fui dominé par cette question essentielle et la préoccupation de lui donner un statut.
Un seul Syndicat, celui des Maçons de Reims, formula quelques réserves. L’accord fut scellé à la quasi-unanimité. La coordination des forces confédérales était réalisée. La C. G. T. prit à Montpellier sa véritable figure.
Maxime Leroy dans la Coutume Ouvrière définit ainsi la C. G. T. issue du Congrès de Montpellier :
La Confédération Générale du Travail ne constitue pas un groupement fonctionnant indépendamment des Syndicats, Bourses et Fédérations, à la manière d’un pouvoir exécutif se superposant et s’ajoutant, en les complétant, aux divers rouages politiques ou administratifs de la République. Elle n’est pas, non plus comparable à une sorte de « Syndicat supérieur », le « Syndicat des Syndicats », comme disait M. Allou, au Sénat, pendant la discussion de la loi de 1884. Elle n’est pas davantage une association de personnes ; elle n’a pas une vie autonome ; elle n’a ni assemblée générale, ni adhérents individuels.
Cette démonstration est exacte. Elle montre l’impossibilité pour le régime actuel d’incorporer la C. G. T. dans son cadre juridique. Si elle ne montre pas son rôle, ni son but, elle l’exprime pourtant par l’application de la théorie des contraires. Nous le verrons en examinant d’abord la résolution de Montpellier et aussi la Charte d’Amiens. Désormais, la C. G. T. va représenter le groupement commun aux deux sections : Bourses et Fédérations, fusionnées dans son sein. C’est une organisation au troisième degré ; le groupement de base étant le Syndicat de métier ou d’industrie, le groupement secondaire ayant forme double de Fédération nationale ou Bourse du Travail et la C. G. T. le groupement réalisent entre celles-ci la liaison qu’elles forment elles-mêmes entre les Syndicats.
On pourrait croire que cette organisation double de la base au faite n’est pas souple, qu’il existe encore des chevauchements, que l’unité est incomplète. Il n’en est rien. Àu contraire, une telle organisation assure l’autonomie des groupements et la coordination des efforts, à condition que l’une des deux organisations secondaires ne tente pas d’empiéter sur les attributions de l’autre.
L’article 3 des statuts de Montpellier qui sera d’ailleurs modifié à plusieurs reprises, notamment en 1918 après le Congrès de Paris, donne la raison décisive de cette constitution et fixe les attributions et obligations des organismes.
Ci-dessous le texte de cet article essentiel :
Nul Syndicat ne pourra faire partie de la C. G. T. s’il n’est fédéré nationalement et adhérent à une Bourse du Travail ou à une Union de Syndicats locale ou départementale ou régionale de corporations diverses. Toutefois, la Confédération Générale du Travail examinera le cas des Syndicats qui, trop éloignés du siège social d’une Union locale, ou départementale, ou régionale, demanderaient à n’adhérer qu’à l’un des deux groupements cités à l’article 2.
Elle devra, en outre, dans le délai d’un an, engager et ensuite mettre en demeure les Syndicats, les Bourses du Travail, Unions locales, ou départementales, ou régionales, les Fédérations diverses, de suivre les clauses stipulées au paragraphe premier du prisent article.
Nulle organisation ne pourra être confédérée si elle n’a au moins un abonnement d’un an à la Voix du Peuple.
C’est le texte qui expose ce qu’on a appelé la triple obligation Confédérale qui est toujours en vigueur. Ainsi, par ce double jeu des organismes secondaires, chaque Syndicat est adhérent à la C. G. T. par le canal des Bourses et celui des Fédérations.
En premier lieu, elle est décentraliste, dans le domaine social et elle est, dans la seconde partie, centralisatrice sur leterrain corporatif et professionnel. L’organisation centralisée se comprend d’elle-même. Elle résulte de la nécessité de resserrer, autant que possible, le lien qui unit, par la Fédération, les Syndicats d’une même industrie, dont les intérêts professionnels sont identiques.
L’organisation décentraliste ne soulève non plus aucune objection. La C. G. T. ne peut ni ne doit vivre par en haut, par la tête. Son activité, sa propagande, son action sociale, sont l’œuvre de toutes ses cellules. Les Syndicats et surtout les Bourses du Travail en sont les facteurs d’exécution et d’action. Ils propulsent la C. G. T. en même temps qu’ils agissent par eux-mêmes. Aux idées de « Craft unionism », c’est-à-dire de corporatisme, elle oppose le principe d’une organisation plus solide, plus agissante, le système de l’Industrial unionism, ou action industrielle base de l’action sociale.
La représentation de la section des Fédérations est assurée par un bureau et un Comité composé d’un représentant par Fédération. Le secrétaire de cette section était en même temps secrétaire de la C. G. T.
Quant à celle des Bourses elle était assurée par un Comité fédéral des Bourses ayant à sa tête un secrétaire.
En fait, la C. G. T. n’ordonne pas, elle ne décide rien. Elle est sous le contrôle permanent des deux Comités fédéraux (Bourses et Fédérations) qui ont charge, eux, d’appliquer les décisions des Congrès.
Le Bureau Confédéral enregistre, sert à l’échange des correspondances, prépare des statistiques.
Il en sera du moins ainsi jusqu’en 1912, au Congrès du Havre, qui modifiera considérablement la structure Confédérale. Quoi qu’en disent les militants confédéraux (C. G. T. ou C. G. T. U.), les deux C. G. T. sont aujourd’hui centralisées et la décentralisation n’est plus réelle, ne joue plus. C’est ce qui explique un peu la succession de crises qui se dérouleront de 1914 à 1925 sans qu’on en aperçoive d’ailleurs la fin. La mainmise des Fédérations sur l’organisme Confédéral, celle plus forte encore du Bureau Confédéral sur toute la C. G. T. (Syndicats, Unions, Fédérations), ont placé, en réalité, la C. G. T. entre les mains de quelques hommes qui ordonnent, exécutent, décident, sans qu’un contrôle suffisant s’exerce. Sans doute tout cela n’est possible que parce que les militants, les Syndicats, les Fédérations, les Unions, ne contrôlent pas assez fréquemment leurs Bureaux, leurs Conseils, leurs Comités et parce que la plupart du temps, ils enregistrent au lieu de discuter et de dicter leurs volontés. Et ils subissent ainsi tactiques et méthodes qu’ils devraient condamner. Les déviations successives du syndicalisme viennent toutes de cette carence totale, de cette absence de contrôle. Approuvés, parce qu’ils surent faire adopter leurs points de vue, avaliser leur conduite, ratifier leurs attitudes, les militants fédéraux et confédéraux, ceux-ci inspirant ceux-là, ont de proche en proche, abandonné lentement mais sûrement, sans s’en apercevoir toujours, les principes essentiels du syndicalisme. Il n’y a pas d’autres raisons syndicales à la crise. Les autres sont d’ordre politique et on les retrouve à toutes les périodes de l’histoire ouvrière.
Depuis le Congrès de Montpellier en 1902, la C. G. T. tint jusqu’à la guerre cinq Congrès : Bourges (1904), Amiens (1906), Marseille (1908), Toulouse (1910), Le Havre (1912). Un sixième était en préparation à Grenoble, lorsque la guerre éclata en 1914.
Le Congrès de Bourges, en 1904, eut, tout de suite, une très grosse importance. Il s’agissait de déterminer l’action Confédérale. Serait-elle réformiste et conciliatrice, ou révolutionnaire et directe ? Telles étaient les deux questions posées au Congrès. Pendant que le Livre, les Tabacs, les Chemins de fer étaient partisans des premières, les autres, notamment le Bâtiment, les Métaux, etc., étaient partisans de la seconde.
Le premier point de vue fut soutenu par Keufer du Livre, qui s’exprima ainsi : « Nous n’admettons pas, disait-il, que la transformation sociale se fera par une révolution brusque ; il faut d’autres moyens pour nous conduire vers l’idéal auquel chacun de nous aspire ; il faut une longue préparation mentale, il faut une modification morale des individus.
La violence n’est pas le meilleur moyen pour obtenir satisfaction et la méthode révolutionnaire est dangereuse en ce sens, qu’elle amènera inévitablement des représailles dont les travailleurs seront victimes.
C’est pourquoi nous maintenons notre opinion, nos préférences pour la méthode réformiste, sans enlever la liberté des autres organisations qui préconisent L’action révolutionnaire ; elles la feront à leurs risques et périls. »
On remarquera quelle différence il y a entre le réformisme et la collaboration de classes qui triomphe de nos jours. Pendant que Keufer recommandait la prudence, Jouhaux, aujourd’hui, entre dans les organismes du Gouvernement, délibère avec les capitalistes qu’il devrait combattre en application des principes du syndicalisme.
Les majoritaires — à l’époque les révolutionnaires — tenaient un langage différent. Que disaient-ils ?
Ils proclamaient que le syndicalisme est l’expression d’une lutte entre deux classes très distinctes et irréconciliables : « d’un côté, ceux qui détiennent le capital, de l’autre les producteurs qui sont les créateurs de toutes les richesses, puisque le capital ne se constitue que par un prélèvement effectué au détriment du travail ».
Après cette constatation d’un antagonisme permanent, ils déclaraient que « c’est une illusion pour les travailleurs de compter sur les gouvernants pour réaliser leur émancipation » attendu, disaient les termes de la déclaration préalable inscrite en tête des statuts types de la C. G. T., que l’amélioration de notre sort est en raison inverse de la puissance gouvernementale. »
Et Jouhaux de conclure dans son ouvrage Le Syndicalisme et la C. G. T., pages 134–135 :
« Donc, double affirmation d’anti-capitalisme et d’antiétatisme, dont les auteurs tiraient la conséquence formelle, que les salariés, impuissants s’ils demeuraient isolés, doivent s’unir d’abord dans le Syndicat et par lui dans la C. G. T. pour mener eux-mêmes la lutte contre les oppresseurs.
Ainsi, le syndicalisme révolutionnaire s’affirmait comme l’organisation du prolétariat en vue de la lutte à mener contre le capital pour la suppression du salariat. Il se déclarait hostile à toute entente permanente entre le capital et le travail, et il proclamait le principe de l’action continue contre le patronat, la méfiance de l’État et la nécessité de l’action directe, de la pression immédiate des producteurs : Il ne répugnait pas aux améliorations des conditions de travail ni aux réformes sociales, mais il ne reconnaissait à celles-ci de valeur vraie qu’autant qu’elles diminuaient la puissance du capitalisme et tendaient à accroître la force émancipatrice du prolétariat. Il ne croyait enfin possible de s’appliquer utilement à les obtenir que par l’activité propre des salariés. »
Il y a gros à parier qu’aujourd’hui Jouhaux et ses amis ne soutiendraient pas pareille thèse. Et pourtant, il fut des 825 qui se prononcèrent contre les 369 qui soutenaient, en 1904, la thèse de Keufer. La Représentation proportionnelle, soutenue par Keufer et ses amis ne fut pas, non plus, acceptée. Là encore, le syndicalisme rompait avec la démocratie. C’est en 1904, à Bourges que fut envisagée l’action pour les 8 heures, qui devait trouver en 1906 les travailleurs prêts à imposer cette revendication par la grève générale. Après les manifestations de 1889, les fusillades de Fourmies et de la Ricamarie, la journée de 8 heures cessa d’être une affirmation théorique pour devenir le but des efforts ouvriers.
Voici, à ce sujet, l’ordre du jour qui fut adopté par le Congrès de Bourges :
Le Congrès, considérant que les travailleurs ne peuvent compter que sur leur action propre pour améliorer leurs conditions de travail ; Considérant qu’une agitation pour la journée de 8 heures est un acheminement vers l’œuvre d’émancipation intégrale ;
Le Congrès donne mandat à la Confédération d’organiser une agitation intense et grandissante à l’effet que le Ier Mai 1906, les travailleurs cessent d’eux-mêmes de travailler plus de 8 heures.
C’est à Bourges que remonte la véritable action pour les 8 heures en France.
Cette décision ne fut d’ailleurs pas suivie par toutes les Fédérations. Le Livre en particulier soutint les 9 heures et cela ne nuisit pas peu à la propagande et à l’action de la C. G. T.
Le Congrès de Bourges eut une importance énorme que Griffuelhes, alors Secrétaire de la C. G. T., — qui devait comme Pelloutier, marquer toute cette époque de son inlassable activité, de son énergie éclairée, — soulignait ainsi :
« Ce qui se dégage du Congrès, c’est le sentiment très net des militants français de mener un mouvement entièrement libre, subordonnant son action à ses propres besoins, créant la lutte en dehors de toute force extérieure et ne se préoccupant jamais que des intérêts ouvriers. »
Et c’est le Congrès d’Amiens, en 1906, qui devait confirmer de façon éclatante les décisions de Bourges. C’est en effet à Amiens que fut mise debout la véritable Charte du syndicalisme autour de laquelle, en 1925, tourne tout le débat doctrinal et les discussions sur la reconstitution de l’Unité.
Battus dans les Congrès antérieurs, les politiciens guesdistes, les marxistes d’alors, tentèrent une offensive suprême. Elle fut habilement menée par Renard du Textile qui devait la renouveler, toujours sans succès en 1908 à Marseille, à Toulouse en 1910 et au Havre en 1912. Il y avait des syndicalistes alors, hélas ! aujourd’hui, il y en a beaucoup moins.
Voyons comment les guesdistes tentèrent à Amiens de faire triompher leur point de vue. Reproduisons le texte, trop oublié, de leur résolution :
Considérant qu’il y a lieu de ne pas se désintéresser des lois ayant pour but d’établir une législation protectrice du travail qui améliorerait la condition sociale du prolétariat et perfectionnerait ainsi les moyens de lutte contre la classe capitaliste ;
Le Congrès invite les syndiqués à user des moyens qui sont à leur disposition — (le bulletin de vote) c’est moi qui ajoute et souligne — afin d’empêcher d’arriver au pouvoir législatif les adversaires d’une législation sociale protectrice des travailleurs.
Considérant que les élus du parti socialiste ont toujours proposé et voté les lois ayant pour objectif l’amélioration de la condition de la classe ouvrière ainsi que son affranchissement définitif ;
Que tout en poursuivant l’amélioration et l’affranchissement du prolétariat sur des terrains différents, il y a intérêt à ce que dés relations s’établissent entre le Comité confédéral et le Conseil national du Parti socialiste, par exemple pour la lutte à mener en faveur de la journée de 8 heures, de l’extension du droit syndical aux douaniers, facteurs, instituteurs et autres fonctionnaires de l’État ; pour provoquer l’entente entre les Nations et leurs gouvernements, pour la réduction des heures de travail, l’interdiction du travail de nuit des travailleurs de tout sexe et de tout âge ; pour établir le minimum des salaires etc., etc...
Le Congrès décide ;
Le Comité confédéral est amené à s’entendre, toutes les fois que les circonstances l’exigent, par des délégations intermittentes ou permanentes, avec le Conseil national du Parti socialiste pour faire plus facilement triompher les principales réformes sociales.
Renard ne proposait rien d’autre que les fameux Comités d’action dont on nous casse les oreilles aujourd’hui et qui doivent permettre au Parti communiste de prendre le pouvoir.
C’est autour de ce texte que s’engage avant le Congrès une campagne très vigoureuse dans tout le pays. Le parti socialiste voulait à tout prix triompher à Amiens. Nous connûmes la même offensive avant le Congrès constitutif de la C. G. T. à St Etienne en 1922.
Mais avec cette différence qu’à Amiens les politiciens furent battus à plate couture, alors qu’ils vainquirent à St Etienne 16 ans plus tard.
C’est Merrheim, des unitaires de Roubaix, appelé à cette époque au secrétariat de la Fédération des unitaires, qui lui donna la réplique et quelle réplique !
« Vous avez voulu, disait Merrheim, faire du syndicat un groupement inférieur, incapable de sortir de la légalité. Nous affirmons le contraire. Il est un groupement de lutte intégrale révolutionnaire et il a pour fonction de briser la légalité qui nous étouffe, pour enfanter le droit nouveau que nous voulons voir sortir de nos luttes. »
Naturellement, comme aujourd’hui, les orateurs de la tendance Renard dénoncèrent comme une action anarchiste celle que menaient les syndicalistes révolutionnaires.
Ce qui faisait dire à ces derniers : « On a trop parlé, déclara l’un d’eux, comme s’il n’y avait que des socialistes et des anarchistes. On a oublié qu’il y a surtout des syndicalistes. »
Le syndicalisme est une théorie sociale nouvelle, une doctrine particulière. Il faut, avec les Congressistes, se prononcer sur elle. Il faut qu’ils disent que cette doctrine est indépendante du socialisme et de l’anarchie.
Le Secrétaire général de la C. G. T. Victor Griffuelhes, prenant la parole le dernier, déclara :
« En réalité, d’un côté, il y a ceux qui regardent vers le pouvoir et de l’autre ceux qui veulent l’autonomie complète contre le patronat et contre le pouvoir. Comment s’établirait cet accord fait de concessions mutuelles entre un Parti qui compte avec le Pouvoir, car il en subit la pénétration et nous qui vivons en dehors de ce pouvoir ? Nos considérations ne seraient pas toujours celles du Parti, d’où impossibilité d’établir les rapports demandés. »
Il n’y a rien de changé. Aujourd’hui les mêmes obstacles se présentent.
En produisant semblables affirmations, Griffuelhes annonçait le divorce total du syndicalisme avec la Bourgeoisie et le Pouvoir.
Keufer, du Livre, présentait une thèse mixte qui, par un paradoxe assez singulier, est devenue celle de ses adversaires d’alors, les dirigeants actuels de la C. G. T.
Àu nom des réformistes, Keufer se prononçait pour l’autonomie syndicale vis-à-vis de tous les Partis politiques et concevait l’organisation ou l’action syndicale selon la méthode trade-unioniste anglaise, la méthode corporative qui vouait le syndicat à ne poursuivre que des améliorations corporatives.
II affirmait d’ailleurs que l’action parlementaire devait s’exercer parallèlement à l’action syndicale. Ni la thèse de Renard, ni celle de Keufer n’obtinrent de succès. La Résolution présentée par Griffuelhes, devenue la charte d’Amiens, obtint 824 voix contre 3 à la motion Renard.
Ci-dessous cette charte fameuse :
Le Congrès confédéral d’Amiens confirme L’article 2 des statuts constitutifs de la C. G. T., disant : La C. G. T. groupe en dehors de toute école politique tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de classe qui oppose sur le terrain économique les travailleurs en révolte contre tous toutes les formes d’exploitation et d’oppression, tant matérielles que morales, mises en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière ;
Le Congrès précise, par les points suivants cette affirmation théorique :
Dans l’œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, l’accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d’améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l’augmentation des salaires, etc... Mais cette besogne n’est qu’un des côtés de l’œuvre du syndicalisme ; il prépare l’émancipation intégrale des travailleurs avec, comme moyen d’action, la grève générale, et il considère que le syndicat, aujourd’hui groupement de résistance, sera dans l’avenir, le groupe de production et de répartition, base de la réorganisation sociale.
Le Congrès déclare que cette double besogne, quotidienne et d’avenir, découle de la situation de salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait à tous les travailleurs, quelles que soient leurs opinions ou leurs tendances politiques ou philosophiques, un devoir d’appartenir au groupement essentiel qu’est le syndicat ;
Comme conséquence, en ce qui concerne les individus, le Congrès affirme l’entière liberté pour le syndiqué de participer, en dehors du groupement. corporatif, à telle forme de lutte correspondant à sa conception philosophique ou politique, se bornant à lui demander, en réciprocité, de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu’il professe au dehors.
En ce qui concerne les organisations, le Congrès déclare qu’afin que le syndicalisme atteigne son maximum d’effets, l’action économique doit s’exercer directement contre le patronat, les organisations confédérales n’ayant pas, en tant que groupements syndicaux, à se préoccuper des partis et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre, en toute liberté, la transformation sociale.
C’est autour de cette charte dont les politiciens proclament aujourd’hui la caducité que se livrent, depuis 5 ans, les batailles les plus terribles entre réformistes collaborationnistes, syndicalistes révolutionnaires et communistes.
La portée de cette résolution, qui marque l’avènement du syndicalisme comme unique force révolutionnaire des travailleurs, fut considérable. Elle domina et domine encore de très haut tous les conflits entre ouvriers et politiciens. Griffuelhes avait vu clair, juste et loin.
Non seulement, la charte d’Amiens proclame la neutralité du syndicalisme vis-à-vis des partis, mais encore elle l’exige du syndiqué dans le syndicat. Elle déclare très nettement que la qualité de membre d’un Parti ou d’un groupement philosophique ne peut être ni une cause d’admission privilégiée, ni une cause de radiation spéciale de la part du syndicat. Elle place ainsi le producteur en première ligne, au-dessus du citoyen. Et c’est juste, parce que le travailleur est une réalité de tous les jours, invariable dans son état comme dans ses désirs, tandis que le citoyen est une entité fugace. Le citoyen peut changer d’opinions, devenir par le jeu de l’évolution ou de l’involution l’adversaire de ce qu’il soutenait âprement hier, soit par conscience, soit par intérêt ; le travailleur, lui, reste semblable à lui-même ; il subit en tant que salarié la double exploitation et la double oppression du capitalisme et de l’État. Ce n’est qu’après avoir assuré économiquement sa défense de classe contre les capitalistes de toutes écoles politiques et philosophiques réunis, eux, en faisceau de classe compact, que le travailleur a le droit et la possibilité de faire de la politique et de philosopher à son aise.
Il déclare d’ailleurs nettement que si philosopher ne saurait nuire et au contraire à son éducation et à son activité sociale, il serait infiniment préférable que le travailleur s’abstînt de participer aux luttes politiques où il est souvent appelé à agir, sur ce plan particulier, aux côtés et en accord de certains de ses adversaires de classe : patrons dits libéraux, mais patrons avant tout.
Si le travailleur s’abstenait de fréquenter les groupements politiques prometteurs ou endormeurs, il n’est pas douteux que le syndicalisme serait depuis longtemps le seul groupement de classe de tous les ouvriers et qu’il les rassemblerait tous sous sa bannière. Le triomphe du syndicalisme qui, depuis Amiens, a rompu avec le Pouvoir, qu’il soit démocratique ou non, avec la Bourgeoisie et toutes ses institutions politiques et économiques, pour affirmer son rôle et sa mission d’avenir, serait depuis longtemps un fait accompli.
Le syndicat, de par la charte d’Amiens, n’est pas seulement un instrument de combat dam la société actuelle, il devient, dans sa conception, l’organe même de la transformation sociale, la cellule de base de la société à venir, celle-ci étant organisée par lui dans les domaines de la production et de la répartition.
L’attitude de neutralité du syndicalisme à l’égard des partis politiques est davantage qu’une méfiance des luttes électorales et parlementaires. S’il en était autrement, ce ne serait qu’une position temporaire et par conséquent révisable. Ce n’est pas le cas.
De cette neutralité découle, dans la réalité, l’idée que le syndicalisme s’étend et œuvre sur un plan très différent des partis politiques et que l’action politique et syndicaliste s’exerce sur deux terrains très distincts. Telle fut l’œuvre magistrale réalisée à Amiens.
Nous aurons l’occasion de revenir sur la valeur de cette charte, lorsque nous examinerons les luttes qui dressent les unes en face des autres les fractions — aujourd’hui dispersées — du mouvement syndicaliste français.
Quelle que soit l’évidente clarté de la charte d’Amiens, elle ne parvint pas à dissiper toutes les équivoques, à éviter les querelles. Et aujourd’hui, plus que jamais, c’est autour d’elle qu’on se dispute.
Peu après Amiens, le mouvement confédéral devait connaître encore un autre péril. Ce fut l’époque de l’« hervéisme » et Gustave Hervé — qui, depuis... — s’imagina un instant qu’il avait rallié le syndicalisme à ses théories. Les Congrès de Marseille en 1908 et de Toulouse en 1910, se chargèrent de détruire ses illusions.
Ce n’est pas en vain que le syndicalisme avait défini sa doctrine et son activité propres.
La charte d’Amiens fut encore confirmée en 1912 au Congrès du Havre, le dernier Congrès d’avant-guerre. Après une longue discussion, souvent très âpre, sur l’orientation syndicale, le Congrès vota la résolution ci-dessous :
Le Congrès, à la veille de reprendre, pour l’intensifier, l’agitation confédérale en vue de réduire le temps de travail, tient à nouveau à rappeler les caractères de l’action syndicale, de même qu’à fixer la position du syndicalisme ;
Le syndicalisme, mouvement offensif de la classe ouvrière, par la voie de ses représentants, réunis en Congrès, seuls autorisés, s’affirme encore une fois décidé à conserver son autonomie et son indépendance qui ont fait sa force dans le passé et qui sont le gage de son progrès et de son développement ;
Le Congrès déclare que, comme hier, il est résolu à s’écarter des problèmes étrangers à son action prolétarienne, susceptibles d’affaiblir son unité si durement conquise et d’amoindrir la puissance de l’idéal poursuivi par le prolétariat groupé dans les syndicats, Bourses du Travail, les Fédérations corporatives et dont la C. G. T. est le représentant naturel ;
De plus, le Congrès évoquant les batailles affrontées et les combats soutenus, y puise la sûreté de son action, la confiance en son avenir, en même temps qu’il y trouve la raison d’être de son organisation toujours améliorable ;
C’est pourquoi, dans les circonstances présentes, il confirme la constitution morale de la classe ouvrière organisée, contenue dans la déclaration confédérale d’Amiens (Congrès de 1906).
L’action confédérale fut aussi dirigée contre le militarisme, le patriotisme et la guerre. Le Congrès de Marseille (1908) en particulier vota une motion qui eut quelque retentissement.
Le Congrès Confédéral de Marseille rappelant et précisant la motion d’Amiens :
Considérant que l’armée tend de plus à remplacer à l’usine, aux champs, à l’atelier, les travailleurs en grève, quand elle n’a pour rôle de les fusiller comme à Narbonne, à Raon-l’Étape et à Villeneuve Saint-Georges ;
Considérant que l’exercice du droit de grève ne sera qu’une duperie tant que les soldats accepteront de se substituer à la main d’œuvre civile et consentiront à massacrer les travailleurs ;
Le Congrès, se tenant sur le terrain purement économique, préconise l’instruction des jeunes pour que, du jour où ils auront revêtu la livrée militaire, ils soient bien convaincus qu’ils n’en restent pas moins membres de la famille ouvrière et que, dans les conflits entre le travail et le capital, ils ont pour devoir de ne pas faire usage de leurs armes contre leurs frères travailleurs ;
Considérant que les frontières géographiques sont modifiables au gré des possédants, les travailleurs ne reconnaissent que les frontières économiques, séparant les deux classes ennemies, la classe ouvrière et la classe capitaliste
Le Congrès rappelle la formule de l’Internationale :
Les travailleurs n’ont pas de patrie ; qu’en conséquence, toute guerre n’est qu’un attentat contre la classe ouvrière, qu’elle est un moyen sanglant et terrible de diversion à ses revendications ;
Le Congrès déclare qu’il faut, au point de vue international, faire l’instruction des travailleurs afin qu’en cas de guerre entre puissances, les travailleurs répondent à la déclaration de guerre par une déclaration de grève générale révolutionnaire.
Cette thèse, déjà soumise aux autres Centrales Nationales au cours des conférences internationales, ne fut jamais acceptée par les Allemands qui refusèrent de connaître l’antipatriotisme et l’antimilitarisme comme des questions intéressant le syndicalisme. Ceci prouve toute la différence qui existe entre le mouvement ouvrier français et tous les autres mouvements qui tous, à l’exception d’une partie des mouvements espagnol et italien, reposent sur la conception social-démocrate. C’est de cette incompréhension que découlera l’impuissance du mouvement syndicaliste de tous les pays belligérants en face de la guerre.
L’entrevue que Jouhaux et Legien eurent à Bruxelles fin juillet 1914 consacra cette impuissance. C’était la répétition plus brutale encore de l’entrevue Griffuelhes Legien, à Berlin, en 1906, su sujet du premier conflit marocain qui en ce moment rebondit pour la troisième fois et risque d’ensanglanter le monde.
Lorsque j’étudierai ici l’action internationale du mouvement ouvrier français ; j’exposerai en détail ce que furent les Conférences et Congrès internationaux. Nous voici maintenant à la veille de la guerre. La grève générale n’est point déclarée et la guerre éclate. Jaurès est tué par Villain le 31 juillet 1914 et la mobilisation est décrétée le 2 août.
Que va faire la C. G. T. ? Impuissante à déclencher la grève générale va-t-elle rester neutre, en attendant l’heure de son intervention possible contre le fléau ou au contraire, emboîter le pas aux gouvernants ?
C’est là que se placent de dramatiques incidents. Le Bureau Confédéral a décidé de fuir, de gagner l’Espagne. Il a pour cela frété un bateau qui doit le conduire de la Rochelle à St Sébastien.
Mais le gouvernement, a eu vent de ce qui se prépare. Il sait que si le Bureau de la C. G. T. quitte la France, c’est pour mener une action vigoureuse contre la guerre, de l’étranger. Le Ministre de la guerre, Messimy veut appliquer immédiatement le carnet des suspects dit « carnet B ».
Malvy, ministre de l’Intérieur, temporise pendant que Viviani, Président du Conseil, craignant une émeute par suite de l’assassinat de Jaurès, émeute qui rendrait la mobilisation impossible, lance une proclamation au Peuple, l’invite au calme et promet la punition du coupable.
Tous ces événements se déroutent à une vitesse vertigineuse. Là C. G. T. reste pour le gouvernement l’X mystérieux.
C’est alors que Malvy a une idée géniale autant que malfaisante. Il délègue auprès du Bureau confédéral un avocat jusqu’alors considéré comme socialiste révolutionnaire d’extrême gauche, très au courant des choses ouvrières, qu’on nous assure — sans que nous puissions l’affirmer — être M. Pierre Laval, ministre des Travaux publics, au moment où j’écris ces lignes (ce qui est de nature à renforcer notre conviction).
Cet avocat annonce au Bureau Confédéral que le gouvernement connaît ses projets d’embarquement et qu’il est décidé, par l’arrestation immédiate, à en empêcher l’exécution.
Le Comité Confédéral est réuni immédiatement. Il ne prend aucune décision. — Le Bureau est livré à lui-même et perd la tête. II va chez Malvy et se rend aux raisons de celui-ci. Désormais, il sera derrière le Gouvernement. Il participera, avec toute la C. G. T., à l’union sacrée... Jaurès est enterré le 2 août. Jouhaux se rend aux funérailles. Àu nom de la C. G. T., il parle et c’est pour dire :
« Comment trouver des mots ? Notre cerveau est obscurci par le chagrin et notre coeur est étreint par la douleur. C’est encore dans son souvenir que nous puiserons les forces qui nous seront nécessaires.
Au nom des organisations syndicales, au nom de tous les travailleurs qui ont déjà rejoint leur régiment et de ceux — dont je suis — qui partiront demain, je déclare que nous allons sur les champs de bataille avec la volonté de repousser l’agresseur : c’est la haine de l’impérialisme qui nous entraîne. »
Jouhaux ne partit pas. Je ne le lui reproche pas. Ce que je lui reproche, par contre, ce sont les paroles prononcées sans mandat, au nom des travailleurs non consultés. — La C. G. T. souscrivait à la guerre.
C’en est fait. C’est la capitulation. Le Carnet B n’est pas appliqué. Malvy a gagné la partie. Il convient cependant d’être juste, surtout lorsqu’on est sévère. Si le Bureau Confédéral faillit à ses devoirs, il ne fut soutenu par personne. Partout, ce n’était qu’abdication, enthousiasme pour cette guerre du droit ( ?) Àu lieu des cris de À bas la guerre qu’on aurait dû entendre, c’était ceux de À Berlin qui retentissaient. Une immense vague de chauvinisme balayait le pays.
Et comme il est difficile de se reprendre, l’abdication s’aggrava bientôt. Ce fut après Charleroi et la ruée sur Paris, la fuite du Bureau Confédéral à Bordeaux, avec le Gouvernement ; ce furent les Terrassiers de Paris, les sans-travail embauchés par Gallieni pour défendre Paris. Quels tristes événements !
Il faudra près d’un an avant que n’apparaissent les premiers et timides symptômes de l’effort anti-guerrier. C’est sous les auspices du Comité pour la reprise des relations internationales auquel adhèrent : Merrheim, Bourderon, Chaverot, Sirolle, Souvarine, etc...- et, où, Trotsky, encore à Paris, joue un rôle prépondérant, que s’organise l’action contre la guerre.
Merrheim est l’inlassable apôtre de la paix. Accompagné de Bourderon, il se rend à Zimmerwald, en 1915, pour y rencontrer les autres pacifistes européens. Ledebour, y représente l’Allemagne où Karl Liebknecht mène une action pacifiste vigoureuse, en compagnie de Rosa Luxembourg. Grimm représente la Suisse. Lénine représente la Russie.
Cette entrevue est dramatique au possible. Pendant 6 heures sans discontinuer, Merrheim et Lénine discutent pied à pied. Lénine voudrait qu’en rentrant en France, Merrheim déclenchât l’insurrection contre la guerre. Celui-ci lui déclare que c’est impossible, qu’il ne serait pas suivi. Il ajoute qu’il n’est d’ailleurs pas certain de rentrer. Par contre Merrheim croit qu’il est possible d’intensifier l’action pour la paix ; d’amener, sans brusquerie, le prolétariat français à se dresser contre la guerre.
La Conférence de Zimmerwald, si elle ne prit en fait aucune décision, n’en marque pas moins le commencement du redressement du mouvement syndical français. Ce fut aussi la reprise des relations internationales rompues par la guerre. C’est sous le couvert de cette action pacifiste, qui va s’intensifier rapidement, que le syndicalisme se ressaisira.
Bientôt, il prendra figure d’opposition organisée et solidement groupée dans le Comité de Défense Syndicaliste avec Merrheim, Rey, Péricat, Andrieux, J.-B. Vallet et tant d’autres.
La province suit. De graves événements encore mal connus ont lieu à Toulouse où un bataillon se révolte.
Des centres permanents d’agitation se créent à Saint-Étienne, Bourges et Decazeville, sous l’impulsion de Merrheim.
L’action pacifiste s’organise partout et à Decazeville, Verdier applique une formule nouvelle : l’occupation des usines et le fonctionnement de ces usines par les ouvriers.
C’était la bonne. C’est celle-là qu’il faudra appliquer demain, si on veut priver le capitalisme de ses moyens de faire la guerre. C’est cette précision qui manquait à la motion votée à Marseille en 1901, c’est celle que l’Union Fédérative des Syndicats autonomes de France a exposée récemment.
Si cette action n’atteint pas le but indiqué par Lénine — et elle eût pu l’atteindre si l’action révolutionnaire de Decazeville avait été amplifiée et suivie — elle a au moins pour conséquence de fortifier considérablement la minorité syndicaliste révolutionnaire qui combat violemment la majorité.
Des séances tumultueuses ont lieu au Comité Confédéral ou Merrheim et Jouhaux se dressent face à face.
Dumoulin, mobilisé et Monatte également mobilisé, luttent aux côtés de la minorité.
Et c’est l’arrivée de Clémenceau au pouvoir avec sa formule « Je fais la guerre ».
Immédiatement c’est le régime de la brutalité qui s’instaure. C’est aussi celui du mouchardage ignoble avec Ignace et Mandel. Merrheim est appelé plusieurs fois par Clemenceau qui veut le forcer à abandonner son action pacifique. Il ne s’y rend pas et continue sa courageuse besogne.
Enfin, il cessera un jour, sans qu’on sache exactement pour quelles raisons. Et c’est le démantèlement des forteresses de Bourges, de Saint-Étienne, de Decazeville, c’est l’emprisonnement de Péricat et des militants de la Loire et la Conférence de Clermont-Ferrand en 1917, où il semble possible de ressouder les forces confédérales. Hélas !, ce n’est qu’un espoir vite déçu. Mal conseillé, mal entouré, Jouhaux continue son erreur, alors qu’il lui était possible encore de revenir dans la bonne voie. La minorité syndicaliste atteindra son apogée au Congrès de Saint-Étienne que préside Dumoulin, alors détaché à Roche-la-Molière. Puis c’est le retour de Merrheim au bercail confédéral, retour qui sera suivi de celui de Dumoulin, convaincu à son tour dans la nuit qui marque la fin du Congrès Confédéral de Paris en 1918. La minorité a désormais ses chefs de guerre, ceux qui lui montrèrent la route à suivre.
Elle est démantelée, débandée, elle périclite, cependant que la guerre prend fin. C’est singulièrement affaiblie qu’elle se présentera au Congrès de Lyon en 1919 où sera liquidée l’action confédérale pendant la guerre.
Entre temps, pourtant, il y eut quelques tentatives de redressement général. Une grève générale a été décidée pour le 21 juillet 1919 pour faire triompher le programme minimum exposé aux travailleurs parisiens par Jouhaux et Merrheim au Cirque d’Hiver, le 24 novembre 1918.
Qu’était-il, au juste, ce programme minimum de la C. G. T. ?
Faisant siens les 14 points qui constituaient le programme du Président Wilson, que la C. G. T. et le Parti socialiste étaient allés recevoir à son débarquement à Brest, la Confédération Générale du Travail en faisait la base de son action immédiate sur laquelle elle greffait son programme de réalisations essentielles et minimum.
-
La C. G. T. demandait des conditions de paix qu’elle définissait en 5 points :
-
La Société des Nations pour la libre coopération des Peuples, en vue de faire disparaître la guerre et l’établissement de la justice internationale ;
-
La coopération de toutes les nations, sous l’égide de la S. D. N. contre tout pays qui, passant outre aux décisions d’arbitrage, déclarerait néanmoins la guerre ;
-
La création d’un Office International des Transports et de répartition des matières premières pour la satisfaction rationnelle des besoins des Peuples ;
-
Pas d’annexion territoriale, pas de représailles inspirées par la vengeance, mais réparations des dommages causés. Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ;
-
Constitution juridique mondiale par la Société des Nations. Désarmement général et lutte contre les militarismes. Triomphe de la démocratie internationale.
-
-
La C. G. T. demandait que les organisations centrales des pays belligérants participent à la discussion et à l’élaboration du Traité de paix. Elle déclarait aussi nécessaire la tenue d’un Congrès International.
-
Le rétablissement de toues les garanties constitutionnelles de toutes les libertés : droits de parole et de réunion, la suppression de la censure, l’amnistie pleine et entière, la libération des prisonniers étrangers des camps de concentration.
-
La reconnaissance du droit ouvrier par la reconnaissance du droit syndical à tous les fonctionnaires de l’État, la révision du Code d’inscription maritime. La reconnaissance du droit d’intervention des Syndicats dans toutes les questions intéressant le travail. L’utilisation des bordereaux de salaire et leur généralisation par l’établissement de contrats collectifs sous le contrôle des organisations syndicales.
-
L’institution de la journée de 8 heures dans le commerce et l’industrie, la suppression du travail de nuit dans les boulangeries ainsi que dans les industries à feu continu, l’interdiction des métiers insalubres aux femmes et aux adolescents âgés de moins de 18 ans, la prolongation de la scolarité à 14 ans.
-
Le contrôle ouvrier pour le réajustement des productions de guerre aux productions de paix, l’institution d’un Conseil économique national et de Conseils régionaux au sein desquels serait représentée la classe ouvrière par des délégués désignés par elle. La fixation des règles de la démobilisation et de la reprise de l’activité économique.
La reconstitution des fonds de chômage et leur répartition sous, le contrôle des organisations ouvrières.
-
La reconstruction des régions libérées sous le contrôle d’organismes collectifs ayant personnalités civile et administrative et composés de producteurs et de consommateurs. L’obligation du remploi et la reconstitution opérée suivant les lois de l’hygiène et du progrès.
-
La réorganisation économique. La C. G. T. réclame, pour l’avenir, la part de direction et de gestion de la production nationale qui doit revenir aux travailleurs organisés, la sauvegarde des droits collectifs par la classe ouvrière, le contrôle des entreprises qui se développent avec le concours de l’État, la surveillance des concessions faites par l’État à des Entreprises industrielles.
-
Le retour à la nation des richesses nationales. C’est-à-dire des, mines, chemins de fer, ports, houille blanche et verte, etc. La C. G. T. présentait d’ailleurs cette partie de son programme sous la forme d’un contrôle collectif sur ces richesses. Ce n’est que par la suite qu’elle posera le principe des nationalisations industrielles, au cours des grandes grèves de 1920.
-
La lutte contre les fléaux sociaux : l’alcoolisme, le taudis, le chômage, l’invalidité, la maladie, la vieillesse.
-
Le recrutement, l’exercice des droits, l’organisation rationnelle de l’immigration, la fixation du contrat de travail pour les ouvriers étrangers, sous le contrôle des organisations syndicales du pays intéressés.
-
L’extension de l’assurance sociale à tous les travailleurs, étrangers compris.
-
La lutte contre la vie chère. La création d’Offices municipaux corporatifs, nationaux, publics d’alimentation populaire, supposant la réquisition des produits. La suppression des droits de douane, régie et octroi. Les Offices devront être gérés par des délégués directs du travail organisé, et des consommateurs.
-
La répartition des charges budgétaires par l’application de la loi sur les bénéfices de guerre, l’impôt sur lé revenu et les successions.
C’est ce programme minimum qui fut accepté à l’unanimité par le premier Comité Confédéral d’après-guerre, les 15 et 16 décembre 1918.
Ce même Comité avait modifié aussi la structure confédérale. Les Bourses disparaissaient pour faire place aux Unions départementales, fédérations départementales des Unions locales ou Bourses du travail. Ce projet fut dressé par Lapierre. De même la Fédération d’industrie remplaçait celle des métiers. À partir de ce moment, la C.G.T. est composée des Fédérations nationales d’industrie et des Unions départementales. Ce système serait parfait si, en fait, les Fédérations, organes centralisateurs, ayant leur siège à Paris, ne jouaient pas un rôle par trop dominant, si les Unions locales n’étaient pas réduites à un rôle social subalterne et si les Unions départementales, organes de décentralisation sociale, correspondaient à un besoin économique réel au lieu d’être des délimitations politiques sans valeur, déterminée dans le domaine économique. Le programme minimum, avant de recevoir la sanction du Congrès Confédéral de Lyon en 1919, subit le feu de la critique de la minorité, qui commençait à regrouper ses forces une seconde fois. Dès qu’il fut exposé su Cirque d’Hiver, il fut violemment attaqué et il fallut toute l’habileté de Merrheim pour le faire accepter — si on peut dire — aux travailleurs parisiens.
Ceux-ci sentaient que ce programme, mi-politique, mi-économique n’était pas un programme spécifiquement syndical. Ils comprenaient que pour le réaliser, il fallait compter sur le pouvoir, composer avec lui, collaborer avec l’État dans toutes sortes de Commissions, d’organismes et s’asseoir en face des patrons dans des organismes mixtes, travailler à la constitution des monopoles d’État et faire de l’État un patron privilégié, bien qu’il soit doublement tyrannique, politiquement et économiquement, et incompétent par-dessus le marché.
Les travailleurs sentaient que tout ce programme qui ne pouvait, à part quelques questions réellement d’ordre ouvrier et placées là tout exprès pour faire accepter l’ensemble, devenir une réalité qu’avec le concours des Pouvoirs publics, dont la C. G. T., serait un rouage économique autant que politique.
C’était l’abandon de toute la doctrine, de toute l’action confédérale confirmées sans cesse par les Congrès de Limoges, de Bourges, d’Amiens, de Marseille, de Toulouse et du Havre. C’était, après le divorce retentissant, le mariage avec la démocratie. C’était aussi l’abandon de l’action directe pour la pratique forcée de l’action parlementaire et de l’action compromettante avec les Pouvoirs publics.
C’était la rectification générale du tir confédéral qui jetait la C. G. T. dans les bras de la démocratie. Depuis 1919, cette politique n’a fait que s’accentuer et la C. G. T. est devenue un appendice du Gouvernement.
Les syndicalistes révolutionnaires eurent un tort, celui-ci : s’en prendre aux hommes, à leurs trahisons, à leurs reniements, au lieu de dresser immédiatement en face du programme minimum leur propre programme. Cette besogne ne fut accomplie qu’en 1921 pour le Congrès de Lille, par le Comité Central des Syndicats révolutionnaires. C’était trop tard. La scission était inévitable.
C’est donc, comme je le disais plus haut, pour défendre ce programme que, disciplinées dans l’action, toutes les fractions de la C. G. T. décidèrent de suivre le mot d’ordre de grève générale qui devait être lancé le 21 juillet 1919.
Comme il fallait s’y attendre et malgré une intense et générale propagande, ce programme ne rencontra pas l’adhésion unanime des travailleurs. Sentant le fiasco, s’exagérant peut-être aussi le péril, la C. G. T. capitula sans combattre, ce qui est bien pis que à être vaincu en se battant. L’histoire de ces événements est mal connue. Elle ne le sera sans doute jamais.
Ce fut peut-être une satisfaction mesurée donnée aux désirs de lutte des travailleurs et un moyen de pression sur le pouvoir ; ce ne fut peut-être aussi, hélas !, qu’une capitulation de plus entre les mains de la bourgeoisie. Le saurons-nous jamais ?
Une chose au moins est certaine : c’est que devant la déroute du colosse confédéral, qui représentait plus de 2 millions de travailleurs, la Bourgeoisie, un instant apeurée, reprit confiance en elle-même. Le hasard des consultations électorales ayant amené au Pouvoir la partie la plus réactionnaire de la Bourgeoisie, celle-ci prépara la destruction de la C. G. T., sans considération de la politique suivie par celle-ci pendant la guerre et jusqu’alors.
Ce fut la lutte de classe, reprise par le capitalisme réactionnaire contre une C. G. T. qui voulait collaborer à tout prix et, malgré les humiliations renouvelées, n’y parvenait pas.
La résolution votée par le Congrès Confédéral de Lyon marquait adroitement tout cela. Elle était rédigée si habilement que, si ce n’était l’esprit connu de ses auteurs, pas un minoritaire syndicaliste n’eût pu ne pas la voter. Celle de la minorité recueillit cependant 312 voix, qui grossirent rapidement.
Quelle que soit la longueur de cette résolution de la C. G. T., il faut, pour la clarté de ce qui va suivre, pour la compréhension des événements présents, la reproduire en entier. La voici :
Émanation directe des forces ouvrières organisées, le Congrès Confédéral proclame à nouveau, avec une conviction renforcée par toute l’expérience passée comme par l’effroyable catastrophe qui a désolé le monde, que l’idéal syndicaliste s’accomplira seulement par la transformation totale de la société.
Issue de la lutte de classe, expression complète de la situation faite au Prolétariat, s’inspirant pour son action et dans son objet de la défense des intérêts professionnels et du développement complet des droits du travail, l’organisation ouvrière répète que son but essentiel est la disparition du patronat et du salariat. La lutte de classe, elle la constate comme un fait dont elle entend tirer toutes les conséquences.
Cette lutte ne pouvant prendre fin qu’avec la suppression de toutes les classes, de tous les privilèges économiques et sociaux, elle doit aboutir à une organisation nouvelle de la collectivité. Participation égale de tous aux charges et aux droits que les rapports des hommes font naître, tel est le principe initial sur lequel le mouvement ouvrier entend instaurer un régime nouveau ; il réalisera celui-ci, suivant ses conceptions propres avec les organismes qu’il aura lui-même créés et dont le caractère essentiel doit être de donner aux forces de la production la direction et le contrôle de l’économie collective : créateur de toutes les richesses, élément qui commande l’activité sociale, le travail entend être tout parce que les autres facteurs de la Société ne sont que ses subordonnés ou ses parasites.
Ainsi, sans qu’aucune équivoque puisse être possible, le syndicalisme déclare qu’il est dans son origine, son caractère présent, son idéal permanent, une force révolutionnaire.
Imprégné de ces principes et de ce but, le Congrès Confédéral de Lyon rappelle et reprend les termes de la résolution d’Amiens qui déclare (Ici texte complet de la motion d’Amiens déjà transcrit.)
Le Congrès estime en outre nécessaire de dire que cette déclaration ne se borne pas à affirmer, pour un moment donné, de façon provisoire et révisable, la neutralité des organisations professionnelles à l’égard des Partis ou des Ecoles, des doctrines ou des philosophies, mais qu’elle proclame de façon permanente cette conception fondamentale de l’action syndicale qui est l’action directe.
Il ne peut laisser croire par contre que cette action trouve son expression exacte et exclusive dans des actes de violence ou de surprise, ni qu’on la puisse considérer comme une arme pouvant être utilisée par des groupements extérieurs au syndicalisme.
C’est parce qu’ils sont producteurs que le Syndicat appelle à lui tous les travailleurs et c’est l’utilisation de la force qu’ils tiennent de leur fonction productive qui est la puissance de l’organisation ouvrière.
Plus que toute autre force sociale présente, il produit ce fait essentiel qui est la conséquence fatale de l’activité collective moderne : le recul de la politique devant l’économie.
Continuer la production pour satisfaire les besoins des hommes, l’accroître pour mettre à la disposition de tous une plus grande somme de richesses consommables, ainsi se traduisent ses préoccupations auxquelles la situation mondiale résultant de la guerre donne une gravité formidable.
Le mouvement ouvrier affirme qu’il doit et qu’il peut y répondre, mais il déclare aussi que tout effort dans ce sens n’est plus conciliable avec le maintien de l’état actuel ; l’appel au travail, auquel, les travailleurs sont prêts à répondre, ne peut se comprendre désormais qu’avec la reconnaissance totale des droits du travail,
Le mouvement syndical ne peut être que révolutionnaire ; puisque que son action doit avoir pour effet de libérer le travail de toutes les servitudes, de soustraire tous les produits à tous les privilèges, de mettre toutes les richesses entre les mains de ceux qui concourent à les créer.
Cette conception, réalisée par l’effort des travailleurs, se fera suivant les modalités du Travail lui-même constituant l’ordre nouveau, basé non sur l’autorité ; mais sur les échanges, non sur la domination, mai sur la réciprocité, non sur la souveraineté, mais sur le contrat social.
L’action quotidienne du Syndicat est une préparation à ce renversement des valeurs.
Toute manifestation de la force ouvrière, tend, en effet, à l’heure présente, à la conclusion des contrats CE SERAIT UNE ERREUR PROFONDE D’Y VOIR UNE COLLABORATION ; les conventions collectives, qu’elles s’étendent d’un atelier, ou à toute une région, ou à une corporation sur toute l’étendue du territoire, possèdent une valeur de transformation, parce qu’elles limitent l’autorité patronale, parce qu’elles ramènent les relations entre employeurs et employés à un marché qui encourage l’effort, sans apaiser l’énergie, puisque le travail n’y trouve pas la reconnaissance à tous ses droits, mais la satisfaction d’amoindrir l’absolutisme patronal en introduisant, dans l’atelier ou l’usine, le contrôle d’un puissance non assujettie à l’exploitation du patronat, d’une force d’émancipation : Le Syndicat.
S’inspirant du même esprit qui l’a déjà amené à réclamer des mesures efficaces contre la vie chère, démonstration même du gâchis économique dans lequel se débat la Société, le Syndicalisme déclare qu’il entend faire un effort pour aboutir aux solutions nécessaires, non dans un intérêt égoïste, mais dans le ferme désir de trouver une solution satisfaisante pour la collectivité.
CETTE REORGANISATION INDUSTRIELLE, CE RETOUR À L’ÉQUILIBRE NE PEUVENT PAS ÊTRE OBTENUS PÀR LES PALLIATIFS QUE PROPOSE CE POUVOIR. LE RÉGIME ÀCTUEL REPOSE TROP SUR LÀ DÉFENSE DES PROFITS PARTICULIERS POUR QU’ON PUISSE ATTENDRE DE LUI LES SOLUTIONS QUI S’IMPOSENT.
L’impuissance de la classe dirigeante et des organisations politiques s’affirme de jour en jour plus forte, plus forte aussi apparaît constamment la nécessité pour la classe ouvrière de prendre ses responsabilités dans la gestion de la Société.
Le mouvement syndical a dû ainsi envisager les solutions qui s’imposent sans délai. Il n’en saurait trouver de plus urgentes, de plus nécessaires, que la nationalisation industrialisée sous le contrôle des producteurs et des consommateurs, des grands services de l’Economie moderne : les transports terrestres et maritimes, les mines, la houille blanche, les grandes organisations de crédit.
L’exploitation directe par la collectivité des richesses collectives, la mise sous son contrôle des fonctions et des organismes qui commandent les opérations industrielles de transformation de ces richesses et de leur répartition, sont une condition essentielle de la réorganisation que nous voulons poursuivre. Mais constatant L’impuissance politique et le caractère même du Pouvoir, NOUS NE SONGERONS PÀS À AUGMENTER LES ATTRIBUTIONS DE L’État, à les renforcer, ni surtout à recourir au système qui soumettrait les industries essentielles au fonctionnarisme avec son irresponsabilité et ses tares constitutives, et réduirait les forces productives au sort d’un MONOPOLE FISCÀL.
Les résultats déplorables que l’on a pu constater dans le passé et qui se manifestent tous les jours, sont une condamnation suffisante de ce système. Par la nationalisation, nous entendons confier la propriété nationale aux intéressés eux-mêmes : producteurs et consommateurs associés.
Faisant confiance à la C. G. T., les Syndicats Confédérés déclarent : que l’action ouvrière se doit de se développer sur ce plan, pour réaliser le plus rapidement possible ces buts immédiats.
Le Congrès de Lyon proclame à nouveau le droit inaliénable des peuples de se déterminer eux-mêmes exprimant sa profonde sympathie à la Révolution russe, il proteste contre toute tentative d’interventions armées en Russie et contre le blocus réduisant un peuple à la famine, parce que coupable de s’être révolté contre ses oppresseurs.
Le Congrès, soucieux d’affirmer sa solidarité effective à l’égard du Peuple russe, charge le Bureau Confédéral de demander aux organisations syndicales des transports, de faire que leurs membres se refusent de transporter armes et munitions destinées aux armées de Koltchack et de Denikine.
Le bureau Confédéral est chargé égaiement de transmettre cette même proposition au Bureau Syndical International pour que ce dernier internationalise, cette action.
Le Congrès réclame que soit mise en application le plus rapidement possible, la résolution votée à Amsterdam qui concluait et l’envoi d’une délégation ouvrière en Russie.
Enfin, le Congrès exprimant la volonté unanime de la classe ouvrière, condamnant la politique réactionnaire des pays de l’Entente, exige que la paix soit conclue avec la Révolution russe.
Comme on peut s’en rendre compte, cette résolution est parfaite. Toutes les affirmations de lutte de classe des Congrès antérieurs s’y retrouvent, renforcées ; l’affirmation de la valeur constructive du syndicalisme, sa capacité de gestionnaire y sont exposées avec un rare choix d’expressions ; les monopoles et le rôle de l’État y sont sévèrement condamnés, de même que la collaboration des classes.
Quelle contradiction avec le Programme minimum du Cirque d’Hiver, que cette résolution condamne en fait ! C’est ce que comprirent les syndicalistes révolutionnaires, c’est pourquoi, ils votèrent contre cette résolution, au nombre de 312.
Néanmoins, ils attendirent le Bureau Confédéral et la C. E. à l’œuvre, après que la majorité eût refusé à la minorité la représentation à laquelle elle avait droit à la C. E.
Le glissement Confédéral continue ; la lutte de classe fait de plus en plus place à la collaboration. Seul le Conseil Economique du Travail est institué.
Le Bureau Confédéral et une délégation de la C. G. T. assistent à la Conférence de Washington, bien que Jouhaux ait donné sa démission de délégué suppléant à la Conférence de la Paix, après le meurtre de Lorne, le 1 mai 1919. Le Bureau International du Travail, dont la constitution a été acceptée par l’Internationale d’Amsterdam en juillet 1919 concentra à peu près tous les efforts de la C. G. T. et de l’Internationale, l’une et l’autre attachées à faire triompher la conception démocratique de la Société des Nations, dont elles rêvent, utopiquement, en régime capitaliste, de faire une Société des peuples.
Et ce sont les grandes grèves de 1920. — Si celles des métaux de 1919 furent un échec, en juin, celles de 1920, tout au moins la dernière, furent un désastre. Ce fut la dislocation de la C. G. T. après une défaite sans précédent.
Pourtant en février 1920, l’heure de la Révolution passa sans qu’il se trouvât une C. G. T. pour la saisir. À la suite de l’augmentation du coût de la vie qui atteignit des proportions jusqu’alors inconnues, un mouvement général de relèvement des salaires extrêmement puissant se dessina, à la tête duquel marchaient les cheminots, dont la Fédération comptait à ce moment 360.000 membres.
Sous la pression des Syndicats parisiens, impulsés par Lévéque, la Fédération fut obligée d’engager une action générale amorcée sur le P.-L.-M. à la suite d’une punition infligée au camarade Campaud frappé dans l’exercice de son droit syndical.
Le P.-L.-M. déclencha la grève générale qui fut immédiatement suivie par les Syndicats parisiens (tous réseaux) et s’étendit rapidement à toute la province.
Du 23 février au 1 mars 1920 toute l’activité du pays est arrêtée. La Fédération des Cheminots a été obligée de lancer l’ordre de grève générale, malgré elle, à tous ses adhérents. Le mouvement est splendide. Tour à tour, toutes les corporations se solidarisent avec les cheminots. La C. G. T. est elle-même entraînée dans la lutte. Elle va donner l’ordre de grève générale lorsque, le 27 février, une délégation de la Fédération des Cheminots se rend discuter avec Millerand, Président du Conseil, et Le Trocquer, ministre des Travaux publics, alors que les militants cheminots sont arrêtés depuis le 25.
Composée de Dubois, de Sotteville, de Le Guennic, de Rennes, de Coudun, de Paris-Est, cette délégation met fin à la grève brusquement, en concluant un accord qui ne sera pas respecté par la suite.
Le mouvement des Cheminots est assassiné et la C. G. T. ne lance pas l’ordre de grève générale. Et pourtant, pris à l’improviste, le gouvernement, qui ne disposait d’aucun approvisionnement ni en vivres, ni en essence pour utiliser ses camions était vaincu. Tous les espoirs suscités par cette grève, partie sur une question de droit syndical, avec pour objectif immédiat le relèvement des salaires, mais qui avait rapidement élargi ses objectifs, et posait, tout à coup, tout le programme défini à Lyon, étaient à terre et, avec eux, ceux du prolétariat de ce pays.
Comme il fallait s’y attendre, le gouvernement ne tint pas ses promesses et maintint les révocations. Il cherchait une revanche, comme après la grève victorieuse des postiers, en 1909.
Mettant à profit le temps qui lui était ainsi accordé par cette accalmie, il constitua des stocks de vivres, de matières premières, d’essence, et lorsqu’il fut prêt, il provoqua la classe ouvrière.
De profonds changements, venaient de se produire dans l’orientation de certaines grandes fédérations, notamment chez les Cheminots. Après avoir enlevé presque toutes les Unions de Réseau, les syndicalistes révolutionnaires enlevaient aux réformistes la direction fédérale, au fameux Congrès du manège Japy, fin avril 1920.
C’est de ce Congrès que partit ce qu’on a appelé « l’ultimatum de San Remo ».
Sur la proposition du Syndicat de Paris-Rive Droite, dont Blacher fut le porte-parole, le Congrès adressa un message à Millerand, Président du Conseil, pour le mettre en demeure de respecter l’accord du 27 février. Et chose curieuse, les réformistes, Bidegarray en tête, ne furent pas les moins ardents, à réclamer l’envoi de cette mise en demeure au Gouvernement. Nous aurions dû être plus clairvoyants, sentir que cet empressement subit de nos adversaires était extraordinaire, qu’il cachait quelque chose. Nous n’eûmes pas le temps de réfléchir. Le vote fut enlevé avec rapidité. Le refus était voulu, l’occasion cherchée par le gouvernement était trouvée. Le Congrès poursuivant ses travaux à Aubervilliers le déclara le lendemain avec, comme objectif : La réalisation de la nationalisation industrialisée.
Mal comprise des cheminots, incomprise à peu près par le grand public, cette revendication n’était pas propice à exalter les enthousiasmes. Autant la grève de février avait soulevé vigoureusement les travailleurs et intéressé le public, autant celle de mai les laissa indifférents.
Si le P.-L.-M., l’Ouest-État, le Midi, le P.-O., suivirent le mot d’ordre de grève, il n’en fut pas ainsi de l’Est et surtout du Nord, dont les dirigeants surent habilement duper le personnel.
On tenta sans succès, d’isoler ces Réseaux et la C. G. T. prit bientôt la direction du mouvement, encore que cette entrée en ligne de la C. G. T. ait donné lieu par la suite à de nombreuses et passionnées polémiques.
Le Cartel des Transports (ports, docks, marins) entre en ligne, sans modifier la situation. Une deuxième vague doit suivre. Ça ne marche pas. Il y a au sein de la C. G. T. des opposants dont Merrheim est le chef.
Après huit jours de lutte il apparaît que la grève sera écrasée si elle n’est pas généralisée par la C. G. T. J’en fais la demande à la C. G. T. après discussion avec Grifuelhes, qui est de mon avis. Elle n’est pas accueillie. On remplace le Bureau fédéral des Cheminots, obligé de se cacher pour se soustraire à l’arrestation. Il y a deux Bureaux, qui se contrecarrent. Et la deuxième semaine de grève marque l’échec du mouvement. Un Comité fédéral extraordinaire se réunit le 16 mai 1920, la C. G. T. y assiste, ainsi que les représentants Fédérations. C’est plutôt un Comité Confédéral.
Il décide de laisser les Cheminots continuer la lutte seuls et de les soutenir pécuniairement. Le mouvement se traîne. Les défections sont chaque jour de plus en plus nombreuses. C’est la fin, l’échec après 20 à 30 jours de lutte, selon les centres.
23.000 révocations et licenciements de cheminots sanctionnent cette défaite, dont les causes sont multiples. Le gouvernement a trouvé sa revanche. Il la tient et bien. La C. G. T. se disloque et c’est le Congrès d’Orléans, pour la liquidation de la situation. Il marquera aussi l’orientation sans cesse plus à droite de la C. G. T., l’abandon désormais total du programme du syndicalisme confirmé par tous les Congrès Confédéraux.
À la faveur de l’emprisonnement des militants cheminots, Bidegarray a pu reprendre la tête de la Fédération des Cheminots. Pour mettre le sceau à sa victoire, le Gouvernement a inventé le coup du complot contre la sûreté de l’État. Cette affaire viendra aux Assises en mars 1921 et se terminera par un acquittement triomphal.
C’est alors que les dissensions entre les fractions de la minorité se feront jour. Il est patent que le parti communiste non encore officiellement formé, a agi sur les événements de mai par le Conseil du Comité pour la reprise des relations internationales. Il continue sa pression sur la minorité syndicaliste, qui vient au Congrès d’Orléans de donner une adhésion de fait à « l’Internationale Communiste ». Adhésion toute sentimentale qui aura les plus graves conséquences.
Les Syndicalistes sentent, au sein des C. S. R, la tutelle qu’on veut leur imposer. Ils se dressent contre les hommes de Moscou : Monatte, Monmousseau, Rosmer, Souzarine, Loriot, etc. C’est la première bataille qui se livre pour l’indépendance du syndicalisme révolutionnaire. Le Bureau des C. S. R. est battu et je suis appelé à remplacer Monatte au Secrétariat général ; Fargues occupe le Secrétariat administratif.
Mais, avant notre entrée en fonctions, une délégation a été nommée pour représenter les C. S. R. au Congrès constitutif de l’Internationale Syndicale Rouge (I. S. R.). Elle est composée presque exclusivement de partisans de la subordination du syndicalisme. Seuls Sirolle, Gourdeaux, Albert et Claudine Lemoine font figure d’opposants. La délégation, hétéroclite, est déjà disloquée en trois parties au moins à son passage à Berlin et subjuguée à peu près totalement par les éléments communistes.
Elle manifestera son incompréhension totale de la Révolution et ne fera aucun effort pour la voir qu’elle est. Ce sont alors d’ignobles chantages exercés sur les délégués restés fidèles. Et après s’être divisée, au Congrès de l’I. S. R., la délégation, précédé de Tomasi — qui sera désavoué par tactique par ses amis — rentre en France. Et c’est le Congrès Confédéral de Lille. Entre mai et juillet, les militants syndicalistes du C. S. R. ont fait une grosse besogne, ils abordent le Congrès de Lille, après avoir redressé le mouvement minoritaire et mis debout un programme qui sera opposé à Lille, trop tard hélas !, au programme de la C. G. T. Ils ont aussi renforcé considérablement leur action et conquis un nombre imposant de Syndicats de province. De 312 à Lyon, 585 à Mans, leurs forces atteindront à Lille 1350 voix.
Le Congrès minoritaire voit participer à ses débats plus de 1100 Syndicats. C’est l’apogée. Le Bureau Confédéral sent la défaite. Il ne s’en tirera que par la violence, en faisant matraquer par des gens à sa solde, les délégués de la minorité. Des coups de revolver sont tirés. Il y a des blessés. Le Gouvernement parle d’interdire la continuation du Congrès. Il est visible que la majorité, stimulée par le Pouvoir, cravachée par les hommes du démocratisme social cherche la rupture. La minorité, quoique divisée en elle-même, ne se prête pas à cette besogne. Le Congrès continue. Une fois de plus — et ç’eût dû être la dernière — Jouhaux et ses amis triomphent.
La division s’accentue cependant entre les fractions de la minorité et au Comité Confédéral de septembre, une réunion extraordinaire du Comité Confédéral de septembre est convoquée.
La C. G. T., de son côté, brusque les choses. Dumoulin reprend sa motion d’exclusion. Il l’aggrave et somme les délégués de le suivre. Il ne triomphe qu’à une voix de majorité. À toute force, il est patent que la majorité confédérale veut la scission. Elle veut aussi dissoudre les C. S. R., ce que refusent les délégués minoritaires au C. C. N. après délibération du Comité Central.
La situation empire. Les exclus sont plus nombreux qu’avant Lille. La minorité tout entière se solidarise avec eux. La scission est désormais inévitable. C’est à ce moment que se tient le Congrès de l’U. D. de la Seine où Monmousseau prononce son dernier discours à peu près syndicaliste et tente déjà sa conversion communiste. Il n’y parviendra pas et devra s’incliner après l’intervention du Bureau des C. S. R.
Mais le malaise augmente. Il faut clarifier la situation. Une Conférence des Unions départementales est convoquée en novembre. Elle marque le désaccord sans cesse plus profond des partisans composant les C. S. R. et décide la convocation d’un Congrès auquel seront convoqués tous les Syndicats du pays pour protester contre la décision qui frappe d’ostracisme la moitié au moins des Syndicats du pays. 1550 Syndicats y participeront.
Ce Congrès se tiendra fin décembre 1921. Sa première tâche sera de désigner une délégation qui aura charge d’informer la C. G. T. de la tenue de ce Congrès et de son importance.
Elle se rend au siège confédéral, 211, rue Lafayette, où elle ne rencontre que Lapierre, secrétaire adjoint de la C. G. T. qui a mission de ne pas discuter et ne reçoit la délégation que par courtoisie.
Bien que prévenus, Jouhaux et Dumoulin sont absents, en délégation internationale.
Après une discussion qui fut parfois tragique, Lapierre accepte cependant de convoquer la C. E. de la C. G. T. et de donner une réponse pour le soir à 6 heures et par écrit.
Ne recevant aucune communication, le Congrès décide d’envoyer à la rue Lafayette une délégation restreinte pour connaître la réponse. J’en fais partie avec Monmousseau, Fourcade, Carpentier, Gauthier.
Nous trouvons portes closes. Le Congrès attend impatiemment notre retour. Nous rentrons immédiatement, et nous apprenons, par un communiqué que la C. G. T. considère que les organisations qui participent au Congrès se sont placées en dehors de la Centrale Nationale. C’est, on ne se le dissimule pas, la rupture. C’est alors que, mis au courant, le Congrès décide que la C. G. T., dont les Syndicats présents constituent la majorité, continue sur la base de ses statuts constitutifs définis à Amiens en 1906. La destitution du Bureau Confédéral est prononcée. Ce n’est d’ailleurs qu’une décision de pure forme. Il y a, en fait, deux C. G. T., sinon officiellement, du moins en réalité.
En effet, le Congrès ne peut échapper à la nécessité, inéluctable d’ailleurs, de désigner, un Bureau Confédéral et une Commission Exécutive provisoires.
Totti, Cadeau et Labrousse sont appelés à ce Secrétariat provisoire. Pendant deux mois encore, on essayera sans succès de recoller les morceaux. Ce sera en vain. On ne pourra y parvenir, la C. G. T. s’y opposera chaque fois. Il faudra bon gré, mal gré, se décider à considérer la scission comme réalisée. La C. G. T. U., un moment arrêtée dans son recrutement et sa propagande par le souci de renouer les rapports entre les deux grandes fractions du syndicalisme, prend maintenant un rapide essor, encore que la lutte des tendances ne se soit pas ralentie à l’intérieur.
Après deux Comités Nationaux, au cours desquels s’y affronteront avec force les défenseurs du syndicalisme et ceux du Parti Communiste, il fut décidé qu’un Congrès Confédéral Constitutif aurait lieu à Saint-Étienne en juillet 1922.
La tension internationale entre le Bureau et la C. E. provisoires de la C. G. T. U. et les Bureaux de l’Internationale Syndicale rouge et de l’Internationale Communiste est à l’état aigu.
À Paris, quoi qu’on en dise, les syndicalistes font tout pour empêcher une rupture totale, soit par des conversations avec les délégués des Exécutifs russes, soit par des propositions concrètes à ces Exécutifs, dont les plus importantes seront soumises par Griffuelhes à Lénine, Zinoview et Lozovsky. Ce fut en pure perte. Les russes restèrent intransigeants. On peut dire, aujourd’hui, sans crainte d’erreur, que la rupture leur incombe et à eux seuls.
Les dernières propositions du Bureau provisoire contresignées par un certain nombre de membres les plus influents de la C. E. n’eurent pas davantage de succès.
Parallèlement à cette action, se déroulait sur le plan national l’offensive du Parti communiste et de ses alliés syndicaux, le tout sous la direction de Frossard, mandataire de l’Exécutif de Moscou, dont il appliquait d’ailleurs les ordres avec une mollesse qui lui sera reprochée par la suite.
Par sa conduite, en ces circonstances tragiques, Frossard n’en aura pas moins assumé de redoutables responsabilités. Pour n’avoir point rompu à temps avec ceux qui dirigeaient l’offensive, après l’avoir souvent annoncé pour avoir tantôt paru céder, tantôt semblé résister, il fut un des hommes qui facilitèrent grandement la mainmise du Parti communiste — dont il dirigea d’ailleurs l’offensive à Saint-Étienne — sur la C. G. T. U.
Entre temps, la C. G. T. U. fut sollicitée de participer à une Conférence convoquée par les Centrales syndicales non adhérentes à Moscou ou à Amsterdam. Sous réserve que la C. G. T. russe serait invitée, la C. E. décida, sur la proposition des syndicalistes communistes, que la C. G. T. U. participerait, à cette Conférence à titre d’information.
Cette Conférence se tint à Berlin, le 12 juillet 1922 et jours suivants. La C. G. T. russe y avait délégué un de ses secrétaires, Andréieff. La minorité russe y était également représentée. Une grande discussion s’y produisit au sujet des persécutions en Russie et sur un motif futile, la C. G. T. russe se retira, en se solidarisant avec la fraction Vecchi de l’Union Syndicale italienne, que la Conférence avait refusé d’admettre.
Les travaux de cette conférence seront examinés plus largement dans la partie internationale. Sur la pression de la délégation française, elle prit la décision de tenter un dernier effort d’entente avec l’I. S. R. avant de constituer une Internationale, dont elle fixa toutefois les principes et dont elle définit la doctrine.
La délégation de la C. G. T. U. à Berlin : Totti, Lecoin et moi-même, rendit compte de son mandat par un rapport adressé au Congrès de Saint-Étienne.
Ce Congrès constitutif de la C. G. T. U. marqua le triomphe de la fraction communiste. Après six jours de débats extrêmement passionnés, les syndicats communistes triomphèrent par 749 voix contre 406.
Monmousseau et ses amis prirent la tête de l’organisation centrale du syndicalisme révolutionnaire français. Sentant le péril, les syndicalistes et les anarchistes constituèrent immédiatement un Comité de Défense Syndicaliste, avec mission d’entreprendre à nouveau le redressement du syndicalisme. J’acceptai d’en être le secrétaire.
La besogne s’annonçait d’autant plus difficile que les syndicalistes abasourdis par leur défaite ne surent ni s’organiser solidement, ni agir à bon escient.
Bientôt, de ce Comité qui portait tous les espoirs de la minorité de Saint-Étienne, ne vécut plus que la tête, à Paris ; la province boudait ou se désintéressait de son existence.
Le Comité de Défense syndicaliste n’en joua pas moins un rôle important.
Peu de temps après le retour de la délégation Confédérale du IIIe Congrès de l’I. S. R., après qu’on eût appris de source sûre que cette délégation, violant son mandat de Saint-Étienne, avait livré le syndicalisme français, pieds et poings liés à l’Internationale Communiste, le Comité fut sollicité de participer au Congrès constitutif de la II Association Internationale des Travailleurs. Je m’y rendis avec A. Lemoine. Ce Congrès, sur les travaux duquel je reviendrai plus tard, décida la constitution de l’Internationale Syndicaliste, après avoir pris acte des décisions scissionnistes du Congrès de l’I. S. R.
C’est alors, en janvier 1923, que les événements se précipitèrent en Allemagne, après l’envahissement de la Ruhr par Poincaré. Ces événements se développèrent rapidement. Les Partis Communistes français et allemand, la C. G. T. U., divers autres Partis communistes, les Conseils d’Usines de Rhénanie Westphalie, réunirent une conférence à Essen.
Sentant le péril de laisser toute l’organisation aux mains des communistes, le Comité de Défense syndicaliste intervint immédiatement. Il fit une démarche auprès du Bureau Confédéral en demandant à participer activement à toute l’action et, aussi, à sa préparation. Le Bureau Confédéral repoussa notre concours.
Le gouvernement de Poincaré refit à ce moment le coup du complot et arrêta les membres du Comité d’action. Ce complot fut étayé sur un faux, qui prit le nom de faux de Hambourg, dont on ne saura jamais sans doute s’il fut l’œuvre de la police bourgeoise internationale ou celle de la Tcheka russe en Allemagne. Les relations de Radek avec le Préfet de Police de Berlin semblent plutôt de nature à faire pencher vers cette dernière hypothèse.
En tout cas, le complot s’effondra après la lecture en Haute Cour du réquisitoire introductif du Procureur général Lescouvé.
Les pseudo comploteurs furent tous libérés. Puis vinrent les grandes opérations d’Allemagne qui marquèrent à nouveau une tendance vers la prise du Pouvoir en Saxe et en Thuringe, mouvement auquel participa la C. G. T. U. qui assista à la Conférence de Francfort où fut dressé le programme d’action qui devait être exécuté par les participants.
Mal dirigé, ce mouvement finit par le triomphe de la réaction, malgré que les conditions de réussite aient paru un moment réunies.
Les gouvernements en partie ouvriers de Saxe et de Thuringe durent fuir devant les baïonnettes de la Reichswehr et, après le Congrès des Usines d’Allemagne, tenu à Chemnitz, et les sanglants événements de Hambourg, le mouvement de révolte allemand né de la faim, écrasé dans le sang, prit fin.
C’est à Bourges, en novembre 1923, que ces événements et tant d’autres, y compris la question de suprématie des communistes furent définitivement tranchés.
Pendant l’année syndicale 1923–1924, le Bureau de la C. G. T. U. et ses amis avaient considérablement renforcé leurs positions. En dépit d’une opposition trop tiède, trop timide, sans position doctrinale définie, qui se fit jour à la C. E. et gagna à elle deux membres sur quatre du Bureau : Marie Guillot et Cazals, les communistes gagnèrent un terrain considérable. Ils avaient conquis presque toutes les Unions départementales, sauf la Loire, le Rhône et les Bouches-du-Rhône, ainsi que toutes les Fédérations, sauf le Bâtiment et les P. T. T.
Malgré les efforts inouïs des syndicalistes, dont l’homogénéité ne fut d’ailleurs pas la vertu dominante, les communistes triomphèrent définitivement. Lozowsky était, nous assura-t-on, présent dans les coulisses. Si les groupements syndicalistes révolutionnaires avaient été plus actifs, s’ils avaient su où Ils allaient, Il peut se faire, que l’écrasement eût été moins brutal et qu’une réaction devînt possible. Ce ne fut pas le cas.
Après Bourges, où le triomphe du Parti communiste s’étala cyniquement, le Bureau Confédéral tenta d’enlever les derniers fortins syndicalistes.
Le Parti communiste entra alors carrément en bataille. Il était décidé à frapper un grand coup et, à cet effet, avec la complicité des dirigeants de la C. G. T. U. et de l’U. D. de la Seine, il organisa un grand meeting de provocation à la Maison des Syndicats, 33, rue de la Grange-aux-Belles, à Paris, qui eut lieu le 11 janvier 1924. S’emparant sans vergogne du programme syndical, il démasqua toutes ses batteries.
Des camarades syndicalistes qui voulaient faire respecter le mouvement ouvrier et défendre son programme furent roués de coups. Des équipes de décrocheurs professionnels, aux gages du Parti communiste, jouèrent du revolver. Deux des nôtres : Pontet et Clos furent tués, une dizaine d’autres blessés.
La colère monta chez les syndicalistes et le jour des obsèques des victimes, auxquelles participèrent, de nombreuses délégations de province, se tint une Conférence de la minorité syndicaliste.
Une fois de plus, celle-ci manifesta son incompréhension, son impuissance, en ne se séparant pas immédiatement des communistes.
Le temps fut mis à profit par ceux-ci qui, à part le Rhône, enlevèrent tout ce qui restait de forces syndicalistes et coupèrent en deux la Fédération du Bâtiment.
Comprenant enfin qu’elle n’avait plus rien à attendre, la minorité syndicaliste, se réunit en Conférence les 1 et 2 novembre 1924.
Toujours par les mêmes raisons, elle ne sut pas prendre des décisions fermes. Elle convoqua et décida la constitution d’une organisation insuffisamment définie : l’Union Fédérative des Syndicats Autonomes de France.
Cette organisation qui eût dû recevoir l’adhésion de tous les Syndicats autonomes du Pays ne put remplir sa tâche et redresser un mouvement à côté de la C. G. T.
Délaissée par ceux-là mêmes qui la constituèrent, mais n’y adhérèrent jamais, elle mena une pauvre existence.
Son Bureau décida de convoquer une Conférence le 23 juillet 1925. Elle se tint à Saint-Ouen. 36 Syndicats y participèrent. La proximité des Congrès Confédéraux ne permit pas de prendre encore une position nette, surtout sur la question de l’Unité qui apparaît bien, maintenant comme la plus fameuse chimère du moment.
Il n’est pas besoin d’être grand prophète pour prédire que les Congrès des deux C. G. T. qui vont se tenir fin août, laisseront les choses en l’état et sanctionneront une scission qui apparaît comme irrémédiable avant longtemps.
À ce sujet, voici ci-dessous la position prise, sur cette question par l’U. F. S. A. qui reste, en dépit de ses maigres effectifs, la seule force syndicaliste de ce pays.
Je la reproduis en entier, parce qu’elle marque exactement la position du conflit, et qu’elle permettra aux hommes d’aujourd’hui, comme à ceux des générations de l’avenir, de se reconnaître dans l’histoire si compliquée du syndicalisme. Elle sera aussi de nature. à marquer le point de départ d’une nouvelle évolution du syndicalisme.
DECLARATION DE LA C. E. DE L’U. F. S. A. AUX CONGRÈS CONFEDERAUX d’AOÛT 1925
Les bouleversements provoqués par la guerre ont posé avec une force accrue, pour la classe ouvrière, le problème de la gestion de la Société par le Syndicalisme.
Ceci implique que les travailleurs doivent exprimer avec plus de clarté et d’objectivité, les désirs d’affranchissement qu’ils ont affirmé à toutes les périodes tumultueuses de l’Histoire.
La persévérance de ces affirmations, leur précision sans cesse plus grande depuis la publication du manifeste de 1863, prouvent avec évidence que la véritable tendance du Syndicalisme est l’organisation du travail et la gestion de la production.
En toute logique, la solution de ce problème qui se pose au sortir de la guerre avec une intensité jamais égalée, devait rapprocher les unes des autres les diverses fractions du syndicalisme dont le but est de supprimer le salariat, d’abolir le capital.
Or, fait extraordinaire, c’est le contraire qui s’est produit. Les tendances se sont heurtées violemment les unes contre les autres et, au lieu d’un renforcement de l’Unité syndicale, ce sont des scissions qui sont intervenues.
Il y a à cela des raisons profondes qu’il convient d’examiner, avant de reprendre la marche en avant. En effet, les scissions quel qu’en soit le mécanisme, ne se sont pas produites fortuitement. À l’origine de chacune d’elles, doit se trouver une cause essentielle. À notre avis, la cause première de toutes ces scissions réside dans l’abandon des principes fondamentaux du syndicalisme par certaines des fractions aujourd’hui rivales.
Ces principes sont condensés dans la charte du syndicalisme. Ce n’est pas par hasard que le Congrès d’Amiens la formula en 1906. Elle est l’affirmation synthétique de toutes les déclarations des Congrès ouvriers antérieurs. Elle résulte de l’observation attentive des faits sociaux, elle est la conséquence des luttes ouvrières et de leurs enseignements. Traduisant la pensée ouvrière, elle dicte au mouvement syndical, sa ligne de conduite dans le domaine immédiat en même temps qu’elle fixe les buts lointains à atteindre. Elle définit aussi le caractère exact du syndicalisme, détermine la valeur revendicative et la capacité révolutionnaire des Syndicats dans la lutte, l’organisation et la gestion.
On peut dire que la Charte d’Amiens contient six affirmations capitales qui constituent les fondements du syndicalisme, ce sont :
-
Affirmation d’unité. « La C. G. T. groupe », en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du patronat et du salariat.
-
Affirmation de lutte de classe. Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de classe qui oppose, sur le terrain économique, les travailleurs en révolte contre toutes les formes d’exploitation et d’oppression tant matérielles que morales, mises en œuvre par le capitalisme contre la classe ouvrière.
-
Affirmation de la nécessité de la lutte quotidienne dans le régime actuel. Dans l’œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, l’accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d’améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l’augmentation des salaires, etc.
-
Affirmation de la capacité d’action révolutionnaire des Syndicats. Fixation de leur rôle social avant et après la révolution. Il (le Syndicalisme) prépare l’émancipation intégrale qui ne peut se réaliser que par l’expropriation capitaliste ; il préconise comme moyen d’action la grève générale et il considère que le Syndicat, aujourd’hui groupement de résistance, sera dans l’avenir le groupement de production et de répartition, base de la réorganisation sociale.
-
Affirmation d’autonomie et d’indépendance. Le Congrès déclare que cette double besogne, quotidienne et d’avenir, découle de la situation de salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait à tous les travailleurs, quelles que soient leurs opinions ou tendances politiques ou philosophiques, un devoir d’appartenir au groupement essentiel qu’est le Syndicat. Comme conséquence, en ce qui concerne les individus, le Congrès affirme l’entière liberté pour le syndiqué de participer, en dehors du groupement corporatif, à toute forme de lutte correspondant à ses conceptions politiques ou philosophiques, en se bornant à lui demander, en réciprocité, de ne pas introduire dans le Syndicat, les opinions qu’il professe au dehors.
-
Affirmation d’action directe et de neutralité envers les Partis et les groupements philosophiques. En ce qui concerne les organisations, le Congrès décide qu’afin que le Syndicalisme atteigne le maximum d’effet, l’action économique doit s’exercer directement contre le patronat, les organisations confédérées n’ayant pas, en tant que groupements syndicaux, à se préoccuper des Sectes et des Partis qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivie en toute liberté la transformation sociale.
Ces principes forment un tout. Il est clair, qu’en cessant de respecter l’un ou plusieurs d’entre eux, on ne pouvait que provoquer l’écroulement de l’édifice si péniblement construit et l’anéantissement du mouvement sur lequel il reposait.
C’est ce qui est arrivé, au moment même où l’Unité était plus nécessaire que jamais, alors qu’il était indispensable d’affirmer la valeur du syndicalisme, de préparer des cadres et de le diriger vers les buts à atteindre.
Personne ne contestera que les objectifs fixés à Amiens restent ceux d’aujourd’hui, puisqu’ils ne furent jamais atteints et correspondent toujours aux désirs et aux besoins des travailleurs. La besogne quotidienne et d’action révolutionnaire, de défense, de préparation, d’agitation, de transformation, reste identique et s’impose plus que jamais.
Cela suffit largement pour nous permettre d’affirmer avec raison, en dépit de toutes les expériences récentes — qui en sont plutôt la confirmation que l’infirmation — que la Charte d’Amiens conserve toute sa valeur doctrinale et que ses principes restent les seuls qui soient de nature à permettre au syndicalisme de retrouver son Unité et sa vigueur.
La preuve en est péremptoirement administrée par les faits suivants :
1° Dès qu’on a cessé de reconnaître que la lutte de classe est un fait indéniable, pour pratiquer ou tenter de pratiquer la collaboration continue du Travail et du Capital par en haut, on a créé une tendance qui ne permettait plus à la C. G. T. de grouper dans son sein, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du patronat et du salariat. Une partie d’entre eux en était exclue idéologiquement, moralement. Elle le fut bientôt matériellement. II ne faut pas chercher ailleurs la cause de la première scission.
La confiance mise par la C. G. T. dans la démocratie et l’État bourgeois, pendant et après la guerre, pour réaliser une partie du programme syndicaliste était en opposition flagrante avec la Charte d’Amiens, qui rompait publiquement avec cette démocratie et son État et n’attendait rien que de l’action directe des travailleurs.
Il y a d’autres causes, mais celle-ci est l’essentielle. Les expériences, qui se suivent et se ressemblent quant aux résultats depuis mai 1924, prouvent et confirment avec éclat, en dépit de l’accentuation de cette politique, qui rencontre l’agrément du Pouvoir et du Parlement, que les militants de 1906 furent clairvoyants, qu’ils avaient pleinement raison.
Indubitablement, le premier divorce des fractions de la C. G. T. vient de là et non d’ailleurs. Il était inévitable, parce que les principes fondamentaux d’un mouvement sont au-dessus de la toi de la majorité et qu’ils doivent y demeurer. C’est du moins notre avis.
2° Lorsque le rôle révolutionnaire du syndicalisme, sa valeur revendicative, son indépendance, son autonomie fonctionnelle, sa capacité d’action furent contestés par un Parti et ses adeptes qui voulaient que le Syndicalisme rompît sa neutralité en faveur de ce Parti jusqu’à en devenir l’appendice, contrairement d’ailleurs à ce qu’affirmait Karl Marx lui-même à Genève en 1866, la deuxième scission, déjà en germe lors de la première, se produisit.
À ce moment, la C. G. T. U., pas plus que la C. G. T., ne pouvait plus grouper dans son sein, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du patronat et du salariat, même si ce principe directeur restait à la base de l’action de la nouvelle C. G. T.
Et ce fut la seconde scission, parce que, une fois encore, les principes fondamentaux du syndicalisme cessaient d’être respectés et qu’ils ne pouvaient être modifiés par une majorité inspirée extérieurement par le parti communiste. Il en eût été de même, s’il se fût agi d’un autre parti ou d’un groupement philosophique.
On peut donc dire, aujourd’hui, que les principes d’Amiens sont niés, dans leur intégralité, soit par l’une, soit par l’autre C. G. T. Faut-il en conclure que l’Unité est à tout jamais impossible ? Peut-être, hélas !, si on continue de tels errements.
Les conceptions nouvelles des deux C. G. T. basées de part et d’autre sur des principes opposés à ceux du syndicalisme, ont en effet donné naissance à des programmes, à des systèmes qui s’opposent dans presque toutes leurs parties à ceux du syndicalisme. Il est à craindre, dans ces conditions que ceux qui les défendent respectivement, ainsi que ceux qui les suivent, s’obstinent dans leurs erreurs et persistent dans la voie qu’ils ont choisie.
On peut donc redouter que les heurts des tendances s’aggravent au lieu de disparaître. Aussi, pour exprimer franchement notre pensée, nous n’apercevons en ce moment et ce jusqu’à ce que nos craintes soient dissipées, aucune possibilité sérieuse de fondre dans un même creuset les systèmes sociaux qui sont, à notre avis, appelés à s’opposer chaque jour plus violemment, jusqu’à l’application de l’un d’eux.
L’histoire nous enseigne que cette lutte se poursuivra, vraisemblablement, par delà cette application, s’exacerbera davantage encore, lorsque l’un des adversaires aura momentanément triomphé, même s’il jugule ses opposants.
En ce qui les concerne, les travailleurs groupés dans l’U. F. S. A. n’attendent rien de la démocratie. Ils savent que le développement de celle-ci signifie le maintien du Capitalisme dans ses privilèges et la continuation de l’asservissement du travail.
Aux prétendus droits du Capital, ils opposent les droits véritables du travail, qui ne peuvent trouver leur expression que par la libération des travailleurs, la suppression du capitalisme et du système qui le soutient et non dans une conciliation impossible des intérêts opposés.
Ils savent que l’État-patron oppresse ses ouvriers, ses employés, ses fonctionnaires doublement : politiquement et économiquement.
Aussi, considérant que la tendance de la démocratie, qui est d’étendre indéfiniment le champ d’action de l’État par l’extension de la politique des monopoles, conduira en fait à ce double asservissement un nombre sans cesse plus élevé de travailleurs, l’U.F.S.A. déclare que le Syndicalisme a pour devoir de revendiquer pour les Syndicats, la pleine autonomie dans l’organisation du travail, de tenter de détruire les hiérarchies arbitraires et incompétentes qui, dans les services publics, dominent les travailleurs et paralysent leur efforts ; de faire restituer aux intéressés eux-mêmes (par le contrôle syndical) les droits de régler les questions d’ordre technique et professionnel, d’enlever aux hommes politiques et aux partis qu’ils représentent la possibilité de s’ingérer dans le recrutement du personnel, en un mot de neutraliser à la fois la puissance malfaisante de l’État et celle non moins malfaisante du Patronat.
C’est une œuvre qui relève essentiellement de l’activité du syndicalisme, si ce dernier veut défendre hardiment les ouvriers contre les démocrates et s’opposer au triomphe de la démocratie, de la république des camarades, de la médiocrité et de l’irresponsabilité.
En monopolisant, l’État devient entrepreneur. Comme tel, il prétend être, à la fois, industriel ordinaire et patron privilégié. Or, comme industriel, il est incompétent et, comme patron, il est tyrannique.
Le syndicalisme doit donc se dresser et lutter contre les institutions composées de représentants de l’État, des patrons et des ouvriers, dont le but est d’acheminer l’ordre social vers la démocratie. C’est le rôle de ses groupements comme, demain, ce sera le rôle de ces mêmes groupements d’assumer les charges de l’organisation sociale.
Les travailleurs n’ont pas davantage foi dans leur soi-disant affranchissement par l’État et les Partis. Ils n’attendent rien que d’eux-mêmes et de leur action. Ils se refusent à reconnaître à un Parti le droit de parler en leur nom et à l’État d’administrer la chose publique à leur place. Ils se souviennent, à ce sujet, des multiples enseignements des révolutions passées. Ils n’ont oublié ni la façon dont le Conseil municipal de Paris accueillait leurs revendications en 1790, ni le vote de la loi Le Chatelier en 1791, par l’Assemblée constituante, ni les fusillades du faubourg St Antoine en 1830, ni la faillite du socialisme d’État, avec Louis Blanc, en 1848.
Ils se rappellent que chacune de ces dates vit couler à flots le sang ouvrier et que le triomphe du prolétariat fut, chaque fois, rendu vain par les trahisons successives des Partis qui utilisèrent le levier populaire pour renverser une tyrannie et imposer la leur.
De telles expériences gardent les travailleurs pour l’avenir. Elles justifient aussi, et au-delà, leur fidélité aux principes du syndicalisme, à son action, aux buts qu’il poursuit.
L’U. F. S. A. croit d’ailleurs fermement que la situation est révolutionnaire ; économiquement, financièrement, politiquement et socialement. C’est pour elle, une raison de plus d’être fidèle à ses principes.
Pour parler net, elle ne voit de possibilité d’unité que dans l’action que les événements vont rendre indispensable. C’est donc de l’action seule, que peut, à notre avis, surgir l’organisation unique des travailleurs. C’est elle qui démontrera la nécessité d’employer les moyens d’action du syndicalisme et acheminera instinctivement les ouvriers vers leurs buts invariables d’affranchissement.
Par avance, l’U. F. S. A., en même temps qu’elle déclare la Paix à toutes les autres tendances du mouvement syndical et à leurs militants, est d’ores et déjà prête à collaborer avec les uns et les autres pour toute action qui aurait pour but la défense des intérêts ouvriers (salaires, 8 heures, vie chère, chômage, etc.,) ou qui tendrait à supprimer le salariat et à faire disparaître le patronat.
Elle est également prête à s’associer à toute action pratique et sérieuse dirigée contre la guerre, à la seule condition que cette action soit dirigée par les travailleurs et leurs organisations syndicales, même si celles-ci ne sont pas d’accord avec elle sur le caractère du deuxième stade d’une révolution qui doit normalement découler de cette guerre, dans les circonstances actuelles.
Pour conclure et se résumer, l’U. F. S. A. déclare :
-
Etre prête à réaliser immédiatement l’unité organique par la reconstitution d’une seule C. G. T. basée sur les six affirmations capitales et de principe contenues dans la charte d’Amiens et rappelées d’autre part.
-
Etre prête dès maintenant, à participer, comme force organique à toute action quotidienne, revendicative ou révolutionnaire dirigée contre le patronat et l’État bourgeois, jusqu’au jour où, conscients de leur vrai rôle social, les travailleurs groupés ou associés dans leurs syndicats, Unions, Fédérations, C. G. T. et Internationale uniques, reviendront d’eux-mêmes aux principes du syndicalisme et en assureront son triomphe définitif, en même temps que la libération du prolétariat, par la prise des moyens de production et d’échange et l’organisation sociale par la classe ouvrière.
La C. E. de l’U. F. S. A.
Pendant ce temps que fait la C. G. T. ? Elle traverse deux périodes totalement différentes. L’une qui va de décembre 1921 à mai 1924 et l’autre, qui commence à cette dernière date et dont le cycle n’est pas encore achevé.
Pendant la première, elle est quelque peu désorientée, perd de ses effectifs. Malgré qu’elle ait tenté de se rapprocher du Pouvoir sous Briand, Poincaré l’écarte. Elle ne peut, quelque désir qu’elle en ait participer à la conférence de Gênes où la Russie reprend pour la première fois contact avec le monde diplomatique en 1922. Albert Thomas, y représente le Bureau International et participe aux travaux, ce qui a le don de mettre en colère Bourderon, qui quitte le Congrès. On y chante la louange de la Société des Nations et le Congrès syndical manifeste une répulsion aggravée pour la lutte de classe.
Après cette dure période de 1922 à 1924, la C. G. T. va connaître à nouveau les grâces du Pouvoir avec l’arrivée de Herriot et du Cartel des gauches qui viennent de triompher, en mai 1924, du Bloc national.
Le programme minimum de la C. G. T. se voit infliger la suprême injure d’être accepté par presque tous les candidats de ce Cartel aux élections de mai.
Le triomphe porte tout naturellement aux portes du Pouvoir les grands manitous confédéraux et fédéraux, qui s’installent un peu partout dans les Commissions instituées.
Mais les résultats réels se font attendre. Ni la nomination de Jouhaux comme représentant du Gouvernement au Conseil de la S. D. N. à Genève, ni celle de nombreux militants réformistes, par Painlevé, au Conseil National Economique et à l’Office national de la main-d’œuvre, pendant que d’autres entrent dans les conseils techniques de toutes sortes, ne permettent à la C. G. T. d’atteindre les buts qu’elle vise.
L’expédition du Maroc, qu’elle n’ose condamner formellement, les difficultés de tous ordres qui surgissent, les déboires causés par l’application du plan Dawes à l’Allemagne, la politique centriste de Painlevé tiraillé de gauche à droite, la rentrée politique financière de Caillaux ont tellement rendu la tâche de la C. G. T. difficile, que Jouhaux et ses amis regardent l’avenir avec effroi.
Il est à peu près certain d’ailleurs que le fiasco qui marquera la fin de l’expérience du Parti radical français, soutenu d’une façon intermittente par le parti socialiste, marquera aussi l’impuissance totale de la C. G. T. à concilier l’intérêt de classe avec l’intérêt général, les intérêts du Travail et ceux du Capital.
La désillusion qui s’en suivra chez les travailleurs, celle qui s’emparera d’eux après qu’ils auront constaté le néant des réalisations du parti communiste, surtout si les événements révolutionnaires forcent celle-ci à agir et à tenter d’appliquer son programme, ramèneront les ouvriers sur la route qu’ils n’auraient pas dû quitter : celle du syndicalisme, seule force de libération véritable.
Les Congrès des deux C. G. T. venant de prendre fin au moment même où je termine cette étude, il me semble impossible de n’en pas parler.
Ces Congrès ont été réunis à Paris à la même date (26 au 29 août 1925).
Dès sa première séance, celui de la C. G. T. U. qui se tenait au « Chaumont Palace » a désigné une délégation avec mission de proposer au Congrès de la C. G. T., réuni au « Manège Japy » de réunir les deux Congrès en un seul après les assises régulières des deux C. G. T. pour la réalisation de l’Unité Nationale.
De son côté, l’U. F. S. A. adressait une lettre à chacune des deux C. G. T. et à leur Congrès pour qu’une délégation puisse exposer le point de vue des autonomes sur l’Unité.
Le Congrès de la C. G. T. reçut la délégation de la C. G. T. U. et moi-même pour l’U. F. S. A. nous donnâmes lecture des déclarations de nos organisations respectives.
Le Congrès prit acte et nous nous retirâmes. Le lendemain le Congrès de la C. G. T. U. reçut le camarade Huart (chaussure) qui vint lui donner connaissance du manifeste inséré d’autre part.
De ces « négociations » nul résultat n’est sorti. La C. G. T. reste sur sa position. Son point de vue se résume en ceci : Unité chez elle.
Le refus formel de la C. G. T. a rendu inutiles toutes négociations. Plus que jamais l’Unité s’éloigne, quelles qu’en soient les nécessités.
Le congrès de la C. G. T. a précisé avec une telle clarté la ligne de conduite de ce groupement, sur le terrain de la collaboration des classes, de l’entente avec la démocratie, de la participation indirecte au Pouvoir, qu’il lui est impossibled’envisageruneaction commune le reste du prolétariat, comme il est désormais certain que celui-ci ne peut compter sur la C. G. T. pour une action de classe, quel qu’en soit le caractère.
Du côté de la C. G. T. U. le triomphe du parti communiste est total, l’asservissement du syndicalisme est complet et, à moins d’un concours exceptionnel de circonstances, il est certain que les syndicalistes ne pourront travailler en commun avec la C. G. T. U.
Reste l’U. F. S. A. seule avec son point de vue syndicaliste. Qu’en adviendra-t-il ? Je l’ignore. Les syndicats le diront.
Comme je le déclarais plus haut la situation reste inchangée.
Seuls les événements la solutionneront. Aux syndicalistes de savoir les utiliser.
ACTION INTERNATIONALE DE LA C. G. T.
Il me paraît nécessaire de faire remonter l’action internationale du mouvement ouvrier français à l’année 1862 qui marqua la première prise de contact des ouvriers français avec leurs camarades anglais, lors de l’Exposition universelle de Londres.
Cette prise de contact eut des lendemains féconds. La publication du manifeste dit « des Soixante » marqua une date importante du mouvement français, qui affirma le caractère de classe de son action.
Le retentissement de ce document — dont les conclusions, pour contradictoires qu’elles apparaissent aujourd’hui, firent sensation à l’époque — fut énorme.
Le recrutement des sociétés de résistance en fut considérablement augmenté. La répression brutale de la grève de la typographie parisienne accrut et surexcita l’agitation ouvrière.
Après avoir arraché le droit de coalition au gouvernement impérial apeuré par des conflits renouvelés, les travailleurs songèrent sérieusement à internationaliser leur action.
C’est en 1864 que fut constituée l’Association Internationale des Travailleurs, elle fut fondée à Londres le 28 septembre, après un meeting international tenu par les ouvriers au Saint-Martin’s Hall, en faveur le la Pologne martyrisée.
Constituée en 1865, la Section française, dont le siège était à Paris, rue des Gravilliers, participa au 1er Congrès de l’Internationale qui se tint à Genève en 1866.
Ce Congrès fut d’une haute tenue par ses discussions doctrinales et les décisions d’ordre pratique qu’il prit, notamment sur le principe de la réduction de la journée de travail à 8 heures, sur la suppression du salariat qui ne disparaîtra, disait-il, que par l’association coopérative des travailleurs. L’évolution de la grève générale qui fut faite à ce Congrès atteste que nos devanciers attachaient à cette forme de lutte une valeur certaine.
La Section française participa également au Congrès de Lausanne, en 1867.
Ce Congrès déclara en outre, que « l’émancipation sociale des travailleurs est inséparable de leur émancipation politique et que l’établissement des libertés politiques est une mesure d’absolue nécessité ». Je pense qu’on pourrait aisément renverser les termes de cette formule sans qu’elle perdît ni de sa valeur ni de force, bien au contraire.
Cette affirmation valut à la Section française d’être poursuivie, sans que se ralentissent pour cela, et l’action et la propagande de l’A. I. T. en France.
Les Congrès suivants marquèrent une nette orientation vers le collectivisme. César de Paëpe, un militant belge de haute valeur, joua un grand rôle dans cette évolution de l’Internationale.
Les Congrès de Bruxelles (18613) et Bâle (1869) accentuèrent cette évolution. Ils affirmèrent que la « propriété collective est une nécessité sociale, que la société a le droit d’abolir la propriété individuelle du sol et de le faire rentrer à la communauté ».
Mais, toutes ces discussions sur des sujets aussi vastes firent apparaître de graves oppositions non seulement dans les Congrès, mais au sein du Conseil Général de l’Internationale.
Pendant que déclinait l’influence des « mutualistes » français et que celle de Karl Marx grandissait, une autre tendance, celle des « fédéralistes », naissait avec Bakounine.
Fédéralistes bakouninistes et étatistes marxistes allaient s’opposer avec vigueur. Ce fut le commencement des luttes qui se poursuivent encore aujourd’hui. Marx et Bakounine étaient en complet désaccord à la fois sur la conception générale de la Révolution et sur le rôle des syndicats.
Les marxistes ne voyaient de possibilité de réalisation révolutionnaire que par l’institution d’un État prolétaire et la constitution du prolétariat en parti politique, tandis que Bakounine et ses amis, dont James Guillaume fut le commentateur brillant et la Fédération jurassienne l’organisme d’action vigoureux, déclaraient que la reconstitution sociale devait avoir pour base la Commune, ce qui correspond au rôle que nous assignons aujourd’hui aux Bourses du Travail ou Unions locales.
D’autre part, en ce qui concerne le rôle des syndicats les divergences n’étaient pas moins grandes. Comme les communistes d’aujourd’hui, et en complète contradiction avec ses affirmations de Genève en 1866, Marx déclarait que les syndicats étaient des organes de défense corporative et qu’à la défense des intérêts professionnels devait se limiter leur rôle. Waldeck-Rousseau eut en Marx un précurseur certain et on ne s’étonne pas qu’il ait cherché à enfermer les syndicats dans une légalité qui leur attribuait ce rôle restreint.
Quels que furent les efforts de Bakounine, d’ailleurs trop occupé par son action à travers tous les pays de l’Europe Centrale et moins homme de plume qu’homme de combat, Marx triompha.
Il réussit à se débarrasser de Bakounine et de ses amis, mais l’Internationale ne survécut pas à cette victoire qui n’est peut-être pas sans analogie avec celle des communistes de nos jours.
Ce fut la fin de la 1ère Internationale, dont la force fut insuffisante pour arrêter la guerre franco-allemande de 1870–1871.
Elle n’en avait pas moins joué un rôle fort important. C’est de cette époque que date la véritable conscience de classe internationale.
Sa formule si claire, si nette : L’émancipation des Travailleurs doit être l’œuvre des Travailleurs eux-mêmes, définit admirablement le caractère de l’action ouvrière. Les enseignements de la I Internationale, son expérience, ne sauraient être oubliés. Ils forment la base de notre activité.
Elle donna d’ailleurs à la Commune des militants de valeur. Varlin est la figure ouvrière qui domine cette époque. On le considère comme le premier Secrétaire de l’Union des syndicats de la Seine.
Il faudra attendre longtemps avant qu’une nouvelle expérience de constitution d’un organisme de liaison devienne possible sur le terrain international.
C’est en 1901 que les syndicats allemands convoquent au Congrès de Copenhague les Centrales Nationales des autres pays. 12 organisations répondent à l’appel du Centre syndicaliste allemand.
Il ne sort pas de ce contact une Internationale, mais un Bureau de renseignements international dit « Secrétariat international des Centres Syndicaux Nationaux ». Le secrétariat en est confié à l’Allemagne qui le conservera jusqu’en 1914, avec Legien.
La C. G. T. qui vient de forger définitivement son Unité au Congrès de Montpellier, en 1902, donne son adhésion à ce Bureau.
Dès le début deux conceptions se heurtèrent fondamentalement : celle des Français qui voulaient une organisation vivante, combative ; l’autre, celle des Allemands qui ne voulaient faire du Secrétariat International qu’un organe de renseignements, de statistique, d’administration.
Les choses ne tardèrent pas à s’envenimer. À Dublin, en 1903, la C. G. T. française présenta un rapport sur l’antimilitarisme et la grève générale. Elle essayait de faire ainsi revivre l’esprit internationaliste qui animait là I Internationale. Ce fut en vain, le rapport ne fut ni lu, ni même distribué.
Ce rapport résumait d’ailleurs remarquablement les conceptions du syndicalisme français.
On y lit aussi cette affirmation d’antimilitarisme :
« L’État n’observe jamais la neutralité. Àu moindre conflit, pour de simples menaces de grève, il mobilise l’armée et l’envoie sur le théâtre des événements contre les travailleurs. L’antimilitarisme doit être mis au premier rang des préoccupations des travailleurs organisés. C’est une besogne aussi indispensable et aussi urgente que celle qui consiste à rallier au syndicat les camarades inconscients. »
Le refus autoritaire de Legien de faire connaître ce rapport montre que l’Internationale n’est qu’un organisme administratif qui reste étranger à toute action de classe vraiment ouvrière et internationaliste.
Il faut peut être chercher dans la permanence de cet état d’esprit, l’une des causes essentielles de la faillite de la Deuxième internationale devant la guerre.
La C. G. T. continue de payer ses cotisations mais elle ne participe pas, en fait, à l’action du Bureau International.
La C. G. T., devant l’attitude hostile persistante du Secrétariat International, ne participe pas aux travaux de la quatrième Conférence qui se tint à Amsterdam, les 23–24 juin 1905, à l’ordre du jour duquel elle avait demandé à nouveau et avec insistance que figurent la grève générale, les 8 heures et l’antimilitarisme.
Le Secrétariat international décida, après consultation des Centres syndicaux Nationaux, tous défavorables à l’exception de la Hollande, que ces questions ne figureraient pas à l’ordre du jour.
Elles étaient, disaient ces Centres, de la compétence, des Congrès Internationaux du Travail et des Congrès Nationaux.
On voit quelle était l’étendue du fossé doctrinal qui séparait le syndicalisme français, libre de toute attache politique, avec les mouvements syndicaux des autres pays, tous plus ou moins corporatifs et liés avec les partis social-démocrates.
On pourrait croire que le syndicalisme français représentait dès cette époque — et représente encore — un mouvement anachronique par rapport aux autres mouvements de tous les pays. Il n’en est rien. Il a atteint une forme particulière, un stade plus évolué, parce que la France a passé par toutes les phases des révolutions politiques et que celles-ci ont démontré aux ouvriers français l’inanité de ces changements qui n’affectent que la forme de l’État et ne modifient en rien le contrat social, alors que les autres pays de l’Europe n’ont pas connu ces bouleversements répétés.
On a beau, de Moscou, tenter l’impossible pour que ce mouvement, jugé dangereux — à juste titre d’ailleurs — pour les politiciens et les Partis disparaisse, il n’en sera pas ainsi. L’avenir lui appartient, c’est lui qui, lorsque les Prolétariats de tous les partis auront perdu toutes leurs illusions politiques, toute leur foi dans les partis, triomphera en définitive.
En 1906, alors que les incidents du Maroc font craindre une conflagration, la C.G.T. délègue à Berlin, sou secrétaire Griffuelhes. Il ne se heurte pas à un refus formel de Legien, mais il reçoit de celui-ci l’invitation d’avoir à s’adresser au parti Socialiste.
Cette réponse permet de mesurer la valeur attribuée au syndicalisme en Allemagne.
Aussi, il est inutile de se demander comment le Secrétariat international accueillit l’idée qu’exprimée à Amiens, la Conférence des Bourses, à l’issue du Congrès Confédéral :
« les travailleurs doivent répondre à toute déclaration de guerre par la grève générale. »
Depuis, certes, l’idée a fait son chemin dans tous la pays, on ne la considère plus, comme le disait dédaigneusement Legien, comme une ineptie générale. Mais au Congrès de Stuttgart en 1907, la C.G.T. devant l’hostilité toujours réservée à ses propositions ne s’en retirera pas moins du Secrétariat international où tout travail est devenu impossible. Elle participera cependant à la Conférence de Paris en 1909. Pendant le conflit du Maroc, en 1911, il y a échange de délégués entre la France et l’Allemagne sans que soient aplanies les difficultés originelles.
En 1912, le conflit balkanique et ses extensions possibles amenèrent la C. G. T. à convoquer un Congrès extraordinaire des syndicats qui vota la résolution suivante :
Le Congrès confédéral extraordinaire de Paris rappelle que la raison d’être de la C. G. T. est de grouper en des organisations : syndicats, unions de syndical, fédérations corporatives, les travailleurs avides de conquêtes morales, matérielles, en créant entre-eux une communauté de pensée, d’action, d’où résultent a solidarité, une union sans lesquelles le progrès ne pourrait se réaliser.
Qu’ainsi, la C. G. T. s’affirme comme le représentant naturel du prolétariat, puisqu’elle exprime ses désirs de mieux-être et de liberté et constitue l’organe par lequel elles doivent se réaliser, en exerçant son action par l’intermédiaire des groupements précités qui sont autant de foyers répandus à travers le pays, au sein desquels les travailleurs trouvent les éléments de leur activité.
Que par là, la C. G. T. a été créée par la classe ouvrière pour synthétiser ses aspirations, les coordonner, en vue de leur assurer une force de rayonnement résultant de l’Unité d’organisation qui, dans l’autonomie de chaque groupement, puise une valeur plus grande.
Qu’il est reconnu par tous que la C. G. T. se présente comme l’interprète de la volonté des prolétaires organisés, que cette volonté se dégage du droit même qui appartient à chaque salarié de participer de façon effective à la vie confédérale.
Par ces considérations, il apparaît qu’à aucun moment il ne peut exister entre les classes en opposition la moindre communauté de pensée et d’action. Mieux que tout autre événement social, une guerre fait éclater cette opposition, puisqu’il s’agit, pour la classe ouvrière, sans profit pour elle, de répondre à l’appel guerrier du Capitalisme en courant sus aux prolétaires, victimes inconscientes du Capitalisme voisin ; que, ce faisant, la classe ouvrière se prêterait à la plus criminelle besogne devant augmenter la force d’exploitation du capitalisme et affaiblir, pour de longues années, le mouvement ouvrier.
Pour toutes ces raisons, le Congrès Confédéral déclare qu’il ne reconnaît pas à l’État bourgeois le droit de disposer de la classe ouvrière ; que celle-ci, majeure, entend poursuivre à son gré, dans les conditions déterminées par elle, au sein de ses organismes, son œuvre de propagande et de conquête.
Qu’en s’acheminant vers sa libération, elle est résolue à ne rien sacrifier à une guerre ; qu’au contraire, elle est décidée à profiter de toute crise sociale pour recourir à une action révolutionnaire.
D’où il résulte que si, par folie ou par calcul le pays au sein duquel nous sommes placés se lançait dans une aventure guerrière, au mépris de notre opposition et de nos avertissements, le devoir de tout travailleur est de me pas répondre à l’ordre d’appel et de rejoindre son organisation de classe pour y mener la lutte contre ses seuls adversaires : les Capitalistes.
Désertant l’usine, l’atelier, la mine, le chantier, les champs, les prolétaires devront se réunir dans les groupements de leur localité, de leur région pour y prendre toutes mesures dictées par les circonstances et le milieu avec, comme objectif, la conquête de leur émancipation et, comme moyen, la grève générale révolutionnaire.
Les délégués des organisations ouvrières estiment que les salariés, mis dans l’obligation d’aller à la guerre n’ont qu’une perspective : accepter les armes pour aller à la frontière massacrer d’autres salariés ou accepter la lutte contre l’ennemi commun : le Capitalisme.
Sous l’empire des obligations imposées par nos dirigeants, les délégués, en faisant choix de la guerre sociale, c’est-à-dire de la révolte dés exploités contre les exploiteurs, considèrent agir en conformité de vœu et de pensée avec les travailleurs organisés des autres pays également soucieux de ne rien sacrifier à la cupidité des gouvernants, le mot d’ordre étant pour tous À bas la guerre entre les Peuples !
Moins de deux ans après, les craintes du Congrès extraordinaire de Paris devaient être effroyablement confirmées, sans qu’il ait été possible d’éveiller à notre conception le Secrétariat International qui persistait à soutenir que la lutte contre la guerre n’était pas du ressort du syndicalisme et en laissait le soin aux partis social-démocrates.
Et en dépit des affirmations produites au meeting de la salle Wagram à la veille de la guerre par Sassenbach et Bebel, le cataclysme fondit sur nous, vertigineusement, en juillet 1914.
Ce fut, dans la faillite la plus lamentable qui soit, la fin de la deuxième Internationale syndicale.
Il y aura bien, à Londres en 1925, à Leeds en 1916, des Conférences interalliées, où on souhaitera la reprise des relations internationales, mais où, au fond, ne joueront que des nationalismes cachés représentés par des organisations syndicales ayant épousé le point de vue de leurs gouvernements respectifs.
La seule manifestation anti-guerrière, d’ailleurs extra syndicale, comme Merrheim tint à le préciser à Lyon, fut la Conférence de Zimmerwald, où Allemands, Suisses, Italiens, Français et Russes tentèrent de mettre fin à la guerre. La C. G. T. fut nettement hostile à l’action de Zimmerwald et c’est de toutes ses forces qu’elle s’opposa à la propagande pacifiste entreprise à ce moment.
Il faudra en arriver à la Conférence de Berne (5 au 9 février 1919) pour voir jeter à nouveau les bases d’une nouvelle Internationale syndicale. Les Belges et les Américains, plus chauvins encore que les autres, n’y assistent pas.
C’est à Berne que fut décidée la tenue du Congrès Constitutif d’Amsterdam (26 juillet au 2 août 1919) qui reconstituera sur des bases nouvelles l’organisme international qui entrera dans l’histoire sous le nom de Fédération syndicale Internationale d’Amsterdam. Les Allemands et les Autrichiens ont été invités, mais sont un peu tenus à l’écart. Il y a des relents de nationalisme qui flottent encore dans l’air d’Amsterdam.
Appleton des « Trades-Unions Anglaises » sera élu président ; Jouhaux (France) et Mertens (Belgique) vice-présidents ; Oudegeest et Fimmen (Hollande) secrétaires.
L’Internationale, ainsi reconstituée, ne comprend pas dans son sein toutes les Centrales européennes — l’Union syndicale italienne, la Confédération nationale d’Espagne, les indépendants d’Allemagne (F. À. U. D.) n’y adhérent pas. En Amérique, seule la Fédération Of Labor adhérera, puis se retirera. Aucune Centrale de l’Amérique du Sud ne donne non plus son adhésion. La Fédération syndicale internationale d’Amsterdam reste une organisation européenne où les représentants syndicaux de l’ex-Entente de guerre jouent les premiers rôles.
Elle ne tardera pas à entrer en conflit avec l’Internationale communiste d’abord, puis avec l’Internationale syndicale rouge. L’action réciproquement défensive de ces organisations amènera bientôt la scission dans presque tous les pays. La France en souffrira particulièrement, quoique n’ayant été atteinte qu’en dernier lieu.
L’action de la C. G. T. française avec Jouhaux inspirera celle de l’Internationale d’Amsterdam. Il n’est donc pas étonnant que la scission en France ait influencé si fortement la Fédération syndicale d’Amsterdam.
Toutes les tentatives d’Unité accomplies par l’I.S.R., insincères d’ailleurs, manœuvrières certainement, seront repoussées par Amsterdam qui poursuit, en liaison étroite avec le Bureau International de Genève et la deuxième Internationale socialiste, sa besogne démocratique dans toute l’Europe. Il est juste de dire que, par opposition, Moscou poursuit une autre action politique qui vise à atteindre des buts aussi exclusivement politiques et particuliers.
La bataille est loin d’être finie entre Amsterdam et Moscou. Il s’est formé dans le sein de la première de ces Internationales une aile dite de gauche, avec Fimmen à sa tête, qui poursuit la réalisation de l’Unité avec Moscou. Elle vient de recevoir l’aide d’une forte fraction des Trades-Unions anglaises à la tête de laquelle se trouve le propre président de l’Internationale d’Amsterdam, Purcell, qui a succédé à Thomas lorsque celui-ci devint ministre des Colonies dans le cabinet Ramsay Mac Donald.
C’est un fait assez extraordinaire pour qu’on le souligne. Il ne s’en suit pas que Moscou, même soutenu du dedans, triomphera d’Amsterdam et forcera les dirigeants hostiles à l’Unité sur les bases proposées par Losovsky à capituler.
Ces luttes menacent d’être terriblement longues et nul n’en peut prévoir la fin ni l’aboutissement.
L’Internationale d’Amsterdam, de même que la C. G. T. reste sur ses décisions du Congrès de Vienne en 1924, qui indiquent que les Centrales adhérentes à Moscou peuvent entrer à Amsterdam, mais ne veulent laisser aucune place aux discussions avec l I. S. R. dont la dissolution doit concorder avec la rentrée des Centrales à Amsterdam.
La Constitution de l’A. I. T. n’a pas rendu le problème plus simple et cependant le Congrès de décembre 1922 à Berlin n’avait pas d’autre issue s’il voulait rendre possible la coordination des forces non adhérentes ni à Moscou ni à Amsterdam.
Toutefois, il apparaît qu’avec un peu de compréhension, avec un peu de volonté éclairée, en raison de l’impossibilité d’action de chacune des Internationales, agissant séparément, on arrivera un jour, de part et d’autre, sous la pression des événements, à agir en commun pour certaines actions déterminées à l’avance.
Ce serait, sinon la solution idéale, du moins une solution meilleure qui permettrait, de faire face à l’adversaire capitaliste.
Il est à craindre que cette sorte d’unité d’action ne se réalise pas, tant l’opposition des programmes apparaît grande. Il se peut, en effet, qu’on ne puisse trouver une seule question susceptible de marquer le point commun de propagande ou d’action.
Dans ces conditions, il est à peu près certain que nous assisterons à la mise en application successive des deux programmes qui ne sont, ni l’un ni l’autre, spécifiquement syndicaux. On verra sans doute se réaliser d’abord le programme social-démocrate et, après un court laps de temps, les communistes l’emporteront. Si les syndicalistes, impuissants en ce moment, savent réagir à temps, la social-démocratie et le communisme seront les fourriers du syndicalisme.
C’est vraisemblablement à cette dernière hypothèse infiniment probable qu’il faudra s’arrêter.
L’action purement syndicale ne reparaîtra que plus tard. Quand ? Je l’ignore. Mais elle reparaîtra, parce qu’elle a des racines trop profondes dans le peuple pour être éliminée. Le syndicalisme représente l’avenir. Il triomphera en définitive, peut-être plus tôt qu’on le pense généralement.
Pierre Besnard
P. S. Je renonce à donner ici les caractéristiques des Congrès internationaux de Rome, de Vienne, pour la C. G. T ; de Moscou, pour la C. G. T. U. et de Berlin, pour le Comité de Défense syndicaliste. Cette étude déjà trop longue en serait trop alourdie. Les Congrès seront examinés lors de l’étude sur l’Internationale, c’est d’ailleurs leur vraie place.
P. B.
CONFÉRENCE
n. f.
Discours public. Les Romains avaient le mot conferentia, issu du verbeconferre (comparer) pour désigner l’assemblée de plusieurs personnes réunies pour étudier une question, le plus souvent philosophique ou historique. Chacun apportait à l’appui de sa thèse des textes et documents que l’on comparait. De là le mot.
Pour le même objet nous avons fait sans le vouloir, simplement du fait d’une prononciation et d’une transcription vicieuses, le mot conférence. Mais en français, ce mot souvent mal employé a fini par prendre des sens très divers et il sert à désigner des objets qui n’ont parfois aucun rapport entre eux. Mais le plus souvent il sert à désigner un discours public, contradictoire ou non. C’est surtout en gardant ce sens au mot conférence que nous allons l’étudier ici.
Au mot causerie (que voyez) nous avons dit que les manifestations de cette dynamique qu’est le verbe a trois principaux degrés : la conversation, la causerie, la conférence.
Sans répéter ici en quoi diffèrent la causerie et la conférence, il nous faut rappeler que celle-ci visant les grands auditoires, les qualités de la conférence doivent être appropriés à sa destination.
C’est à tort que l’on a tendance à mépriser les qualités matérielles, osons même dire les qualités physiques du conférencier ; la justice de la cause, la justesse des arguments, la documentation, l’éloquence, même, atteindront plus sûrement leur but si le conférencier est doué d’un physique agréable, d’un aspect sympathique, d’une voix puissante et harmonieuse. Toutes choses, d’ailleurs, que presque tous peuvent acquérir.
De même qu’il est répugnant de recevoir des aliments servis par des mains de propreté douteuse, le conférencier doit être pour ses auditeurs un agréable et appétissant maître-d’hôtel de la pensée. Il doit donc plaire, mais ne jamais oublier que plaire est un moyen, non un but.
La conférence, bien que ne nécessitant pas les mêmes qualités de fond que la causerie, doit être gardée du superficiel. Le conférencier évitera seulement, parlant à un public trop nombreux pour en connaître les individus, de s’engager dans des développements trop techniques ou trop savants que tous ne pourraient pas suivre. C’est précisément là que gît une difficulté : si, pour bien présenter sa pensée, le conférencier a besoin de citer ou exposer un objet dont la connaissance ou la compréhension sont réservées à ceux qui ont fait des études d’un degré un peu élevé ou un peu spécial, il lui faut échapper à deux dangers :
-
citer ou exposer l’objet sans se soucier des ignorants. Ceux-ci, alors, cesseraient de l’écouter.
-
Donner une définition, une explication à la portée des primaires. Ce procédé irrite les fortunés de l’instruction ; ils déclarent être venus perdre leur temps à écouter des choses que tout le monde connaît
C’est ici que devra jouer l’habileté de l’orateur pour se faire comprendre des humbles, leur donner le lait qui leur est nécessaire et le faire de telle façon que les favoris des enseignements secondaire et supérieur y trouvent eux-mêmes de l’intérêt.
Le conférencier doit embrasser son auditoire et veiller à ce qu’il n’y ait pas dans la salle un seul auditeur qui n’ait reçu cette impression qu’à certains moments, c’est à lui que l’orateur parlait.
Le choix du sujet est plus limité pour la conférence que pour la causerie puisqu’il doit intéresser plus d’auditeurs.
Il est des qualités également indispensables à la conférence et à la causerie comme, par exemple, la sincérité, l’amour du sujet, la sensibilité. Que l’orateur s’adresse à mille ou à dix mille auditeurs, ils ne participeront à son émotion qu’en en sentant l’authenticité. Il pourra, par du cabotinisme, arracher un cri de haine , ou d’amour à son auditoire, mais l’adhésion profonde, la communion ne seront atteintes que si l’auditoire s’est associé instinctivement aux vibrations profondes de sa conscience.
Nous venons d’indiquer des généralités, mais il y à dans les qualités requises, des spécialités comme, par exemple, celles de la conférence contradictoire. Dans : ce cas il y a, au plus, trois états différents pour l’orateur : il peut être le conférencier, le contradicteur ou l’intervenant.
Conférencier, il parle le premier et doit traiter le sujet aussi complètement que possible. Il aura le souci de prévoir tous les arguments opposables à sa thèse et d’y répondre par anticipation. Cette partie de la conférence est parmi les plus difficiles car il répugne aux esprits fins d’entendre répondre à une question qui n’a pas été posée. Le conférencier devra donc user de diplomatie soit en répondant à des questions ou objections situées dans le passé, soit en donnant de telles explications que la question ou l’objection ne puissent être formulées sans ridicule.
Le contradicteur se croit trop souvent autorisé à intervenir sans préparation, comptant uniquement sur l’inspiration provoquée par les paroles du conférencier.
C’est à cause de cette paresse que les conférences contradictoires sont encombrées de banalités, de lieux communs, de digressions. Le contradicteur, précisément parce qu’il ne sait pas, le plus souvent, sur quel terrain se placera le conférencier (on peut traiter un sujet de tant de points de vue différents tout en servant un même parti pris !) doit avoir une connaissance à la fois générale et profonde du sujet.
Seul l’intervenant, puisque son rôle est épisodique, a le droit de ne compter que sur son inspiration. Le plus souvent il n’appartient à aucun des deux camps en présence, il a une opinion mixte ou tierce.
Nous croyons que l’intervenant le plus intéressant est celui qui comble une lacune, qui apporte à la tribune un fait, une date, une précision à quoi les deux principaux orateurs n’avaient pas pensé.
Nous en tenant à notre définition, il convient de considérer comme conférences les discours des parlementaires, les professions de foi, les discours académiques, les sermons. Le Sermon sur la Montagne (Matt. V. VI. VII.) quelle qu’en soit l’authenticité, est une pure merveille de fond ; les sermons de Bossuet et, plus spécialement, ses oraisons funèbres sont des merveilles de forme... et d’habileté diplomatique.
Un cours est une conférence pédagogique ou didactique.
Comme conférences contradictoires citons les plus célèbres : Jésus discutant à douze ans avec les docteurs (enseigneurs) de la loi, les controverses entre papistes et réformistes au temps de la Réforme, Colloque de Poissy, Colloque de Bade, Conférence de Suresnes (entre Henri IV et les ligueurs) mais ici nous nous trouvons sur le terrain de la conférence diplomatique.
Les clubs révolutionnaires, Feuillants, Cordeliers, Girondins, Jacobins, furent les champs-clos d’ardentes joutes oratoires qui furent des conférences contradictoires.
La lice oratoire n’a, d’ailleurs, jamais cessé d’exister depuis, sous la forme de clubs et les plus célèbres de notre époque sontLe Faubourg, La Tribune des Femmes et les Insurgés.
Ces clubs remplacent actuellement pour le peuple curieux de savoir, les universités populaires qui ont à peu près disparu bien avant la guerre de 1914 et qui, depuis, n’ont repris vie de façon indiscutable qu’à Saint-Denis où une université populaire à des manifestations vitales presque égales à celles de l’université populaire du Faubourg Saint-Antoine, qui fut le modèle du genre.
Il est désirable qu’elles renaissent avec toute leur ampleur car elles répondent à un besoin réel. A l’heure où nous écrivons, des libertaires de toutes nuances s’unissent pour fonder une université populaire qui portera le titre de : « Maison de la Pensée ».
Les universités populaires sont des outils précieux parce que la force du verbe s’y manifeste sous tous ses aspects : conférences, causeries, cours, débats, théâtre, etc.
Voyons maintenant l’emploi du mot dans un sens qui s’éloigne un peu de notre définition : on nomme souvent conférence une consultation de médecins au chevet d’un malade de marque.
Une consultation entre nations ou entre partis est aussi nommée une conférence. La plus célèbre de ces forces malhonnêtes est la conférence pour la paix. Ses accès, comme ceux du paludisme aigu .sont pernicieux, subintrants, récidifs.
Dans le même genre de farces tragiques il convient de classer les conférences entre patrons et les comités de grèves.
Nous éloignant encore du sens que nous avons adopté, les congrès sont souvent appelés conférences.
Enfin, les fondateurs du méthodisme ont, les premiers, donné le nom de conférence à leur conseil d’administration et certaines sectes protestantes suivent encore cet exemple.
La conférence, pour en revenir à notre définition, étant la manifestation la plus étendue de la puissance du verbe, le conférencier peut faire un très grand mal comme il peut faire un très grand bien.
Celui qui monte à la tribune doit donc avoir conscience de sa responsabilité et, mieux et plus simplement : une conscience.
Raoul ODIN.
CONFESSION
n. f. (du latin : confessio, aveu)
Déclaration par laquelle on reconnaît un fait, on avoue quelque faute. C’est dans ce sens qu’on dit confession sincère, confession franche, confession ingénue, confession volontaire ou forcée, confession générale, confession publique ou privée, confession judiciaire ou extrajudiciaire, etc... La confession qui nous intéresse ici, et de laquelle il est séant qu’il soit fait mention et parlé explicitement, c’est celle que le prêtre entend au tribunal de la Pénitence ; c’est celle que le pécheur, repentant de ses fautes, vient faire au représentant de Dieu, en sollicitant du ministre de Dieu et de son Église, l’absolution de ses péchés.
« La confession fut établie au IIIe siècle, abolie au Ve pour cause d’abus et de scandale, puis définitivement adoptée par l’Église catholique au XIIe siècle. » (Dictionnaire Bescherelle, Tome I, page 729.)
La confession est un des moyens les plus sûrs, — peut-être même le plus puissant, mais assurément le plus perfide — par lesquels l’Église catholique, apostolique et romaine acquiert, garde et fortifie la domination totale à laquelle elle tend avec un esprit de suite prodigieux et une incomparable habileté. Dans le jeu savant des Sacrements à l’aide desquels l’Église catholique oblige les fidèles à entretenir avec le clergé, des relations régulières et fréquentes, celui de la Pénitence, qui s’exerce par la confession, occupe une place spéciale par le fait seul que, tandis que le baptême, la confirmation, le mariage, l’extrême onction se donnent une fois pour toutes ou, pour le moins, très rarement, la Pénitence et l’Eucharistie sont imposés durant toute la vie et ramènent le catholique fréquemment aux pieds des autels ! Et encore, même de ce point de vue, le Sacrement de l’Eucharistie doit-il céder le pas à celui de la Pénitence, car l’Église fait obligation au catholique qui veut communier, de se confesser pour ne se présenter à la Sainte Table que pur de toute faute et indemne de toute souillure, tandis que le fidèle qui a reçu, par le Sacrement de Pénitence, l’absolution de ses péchés n’est point tenu de communier. Les Sacrements ! Rappelons-nous que l’Église les proclame de fondation divine et que, pour le catholique véritablement soucieux de son salut éternel, ils sont d’étroite obligation : obligatoire, le Baptêmequi, lavant le néophyte des souillures du péché originel, lui confère la qualité de chrétien, l’admet dans l’Église militante et lui ouvre les portes du Ciel ; obligatoire, l’Eucharistie, que le catholique doit recevoir au moins une fois l’an, à Pâques ; obligatoire, la Pénitence, qui permet au pécheur, par l’aveu de ses fautes, le repentir qu’il en ressent et le ferme propos qu’il forme de n’y plus retomber, d’obtenir l’absolution et la rémission complète de ses péchés ; obligatoire, le Mariage, pour l’homme et la femme qui désirent s’unir et consommer, sans offenser Dieu ni commettre un péché mortel, l’œuvre de chair et donner la vie à des enfants légitimes ; obligatoire, l’Extrême-Onction pour tout catholique qui, se sachant ou se croyant en danger de mort, a le devoir d’appeler un prêtre et de recevoir les derniers Sacrements qui lui assurent l’état de grâce et le préservent de la damnation éternelle.
Chaque sacrement, cela va de soi, a une signification spéciale et un but précis ; tous s’imposent au catholique a un moment donné de sa vie et s’adaptent à une circonstance particulière de son existence. Sans entrer, ici, dans le détail et sans nous arrêter trop longtemps à chacun de ces sacrements, il me paraît utile de jeter sur tous un coup d’œil d’ensemble, afin de montrer la chaîne solide et ininterrompue que, rapprochés, ils forment. Ce coup d’œil provoque une observation aussi intéressante qu’originale. Cette observation consiste à faire remarquer que, dans leur ensemble, ces sacrements s’appliquent à chacune des époques décisives de la vie et que, certains ayant un caractère régulier et fréquent, l’Église catholique, grâce aux dits sacrements, ne perd pas de vue le fidèle, le tient constamment sous sa coupe, le rappelle sans cesse à ses obligations envers Dieu, et acquiert, de la sorte, sur lui un empire qui, commençant au berceau, s’étend et se fortifie sans solution de continuité, jusqu’à la tombe. Je m’explique : L’homme vient au monde, il a quelques jours à peine ; il est encore physiquement d’une extrême fragilité, intellectuellement dans les ténèbres et moralement dans l’inconscience. I1 est donc de toutes façons incapable d’un mouvement, d’un geste, d’une parole qui soit l’indice d’une conscience ou la marque d’une volonté. Qu’à cela ne tienne : ses parents décident pour lui et, voulant en faire un catholique, ils le fontbaptiser. Désormais, l’enfant appartient à l’Église, et celle-ci prendra des dispositions pour ne le point lâcher. L’enfant a grandi ; il est âgé d’une douzaine d’années. Son corps a pris un développement qui ne tardera pas à le conduire à la puberté et à faire de lui un jeune adulte ; son esprit a reçu quelque culture ; sa conscience commence à discerner ce qui est bien de ce qui est mal ; ses actes témoignent d’un état moral qui n’en est encore qu’au tâtonnement, mais est en voie de se former. Il est à cette période de la vie où, sous tous les rapports, l’enfant, sans avoir totalement cessé d’exister, tend à disparaître pour faire place à l’adolescent qui commence à poindre. Il est à cette phase de l’existence où la mémoire commence à se peupler de souvenirs et d’impressions, où l’intelligence s’ouvre à la compréhension des faits, où le jugement, tenté de comparer, d’apprécier, de résoudre, hésite à le faire, et finalement s’y décide, où l’imagination devient plus fougueuse chez les uns et plus pondérée chez les autres ; où, le sang et les nerfs étant en proie aux agitations et à la fièvre de la croissance, la chair commence à ressentir l’aiguillon du désir sexuel, encore vague ; où, d’accord avec les sens qui s’éveillent, le cœur se sent agité de sentiments affectueux et tendres. L’heure est venue, pour l’Église, de frapper un grand coup, d’impressionner fortement, de bouleverser profondément cette enfance parvenue au seuil de l’adolescence et de graver dans son souvenir des empreintes durables. Cet enfant fait sa première communion ; pour la première fois, il reçoit le sacrement de l’Eucharistie. Il est préparé avec soin à cette auguste cérémonie ; il y est entraîné, les derniers jours surtout, par des apprêts de toutes sortes. Le grand jour arrive : l’Église a pris un air de fête, elle s’est ornée de ses plus belles parures ; le communiant n’a jamais été vêtu d’ajustements plus soignés ; toute sa famille est à ses côtés ; il est le centre de toutes les impressions éprouvées, de toutes les salutations et paroles échangées. Fût-il le moins imaginatif et le plus froid des enfants, il est ému et troublé ; il règne tout autour de lui un empressement inaccoutumé il vit, durant vingt-quatre heures, dans une atmosphère spéciale et ce concours de circonstances le conduit, sans qu’il sache trop pourquoi, peut-être même sans qu’il songe à se le demander, à considérer cette première Communion comme un des événements les plus marquants de son existence. J’ai connu des hommes — et surtout des femmes — qui, parvenus à un âge déjà avancé, avaient conservé un tel souvenir de cette journée que les moindres détails s’en étaient gravés en traits indélébiles dans leur mémoire et qu’ils ne pouvaient en parler sans une vive émotion.
Mais voici que l’adulte a remplacé l’adolescent. La fillette est devenue jeune fille, le jeune garçon s’est transformé en homme ; il a, maintenant, vingt-cinq à trente ans ; il est dans toute la force de l’âge. Son tour est venu de se créer un foyer, de fonder une famille. Instant grave, heure décisive et capitale : du choix qui sera fait dépendra le bonheur ou le malheur attaché à une heureuse ou à une mauvaise union. Le choix est fait. Voici les deux époux. I1 est venu, le jour qui d’eux va faire le mari et la femme ; ils ne cessent de se contempler ; leur cœur est doucement agité ; l’amour le plus vif brille dans les regards qu’ils échangent. A dater de ce jour, leur existence va changer, le sort va leur devenir commun ; appuyés l’un sur l’autre, ils communieront dans la peine comme dans la joie ; échecs et réussites, revers et succès, aisance et privations, larmes et sourires, craintes et espérances, tranquillité et agitation, entre eux tout sera commun et partagé : moins lourdes à porter seront les tristesses et doublées seront les joies. Puis, viendront les enfants et on revivra dans ces êtres chéris. — Oh ! de quels soins, ils seront l’objet ! De quel amour et de quelle sollicitude ils seront entourés ! Pourvu qu’ils soient sains, robustes, beaux, intelligents et bons ! Et les deux époux unissent leurs projets d’avenir et leurs rêves, comme ils unissent leurs mains et leur lèvres. Ils devraient être laissés tout entiers à la passion qui les transporte, à l’amour qui les unit, aux douces perspectives que l’avenir ouvre devant eux. Quel est donc cet intrus qui se faufile auprès d’eux et, solennel, baragouinant un mauvais latin, bredouillant quelques formules sacramentelles, les déclare, dans un jargon qu’ils ne comprennent ni l’un ni l’autre, irrévocablement unis par le Sacrement du Mariage ? Cet intrus, c’est le prêtre, encore le prêtre et toujours le prêtre.
Quand vous aviez quelques jours, jeunes époux, c’est le prêtre qui vous a baptisés, quand vous aviez douze ans, c’est le prêtre qui vous a donné, pour la première fois, l’Eucharistie. Aujourd’hui, c’est le prêtre qui bénit votre union et vous déclare légitimement mariés. Cessera-t-il de s’attacher à vos pas, de s’acharner à votre poursuite ? Non ! Il vous a attendus au seuil de la vie ; il vous escortera jusqu’aux portes de la mort.
Autre date solennelle et fatidique ! Heure à laquelle, se sentant gravement malade, le patient que guette la mort, embrasse d’un coup d’œil toute sa vie, remonte le cours de ce fleuve jusqu’à sa source et en examine les eaux avant qu’elles ne se jettent définitivement dans le gouffre. Ce moribond sait ce qu’il était, ce qu’il faisait, où il se trouvait il y a dix, vingt, quarante ans. Il ne sait ce qu’il sera, ce qu’il fera, où il sera, demain ; il s’affole à l’appréhension de ce redoutable inconnu. Toutes les frayeurs le harcèlent ; toutes les terreurs que la religion a jetées dans son imagination et que les agitations de la vie avaient écartées de lui et tenues à distance, se rapprochent, grossissent, prennent des formes fantastiques. Spectres pleins de menaces, ces folies ne lui laissent plus un instant de repos ; elles attisent sa fièvre, elles alimentent son délire. Ces hallucinations tournent à, l’obsession : c’est l’idée fixe de l’enfer et de ses inexprimables tourments qui met l’esprit du malade à la torture. Mais voici le prêtre ; il est porteur des saintes huiles ; il pratiquera sur le moribond, les onctions qui calment et purifient ; il administrera les derniers sacrements, il prononcera les dernières prières ; il exorcisera Satan ; il murmurera les paroles de suprême consolation, de pardon, d’espoir et de confiance, à l’oreille de l’agonisant qui a déjà perdu toute connaissance, mais qui doit pourtant à l’assistance du prêtre l’apaisement in extremis des terreurs dont celui-ci a peuplé sa pauvre cervelle depuis son enfance et qu’il y a soigneusement entretenues durant toute sa vie.
Baptême, Eucharistie, Mariage, Extrême-Onction, l’homme d’Église ne suit-il point le fidèle pas à pas, du premier souffle au dernier soupir ? N’est-il pas à ses côtés à toutes les dates importantes, à toutes les heures graves, à toutes les minutes solennelles de son existence, comme pour lui dire : « Quand tu es bébé, je te baptise ; quand tu es enfant, je te fais communier ; quand tu es homme, je te marie ; quand tu vas mourir, je t’administre les derniers sacrements. Sans cesse tu m’appartiens ; à chaque phase décisive de ta vie, tu es à moi ! que tu viennes au monde ou le quittes, que tu naisses ou que tu meures, que tu sois jeune ou vieux, bien portant ou malade, je suis toujours là, à tes côtés, tout près de toi. Je t’ai sous la main constamment ; tu es sous ma dépendance toujours et partout. »
L’Église est insatiable. Il ne lui suffit pas que le fidèle lui appartienne au cours des événements qui font époque dans son existence ; elle entend qu’il ne puisse à aucun moment, se soustraire à l’envoûtement dont il est la victime ; elle veut qu’il soit dans la nécessité de recourir périodiquement aux Ministres du Culte catholique, qu’il soit tenu de prendre, assez fréquemment pour ne jamais avoir le temps de l’oublier, le chemin qui conduit à l’Église. Il fallait donc qu’au Baptême, au Mariage, à l’Extrême-Onction, sacrements dont l’administration ne s’opère pas périodiquement, vinssent s’ajouter d’autres sacrements- un au moins — dont le fidèle serait dans l’obligation de faire un usage régulier, périodique, assez fréquent. L’Eucharistie s’impose au catholique au moins une fois chaque année, à l’occasion des fêtes pascales. Une fois tous les douze mois, c’est assez, il et vrai, pour que le catholique n’oublie pas complètement sa religion et les devoirs qu’elle lui prescrit ; mais c’est peu, bien peu, trop peu, beaucoup trop peu, pour le tenir suffisamment en haleine et le garder, ainsi qu’il est utile, sous la domination de l’Église. Le sacrement de Pénitence est celui que l’Église a institué dans le but de rapprocher d’Elle constamment toutes les brebis du troupeau sur lequel Elle a, dit-elle, reçu le mandat de veiller. Elle en est, prétend-elle, responsable devant Dieu et le bon Pasteur a le devoir de ne laisser jamais trop s’éloigner ses ouailles, s’il ne veut s’exposer à en perdre.
Sébastien FAURE.
CONFESSIONNAL (Le)
n. m.
On donne le nom de confessionnal à un meuble ayant la forme d’une guérite, meuble occupant d’ordinaire, un coin discret et obscur dans une Église ou une Sacristie, et dans lequel le prêtre reçoit la confession du pénitent ou de la pénitente. J’ai dit, au mot Confession, que la Pénitence est, de tous les sacrements institués par l’Église, celui qui met le fidèle le plus fréquemment et le plus régulièrement en contact avec le clergé catholique. C’est, en effet, le sacrement qui fait prendre au catholique 1e chemin de sa paroisse, l’abîme dans l’humilité et le repentir de ses fautes, le contraint à verser dans l’oreille du prêtre, l’aveu de ses péchés et la confidence de ses tentations et de ses faiblesses, lui prescrit de dévoiler au confesseur ses pensées les plus cachées et ses plus secrètes intentions, frappe son esprit par le rappel du pouvoir surhumain dont dispose l’Église dans la personne de ses plus modestes représentants.
Tels sont les résultats qu’un rapide et superficiel examen du Sacrement de la pénitence met en pleine lumière. Ces résultats sont incontestablement précieux ; ils favorisent et consacrent avec force le pouvoir du clergé sur les adeptes de la religion catholique. Ils ne sont rien, cependant, auprès de ceux que révèle une observation poussée plus loin. Ils ne touchent que le fidèle lui-même. Le catholique zélé, scrupuleux, convaincu, vient au confessionnal pour y chercher naïvement l’apaisement de sa conscience bourrelée d’inquiétudes, la rémission de ses péchés et le ferme propos de ne plus retomber dans les mêmes égarements. De la part du catholique sincère et fervent, il n’y a là qu’un acte de foi, l’accomplissement d’une pratique religieuse et d’un devoir qui lui sont imposés ; mais, de la part du père spirituel, du directeur de conscience à qui il ouvre son cœur, il y a beaucoup plus ; car la confession ne se limite presque jamais au seul fidèle ; elle le dépasse ; elle s’étend à sa famille, à son entourage, à ses relations, à ses intérêts, matériels à tout ce qui, directement ou indirectement, concerne sa vie. Ici, c’est la femme qui répond aux questions qui lui sont posées sur son mari ; là, c’est l’enfant qui est interrogé sur ce qui se passe dans sa famille ; ailleurs, c’est le père ou la mère qui ont à parler de leurs relations ou de leurs affaires, de leurs embarras, de leurs préoccupations, de leurs revers et de leurs succès, de leurs appréhensions, de leurs espérances et de leurs projets. Et tel homme, telle femme, tel enfant qui se garderait bien de se confier à qui que ce soit, n’hésite pas, au tribunal de la Pénitence, à révéler tout ce qu’il sait ou suppose, non seulement parce qu’il croit que le secret en sera scrupuleusement observé, mais encore parce qu’il est persuadé qu’il ne doit rien cacher au prêtre, parce qu’il éprouve un certain soulagement à s’ouvrir et parce qu’il est convaincu que, s’il manquait de sincérité, en une circonstance aussi grave, il commettrait une grosse faute et ne manquerait pas d’en être puni.
Oh ! L’inégalable institution de surveillance et de police que le Confessionnal met aux mains du Clergé ! Que, dans chaque paroisse, il y ait seulement quelques dizaines de pénitents assidus et rien ne restera ignoré, par le curé et ses vicaires, de ce qui se passe au sein de la population tout entière. Que d’affaires se traitent, que d’associations se forment, que de mariages se concluent et aussi que de désaccords surgissent, que de conflits éclatent, que de méchancetés se commettent, dont il suffirait, pour en découvrir l’origine, de remonter aux confidences que les pénitents font quotidiennement à leur confesseur !
Du Sacrement de pénitence, je viens de dire : « institution de surveillance et de police ». Ce n’est point assez ; j’ajoute : « merveilleuse officine de délation ». Car l’exercice de la surveillance nécessite de la part de ceux qui s’en acquittent des démarches, de la prudence, des ruses, des travestissements ; la pratique de la police implique quelque danger et de multiples efforts. Le confesseur, lui, n’a pas besoin de se déranger, d’enquêter, de surprendre, de surveiller, de s’exposer. Il lui est suffisant d’attendre, dans l’ombre discrète du confessionnal, la venue du délateur bénévole et d’arracher à sa dévotion et à son aveuglement toutes les confidences, indiscrétions et mouchardages dont il n’aura plus qu’à faire son profit. Au tribunal de la Pénitence, le prêtre est tout-puissant ; le fidèle lui appartient en totalité, il est à sa merci. Le confesseur en fait ce qu’il veut, et c’est en toute confiance et joie intérieure que le confessé s’abandonne à lui et lui livre candidement ses parents, ses amis, ses relations et ses intérêts les plus chers. Peut-il cacher quoi que ce soit à cet homme illuminé de la grâce, investi d’une fonction sacrée, exerçant un ministère divin, qui peut lui refuser l’absolution et qui détient les clefs du paradis ? N’est-il pas venu chercher auprès de ce représentant du Souverain Maître la purification, la paix et le réconfort dont son âme éprouve le besoin ? On s’est étonné bien des fois de la connaissance parfaite que possède le clergé de l’état d’âme de toutes les personnes qui composent une population ; on s’est demandé, comment le parti-prêtre parvient à être si exactement renseigné sur les sentiments et opinions, sur la situation sociale, sur les secrets de la vie privée, sur les projets des uns et des autres.
Grâce au confessionnal, chaque paroisse possède ses informateurs et la fiche de chacun est constamment tenue à jour.
Sébastien FAURE.
CONFIANCE
n. f.
Certitude que l’on éprouve de se voir aider dans ses entreprises par un ou des individus auxquels on a fait part de ses espérances. Assurance de voir se réaliser ses présomptions. « Avoir confiance en ses amis. « Être confiant en l’avenir ».
La confiance est un sentiment indispensable lorsque l’on veut réussir dans une entreprise. Elle stimule et donne de la force et de l’énergie, alors que la défiance annihile tous les efforts. Manquer de confiance, c’est douter de tout et ne produire que du travail stérile ; c’est aller vers l’inconnu et être incapable de se déterminer un but. L’homme doit être confiant en lui-même, mais il faut qu’il sache discerner ses faux et ses vrais amis lorsqu’il doit placer sa confiance en d’autres individus. Accorder sa confiance à quelqu’un, c’est lui abandonner un peu de soi-même et par conséquent, il convient d’être certain de la probité et de l’affection de celui à qui on donne cette marque d’amitié. Il y a tellement d’intrigants et de filous qui cherchent à capter la confiance des autres pour s’en servir au mieux de leurs intérêts particuliers, que l’on hésite aujourd’hui à se confier à autrui.
Pourtant, il est encore des hommes dignes de confiance, et si tous les politicaillons ont spéculé sur l’aveuglement des masses qui avaient placé en eux toutes leurs espérances, il nous reste assez de confiance pour présumer que l’avenir sera meilleur que le passé et que chaque heure qui s’écoule nous approche de la libération. Nous avons confiance, et c’est cette confiance qui nous stimule dans notre de désir de poursuivre la lutte, malgré les embûches qui se dressent sur notre route.
CONFLIT
n. m.
Le conflit est le choc qui résulte de l’antagonisme qui existe entre des éléments qui s’opposent. Juridiquement, le conflit, nous dit le Larousse, est : « la lutte qui s’élève entre deux tribunaux revendiquant ou repoussant tous deux la même affaire ».
Dans le langage courant, le mot conflit emprunte une autre signification, et caractérise un différent qui s’élève entre deux ou plusieurs parties. Il y a les conflits d’intérêt, les conflits politiques, les conflits sociaux, etc..., etc...
La vie dans les sociétés modernes est illustrée par des conflits de toutes sortes. Ce sont les uns qui se déchirent et qui entrent en conflit pour obtenir des privilèges et des honneurs ; et les autres qui sont en conflit pour savoir de quelle façon on se débarrassera des premiers. C’est la lutte constante et ininterrompue des hommes contre les hommes. Lorsque les conflits naissent de l’opposition de certains intérêts individuels, les dangers sont relatifs, mais sitôt qu’ils débordent du cadre de la nation et qu’ils s’élèvent entre gouvernements de pays étrangers, la menace devient terrible, car ces conflits dégénèrent en guerres meurtrières dont les travailleurs sont les premières victimes. Il serait à souhaiter que, dans l’avenir le plus proche, la classe ouvrière fût unie et forte, pour pouvoir sortir victorieuse du conflit inévitable entre le Capitalisme et le Travail.
CONFRONTATION
n. f.
Action de mettre en présence, différentes personnes, pour examiner contradictoirement leurs dépositions. La « confrontation » est d’usage en justice, entre accusés ou témoins, dont les déclarations sont opposées ; elle a pour but la recherche de la vérité, mais en réalité son résultat est d’embrouiller les affaires les plus simples.
On dit aussi : « confronter deux écritures », c’est-à-dire examiner si elles sont semblables l’une à l’autre ; confronter des idées, des objets, etc., afin de rechercher quels sont leurs rapports communs en usant de la comparaison. Réserve faite de la confrontation judiciaire qui est toujours négative et ne peut servir en rien les intérêts collectifs, la confrontation des idées et de toutes autres choses est une action utile qui peut faire jaillir la lumière et nous éclairer sur bien des questions qui demeurent obscures.
CONGRÈS
n. m.
Assemblée de délégués dont les mandataires ont eux-mêmes examiné les questions à traiter par le Congrès et, indiqué les solutions qui leur paraissent les meilleures.
Le délégué au Congrès a charge de défendre le point de vue adopté par ceux qui l’ont mandaté, de faire tous ses efforts pour le faire triompher ou de se rallier a un point de vue à peu près analogue à celui qu’il a exposé. Le Congrès est le pouvoir législatif des Syndicats, Coopératives ou Associations diverses d’intérêts matériels ou moraux. Les décisions des Congrès, que ceux-ci soient syndicaux, politiques, coopératifs ou scientifiques, sont appliquées, exécutées, par une Commission exécutive ou administrative. C’est le pouvoir exécutif des organismes. L’application des décisions des Congrès, les actes ou actions qui en découlent sont contrôlés par des Comités nationaux ou internationaux. C’est le pouvoir de Contrôle. Si chacun de ces rouages fonctionne bien, s’il remplit le rôle qui lui est dévolu, le groupement ou les groupements réunis atteignent presque toujours à la prospérité et font d’excellente besogne. C’est d’ailleurs assez rare. On voit le plus souvent l’exécutif ne pas tenir un compte suffisant des décisions législatives, et plus encore, on enregistre la défaillance du Contrôle, qui donne trop facilement un blanc-seing à ce même exécutif, ou accepte ses explications et ses thèses sans les contrôler ni les vérifier. C’est bien la pire des choses et souvent les Congrès ne légifèrent, ne décident que d’après les explications de l’exécutif, qui se targue d’un Contrôle inexistant ou défaillant. Il ne faut pas chercher ailleurs la cause des erreurs doctrinales, des rectifications de tir, des changements de tactiques qu’un exécutif habile arrive toujours à expliquer ou à masquer, lorsqu’il, a quitté la ligne droite et prépare quelque conversation qui va le plus souvent à rencontre de l’intérêt général des travailleurs, coopérateurs ou associés de tous ordres.
Dans le mouvement ouvrier, il y a différentes sortes de Congrès, ce sont : les Congrès régionaux ou départementaux, les Congrès de Fédérations d’industrie ou fédéraux, les Congrès nationaux de toutes les Fédérations ou Congrès confédéraux, les Congrès qui réunissent par industrie les représentants de divers pays, ou Congrès fédéraux internationaux, et enfin les Congrès qui réunissent les représentants nationaux de toutes les Corporations, ou Congrès internationaux des Centrales syndicales. Il en est de même sur le plan coopératif ou politique. C’est dans les Congrès de toute nature que se confrontent les thèses doctrinales, que se vérifient les expériences faites et que sont tracées les directives de l’action à mener. Les Congrès se tiennent soit tous les ans soit tous les deux ans, suivant les statuts des organismes.
Les Congrès voient généralement des tendances se former pour défendre des thèses en présence. Ces thèses sont défendues avec vigueur et parfois avec parti-pris. De l’exposé des thèses surgit presque toujours une résolution, une motion, un ordre du jour les condensant et sur lesquels les délégués ont à se prononcer par un vote qui donnera à la thèse ainsi consacrée le caractère d’une décision qui constitue pour un ou deux ans, la ligne de conduite, de propagande et d’action des groupements affiliés à l’organisation qui a tenu ce Congrès. Ce sont là des principes généraux que suivent tous les groupements, qu’ils soient ouvriers ou patronaux ; ces principes constituent une sorte de jurisprudence consacrée par l’usage et passée dans les mœurs. On retrouvera ce terme dans l’exposé général du syndicalisme.
Il y a aussi d’autres sortes de Congrès. Dans l’ordre religieux, il y a les Conciles qui ont charge d’examiner les thèses de l’Église, de surveiller l’intégrité du Dogme et de condamner réformateurs et iconoclastes. Jean Huss, précurseur de la Réforme, fut condamné à être brûlé vif par le Concile de Constance, et exécuté en 1415. On retrouve d’ailleurs, le motConcile, à son ordre, dans cette encyclopédie. Les Conclaves sont des Congrès de prélats portant le titre de cardinaux, qui ont charge d’élire le pape lorsque le successeur de St-Pierre vient à décéder. On retrouve également ce mot à son ordre. Il y a enfin les Congrès de Parlements. En France, les deux Chambres : députés et sénateurs se réunissent en Congrès, à Versailles, pour élire le président de la République, ou pour modifier la Constitution. Il en est de même aux États-Unis, en Suisse.
Il y a encore des Congrès de la Paix, qui, généralement, préparent la guerre. Celui de la Haye fut le plus fameux. La Société des Nations, avec ses séances trimestrielles et mensuelles, tient elle aussi, des Congrès où sont pris des engagements aussi solennels que vite oubliés. Ce qu’il faudrait souhaiter, c’est que toutes ces parlotes inutiles et vaines de gens qui ne sont là que pour mentir et tromper les peuples soient remplacés par un Congrès des Peuples, où ceux-ci fixeraient leurs rapports et enterreraient définitivement la guerre, le capitalisme et son exécrable régime. Mais ce jour n’est pas encore venu. Ce jour-là, les Congrès ouvriers auront, eux aussi, plus d’intérêt qu’en ce moment. Ils auront aussi de plus graves responsabilités à prendre.
Pierre BESNARD.
* * *
CONGRÈS
Assemblée de gens ayant pour mission de délibérer sur des intérêts communs. Les Congrès se différencient des Assemblées ordinaires, de ce fait qu’ils ne sont convoqués qu’à des périodes indéterminées et assez éloignées les unes des autres. Un Congrès ne siège jamais en permanence. Il y a plusieurs catégories de Congrès, et leur importance est relative aux questions qui y sont traitées et aux sujets qui y sont débattus. Nous avons tout d’abord les Congrès diplomatiques, dont les acteurs sont les représentants de différentes nations ayant des conflits à régler. Les représentants des dites nations ont ordinairement comme mandat, de défendre les intérêts généraux de leur pays, et de chercher un terrain de conciliation pour éviter les ruptures qui sont les prémices de 1a guerre ; c’est du moins ce que l’on dit au peuple ; mais, en réalité, les diplomates et les ambassadeurs s’acquittent de leur besogne, sans s’inquiéter aucunement des intérêts généraux de la nation, mais simplement de ceux d’une infime minorité qui tire les ficelles de la politique. Lorsque ces Messieurs de la diplomatie ont du temps à perdre, ils s’attaquent parfois à des questions d’ordre sentimental ; c’est ainsi qu’au Congrès de Genève, en 1863, ils accouchèrent d’une convention internationale neutralisant les blessés en temps de guerre et que en 1878, le Congrès de Saint-Pétersbourg prononça l’interdiction de l’emploi des balles explosives. Nous savons comment ces conventions furent respectées, et le cas que l’on fit, entre 1914 et 1918, des décisions de Genève et de Pétersbourg. En France, on appelle également « Congrès », la réunion de la Chambre des députés et celle du Sénat, lorsqu’il faut élire un nouveau président de la République, ou modifier la constitution. Ce Congrès se réunit au Palais de Versailles. Mais il se tient d’autres Congrès que ceux d’essence politique et diplomatique, et, bien qu’ignorés du public, ils offrent cependant un intérêt autrement appréciable que les premiers. Ce sont les Congrès de savants, qui enregistrent les découvertes récentes et dans lesquels les hommes de science se concertent pour étudier les phénomènes de la nature et, en unissant leurs connaissances, arriver à poursuivre l’oeuvre de civilisation ; ce sont les Congrès de médecins, dans lesquels on travaille pour alléger et abréger les souffrances physiques de l’individu et ce sont, enfin, les Congrès ouvriers, où le travailleur cherche son orientation et les moyens utilisables pour lutter contre le capital et l’abolir. Nous dirons donc, s’il nous faut donner une définition, de ce qu’est un « Congrès » : que c’est la réunion de délégués d’une nation, d’un parti politique, d’une organisation syndicale ou philosophique ; et que son rôle est d’enregistrer le travail accompli dans le passé, de souligner une situation de fait et de déterminer une situation et un travail d’avenir.
Quelles que soient les imperfections, dues plutôt à la manière qu’à l’esprit dans lequel il est organisé, le Congrès est l’unique forme de représentation en usage dans les organisations de réforme sociale, et si les résultats que l’on pouvait en espérer ont souvent été négatifs, c’est que, même dans les associations d’avant-garde, on ne s’est pas encore libéré des pratiques politiques, que la « manœuvre » y est d’une pratique courante et que l’on cherche trop souvent à satisfaire son petit orgueil par une victoire oratoire, sans songer aux intérêts profonds de la classe ouvrière.
Il y a, en France, deux importantes organisations prolétariennes : la Confédération générale du Travail et la Confédération générale du Travail unitaire. La ligne de conduite de ces organisations est déterminée par le Congrès, qui se réunit tous les deux ou trois ans, et plus souvent, si la nécessité s’en fait sentir. Il est évident qu’il serait préférable que ces Congrès nationaux fussent convoqués à. des dates plus rapprochées les unes des autres ; mais on sait les frais qui sont occasionnés par le déplacement de centaines de délégués ; nous ne devons pas oublier que nous sommes en régime capitaliste, et que les caisses des organisations ouvrières sont plus souvent vides que pleines. Les délégués à ces Congrès sont désignés par l’Assemblée générale de leur organisation particulière, et y sont également représentées les diverses fédérations d’industrie ou de région ; ces fédérations n’ont pas voix délibératives, mais consultatives. Nous pouvons donc considérer que dans son esprit, la représentation est assez logique, et qu’il serait difficile de faire mieux dans la situation présente de l’organisation ouvrière et sociale. Les délégués au Congrès doivent s’inspirer des désirs de leurs mandants, pour approuver ou désapprouver le travail et la politique du bureau qui, ordinairement, fut désigné par le Congrès précédent et qui accepte, secondé par une Commission exécutive, la responsabilité de l’organisation, durant la période qui sépare deux Congrès ; d’autre part, les représentants des organisations ont à charge, toujours en s’inspirant de l’esprit des organisations qui les ont mandatés, de déterminer la ligne de conduite future de l’organisation nationale. Nous avons dit plus haut, que la façon dont sont organisés les congrès ouvriers n’était pas exempte de critiques. Il est, en effet, regrettable de constater qu’il arrive fréquemment que des « chefs » d’organisation usent du pouvoir et de l’autorité dont ils disposent pour s’imposer à la masse, et manœuvrent de telle manière qu’il est impossible de les déloger des fonctions qu’ils occupent et qu’ils entendent conserver indéfiniment. Ce sont des travers qui ne seront vaincus que par l’éducation des travailleurs qui, prenant leurs responsabilités, n’attendront pas leur libération de la venue d’un messie quelconque. Sans remonter bien haut dans l’histoire prolétarienne de la France, il faut cependant citer, car il exerça une réelle influence sur la vie et sur l’action du Prolétariat, le Congrès d’Amiens qui, en 1906, traça les droits et les devoirs de la classe ouvrière, détermina le but qu’elle poursuivait et élabora une charte restée célèbre dans le monde syndical.
Depuis la fin de la « Grande guerre », différents Congrès nationaux se sont réunis ; celui de 1919 mérite une mention particulière, parce qu’il fut celui où Jouhaux, secrétaire de la Confédération générale du Travail exposa et chercha à légitimer les déviations dont il s’était rendu coupable durant la guerre ; et aussi parce que ce Congrès marqua l’aube de la division du Prolétariat français, qui devait s’effectuer au Congrès suivant, à Lille. Deux tendances s’affrontèrent à ce quatorzième Congrès, qui tint ses assises dans la ville de Lyon, et les principes du réformisme et de la collaboration de classe sortirent victorieux de la bataille. Il est curieux de relire les déclarations du secrétaire de la C.G.T., qui défendit avec chaleur son attitude guerrière et les relations qu’il noua au cours de la boucherie, avec les représentants officiels des divers gouvernements. Le Congrès de Lyon ne fut qu’une préface ; insensiblement, la classe ouvrière ouvrit les yeux et comprit son erreur ; elle se sépara petit à petit des chefs réformistes qui voulaient éteindre le flambeau qui, durant des années, avait éclairé le prolétariat, mais ceux-ci se mirent sur la défensive, et par un statut arbitraire éliminèrent de l’organisation syndicale, les ouvriers et les syndicats qui refusaient de se courber sous le joug des dirigeants. Les forces prolétariennes furent coupées en deux et la scission fut consommée au Congrès de Lille.
Il se forma par la suite, en conformité avec le Congrès qui se tint à Paris, en décembre 1921, une nouvelle confédération ouvrière, qui prit le nom de Confédération générale du Travail unitaire, et qui ne tarda pas à grouper plusieurs centaines de milliers de travailleurs. Depuis cette date, toutes les tentatives pour regrouper les forces éparses de la classe ouvrière sont restées inopérantes. Dans chaque Congrès, des motions d’unité sont présentées et votées par les délégués du prolétariat, mais il semble que ces congrès soient guidés par des forces occultes et l’application de ces motions reste vaine. Le mal dont souffrent les organisations politiques a pénétré dans le giron du prolétariat, et les Congrès ouvriers n’offrent plus un caractère particulier, mais sont le théâtre de luttes politiques qui affaiblissent le prolétariat.
Il nous faut dire quelques mots sur les Congrès anarchistes et plus particulièrement sur ceux qui ont déterminé le mouvement anarchiste à son origine. C’est en 1873, que l’on doit fixer la naissance de l’anarchisme en tant que mouvement ; car si, antérieurement, les partisans d’une société anti-autoritaire travaillaient en collaboration avec les éléments révolutionnaires de l’Association internationale des Travailleurs, c’est en 1873 qu’ils se désolidarisèrent d’une façon catégorique des défenseurs du principe d’autorité. La résolution qui fut présentée au Congrès anarchiste de Berne, qui se réunit en 1876, résolution qui fut acceptée par tous les délégués présents mérite d’être citée :
-
Plus de propriété, guerre au capital, aux privilèges de toute sorte et à l’exploitation de l’homme par l’homme ;
-
Plus de patrie, plus de frontière et de lutte de peuple à peuple ;
-
Plus d’État, guerre à toute autorité dynastique ou temporaire, et au parlementarisme ;
-
La révolution sociale doit avoir pour but de créer un milieu dans lequel désormais l’individu ne relèvera que de lui-même, sa volonté régnant sans limites et n’étant pas entravée par celle du voisin.
Pour bien préciser les buts de l’Anarchisme, Elisée Reclus faisait adopter, en 1878, au troisième Congrès anarchiste qui tint ses assises à Fribourg, la résolution suivante :
« Nous sommes révolutionnaires parce que nous voulons la justice... Jamais un progrès ne s’est accompli par simple évolution pacifiste, et il s’est toujours fait par une évolution soudaine. Si le travail de préparation se fait avec lenteur dans les esprits, la réalisation des idées se fait brusquement. Nous sommes des anarchistes qui n’ont personne pour maîtres et ne sont les maîtres de personne. Il n’y a de morale que dans la liberté. Mais nous sommes aussi des communistes internationaux, car nous comprenons que la vie est impossible sans groupement social. »
Ces deux Congrès sont, à nos yeux, les plus importants, car ils établirent ce que l’on pourrait appeler une charte anarchiste. Il y eut par la suite, d’autres Congrès anarchistes, et notamment celui d’Amsterdam, en 1907, où Malatesta essaya de rapprocher les anarchistes individualistes et communistes, et tenta également de jeter les bases d’une internationale anarchiste. Malheureusement, ces tentatives échouèrent et, depuis, les anarchistes disséminés de par le monde n’ont eu entre eux que des relations par correspondance. Il faut espérer que la faillite des partis politiques donnera un renouveau d’énergie aux anarchistes, et que bientôt, unis nationalement et internationalement, ils se retrouveront dans les Congrès qui n’auront plus à jeter les bases de l’anarchisme théorique, mais à rechercher les moyens les plus propices pour abolir le capital et élaborer sur ses ruines une société libertaire de laquelle aura disparu l’autorité.
CONJECTURE
n. f.
Jugement qui ne s’appuie que sur des probabilités et des suppositions. « La physionomie n’est pas une règle pour juger les hommes, elle nous peut servir de conjecture. » (La Bruyère.) Il ne faut jamais se fier aux apparences, et il ne faut jamais se baser sur des conjectures pour se faire une opinion. Condillac a dit fort justement : « Il est permis de conjecturer, mais avec beaucoup de réserve et de prudence, car celui qui conjecture ne s’appuie trop souvent que sur le vide ». Bien des gens devraient s’inspirer des conseils de Condillac, et ne pas émettre des jugements à tort et à travers. On se perd en conjectures, c’est-à-dire en présomptions, en suppositions, alors que la réalité brutale des faits devrait seule nous éclairer. La conjecture est dangereuse car elle est trompeuse et détermine parfois des erreurs regrettables.
CONJONCTURE
n f.
Occasion, rencontre de circonstances. Il est des conjonctures favorables et des conjonctures fatales. « Toute confiance est dangereuse si elle n’est entière ; il y a peu de « conjonctures » où il ne faille tout dire ou tout cacher. » (La Bruyère.)
CONNIVENCE
n. f.
Action de participer moralement à une action. Se rendre complice d’un fait en n’en empêchant pas l’exécution, bien qu’on en ait la possibilité.
« Un juge connive aux concessions d’un greffier. Le receveur connivait avec le percepteur. Cette mère connive au libertinage de sa fille. Peut-être alors serai-je forcé moi-même, d’écarter le soupçon d’avoir connivé à cet indigne procédé. » (Diderot.)
La connivence en matière criminelle est punie en vertu d’articles du Code pénal ; c’est ainsi que l’individu qui, de connivence avec un détenu, favorise par son silence l’évasion de celui-ci, est puni d’une peine de six mois de prison.
Le capital, ou plutôt la bourgeoisie est de connivence avec les gouvernements qui organisent la répression contre le prolétariat ; mais la bourgeoisie reste dans l’ombre et n’est que le cerveau ; le gouvernement est le bras. La complicité de la bourgeoisie n’en est pas moins manifeste.
CONQUÊTE
n. f.
Action de prendre, de gagner, d’acquérir, d’obtenir par la force ou par la ruse, de capter une chose, un objet, une idée ; d’accaparer une ville, une province, un pays ; en un mot, soumettre quelqu’un ou quelque chose à sa domination. Les conquêtes peuvent se diviser en deux catégories bien distinctes :
-
les conquêtes utiles et bienfaisantes ;
-
les conquêtes nuisibles et criminelles.
Les premières sont celles qui ne se réalisent pas au mépris de la logique, de la vérité ou de la justice ; elles se caractérisent par les victoires de la civilisation sur l’ignorance et la bestialité humaines. Ce sont les conquêtes de la science, qui, loin de servir aux appétits du capital et du militarisme, pénètrent au plus profond des couches sociales et viennent jeter sur l’humanité malheureuse une lueur l’espérance. Ce sont ces conquêtes qui, acquises au prix de sacrifices sans nombre, ont fait germer dans le cerveau des hommes, l’amour de la liberté et de la fraternité. Ce sont les conquêtes de tous les savants, de tous les philosophes, de tous les littérateurs, de tous 1es écrivains qui déchirent le voile du passé et nous tracent la route de l’avenir.
Hélas, ce ne sont pas les seules conquêtes qui illustrent l’histoire. « II y a des crimes qui deviennent glorieux par leur éclat ; de là vient que prendre des provinces injustement s’appelle faire des conquêtes. » (La Rochefoucauld.) Les conquérants ont, depuis des siècles et des siècles, ravagé le monde et de même que l’herbe ne croissait plus partout où le cheval d’Attila avait passé, des civilisations se sont écroulées et éteintes partout où l’esprit de conquête à dominé. La terre fut le tout temps ensanglantée par des conquérants avides, répandant l’effroi sur leur passage et semant la haine, la misère et la mort. Les démocraties modernes n’ont rien à reprocher aux anciennes autocraties, et les enquêtes criminelles de nos sociétés modernes s’inscriront à l’encre rouge sur les pages de l’histoire. « A l’égard du droit de conquête, il n’y a d’autre fondement que celui du plus fort », nous enseigne J.-B. Rousseau, et il est vrai, hélas ! que « la raison du plus fort est toujours la meilleure ». C’est pourquoi il ne suffit pas aux opprimés de ce monde d’avoir raison, il faut aussi qu’ils aient la force et la puissance de se faire craindre, s’ils veulent partir à la conquête de la richesse sociale accaparée de nos jours par une poignée de parasites.
CONSCIENCE
n. f.
Ce mot a deux sens philosophiques bien différents. Il désigne cette connaissance ou ce sentiment de ma propre existence qui accompagne tous mes états intérieurs ou peut-être seulement mes changements d’état. Il désigne aussi le jugement secret qui approuve certains de mes projets et de mes actions mais en blâme d’autres. Au premier sens, le mot appartient à la psychologie. Au second, il appartient à l’éthique, sagesse ou morale.
Conscience Psychologique ou Conscience de Soi. — Encore que les sophistes aient opéré en philosophie la première révolution critique, c’est-à-dire le premier effort pour tourner notre attention non plus vers le monde extérieur, mais vers le monde interne ; encore que Socrate, le plus grand des sophistes, recommandât de se connaître soi-même : on ne trouve jamais, dans ce qui nous reste des sophistes et des socratiques, un mot qui se puisse traduire par conscience. (Pourtant, le verbe d’où se tirera le substantif correspondant se rencontre au moins dans Xénophon.)
Platon ne distingue pas la conscience des autres opérations de l’esprit ; il ne connaît aucune forme commune aux faits intérieurs. Là où nous disons conscience, il énumère : raison, science, mémoire et opinion juste. Comme nous disions qu’on ne jouit pas d’un plaisir sans en avoir conscience, Platon, au Philèbe, exige, pour qu’il y ait plaisir, que les quatre caractères sus nommés accompagnent la cause de la jouissance. Aristote, quoiqu’il en fasse une manière de théorie tâtonnante, n’a pas non plus de mot pour désigner la conscience psychologique. Les stoïciens sont les premiers à donner nom et unité au sens intérieur ; ils l’appellent synédèse, et ce mot est composé exactement comme notre mot conscience.
Le problème de la conscience psychologique de ses « données immédiates » et de ses limites est fort difficile. Je n’ai pas la prétention de le résoudre, ici ni ailleurs. Trois grandes thèses s’y combattent. Pour certains spiritualistes (Leibniz, Maine de Biran, Ravaisson, Bergson), la conscience atteint en nous l’être un, identique, cause de ses propres actions. Elle nous donne du réel, de l’absolu, du vital. Grâce à elle, la psychologie, si elle sait devenir assez profonde, assez large et assez hardie, englobe la métaphysique et l’illumine.
Pour l’école critique, la conscience est une forme ; elle ne révèle pas l’être réel que je suis ; elle dit seulement comment je m’apparais, comment je ne puis pas ne pas m’apparaître. Toutes les idées que les spiritualistes prétendent dégager de cette apparence inévitable, idées de cause, d’unité, d’identité, ne sont que les formes à priori qui rendent possible cette apparence, et rien ne nous permet d’affirmer que quelque chose répond à ces idées dans la réalité. Les empiriques (Stuart Mill, Alexandre Bain, Herbert Spencer, Th. Ribot, etc.) voient dans la conscience, la caractéristique des faits psychologiques, lesquels sont probablement des faits physiologiques d’une certaine intensité. La science de l’esprit n’est que la science des faits accompagnés de conscience et des lois selon lesquelles ils s’associent. Comme toutes les autres sciences, elle reste confinée au pays des phénomènes, ne saurait nous projeter dans le royaume de la substance, de l’absolu et du vital. La conscience n’existe que dans le changement ; sa forme la plus simple est l’oscillation entre deux états. Toute conscience reste donc relative, et par suite, toute pensée. D’ailleurs, la conscience, qui a évolué, nous présente aujourd’hui comme primitifs et irréductibles des phénomènes dérivés et très complexes. Quant aux phénomènes inconscients, sur quoi Leibniz attira le premier l’attention, la plupart des empiriques les classent comme physiologiques, non comme psychologiques. Ils n’y voient, avec Stuart Mill, que « modifications inconscientes des nerfs ».
J’indique rapidement mon opinion, qui sans doute, importe peu au lecteur. La thèse empirique et la thèse critique me paraissent contenir, l’une et l’autre, de beaux éléments de vérité. La thèse empirique est supérieure comme hypothèse de travail. La thèse critique me satisfait davantage, les jours ambitieux et imprudents, où je m’amuse dès maintenant à une explication totale qui sera peut-être toujours prématurée. Je sollicite, d’ailleurs, l’une ou l’autre assez pour l’accorder à ma psychologie pluraliste (voir ce mot), c’est-à-dire à ma persuasion ou à ma rêverie que ma substance intérieure est, comme la matière de mon corps, une colonie d’êtres innombrables.
Conscience Ethique. — On dit plus souvent « conscience morale ». Mais mon immoralisme de sagesse, qui conserve et individualise le sens éthique, ne me permet pas de parler selon la coutume. (Voir les mots Ethique, Morale, Sagesse). Dans sa signification éthique, le mot conscience a contre lui d’avoir été ignoré de tous les anciens, d’être une création du christianisme. A condition de le désarmer de tout venin autoritaire, il est pourtant commode pour désigner l’ensemble de ce que Socrate appelait « les lois non écrites » ; pour rappeler aussi, avec cette doctrine des sophistes que « l’homme est la mesure de toutes choses », cette formule d’Aristote que « l’homme bon est la règle et la mesure du bien ».
Par une analyse heureuse, les docteurs du moyen-âge reconnaissent dans la conscience éthique un élément intellectuel (distinction du bien et du mal) et un élément sentimental (penchant vers le bien, recul devant le mal), qu’ils nommentsyndérèse.
Ne consultez ni le Littré, ni le Larousse. Ici, comme en quelques autres occasions, ces excellents dictionnaires vous jetteraient dans l’erreur. Ils ne connaissent qu’un sens tardif et dérivé ; ils font de syndérèse un synonyme bien inutile deremords. Et ils donnent une étymologie absurde. La francisation du mot date du XVIe siècle. C’est pourquoi on le fait venir du grec syntézésis et on lui fait porter la marque de la prononciation des Grecs modernes, qui, après la lettre correspondante à n, donnent au t le son de notre d. Dans tout le moyen-âge, on le rencontre, pour la première fois, dans Saint Jérôme (mort en 420). Il est probable que le mot bizarre est dû à une erreur de copiste : Jérôme, transformant en faculté éthique la conscience psychologique, avait sans doute écrit le mot stoïcien synédèse.
A cause de son origine religieuse, le mot conscience conserve souvent un sens autoritaire. Quand la troisième République rendit laïque le personnel de son enseignement et feignit d’en laïciser la couleur superficielle, elle fit un acte de foi un peu mystique en la conscience morale, proclama le bien et le devoir comme des évidences universelles et qui se suffisent. On purgea la morale de ses ridicules sanctions infernales ou paradisiaques, non de son caractère obligatoire. Sous l’influence conjuguée du Cousinisme et du Kantisme, on fit de l’obligation le centre de la moralité et on prêcha « la religion du devoir ». Un des meilleurs théoriciens de la doctrine : C.-A. Vallier, écrivait en 1822, dans l’Intention Morale, ces paroles austères :
« La loi morale ne se révèle qu’à ses adorateurs ; elle veut être crue sans preuve. Elle est parce qu’elle est ou plutôt parce que nous voulons qu’elle soit. »
Plusieurs sentaient que ce chemin conduisait vers plus de liberté qu’ils ne voulaient et tentaient de donner à la morale quelque fondement métaphysique. Fondement ruineux dès qu’une dogmatique n’est plus imposée. Les meilleurs de ceux qui essayent ces tentatives désespérées, Frédéric Rauch, par exemple, ou M. Lévy-Bruhl, les désavoueront plus tard.
La conscience individuelle, sans avoir subi aucune déformation éducative, permettrait-elle la construction d’une morale universelle ? D’une, non, mais de plusieurs. Parce que, même sans aucun enseignement, elle est déformée et contient d’innombrables éléments sociaux et grégaires. Bête de troupeau, le chien Nietzsche pour qui elle exige l’intensité de la vie et la domination sur les moutons. Pour l’anthroposociologie des états-majors et des nationalistes intégraux, elle sacrifie l’humanité à une nation et fait l’apologie de la guerre. La stupide conscience de l’Américain moyen chante haine du nègre et la gloire du dollar. Pour Adam Smith, la conscience n’est que sympathie ; pour Schopenhauer ou pour Tolstoï, n’est-elle pas un autre nom de la pitié ? Mais chez Herbert Spencer, elle devient un hymne en l’honneur du Progrès, c’est-à-dire l’Hétérogénéité Croissante.
Les siècles nous ont fait une conscience bien contradictoire.
Que chacun fasse l’effort d’éliminer tout ce qu’il porte de grégaire et de se découvrir lui-même. Mais qu’il ne se flatte pas de pouvoir ensuite déchiffrer les autres.
Il est d’une prudence élémentaire de se refuser à déterminer le contenu pur de la conscience éthique, reconnaître qu’elle peut varier avec les individus, que chacun est la mesure de sa vérité et que je ne puis éclairer et diriger que moi-même.
Je reviens volontiers à l’éthique stoïcienne, mais en l’amendant pour lui donner une forme. Etre multiple, l’homme est déchirement et douleur s’il ne sait se faire harmonie et bonheur. Il veut être heureux ; il ne se découvre, aux profondeurs, nul autre but qui lui attribue une vocation différente, confond des moyens, efficaces ou non, avec la fin véritable. Or, le bonheur ne se trouve que dans l’accord avec soi-même. Ma conscience, c’est mon besoin d’harmonie ; la voix de ma conscience, c’est l’avertissement devant ce qui empêchera ou troublera mon harmonie. Je suis intelligence, cœur et instinct. Il faut que j’arrive a mettre d’accord tout cela. Quand tout cela se précipite vers un geste ou recule devant un geste, ma conscience est ce oui ou ce non unanime de mon être. Lorsque tout cela n’est pas d’accord, ma conscience et son incertitude sont la recherche tâtonnante de mon harmonie. Parfois — rarement — elle exige un sacrifice. En cas d’absolue nécessité, je fait couper, pour sauver ma vie, mon bras gangrené. Pour sauver mon harmonie essentielle, il m’arrive de rejeter un de mes instincts. Plus souvent je réussis à l’apaiser par une satisfaction de rêve ou à le diriger et l’utiliser. Comme disent les psychanalistes, je le platonise ou je le sublime. Jamais je ne puis sacrifier ni ma raison ni mon cœur. Je meurs également si on me coupe la tête ou si on m’arrache le muscle cardiaque. De même je ne conserve une vie éthique qu’autant que je protège ma raison et ma sensibilité humaine. Pour les protéger et les mettre d’accord, je n’ai guère qu’à les découvrir. Dans leur pureté, ils sont toujours en harmonie comme deux nécessités de ma vie, comme deux conspirateurs pour ma vie. Leur lutte apparente est faite de confusion. Tant que je prends ma logique pour ma raison ou les traditions pour mon cœur, je suis un pauvre être divisé avec lui-même. Dès que j’atteins la vérité de mon cœur et de ma raison, je connais ma profonde volonté et ma joyeuse harmonie.
Mais le chœur émouvant que forment mon sentiment et mon intelligence chante des conseils, non des ordres. Je repousse en riant l’idée que l’impératif éthique puisse avoir une autorité particulière. Nulle obligation. Mais l’impossibilité d’être heureux sans écouter ma conscience. Quelque chose d’analogue à l’impossibilité de sourire à la phrase que j’écris, tant que je ne lui ai pas donné rythme et clarté.
D’après Kant et ses suiveurs, l’obligation fait partie de la définition même de la morale. Partout ailleurs, il y a impératif hypothétique : « Fais ceci, si tu veux cela ». Ici il y aurait impératif catégorique : « Fais ceci », sans condition. Si Kant avait raison, le sage verrait là un motif de plus de révolte et d’immoralisme.
Mais Kant se trompe. L’Impératif éthique n’est pas catégorique en fait puisqu’on lui désobéit. Et il est hypothétique comme tous les impératifs humains. « Si tu ne veux pas que je te fasse fusiller », sous-entend le colon qui me donne un ordre. Ainsi son ordre est un conseil, que peut-être un conseil intérieur affrontera et me fera mépriser. Le conseil prend l’apparence d’un ordre quand on suppose que je veux réaliser l’hypothèse sur quoi il s’appuie. Tout comme les anciens rois de France, mon médecin rédige des ordonnances : il suppose légitimement que je veux guérir et vaniteusement que j’ai confiance en lui. Un professeur de danse ou de billard profère ses règles aussi apodictiquement que Kant ou mon curé : ma présence chez eux les autorise à sous-entendre mon vouloir.
Pour l’être noble qui a soif de vérité, de beauté créée, de beauté vécue, trois impératifs deviennent, par son vouloir et sa constance, catégoriques. Il a épousé sans divorce possible les trois hypothèses. Il est prêt à sacrifier les fins moins intéressantes à la science, à l’art au rythme libre de sa conduite. Mais la nécessité intérieure de savoir, de créer ou de se réaliser n’a une force triomphante que chez un petit nombre. Pour les populaces d’en haut ou d’en bas, sont autrement impératives, non point seulement les nécessités biologiques, mais les fantaisies chatouilleuses ou enivrantes du plaisir, de la richesse, de la vanité. La conscience est aussi facile à étouffer que le goût délicat ou l’amour du vrai. Pour défendre en nous ce centre libre, ne nous laissons « bourrer le crâne » ni par autrui ni même par la logique ; ne nous laissons bourrer le cœur ni par !es instincts ni surtout par les traditions.
HAN RYNER.
* * *
CONSCIENCE
(lat. conscientia)
Sentiment qu’un être a de son existence — sentiment du moi, ex : L’homme a conscience de sa liberté. Un profond sommeil lui a fait perdre la conscience. Sentiment intérieur par lequel l’homme juge du bien ou du mal de ses actions, ex : Suivre les inspirations de sa conscience ; parler contre sa conscience.
Tout le monde attache au mot « Conscience » deux acceptions différentes. Certains dictionnaires donnent jusqu’à dix-sept définitions de ce mot. Cela provient de l’état actuel de la science, qui ne peut démontrer la réalité de la conscience en tant qu’être immatériel et qui est en conflit avec les religions, qui affirment que la conscience est une qualité de l’âme. D’autre part, la science matérialiste apporte un troisième point de vue :
La conscience, ou sensibilité, ou sentiment d’existence, est une fonction de la matière à un certain moment de son évolution. Philosophiquement, il est d’une grande importance de savoir ce qu’est la conscience. Descartes expose et défend ce point de vue : si l’âme, la conscience, la faculté de sentir, sont une fonction de la matière, la conscience, l’âme, la faculté de sentir, sont partout, à un degré différent. Il n’y a pas de différence essentielle entre l’homme et les animaux, les animaux et les choses... il n’y a pas, de ce fait, de Liberté ; l’homme est matière, essentiellement matériel ; il n’y a ni bien ni mal ; le seul bien est de satisfaire ses passions, et comme la conscience n’existe pas en réalité, il n’y a pas de mal à employer pour cela tous les moyens. Au contraire, si l’homme seul possède une âme immatérielle, une conscience réelle, les ordres de cette conscience doivent être écoutés et sont le bien, les interdictions le mal. Et plus tard, le socialiste belge Collins reprend le même raisonnement, quant aux conséquences de la négation d’une conscience — psychogène — réelle, immatérielle, chez l’homme. Il prétend couper en deux, la série continue des êtres et différencier essentiellement, l’homme des animaux. Sa démonstration est la suivante. Chez l’homme où il y a sentiment d’existence, il le traduit par le Verbe. Les animaux ne développent pas le Verbe. On ne sait donc pas, — « a priori », — s’ils sentent — quoi qu’ils en aient toutes les apparences. Or, trois choses sont nécessaires et suffisantes pour développer le Verbe :
-
Un organisme à mémoire centralisée, capable de mouvements multiples ;
-
Un état de société réelle ;
-
Le sentiment d’existence.
Les animaux ne développent pas le Verbe, donc, il leur manque un des trois attributs. Lequel ? Ils ont le premier et le second. « A priori » on ne sait pas s’ils ont le troisième. Or, lorsque ces trois conditions se trouvent réunies chez un être, le Verbe naît. Donc, ils n’ont pas d’âme, pas de conscience. Le bien et le mal existent. Le bien est la direction des passions par la conscience, afin de les faire contribuer au bien-être individuel et social.
Le Dantec, dans son excellent ouvrage : « Science et Conscience », expose le mécanisme de la Conscience matérielle et nie le bien et le mal. En effet, lorsque dans l’Univers, tout est matière, force, il ne peut y avoir qu’un seul bien : être fort, et un seul mal : être faible.
Comment, dès lors, s’explique le phénomène de la Conscience, de l’Impératif de Kant. Toutes les sensations, tous les mouvements, sont transmis par le système nerveux, au centre : cerveau, sous forme de vibrations. Chaque vibration s’inscrit dans la matière cérébrale comme sur un disque de phonographe. La trace est plus ou moins marquée, selon la puissance et la durée des vibrations. Cette faculté qu’a la matière du cerveau de conserver les modifications qu’elle reçoit est la mémoire générique. Chaque sensation s’allie toujours à une modification bonne ou mauvaise, agréable ou désagréable. Quand la circonstance où s’est produite telle ou telle sensation, ou une approximative, est rappelée au cerveau, par des paroles, la vue d’un lieu ou d’un acte, un choc, etc..., mécaniquement, se réveille aussi la sensation agréable ou désagréable qui avait accompagné la première ou les premières modifications. Peu ou prou, cette tendance se transmet par hérédité. Mais le rythme créé en une matière cérébrale par diverses modifications peut être annihilé, voire même effacé, par des sensations nouvelles ; c’est pourquoi, l’éducation est capable de créer une conscience, ce qui explique, que Bien et Mal, n’aient pas la même signification pour des individus différents, et ce en suivant rigoureusement les commandements de leur conscience.
CONSCIENCE (Objection de)
La raison, quand elle est sociale, a, naturellement, cette disgrâce : de n’être subtile, à l’ordinaire, qu’afin de tromper et corrompre la raison. C’est elle qui, par les « distinguos » où se tiennent encore des hommes importants, honorables, amis sincères mais trop timides de la paix, complique jusqu’à le pervertir, jusqu’à le faire paraître subversif, alors qu’il ne signifie que le droit de tout le monde à la vie, le vœu de ceux qui sont appelés, communément, les « objecteurs de conscience ». On désigne par ces mots les hommes, trop rares encore, qui, déférant ainsi aux commandements chrétiens : « Homicide point ne seras », « Tu ne tueras point », « Aimez-vous les uns les autres », etc..., font acte des plus généreux scrupules de la conscience humaine, pour refuser ouvertement, publiquement, solennellement :
-
De faire la guerre ;
-
D’apprendre, préalablement, le métier des armes ; c’est-à-dire : de consentir le service militaire, obligatoire, aujourd’hui, dans la plupart des nations : celles-là mêmes qui se targuent de prendre la tête de la Civilisation.
En ceci comme dans la plupart des cas, il semble bien que l’homme simple approche, seul, la vérité.
Je définis l’homme simple : celui qui, non moins sain d’esprit que de corps, s’impose d’être vrai envers lui-même ; ce qui lui permet d’être, le plus aisément du monde, vrai envers autrui, envers l’univers des hommes.
Cet homme simple, lorsqu’il tente d’accomplir l’œuvre de la paix : — « le plus difficile des combats », a dit Jaurès, — ne s’adresse, pour les moyens, qu’à la paix seulement. Il dénonce et condamne, comme une cause perpétuelle de guerre, le sophisme, dont les nations font encore leur règle : « Si vis pacem, para bellum ». Il se borne à se dire, plus lucidement, plus honnêtement : « Si tu veux la paix, prépare la paix... Et ne prépare que la paix... »
On ne lui répond pas, hélas ! à cet homme simple : que la guerre est dans la nature des choses et que la Nature en est tout habitée. Il connaît, hélas ! son propre corps : ce champ de bataille où ses maîtres innombrables : les Microbes se livrent un combat de toutes les secondes ; combat nécessaire à sa bonne santé, à la durée de sa vie, à lui l’homme... Il sait encore — ô dérision ! — que sa mort immédiate serait faite de la paix que, soudain, signeraient (sic) entre eux ces maîtres impondérables.
Mais il voit, aussi, que l’homme ne se trouvait pas bien de vivre passivement dans la nature, puisqu’il n’y est pas resté. Il voit que l’homme est assez doué, assez inventif, pour secouer souvent le joug naturel. Il voit même que cet homme ne s’est réalisé dans l’esprit et dans la civilisation que par la pénible et très lente conquête qu’il a faite de lui-même sur cette nature, où le Bien et le Mal sont des « distinguos »inconnus, où, seule, la Nécessité règne, où l’Ordre oscille, éternellement, de la Vie à la Mort, solidaires l’une de l’autre...
Il est conduit ainsi à reconnaître — et cette reconnaissance, c’est tout son espoir, c’est, aussi, son salut déjà — qu’il se peut affranchir, dans une assez haute mesure, des dures lois où semblent être à jamais réduites les autres espèces que la sienne.
Il lui est possible ainsi de ne plus voir dans la guerre une fatalité irréductible.. Or, par cela même qu’il conçoit que la guerre ne lui est pas inévitable, qu’elle ne sera pas toujours : — c’est-à-dire : que les peuples auront, un jour, autant d’intérêt, de profits à vivre dans la paix qu’ils en eurent longtemps à valoir pour la guerre, — l’homme cesse de déclarer lui-même, éternellement, la guerre au monde. Dans ce monde, il apporte ainsi ce qu’il y voulait trouver : la paix. Elle existe déjà puisqu’il l’a pensée.
C’est un immense progrès, lequel est gros de bien d’autres progrès encore : que les hommes en soient arrivés à dire banalement : « La guerre ne sera pas toujours. Un jour viendra qui verra les peuples, ni meilleurs ni pires qu’aujourd’hui, vivre dans la paix, parce qu’ils auront été obligés en quelque sorte à la faire. »
Nous éprouvons ainsi que créer véritablement la paix, c’est notre œuvre, notre grand œuvre ; et que c’est un grand œuvre possible. Nous commençons à découvrir que la paix sera entre les peuples, puis entre les hommes, dans la mesure où nous l’aurons précisée, où nous l’aurons aimée, servie, voulue.
L’important, c’est, donc, d’abord, de la vouloir.
Marivaux dit quelque part (dans Le Jeu de l’Amour et du Hasard, je crois) : « Il faut être trop bon pour l’être assez ».
Je serais tenté de dire : « Il faut être trop pacifiste pour l’être assez ».
Mais, à vrai dire, est-ce être trop pacifiste que de tenir le langage de celui que j’appelle l’homme simple, et que je pourrais appeler aussi bien : l’homme vrai... Car rien n’est moins « simpliste », peut-être, que cet homme simple...
Que dit-il ?
Il dit à la société des hommes avec laquelle il a passé implicitement un contrat : « Accepte que je te prenne au sérieux plus et mieux que tu ne le fais toi-même. Je sais à quoi je m’engage en m’accommodant du bénéfice comme du maléfice de tes mœurs et de tes lois. Je m’engage à t’aider à durer, à vivre. Je te dois donc, de la vie. Je te l’apporte, dans la mesure de mes petites forces. Cela s’appelle mon travail, mon intelligence — si j’en ai. — Cela s’appelle droits et avoirs tant bien que mal accordés, équilibrés, ma sociabilité. Comprends bien que je ne suis pas un anarchiste. Sinon, il me suffirait de t’avoir dit :
« Ton ordre n’est pas le mien. Je ne dois donc rien à ton ordre... Et je ne vais pas perdre mon temps à faire valoir contre. toi les droits naturels de ma conscience, et ses scrupules... »
» Je ne suis qu’un brave homme, un homme moyen. qui, t’ayant pris au sérieux, entend te faire, non seulement le moins de mal possible, mais le plus possible de bien. Il a passé un contrat avec toi... C’est encore le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau... Je t’embarrasserais singulièrement, je crois, en te posant cette question : « Ce Contrat social, vas-tu jurer que Rousseau l’eût rédigé s’il avait pu prévoir ceci, qui n’était pas de son temps : tous les hommes valides d’un pays obligés à être soldats ; les nations armées jusqu’à n’être plus que des troupeaux militaires ?... On oublie trop, semble-t-il, que la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (la seconde comme la première dont nous faisons encore plus vanité qu’application) ne contient même pas le mot Patrie. On oublie trop aussi, que, lorsqu’il devint un mot à la mode, ce mot patriote désignait moins l’homme attaché à sa patrie que le révolutionnaire attaché à la Révolution. On disait la Patrie, comme Rousseau avait dit : l’État. Cela, pour réagir, dans le langage quotidien, contre la Monarchie et contre le Roi, lequel disait : « L’État. c’est moi... »
» Tout cela, qui n’était, dès l’abord, que phraséologie, est devenu du sentiment, des principes et, finalement, la Loi elle-même... Victor Hugo l’a bien dit : « Car le mot c’est le Verbe : et le Verbe, c’est Dieu ». Ce que les braves gens traduisent vulgairement en disant : « Les paroles restent »... Mais je ne veux pas t’embarrasser, chère Société. Je veux seulement, te prenant plus au sérieux que tu ne le fais toi-même, te servir, en t’apportant ce qui, seul, te peut vraiment servir, ce que je me suis engagé seulement à te dévouer, en signant implicitement le contrat qui nous lie : La Vie.
» Que m’apprends-tu toi-même, Société ? Que le crime le plus grand, pour un homme, c’est d’être homicide ; que je ne dois pas tuer... Tu me fais même un devoir de la liberté, de l’égalité et de la fraternité ; ce qui tient tout entier dans cette formule évangélique : « Aimez-vous les uns les autres ».
» Je réponds : « De tout mon cœur, de toute ma raison... De tout mon espoir comme de tout mon désir... »
» Mais — chose singulière, et qui nous ferait désespérer de la raison comme de toi ! — a peine t’ai-je donné mon assentiment aussi plein que sincère, j’ai cette stupeur : que ce soit toi qui devienne réticente, chicanière, évasive ; que ce soit toi qui ratiocines comme un rabbin juif ou comme un Père de l’Église byzantine... Ce qui n’est pas peu dire.
» Que me dis-tu ? Ceci : Homicide point ne seras... Il est, pourtant, des cas où...
» Tu ne tueras point... A moins, pourtant, que...
» Aimez-vous les uns les, autres... Mais, tant que la guerre sera possible, il vous sera, non seulement obligatoire, mes enfants, mais glorieux de faire de la guerre... Et, pour commencer à vous aimer les uns les autres, apprenez, les uns et les autres, à vous bien tuer. Et, pour cela, soyez tous des soldats. »
« Voire ! »
L’homme simple se demande :
« Qui trompe-t-on ici ?... Ce n’est pas moi, d’ailleurs, que l’on trompe. Car je me faisais, par mes propos, plus candide, plus bête, que je ne le suis en réalité... Je vois plutôt que c’est la société avec laquelle j’ai implicitement passé un contrat qui se trompe elle-même. Je voulais par elle la vie, — rien que la vie. Elle est assez malheureuse, assez démente, assez aveugle encore, pour exiger seulement de moi que je l’aide à s’assassiner elle-même »...
Mais l’homme simple se doit, pour faire honneur à sa simplicité, d’être un honnête homme : ce que j’appellerai « un honnête homme quotidien », aussi quotidien que la vie elle-même.
Qu’il ait raison dans l’absolu, ou mieux : dans la vérité, voilà qui ne sera contesté par aucun de ses contradicteurs. Et, d’un certain point de vue anarchiste (qui n’est pas, d’ailleurs, tout le point de vue anarchiste), cela pourrait suffire à me dispenser d’en dire plus long.
Mais l’homme simple s’entend répondre, à bon escient d’ailleurs, à bon droit même :
« On ne vit pas dans l’absolu. Et, vous, pas plus que personne... On n’a donc pas raison par l’absolu »...
L’homme simple se fait honneur — je dirai surtout : honnêteté — de n’avoir pas raison par l’absolu, et de déchoir fraternellement des belles cimes où il eut pu continuer de causer familièrement avec cet absolu.
Quelque admiration qu’il professe pour eux — et cette admiration est grande et vive — il ne prétextera donc pas l’exemple des « objecteurs de conscience » qui l’ont précédé, et dont la sagesse hardie et, pourtant, toute normale, l’inspire.
Ils sont trop, d’ailleurs... A ne commencer que par les premiers chrétiens, lesquels ne refusaient pas toujours seulement le service militaire, mais l’impôt (plusieurs d’entre eux ne sont encore des Saints, sur notre calendrier, que parce qu’ils ont refusé les deux)...
L’homme simple oubliera, donc, entre tant, ce patron des Gaules : Saint-Martin de Tours, lequel proclamait, en 380 après Jésus-Christ :
« Soldat du Christ, je ne combats pas avec l’épée ».
Il ne fera pas argument, quel que soit l’amour qu’il leur voue, des exemples des Quakers, de celui, plus révolutionnaire dans ses affirmations, des Doukhobors, disciples de Tolstoï.. Il pourrait remplir de leur martyrologe plusieurs pages de cette Encyclopédie... Mais il ne ferait ainsi que répéter ce qui sera dit de ces véritables chrétiens, et mieux : de ces véritables civilisés, les seuls vraiment exemplaires, quand on écrira d’eux spécialement dans cette même Encyclopédie...
Quittant les exemples, les précédents sublimes, l’homme simple ne paraphrasera même cet aveu, dépouillé d’artifice autant que rempli de sagesse, du très, du tout lucide Ernest Renan :
« Je n’aurais pu être soldat. J’aurais déserté. »
Il ira même jusqu’à oublier que jusqu’au jour qui vit, après la France et la Prusse, les plus importantes nations décréter le service militaire obligatoire, c’est-à-dire : jusqu’en 1872 environ, les neuf dixièmes des hommes qui composent le plus sûr et le plus vif honneur des sciences, des lettres, des arts et des morales, ont été exonérés de l’obligation militaire.
Ceci nous fait comprendre, d’ailleurs, que, n’étant pas inquiétés par l’armée, dans leur liberté et dans leur égoïsme, ils ne nous aient pas précédés dans l’honneur de résoudre le problème posé par l’objection de conscience ; ou qu’ils n’y aient fait que de philosophiques allusions... Aussi bien est-il remarquable que, dans les Congrès de la Paix, où les objecteurs de conscience tendent de faire prévaloir leur « pacifisme intégral », les honnêtes hommes qu’ils voient se dresser contre eux soient, à quelques exceptions près, des vieillards ou des adultes exonérés, pour un motif quelconque, de la servitude militaire. Le signataire de ces lignes tient à préciser que, frisant la cinquante-deuxième année de son âge, il ne relève plus de l’armée.
L’homme simple, s’il ne fait pas table rase du passé, lequel ne lui mesurerait, d’ailleurs, pas les arguments émouvants, s’impose de ne rien lui demander.
Il se tourne seulement vers la société avec laquelle, implicitement, il a passé contrat, et il lui dit :
« Je crois t’avoir compris. Tu veux la paix, mais, en la préparant, surtout par les moyens qui sont ceux de la guerre... Tu la veux comme la veut, par exemple, M. Raymond Poincaré, qui t’a fait tant de mal ; comme la veulent ses pairs : « Dans l’Honneur, dans le Droit et dans la Force... » Je pourrais te répondre par un langage plus sobre, qui est, tout sainement, celui de la vérité, sans doute : « Il ne faut pas vouloir, si toutefois, on le veut vraiment, la Paix dans l’Honneur, le Droit et la Force... Ce qu’il faut vouloir, c’est l’Honneur, le Droit et la Force dans la Paix... » Mais passons...
» Je me borne à te demander ceci :
» La guerre des peuples est bien, n’est-ce pas ? devant ton jugement même, le plus grand des crimes ? Tu me réponds : « C’est le plus grand de tous. Nous devons travailler à tuer la guerre, et, d’abord, à la déshonorer. » C’est ici un langage devenu ordinaire, et que nous tiennent même ceux qui sont les préparateurs les plus sûrs de cette guerre qu’ils condamnent.
» Je continue : « Un crime, le plus grand des crimes : c’est entendu ? Mais le propre de l’homme n’est pas, hélas ! d’être bon. Et sa vitalité même s’accommode souvent des plus grands crimes... La guerre est odieuse. Mais c’est peut-être une sélection nécessaire, laquelle permet au plus fort de durer malgré le pullulement du plus faible ?... Et puis, la guerre ne développe-t-elle les valeurs morales, ne les fait-elle pas paraître incomparablement ?... » Voilà, seulement vingt ans, tu m’aurais répondu, chère Société : « Oui, la guerre est odieuse. Mais elle est cette sélection. Elle est ce prétexte à la mise en valeur des vertus morales ». Et nous en eussions discuté... Il n’en est plus besoin désormais. Ce sont tes augures les mieux famés, tes oracles les plus célèbres parfois, eux-mêmes, qui, instruits par la dernière guerre : celle qui fit douze millions de cadavres, sont les premiers à nous dire :
« Sans doute, la guerre est bien une sélection. Mais c’est, peut-on dire, une sélection à rebours. Nous ne le voyons que trop, hélas ! ceux qu’elle nous a pris, c’étaient les plus jeunes, les plus forts, les plus hardis ; les plus généreux aussi, bien souvent. Ceux qu’elle nous a laissés, ce sont, à l’ordinaire, les autres, tout le reste des autres... Quant à l’affirmation des valeurs morales ?... Bornons-nous à constater l’endurance, qui fut, en effet, extraordinaire... Mais, prudemment et dignement, taisons-nous du reste... La guerre, il semble bien qu’elle ait trouvé désormais son symbole dans ceci : la Boue... L’Arioste, apprenant la naissance de l’artillerie à la bataille de Crécy, s’écriait : « La guerre s’est déshonorée. » Que ne dirait-il pas aujourd’hui ?...
» Je m’obstine pourtant, étant homme simple, a continuer, et je te dis, chère Société : « Entendu pour le plus grand des crimes. Entendu pour la sélection à rebours. Entendu, malgré tant d’émouvants sacrifices, pour l’impuissance de la guerre à faire, désormais, éclater les hautes valeurs morales... A se montrer ce que le sage et pacifique Montaigne voyait en elle : « L’action la plus pompeuse des hommes... » Mais il est fréquent — je n’ose dire : ordinaire — que le crime profite à celui, a ceux qui l’ont commis. La guerre peut être, à tout le moins, une bonne affaire.
» Autrefois, chère Société, tu m’aurais certainement répondu : « Ce grand crime est, finalement, pour le vainqueur, une bonne affaire. On a voulu les moyens. On a la fin. Amen ! Et la justice n’est pas de ce monde ».
» Que me répondent aujourd’hui tes augures, tes oracles les plus illustres eux-mêmes ? Ceci : « La dernière guerre a fait paraître implacablement à tous ce que nous savions déjà, sans oser le dire : Que, voilà bientôt cent ans que la guerre — une bonne affaire tant que les civilisations furent éminemment agricoles — ne paie pas... Qu’elle fait des vainqueurs aussi dépourvus, aussi ruinés, aussi exsangues, finalement, que les vaincus... Quand ils ne le sont pas davantage... » « Toute paix est bonne ; toute guerre est mauvaise », avait dit l’honnête Franklin.
En 1877, le malhonnête Bismarck pouvait, sans crainte d’être démenti, déclarer devant le Reichstag :
« La France s’est relevée plus vite de sa défaite que nous de notre victoire... » Avertissements inestimables, puisqu’ils furent si peu entendus ! Le noble Norman Angell nous prouvait péremptoirement, en 1909, par son beau livre : La Grande Illusion, que cette grande illusion, c’est ce que les hommes s’obstinent encore à appeler la Victoire, et que la guerre ne peut être, dorénavant, que la plus désastreuse des affaires... Cela, quelle qu’en soit l’issue !... La raison d’un tel changement, on voudrait, pour l’honneur des hommes, de l’intelligence et de l’amour, qu’elle fût morale. Elle n’est fille — si je puis ainsi dire — que du Machinisme.
» Comme l’a lumineusement montré Francis Delaisi par son grand livre nécessaire, et qui devrait être dans toutes les bibliothèques : Les contradictionts du monde moderne, leur économie, leur consommation, leurs finances, leurs industries, les moyens si nombreux, si divers et rapides qu’elles ont de communiquer entre elles, la complexité, le mystère surtout, des affaires qu’elles ont en commun, font que, aucune nation ne pouvant vivre aujourd’hui, d’une vie proprement nationale, toutes les nations sont impérieusement, étroitement solidaires les unes des autres. Leur ordre et leur vie elle-même sont faites de leur interdépendance.
» C’est même cette interdépendance qui, obligeant les nations à se réconcilier, si elles veulent continuer de vivre, finira pas fonder les États-Unis de l’Europe. Et les États-Unis de la Terre, plus tard... C’est elle qui si vis pacem para pacemaccomplit, péniblement, lentement, mais, sûrement, dans le temps, la grande œuvre de la paix.
» Or, quelle qu’en soit l’issue, quels qu’en soient les vainqueurs, la guerre, qui rompt cette interdépendance, qui détruit cet ordre, est, non seulement une faute monstrueuse, un crime inexpiable, mais une défaite irrémédiable : cela, non seulement pour les belligérants, mais pour le monde entier... A méconnaître une fois encore cela, à s’en remettre une fois de plus à la guerre du soin de régler ses différends, l’Europe courrait le risque de disparaître tout entière... Une nouvelle guerre, et qui, nécessairement, paraît, par comparaison, paraître la dernière : — celle qui devait être la dernière — comme un jeu d’enfants : c’en serait fini de la civilisation européenne, et de l’Europe elle-même... »
« Merci des renseignements », dit l’homme simple.
Alors, n’ayant que trop interrogé déjà sa « chère Société », et s’estimant suffisamment instruit, il conclut :
« Je tiens de toi, chère Société, ma Mère, que, non seulement rien ne nous justifierait désormais de faire la guerre, mais que tout s’accorde pour nous la rendre odieuse et méprisable, pour nous en décourager, et mieux : pour nous en dégoûter. Je tiens de toi qu’elle est le crime le plus efficace que tu puisses commettre sur toi-même.
» Accepte que je t’aime assez, chère Société, ma Mère, pour n’être pas ton complice... Accepte que je tâche à te sauver, et, d’abord, à te sauver malgré lui. Trouverais-tu bien que, tenant de la nature une mère alcoolique ou, friande de stupéfiants, j’eusse ce sadisme de lui fournir l’alcool ou les poisons qui la doivent tuer, inévitablement, un jour ou l’autre ?
» Ne me dis pas, croyant être sage : « Comparaison n’est pas raison ». Cette fois-ci, comparaison est tout à fait raison... Ce qui est bon pour la santé d’un seul homme vaut, ici, pour la santé de tous les hommes.. La meilleure façon de tuer un dieu, ce fut toujours de ne pas le prier. La meilleure façon de désapprendre la guerre aux peuples, c’est encore que l’individu n’apprenne pas lui-même à la faire.
» Que, dévoué à ta conservation, chère Société, ma Mère, c’est-à-dire à la paix préparée par la paix seulement, l’individu commence par n’être pas un soldat. C’est une chance de moins qu’il aura d’être un guerrier... A toi, donc, tout mon travail, ma Mère, tout mon zèle, toute mon intelligence, tout ce qui peut faire prospérer en toi et la vie et l’esprit. Je ne me refuse qu’à ceci : te faire boire, vieille alcoolique ; t’empoisonner un peu plus, vieille stupéfiée... Bref, à parfaire ton assassinat, vieille ennemie de toi-même. »
* * *
Tels furent les arguments de bon sens, de bon sens seulement, dont j’essayais de nourrir le discours que je prononçai, à la Sorbonne, dans l’amphithéâtre Richelieu, le jour de septembre 1925, où le Congrès International de la Paix y discuta de l’objection de conscience. J’y étais le porte-parole de la Ligue pour la reconnaissance légale de l’Objection de conscience, laquelle m’avait commis à l’honneur de parler en son nom.
Le matin, la Commission du Désarmement avait adopté, par 15 voix contre 3 (sur 18 votants), un ordre du jour demandant la suppression des armées permanentes et du service militaire obligatoire. Cet ordre du jour, reconnaissant le droit de tout homme à refuser du tuer son semblable et, partant, d’apprendre le métier des armes, demandait que, en attendant qu’eût lieu une suppression souhaitée par tous les pacifistes et par le plus grand nombre des hommes civilisés, les réfractaires, qui prétextent les scrupules de leur conscience, fussent exonérés de toute peine et, même, de toutes poursuites.
Malgré une assez vive opposition, et quelques manœuvres bizarres, je parvins à faire devant le Congrès, le rapport auquel j’avais été commis.
Mon argumentation pouvait tenir toute dans ces phrases essentielles du discours : « A moins qu’il ne soit qu’un nouveau sophisme, le droit des peuples à disposer des peuples — droit dont toutes les nations font présentement, état — implique le droit à disposer de lui-même de l’individu. Certes, l’œuvre de la paix, c’est, par-dessus toute, l’œuvre des collectivités ; et je tiens, avec mes adversaires, que les économistes y peuvent réussir plus vite, sinon mieux, que les moralistes ? Mais l’œuvre des collectivités ne dispense pas l’individu d’accomplir, dans la mesure de son énergie, de son zèle et de sa responsabilité, son œuvre personnelle de paix. Les pacifistes individuels ont précédé, dans le pacifisme, la Société des Nations, qui est encore beaucoup moins celle des peuples que celle de leurs gouvernements. Les pacifistes sincères et vrais se doivent encore de ne pas se traîner à la remorque de cette Société, mais de continuer à la devancer. Aussi bien, plus nombreux, plus conscients et plus résolus individuellement seront les pacifistes, plus sera aisée et plus efficace la tâche de la Société des Nations. Désapprendre la haine, désapprendre la guerre : cela, c’est plus directement l’oeuvre de l’individu que celle de la collectivité. C’est dans la famille d’abord, et par les soins maternels, que doit commencer la propagande qui, faisant éclater l’ignominie et l’absurdité de la guerre, 1a déshonorera. Ce qu’une collectivité ne peut aisément enseigner — ceci, par exemple : qu’il n’y a pas de 1âcheté contre la guerre, et que le seul véritable courage est celui qui sert, veut, fait et maintient la paix, — il est au pouvoir de tout homme bénévole de le répandre, de l’accréditer dans les cœurs et dans les esprits... Apprendre aux peuples à résigner, d’abord, à réprouver ensuite, tous les héroïsmes attachés à la guerre ; bref, leur apprendre la science, l’art et la philosophie de la paix : c’est autant à l’individu humain qu’à la collectivité des hommes, qu’un tel honneur incombe ; et, plus que celle-ci, celui-là, présentement, s’y montre apte.
Or, quel enseignement de la paix surpasse en sincérité, en simplicité éloquente, celui que donne le premier venu des hommes qui, doucement, purement, sans provocation, sans révolte même, publie :
« Je ne tuerai point. Je ne serai point un guerrier. Je ne ferai point un soldat. »
Ni désertion... Et moins encore cet « art de se débrouiller », ce « système D », que s’entendent si bien à pratiquer, tant de nos meilleurs patriotes, de nos plus fiers militaristes...
Dans la pleine raison de son âge, dans la pleine conscience de son devoir humain, un homme proclame son droit, qui est bien, en ceci, le plus pur comme le plus sacré des droits.
Rien de plus. Rien de moins.
On eût mal compris, voilà seulement soixante ans, qu’un homme, seul, prît devant ses compatriotes, cette attitude et cette responsabilité. On peut soutenir que celui-là qui répugnait vraiment au métier des armes, à être un soldat, voire un guerrier, se quittait assez facilement d’un service, d’une servitude qu’il détestait.
Aujourd’hui, c’est un fait, humiliant, mais certain : que, dans certains pays, tout homme valide fait un soldat.
On ne dit pas assez que ce qui est appelé le Militarisme est né véritablement avec le service militaire obligatoire, et qu’il est ainsi, en quelque sorte, l’œuvre de la Révolution Française levant, pour sa juste défense, une armée de 1.200.000 volontaires.
Trop heureuses de l’aubaine — si je puis ainsi dire — la Prusse, puis d’autres nations, ont suivi un exemple qui leur assurait une « chair à canon » non plus vénale, non plus vendue, celle-ci, mais trop sincère, parfois...
Les armées de métier étaient, sur l’état militaire où l’Europe a fini par se réduire et, intellectuellement, s’avilir, un progrès en ceci : que la masse laborieuse, pensante, profonde, n’était pas infectée du militarisme, de l’esprit de guerre.
Il serait facile de prouver qu’un serf du Moyen-Age, non obligé à se faire tuer pour des biens qui n’étaient pas les siens et des honneurs dont il n’avait cure, était finalement plus indépendant et plus libre que l’électeur, — c’est-à-dire le peuple souverain — français du XXè siècle...
D’ailleurs, ce qui sera écrit, dans cette Encyclopédie, sous la rubrique Militarisme, montrera suffisamment que le service militaire obligatoire est le plus grand crime que l’humanité ait commis contre elle-même...
Ce n’est pas manquer du respect fait d’amour dû au grand Jaurès, de professer qu’il s’est trompé en préconisant l’Armée Nouvelle ; ce qui revient à dire : la Nation armée.
Mais, instruit par les terribles leçons de la dernière guerre, la préconiserait-il encore ? Ses imitateurs, qui le singent plus qu’ils ne l’exaucent d’ailleurs, disent : « Oui ». Mais le génie leur manque, qui eut, peut-être, conduit Jaurès à changer en ceci d’action comme d’idéal...
Le monde sent, obscurément encore certes, mais il sent que si de toutes ses forces, aussi bien individuelles que collectives, il ne se soulève pas contre la guerre, et, d’abord, contre l’école nationale de la guerre, c’est-à-dire le service militaire obligatoire, toute la civilisation risque de n’être, finalement, qu’un magnifique sacrifice fait, par les plus sublimes inventions de l’homme, à Moloch dévorant.
L’objecteur de conscience ne fait qu’annoncer, par son calme refus raisonné, la révolte cordiale où tous les hommes devront bientôt s’unir s’ils veulent, enfin, exercer leur droit à la paix, qui n’est que leur droit à la vie.
Voilà, dans sa substance, le long propos que je tins, à Paris, au Congrès International de la Paix, en 1925.
J’aurai l’immodestie de le dire moi-même — mais la vérité m’y oblige — l’accueil fait à ce discours par des délégués de toutes nations me surprit, tant la chaleur en était vive. Le président du Congrès en excipa pour dire que, étant donné l’enthousiasme qui montrait que « tout le monde avait compris », ce discours ne serait pas traduit... « Innovation » contraire à l’usage, et qui souleva des protestations autres que les miennes...
Le vénérable M. Ferdinand Buisson, président de la Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen, me répondit.
J’eus cette surprise qu’il ne vît, dans ma louange du droit de tout homme à ne pas tuer, à ne pas apprendre l’art de tuer, qu’une exaltation du droit de l’individu à nefaire que ce qui lui plaît. Certes, il rendait « justice à ma générosité », et, le droit que j’invoquais, il l’admettait lui-même... Mais seulement pour une élite, et pour des raisons, dont on peut dire qu’elles ne brillaient pas leur nombre...
Bref, il demandait au Congrès de Paris de repousser un ordre du jour qui, plus catégorique, avait été pourtant adopté, en 1924, par le Congrès de Berlin.
Contrairement à l’usage, je ne fus pas admis à répondre. J’en eusse profité pour appuyer ma dialectique d’un projet prévoyant, pour les objecteurs de conscience, la création d’un service national civil. Je n’en étais pas personnellement partisan. J’avais accepté, pourtant, de le rapporter pour déférer au vœu de la Ligue pour l’objection de conscience. Je fus gardé de faire ce rapport par la partialité, un peu trop visible, du bureau du Congrès..
On vota dans une assez grande émotion. Le premier vote donna la majorité à l’ordre du jour que j’avais défendu.
Le résultat de ce vote ayant été contesté, j’acceptai que l’on procédât à une seconde consultation... Déjà, des congressistes, tenant le premier vote pour acquis, s’en étaient allés.
Le second scrutin donna lieu à ce que l’on appelle une « cuisine de congrès ». Des maîtres-queux y brillèrent.. On découvrit alors qu’il y avait des cartes vertes, ou blanches, qui donnaient droit « à tant ou tant de voix ».
Le second résultat fut celui-ci : 193 voix pour la motion Buisson ; 144 voix à la motion Pioch.
C’était, à tout le moins, pour les Objecteurs de conscience, une victoire morale...
Celle-ci, remportée, et pour la première fois, en France, pays à service militaire obligatoire...
Quelques jours après. Romain Rolland m’écrivait :
Vous avez eu raison de lutter pour l’objection de conscience. Continuez, mon vieil ami. L’objection de conscience, c’est notre fest burg.
On continue.
Georges PIOCH
CONSCRIPTION
n. f.
Inscription sur les rôles militaires des jeunes gens devant être appelés dans l’année à servir dans l’armée de leur pays. Selon l’âge déterminé par la loi, à la date indiquée, ces jeunes hommes doivent, dans les pays où la conscription est obligatoire, se présenter devant un conseil qui délibère sur leurs capacités physiques et décident s’ils sont propres ou impropres à remplir leurs « devoirs militaires ». A la sortie de ce conseil, les jeunes gens changent de nom et s’appellent des conscrits. Le mot conscription ne date que de 1798, mais l’institution est fort ancienne. En France, la conscription ne fut pas toujours obligatoire, et ce n’est qu’à la suite des guerres napoléoniennes que, par la loi du 10 mars 1818, on institua le service militaire obligatoire sur les bases du tirage au sort. Ce mode de recrutement fut abrogé il y a quelques années et en principe chacun est aujourd’hui obligé, en France, de remplir ses « devoirs militaires ». Il est encore certains pays où la conscription est volontaire L’Angleterre et les Etats-Unis d’Amérique, par exemple, n’obligent personne à être soldat. Ce qui ne les empêche du reste pas d’avoir des armées permanentes et puissantes.
La conscription est une contrainte, et il est par conséquent compréhensible que dans les pays où elle est obligatoire, il se crée des groupes qui militent en faveur de la conscription volontaire. Ces groupes, animés de nobles sentiments, il faut le reconnaître, s’imaginent ainsi lutter contre le militarisme. Nous pensons que c’est une erreur, et que la conscription volontaire n’est pas un avantage social sur la conscription obligatoire. Il suffirait, pour s’en rendre compte, de jeter un regard dans le passé et de considérer que, durant des siècles, la guerre a ravagé le monde et que la conscription cependant était volontaire. L’erreur des personnes qui militent en faveur de la conscription volontaire consiste en ce fait qu’elles confondent les effets et les causes. La conscription volontaire ou obligatoire est un effet dont la cause est le militarisme. C’est ce dernier qu’il faut détruire.
D’autre part, même dans les pays à conscription volontaire, lorsque les événements l’exigent, le capital s’arrange toujours pour trouver le nombre d’hommes qui lui est indispensable, et nous en avons eu un exemple frappant lors de la dernière guerre de 1914. L’armée anglaise n’était composée que de volontaires et, la guerre se poursuivant, il fallait continuer à donner au Moloch, sa ration quotidienne de jeunes hommes sains et vigoureux. Or, il ne s’en présentait plus aux bureaux de recrutement du Gouvernement anglais. Il fallait aviser et l’on avisa. Il fut interdit, par ordre des autorités militaires, d’embaucher dans les usines, des hommes ayant moins de 25 ans et, si cet ordre ne fut jamais donné officiellement, il fut néanmoins appliqué avec rigueur par les patrons qui avaient tout intérêt à ce que la boucherie se prolongeât. Lorsque les hommes sans travail, dans l’impossibilité de nourrir leur famille, étaient acculés à la misère la plus noire, ils avaient cette dernière ressource : se rendre au bureau de recrutement le plus proche, et signer le bulletin d’engagement qui assurait à leur femme et à leurs enfants la bouchée de pain. Par la suite, lorsque bon nombre d’engagements furent ainsi récoltés, l’Angleterre se divisa en deux camps : les engagés « volontaires » (les soldats) et ceux qui persistaient à ne pas vouloir servir. A la faveur de la division, et appuyé par les premiers, le Gouvernement anglais institua pendant la guerre la conscription obligatoire. Nous, voyons donc que la conscription volontaire est un leurre, et qu’il ne faut pas se laisser aveugler par ce mirage. Certes, tout ce qui peut ébranler les bases du régime capitaliste a son utilité et aucune lutte n’est stérile. Gardons-nous, cependant, de nous laisser illusionner. Par la force même des événements, tous les pays arriveront à abolir le service obligatoire et à instaurer le volontariat. Le capital trouvera encore assez d’hommes qui, sans y être obligés, se présenteront pour remplir les fonctions de soldat ; il n’y a, pour s’en assurer, qu’à regarder autour de soi : personne n’est obligé d’être policier, et cependant les rues sont noires d’agents. Le volontariat n’est plus un danger pour la bourgeoisie, et c’est pourquoi il nous faut regarder plus avant et mener une bataille acharnée contre le militarisme, qui renferme en lui la conscription volontaire et la conscription obligatoire qui, en vérité, sont aussi néfastes l’une que l’autre.
CONSEIL
n. m.
Réunion de personnes qui ont généralement charge d’appliquer les décisions d’assemblées plus étendues qui les ont désignées pour administrer, sous le contrôle de ces assemblées, les biens sociaux, s’occuper des intérêts communs aux membres d’un même groupement, d’une même société, dont le but est nettement défini par des statuts. Les Conseils sont l’expression et l’émanation des Assemblées générales. Ils sont généralement élus à la majorité, et responsables de leur gestion devant leurs mandataires, au nom desquels ils agissent.
Dans l’ordre politique, militaire et judiciaire, les Conseils sont, le plus souvent, composés de personnalités désignées par décret du pouvoir exécutif.
Il y a plusieurs sortes de Conseils :
-
Dans l’ordre économique et social. ― Le Conseil d’administration, Société industrielle ou commerciale, Syndicat patronal ou ouvrier, le Conseil d’Usine, le Conseil national économique, le Conseil national de la main-d’œuvre ;
-
Dans l’ordre politique. ― Le Conseil municipal, le Conseil général, le Conseil d’arrondissement, le Conseil de Préfecture, le Conseil des Ministres, le Conseil supérieur de la Défense nationale, le Conseil d’État ;
-
Dans le domaine militaire. ― Le Conseil de révision, le Conseil de discipline, le Conseil de guerre, le Conseil supérieur de la guerre ;
-
Dans le domaine judiciaire. ― Le Conseil de famille, le Conseil des Prud’hommes, le Conseil supérieur de la magistrature, Conseil judiciaire ;
-
Dans l’Instruction publique. ― Le Conseil académique, le Conseil départemental, le Conseil supérieur de l’Instruction publique ;
-
Dans le domaine scientifique. ― Le Conseil international des recherches scientifiques ;
-
Dans l’ordre religieux. ― Le Conseil de fabrique ou presbytéral.
Il y en a sans doute d’autres encore qui ne me viennent pas présentement à l’esprit.
Reprenons, maintenant, chacun de ces Conseils.
1. ORDRE ÉCONOMIQUE
Conseil d’administration. ― Ce genre de Conseil n’est pas particulier à une œuvre, à un organisme constitué par l’une des classes sociales. Les patrons, comme les ouvriers ont leurs Conseils d’administration pour gérer leurs entreprises, leurs groupements de tous ordres. Issu de l’Assemblée générale des actionnaires ou des syndiqués, le Conseil d’administration, dont la composition numérique est variable, a charge, comme son nom l’indique, d’administrer la chose commune qui ne peut être gérée directement par tous. Dans l’ordre capitaliste, le Conseil d’administration, généralement composé des personnalités les plus marquantes, est la véritable puissance de cette société. La valeur d’une entreprise est presque toujours subordonnée à l’influence, au renom, à la richesse des membres du Conseil d’administration et, principalement, du Président de ce Conseil. C’est d’ailleurs lui qui est responsable devant la loi. La plupart des membres du Conseil d’administration d’une société sont également membres des Conseils d’administration d’entreprises similaires, alliées, ou de caractère différent. Responsable de la gestion de l’Entreprise, les conseillers jouissent aussi des privilèges que comporte la direction de l’affaire, de la Société, de l’Établissement, de l’exploitation. Ils en sont, en fait, les seuls maîtres et les Assemblées générales ne font, généralement, qu’entériner les décisions qu’ils ont prises, tant pour la gestion que pour l’administration.
Il est facilement concevable que les membres des Conseils d’administration des grandes affaires commerciales, industrielles, bancaires, etc..., acquièrent, de par leurs fonctions, autorité et puissance.
Cette autorité et cette puissance sont d’autant plus grandes que l’affaire est plus importante, que le conseiller est membre d’un plus grand nombre de conseils. C’est ainsi que sont nés les potentats de la finance des houillères, des peaux, des tissus, du papier, des mines, du blé, du sucre, du café, de la sidérurgie, des transports par eau et par fer, des pétroles, etc., qui, aujourd’hui, possèdent, à quelques-uns, toute la richesse réelle d’un pays.
Les Conseils d’administrations capitalistes sont en fait les vrais maîtres du jour. Ce sont ceux qui commandent aux gouvernants dont le rôle consiste à appliquer, dans l’ordre politique, les mesures arrêtées dans l’ordre économique et social par les Conseils d’administrations capitalistes. Dans ces conditions, on conçoit aisément que le Conseil des Ministres ne soit que l’appareil d’enregistrement et d’exécution des Conseils d’administration qui le dominent, ainsi que le Parlement, de toute leur puissance dorée. Nous savons comment s’organisent nationalement et internationalement les Sociétés d’exploitation bourgeoise. Nous savons, par l’étude des Cartels, comment fonctionnent et agissent ces appareils d’asservissement. Inutile d’y revenir. Il nous reste a examiner ce que sont les Conseils d’administration des Syndicats, à en exposer le fonctionnement et le rôle.
Institués, comme les Syndicats, par la loi de 1884, les Conseils syndicaux sont responsables, en face du pouvoir, de la marche, de l’attitude générale du Syndicat. Le bureau du Syndicat est tenu de fournir aux Pouvoirs publics, le nom et l’adresse des administrateurs syndicaux. Il doit également notifier à ces mêmes pouvoirs toutes les modifications survenant dans la composition du Conseil syndical. Toutes ces formalités sont d’ailleurs plus ou moins observées, plutôt moins que plus. Le Conseil d’administration est nommé, pour un temps déterminé par l’Assemblée générale des syndiqués. Il est renouvelable ou non, à l’expiration de son mandat, selon les stipulations statutaires. C’est lui qui a charge d appliquer les décisions prises par les Assemblées générales. S’il y a une situation générale grave, inquiétante, il lui appartient de provoquer une Assemblée générale pour examiner cette situation et prendre les mesures qui y correspondent. Le Conseil d’administration applique mais il ne décide pas. Du moins, il devrait en être ainsi si on veut que la décision reste toujours placée entre les mains de tous les syndiqués. Il se peut pourtant que, devant une situation exceptionnellement grave, qui ne souffre aucun répit, le Conseil soit appelé à agir par lui-même. Il ne doit le faire que dans le cadre ou le prolongement des décisions déjà prises et se faire approuver dès que possible. Le Conseil est le pouvoir exécutif des syndicats, les assemblées générales, le pouvoir d’exécution et les comités, le pouvoir de contrôle. Ce sont les caractéristiques essentielles du mouvement syndical. Il est indispensable, pour que l’appareil syndical fonctionne à plein rendement, qu’il y ait délimitation très nette des rôles et attributions de ces organismes et que chacun remplisse bien sa mission. Sans quoi, c’est la paralysie, le chevauchement, le conflit d’attributions, le règne de quelques-uns sur l’ensemble rendu possible. C’est ce qui arrive, hélas ! de nos jours, dans l’ensemble du mouvement syndical de tous les pays. Les Assemblées générales ne décident plus, les Comités ne contrôlent pas et les Conseils, voire les Bureaux, agissent à leur guise.
Il ne faut pas chercher ailleurs les causes de la crise syndicale actuelle.
L’ensemble des Conseils syndicaux d’une localité forment par voie de délégation, le Conseil de l’Union locale des syndicats, de l’Union départementale ou régionale. Les Conseils syndicaux industriels forment de la même manière, les Conseils fédéraux d’industrie. Ceux-ci et les Conseils départementaux désignent les administrateurs confédéraux. Ainsi s’édifie et se constitue, en face de l’appareil bourgeois, l’appareil ouvrier qui aura charge de remplacer son adversaire lorsque celui-ci sera terrassé. Il y a aussi, maintenant, les Conseils d’usine, dont nous exposerons longuement le caractère au cours de l’étude sur le Contrôle ouvrier dont les Conseils d’usine sont les agents d’exécution.
Ici, je me contenterai d’indiquer que les Conseils d’usine doivent être les sentinelles avancées du syndicat dans l’usine, la force grandissante et organisée qui fera chaque jour reculer un peu plus la puissance patronale.
Il y a encore le Conseil économique national, qui est d’invention confédérale et de réalisation gouvernementale. C’est au Congrès confédéral de Lyon, en 1919, que la C.G.T. décida de former un Conseil économique du Travail. Ce Conseil avait charge de préparer les voies a l’action confédérale, d’étudier les grands problèmes économiques et d’indiquer des solutions pour chacun d’eux.
On attendait beaucoup de ce Conseil dans le monde du travail. Il déçut bien des espoirs et finit lamentablement une existence courte et sans gloire.
Il ne renaquit qu’en 1925, sous le ministère Painlevé. Mais cette fois-ci, ce n’était plus une création ouvrière où ne siégeaient que des ouvriers ou des sociologues et techniciens d’avant-garde, mais au contraire une sorte d’aréopage composé de capitalistes haut cotés et de représentants ouvriers ayant oublié la nécessité de la lutte de classe. La collaboration des classes, cette panacée de la C.G.T., avait réalisé ce tour de force et rendu possible cette création hybride qui avait pour mission, flanquée d’un nombre imposant de Comités plus ou moins techniques, d’étudier les grands problèmes économiques et de soumettre au gouvernement des solutions à ces problèmes. Il n’y a rien à attendre d’un tel organisme. Ou il sera totalement impuissant, et disparaîtra de lui-même ou, au contraire, il agira, et ce sera à l’encontre des intérêts ouvriers qu’il confond avec ceux du patronat. Le Conseil syndical on le voit, est une institution importante dont il était bon d envisager le rôle et le fonctionnement. Il peut rendre des services éminents ou devenir un appareil d’oppression. La clairvoyance, l’intelligence, la compréhension, l’énergie de la classe ouvrière en feront ceci ou cela.
2. L’ORDRE POLITIQUE
a) Le Conseil municipal. ― Le Conseil municipal a charge d’administrer la commune. Il est élu au suffrage universel. Sont éligibles tous les hommes âgés de 25 ans accomplis. Pour être éligible, il faut :
-
être en possession du droit électoral ;
-
n’avoir pas de casier judiciaire ;
-
n’être pas dispensé de subvenir aux charges communales ;
-
n’être pas domestique exclusivement attaché aux personnes.
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leur fonctions : les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture, les commissaires et agents de police, les magistrats de Cour d’appel et des tribunaux de première instance, à l’exception des suppléants auxquels l’instruction n’est pas confiée, les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs des services municipaux, les instituteurs publics, les employés de préfecture ou de sous-préfecture, les ingénieurs des Ponts et chaussées, les agents et employés des services communaux. Le Conseil municipal est élu pour quatre ans. Il est renouvelé dans toute la France, le premier dimanche de mai, même s’il a été élu dans l’intervalle. Le Conseil municipal se réunit en session ordinaire, quatre fois par an : en février, mai, août et novembre. Le Conseil est présidé par le maire élu par le Conseil. Le maire est assisté d’un ou de plusieurs adjoints. Les Conseils municipaux votent le budget des communes, qui doit être approuvé par le Préfet. Ils émettent aussi des vœux, des avis et des réclamations. Les délibérations du Conseil sont consignées sur un livre ad hoc. Elles sont aussi adressées au Préfet, qui en prend note. Celui-ci peut, en cas de circonstance grave, en interdire l’exécution. Les séances du Conseil municipal sont publiques. Toutefois, sur la demande du maire ou de trois conseillers, elles peuvent se transformer en Comité secret.
b) Conseil d’arrondissement. ― Le Conseil d’arrondissement se réunit une fois par an par décret en session ordinaire. Il délibère sur les impôts. Son avis est souvent obligatoire. Il émet aussi des vœux sur des affaires concernant l’arrondissement. Il se compose d’autant de membres qu’il y a de cantons dans l’arrondissement. Les conseillers sont élus pour six ans, et renouvelables par moitié tous les trois ans. Les membres du Conseil d’arrondissement peuvent être appelés à remplacer le sous-préfet et à faire partie du Conseil d’arrondissement. Ils sont aussi, électeurs sénatoriaux. Les décisions du Conseil d’arrondissement peuvent être suspendues par décret du Préfet. Celui-ci peut, par la même mesure, dissoudre le Conseil, dont les membres doivent être réélus avant la session annuelle et trois mois après le décret de dissolution au plus tard.
c) Conseil général. ― Le Conseil général est le Conseil administratif du département. Il est élu au suffrage universel et se compose d’autant de membres qu’il y a de cantons dans le département. Les conseillers généraux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié, tous les trois ans. Ils sont rééligibles. Le Conseil général se réunit deux fois par an, en session ordinaire. La deuxième session qui a lieu de plein droit le premier lundi qui suit le 15 août a pour but de délibérer sur le budget, et d’examiner les comptes du département présentés par le préfet. C’est la plus importante. La première a lieu le second lundi qui suit le jour de Pâques. Elle n’est que l’occasion d’une manifestation politique sans importance pour ou contre le pouvoir central, par l’émission de vœux platoniques. Le Conseil général peut, aussi, être réuni extraordinairement par décret du Préfet. Il peut l’être également sur la demande des deux tiers des membres du Conseil adressée au Préfet. La durée des sessions extraordinaires ne peut excéder huit jours. Le Préfet a droit d’accès, quand il le veut, au Conseil général. Il y représente le Gouvernement. Il est entendu quand il le demande. Il n’assiste pas aux séances d’apurement des comptes administratifs. Les séances du Conseil général sont publiques. Les délibérations sont de deux sortes : les unes sont exécutoires par elles-mêmes, les autres ne le sont qu’après approbation.
Si le Conseil général prend une délibération illégale, elle peut, suivant le cas, être annulée par décret du Préfet ou attaquée par lui à fin d’annulation devant le Conseil d’État, soit même par des particuliers dont elle gêne les intérêts.
d) Conseil de Préfecture. ― Le Conseil de Préfecture joue auprès du Préfet, plus particulièrement, le rôle de tribunal administratif. Le Conseil de Préfecture, en dehors de ses attributions contentieuses, a d’autres attributions consultatives et administratives. Il est, de plus, chargé de la répression de certains délits, et ses membres sont revêtus d’attributions personnelles. Le Conseil de Préfecture se compose de neuf membres dans le département de la Seine, de quatre membres dans vingt-neuf départements, et de trois membres dans les autres, moins importants. Le Conseil est, en principe, présidé par le Préfet. Toutefois, celui-ci peut se faire remplacer par l’un des conseillers. En cas d’Insuffisance des membres pour délibérer, le Conseil de Préfecture s’adjoint des conseillers généraux. Le secrétaire du Conseil de Préfecture joue le rôle de ministère public. Les conseillers peuvent, s’il y a lieu, remplacer le préfet, le sous-préfet, le secrétaire général de la Préfecture, être membres du Conseil de révision, etc. Les délibérations du Conseil de Préfecture sont publiques et, orales, sauf en ce qui concerne la juridiction financière. Les arrêts du Conseil de Préfecture peuvent être attaqués devant le Conseil d’État, dans le délai de deux mois, à dater de la notification, s’il s’agit d’arrêts contradictoires, et à dater de l’expiration du délai d’opposition, s’ils sont rendus par défaut.
e) Conseil des Ministres. ― Le Conseil des Ministres est chargé d’administrer le pays sous le contrôle des Chambres. Il délibère en Conseil des Ministres, sous la présidence du chef de l’État, et en Conseil de Cabinet, sous la présidence du président du Conseil ou du viceprésident, en l’absence du président. Le président du Conseil des Ministres est appelé et désigné par le président de la République, après consultation des présidents de la Chambre et du Sénat, et audition des présidents des groupes politiques des deux assemblées et des personnages politiques importants de ces groupes. Le président du Conseil, lorsqu’il a accepté la mission de former le ministère, consulte à son tour ces mêmes personnalités, et forme le cabinet en dosant savamment celui-ci par l’attribution d’un nombre de portefeuilles correspondant aux effectifs des groupes qui forment la majorité sur laquelle il s’appuie ou qu’il recherche. La constitution d’un ministère donne lieu à un grand nombre d’opérations politiques qui ne sont pas toujours très droites ni très loyales. Les évincés crient et forment une opposition, sourde le plus souvent, mais d’autant plus dangereuse. Après avoir constitué son ministère, le président du Conseil présente ses collaborateurs au président de la République, qui signe les décrets nommant les nouveaux ministres. Ceux-ci entrent alors en fonction. Le Conseil se réunit en Conseil de Cabinet pour élaborer la déclaration ministérielle, c’est l’acte de naissance et quelquefois de décès du ministère. Cette déclaration, composée de phrases à effet, balancées, presque toujours creuses, souvent prometteuses, est alors lue à la Chambre, par le président du Conseil et au Sénat par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vice-président du Conseil. Après la lecture de cette déclaration, accueillie généralement au Sénat par un silence expactatif et suivie à la Chambre, par un débat général sur la politique générale du ministère, ce ministère vit s’il a recueilli une majorité, ou démissionne s’il ne l’a pas trouvée. Dans l’affirmative, il a charge d’assurer la continuité de la vie publique, de préparer les lois, le budget et de les faire voter et appliquer. Le Conseil des Ministres est le pouvoir exécutif de fait. Le président du Conseil est le chef du gouvernement, dont-il dirige la politique intérieure et extérieure. Généralement, le ministère se compose des ministres : de l’Intérieur, de la Guerre, de la Marine, des Finances, des Travaux publics, du Commerce, de l’Agriculture, de la Justice, du Travail, des Colonies, qui s’adjoignent des sous-secrétaires d’État en nombre variable. Lorsque le ministère est mis en minorité par l’une des deux Chambres, il démissionne. Cependant, il se peut que le vote du Sénat n’entraîne pas la démission du Cabinet.
Lorsque le Conseil des ministres a examiné la situation qui découle du vote hostile, le président du Conseil remet la démission du Cabinet au président de la République. Celui-ci charge les ministres démissionnaires de l’expédition des affaires courantes de leur département, jusqu’à la constitution du Cabinet nouveau.
f) Conseil supérieur de la Défense nationale. ― Ce Conseil a été constitué par décret du 3 avril 1906. Il a pour attribution d’examiner toutes les questions qui exigent la collaboration de deux ou de plusieurs ministères. La défense nationale, en France, sur le terrain tant national que colonial, exige la coordination de trois ministères : guerre, marine et colonies.
Ce Conseil se réunit au moins une fois par semestre. Sont membres du Conseil supérieur de la Défense nationale : le président du Conseil des Ministres, président, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, le ministre de la Guerre, le ministre de la Marine, le ministre des Colonies. Le président peut, à tout moment, provoquer la réunion de ce Conseil. Il en assure la présidence toutes les fois qu’il le juge utile.
Le chef d’État-Major général de l’armée, le chef d’État-Major général de la Marine, et le président du Comité consultatif des colonies assistent aux séances avec voix consultative. Le Conseil peut convoquer toute personne susceptible d’apporter une aide à ses travaux.
g) Conseil d’État. ― Le Conseil d’État est un organisme placé aux côtés du chef de l’État, des ministres et, aussi, du Parlement.
Il est en même temps que la clé de voûte du contentieux administratif, le grand conseil du gouvernement et l’instance juridique suprême dans le domaine administratif. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice en est le président. Il est présidé en fait, par un vice-président. Le Conseil d’État prépare ou éclaire les décisions qui découlent de l’application des lois. Il est divisé en sections et se réunit, toutes sections réunies, en assemblée générale toutes les fois que c’est nécessaire. Le Conseil d’État comprend outre le président et le vice-président, des présidents de section et des conseillers d’État en service ordinaire, et des conseillers d’État en service extraordinaire, des maîtres des requêtes, des auditeurs de première et deuxième classe. Le secrétaire général est pris parmi les maîtres des requêtes. Le Conseil d’État peut annuler les décisions des Conseils de Préfecture. Il statue sur tous les faits litigieux qui lui sont soumis par les fonctionnaires de l’État, par les conflits d’ordre administratif, découlant de l’application des lois, décrets ou règlements d’administration publique.
DANS LE DOMAINE MILITAIRE
a) Conseil de révision. ― Le Conseil de révision a charge, dans chaque département, d’examiner les opérations de recrutement. Il statue sur l’aptitude des jeunes gens au service militaire. Il est présidé par le Préfet ou le secrétaire général de la Préfecture. Il se compose d’un conseiller général, d’un conseiller d’arrondissement, d’un officier général ou supérieur, délégué par l’autorité militaire. Il est assisté d’un sous-intendant, d’un officier de gendarmerie, du commandant de recrutement, d’un médecin militaire. Le Conseil de révision siège successivement au chef-lieu de chaque canton. Les maires de toutes les communes du canton sont tenus d’y assister ou de s’y faire représenter.
b) Conseil de discipline. ― Le Conseil de discipline se réunit sur la convocation du chef de corps, pour examiner le cas des soldats souvent punis, que l’autorité militaire veut, pour l’exemple, envoyer dans les corps d’épreuve (compagnies de discipline).
Il se réunit aussi avant la libération de la classe, pour fixer le rabiot à infliger aux soldats qui ont subi, dans le cours de leur service militaire, une peine de prison supérieure à 15 jours. Il est composé d’un colonel ou d’un officier supérieur, de deux capitaines ou lieutenants et d’un adjudant ou sous-officier.
Seul le ministre de la Guerre peut infirmer ses décisions.
c) Conseil de guerre. ― Le Conseil de guerre est le Tribunal qui juge les militaires, pour tous les crimes ou délits qui tombent sous le coup du Code militaire. Sa composition varie avec le grade de l’inculpé. Il y a un Conseil de guerre par corps d’armée. Il est généralement présidé par un colonel ou un lieutenant-colonel. Les jugements des Conseils de guerre peuvent être cassés, en temps de guerre, par un Conseil de révision, et en temps de paix par la Cour de Cassation. La suppression des Conseils de guerre et leur remplacement par un tribunal civil est depuis longtemps à l’ordre du jour des partis de gouvernement qui se réclament de la démocratie. Elle n’est sans doute pas près d’être réalisée.
d) Conseil supérieur de la guerre. ― Il délibère sur toutes les questions qui intéressent l’organisation de l’armée et la préparation à la guerre. Le ministre de la Guerre en est le président. Il comprend, en temps de paix, un certain nombre de généraux chargés de missions spéciales et siège sous la présidence du chef d’État-Major général, vice-président du Conseil. En temps de guerre, il se compose des commandants d’armées et du chef d’État-Major général.
4. DANS LE DOMAINE JUDICIAIRE
a) Conseil de famille. ― Le Conseil de famille est une assemblée de parents qui a charge de veiller aux intérêts des membres de cette famille qui sont incapables de le faire eux-mêmes. Le Conseil de famille représente la fonction délibérative à côté de la gestion active qu’est le tuteur nommé par lui. Il peut destituer un tuteur incapable ou indigne. Il contrôle sa gestion. Il autorise la plupart des actes qui excèdent les limites de l’administration courante. Les décisions du Conseil de famille sont passibles d’appel aux Tribunaux civils. Le Conseil de famille est convoqué par le juge de Paix, qui le préside, sur la réquisition d’un membre de la famille, d’un ami du mineur ou d’office par le juge de Paix. Il est composé de six parents ou alliés du mineur, les plus proches en degré résidant tant dans la commune où la tutelle s’est ouverte que dans un rayon de deux myriamètres, pris moitié dans la ligne paternelle, moitié dans la ligne maternelle et en suivant l’ordre de proximité dans chaque ligne. Le parent est préféré à l’allié du même degré, le plus âgé au plus jeune. À défaut de parents ou alliés en nombre suffisant sur les lieux, le juge de Paix peut convoquer à son choix, soit des parents domiciliés à une plus grande distance, soit, dans la localité, des personnes non parentes, mais connues pour avoir eu des rapports d’amitié avec le père ou la mère. La mère est tutrice de droit, tandis que les ascendantes doivent être désignées par le Conseil de famille. Le juge de paix préside avec voix prépondérante en cas de partage. Les trois quarts, au moins du Conseil de famille doivent être présents ou représentés par un mandataire porteur d’une procuration spéciale.
b) Conseil des Prud’hommes. ― Conseil électif chargé de juger les différends entre employeurs et employés. Ce Conseil est composé par moitié de patrons et d’ouvriers. Les Conseils des prud’hommes sont établis par décret du Conseil d’État sur la demande des Chambres de commerce ou des Chambres consultatives des arts et manufactures.
Ils sont placés dans les attributions et sous le contrôle du ministère de la Justice et soumis aux règles disciplinaires des autres tribunaux. Il n’en existe que dans les villes qui constituent des centres industriels. Le nombre des prud’hommes et là circonscription de chaque conseil sont fixés par le décret d’institution. Tout Conseil de prud’hommes est divisé en deux bureaux qu’il constitue lui-même : l’un appelé bureau particulier ou de conciliation ; l’autre, bureau général ou de jugement. Le bureau particulier est composé de deux membres, dont l’un est patron et l’autre ouvrier. Il a pour mission de tenter de régler à l’amiable les différends ou contestations. S’il échoue, l’affaire est renvoyée devant le bureau général, composé d’un nombre égal de prud’hommes ouvriers et patrons. L’appel, s’il est recevable, a lieu devant le Tribunal civil. Les parties peuvent se faire représenter par un ouvrier ou un patron de la même profession. Les chefs d’industrie peuvent se faire représenter par leur directeur-gérant ou par un employé. Le mandataire doit être porteur d’un pouvoir sur papier libre, ou inscrit sur la copie ou l’original de l’assignation. Les Conseils de prud’hommes sont divisés en sections d’industrie, et ces sections s’occupent exclusivement des contestations entre patrons et ouvriers, de cette industrie. Il y a la section du commerce, des métaux, du bâtiment, etc...
c) Conseil supérieur de la magistrature. ― Le Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction qui a charge de juger les magistrats qui commettent des fautes graves et de sanctionner ces fautes. Il est composé de la Cour de cassation, qui siège, toutes chambres réunies, sur la convocation du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il ne statue ou ne donne son avis qu’après avoir entendu le magistrat traduit devant lui.
d) Conseil judiciaire. ― Le Conseil judiciaire est nommé par le tribunal sur l’intervention des parents d’une personne faible d’esprit, qui ne peut gérer elle-même ses affaires, ou dont la prodigalité est reconnue exagérée, et met en péril la fortune commune. Les personnes pourvues d’un Conseil judiciaire ne peuvent, sans l’assentiment de ce dernier, ni plaider, ni transiger, ni aliéner leurs biens, ni recevoir un capital mobilier ou en donner décharge. Les personnes pourvues d’un Conseil judiciaire sont demi-interdites. Les interdits sont considérés comme des mineurs et leurs intérêts sont confiés à un tuteur. L’interdit ne jouit d’aucun droit. Il ne peut pas tester.
5. DANS LE DOMAINE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE
a) Conseil académique. ― Ce Conseil est à la fois tribunal et conseil. Il assiste le Recteur dans chaque Académie. Il est composé de droit de membres choisis par le ministre et les membres élus pour quatre ans (quatre professeurs de lycée, deux professeurs de collège). Il tient deux sessions par an.
b) Conseil départemental. ― Ce Conseil, qui se réunit tous les trois mois, a trois attributions : pédagogiques et règlements des études, programmes, méthodes : administration et établissement d’écoles, titularisations, promotions, récompenses ; contentieuses et disciplinaires. Il ne s’étend qu’à l’instruction primaire.
c) Conseil supérieur de l’Instruction publique. ― Ce Conseil remplit à la fois le rôle de Conseil auprès du ministre, et de tribunal. Il examine les causes, transmises en appel, des autres tribunaux académiques. Il se compose de cinquante-huit membres appartenant aux trois ordres de l’enseignement (primaire, secondaire et supérieur). Treize de ces membres sont nommés par décret. Les autres membres sont élus. Il siège, ordinairement, deux fois par an.
6. DANS LE DOMAINE SCIENTIFIQUE
a) Conseil international des Recherches scientifiques, industrielles et agricoles. ― Ce Conseil a pour but de rechercher, de grouper, d’examiner et de faire appliquer toutes les inventions susceptibles de marquer un progrès dans l’ordre scientifique, industriel ou agricole. C’est, en somme, une sorte d’académie scientifique internationale, qui n’est encore qu’à ses débuts. Elle vulgarise dans la mesure de ses moyens, les œuvres des savants, des inventeurs, des techniciens dans toutes les langues et dans tous les pays.
7. DANS L’ORDRE RELIGIEUX
a) Conseil de fabrique. ― Le Conseil de fabrique, supprimé par la loi du 9 décembre 1905, avait pour but d’administrer les biens d’une paroisse de culte catholique.
b) Conseil presbytéral. ― Mêmes attributions que le Conseil de fabrique, mais en ce qui concerne l’administration des biens d’une paroisse de culte protestant.
― Pierre BESNARD.
CONSERVATISME
n. m.
Opinion d’une catégorie d’individus, adversaires politiques de toute innovation, qui entendent maintenir et conserver la forme des institutions et repousser comme un sacrilège toute transformation sociale. Le conservatisme est opposé à tout progrès ; la crainte de la révolution qui anime les conservateurs est tellement ridicule qu’elle leur fait perdre toute mesure et que ce sont souvent les abus dont ils se rendent complices qui déchaînent la révolte.
Attaché aux dogmes et aux croyances du passé, le conservatisme ne peut vivre dans un milieu, qui, bien que corrompu, est obligé de s’adapter cependant aux progrès de la science et c’est pourquoi on peut le considérer comme étant en train de s’éteindre. Il est encore assez puissant cependant pour porter des coups dangereux et il faut se méfier. Les fusils et les canons sont à sa portée et il s’en servirait pour se défendre contre les idées nouvelles ; mais comme le dit si justement Le Lachâtre : « Ce n’est pas au moyen de l’artillerie qu’on ravivera les dogmes morts, les croyances qui ont fait leur temps ; ce n’est pas au moyen de l’artillerie qu’on pourra constituer l’ordre politique et économique, consolider une société qui s’écroule, transformer les erreurs en vérité, les préjugés en principes, arrêter la marche de l’humanité ».
CONSPIRATION
n. f.
Action de s’associer, de s’unir secrètement dans le but de renverser le gouvernement et d’en changer la forme. « Il ne peut y avoir de conspiration dangereuse dans un pays dont le peuple est heureux et libre » écrivait Voltaire ; mais ce pays n’existe pas et n’a jamais existé, même du temps de Voltaire.
Du reste, ce n’est jamais le peuple qui conspire, mais généralement une poignée d’individus qui espèrent, en changeant les hommes au Pouvoir, changer le cours des événements ou la situation économique et sociale.
Il faut reconnaître qu’à côté des conspirations intéressées il en fut qui exercèrent une heureuse influence sur l’histoire des peuples, telle la Conspiration de Cromwell, qui, en renversant le roi Charles 1er d’Angleterre, ouvrit au pays la route du Libéralisme. Mais, en général, les conspirations sont d’essence politique et ne changent rien, sinon les hommes.
CONSTITUTION (LA)
n. f.
La Constitution dit le Larousse est la « loi fondamentale d’une nation ». Elle est en effet l’ensemble des règlements qui régissent un pays. En France, depuis la Révolution de 89, une douzaine de Constitutions virent le jour et la dernière date de 1875 et c’est encore en son nom que nous sommes gouvernés actuellement.
La Constitution de 1791 déclarait que la France était représentée par le Corps Législatif et par le roi, mais à la déchéance de Louis XVI et lorsque la monarchie fut abolie et remplacée par la République, une nouvelle Constitution devint nécessaire. Elle fut décrétée le 24 juin 1793 et acceptée le 10 août de la même année, mais elle ne fut jamais mise en vigueur car la République en ébullition et attaquée par ses ennemis intérieurs et extérieurs ne pouvait pas trouver le temps de s’arrêter à un système fixe ; la Convention se rallia au rapport présenté par Saint-Just et décréta que le Gouvernement serait révolutionnaire jusqu’à la paix.
Il n’est pas inutile de retracer quelques passages du rapport présenté à la Convention par Hérault de Séchelles qui rédigea la Constitution de 93. Un réel souci de liberté et de fraternité avait animé l’auteur de ce travail qui pêche cependant à sa base ; qu’on en juge par la conclusion : « Si, dans la moitié des départements plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d’eux, régulièrement formées, demandent la révision de l’acte constitutionnel, le Corps législatif est tenu de convoquer toutes les Assemblées primaires de la République pour savoir s’il y a lieu de recourir à une convention nationale. Enfin la constitution garantit à tous les Français : l’égalité, la sécurité, la propriété, la dette publique, des secours publics, le libre exercice des cultes, une instruction commune, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition, le droit de se réunir en Société populaire, la jouissance de tous les droits de l’homme. »
Les révolutionnaires de 93 ne comprirent pas que du fait même que la propriété subsistait, tous les autres articles de leur charte devenaient caducs et que la propriété qui avait été arrachée à la noblesse, n’allait pas servir à un meilleur usage entre les mains de ses nouveaux détenteurs.
Lorsque la révolution fut écrasée et que les éléments bourgeois dominèrent à nouveau, on vit naître en 1795 une nouvelle Constitution qui fut abolie à son tour et remplacée par la Constitution de l’an VIII qui tua la République. Ensuite ce fut l’Empire et la Restauration et plus tard la Révolution de 1848 qui proclama à nouveau la République.
Le 4 novembre 1848 la Constitution de la République fut promulguée ; le préambule mérite d’être cité.
« La France s’est constituée en République. En adoptant cette forme définitive de gouvernement, elle s’est proposé pour but de marcher plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation, d’assurer une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société, d’augmenter l’aisance de chacun par la réduction des dépenses publiques et des impôts, et de faire parvenir tous les citoyens sans nouvelles commotions, par l’action successive et constante des institutions et des lois, à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être. La République française est démocratique une et indivisible. Elle reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives. Elle a pour principes : la liberté, l’égalité et la fraternité. Elle a pour bases : la famille, le travail, la propriété, l’ordre public. Elle respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne ; n’entreprend aucune guerre dans des vues de conquête, et n’emploie jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. Les citoyens doivent aimer la patrie, servir la République, la défendre au prix de leur vie, participer aux charges de l’État en proportion de leur fortune ; ils doivent s’assurer par le travail, des moyens d’existence, et par la prévoyance des ressources pour l’avenir ; ils doivent concourir au bien-être commun en s’entraidant fraternellement les uns les autres, et à l’ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et l’individu.
La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l’instruction indispensable à tous les hommes ; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l’existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d’état de travailler. »
Dans ce préambule se cristallise toute la démocratie, et si les formes de la Constitution de 48 ont été abrogées par la Constitution de 1852 et celle de 1875, l’esprit de cette dernière conserve toujours en son sein l’erreur fondamentale qui consiste à croire que la liberté peut exister dans un régime où l’inégalité économique, issue de la propriété, est la base même de ce régime.
On comprendrait encore que les Révolutionnaires de 93 eussent commis la faute grave de ne pas comprendre qu’il ne peut y avoir de liberté et de fraternité tant que la transformation économique de la société ne se sera pas réalisée ; mais on ne peut accorder ces circonstances atténuantes aux démocrates de 48 et de 75 qui avaient pour se guider l’exemple du passé et l’expérience de la demi-douzaine de Constitutions qui avaient été inopérantes à établir un régime stable et fraternel. II faut donc en conclure que la Constitution est une belle page de rhétorique, rédigée en connaissance de cause, par des parlementaires attachés à la conservation de la propriété et qui ne voulaient en aucun cas que les classes pauvres se libèrent du joug de l’exploitation.
Que le peuple se laisse griser par ses espérances démocratiques et que la Constitution lui donne l’illusion de la Liberté et de la Fraternité, cela ne fait aucun doute. La charte de 1875, qui déclare que « tous les citoyens sont égaux devant la loi », et que cette loi ne peut être que l’expression de la volonté populaire puisqu’elle est élaborée par les représentants du peuple élus par ce dernier au suffrage universel, découle de raisonnements captieux.
« Égalité devant la loi » ne veut pas dire « Égalité en soi » et la Liberté dans la loi n’est pas « La Liberté » ; et puisque la loi en vertu même de la Constitution dont elle n’est qu’une dérivation, défend la « propriété » contre ceux qui voudraient l’attaquer, la Constitution et la loi, quelles que soient les formules employées, ne peuvent être une source de liberté, d’égalité et de fraternité.
On ne peut arriver « à un degré plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être » tant que la Société reposera sur le Capitalisme ; voilà la vérité de laquelle il faut s’inspirer.
Lorsque Lamennais pose la question : « Qu’est aujourd’hui le prolétaire à l’égard du capitaliste ? », il y répond avec une simplicité brutale mais précise : « Un instrument de travail ».
« Affranchi par le droit actuel, légalement libre de sa personne, il n’est point, il est vrai, la propriété vendable, achetable de celui qui l’emploie. Mais cette liberté n’est que fictive. Le corps n’est point esclave, mais la volonté l’est. Dira-t-on que ce soit une véritable volonté que celle qui n’a le choix qu’entre une mort affreuse, inévitable et l’acceptation d’une loi imposée ? »
« Les chaînes et les verges de l’esclave moderne, c’est la faim. » Et nous pouvons ajouter que ces chaînes et ces verges, sont le travail de la Constitution qui les fabrique pour la Bourgeoisie et le Capital.
Les sociétés sont construites sur des iniquités politiques et économiques et l’on peut dire que les iniquités politiques sont engendrées par les iniquités économiques. Toute Constitution sociale qui ne détruira pas l’iniquité économique n’aura rien fait, et ce sera l’éternel recommencement comme ce le fut depuis 93. Que peuvent les belles phrases, les formules pompeuses, les déclarations ronflantes, la sincérité des intentions même, si tout l’ordre économique s’oppose à la liberté et au bien-être collectif.
Il ne suffit pas d’écrire sur les murailles des monuments, d’enseigner aux enfants que les hommes sont libres et égaux alors que la réalité de la vie se charge bien vite de dessiller les yeux.
Il n’y a de bonheur possible que dans la liberté et l’égalité. Or, la liberté et l’égalité ne se donnent pas par une Constitution plus ou moins élastique ; elles se prennent, elles se gagnent par la lutte, par la volonté de vaincre et du jour où la Liberté ne sera plus un vain mot, il n’y aura pas besoin de Constitution pour nous le rappeler, car elle se manifestera par sa Grandeur et sa Beauté.
CONTINGENCE
n. f.
Ce qui est relatif, subordonné dans sa réalisation à un fait ou à un événement. Ce qui peut arriver ou ne pas arriver. Ce mot est peu usité en dehors de la Philosophie. La « contingence » a soulevé le problème de la liberté, de la fatalité et du déterminisme. La question se pose à savoir si l’homme est libre de tous ses mouvements, de ses actes, de ses pensées et, philosophiquement parlant, responsable ; ou si au contraire il est dépendant d’une quantité de « Contingences », et par conséquent irresponsable.
Les Anarchistes qui pensent que l’individu est le produit du milieu, qu’il hérite des tares et des bienfaits du passé, qu’il subit l’ambiance de tout ce qui l’entoure, estiment qu’il est subordonné aux « Contingences » ; mais il ne faut pas en conclure que socialement il est absolument irresponsable de tous ses actes. L’individu a, lui aussi, une volonté dans le grand tout et c’est cette volonté individuelle qui doit être en lutte constante contre les « Contingences », pour se libérer des entraves que celles-ci lui ont tissées.
CONTRAINTE
n. f.
La contrainte nous dit le « Larousse » est la violence exercée contre une personne. Le Lachâtre, un peu moins bref, nous dit « qu’elle est la violence exercée contre quelqu’un pour l’obliger à faire quelque chose malgré lui ou l’empêcher de faire ce qu’il voudrait ».
Si l’on approfondit tout ce que renferme en elle cette dernière définition de la violence, on peut conclure que nous sommes à chaque instant de notre existence, contraints à commettre des actes qui nous déplaisent, et si la violence ne se manifeste pas toujours brutale pour nous les imposer, elle agit sur notre volonté et entrave par ses rigueurs notre liberté.
Il n’est pas abusif d’affirmer que nous vivons sous une contrainte perpétuelle dans la société actuelle basée sur l’autorité, et il coule de source, qu’il n’en peut être autrement.
De même que l’Autorité, la Contrainte s’exerce surtout sur ceux qui sont placés en bas de l’échelle sociale et qui sont toujours les premières victimes des maux engendrés par le désordre économique et politique des sociétés modernes ; or, la contrainte est un des fruits de ce désordre et cela se conçoit, car sans elle la société capitaliste ne serait pas viable.
Nous passerons sous silence les premières contraintes que nous subissons, dès notre plus jeune âge, bien qu’elles déterminent souvent tout le cours de notre vie. C’est dans la famille, à l’école, qu’elles nous sont imposées, mais les jeunes cerveaux s’assimilent facilement et les souffrances que nous ressentons s’estompent lorsque nous approchons de l’adolescence.
C’est surtout lorsque nous arrivons à l’âge d’homme que la contrainte devient féroce et que nous sommes obligés de nous courber sous elle ou de mourir. Elle se présente d’abord à nous, par les formes de travail qui nous sont imposées et auxquelles il nous est impossible d’échapper. En abolissant l’esclavage et le servage on n’a pas aboli la contrainte et on n’a pas donné naissance à la liberté. On prétend que l’ homme est libre, surtout depuis les transformations opérées par la grande Révolution française, et que la disparition des corporations a fait du producteur un homme libre, que c’est de bon gré qu’il travaille aux conditions qu’il accepte après les avoir débattues en pleine conscience et en pleine liberté.
Nous savons quel crédit il convient d’accorder à un tel argument. Si nous n’avions pas à subir dès notre entrée en ce monde les « contraintes naturelles », c’est-à-dire l’obligation absolue de manger pour vivre, nous ne serions pas assujettis comme nous le sommes. Mais nous ne pouvons pas nous abstenir de nous nourrir et nous savons fort bien que le travail est indispensable pour subvenir aux besoins matériels de la collectivité. Ce n’est donc pas le travail que nous considérons ici comme une contrainte, mais la forme qu’il emprunte.
Nous avons dit d’autre part que le capitalisme avait accaparé tous les moyens de production et toute la richesse sociale et que le travailleur ne possédant que ses bras était dans l’obligation de les louer pour suffire à ses besoins les plus immédiats. Prétendre que cette location est libre, est non seulement ridicule mais criminel, puisqu’il est évident que si le prolétaire se refuse à louer ses bras au capitalisme, il ne pourra trouver sa subsistance ; il est donc contraint de travailler pour le capitalisme, et aux conditions que ce dernier voudra bien lui imposer.
Le travail en société bourgeoise est donc une véritable contrainte, puisque le travailleur, sous peine de mort, ne peut pas échapper à cette loi arbitraire forgée de toutes pièces par les hommes au profit d’une catégorie d’individus.
Que de choses ne nous oblige-t-on pas à faire malgré nous ! Nous disons que la contrainte s’exerce sur tous les travailleurs et qu’il est impossible de l’éviter. Les gouvernements, par leurs impôts directs et indirects, font peser sur tous les individus une contrainte continuelle et ce n’est seulement que lorsque le peuple se révolte que la violence entre en jeu. La contrainte s’impose encore à nous, lorsqu’au nom de la « Patrie » nous sommes appelés à remplir nos « devoirs militaires » et à « servir le pays », et quelles que soient les mesures que nous prenions pour nous défendre contre les obligations que nous jugeons arbitraires, c’est de la contrainte, et toujours de la contrainte qui s’abat sur nous et nous écrase.
« Nécessité sociale affirment ceux qui l’exercent ; sans autorité et sans contrainte il n’y a pas de vie collective possible, nous disent les partisans des sociétés gouvernementales » ; cependant, depuis les milliers et les milliers d’années que les sociétés sont élaborées sur ces deux principes, il serait peut-être temps de nous démontrer les bienfaits de l’autorité et de la contrainte.
Ce qui est vrai, c’est qu’une minorité de malins tirent les ficelles de l’économie politique et sociale, et que la grande majorité suit ces mauvais bergers qui craignent que la liberté du peuple ne leur enlève leurs privilèges.
L’Autorité et la Contrainte ne sont avantageuses qu’à ceux qui les exercent et lorsque les hommes auront compris qu’il n’y a de bonheur possible que dans la liberté, ils feront table rase de tous les vieux préjugés qui les tiennent asservis au monde moderne, et se mettront au travail pour élaborer une société nouvelle, sans contrainte et sans autorité.
CONTRASTE
n. m.
Opposition ou dissemblance d’objets, de propriétés physiques ou de qualités morales. « Contraste de l’obscurité et de la lumière ». « La pauvreté est un contraste choquant à l’opulence de certains ».
Il y a aussi des contrastes dans le domaine des idées. Les idées de Liberté sont en opposition et présentent un contraste aux idées d’autorité. Il faut espérer que du choc des contrastes jaillira un jour une ère nouvelle, où le contraste ne se manifestera plus que sur le terrain artistique et littéraire, mais où il aura totalement disparu de la vie économique des populations.
CONTRAT ANARCHISTE (LE)
n. m.
L’État étant disparu, ou évincé, comment les rapports entre les humains se règlent-ils entre les isolés et les associations, d’isolé à isolé, d’ association à association ? Par une entente, un accord librement proposé, librement discuté, librement accepté, librement accompli ; en d’autres termes, par un Contrat.
Qu’on le dénomme « promesses », « conventions », le terme importe peu ; ce qui importe, c’est de savoir de quelle nature peut être ce contrat lorsqu’il est passé entre anarchistes.
S’il est hors de doute que les clauses d’un contrat doivent pouvoir être proposées, examinées et discutées dans des conditions laissant toute liberté d’esprit et d’action aux cocontractants, il est hors de doute également que lesdites clauses ne sauraient renfermer aucune stipulation qui soit contraire à la conception anarchiste de la vie humaine.
C’est ainsi que le contrat passé entre anarchistes ne saurait contenir aucune clause qui y astreigne malgré lui quiconque ne veut on ne peut plus en exécuter les termes.
Il se peut qu’un individu n’ait pas mesuré toute la portée de l’accord qu’il a souscrit ; qu’en cours d’exécution son état d’esprit se soit modifié sous l’influence de circonstances nouvelles. Il se peut qu’une émotion, qu’un sentiment d’une espèce ou d’une autre l’envahisse, le domine, s’empare de lui, momentanément tout au moins, le plaçant dans une situation mentale tout autre que la mentalité qui était sienne au moment de la conclusion de l’accord. Pour toutes ces raisons, le contrat passé entre anarchistes, doit pouvoir être résiliable.
L’un des contractants, de même, peut se juger lésé ou réduit à une situation défavorable, inférieure ou indigne de lui par rapport aux autres contractants. Les cocontractants peuvent s’apercevoir, après expérience, qu’ils ne sont pas qualifiés pour remplir les clauses du contrat qu’ils ont conclu. Ou encore qu’ils se sont aventurés au-delà de leurs aptitudes ou de leurs possibilités en se risquant à établir le contrat qui les unit même temporairement. C’est pourquoi une des conditions préalables à la conclusion du contrat entre anarchistes postule, de la part des cocontractants, un examen sérieux et préalable de leurs capacités et de leurs ressources.
Le contrat doit donc pouvoir être résiliable, mais avec préavis, car il est d’une élémentaire camaraderie qu’aucun des participants au contrat ne subisse d’embarras, de retard, de peine ou de dommage évitable, du fait de la rupture du contrat.
Même en cas de brusque rupture du contrat, il ne saurait être question, entre anarchistes, sous prétexte d’en faire respecter les termes, de l’intervention d’un tiers ou d’une autorité ou institution extérieure aux cocontractants. Il ne saurait être non plus question de sanctions disciplinaires ou pénales, sous quelque vocable qu’on les masque. Rien de cela ne serait anarchiste. On peut cependant, en cas de difficulté ou de litige en cours d’exécution du contrat, prévoir le recours à un arbitre-expert, ― un technicien, par exemple ― mais à la condition absolue qu’il soit, choisi par les deux parties en désaccord et qu’il jouisse assez de leur confiance pour que sa décision ne soit pas mise en discussion.
Tout contrat impliquant obligation, sanction, intervention étatiste, gouvernementale ou administrative extérieure aux cocontractants n’est ni individualiste ni communiste (anarchiste), il n’y a pas à ergoter là-dessus.
C’est pourquoi le contrat conçu à la façon dont nous l’entendons ― dont l’entendent les anarchistes de toutes les tendances ― ne peut être passé qu’entre unités humaines possédant un tempérament, une mentalité adéquats. Si cette mentalité préalable fait défaut, il n’y a pas de contrat possible entre anarchistes. C’est pourquoi encore ― même admise cette mentalité déterminée ― les anarchistes affirment que pour s’associer, il est urgent de se bien connaître, de ne passer contrat que pour une période et une besogne aussi bien déterminées qu’il est humainement prévisible.
Il est donc entendu théoriquement que le contrat se rompt dès qu’il lèse l’un des cocontractants. Comme toutes les formules d’ailleurs, celle-ci présente le défaut, quand on l’envisage dans ses applications pratiques, de ne pas tenir compte des circonstances de vie et de tempérament individuels. Pratiquement, l’on peut écrire que le contrat entre camarades anarchistes cesse dès que l’entente qui a présidé pour le conclure se retrouve pour le dissoudre.
En effet, le contrat conclu entre anarchistes pour une fin quelconque est sous-entendu n’avoir pas été conclu à la légère. Son origine a été exempte des restrictions mentales, des pensées de derrière la tête, des dissimulations, des fraudes, de cette recherche d’un intérêt sordide, qui stigmatisent les contrats en vigueur dans la société actuelle. Les cocontractants se connaissent, ils ont pesé le pour et le contre, réfléchi aux conséquences, examiné les points forts et les points faibles de la situation, prévu les dangers et les périls, supputé les joies et les avantages, déterminé les concessions qu’ils auraient à se faire mutuellement.
Ces remarques suffisent à indiquer qu’un contrat loyal ne cesse pas uniquement par suite du caprice, de la fantaisie, d’un mouvement d’humeur de l’un des contractants. Sa rupture ne se fait pas sans réflexion, sans examen sérieux des dommages ou des conséquences qui peuvent s’ensuivre.
Cependant, lorsque l’un des contractants a formulé sa volonté formelle de rompre le contrat, aucun anarchiste ne saurait s’y opposer. Cela ne veut pas dire que les autres cocontractants n’objecteront pas à cette rupture. Il se peut en effet, au moment où le contractant mécontent demande la rupture de l’association, que les autres associés se trouvent dans des dispositions d’esprit et de sentiment absolument semblables à celles qui les ont poussés à conclure le contrat. Un anarchiste peut donc objecter à la rupture, demander à réfléchir, faire valoir certaines raisons, invoquer certaines considérations, d’un ordre tout particulier quand il s’agit du domaine du sentiment, considérations que comprennent ceux qui vivent intensément la vie sentimentale. Un anarchiste pourra résister plus ou moins longtemps à la rupture d’un contrat, s’il possède la conviction profonde que son camarade agit sous l’empire d’une influence pernicieuse. Il n’est rien là qui frise l’inconséquence. Selon son tempérament, il pourra souffrir, se lamenter même et qui donc lui reprocherait d’être autre chose qu’une équation géométrique ? C’est seulement s’il s’opposait catégoriquement, par la violence, sur un plan quelconque, à la dissolution exigée par son cocontractant que, au point de vue anarchiste, il cesserait d’être conséquent, dans le sens profond et pratique du mot.
À moins de motifs exceptionnels, d’un cas de force majeure, l’anarchiste qui impose la rupture du contrat irréfléchiment, à brûle-pourpoint me paraît un inconséquent et un camarade de mauvais aloi. Un compagnon anarchiste loyal ne profite de sa faculté de « rompre le contrat à sa guise » qu’après avoir obtenu l’adhésion sincère de son ou de ses contractants. On regardera pratiquement à deux fois ― sinon davantage ― avant de rompre une entente, manquer à des promesses, briser des conventions faites de bonne foi et qui sousentendaient une confiance réciproque.
Il est impossible de faire passer la rupture imposée ou exigée à tout bout-de-champ, sans rime ni raison, infligeant de la souffrance inutile, comme un geste de camaraderie. Qu’est-ce donc que la camaraderie, sinon un contrat tacite conclu entre êtres qu’unissent certaines affinités intellectuelles ou sentimentales ou de gestes, afin de se rendre la vie plus agréable, plus plaisante, plus joyeuse, plus profitable, plus utile à vivre ?
On a demandé souvent quelle serait la différence entre l’humanité actuelle et une humanité anarchiste ou à tournure d’esprit anarchisante. Certes, topographiquement parlant, je l’ignore ; je suis hors d’état de fournir la nomenclature exacte des hameaux, des villages, des villes, des rues de chaque ville, des ruisseaux, des torrents, des chemins vicinaux. Mais je suis assuré d’une chose, c’est que le contrat social, le contrat d’association humaine n’y sera pas imposé, ni politiquement ni autrement ; pas plus par une caste que par une classe sociale. Dans les sociétés actuelles, l’unité humaine est placée en face d’un contrat social imposé ; dans toute humanité saturée, imprégnée d’esprit anarchiste, il n’existera que des contrats proposés. C’est-à-dire qu’un milieu anarchiste, une humanité anarchisante ne tolère pas, ne saurait tolérer qu’il y ait une clause ou un article d’un accord ou d’un contrat qui n’ait été pesé et discuté avant d’être souscrit par les cocontractants. Dans un milieu ou une humanité du type anarchiste, il n’existe pas de contrat unilatéral, c’est-à-dire obligeant quiconque à remplir un engagement qu’il n’a pas accepté personnellement et à bon escient ; aucune majorité économique, politique, religieuse ou autre, aucun ensemble social ― quel qu’il soit ― n’y peut contraindre une minorité ou une seule unité humaine à se conformer, contre son gré, à ses décisions ou à ses arrêts.
― E. ARMAND.
CONTRE-RÉVOLUTION
n. f.
Pour donner un aperçu de ce que peut être la Contre-Révolution, il serait peut-être utile de définir auparavant ce que nous entendons par « Révolution ». Nous le ferons très brièvement, en quelques mots, en renvoyant le lecteur au mot « Révolution » pour tous enseignements complémentaires.
Le Lachâtre nous dit que la « Révolution » est « le changement subit dans les opinions, dans les choses, dans les affaires publiques, dans l’État » ; quant au « Larousse » il se contente de la définir : « Changement subit dans le Gouvernement d’un État ». ’
Il est tout naturel qu’ayant défini le mot Révolution de façon ambiguë et incorrecte, la « Contre-Révolution » soit à son tour déformée dans son esprit et dans sa lettre. Lachâtre nous dit en effet que la Contre-Révolution est « Une Révolution qui a pour tendances de détruire les résultats de celle qui l’a précédée ». Cela peut sembler suffisant à ceux qui se grisent encore de démocratisme et de parlementarisme, mais pour ceux qui ont tant soit peu étudié l’histoire et la vie des diverses révolutions et contre-révolutions du passé, la définition de Lachâtre n’est pas seulement incomplète, elle est erronée.
Pour nous qui pensons que la Révolution est un tout et que rien ne peut en être détaché, qui la considérons comme le moyen de transformation absolue de la société capitaliste, et qui sommes convaincus que pour être efficace elle sera anarchiste ou ne sera pas, nous sommes amenés à dire que la Contre-Révolution, est l’ensemble des éléments qui, au lendemain ou à la veille d’un mouvement révolutionnaire ou insurrectionnel, agissent de façon à entraver l’instauration du Communisme anarchiste.
On peut donc être un facteur de Contre-Révolution avant même que la Révolution ait été déclenchée.
L’erreur que l’on commet assez couramment est de croire que seuls les éléments bourgeois sont un danger pour la Révolution et qu’une fois que ceux-ci sont affaiblis, sinon écrasés, la Révolution peut suivre son cours en toute tranquillité.
Cette erreur fut la cause de bien des désillusions, car si, au lendemain d’un mouvement populaire, le premier travail de salubrité consiste à s’assurer que les forces de réaction capitaliste se trouvent dans l’incapacité de nuire, et que toutes mesures soient prises pour les en empêcher, il est également indispensable de veiller à ce que le peuple en révolte ne se laisse pas entraîner sur le chemin qui le conduirait à un nouvel ordre social vicié à sa base, et qui petit à petit le ramènerait à son point de départ.
Lorsque nous disons que la Révolution est un tout, ce n’est pas que nous ayons la naïveté de croire qu’il soit possible d’élaborer dans le plus proche futur la Société Anarchiste. Nous savons que trop de préjugés encrassent encore le cerveau des individus et que les tares transmises par des milliers et des milliers d’années de servitude, seront des facteurs avec lesquels il faudra compter, facteurs de contre-révolution qui entraveront la réalisation immédiate d’une société vraiment anarchiste. Mais ce que nous croyons c’est que la Révolution peut se diviser en deux phases : qu’elle sera premièrement économique, matérielle, et ensuite, intellectuelle et morale. Sur le terrain économique, la Révolution doit établir l’égalité des hommes, égalité alimentaire pourrait-on dire, qui doit servir de fondement à l’évolution morale et intellectuelle des hommes vivant en société.
Or, à nos yeux, la Contre-Révolution se présente sous la forme de tout organisme qui, par ses pratiques ou sa propagande, arrête dans sa marche l’œuvre de destruction des vieux principes autoritaires sur lesquels repose toute l’inégalité économique et sociale des sociétés modernes. Une Révolution laissant subsister une hiérarchie qui se manifeste non seulement par l’autorité gouvernementale, mais aussi par le privilège qu’ont certains de consommer plus que leurs semblables, est une révolution incomplète, qui traîne comme un boulet le lourd fardeau de l’illusion démocratique et renferme en elle-même tous les germes de corruption inhérents aux sociétés modernes.
La Révolution ne sera vraiment triomphante que :
-
Lorsque le capital aura totalement disparu de la surface du globe ;
-
Lorsque l’Autorité sera complètement abolie ;
-
Lorsque l’individu ne sera plus soumis à la contrainte d’autrui et qu’il sera entièrement libre de ses actes et de sa volonté.
Affirmer que demain il soit possible de voir le jour se lever sur un monde à ce point rénové serait une folie, et les Anarchistes vivent trop sur la terre pour ignorer les difficultés qu’il y aura à surmonter pour atteindre ce but. Cependant tout ce qui ne s’oriente pas vers ce but nous semble être Contre-Révolutionnaire.
On confond facilement Révolte et Révolution. La Révolution, comme l’a si bien démontré Kropotkine, sera communiste, ou alors, écrasée dans le sang, elle sera à recommencer. Par conséquent, si l’on accepte ce principe élémentaire du révolutionnarisme, que la Révolution doit ouvrir les portes du Communisme libertaire ― et les Anarchistes ne peuvent pas ne pas l’accepter ― tout ce qui est une entrave au Communisme est un facteur de Contre-Révolution.
Lorsque nous employons le terme « Contre-Révolution » ou « Contre-Révolutionnaire », nous ne donnons pas toujours à ces expressions un sens péjoratif, car il y a deux sortes de « Contre-Révolution et de Contre-Révolutionnaire ».
Dans la première catégorie, on peut classer tous ceux qui, par un mouvement de recul de la Révolution, espèrent reconquérir les privilèges abandonnés dans la lutte, et rétablir l’ordre social dans lequel ils étaient les maîtres tout puissants. Ce sont les Contre-Révolutionnaires appartenant à la bourgeoisie et qui ne désirent qu’une chose : voir se perpétuer l’inégalité et l’injustice politique, économique et sociale, qui leur assurent non seulement le bien-être mais aussi le superflu.
De ceux-là il n’y a rien à attendre, sinon des déboires ; ce sont des adversaires acharnés de tout mouvement de libération prolétarienne et ils ne méritent que le mépris et la haine des classes opprimées. Il faut les écraser dès les premiers jours d’un mouvement insurrectionnel.
Est-il besoin de s’étendre sur les facteurs de Contre-Révolution qui prennent leurs sources dans les rangs de la bourgeoisie ? La classe ouvrière sait bien ― et elle est payée, ou plutôt elle paye pour le savoir ― que le capitalisme n’acceptera jamais de bon gré la transformation d’une société qui lui permet toutes les jouissances et le fait bénéficier de tous les avantages. Par tous les moyens, le capitalisme se défend et se défendra contre les forces de Révolution ; il est contre-révolutionnaire par essence, en vertu même de la situation qu’il occupe dans la société ; et, durant les périodes catastrophiques, lorsque sous la poussée du populaire, les maîtres détrônés, jetés à bas de leur piédestal, sont obligés d’abandonner le terrain, ils n’acceptent leur sort que provisoirement et sitôt que l’horizon leur semble propice, ils mettent tout en œuvre pour reconquérir le terrain perdu. C’est l’histoire de toutes les révolutions du passé, et la plus récente, celle de 1917, en Russie, n’échappa pas aux attaques et aux manœuvres honteuses de la contre-révolution capitaliste.
Si la contre-révolution réactionnaire est possible, c’est que dans la Révolution elle-même il y a des facteurs de contre-révolution. Être révolutionnaire, ce n’est pas seulement détruire, c’est surtout construire. La société bourgeoise peut être comparée à la chandelle de nos ancêtres, il faut la remplacer par un flambeau. On ne comprendrait pas l’individu démolissant un bec de gaz parce qu’il éclairait mal, et qui, n’ayant rien à mettre à la place, serait plongé dans l’obscurité.
On a trop spéculé sur la force physique, musculaire, numérique du peuple, dans les révolutions passées. On a laissé croire aux masses d’ouvriers qu’ils étaient la force parce qu’ils étaient la majorité. Cela était peut-être vrai à l’époque où les progrès de la science n’étaient pas arrivés au point culminant qu’ils atteignent de nos jours ; mais actuellement, ce qui fait la puissance du capitalisme, c’est son intelligence, ses connaissances, ses techniciens, et ce qui fait la faiblesse du prolétariat c’est son ignorance. Cette ignorance est, elle aussi, un facteur de contre-révolution aussi dangereuse que le capitalisme lui-même.
Il peut sembler paradoxal que des révoltés puissent être des contre-révolutionnaires et il en est pourtant ainsi.
Il y a donc ce que l’on peut appeler la seconde catégorie de « contre-révolutionnaires », qui est composée de révoltés voulant détruire l’ordre social bourgeois, d’individus qui aspirent à la liberté et au bonheur pour tous, mais qui se trompent, de route et qui empruntent celle qui ne peut les conduire qu’à un nouvel esclavage et s’éloignent sensiblement du but poursuivi.
Ces « contre-révolutionnaires » ne sont pas guidés, nous le répétons une fois encore, par l’intérêt, mais par l’ignorance. Ils sont sincères dans leurs erreurs et pensent loyalement qu’ils travaillent pour le bien de l’Humanité, alors qu’en réalité ils retardent l’ère de la libération des peuples.
Ils sont des agents de contre-révolution, malgré leurs convictions révolutionnaires, et il est pénible et douloureux de constater toutes les énergies dépensées, tous les sacrifices consentis, sincèrement au nom de la Révolution en faveur de la Contre-Révolution. Et cela nous fait songer à l’ours du fabuliste, qui, pour tuer une mouche qui se promenait sur la figure de son maître, lui écrasa la tête avec un pavé.
Si un ours était susceptible de raisonner, d’éprouver un sentiment d’intelligence ou de logique, s’il n’était pas simplement conduit par l’instinct, nous dirions que c’est un noble sentiment qui détermina son geste brutal ; il eut été préférable pour le maître que l’ours n’éprouvât pas ce sentiment. C’est également un sentiment noble et sincère qui détermine ces « contre-révolutionnaires », révolutionnaires dans leurs actions, et ils sont convaincus de l’efficacité des moyens employés pour assurer le triomphe de la Révolution ; mais hélas, la sincérité n’a rien à voir avec la vérité et un homme sincère peut être dangereux lorsqu’il se trompe.
« Les gens qui font des révolutions à demi ne parviennent qu’à se creuser un tombeau. »
Ce sont là les profondes paroles de Saint-Just qui il 26 ans, monta à l’échafaud, les pieds baignant dans le sang de Robespierre, le front haut et le regard plongé dans l’avenir.
Il mourut Victime de ses erreurs, et de celles de tous les conventionnels qui eurent confiance en une République établie sur l’Autorité et la Propriété, et avec quelle fougue, avec quel amour, avec quelle émotion vibrante, il la défendit, « sa République ! »
Et si aujourd’hui il pouvait apercevoir son œuvre, si avec Robespierre « l’Incorruptible » il pouvait contempler le régime d’arbitraire, de boue et de sang que nous subissons et qui prend sa source dans l’erreur républicaine et démocratique de 93, ne serait-il pas terrifié, lui qui croyait à la justice, à la vertu et à l’humanité ?
Si nous jetons un regard rétrospectif sur le passé, ce n’est pas pour amoindrir les hommes qui ont illustré de façon admirable le grand livre de leur époque et qui ont joué un rôle considérable dans l’évolution des Sociétés. Mais lorsque, avec la quiétude que nous donne le recul de l’histoire, sans haine et sans passion, nous examinons le travail accompli par nos aînés avec le seul désir et l’unique souci de faire mieux lorsque notre tour viendra, il est opportun d’enregistrer les fautes commises hier pour ne pas les répéter demain.
Saint Just avait tort et Robespierre aussi. Ils ont réalisé des choses grandioses, ils n’ont pas su réaliser, la Révolution et pousser la Contre-Révolution dans ses retranchements et cela leur coûta la vie. Le « Père Duchesne » avait raison et en le faisant arrêter et condamner à mort, Robespierre franchissait le mur qui séparait la Révolution de la Contre-Révolution, il allait être lui-même sa propre victime.
Qui donc aujourd’hui contesterait la sincérité et le désintéressement des héroïques communards de 1871, qui, durant près de trois mois se défendirent courageusement contre les armées ― supérieures en nombre et en force ― des Versaillais ? Les chefs de ce beau mouvement agissaient-ils révolutionnairement en faisant garder les banques par des soldats et en refusant de s’emparer de cette richesse ― toujours mal acquise ― alors que le peuple affamé se mourait devant les coffres-forts de la bourgeoisie ? Ne sont-ils pas responsables dans une certaine mesure de la répression terrible de Thiers, qui se vengea de la terreur éprouvée par la bourgeoisie, en faisant massacrer des dizaines de milliers de révoltés ?
« Les gens qui font des révolutions à demi ne parviennent qu’à se creuser un tombeau. »
Il faut méditer ces paroles et s’en inspirer à chaque moment dans la lutte que nous menons contre l’organisation féroce des Sociétés capitalistes ; et puisque nous avons les enseignements et les expériences du passé pour nous guider, puisque ceux qui nous ont précédés sont morts pour que nous sachions, apprenons à nous conduire pour ne pas commettre les erreurs qui furent les causes déterminantes de leurs échecs.
Une demi-révolution est une demi-victoire et une demi-défaite. Le monde ne sera régénéré que lorsque la victoire sera complète, et tous ceux qui s’arrêtent en route peuvent être considérés comme faisant inconsciemment le jeu de la Contre-Révolution.
Reclus nous a enseigné que le communisme ne s’instaurera qu’à la suite d’une série d’évolutions et de révolutions qui se répèteront inévitablement, jusqu’au jour où la Société transformée ne fond en comble ne conservera plus aucune trace de la barbarie des sociétés à bases capitalistes. Or, l’histoire nous apprend que jamais les mouvements de révolte ne furent provoqués par les dirigeants du peuple et que tout gouvernement, ayant la charge de veiller à ce que l’ordre soit maintenu à l’intérieur de la Nation, est par essence conservateur et par force contre-révolutionnaire.
Jules Lemaître, dans une de ses œuvres intitulée : « Les Rois », nous présente un monarque à tendances socialistes, qui veut le bien de son peuple, travaille à lui apporter le bonheur et qui est conduit par la force des événements à faire fusiller ses sujets sous les fenêtres mêmes de son palais.
Le Roi de Jules Lemaître n’avait pas saisi l’incompatibilité qui existe entre le principe de liberté d’où doit jaillir le bien-être universel et le principe d’Autorité, qui donne naissance à tous les abus, à tous les travers, à toutes les iniquités dont peut se rendre coupable une société. Le Roi de Jules Lemaître, malgré ses sentiments et son désir de bien faire, ne pouvait être un révolutionnaire, mais un contre-révolutionnaire, parce que, attaché de par ses fonctions à maintenir dans sa forme un état de chose arbitraire, il était condamné à prendre position en faveur des forts au détriment des faibles. Tout Gouvernement à des époques indéterminées de sa vie se trouve dans la même position.
La Révolution n’aura accompli son œuvre, que lorsque tout Gouvernement, c’est-à-dire l’organisme autoritaire sous lequel il faut se courber, que ce soit au nom d’une majorité ou d’une minorité, deviendra une inutilité sociale, et le rôle du révolutionnaire ne peut donc pas être de soutenir un gouvernement mais de chercher à en amoindrir les effets nocifs.
Il est impossible de concevoir que dans une société qui se divise en classes et où la richesse existe à côté de la misère, un État ou un Gouvernement puisse se réclamer de la Révolution. Que les intentions des hommes qui sont à la tête de cet État soient louables, ce n’est pas ce qui importe ; ce qu’il faut regarder c’est si les actes de ces gouvernants ne s’opposent pas à la marche en avant de la Révolution.
Lorsqu’en 1923, l’Allemagne traversait une terrible crise économique et que le prolétariat était presque acculé à la famine, on demanda à un socialiste français ce qu’il ferait s’il avait la direction de l’État allemand, et il répondit par le vieux précepte latin « Primum vivere, deinde philosophari ». Le prolétariat, classe opprimée dans tous les pays, parce qu’il n’y a pas encore de pays d’où l’exploitation de l’homme par l’homme ait disparu, n’a pas d’autres possibilités pour vivre que d’exproprier les richesses sociales détenues en partie ou en totalité par le capitalisme et il n’appartient à personne de déterminer ou d’arrêter l’heure de la révolte.
Le peuple est révolutionnaire, non seulement par instinct, mais aussi parce qu’il souffre et qu’il arrive fatalement un moment où, las de servir de machine à exploiter, il se dresse contre ses maîtres et arrache violemment ce que ceux-ci ne veulent pas donner de bon gré, et en ces jours de révolte féconde tout ce qui ne se trouve pas du côté de l’affamé se place du côté de l’oppresseur.
Qu’importe la couleur, le titre, l’étiquette dont on se pare ; on est pour ou contre la révolte ; on est révolutionnaire ou contre-révolutionnaire. Il n’y a pas de milieu, en période révolutionnaire ; on ne peut pas vouloir un peu, il faut vouloir beaucoup ; la Révolution ne peut se mesurer à l’aune, comme une pièce de drap. Pour sortir victorieuse de la bataille il faut qu’elle efface à jamais toutes les erreurs du passé, sans quoi il faut la poursuivre et la continuer sur le terrain économique et non sur le terrain inculte de la politique.
La Contre-Révolution ? Ce sont tous ceux qui veulent arracher le flambeau des mains du peuple afin de conduire la classe ouvrière, comme un troupeau de moutons, vers des destinées inconnues ; ce sont tous les démagogues qui cherchent à se tailler des lauriers dans le sang des sacrifiés ; mais ce sont aussi tous les pacifistes bêlants, les sentimentaux et les humanitaires à fleur de peau ; les philosophes pour classe pauvre qui critiquent la violence et prêchent la passivité, et qui ne veulent pas comprendre que la violence organisée est la seule arme que possède le pauvre pour se défendre contre l’insolence et la violence des riches.
Quoi qu’on dise et quoi qu’on fasse, la Révolution est en marche et la Contre-Révolution sera écrasée. Certes, cela coûtera encore bien des larmes et bien du sang ; ce ne sont cependant pas les révolutionnaires qui peuvent en être rendus responsables ; ce sont ceux, au contraire, qui ne veulent rien faire pour que le monde change et qui rendent la tâche plus ardue.
« Quand on s’empiffre, alors qu’il y en a qui crèvent de faim ; lorsqu’on va bien vêtu, quand il y en a qui sont couverts de loques ; lorsqu’on a du superflu, quand il y en a qui, toute leur vie, ont manqué de tout, on est responsable des iniquités sociales puisqu’on en profite. » (Jean Grave : l’Anarchie, son but, ses moyens, p. 158.)
Marchons de l’avant. Nous avons raison puisque nous voulons le bonheur de l’Humanité et que tout ce qui nous entoure nous engage à joindre nos efforts pour prendre possession de ce qui nous appartient. La Contre-Révolution sera vaincue un jour, cela ne peut pas être autrement, et si nous ne profitons pas nous-mêmes des bienfaits de la Révolution, sachons au moins lutter en pensant que nous revivrons dans nos enfants et laissons leur un héritage plus grand que celui qui nous fut légué par nos ancêtres.
La semaille est jetée, les petits, les nôtres feront la récolte.
― J. CHAZOFF
CONTREBANDE
n. f.
Pour satisfaire aux appétits du capitalisme national, on a divisé le monde en contrées et on a établi entre elles des barrières que l’on ne peut franchir que sous certaines conditions. Il est interdit par la loi ou par certains décrets de transporter d’un pays à l’autre ou d’une ville à l’autre des marchandises prohibées par les règlements, non pas parce que ces marchandises sont impropres à la consommation ou aux besoins de la population, mais parce que leur importation nuirait aux intérêts d’une certaine catégorie de commerçants ou d’industriels. Ainsi que nous l’avons démontré lorsque nous avons traité de la concurrence (voir ce mot) la douane n’a d’autres buts que de garantir les bénéfices des dits commerçants et industriels et quiconque passe outre les règlements et introduit en fraude les produits interdits, fait de la contrebande.
Cependant, malgré les rigueurs de la loi, la contrebande se fait sur une grande échelle et ce qu’il y a de plus curieux, c’est que ce sont souvent des capitalistes et non des moindres, qui se livrent à ce trafic.
La bourgeoisie française ne se contente pas des bornes internationales, elle en a dressé à l’intérieur même du pays. Au sein même de la nation, toutes les villes ne sont pas régies par le même statut et il est interdit de transporter de l’une à l’autre certaines marchandises sans payer une redevance à la commune dans laquelle on importe cette marchandise. L’argent récolté sert à équilibrer les budgets communaux.
Il n’est donc pas surprenant qu’il y ait des gens se livrant à la contrebande.
À côté de cette contrebande commerciale il y a ce que l’on appelle la contrebande de guerre et en principe on considère comme entrant dans cette catégorie de contrebande tous les objets fabriqués à l’usage de la guerre : fusils, canons, munitions, et même les vivres lorsqu’il s’agit d’une place investie.
La contrebande entraîne la saisie des marchandises importées frauduleusement et l’emprisonnement pour le contrebandier. Pourtant les peines d’emprisonnement ne sont en réalité appliquées en matière de contrebande de guerre que lorsque ce sont des révolutionnaires qui cherchent à se procurer des moyens de défense ; lorsque ce sont les éléments bourgeois et réactionnaires qui vont à l’étranger pour acheter des armes et les introduire dans le pays dans le but de s’en servir contre la classa ouvrière, ils bénéficient toujours de l’indulgence des tribunaux et de la magistrature, Cela se comprend.
CONTREMAITRE
n. m.
Personne qui dirige les ouvriers et les ouvrières dans un atelier ou un chantier « dit le Larousse ». Cette définition est fausse. Le contremaitre est un valet inconscient de la bourgeoisie, qui, issu de la classe ouvrière, trahit ses camarades et se met au service de ses oppresseurs.
Il y a des besognes secondaires que le bourgeois ne veut pas faire lui-même et des contacts auxquels il se refuse. Pour maintenir entre lui et son personnel, les relations indispensables à la marche de ses affaires, le capitaliste a recours à un intermédiaire auquel il accorde quelques avantages, en échange de quoi cet intermédiaire se soumet de plein gré à l’autorité patronale et consent à veiller et à surveiller ses camarades de façon à ce qu’ils ne piétinent pas les intérêts du maître. Cet intermédiaire est le contremaitre, c’est-à-dire « à côté du maître ». Il est encore des prolétaires qui s’illusionnent sur les fonctions de ce chien couchant et qui assurent qu’il se trouve de bons contremaitres ; c’est que l’ouvrier ne se rend pas compte du rôle qu’est obligé de jouer le représentant du patron.
Un bon contremaitre est impossible ; si ses services ne sont pas avantageux pour celui qui l’emploie, il ne tarde pas à être remercié ou être remis au même niveau que ses anciens camarades, et s’il veut conserver sa place et conserver la confiance de son patron, il est alors obligé de défendre des intérêts qui sont diamétralement opposés à ceux de l’ouvrier.
En conséquence, le contremaitre ne peut être qu’un agent inférieur de la bourgeoisie, et il est d’autant plus méprisable lorsqu’il agit consciemment, qu’il se dresse de façon continue entre le patron et l’ouvrier et empêche ce dernier d’acquérir le bien-être et la liberté auxquels il a droit.
CONTROLE OUVRIER (LE)
n. m.
Le contrôle ouvrier (ou plus exactement contrôle syndical de la production), est une action permanente menée par la classe ouvrière, sur le lieu même du travail, pour permettre à celle-ci de se rendre compte, aussi exactement que possible, du fonctionnement intérieur et détaillé des entreprises industrielles et commerciales ou des Exploitations de l’État, pour en tirer le meilleur profit en faveur de l’action multiple du prolétariat.
Par le Contrôle exercé par ses divers organismes, la classe ouvrière peut pénétrer les secrets des fabrications, connaître les moyens d’approvisionnement en matières premières, le coût de ces matières, le prix de revient, l’évaluation des frais généraux, le prix de vente, les bénéfices approximatifs, les formes de l’écoulement du produit fini, la valeur du salaire qui peut être revendiqué, etc...
Les organes du Contrôle sont les sentinelles avancées du prolétariat dans la forteresse capitaliste. Leur puissance doit s’intensifier chaque jour et la poussée qu’ils exercent doit être telle que les œuvres de défense bourgeoise soient attaquées sans cesse plus fortement, plus intelligemment, plus objectivement, afin d’accentuer le recul des forces du capital et l’avance tenace, méthodique et permanente des forces ouvrières.
Ces divers organismes d’action, de pénétration, sont en fait, les embryons des sociétés anonymes ouvrières gérées par les Syndicats, qui remplaceront les Sociétés anonymes capitalistes, gérées par les Conseils d’administration actuels. L’idée du Contrôle ouvrier de la production est déjà ancienne. Elle prit naissance en Allemagne. On en trouve trace dans une proposition que Bebel fit en 1877, au Reichstag, pour demander la création des Chambres industrielles, dont le rôle eût consisté à garantir les intérêts de l’industriel et du travailleur, à transmettre aux autorités des compte rendus et des propositions. Ces organismes, sans contact direct avec les usines, devaient être formés en parties égales de patrons et d’ouvriers. C’était déjà l’idée qui fut reprise un peu partout, pendant la guerre de 1914–1918, par les démocrates de tous les pays. C’est celle que tendent à réaliser les patrons démocrates avec le concours des Syndicats réformistes par la collaboration de classe constante dans tous les domaines.
Ce projet fut complété en 188–86 par Auer qui lui conserva son caractère paritaire. Il se borna à adjoindre aux Chambres du Travail (Arbeitskammeren) qu’il voulait voir fonctionner dans chaque localité importante des Bureaux du travail (Arbeitsämter) dans les districts de 200 à 400.000 habitants et, à la tête de cette hiérarchie sociale, un Bureau d’Empire du Travail (Reichsarbeitsamt).
La Commission plénière du Reichstag repoussa le projet qui ne fut même pas discuté par l’Assemblée. On voit que par sa constitution, il ressemblait déjà beaucoup à cette institution du Traité de Versailles, titre XIII : le Bureau International du Travail.
L’étude du projet marqua un fort temps d’arrêt. Ce n’est qu’après l’abolition des lois d’exceptions bismarckiennes que le problème redevint actuel, lorsque l’ouvrier comprit enfin les liens étroits qui l’unissaient à la production, vers 1890.
De nombreux projets furent déposés de 1890 à 1914, après que l’édit impérial de 1891 eut vaguement promis que ”pour favoriser la paix sociale, entre patrons et ouvriers, on examinerait les moyens de faire collaborer des représentants investis de la confiance des ouvriers au règlement des questions communes”. Cette promesse fut l’objet d’un amendement au code industriel (Gezverbeordnungsnovelle 1891), qui obligeait les patrons à afficher dans leurs usines un règlement de travail (Arbeitsordung) et qui prévoyait la création de Comités ouvriers permanents, chargés d’en surveiller l’application.
Toutefois, les pouvoirs de ces Comités ouvriers étaient en fait, très limités. Ils n’étaient d’ailleurs pas obligatoires. La loi de 1891 faisait de ces Conseils des organes facultatifs, qu’elle se garda bien de reconnaître comme la représentation accréditée du prolétariat dans l’usine.
Malgré tout, l’idée fit son chemin. Les Comités se multiplièrent rapidement, malgré la mauvaise volonté du patronat et l’opposition du gouvernement. En 1891, en application du programme d’Erfurt, un nouveau projet social-démocrate fut déposé. Les syndicats chrétiens, fondés en 1894, prirent, eux aussi, position. Leur porte parole, le député du centre Hitze, demanda qu’à côté des Chambres patronales de commerce, d’industrie et d’agriculture, des Chambres ouvrières de même nature fussent créées. Il proposa en outre que les Comités d’ouvriers constitués en 1891 fussent déclarés obligatoires. A plusieurs reprises, en 1895 et 1898, il renouvela son intervention, mais sans succès. Puis les social-démocrates reprirent la bataille. En 1898–99, Pachnieke et Rosicke demandèrent à nouveau la création d’un Bureau d’Empire du Travail.
Les nationaux-libéraux eux-mêmes, protecteurs attitrés de la grande industrie, qui sentaient tout ce que portait en puissance cette institution des Comités ouvriers, cherchèrent à canaliser, par voie de légalisation appropriée, la force qui se dégageait et devenait chaque jour plus menaçante en raison du caractère de lutte sociale qu’ils voyaient déjà se dessiner.
Leur chef, Bassermann, soutint un projet qui étendait la compétence des tribunaux industriels (Gewerbegerichte) et qui leur rattachait les Chambres du Travail, où seraient admis les délégués des ouvriers.
La loi prussienne sur l’industrie minière, du 14 juillet 1905, bien qu’elle les maintînt dans un rôle restreint, décréta que les Comités d’ouvriers seraient obligatoires. Les délégués à ces Comités étaient élus dans toutes les entreprises comptant au moins 100 membres, afin de formuler les revendications, de surveiller l’application des règlements du travail, et le fonctionnement des institutions de prévoyance. Ils nommaient des délégués spéciaux (Sie erheiitsmiauner) également élus par les ouvriers, qui étaient chargés de l’inspection régulière de la mine. Il en fut d’ailleurs de même en France, pour ces délégués.
En 1905, les syndicats libres socialistes, décidèrent d’élargir le débat. Les Comités formés dans les mines et les autres industries n’avaient que des attributions limitées. Tout un ensemble de questions générales du travail leur échappait par trop.
Les forces s’éparpillaient au lieu de se concentrer.
Les Comités, sans, liaison entre eux, devenaient esclaves de l’esprit local qui les divisait et risquait de les opposer les uns aux autres.
C’est alors que les syndicats reprirent à leur compte les anciens plans de la social démocratie et voulurent confier à des Chambres syndicales la représentation légale de la classe ouvrière et le soin d’ordonner et de centraliser les problèmes du travail.
Mais ils modifièrent radicalement les projets d’autrefois, en abandonnant au Congrès de Cologne (1905) le principe des Chambres mixtes. Sur la proposition d’Otto Hue, ils décidèrent de réclamer des représentations purement ouvrières, analogues aux Chambres de commerce patronales.
Les syndicats et le parti social-démocrate soutinrent ce projet pendant trois années. En 1908, le gouvernement d’Empire se résolut à élaborer un projet qui était loin de donner satisfaction aux ouvriers. Ce projet erra de commission en commission, tour à tour amendé et rejeté par le gouvernement et les partis. Il fut définitivement abandonné en 1911. Aucun effort ne fut tenté pour le réaliser jusqu’en 1914, au moment du déclenchement de la guerre.
Les seules représentations légales qui existaient à ce moment étaient les Comités prévus par le code industriel de 1891 et la loi minière de 1895.
En somme, les industriels avaient, avec le concours du gouvernement, habilement détourné de leur but les Conseils d’Entreprises dont ils sentaient déjà toute l’importance.
Non seulement ils rejetèrent ainsi les Comités exclusivement ouvriers, mais ils refusèrent de laisser former les Comités paritaires qui leur apparaissaient comme une étape à laquelle ne s’arrêteraient pas longtemps les ouvriers allemands.
En raison de la durée de la guerre, pour obtenir un rendement intensif et se concilier les bonnes grâces des états-majors ouvriers, dont la puissance devenait considérable, le gouvernement impérial, sous la pression de la social-démocratie, jugea indispensable de donner au prolétariat de l’industrie, des satisfactions plus précises.
C’est ainsi, lorsque le gouvernement mobilisa toute la main d’œuvre civile, qu’il unit à ses exigences, des concessions qui furent, cette fois-ci, bien accueillies par les syndicats.
La loi du 5 décembre 1916 institua en effet les Comités ouvriers obligatoires dans toute entreprise comptant plus de cinquante personnes. Les employés obtinrent une représentation analogue (Angestellienausschüsse). Les attributions conférées par le code de 1891 furent élargies et étendues, notamment à la règlementation des salaires.
La guerre persistant, le gouvernement, toujours conseillé par les social-démocrates, décida de calmer les inquiétudes des travailleurs en élargissant la loi de 1916, c’était en 1917. En 1918, la grande grève des métallurgistes de Berlin obligea le gouvernement à hâter le dépôt du projet qui fut soumis au Reichstag le 4 mai 1918 par le Comte Hertling. La déception fut grande. En effet, étaient exclus de ce projet : les ouvriers agricoles, les ouvriers et employés d’État. En fait, on avait compartimenté les ouvriers pour les dresser les uns contre les autres.
La Commission du Reichstag amenda ce projet qui ne fut pas voté. La révolution survenant le rendit inutile.
La période des tâtonnements ouvriers, des essais de constitution d’organismes paritaires en vue d’assurer la collaboration permanente des classes était terminée en Allemagne.
Telle est l’origine des Comités d’ouvriers et des Conseils d’usine. En France, en 1916–18 des Comités analogues ont fonctionné sous la direction d’Albert Thomas.
Des centres, tels que Bourges, Decazeville, Saint-Étienne, Paris, secouèrent la tutelle qui leur était imposée. De grands mouvements eurent lieu à cette époque chez les métallurgistes en vue d’appliquer le vrai contrôle ouvrier. Ils allèrent, comme à Decazeville, jusqu’à la prise des instruments de production (mines, hauts fourneaux, laminoirs) qui permirent aux ouvriers de se rendre compte de leur aptitude à organiser et à gérer la production.
L’idée des Conseils ouvriers fera son chemin en dépit de toutes les déviations qu’elle pourra encore subir. En Italie, lors de la prise des usines de Milan et de Turin, les Conseils d’usine et les Comités d’ateliers firent un grand pas. Si ce mouvement n’avait pas été trahi, il n’est pas douteux qu’en 19–21, il eût permis à nos camarades italiens, sinon de triompher, du moins de faire une expérience du plus haut intérêt.
En Russie, les Conseils d’ouvriers jouèrent un rôle de premier plan. Ils furent l’âme de la révolution de novembre 1917. Malheureusement, dans ce pays où le syndicalisme n’existait pas, pour ainsi dire ; ils furent, de même que les syndicats, constitués par le gouvernement, bientôt asservis par ce dernier.
Les scandales auxquels les élections des délégués donnèrent lieu furent innombrables et inimaginables. Le gouvernement n’acceptait les résultats de ces élections qu’autant que ses candidats étaient élus. S’il en était autrement, il annulait purement et simplement les élections, jusqu’à ce qu’il ait satisfaction. Il n’hésitait d’ailleurs pas à déporter ou emprisonner les délégués élus qui ne souscrivaient pas à sa politique de parti.
Aujourd’hui, en Russie, les Comités ouvriers, les Conseils d’usines sont devenus, comme les syndicats, des organes du Pouvoir nouveau. C’est toujours le système de la collaboration et le contrôle ouvrier ne s’exerce pas pour
En Allemagne, les Conseils d’usine ont pris quelque ampleur nouvelle lors de l’occupation de la Ruhr. Les Conseils d’usine de Rhénanie, de Westphalie, notamment, jouèrent un rôle important aux conférences d’Essen et de Francfort, sous la direction du Parti Comité directeur du Parti communiste allemand et de l’Exécutif de l’Internationale Communiste et de l’I.S.R.
La conférence de Chemnitz, après l’échec de l’essai de prise du pouvoir de Saxe, marqua le point culminant de leur action qui prit fin après les tragiques événements de Hambourg et la disparition des gouvernements partiellement ouvriers de Saxe et de Thuringe.
Il faudrait pouvoir étudier complètement toute l’histoire des Conseils d’usine et du Contrôle ouvrier en Allemagne pour arriver à donner l’idée exacte du contrôle ouvrier. Les Rate ou Conseils d’usines ont joué un rôle essentiel au cours de la Révolution de 1918. Les Spartakistes, soutenus par Daümig et Richard Müller avaient lancé le mot d’ordre suivant : Tout le pouvoir aux Räte. Haase et quelques indépendants cherchèrent une formule de transaction et déclarèrent qu’il ne fallait point poser le dilemme : ou bien “Ratasystem ou bien système parlementaire mais, au contraire, chercher à concilier les deux systèmes.
C’est ainsi que le Wollsugsrat ou organe central des Conseils d’usines se vit enlever ses pouvoirs législatifs et exécutifs qui furent confiés au Conseil des six commissaires du Peuple : Ebert, Scheidemann, Landsberg (socialistes majoritaires),Hanse, Ditfmann et Barth (socialistes indépendants).
Un Comité central fut nommé (Zentrahrat). Il eut : autorité sur tous les Conseils d’usines d’Allemagne, mais, en fait, il n’était guère efficient qu’à Berlin où il surveillait les Commissaires du Peuple.
Aussitôt la réunion de Weimar qui vota la nouvelle constitution, eu février 1919, Scheidemann, président du Conseil etLegien déclarèrent les Conseils d’usine superflus. Ils étaient — et on le conçoit — un obstacle à l’exercice du pouvoir de l’État et devaient disparaître. Des luttes violentes eurent lieu, et en février 1918, à. la suite de la grève de Berlin, le gouvernement dut céder. Il fut décidé que les Conseils d’usines auraient existence légale. Cette existence fut confirmée en avril 1918 lorsque Munich était aux mains des Conseils.
C’est alors qu’on commença à discuter sur ce que serait le contrôle ouvrier de la production.
Tandis que Haase louvoyait, Daümig et Müller déclaraient que les Conseils d’usines devraient avoir la maîtrise économique complète, contrôler la production, étudier la socialisation de l’industrie.
Wisel, social-démocrate, s’opposa à cette conception. Il voulait revenir à la collaboration des ouvriers et des patrons et établir le Bureau et le Conseil du Travail que les social-démocrates réclamaient déjà avant la guerre, tout en limitant le rôle des Conseils à une besogne secondaire.
Les syndicalistes comprirent qu’ils avaient été dupés par les politiciens et au Congrès de Nuremberg (4 juillet 1919), ils rédigèrent un code du travail qui déclarait : D’accord avec les syndicats, les Conseils d’entreprise réaliseront la démocratie dans l’usine. Le fondement de cette démocratie est le contrat collectif de travail sanctionné juridiquement et ayant force de loi.
Le Conseil d’entreprise réglait, d’accord avec le patron, l’hygiène, l’assurance, l’emploi des femmes, des enfants, des apprentis, la durée du travail, les salaires, le travail à la tâche, les congés, solutionnait les conflits. Cette résolution de Nuremberg ne fut pas acceptée par l’Assemblée nationale, du moins entièrement. Elle donna naissance à l’article 34, puis 165 de la Constitution définitive qui constituait le Conseil économique d’Empire et instituait obligatoirement les Conseils d’entreprises, les Conseils de districts et le Conseil d’Empire.
C’était un compromis entre l’économie rationnelle ( ?) de Wissel et les projets des syndicats. Le statut réel de ces organismes n’est pas encore complètement fixé et on ne sait encore quel sera le rôle politique et le caractère économique des Conseils d’Entreprises, pas plus qu’on ne conçoit exactement et de quelles façon s’exercera leur action de contrôle. La loi du 4 février qui sanctionne l’existence des Conseils d’Entreprises fixe bien leur statut, mais elle a été tellement remaniée qu’il est, en fait, impossible de déterminer la valeur exacte, politique et économique, de cette institution.
Ce qu’on peut dire, c’est que les Conseils d’Entreprises se sont vus retirer tous les pouvoirs qui faisaient leur force en 1918 et que, comme en Russie, ils ne sont plus que des rouages étatiques, à part quelques-uns qui essaient de réagir sous l’action des syndicalistes anarchistes et des communistes.
Leur réveil, en 1923, fut de courte durée et ils semblent se stabiliser sur le plan démocratique.
En France, l’idée n’a fait que peu de chemin, en dépit de la propagande faite et des projets établis depuis 1920. Les tentatives d’établissement du Contrôle ouvrier, au sens propre du mot ont réellement échoué en présence d’un patronat fortement organisé qui n’a pu être entamé nulle part en raison des divisions ouvrières.
Quelles que soient les difficultés à vaincre, quelque indifférence qu’éprouve encore pour le Contrôle ouvrier un prolétariat qui ne le comprend pas, n’en saisit ni la portée exacte, ni la valeur réelle, il faut cependant réaliser entièrement cette revendication, la plus complète du prolétariat, puisqu’elle va de l’éducation du producteur jusqu’à la gestion des Entreprises.
Il faut d’abord tenter d’en fixer le caractère actuel, d’en déterminer les formes, d’en indiquer les moyens, en formuler les buts et constituer les organismes qui en assureront le fonctionnement.
C’est ce que je vais tenter de faire pour permettre d’œuvrer immédiatement.
Organisation pratique et immédiate du contrôle ouvrier
Pour prévoir par quelles modalités le “Contrôle Ouvrier” peut être institué dans les entreprises, il convient, au préalable, de fixer d’une part le but général du contrôle et, d’autre part, les objectifs immédiats à atteindre.
Il découle des directives du Mouvement Syndical que le contrôle ouvrier doit aboutir à la gestion des entreprises par les travailleurs.
Dans l’atelier, l’organe de contrôle doit donc permettre de constituer la cellule primaire de la nouvelle organisation de la production.
En conséquence, ce contrôle sera établi de façon à permettre aux travailleurs ouvriers, employés, techniciens, de prendre en mains le cas échéant, la gestion de la production.
Mais, dans ce but, une condition préalable est à remplir, c’est d’assurer l’éducation des travailleurs pour les mettre à même de faire face à cette tâche. Le contrôle devra donc, en premier lieu, être constitué pour permettre à la classe des travailleurs de faire son éducation de “ gestionnaire ”.
Le but général du contrôle est double : 1°) Éduquer les salariés, et l’ouvrier en particulier, dans le but de leur faire connaître les rouages de la production ; 2°) Permettre aux travailleurs de prendre en mains, en connaissance de cause, la gestion de la production, quand les circonstances le permettront.
Quels sont, d’autre part, les objectifs immédiats à atteindre par le contrôle ouvrier ?
Ces objectifs doivent tendre à intéresser l’ouvrier au Contrôle, en lui faisant éprouver un intérêt à revendiquer cette institution. Son fonctionnement, par conséquent, permettra de poursuivre en connaissance de cause la réalisation des revendications des travailleurs. Ses avantages résident dans le contrôle par le travailleur, de l’emploi de son travail à tous les points de vue. L’installation du Contrôle permettra, non seulement de revendiquer un salaire normal, mais encore d’acquérir la capacité de gestion.
Ces conditions générales étant fixées, il faut :
-
Déterminer la nature des organes du contrôle ouvrier ;
-
Etablir leur constitution ;
-
Fixer leurs attributions ;
-
Préciser, la coordination des divers organes de contrôle entre eux ;
-
Examiner leurs liens avec l’organisation syndicale d’une part, avec le patronat d’autre part.
1. Organes du contrôle ouvrier
Pour être efficace, tant au point de vue éducatif que pour les buts finaux à atteindre, le contrôle ouvrier doit être institué dans chaque cellule de la production. Par conséquent, chaque atelier doit être “ contrôlé ”, ce qui oblige à créer un organe de contrôle dans chaque service de l’atelier : service technique et service administratif.
Ce contrôle doit-il être institué par atelier constitué ou par fabrication ?
II semble plus rationnel, tant au point de vue de la facilité du contrôle que de l’efficacité de l’éducation pratique des ouvriers, d’établir le contrôle par fabrication. Prenons comme exemple l’atelier mécanique d’une usine de constructions de matériel électrique comprenant : forge, fonderie, atelier mécanique, bobinage, ajustage, montage, peinture.
La question pratique qui se pose est de savoir si, dans chaque atelier, le contrôle s’effectuera globalement pour l’ensemble des fabrications confiées à cet atelier (travail des machines, pointage, comptabilité, prix de revient), chaque contrôleur d’atelier se mettant en liaison avec le contrôleur de l’atelier voisin, pour suivre la marche des diverses fabrications, ou bien si, au contraire, dans l’usine, le contrôle se fera par fabrication.
Par exemple, pour la fabrication de moteurs électriques ; devra-t-on, dans l’atelier mécanique, organiser te contrôle en vue de suivre séparément le travail des pièces de chaque type de moteur confié à cet atelier ; puis garder la liaison avec l’atelier d’où sortent ces pièces et avec l’atelier où elles vont après l’atelier mécanique, ou bien, devra-t-on faire suivre globalement par le contrôleur de l’acier mécanique, l’ensemble des fabrications de cet atelier : moteurs de types divers, etc.., ?
La constitution des organes de contrôle sera différente suivant que l’on adoptera l’un ou l’autre de ces points de vue.
En effet, dans le cas du contrôle général s’appliquant à toutes les fabrications de l’atelier, l’ouvrier qui en sera chargé devra suivre toutes les opérations dans l’atelier : techniques et administratives. Dans les ateliers importants, il lui sera extrêmement difficile, n’étant pas au courant des directives données par le Directeur de l’usine, de démêler l’organisation du travail. De .plus, son temps sera extrêmement absorbé par ce contrôle ; il doublera à la fois le contremaître et le pointeur. Cette situation entraînera la nécessité d’obtenir du patronat l’acceptation de distraire un ouvrier de son travail à titre permanent. Il n’est pas besoin d’insister sur les difficultés de toutes sortes que pourrait entraîner une pareille revendication.
Au contraire, si le contrôle est fait par fabrication, il peut être institué, par atelier, plusieurs contrôleurs qui, tout eneffectuant leur travail, pourront suivre la marche des opérations d’un atelier à l’autre, en liaison avec les contrôleurs de la même fabrication dans les ateliers voisins.
II suffira que les contrôleurs aient connaissance de la distribution du travail dans l’atelier, c’est-à-dire qu’ils soient aidés par les employés chargés de la comptabilité de l’atelier.
Et c’est ici qu’apparaît toute la valeur économique du contrôle par fabrication. Ce contrôle permettra facilement de connaître le prix de revient de la fabrication, clef de la forteresse patronale.
Possesseurs du prix de revient, les travailleurs auront en mains les données du problème des prix. Ils sauront exactement de quelle façon leur travail est “exploité“, ils connaîtront également dans quelles mesures leurs salaires peuvent être modifiés. Enfin, ils pourront asseoir leur instruction économique et acquérir la. notion de “possibilité” qui, parfois, leur fait défaut.
****** 2. Constitution des organes de contrôle
Dans ces conditions, les organes de contrôle seront constitués par un certain nombre de contrôleurs choisis dans chaque atelier et affectés à une fabrication donnée ou, plus exactement, à l’exécution d’une “ commande ”.
Les contrôleurs des divers ateliers affectés à la même fabrication se réuniront pour confronter leurs renseignements.
En conséquence, on peut envisager dans chaque entreprise, la création de l’organisme de contrôle de la façon suivante :
-
Un Comité général du contrôle, composé de 4 à 16 membres, suivant l’importance de l’entreprise, désignés par le Syndicat sur une liste élue par l’Assemblée des ouvriers, des employés et techniciens de l’entreprise.
-
Un certain nombre de contrôleurs, désignés par le Comité général, par atelier, pour chaque fabrication ou pour des contrôles spéciaux.
-
Des commissions de détermination des prix de revient, constituées par commande par la réunion des contrôleurs de fabrication de cette commande.
-
Des commissions de “ contrôles spéciaux ”, constituées par des contrôleurs spéciaux (embauchage, débauchage, hygiène, conflit).
-
Des délégués d’atelier nommés par les ouvriers, employés et techniciens des ateliers, délégués effectuant la liaison entre les travailleurs et le Comité général dans l’intervalle des Assemblées générales des Travailleurs de l’Entreprise.
3. Attribution des organes de contrôle
-
Assemblée générale des Travailleurs de l’Entreprise. Cette Assemblée aura pour attribution de désigner les travailleurs parmi lesquels le Syndicat choisira les membres du Comité général du contrôle.
Elle pourra révoquer ces membres dans des conditions à déterminer.
-
Assemblée des travailleurs par atelier. Elle aura pour mission de nommer le ou les délégués d’atelier chargés d’effectuer la liaison entre les travailleurs de l’atelier et le Comité général.
-
Comité général. Il aura tous pouvoirs pour organiser le contrôle, notamment pour nommer les contrôleurs, leur fixer leurs attributions, leur donner toutes les instructions, assurer la liaison et la coordination de leurs fonctions. Ces attributions seraient à préciser dans le détail, une fois le cadre général du présent projet accepté. La Commission technique locale pourra établir un projet d’attributions détaillé pour chaque sorte d’industrie.
Le Comité général assurera la liaison avec le Syndicat pour toutes les questions syndicales et d’organisation générale. A cet effet, il sera, dans l’entreprise, le représentant du Syndicat.
-
Contrôleurs. Ces contrôleurs n’auront qu’une besogne technique fixée par le Comité général. Ils recueilleront les renseignements relatifs à l’organisation du travail, des fabrications, à la comptabilité (prix de revient), matières premières, main-d’œuvre, frais généraux.
Une étude détaillée de ces fonctions pour les divers services des usines et entreprises devrait être faite par la Commission locale d’études, à l’effet d’aboutir à un règlement général applicable aux usines ou entreprises.
-
Commissions de contrôleurs. (Prix de revient). Le nombre des Commissions et leurs attributions sera fixé par le Comité général. Une instruction générale serait à établir, après étude par la Commission, montrant quel serait le rôle de coordination .de ces Commissions, dans un but technique, administratif et économique.
Ces Commissions doivent jouer, vis-à-vis du Comité général (étant lui-même la direction “en puissance” de l’entreprise), le rôle des divers services actuels des entreprises, par rapport à la direction générale.
Dans chaque cas particulier, ces Commissions devront donc être constituées en vue de pouvoir assurer, le cas échéant, la direction des services de l’entreprise ; c’est dans ce but qu’elles doivent connaître exactement, par les contrôleurs qui les composent, la situation technique et économique de chaque fabrication.
Leur tâche principale sera de déterminer le prix de revient de fabrication, sinon dans le détail, tout au moins dans ses éléments principaux : quantité de travail, quantité de matières.
-
Commissions spéciales. Seul, le Comité général peut ; dans chaque cas, déterminer le nombre et les attributions de Commissions, composées de contrôleurs nommés par lui. En principe, ces Commissions auront’ pour attributions : l’embauchage, le débauchage et les conflits.
Il y a lieu d’examiner s’il ne serait pas préférable de choisir les membres de ces Commissions parmi les délégués d’atelier, le choix étant fait par le Comité général.
-
Délégués d’atelier. Le délégué d’atelier aura pour mission la liaison entre les travailleurs de l’atelier et le Comité général, pour toutes les questions concernant l’atelier.
L’Assemblée des délégués sera, en outre, chargée de contrôler le Comité général. Le délégué d’atelier a donc un rôle limité strictement à la liaison avec les travailleurs et au contrôle de l’activité du Comité général, des Commissions de contrôleurs.
4. Coordination des organes de contrôle
Les divers organes de contrôle, dont les attributions ont été énumérées ci-dessus, doivent se pénétrer qu’ils constituent la “ Direction en puissance ” de l’entreprise.
Ils devront, dans leurs rapports, s’inspirer des méthodes de coordination et de liaison des divers services des usines.
Les Comités généraux des entreprises auront donc besoin d’étudier ces méthodes en détail. A cet effet, des conférences leur seront faites dans les centres industriels, par les techniciens qualifiés.
La liaison des organes s’établira automatiquement, par suite de la nécessité de collecter les renseignements puisés par les divers contrôleurs. En outre, des réunions plénières entre les Commissions et le Comité général, permettront de dégager l’ensemble de l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise.
5. Liaison avec les organisations syndicales et le patronat
Il a été spécifié que le Comité général sera, dans l’entreprise, le délégué du Syndicat. Cette fonction pourra d’autant mieux s’établir que les membres du Comité général seront choisis par le Syndicat.
Le Syndicat fixera donc la politique générale que doit suivre le Comité.
Dans le cadre actuel, le Comité sera donc dans l’entreprise l’organe d’exécution des décisions du Syndicat ; dans le cadre futur, il sera l’organe d’exécution des décisions de la D. G. E. N. (Direction générale de l’Economie nationale).
En ce qui concerne la liaison avec le patronat, elle sera assurée, pour les questions spéciales à l’entreprise, par le Comité général et, pour toutes les questions intéressant un ensemble d’entreprises, par les organismes syndicaux, discutant toujours de puissance à puissance.
Cette discrimination des attributions sera à faire par la C. G. T., en vue de l’établissement du règlement général du contrôle.
Conclusion
Sur le papier, cette organisation peut paraître complexe. — En pratique, elle sera très simple. Dans une entreprise comptant 500 ouvriers, par exemple, le Comité général pourrait comprendre 5 membres. Dès sa nomination, il s’enquerrait par l’intermédiaire des employés ou des techniciens syndiqués, des commandes en exécution.
Dans chaque atelier, il désignerait un employé et un ouvrier de l’atelier, chargés de suivre dans cet atelier l’exécution de chaque commande, c’est-à-dire qu’il ferait noter le nombre total d’heures de travail affectées à la commande, le nombre de pièces venant d’un autre atelier et les matières premières employées, ainsi que le nombre et la nature des pièces allant à l’atelier suivant. A chaque fin de journée, ces renseignements peuvent être pris sur les livres des pointeurs, dans l’atelier même.
Les contrôleurs de chaque fabrication des divers ateliers se réuniraient périodiquement, désigneraient un secrétaire collectionnant ces renseignements, pour obtenir le prix de revient approximatif. Ce travail exigera peu de temps. Il pourrait être effectué sans difficulté par un ouvrier intelligent, à qui des instructions précises seront données.
L’institution du contrôle permettra de former rapidement des cadres ouvriers, connaissant le fonctionnement administratif de l’entreprise.
Le gros effort à faire est d’assurer l’éducation des Comités généraux, une fois nommés. A cet effet, des tournées de conférences seront instituées pour commenter le règlement à établir.
Enfin, on remarquera qu’il n’est pas question, dans cette organisation du contrôle ouvrier, de réclamer actuellement une part de gestion au bénéfice du Syndicat. Outre que cette part de gestion ne pourrait pas être obtenue du patronat, ce qui vouerait à l’échec le succès de la revendication et en désintéresserait les ouvriers, cette revendication serait le prétexte du refus du contrôle.
En se bornant à la constitution des organes de contrôle, ce qui peut être réalisé en dehors de tout accord passé avec le patronat, on peut exercer pratiquement et effectivement le contrôle de la production indépendamment du patronat.
En cas de résistance patronale — ce qui ne peut manquer de se produire — il y aura, sur ces bases, une belle propagande à organiser.
Ce projet fut exposé au Congrès Confédéral de Lille, en juillet 1921, par le Comité Central des Syndicalistes révolutionnaires français. Bien qu’il ait fait l’objet d’une propagande active, il n’a pas encore été compris et moins encore appliqué. Tel apparaît être le cadre dans lequel les ouvriers devraient s’efforcer d’agir avec méthode et persévérance dans le domaine immédiat.
L’organisation du Contrôle ouvrier qui, par le succès de la Révolution, deviendrait celte du Contrôle de la production serait, on le conçoit, sensiblement différente. Il ne s’agit plus, en effet, de surveiller, de comprendre la gestion capitaliste, mais, pour la classe ouvrière, de gérer elle-même.
Il serait sans doute prétentieux dans les circonstances actuelles, d’en tracer le schéma détaillé. Toutefois, il n’est nullement impossible d’en envisager les bases générales. Il est même nécessaire que cela soit fait, si on ne veut pas laisser au hasard le soin de faire cette besogne et peut-être, hélas ! risquer de compromettre le succès par des improvisations hâtives et désordonnées.
Dès maintenant, la première besogne à accomplir consiste à faire comprendre la valeur exacte du Contrôle, à constituer et à faire agir les organismes de ce Contrôle, qui seront, je le répète, les embryons du Contrôle de la production.
Si toute cette préparation morale et matérielle s’effectue normalement, la classe ouvrière sera à pied d’œuvre pour assumer les responsabilités de la gestion avec succès, le moment venu.
Tout de suite, disons que le Contrôle de la production devra s’exercer sous le contrôle des syndicats. Pourquoi ? parce que seuls les syndicats, force organisée de la Révolution, pourraient, sans déviation, pousser l’activité humaine vers les fins souhaitées. Si ce contrôle leur échappait, ce serait faciliter les entreprises que la contre-révolution ne manquera pas de tenter. Vouloir donner, comme en Allemagne et en Russie, tout le pouvoir aux Conseils d’Usines comprenant une très forte proportion d’inorganisés susceptibles de faire dévier la révolution de sa ligne droite, c’est courir une grave aventure, risquer un gros péril.
Si, en Russie, il y eut accaparement des Conseils d’Usines par le gouvernement, c’est précisément que les syndicats étaient ou inexistants ou pIacés dans la main du gouvernement.
Et puis, lorsqu’il y a plusieurs usines de la même industrie dans une même localité, il doit y avoir coordination dans la production, l’approvisionnement, l’écoulement des produits. Tout cela ne peut être réglé que par le Syndicat d’industrie, centre de coordination des Conseils d’Usines.
Est-ce à dire qu’il faille écarter des Conseils d’Usines les inorganisés, les sans-parti ? Non. Au contraire, la participation des inorganisés à ces Conseils leur fera comprendre la nécessité du groupement, elle en fera des propagandistes de premier ordre pour les syndicats.
J’ai dit, au cours de cet exposé que les Conseils ouvriers devraient remplacer des Conseils d’administration capitalistes actuels. Il faut donc concevoir une organisation qui permette d’atteindre ce but, sans laquelle toute gestion est impossible.
Pour cela, il est nécessaire de prévoir une organisation technique et une forme de gestion capables de jouer le rôle des Conseils capitalistes sur ce plan nouveau.
II semble bien que l’organisation technique doive trouver sa base dans l’atelier et que l’organisme de doive être composé des militants les plus aptes à assurer ce rôle, quelle que soit leur spécialité.
Donc, l’administration de l’usine doit reposer sur deux groupements essentiels les Comités d’Ateliers qui forment le Conseil technique et les Conseils d’Usine spécifiquement chargés de l’organisation générale de l’usine : approvisionnement, production, échange sous la direction d’un Conseil de gestion restreint formé des représentants des Comités d’ateliers et des Conseils d’usines, fonctionnant lui-même suivant les décisions et sous le Contrôle du syndicat d’industrie et de l’Union locale.
Une telle organisation, dont il n’est pas nécessaire de fixer le rôle dans le détail, assurera à l’ordre nouveau un maximum de souplesse et d’efficacité d’action toujours contrôlé, ce qui est indispensable pour qu’on ne s’écarte à aucun moment de la doctrine révolutionnaire pour que les conquêtes du prolétariat soient constantes.
En dehors de ces lignes générales, il est bon de laisser l’initiative particulière s’exercer. C’est de l’expérience cumulatrice que surgira la meilleure forme du Contrôle de la production, l’organisation la plus efficace du travail.
Le Contrôle devra pourtant être rapidement constitué si on veut réduire au minimum le temps d’arrêt de la production et des échanges, facteur essentiel du succès de la Révolution.
En somme, le Contrôle ouvrier aujourd’hui, celui de la production demain, sont les grands problèmes qui doivent être examinés et solutionnés rapidement si le prolétariat veut être en mesure d’assurer lui-même, hors de tous les partis et de leurs gouvernements, le salut des travailleurs.
Insister davantage sur le caractère des efforts à accomplir, m’apparaît inutile.
Pierre Besnard.
CONTROVERSE
n. f.
Discussion d’un sujet sur lequel on ne se trouve pas d’accord. La controverse se fait généralement en public et le sujet débattu est ordinairement d’ordre politique ou social. Lorsqu’elle est courtoise, la controverse est utile parce qu’elle oppose arguments à arguments et idées à idées ; mais quand la passion et le fanatisme s’en mêlent, la controverse n’est plus une source de lumière mais d’obscurité.
La controverse sincère est une bonne arme de propagande, car elle permet à l’auditoire de se faire une opinion sur une question qui l’intéresse, à la condition cependant que le débat se poursuive en bon ordre et sans dévier.
CONVENTION
n. f.
Accord, entre deux ou plusieurs personnes, entre diverses organisations sociales, commerciales ou politiques, ou encore entre deux ou plusieurs États.
Une convention est un traité verbal ou écrit que chaque partie s’engage évidemment à respecter. La Grande-Bretagne durant la guerre de 1914, en vertu d’une convention avec la France, s’engagea à enrôler dans ses armées les sujets français résidant en Angleterre ou de les expulser de son territoire.
C’est en vertu d’une convention internationale acceptée par tous les pays du monde que l’or sert d’étalon en matière d’échanges commerciaux et de transactions financières.
CONVICTION
n. f.
Certitude de la véracité d’un fait, d’un principe, d’une idée. Les convictions ne reposent pas toujours sur des preuves contrôlables et c’est ce qui explique les convictions bâtardes ou erronées de bon nombre d’individus. Les convictions religieuses, par exemple, sont étayées sur la foi et sur la croyance et non sur la raison ; cela n’empêche pas les fidèles sincères, d’avoir la conviction que Dieu existe et que nous lui devons une obéissance absolue et sans contrôle. Il leur serait pourtant difficile et même impossible d’apporter une preuve quelconque à l’appui de leurs convictions.
Une conviction sincère est toujours respectable quelle qu’elle soit ; il faut néanmoins combattre et chercher à détruire celles qui sont dangereuses pour la liberté individuelle et collective, car elles sont une source d’erreurs et de préjugés nuisibles à l’évolution et à la civilisation.
Les Anarchistes sont convaincus que l’ordre économique bourgeois est une entrave à la paix sociale et au bonheur du genre humain et que seul le communisme libertaire peut régénérer le monde ; c’est pourquoi ils défendent leurs convictions avec chaleur, espérant les faire partager par le plus grand nombre possible d’individus qui, venant grossir les rangs des exploités conscients de leur force, travailleront à la transformation sociale.
CONVOITISE
n. f.
La convoitise est le penchant qui incite à désirer ce que l’on n’a pas et qui appartient à autrui. Ce terme est presque toujours employé péjorativement et pourtant il est des convoitises raisonnables, sensées et logiques.
S’il est méprisable et parfois odieux de convoiter des richesses, des honneurs et des plaisirs, surtout lorsque ceux-ci ne peuvent être acquits qu’au détriment de son prochain, par contre il est tout à fait compréhensible que le peuple vivant dans la misère, face à la richesse de certains, convoite le bien-être de la bourgeoisie.
La convoitise est un défaut si elle dépasse certaines mesures, c’est-à-dire si elle conduit un individu à désirer plus que son voisin et à se procurer par des moyens indélicats ou par des bassesses l’objet de sa convoitise ; elle est au contraire une qualité si elle détermine l’individu à lutter pour être placé sur le même rang et au même niveau que ses semblables afin de bénéficier avec eux de toutes les richesses sociales. C’est pour maintenir l’esclavage du peuple que de tous temps les lois civiles et religieuses ont interdit de convoiter le bien de son prochain ; heureusement que, petit à petit, la lumière se fait dans les cerveaux et du jour où l’homme saura sainement convoiter, la Révolution, en abolissant tous les privilèges, fera disparaître la convoitise.
COOPERATION
n. f.
Auprès des révolutionnaires, et même des anarchistes, l’idée de la coopération n’a pas joui de la faveur ni attiré l’attention a laquelle elle a cependant droit par ses origines, qui la rattachent directement aux doctrines socialistes et anarchistes, par son importance pratique en tant que facteur économique actuel ; par les possibilités d’avenir et de reconstruction sociale qu’elle offre.
Cette défiance provient surtout de la prédominance de la mentalité bourgeoise dans les associations coopératives, et du peu d’idéalisme social qui s’y manifeste, faisant place à des préoccupations mercantiles, à l’égoïsme des adhérents et encore plus des dirigeants.
La coopération n’a pas su éviter l’adaptation au milieu. On en pourrait dire autant du syndicalisme, des partis politiques et même révolutionnaires. Issue du monde ouvrier, elle a dévié du but que lui assignaient ses protagonistes. Comme dit Ch. Gide, dans son livre les Sociétés Coopératives de Consommation, page 24 :
« Le système coopératif n’est pas sorti du cerveau d’un savant où d’un réformateur, mais des entrailles même du peuple. »
Vérité incontestable. Mais le peuple n’a pas su conserver la direction de ce mouvement, qui lui offre pourtant de magnifiques possibilités pour la lutte présente et pour les fondations de la société de demain.
Le dédain dans lequel les militants tiennent la coopération proviennent aussi d’une différence, essentielle de mentalité : les nécessités de la lutte sociale exigent des tempéraments ardents, dévoués, plus ou moins risque-tout ; l’organisation d’une coopérative, de quelque forme qu’elle soit, demande d’autres qualités, dont la première est la pondération et la seconde la souplesse.
Les coopératives ont également absorbé, retiré de la lutte, fait des petits bourgeois de bons militants. Reproche justifié, mais qui peut s’appliquer tout aussi bien au milieu social qui se charge d’abattre la combativité des camarades.
La coopération, malgré ses imperfections, ses défauts, ses déviations, n’en reste pas moins une forme d’association ayant son importance, et surtout offrant une base solide à toute idée de reconstruction sociale. Quand le souff1e révolutionnaire, pénétrant là comme ailleurs l’aura débarrassée des éléments malsains qu’elle traîne, elle se présentera comme une forme d’organisation souple et pratique capable d’assurer la production, la circulation et la répartition des produits, tout en laissant la liberté aux membres. Les coopératistes les plus neutres au point de vue social, les Gide, Gaumont, etc., ont dû reconnaître à maintes occasions, l’idéal libertaire qui présidait à la coopération.
La coopération, c’est le régime de la libre association se substituant au régime de la concurrence ou du monopole, base de la société bourgeoise. Des consommateurs ou des producteurs, pour conquérir à la fois le bien-être et l’indépendance économique, s’associent et administrent leurs affaires en dehors de toute tutelle étatiste ou capitaliste, n’est-ce pas là, théoriquement tout au moins, le fondement même de la reconstruction sociale du point de vue anarchiste ?
Les protagonistes de la coopération sont les pères spirituels des différentes doctrines sociales. Citons De L’Ange, Lyonnais, qui, pendant la révolution de 89, tenta maints essais ; Fourier, avec son familistère, ou coopérative intégrale de production et de consommation confondues ; Owen, qui inspira les pionniers de Rochdale ; Saint-Simon, avec son coopératisme mystique et religieux, qui dévia avec le positivisme des adeptes d’Auguste Comte ; Buchez, autre mystique coopérateur ; Proudhon, qui lança l’idée et tenta la réalisation de la coopérative de crédit « La banque du peuple » et préconisa les différentes formes de la coopération ; Louis Blanc, avec son coopératisme aidé et contrôlé par l’Etat ; Raiffaisen et Schulze Delitsch qui, en Allemagne, créèrent le mouvement coopératif de crédit.
Le premier socialisme fut tout imprégné le cette idée de la coopération. Mais la résistance ouverte ou déguisée de la bourgeoisie, et l’inexpérience des fondateurs, furent les causes de nombreux échecs : Les événements politiques et révolutionnaires détournèrent ce courant et l’amenèrent, soit vers la politique, soit vers la préparation d’une l’évolution. La coopération continua son chemin, mais avec des éléments bourgeoisants.
La coopération de consommation s’est beaucoup développée ; les sociétés, éparpillées dans tous les pays, se chiffrent par dizaines de milliers, les adhérents par millions, et les affaires par milliards.
Les coopératives de production exigeant des capitaux, de la compétence, une clientèle et surtout une plus haute moralité, ont eu plus de peine à progresser, et leur développement se fait lentement. S’écartant trop de la cause du peuple, donnant trop l’apparence d’un moyen de débrouillage pour quelques-uns plutôt que d’une forme nouvelle de la production, ce qui serait pourtant leur force et leur valeur, elles n’ont pas su créer un mouvement populaire puissant.
Sous une forme atténuée, et plus réalisable actuellement, la coopération de production a eu plus de succès sous les modalités de coopératives de main-d’œuvre, appelées différemment suivant les pays ; commandites en France ; ghildes en Allemagne, Autriche ou Angleterre ; braccianti en Italie ; artels en Russie, etc...
Cette forme nouvelle de la coopération a peut-être pour elle l’avenir. Elle évite les difficultés de l’association remplaçant le patronat et sujette à prendre les vices de la société bourgeoise, en procurant des privilèges à ses membres au détriment du bien-être général. Elle cadre mieux avec l’idée d’un régime social où des associations autonomes de production, s’administrant à leur guise, auraient pour fonction de satisfaire à tel besoin particulier de la communauté, sans pouvoir spéculer sur leur situation spéciale, ni créer un autre genre de propriété. Harmonisant leurs efforts avec ceux des organes de répartition (coopératives de consommation, logement, instruction, art, etc.), et fondues dans la commune libertaire, la commune de l’avenir, elles peuvent former la base économique de !a société de demain, organisme assez souple pour évoluer rapidement et pacifiquement vers le communisme intégral, suivant l’évolution des mentalités ; en tous cas système pratique de reconstruction sociale applicable le jour même de l’expropriation de la bourgeoisie par une révolution triomphante.
La coopération agricole fait aussi beaucoup de progrès. Malheureusement, ce ne sont guère que les petits propriétaires qui l’utilisent, la masse des prolétaires paysans restant en général trop dispersée. De nombreux syndicats agricoles ont été créés et prospèrent. On leur doit surtout la hausse des denrées agricoles. Mais ce principe d’association pour la culture, de la coopérative de village, est plein de promesses pour l’avenir. C’est la forme toute trouvée du travail agricole. Il suffira d’y amener les prolétaires des champs et les petits cultivateurs. L’idée a d’ailleurs pénétré les campagnes, Nos militants n’auront qu’à la développer.
Une autre forme de la coopération est celle du crédit, tant préconisée jadis par Proudhon, très développée aujourd’hui en Allemagne, Suisse, et l’Europe centraIe ; fonctionnant en France sous le nom de caisses rurales. Jouissant de la faveur et du soutien pécuniaire des Etats, cette modalité de la coopération a surtout favorisé la petite propriété agricole, la petite industrie, le petit commerce. Elle est peu intéressante à notre point de vue.
Il y a aussi des coopératives de construction (Angleterre, Amérique, etc ... ), mais ce sont plutôt des associations de petits propriétaires ou aspirant à l’être, et le sujet d’exploitations éhontées.
En résumé, un fort courant vers la coopération se développe dans toutes les parties du monde. La coopération s’avère une nouvelle forme sociale se substituant au régime capitaliste, et plus conforme aux besoins et à la mentalité modernes.
S’en désintéresser est une erreur. Ne pas voir les possibilités qu’elle présente est une faute.
Dans le mouvement coopératif, les anarchistes ont une large tâche à accomplir : combattre les politiciens, arrivistes et centralistes , inculquer l’idéal libertaire et faire entrevoir aux adhérents que la société dont ils font partie, s’ils veulent lui garder son indépendance et son idéal, peut-être une des pierres de la fondation de l’édifice social de demain.
— Georges BASTIEN.
COOPÉRATISME
n. m.
Tout mouvement qui se développe finit par trouver sa théorie, sa base doctrinale. Quoique née spontanément, de mobiles divers, et s’affiliant plus ou moins directement au fouriérisme, à l’owenisme, au saint-simonisme, et autres doctrines du début de la période socialiste, la coopération a fini par trouver ses théoriciens qui ont naturellement établi les bases d’une organisation sociale idéale sur les coopératives existantes, se développant graduellement, et envahissant progressivement tout le champ social.
Le mouvement coopératif de production agricole, composé surtout de petits propriétaires, n’a guère d’idéal social, cela se conçoit, pas plus que celui des caisses de crédit coopératives.
Longtemps, les coopératives de production se réclamèrent d’un idéal de transformation sociale, mais leur petit nombre et leur peu d’influence ne leur a guère permis de sortir des considérations générales, et de tracer un programme positif d’ensemble.
Du mouvement coopératif de consommation devait sortir la doctrine la plus complète et la plus ambitieuse.
Les ouvrages de Charles Gide et surtout la République coopérative d’E. Poisson, ont donné corps à cette doctrine coopératiste, et, à de peu nombreuses exceptions près, sont aujourd’hui acceptées par le mouvement coopératiste en général.
Ainsi compris, le coopératisme est du plus pur réformisme ; mais, si l’on peut dire, du réformisme d’action directe, et non étatiste ; c’est la substitution pacifique des organismes coopératifs au régime économique bourgeois.
Le coopératisme vise tout d’abord à l’abolition du profit commercial, qui reste aux coopératives, est réparti en partie aux coopérateurs, et l’autre partie sert à constituer un capital social collectif.
Par ce capital social collectif, le coopératisme agrandira son rayon d’action, pénétrant partout, et dans tous les domaines. Après avoir canalisé la consommation, il entreprendra les transports et ensuite la production jusqu’à ce qu’il soit devenu la seule organisation économique existante.
Le capital, réduit à la portion congrue d’un intérêt fixe d’abord, puis éliminé progressivement, grâce à l’accumulation des réserves collectives, deviendra inutile et disparaîtra.
Le coopératisme aura ainsi, éliminé les sources du profit commercial et capitaliste au bénéfice des consommateurs, c’est-à-dire de tous. Une sorte de république coopérative (c’est le nom donné) sera instituée et les citoyens consommateurs associés régiront toute la vie sociale au moyen d’un système démocratique calqué sur le parlementarisme. Tous les producteurs deviendront les salariés de la collectivité, donc leurs propres salariés, donc pas salariés, disent les théoriciens du coopératisme.
Nous savons trop apprécier les méfaits d’un régime démocratique et centraliste pour ne pas dénoncer la phraséologie et le danger d’une telle doctrine, qui n’est que du collectivisme déguisé, où l’État se fait appeler Fédération des coopératives ou tout autre nom. Nous savons que ces salariés de tout le monde resteront des prolétaires exploités, que la hiérarchie avec ses privilèges et ses injustices existera ; que le parasitisme social actuel n’aurait ainsi fait place qu’à une nouvelle caste de dirigeants soi-disant compétents, compétents surtout en la façon d’extorquer les votes des Assemblées.
Si la coopération n’a pas l’influence morale et la puissance transformatrice et émancipatrice qu’elle devrait avoir, elle le doit surtout à cet esprit de centralisme et de démocratie, marque de l’arrivisme qui l’a déjà en partie châtrée de sa force idéaliste.
Un autre exemple, celui de l’Italie avec ses nombreuses, puissantes et actives sociétés coopératives de consommation, production et crédit, doit nous éclairer. La vague fasciste a tout balayé ! La violence des maîtres, en peu de mois, a détruit le résultat de longs et pénibles efforts d’organisation.
En réalité, le coopératisme porte en lui une saine notion d’organisation sociale meilleure, mais il doit se débarrasser des doctrines politiques et centralistes qui l’étouffent ; il doit surtout n’avoir confiance qu’en sa propre force autonome, faire l’appel le plus large aux initiatives locales en leur laissant l’intégrale liberté ; apprendre à ses membres à administrer eux-mêmes leurs affaires et non plus à déléguer le pouvoir à des représentants (toujours la même duperie). Le coopératisme doit aussi comprendre que la transformation graduelle et pacifique n’est point possible, et qu’il lui faudra un jour où l’autre se mettre avec les forces révolutionnaires ou sombrer.
Merveilleux champ d’expériences et école de self-administration, le coopératisme doit surtout tenter de devenir une force d’émancipation, mettant les moyens matériels au service de la libération morale et intellectuelle.
L’homme n’est pas qu’un consommateur, il est aussi un producteur, un artiste, un savant, un amateur de toutes les sensations vitales. Vouloir faire prédominer un des côtés de la vie humaine sur les autres, c’est aboutir à une nouvelle tyrannie déguisée et un nouveau parasitisme. La vérité se trouvera dans une harmonie bien équilibrée des différentes sortes d’associations humaines : production, consommation, art, études, etc...
― GEORGES BASTIEN.
COOPÉRATIVES (SOCIÉTÉS) DE CONSOMMATION
n. f.
Parmi les différentes formes de la coopération, celle dite de consommation a pris un énorme développement, une ampleur considérable qu’aucune attaque ni événement n’ont pu entraver. La guerre même, la révolution russe, loin d’être une cause de crise du mouvement coopératif de consommation, ont été des stimulants et ont contribué à une prodigieuse extension de ces coopératives.
Alors que la coopération de production piétine sur place ou progresse lentement, que la coopération de crédit ou agricole se restreint à la petite bourgeoisie, celle de consommation marche à pas de géant et conquiert rapidement tous les pays, pénétrant jusque dans les campagnes.
En 1925, l’on compte plus de vingt millions d’adhérents à ces coopératives et le chiffre d’affaires dépasse dix milliards de francs.
Les causes en sont assez simples à saisir.
Tout d’abord, le capital exigé est relativement faible. Avec un capital représentant la valeur de quinze jours de travail de ses membres, une coopérative de consommation peut subsister. Les compétences nécessaires sont également faibles : ordre, méthode, comptabilité, aptitudes commerciales d’ailleurs facilitées dès que la société prend de l’extension, les offres venant se présenter.
Chacun pouvant devenir coopérateur sans effort, le recrutement a été aisé, même dans les tout petits centres.
Mais le grand avantage de la coopérative de consommation est incontestablement d’avoir pris la place de l’intermédiaire, du commerçant. En effet, toute la charge que font peser les privilèges sur la population, peut se situer dans l’exploitation, le prélèvement qui prend cours depuis le moment où l’ouvrier produit la marchandise et celui où le consommateur en prend livraison. Tous les prélèvements capitalistes ou étatistes ont lieu entre ces deux moments. Les profits ainsi prélevés étant énormes, toute association de consommateurs se substituant au commerçant a la partie belle. On peut même plutôt s’étonner que les bénéfices réalisés par les consommateurs coopérateurs soient si peu élevés. C’est à un vice d’administration qu’ils le doivent.
Le but de la coopération de consommation est la suppression du bénéfice au profit commercial, et l’établissement du juste prix de vente, c’est-à-dire du prix exact de revient majoré des frais généraux et de transport. Tout prix supérieur à ce total laisse une marge appelée le profit commercial, que les coopératives de consommation veulent supprimer.
Suivant l’exemple et la théorie fournis par les pionniers de Rochdale, tisseurs, qui fondèrent en 1843 une coopérative de consommation, les coopératives vendent à un prix égal ou légèrement inférieur à celui du commerce, mais tous les ans ou tous les six mois, reversent aux coopérateurs le trop perçu, sous le nom de ristourne, boni et, après certains prélèvements pour des œuvres sociales, pour les réserves, amortissements, développements, etc...
Il y a une infinité de nuances sur l’emploi de ce trop-perçu. Certaines coopératives, plus véritablement dénommées ligues d’acheteurs, vendent au strict prix de revient, majoré des frais généraux. Mais elles ne progressent pas, n’ayant point de réserves, étant à la merci des crises économiques.
D’autres, comme en Belgique, soutiennent la politique d’un parti (la coopérative est alors la vache à lait des politiciens). D’autres, comme à Saint-Claude (Jura) laissent tout le trop-perçu pour des œuvres sociales, hygiéniques, éducatives, etc...
Cette question est très controversée, mais la majorité des sociétés distribuent aux coopérateurs une partie des trop-perçus, réservant une fraction pour le développement de la coopération ou pour certaines œuvres sociales.
La constitution de réserves promet aux coopératives de se libérer peu à peu du capital, de former ainsi un capital collectif, inaliénable, sorte de bien de main morte, collective, mais active, qui leur permet d’envisager leur développement, de viser à la production dans des usines leur appartenant, de créer des œuvres d’intérêt général, bref tout un programme social.
Mais, il faut bien le dire, sauf quelques exceptions, les tentatives d’organiser la production ont donné peu de résultats, par suite de causes diverses, dont la plus importante est le maintien du salariat dans les usines coopératives.
Trop exclusives, les coopératives de consommation n’ont su ni voulu résoudre cet important problème du salariat, dans leur propre sein, et se sont heurtées à des grèves de leur personnel, et à des luttes entre le coopératisme et le syndicalisme.
Les théoriciens de la coopérative de consommation ont voulu voir dans ce genre de coopération, la solution à tous les problèmes économiques. Mais l’expérience leur montre que le rôle actuel des coopératives de consommation ne va guère plus loin que celui de commerçant et de commanditaire et client régulier de la production. La coopération de consommation, impuissante à résoudre le problème du salariat, autrement que par des phrases creuses, se rendra compte que ses succès actuels sont dû à sa situation spéciale d’intermédiaire, mais qu’elle devra faire une place à côté d’elle et favoriser les autres modes de la coopération.
Sa valeur sociale au point de vue de l’avenir est plus contestable que celle des autres formes de la coopération, car les capacités commerciales qu’elle forgé sont appelées à disparaître dans une société bien organisée, surtout après une révolution sociale.
Néanmoins, telle qu’elle est, la coopérative de consommation est appelée à jouer un grand rôle, comme agent de répartition, de statistique, de coordination de la circulation et des échanges. Par ses fédérations nationales voire internationales, ses magasins de gros, elle peut devenir l’agent régulateur de toute la circulation économique.
Elle a appris aussi au consommateur ce que le syndicat enseigne au producteur : à tenter de ne plus être exploité, en dénonçant le vol manifeste appelé commerce.
Son influence sociale a déjà été énorme ; elle grandira encore à l’avenir. En s’attaquant aux néfastes intermédiaires, en proclamant la volonté des consommateurs de se défendre envers et contre tous, elle aura contribué considérablement à l’évolution sociale. Dans une société libertaire, son rôle légèrement transformé n’en sera pas moins bienfaisant et incontestable.
— GEORGES BASTIEN.
COQUIN
Le mot Coquin est interprété de différente façon selon la personne à laquelle il s’applique ; parfois il sert à désigner un être sans scrupules, propre à toutes les besognes et d’une indélicatesse notoire. « Ce fonctionnaire est un coquin, il profite de sa situation pour se livrer à des actes malhonnêtes. » D’autrefois il est une expression de mauvaise humeur ou de colère. « Mon coquin de fils n’est pas rentré à la maison cette nuit. » Enfin il est également employé dans un sens malicieux. « L’heureux coquin, toutes les femmes sont amoureuses de lui. » (Beaumarchais.)
Au féminin : Coquine. Ce mot désigne couramment une femme débauchée et intéressée.
CORAN n. m.
Plus exactement : Korañ-lecture. La lecture par excellence. Comme la Bible est le livre sacré des juifs et des chrétiens, le korañ est la lecture sacrée des musulmans.
Le korañ a été écrit, affirme Mahomet (mieux : Mohammed) par Dieu, qui chargea l’ange Gabriel de le révéler par fragments au prophète.
L’histoire de ce livre ne permet pas le silence sur l’histoire de son auteur, dont on a dit trop de mal et trop de bien.
Il est vrai que le korañ est loin d’avoir la valeur littéraire et surtout poétique des livres canoniques des religions de l’Extrême-Orient, ni même de la Bible ; tous livres d’ailleurs ayant eu des auteurs multiples. Mais, précisément pour cela, parce que son auteur est unique bien que souvent compilateur, on y relève moins de contradiction, plus d’unité, plus d’ordonnance, osons dire une meilleure administration parce que Mohammed fut un admirable administrateur.
Il fut, de tous les imposteurs religieux, le plus conscient et le plus intelligent. Tous les autres ont été leurs propres dupes, ils ont cru eux-mêmes à leur mission divine. Mohammed, au contraire, a froidement prémédité son œuvre. Il en est resté le maitre et ne s’est jamais laissé saisir par elle. En cela il est unique.
De toute son entreprise, rien ne fut confié au hasard.
Intelligent, instruit, doué d’un sens pratique rare chez un grand ambitieux, il se traça de bonne heure un programme qu’il suivit de point en point jusqu’à s’imposer une retraite de quinze années au bout desquelles il ne fit sa « rentrée » que se prétendant illettré.
Le korañ est un des articles de ce programme.
Mohammed est né à la Mecque en l’an 578 de notre ère, son nom, très répandu chez les Arabes, signifie Mo Hamad, c’est-à-dire : l’homme du pays de Hamad, car on se nomme Mohammed chez les Arabes comme on se nomme Lenormand, Poitevin, Dumaine ou Dumesnil chez les Français. Mais certains commentateurs préfèrent un autre sens très soutenable également : loué, comblé de gloire. Ils prêtent à son père des propos qui indiqueraient qu’il croyait au futur rôle de son enfant.
Mohammed était de famille princière, de la tribu des Coréïshites. Il est incontestablement descendant d’Ismaël, donc d’Abraham, le père des croyants.
Selon la légende arabe, quand Agar et Ismaël furent chassés de la tente paternelle, ils se réfugièrent à La Mecque où, quand il fut homme, Ismaël bâtit le premier temple à la gloire de l’Éternel, 993 ans avant la construction du temple de Jérusalem. Son nom : Caraba, signifie simplement carré et vient de sa forme cubique.
Voici pour l’ascendance ,de Mohammed. Évidemment des légendes font concorder sa naissance avec de prodigieux phénomènes.
L’enfance du futur prophète fut dramatique : il perdit, à l’âge de deux mois, son père qui lui laissait en héritage cinq chameaux et une esclave éthiopienne. Sa mère l’éleva laborieusement et, quand il eût atteint sa sixième année, elle mourut au cours d’un voyage entre Médine et La Mecque. Il fut recueilli par son grand-père Abd-el-Motaleb, mais ce bon vieillard de cent douze ans mourut tôt après. C’est un oncle, frère utérin de son père, qui recueillit l’orphelin. Cet oncle, nommé Abou-Taleb, lui fit donner une solide instruction. Quand l’enfant eut treize ans il l’emmena avec lui dans ses voyages d’affaires en Syrie. La légende prétend qu’un moine de la région de Damas prophétisa que l’enfant était voué aux plus hautes destinées. Il est en tous cas vrai qu’au cours de ce voyage l’enfant avait eu l’occasion de prouver son sens précoce des affaires, sens qui allait se développer et s’affermir. Outre cela il devait hériter de droit de la charge de son père : préfet du temple de La Mecque.
À quatorze ans il combattit dans les rangs de sa tribu que favorisa la chance des armes.
Il devint bientôt l’homme de confiance chargé des affaires lointaines de Kadige, riche commerçante de sa tribu. Pendant le voyage qu’il fit en compagnie d’un serviteur enthousiaste et témoin prédisposé à l’admiration, les merveilles et les miracles adoucirent le parcours. Au retour, Mohammed avait à peine vingt-cinq ans, Kadige, sa riche maîtresse, en avait quarante et l’absence du jeune affairiste lui ayant paru longue, elle comprit qu’elle l’aimait, le lui dit, lui offrit sa main que Mohammed accepta.
Nous aurions tort de tirer des conclusions sévères de cette différence d’âge, il est même très probable que Mohammed aima son épouse jusqu’à l’heure où elle mourut, vingt-cinq ans plus tard, car de son vivant il n’usa pas du droit d’épouser plusieurs autres femmes, droit consacré par les lois et les usages des Arabes bien antérieurement à la fondation de l’Islam.
Mohammed avait son plan, il disposait maintenant d’une grande fortune pour le réaliser. Il se retira dans la solitude, le silence et la méditation durant quinze années. Il avait donc quarante ans, Kadige sa femme, en avait cinquante-cinq quand il se révéla prophète.
Il fut d’une extrême prudence et n’entreprit d’abord que les conversions dont il était sûr : son premier disciple fut son adoratrice naturelle Kadige, puis son cousin Ali, flls d’Abou-‘I’aleb qu’il avait à son tour recueilli pendant une famine, puis ses autres proches parents.
Il commença prudemment par raconter une vision où l’ange Gabriel lui serait apparu en lui donnant un message divin à lire. Mais Mohammed avait renié son instruction, il avait embrassé la profession d’illettré et en cela consistait le miracle : cet illettré lisait les messages de Dieu !
Voici le premier verset divin dont l’ange Gabriel lui ordonna la lecture (Koran) :
Il forma l’homme en réunissant les sexes.
Il apprit à l’homme à se servir de la plume ;
Lis, au nom du Dieu adorable,
Il mit dans son âme le rayon de la science. »
Et pendant vingt-trois ans le prophète reçut les messages de Dieu par l’ange Gabriel, ils forment cent quatorze chapitres.
Les versets que Mohammed avait lus dans ses extases il les dictait à ses secrétaires qui les inscrivaient sur des feuilles de palmier, sur des peaux et des omoplates de moutons.
Ce trésor divin était enfermé pèle-mêle dans un coffre et les versets étaient fidèlement appris par coeur par les disciples de Mohammed.
C’est seulement après la mort du prophète qu’Aboubecr, disciple et beau-père de Mohammed qui, après la mort de Kadige, avait épousé de toutes jeunes filles, recueillit en un volume les précieuses révélations. Le classement en est naïf : les chapitres viennent par ordre de longueur ; les plus longs les premiers.
Le Korañ prouve que Mohammed avait une solide connaissance de l’Ancien et du Nouveau testament (voir l’article Bible) qu’il cite dans certains passages et dont il s’approprie les termes dans d’autres.
Comme la religion de Moïse, la religion de Mohammed est théocratique. Aussi, le culte et le service de la patrie se confondent avec le culte et le service de Dieu, le chef de l’Église est obligatoirement le chef de l’État.
La doctrine koranique se nomme Islam. Selon le D’Pridoux ce mot signifie foi « qui sauve », selon Savary consécration à Dieu. On pourrait trouver d’autres sens encore, car dans islam se trouve le radical salam qui signifie paix.
Les points essentiels de cette doctrine sont : monothéïsme, humilité, prière, jeûne, aumônes, patriotisme, pèlerinage à La Mecque, fatalisme, prédestination, peines éternelles pour les réprouvés, paradis délicieux pour les élus.
L’enfer des Musulmans est simplement calqué sur celui des judéo-chrétiens-catholiques ; mais leur paradis est infiniment plus séduisant, à en juger par ces quelques extraits :
« Chapitre II intitulé : LA VACHE, verset 23. — Ils habiteront des jardins où coulent des fleuves. Lorsqu’ils goûteront des fruits qui y croissent, ils diront : voilà les fruits dont nous nous sommes nourris sur la terre ; mais ils n’en auront que l’apparence. Là ils trouveront des femmes purifiées. Ce Séjour sera leur demeure éternelle. »
Les anciens auteurs arabes, les « pères de I’Église » des musulmans et, parmi eux, Gelaleddin El Hassan, nous apprennent ce qu’il faut entendre par femmes purifiées : qui ne seront point sujettes aux taches naturelles, vierges, à l’oeil noir, stèriles, exemptes de tous besoins sauf de celui d’aimer.
Ceux qui craignent le jugement posséderont deux jardins...
Dans chacun d’eux jailliront deux fontaines...
Les fruits divers croitront en abondance...
Les hôtes de ce séjour, couchés sur des lits de soie, enrichis d’or, jouiront, au gré de leurs désirs, de tous ces avantages ...
Là seront de jeunes vierges au regard modeste, dont jamais homme ni génie n’a profané la beauté...
Ces vierges aux beaux yeux noirs seront renfermées dans des pavillons superbes...
Des tapis verts et des lits magnifiques... »
Ils seront servis par des enfants doués d’une jeunesse éternelle...
Qui leur présenteront du vin exquis...
Sa vapeur ne leur montera point à la tête et n’obscurcira point leur raison...
Près d’eux seront les houris aux beaux yeux noirs. La blancheur de leur teint égale l’éclat des perles.
Leurs faveurs seront le prix de la vertu...
Leurs épouses resteront vierges...
Elles les aimeront et jouiront de la même jeunesse qu’eux... »
Il est regrettable que l’auteur qui a fait preuve d’une grande psychologie en remplaçant la contemplation de l’Éternel par le joli paradis dont nous ne venons que de donner une toute petite idée, ait introduit dans son ouvrage les violences du coléreux Saint-Paul. Quel dieu monstrueux que celui qui commet cet abominable crime :
« Dieu a imprimé son sceau sur leurs cœurs et leurs oreilles, leurs yeux sont couverts d’un voile et ils sont destinés à la rigueur des supplices. » (La Vache, II, 6.)
C’est ce dieu qui, vingt versets plus loin, ose poser cette question :
« Pourquoi ne croyez-vous pas en Dieu ? » (II, 26)
Il est vrai que nous trouvons au IVe chapitre, LES FEMMES, cette délicieuse contradiction :
« Dieu est l’auteur du bien qui t’arrive, Le mal vient de toi. »
Mais il serait enfantin de chicaner sur ces détails ; pour envisager le Korañ du même point de vue que nous avons envisagé la Bible, il nous semble plus juste de procéder par comparaison. Nous pouvons donc considérer que la Bible, moins poétique que les livres de l’Extrême-Orient, a plus d’unité ; mais en gardant une grande valeur artistique, voire à cause de cette valeur, elle reste marquée du sceau de l’incohérence poétique. Quand nous passons de la lecture de la Bible à celle du Korañ, nous sommes frappés de l’infériorité du style quoique encore fort joli, de l’infériorité poétique, bien que les versets du korañ soient encore fort musicaux.
Mais quelle supériorité dans la solidité de l’ouvrage ! Nous avions, avant cela, lu les jolies élucubrations d’une foule de poètes, nous avons maintenant sous les yeux l’ouvrage positif d’un homme qui sait ce qu’il veut et où il va et qui possède le génie affairiste le plus puissant.
Raoul ODIN
CORPORATION
n. f.
La Corporation est, dit le dictionnaire, une association d’individus qui exercent une même profession.
La Corporation fut en effet cela pendant très longtemps, sans que le but variât. Aujourd’hui, ce qui en survit est tout différent, quoique l’esprit qui s’en dégage : le Corporatisme, reste encore fortement attaché au passé.
Il faut cependant distinguer entre les corporations du Moyen-Age et les syndicats professionnels d’aujourd’hui, comme il convient d’établir entre les corporations d’autrefois et celles qui sont chères à M. Georges Valois et à ses amis, partisans des États Généraux, de notables différences.
Les anciennes corporations prirent naissance en France vers l’an 1300. La première qui se constitua fut celle des Marchands de Paris. Elle se donna un chef, véritable puissance, qui était chargé de défendre les intérêts de la corporation des marchands. Ce chef prenait le nom de Prévôt des marchands. Le plus célèbre fut Étienne Marcel, dont la statue s’élève à Paris, à côté de l’Hôtel de Ville. Les marchands étaient en quelque sorte, les maîtres de la Cité et Étienne Marcel le vrai maire de Paris.
Il joua d’ailleurs un rôle extrêmement important aux États Généraux de 1355 et obligea la royauté à établir une Charte libérale qui marque dans l’histoire.
Les corporations restent toutes puissantes pendant toute la période de 1355 à 1789. Jugées comme une entrave au progrès par la Constituante, elles furent définitivement supprimées en 1791, après que Turgot en eût lui-même ordonné la suspension quelques années plus tôt. Là s’arrête l’histoire des vieilles corporations.
Sous l’ancien régime, les corporations étaient des associations d’individus exerçant la même profession dans une même localité. Les membres étaient liés entre eux par des droits et des devoirs. L’entrée dans la corporation était difficile. En fait, bien qu’elle groupât tous les individus qui exerçaient un même métier : apprentis, compagnons et maîtres, seuls ces derniers dirigeaient la corporation.
Les maîtres formaient entre eux, la maîtrise qui gouvernait le métier. Ils avaient faculté de transmettre leurs pouvoirs à une jurande, sorte de Conseil de maîtrise qui avait charge de défendre les intérêts de la corporation.
On entrait dans la Corporation par tradition, de père en fils, en qualité d’apprenti. On n’accédait au titre de Compagnon qu’après un stage de plusieurs années et avoir subi un certain nombre d’épreuves dont le compagnonnage, aujourd’hui presque disparu, avait conservé les coutumes peu intéressantes, pour ne pas dire plus.
Enfin et par exception, sauf par héritage ou mariage, le compagnon devenait maître après avoir accompli un chef-d’œuvre, c’est-à-dire après avoir prouvé ses capacités professionnelles en réalisant un travail professionnel délicat.
L’esprit des Corporations était nettement conservateur. Ce n’est qu’après de longs et patients efforts par exemple, que Jacquard réussit à faire comprendre l’utilité du métier à tisser et pourtant les corporations de cette époque (1820) étaient singulièrement plus évoluées que celles du moyen-âge.
La Corporation permettait aussi une exploitation sans limite des travailleurs : apprentis et compagnons. Lyon fut à différentes reprises, le théâtre de luttes terribles entre maîtres et compagnons.
En entrant dans une Corporation, l’individu s’engageait a ne jamais changer de métier. Il était rivé à son métier comme l’esclave à sa chaîne et il ne différait guère de ce dernier.
Si les corporations disparurent officiellement en 1791, leur esprit ne cessa pas de prédominer jusqu’en 1848.
Il fallut que le socialisme fît sa première apparition pour que se modifiassent un peu les aspects de ce mouvement particulier. Ce sont bien, en fait de véritables corporations qui subsistent jusqu’à la naissance de la première Internationale.
Leur esprit ne continue pas moins à se manifester et le mouvement syndical lorsqu’il s’éveillera vers 1875 et s’affirmera déjà puissant sans être légal quoique toléré, en 1879, sera dominé, lui aussi, par l’esprit conservateur que lui léguèrent les corporations d’autrefois.
La législation du mouvement syndical en 1884, sa formation en syndicats de métier lui conservent son caractère jusqu’aux environs de 1896 et on peut dire qu’il ne s’évadera réellement de ce cadre exclusivement corporatif qu’avec l’apparition des Bourses du Travail en 1892.
C’est de 1902 à 1906, que le corporatisme et le syndicat professionnel limité à ce rôle subalterne, seront de plus en plus rejetés dans l’ombre pour faire place au syndicalisme social et de lutte de classe.
Néanmoins en dépit des efforts des militants, le vieil esprit des corporations subsiste encore de nos jours. La besogne à accomplir pour le détruire reste considérable.
En effet, de divers côtés, on cherche à faire revivre les corporations supprimées par la loi Lechapelier.
Tandis que M. Duguit veut créer un vaste système de fédéralisme professionnel qui doit trouver son aboutissant dans la constitution d’un parlement professionnel qui doit, selon M. Duguit être le « contre-poids nécessaire à l’action étatique du Parlement politique », MM. Georges Valois, Eugène Mathon et Latour du Pin, théoriciens ou praticiens du syndicalisme royaliste ou conservateur, veulent, à l’instar de Mussolini et de Rossoni en Italie, instituer des corporations sociales et des corporations économiques sur des bases qui ne sont pas très éloignées des corporations fascistes en Italie.
« Il faut, disait Mathon à une réunion de notables qui s’est tenue à Paris, le 18 octobre 1923, instituer une représentation des intérêts professionnels et créer sur cette base un organe consultatif qui éclairera les pouvoirs publics dans l’examen des problèmes techniques. De la sorte, les intérêts particuliers cèderont le pas aux intérêts généraux. Mais la représentation des intérêts suppose une organisation de ces intérêts. Ils devront donc être coordonnés, et la pierre angulaire du système sera la Corporation ».
Et M. Mathon, qui est, ne l’oublions pas, le Président du Comité Central de la Laine, définit ainsi qu’il suit le rôle et le caractère des corporations.
Dans celles-ci entreront — et obligatoirement — tous ceux qui ont des intérêts professionnels communs : la corporation de métier groupera donc à la fois : le patron, le technicien et les ouvriers. A sept siècles de distance c’est le vieil esprit qui revient.
Suivant ce magnat de l’industrie, la corporation revêtira deux aspects très nets : l’aspect social et l’aspect économique, c’est la particularité essentielle de sa thèse.
1° La corporation sociale sera caractérisée par une collaboration étroite entre les patrons et les ouvriers qui auront des délégués respectifs au Conseil corporatif. Elle étudiera les questions de salaire, de main-d’œuvre, d’apprentissage. Elle aura un patrimoine indivisible qui, appartenant à tous ses membres, les incitera à développer sa prospérité. Les conflits possibles entre patrons et ouvriers seront déférés à des juridictions corporatives. Tout patron dont le tort sera reconnu pourra être frappé d’interdit par la corporation qui assurera aux ouvriers la continuation du paiement de leurs salaires.
À l’inverse, un patron dont les ouvriers auront déclaré la grève sans motifs valables sera soutenu par la corporation, qui protègera son industrie, se préoccupera de ses commandes en cours, etc...
2° Autre sera le rôle de la corporation économique qui sera exclusivement dirigée par le patronat, car c’est lui qui possède les entreprises et assume la responsabilité de leur gestion.
En résumé, dit M. Mathon, nous voulons faire revivre la corporation et nous croyons que c’est elle qui pourra résoudre à la fois les difficultés d’ordre économique sous la direction exclusive des chefs et les difficultés d’ordre social par la collaboration des patrons et des ouvriers.
La corporation économique nommera un « Conseil économique », qui s’occupera des intérêts généraux professionnels, veillera au respect de la discipline corporative. Ce Conseil pourra même légiférer au sein de la corporation. Il déterminera les conditions de la production, des prix de revient, etc... Il pourra imposer ses membres suivant un taux qu’il fixera.
Les pouvoirs de la corporation seront limités par ceux des autres corporations. Il y aura des corporations de consommateurs qui assureront une représentation de la famille. Cette pression du consommateur fera disparaître la spéculation illicite, les coalitions, etc...
Des tribunaux intercorporatifs jugeront les litiges éventuels entre corporations. L’État n’interviendra que le moins possible dans cette organisation. Il en sera seulement le tuteur, l’arbitre.
Et voici la caractéristique essentielle du système. Au-dessus de la corporation locale sera instituée une corporation régionale qui représentera les intérêts dont elle a la charge auprès des États provinciaux. Au-dessus encore, il est prévu une corporation nationale qui agira de même aux États-Généraux.
Dans ces États, les grands problèmes économiques seront discutés par des gens compétents qui soumettront leurs projets aux pouvoirs publics, ayant seuls qualité pour homologuer.
D’autre part, l’État devra constituer un Ministère de « l’Économie nationale », organisé sur le plan même des corporations. Il déléguera un représentant au Conseil Économique de chaque corporation et son chef sera permanent.
Par là une impulsion efficace pourra être donnée à la production. L’État pourra concéder à des corporations diverses certaines gestions qu’il assume mal. Il arbitrera les conflits d’intérêts, sauf appel devant la Cour suprême inamovible.
Tel est l’habile système que préconisent le haut patronat conservateur et les théoriciens d’Action française.
Il n’est pas difficile de comprendre à quoi doit mener une résurrection des corporations envisagées sur ces bases nouvelles. C’est le renforcement de l’autorité et l’installation d’un dictateur qui, dans l’esprit des auteurs de ce plan, doit être un roi.
Quelle que soit le caractère et le titre de ce dictateur, ce qui importe c’est la menace que représente une telle conception qui a pour aboutissant la consécration définitive des privilèges du patronat de droit divin.
Aussi, a-t-on le droit de s’étonner lorsqu’on voit de bons camarades s’engager inconsidérément dans la voie de ce retour à la corporation par le développement intempestif de l’esprit corporatiste...
Le salut consiste dans une organisation aussi scientifique que possible du prolétariat sur les bases industrielles et tous les efforts doivent tendre à obtenir ce résultat au plus tôt, si l’on ne veut être finalement distancé par un adversaire redoutable et agissant.
C’est ce que nous examinerons lorsque nous analyserons le syndicalisme et sa structure.
— Pierre Besnard
CORPORATISME
n. m.
Esprit particulier qui découle de l’exercice d’une profession déterminée. Le Corporatisme devient souvent même chez certains individus évolués ou qui se prétendent tels, une sorte d’orgueil qui les fait considérer leur profession comme supérieure à toute autre et s’estimer eux-mêmes au-dessus des autres travailleurs.
Cet esprit est une survivance des vieilles corporations d’autrefois. De nos jours, nombreux sont encore les « ouvriers qualifiés », les « compagnons » qui s’imaginent être supérieurs socialement, intellectuellement, aux « manœuvres », aux « ouvriers spécialisés » et cela dans tous les pays.
Le corporatisme n’est autre chose, en somme, que « l’esprit de corps » ouvrier.
De même que l’esprit des corps militaires oppose les uns aux autres fantassins et cavaliers, l’esprit corporatiste oppose, dans les mêmes conditions, les ouvriers aux autres ouvriers.
Le Corporatisme, comme « l’esprit de corps » est savamment entretenu par les gouvernants et les patrons.
Dresser les travailleurs d’une profession contre ceux d’une autre, opposer dans une même profession, les prolétaires exerçant des métiers différents, compartimenter le métier en spécialités dont les éléments travailleurs se jalouseront, c’est la tactique préférée du patronat.
Il faut d’ailleurs reconnaître que, jusqu’à maintenant, elle a presque toujours réussi, en dépit de tous nos efforts pour faire comprendre aux ouvriers que, socialement, ils sont tous égaux, qu’ils sont au même titre, chacun dans leur métier, dans leur profession, indispensables à l’exercice de la vie sociale.
Faire comprendre à tous qu’il n’y a pas de profession privilégiée, que les intérêts généraux de tous les ouvriers sont semblables, voilà le grand but à atteindre, le premier que doit se donner comme objectif constant toute la propagande syndicale et sociale.
Le jour où l’électricien, le maçon, le dessinateur, le vidangeur, le cheminot, le métallurgiste, etc., auront compris cela, le corporatisme, dans ce qu’il a de mauvais, de nuisible, de conservateur, de rétrograde, de déformant, aura vécu, Ce jour-là l’unité morale du prolétariat sera réalisée. Et les barrières corporatives étant brisées, le patronat sera aussitôt, par voie de conséquence, privé de l’un de ses moyens de pression et d’action peut être le plus puissant, le plus efficace.
On peut donc dire que le corporatisme s’oppose, et fortement, à révolution sociale du mouvement ouvrier. Il est assez paradoxal d’ailleurs que des ouvriers, qui se déclarent eux-mêmes syndicalistes révolutionnaires, œuvrent en ce moment, et de toutes leurs forces, pour faire revivre le corporatisme plus intensément que jamais.
Ils devraient s’apercevoir qu’en agissant ainsi, ils fournissent à nouveau au capitalisme une arme qu’avaient émoussée trente années de propagande intelligente et constante.
Le développement du corporatisme, de l’esprit égoïste qui se dégage de sa pratique est néfaste au-delà de tout ce qu’on peut imaginer.
C’est au nom des intérêts corporatistes qu’on défend, dans certaines professions, les fameux us et coutumes qui sont périmés depuis 50 ans, au lieu de chercher à en imposer de nouveaux, en rapport avec la vie actuelle. Cette action est nettement conservatrice et inconcevable.
C’est encore au nom des mêmes intérêts qu’on entreprend, sans coordination, sans liaison, sans consultation préalable, les actions les plus diverses, les plus contradictoires, presque toujours vouées à l’insuccès le plus complet.
Même quand elles réussissent, ces actions n’ont que peu de valeur. Elles ne permettent guère que d’obtenir des résultats partiels, qui exacerbent davantage les rapports entre travailleurs, pour le plus grand bénéfice des employeurs.
C’est de la pratique constante du corporatisme, de la valeur donnée à tel ou tel métier, valeur reconnue et exaltée par les ouvriers qu’est passée dans les mœurs générales, la théorie, confirmée par le fait, de l’inégalité sociale, de l’utilité plus ou moins grande de telle ou telle profession et partant, de la rétribution différente des travailleurs exerçant ces professions. Le Corporatisme a donné naissance à un catalogue social de la valeur de la force travail, établi par les patrons et accepté comme tel par les ouvriers.
Toutes les grèves pour les augmentations de salaires, qui ont pour but de maintenir les principes de la loi d’airain, sans jamais solutionner cette insoluble question sont le résultat du Corporatisme. La survivance du Corporatisme les a rendues inévitables et indispensables.
Alors qu’il s’agit de proclamer l’égale utilité et l’identique rétribution de toutes les fonctions sociales, qu’il convient, dans la société actuelle, de poursuivre l’établissement d’un minimum de salaire régional ou national pour toutes les professions, les ouvriers, faisant inconsciemment le jeu des patrons, luttent pour des augmentations parcellaires, localisées qui les épuisent en efforts stériles et les obligent à des actions constantes dont le bénéfice va toujours aux mercantis, aux logeurs, aux propriétaires, etc..., qui ne manquent jamais, ceux-là, à chaque augmentation partielle des salaires de faire subir à toutes choses une augmentation générale qui frappe, elle, l’ensemble des travailleurs. Et on continue, toujours ainsi, sans changement. On s’agite sans résultat, on perd temps et force dans ce Don Quichottisme au lieu de poursuivre efficacement et sérieusement des conquêtes solides qui assureraient matériellement et moralement une vie meilleure à tous les travailleurs, quelle que soit leur profession.
En dehors de ces arguments péremptoires, dont nul ne peut contester la valeur, il en est d’autres, non moins sérieux, qu’il convient d’examiner et de retenir.
N’est-il pas ridicule, en effet, qu’en notre époque de civilisation industrielle, où tout repose sur l’organisation pratique de l’industrie évoluant sur le plan régional, national et international, on parle encore de corporatisme ?...
Alors que, pour répondre à l’action intelligente des Cartels d’industrie, des Trusts nationaux, des Consortiums internationaux, le Syndicalisme devrait faire tous ses efforts pour modifier son organisation interne, adapter ses organes à leur rôle nouveau, créer ceux qui lui sont nécessaires et n’existent pas, on assiste à ce spectacle d’un mouvement « figé » dans le passé, dont l’action, la propagande conservent des formes désuètes.
Il faudra pourtant, s’il veut vaincre, que le travail s’organise sur le même plan que le Capitalisme.
Aux formations tantôt massives, tantôt alertes et vigoureuses du Capitalisme, le mouvement ouvrier doit opposer des forces organisées aussi scientifiquement.
Hors de là, pas de succès possible. Le Corporatisme, survivance d’un passé vieillot, doit disparaître pour, faire place à une conception plus saine, plus adéquate de nos forces.
Le Corporatisme, conservé par le pré-syndicalisme, ayant servi de gymnastique au syndicalisme bégayant de 1879–84, a fait plus que son temps. Qu’on l’enterre sans De profundis.
Il n’a qu’un bon côté, un seul : Faire aimer à l’ouvrier son métier. Il n’est pas difficile à ce travailleur de conserver cette vertu, de la développer en prévision des nécessités révolutionnaires de demain qui exigeront devant la défection presque certaine d’une partie assez importante de techniciens, des connaissances pratiques et techniques étendues, pour assurer le fonctionnement de l’appareil de la production dans toutes ses sphères.
Qu’on cultive celui-ci, mais qu’on abandonne sans plus tarder celui-là. C’est une nécessité impérieuse.
Pierre BESNARD
CORRECTION (MAISONS DE)
n. f.
« Établissements dans lesquels on place les enfants pervertis, mauvais ayant ou non commis un délit ― et ayant pour but la rééducation morale de l’enfance », telle est la définition bourgeoise et officielle de ces maisons.
En vérité, il y a loin de cette définition à la réalité et le but recherché n’est jamais atteint car, d’après les statistiques on peut se rendre compte que les 99 % des gosses qui ont séjourné dans les maisons de correction en sortent tout à fait dépravés.
On peut dire, sans s’exposer à être taxé d’exagération, que les maisons de correction sont les plus grands fournisseurs de contingents du bagne, des prisons, de Biribi et de la guillotine.
L’idée de ces établissements revient aux religieux et date de la révocation de l’Édit de Nantes (1685).
Lorsque, sous l’influence des Jésuites, Louis XIV enjoignit aux protestants de se convertir au catholicisme sous peine des galères et de « mort civile », les prêtres s’inquiétèrent tout de suite des enfants de ceux qui ne voudraient pas abjurer leur confession religieuse et une ordonnance royale les autorisa à se saisir des gosses des deux sexes pour « les rééduquer religieusement ». Les premiers temps on enlevait les enfants et on les plaçait dans les couvents pour en faire soit des moines, soit des religieuses. Mais certains de ces fils d’hérétiques ne voulurent point se plier docilement aux ordres de leurs nouveaux confesseurs ; aussi l’Église, par ordonnance royale du 19 mai 1692, fut autorisée à ouvrir des maisons de correction destinées à punir les enfants rebelles et à les ramener par tous les moyens dans la voie du salut.
Par la suite, les prêtres ouvrirent des maisons de filles repenties, destinées à recevoir les jeunes filles arrêtées pour s’être livrées à la débauche. Et puis, enfin, le cercle des maisons de correction fut élargi et l’on confia aux pères de l’Église la tâche de « corriger » les enfants coupables de délits ou de crimes et que leur jeune âge soustrayait à la justice ordinaire.
La révolution de 1789 abolit ces établissements, mais quand Louis XVIII monta sur le trône il rétablit, par une ordonnance datée du 27 janvier 1816, tous les édits royaux de Louis XIV et Louis XV. Mieux, même, il autorisa les bons pères à se saisir des enfants des républicains et de les « rééduquer religieusement ».
Louis-Philippe restreignit le pouvoir des prêtres et ne leur accorda plus que les enfants délictueux ou les filles se livrant à la débauche.
La révolution de 1848 abolit cela, mais Napoléon III rétablit ce privilège. Toutefois, il créa des maisons de correction dépendant directement de l’administration pénitentiaire, dans lesquelles les prêtres et les religieux faisaient office de gardiens. Puis en 1863, un décret plaça les maisons de correction religieuses sous le contrôle du président de la Cour d’appel du ressort.
Enfin, le 14 décembre 1905, à la suite de la loi sur la séparation des églises et de l’État, un décret d’administration publique plaçait toutes les maisons de correction dans les mains de l’administration pénitentiaire.
Il y a actuellement treize maisons de correction en France.
Dix dites colonies d’éducation pénitentiaire pour les garçons : Aniane (Hérault) ; Auberives (Haute-Marne) ; Belle-Isle (Morbihan) ; Les Douaires (Eure) ; Eysses (Lot-et-Garonne) ; Sacuny (à Brignais, Rhône) ; Saint-Hilaire (Vienne) ; Saint-Maurice (Loir-et-Cher) ; Le Val d’Yèvre (Cher) ; Gaillon et trois colonies de préservation pour jeunes filles : Cadillac (Gironde) ; Clermont (Oise) et Doullens (Somme).
Les maisons de Clermont pour les filles et de Gaillon et Eysses pour les garçons, ont un règlement plus rigide, car elles sont des colonies correctionnelles destinées à recevoir les « incorrigibles » des autres maisons.
Ces établissements dépendent du ministère de la Justice et sont administrés tout à fait comme les prisons : à la tête de chacun, sont : un directeur, un gardien-chef, deux ou trois premiers gardiens et un contrôleur du ministère, chargé « en principe » de veiller aux intérêts des colons ― mais en réalité qui joue uniquement, comme, du reste, dans les prisons, le rôle de sous-directeur.
En plus des gardiens ordinaires, le Gouvernement adjoint encore un détachement de soldats dont le nombre va de vingt jusqu’à cent vingt (comme à Clermont et à Eysses).
Il doit y avoir en outre, un instituteur, mais dans certaines maisons cela a été jugé superflu et c’est un gardien qui remplit cet office.
Le règlement est très sévère et identique à celui des Maisons Centrales d’adultes. Une discipline des plus féroces doit régner et les enfants sont à la merci des gardiens.
Chaque manquement au règlement équivaut à une punition qui s’aggrave chaque fois. Les colons délinquants sont amenés au « Prétoire », audience que donne le directeur aux gardiens qui ont à se plaindre ou à signaler des contraventions au règlement.
Le gosse comparaît devant le directeur ― ou, à son défaut, le gardien-chef ― et ne peut fournir aucune explication. Sitôt que le gardien s’est expliqué, le gosse s’entend condamner à l’une des sanctions prévues par le règlement. Ces sanctions sont ainsi échelonnées :
-
Pain sec ; allant de quatre à quinze jours (qui peut être renouvelée incessamment) ; pendant tout le temps de sa punition le gosse reçoit chaque jour une ration de pain, et tous les quatre jours une gamelle de bouillon le matin et une gamelle de légumes le soir ;
-
Cachot ; de huit jours à un mois (en principe, pour toute peine de cachot dépassant un mois, le directeur doit se faire approuver par le ministère, mais on a trouvé le moyen de tourner la difficulté : quand le gosse a fini sa peine d’un mois, on le fait de nouveau comparaître au prétoire où il se voit renouveler sa punition) ― même régime alimentaire que le pain sec, avec, en plus, la détention dans un cachot sans air et sans lumière ;
-
Salle de discipline ; de huit jours à un mois et demi. Un des plus terribles supplices que l’on puisse endurer.
La « salle » est une pièce d’à peu près quinze mètres de long sur trois de large. Au milieu est tracée une piste circulaire de 0 m. 40 de largeur. Les gosses doivent marcher sur cette piste au pas cadencé de six heures du matin à huit heures du soir (un quart d’heure de marche alternant avec un quart d’heure de repos) ; les pieds nus dans des sabots sans bride et non appropriés à la pointure (ce qui fait que les punis ont les pieds en sang au bout de la journée). Ils doivent marcher les bras croisés sur la poitrine et touchant le dos de celui qui les précède.
Inutile d’ajouter que tous, indistinctement, sortent de la « salle » pour aller à l’infirmerie.
Mais si le gosse tombe malade avant l’expiration de sa punition, il doit, en sortant de l’infirmerie, retourner à la « salle » pour accomplir la fin de sa peine.
-
Les fers ; allant de 4 jours à un mois. C’est la peine du cachot avec cette aggravation que le gosse a les pieds enfermés dans des pedottes et les mains dans des menottes. Quelquefois, même, on applique la crapaudine, c’est-à-dire que l’on attache les mains et les pieds derrière le dos et que l’on fait rejoindre l’extrémité de ses membres par une corde solidement serrée. L’enfant doit boire, manger et même faire ses besoins dans cette position. Ce qui fait qu’au bout de deux ou trois jours le gosse, mis dans l’impossibilité de se dévêtir, fait ses besoins dans son pantalon et reste dans ses excréments jusqu’à l’expiration de sa punition.
Enfin, à la colonie d’Eysses, on a ajouté à cela la basse fosse. Cet établissement est un ancien couvent de dominicains et il y a (à titre historique, dit-on) une ancienne oubliette dans laquelle les bons pères devaient plonger les moines hétérodoxes.
On envoie, maintenant, pour une période de un à quatre jours les délinquants trop « terribles ».
Attachés aux pieds et aux mains, les gosses sont descendus au bout d’une corde. L’atmosphère est nocive et, sans air, envahi par l’humidité, le malheureux risque l’asphyxie.
Tous les huit heures il est remonté au bout de la corde et examiné par un docteur qui n’a qu’un seul devoir : déterminer si le gosse peut supporter encore huit heures de supplice.
Il est arrivé que le docteur se trompe... alors à la huitième heure on remonta un cadavre !
Nourriture. ― La nourriture est à peu près la même qu’en prison ; matin : bouillon ; soir : soupe et légumes (oh ! si peu). Jeudis et dimanches une petite et très mince tranche de matière caoutchouteuse qu’on dénomme viande par euphémisme. Les gosses non punis ont du pain à volonté ― mais il y en a très peu qui profitent longtemps de cet avantage. Autrement ils ont à peu près la ration que l’on accorde dans les prisons.
Travail. ― Tout détenu est astreint au travail. Dans les colonies possédant assez de terrain, les gosses sont pour la plupart employés aux travaux agricoles.
Dans les autres et dans les maisons de filles, ils sont alors, comme dans presque toutes les prisons, exploités d’une manière féroce.
Des « entrepreneurs » du dehors ont obtenu la concession des travaux. Les gosses fabriquent un peu de tout pour le bénéfice du concessionnaire. Ils sont alors sous la surveillance non seulement de leurs gardiens mais encore d’un contremaitre civil n’appartenant pas à l’administration et salarié par l’entrepreneur pour « diriger » la production.
Comme de bien entendu, les gosses ne touchent pas un sou de leur labeur ― sauf de rares exceptions ― et ils sont « tâchés » ; c’est-à-dire qu’ils doivent accomplir une quantité déterminée de travail. La « tâche » n’est pas conditionnée à la capacité productrice de chaque gosse ― elle est déterminée arbitrairement par le directeur.
Si le colon est malhabile ou malade et qu’il ne fasse pas la production déterminée, il est alors conduit au prétoire et se voit appliquer pour « défaut de tâche » les mêmes punitions, énumérées plus haut, que pour les infractions au règlement.
Comme on peut s’en rendre compte par la description ci-dessus, les enfants sont traités aussi durement (quelquefois davantage) que les adultes.
Des faits scandaleux se sont produits, des gosses ont été torturés et même assassinés dans ces maisons ― des enquêtes furent faites depuis 1905 par des hommes de différentes tendances et toutes ont dévoilé des faits horrifiants. Mais nous ne les relèverons pas en cette étude. Notre but étant d’étudier l’institution et non les faits ; d’autre part nous ne voulons donner nulle place au sentiment ― ce qui ne serait pourtant pas hors de propos.
Il y a d’autres sortes de maisons de correction :
Les maisons de préservation, les patronages de l’enfance, les œuvres de relèvement moral et les patronages religieux.
Les maisons de préservation peuvent être divisées en deux catégories : les prisons et maisons d’enfants. Elles ne sont point destinées à recevoir des enfants délictueux. C’est seulement à la demande des parents que les enfants sont détenus dans ces établissements. Quand des parents ne sont pas contents ou veulent pour de motifs mesquins se débarrasser de leurs enfants, ils vont au commissariat de police et, moyennant un versement de tant par jour (les sommes varient suivant la richesse des parents) ils font appréhender leurs gosses qui sont mis dans ces maisons jusqu’à ce que les parents les réclament ou cessent de payer la redevance. Dans le deuxième cas, si les parents déclarent se désintéresser de leur progéniture (il se trouve, hélas ! des pères et des mères assez dénaturés pour faire cela), les gosses sont placés dans les patronages.
Patronages religieux. ― Les prêtres, ces gens qui, à leurs dires, prêchent la loi d’amour, jouent un rôle prépondérant dans la répression de l’enfance.
À côté de leurs maisons de correction, ils avaient imaginé une combinaison très lucrative.
Quand un enfant échappé de ses parents était arrêté en état dit de « vagabondage » les prêtres demandaient au magistrat de leur confier l’enfant jusqu’à sa majorité, soi-disant pour lui apprendre un métier et pour le relever moralement. Et ils avaient monté de vastes établissements agricoles, en province, dans lesquelles ils exploitaient d’une façon atroce les petits malheureux qui leur étaient imprudemment confiés. Des scandales éclatèrent qui firent fermer bon nombre d’établissements, et depuis 1905 l’État ne leur confie plus de gosses. Alors ils trouvèrent autre chose, ils allèrent chez les parents pauvres et chargés de marmaille ou bien chez ceux qui étaient mécontents de leur enfant et ils leur demandèrent des gosses. Les garçons sont pour la plupart employés à l’agriculture, les filles dans les ouvroirs, et ce, jusqu’à leur majorité. La vie y est aussi infernale que dans les maisons de correction de l’État.
Patronages de l’enfance. ― Ceux-là sont l’invention de grands « philanthropes ». Au fur et à mesure que les scandales éclataient dans les patronages religieux, les soi-disant démocrates approfondirent le problème de l’enfance. Se servant d’appuis politiques, ils ne tardèrent pas à se voir autoriser à monter des œuvres similaires aux patronages cléricaux. Associés, ils créèrent des « œuvres pour le relèvement moral de l’enfance ». Puis une législation fut mise au point, qui créait les tribunaux pour enfants. Alors ce fut et c’est demeuré l’âge d’or pour ces individus.
Tous les délits, contraventions et crimes commis par des mineurs âgés de moins de seize ans (depuis on a étendu à dix-huit ans la limite), sont soumis à la juridiction spéciale du tribunal d’enfants.
Ce tribunal est composé d’un président et de deux juges assesseurs. Un substitut représente le Gouvernement. L’accusé a le droit de se faire défendre par un avocat ― mais en plus du tribunal correctionnel ordinaire, un sixième personnage entre officiellement en scène. C’est un avocat ou un représentant d’un patronage ou d’une œuvre de relèvement.
Après la plaidoirie et le réquisitoire, ce représentant se lève et demande (ce qui est toujours accordé sauf dans les cas graves) qu’on lui confie l’enfant jusqu’à sa majorité.
Et le tribunal pour enfants de la Seine est même présidé par M. Rollet qui est en même temps fondateur-président d’une œuvre qui porte son nom : le patronage Rollet.
En outre des enfants « confiés » par le tribunal, ces patronages acceptent aussi les gosses amenés par les parents.
Une fois l’enfant dans leurs mains, ils le laissent quelque temps dans la « maison mère » où ils font des travaux pour le compte d’entrepreneurs civils. Si l’enfant travaille bien, qu’il est un peu malingre, ils le gardent là jusqu’à sa sortie. Il aura à subir le même régime que dans les maisons de correction de l’État, les mêmes punitions (moins la salle de discipline) et le même traitement alimentaire. Seulement, une fois par mois (s’il est sage) il pourra voir ses parents au parloir. Il gagnera environ quatre ou cinq sous par jour pour un labeur exténuant et malsain.
Autrement il sera placé chez des cultivateurs, dans une bourgade lointaine de province.
Là, il devra travailler dur et, sans souci de ses possibilités physiques, il devra exécuter du petit jour à la tombée de la nuit, les travaux les plus pénibles et les plus répugnants ; il subira toutes les vexations et même les mauvais traitements de maîtres qui n’ont nul besoin de se gêner ― il y a bien un inspecteur qui passe ou devrait passer tous les ans, mais si le gosse réclame il est considéré comme mauvaise tête et, en fin de compte c’est toujours lui qui aura tort.
Certes il pourra écrire à ses parents, mais le paysan lira les lettres avant de les envoyer.
Naturellement il sera aussi mal, sinon plus, que le sont d’ordinaire les petits valets de ferme.
Il touche un salaire de 100 francs par an, mais dessus il lui est retenu 60 % pour ses vêtements et sa nourriture.
S’il réussit à s’évader et s’il est repris, on l’envoie directement en colonie pénitentiaire ― quelles que soient les raisons qu’il puisse donner.
Cependant que les patronages touchent une redevance de l’État, plus une redevance du paysan.
Certaines de ces œuvres ― comme le patronage Julien ― sont montées par actions et distribuent en fin d’année des dividendes à leurs sociétaires.
Œuvres de relèvement moral de jeunes filles. ― Ces œuvres fonctionnent à peu près comme les patronages, à cette exception qu’elles ne placent pas chez des particuliers.
Montées de la même façon que les patronages, elles reçoivent leurs contingents des tribunaux d’enfants.
Seulement elles ont encore une « clientèle » spéciale ― mais ici il faut expliquer une monstruosité de la loi sur la répression de l’enfance.
En principe une jeune fille a le droit de quitter ses parents à quinze ans, à condition qu’elle mène une « existence sans reproche » et qu’elle puisse prouver qu’elle peut vivre de son propre travail.
Il en est toutefois autrement en vertu d’une « loi sur la protection de l’enfance » votée en 1912.
Une jeune fille quitte-t-elle ses parents sans les prévenir et ceux-ci, désolés et inquiets de ne la point voir revenir, vont-ils au commissariat faire part de leurs inquiétudes ? ― Si la jeune fille est retrouvée, on l’arrête et, sans prévenir les parents, on la fait comparaitre devant le tribunal d’enfants qui la confie à une œuvre de relèvement jusqu’à sa majorité. Les parents protestent-ils ? On leur dit que leur démarche auprès du commissaire a été considérée comme un dépôt de leur enfant. Veulent-ils faire appel du jugement ? qu’ils sont incapables de surveiller « dignement ». Le procureur de la République leur apprendra que ce n’est pas un jugement mais une « décision » qui a été prise par le tribunal et qu’en conséquence leur instance en appel est irrecevable en droit.
J’ai eu, malheureusement, trop de preuves de cela apportées, alors que je faisais une enquête dans le Libertaire, par des parents indignés et désolés, mais impuissants, qui demandaient depuis de longs mois qu’on leur rendit leur fille sans qu’ils pussent obtenir gain de cause.
Les fillettes sont enfermées comme dans les prisons de femmes. Elles travaillent dans la journée dans des ouvroirs, ne gagnent rien ou dix sous par jour, suivant les maisons ; ont le même régime que dans les prisons, tant au point de vue discipline, punitions, hygiène et régime alimentaire. Elles peuvent voir une fois par mois (à condition de ne pas avoir été punies dans le mois) leurs parents au parloir en présence d’une surveillante.
Et, comme pour les patronages, certaines « œuvres de relèvement » sont constituées par actions et distribuent des dividendes annuels.
But recherché par le législateur.
Admettons pour un instant la sincérité de ceux qui ont combiné le système des maisons de correction. Quel était le but qu’ils se proposaient d’atteindre ? Quelles sont les raisons données pour le maintien d’un pareil état de choses ?
Voici comment parlent les « protecteurs » de l’enfance :
« Soit par de mauvaises fréquentations, soit par manque de surveillance des parents, soit encore par les mauvais exemples de ceux-ci, il y a des enfants qui commettent des délits, qui, petit à petit se pervertissent et qui ne tarderaient pas, si nous n’y mettions bon ordre, à devenir de dangereux bandits.
La plupart du temps, nous voulons bien l’admettre, l’enfant agit plutôt par inconséquence, mais le vice devient vite une habitude.
Il faut donc soustraire l’enfant qui a des tendances au vice, à l’ambiance dans laquelle il vit.
Il faut le placer dans des lieux où il apprendra la force de la vertu, où il sera rééduqué totalement et d’où il sortira homme sain physiquement et moralement, ayant appris la vertu du Travail.
Au reste, ce ne sont pas des maisons de répression, mais uniquement, comme leur titre l’indique, des maisons de « correction morale » ou si vous aimez mieux, des espèces de sanatoria moraux que nous établissons. Si au début il y a la pénitence, c’est uniquement pour leur faire comprendre qu’ils ont fauté et que toute faute doit avoir sa punition. »
Causes du mal.
On pourrait répliquer à ces « bonnes âmes » beaucoup de choses.
Quelles sont, en effet, les causes de la perversion de l’enfance ?
Le mauvais exemple ? ― eh, oui ! Mais pas celui des parents : celui que leur donne la société par sa composition et son essence même.
Quels sont, pour la presque totalité, les enfants « pervertis » ? Des enfants pauvres, de familles nombreuses.
En effet prenez les statistiques et dénombrez les enfants. 98% sont ou des gosses de familles nombreuses, ou des gosses de veuves, ou de filles-mères, ou des orphelins.
Or, promenez-vous un instant dans les rues des villes. Qu’y voyez-vous ? De grands magasins ayant des étalages somptueux, des maisons d’alimentation aux vitrines emplies de toutes sortes de bonnes choses, des pâtisseries étalant des friandises convoitables, des tailleurs exposant les costumes les plus divers, des cordonniers montrant des chaussures de toutes formes.
Pénétrez maintenant dans la vie des gosses de pauvres. Que remarquez-vous ?
D’abord leurs parents travaillent toute une longue journée pour ne ramener qu’un salaire insuffisant à l’aisance de la famille.
Les gosses mangent rarement à leur faim, ils ont des habits troués et rapiécés, des chaussures lamentables ; ils ne connaissent pas la joie des friandises et d’un bon repas les laissant rassasiés.
Alors comment voudriez-vous que ces gosses privés de tout, livrés à la rue pendant que leurs parents s’échinent à l’atelier ― comment voudriez-vous qu’ils n’eussent pas un regard d’envie devant toutes les belles choses qu’on met à leur vue dans les devantures ? Comment n’auraient-ils pas envie de connaître des joies ― en somme toutes naturelles ― que la misère leur interdit ? Et de l’envie, de la convoitise, comment ne seraient-ils pas tentés de s’approprier un peu de cette joie qui, après tout, leur appartient aussi légitimement qu’aux autres ?
Et si, un jour, la tentation étant trop forte, ils commettent un larcin ; à qui incombera leur faute ? À eux ? À leurs parents ?
Que non, pas ! à la société qui permet qu’il y ait trop d’un côté tandis qu’il y a pénurie ― et pénurie la plus complète d’autre part.
Mais laissons ce raisonnement logique de côté. Pour un instant ne raisonnons plus en anarchistes ; plaçons-nous du point de vue bourgeois.
Admettons (oh ! uniquement pour la démonstration) que ce ne soit pas la société qui soit coupable ― que ce soit l’enfant, seul ou avec ses parents, qui doive supporter la responsabilité de cela.
Les gens « comme il faut » appliquent-ils une méthode efficace ?
Méthode appliquée et résultats obtenus.
Donc, c’est bien cela, par suite de mauvaises fréquentations, de mauvais exemples ou d’ambiance familiale, l’enfant commence à se pervertir. Il faut donc l’arracher de son mauvais milieu, détruire en lui le mauvais germe et le rééduquer totalement.
Il faudrait logiquement entourer le gosse de personnes saines moralement, instruites et capables, par leur exemple, d’inculquer la vertu du travail à ces jeunes cervelles. Il faudrait considérer les gosses comme des malades moraux et les doter de rééducateurs paternels qui leur fassent comprendre qu’ils ont commis des fautes parce qu’ils ne savaient pas et qu’on ne leur garde pas rancune ; qu’on veut, non pas les punir mais les empêcher de recommencer les mêmes actes en leur apprenant la beauté d’une existence faite de labeur et d’honnêteté. (Je tiens à faire remarquer que ce n’est pas moi, mais le raisonnement bourgeois qui parle ainsi).
Or, comment s’y prend-on pour arriver à ce résultat ? Le personnel employé dans les maisons de correction est loin, très loin de répondre au but recherché. Les surveillants (gardiens et gardiennes) sont pris parmi les paysans pas tout à fait illettrés, mais peu s’en faut, qui, ayant trouvé que le travail de la terre est par trop fatigant ― ainsi que tout autre travail ― ont choisi cette place de tout repos qu’est la « fonction » de gardien de prison.
Ont-ils seulement, ces paysans non cultivés, un sens moral suffisant pour leur tâche d’éducateurs ? Non ; pour la plupart ― pour ne pas dire la totalité ― ce sont des brutes méchantes et ne cherchant qu’à faire du mal à ceux qui sont sous leurs ordres.
Ils ne voient pas en les colons qu’on leur confie des jeunes êtres égarés qu’il faut ramener dans le bon chemin ― ils voient en chaque détenu un bandit, une « forte tête » qu’il faut mâter par la terreur et la violence.
L’ambiance d’une maison de correction est-elle une ambiance régénératrice ? Allons donc !
Dans les colonies pénitentiaires, comme dans les patronages, sévissent les mêmes mœurs que dans les centrales, Biribi ou les bagnes. L’onanisme, seul ou à deux, est une règle générale. La sodomie fait aussi de grands ravages. Les grands forcent les petits, les forts obligent les faibles à subir leurs exigences sexuelles ― et quelquefois, même, les gardiens s’en mêlent.
Les gosses prennent-ils conscience de la beauté d’une vie de travail ? Non !
Ensemble ils se racontent leurs coups, en combinent d’autres pour le jour de leur libération et il est commun de voir des gosses qui seraient devenus de bons et de braves petits gars monter des associations. Quand ils sortent, pour la plupart ils recommencent en grand ce qu’ils n’avaient fait qu’en petit et tels qui auraient fait des hommes courageux, vont inaugurer, dès leur sortie, une vie qui les conduira de prison en prison, quand ce n’est pas au bagne ou à l’échafaud.
Vous avez pris, ô moralistes, des gosses égarés qui pouvaient se reprendre et vous en avez fait de la chair à souffrance, de la chair à prison.
Non seulement votre but n’est pas atteint, mais, au contraire, il est complètement éloigné : vous ne faites que fournir des contingents aux machines à condamner que sont les magistrats.
Conclusion.
Même du point de vue bourgeois, la théorie des maisons de correction ne tient pas devant les faits.
Rien ne peut légitimer, à quelque tendance politique qu’on appartienne, la survivance des « bagnes d’enfants ».
Aussi devons-nous nous attacher à dénoncer devant l’opinion publique ce reste de barbarie qu’est l’institution des maisons de correction.
Combattons pour faire supprimer ces lieux où l’on torture l’enfance.
En attendant le jour où nous établirons un milieu social qui, assurant à chaque individu le droit au bonheur, supprimera la misère : cause de tous les vices et de tous les crimes.
― Louis LORÉAL
CORRUPTION
n. f.
Action par laquelle une chose se désorganise, s’altère, se putréfie. « La corruption de la viande. »
Le mot « Corruption » s’emploie surtout comme synonyme de dépravation physique ou morale. « L’époque du Directoire s’est signalée par la corruption de ses mœurs ».
L’argent est une source de corruption et les hommes qui se vendent à une cause, qui sacrifient leurs opinions et leurs idées et qui se laissent corrompre pour de l’argent, sont nombreux. C’est surtout sur le terrain politique que s’exerce la corruption. Il est peu de parlementaires qui ne se laissent acheter et qui ne consentent à tromper pour certains avantages matériels, leurs électeurs confiant en la sincérité de leurs représentants.
Peut-il du reste en être autrement au sein d’une société où tout se vend et tout s’achète, où on ne vit que sur le mensonge et où le bonheur appartient au plus adroit et au plus rusé ? C’est toute l’organisation sociale présente qui est corrompue, et c’est la raison pour laquelle elle ne peut être réformée, mais qu’il est nécessaire d’en ébranler les assises et d’en abolir les institutions, si nous voulons réellement voir succéder à la corruption moderne une ère de loyauté et de franchise.
COSMOS
n. m.
Ce mot grec n’entrait dans le latin du moyen-âge et dans les langues modernes qu’en composition (macrocosme, microcosme, cosmopolite etc.). Le succès de Cosmos, ouvrage consacré par Alexandre de Humboldt à la description de l’univers (1847–1851), a fait des doux mots cosmos et univers des synonymes ou à peu près.
Le penchant unificateur de l’esprit humain rend tendancieux et anti-pluralistes tous les termes qui servent à désigner l’ensemble des choses. Le langage ne permet pas plus d’exposer, sans contradiction apparente, une philosophie pluraliste qu’une doctrine phénoméniste. La prudente périphrase que je viens d’employer, « l’ensemble des choses », chuchote déjà, malgré mon sentiment, je ne sais quelle unité. Univers aussi. Monde etcosmos affirment, en outre, que l’univers est ordonné selon un plan.
Cosmos, chez les premiers grecs, n’avait d’autre sens que celui d’ordre ou arrangement. Ce sont les pythagoriciens qui commencèrent à désigner ainsi l’univers ; ils voulaient que leur seule façon de le nommer fut déjà éblouissement d’adoration devant l’ordre et l’harmonie qui leur paraissait éclater en lui.
Le succès du pythagorisme dans la grande Grèce le fit pénétrer de bonne heure à Rome. Mundus ne signifiait d’abord, lui non plus qu’ornement et arrangement. Dès Ennius et Plaute il devint le nom le plus fréquent, comme le plus glorieux et le plus pieux, de l’univers.
Lorsque Socrate se dit « citoyen non d’Athènes, mais du Cosmos », il veut se déclarer le frère de tous les hommes, hellènes et barbares ; et il se glorifie de faire partie de la totale organisation. La première intention est certaine ; la seconde, fort probable, puisque Diogène répétant qu’il est « citoyen du Cosmos » ajoute : « Et je ne connais qu’un gouvernement digne d’admiration, le gouvernement du Cosmos. » Les stoïciens proclament aussi leur admiration pour « la cité de Zeus »... Sommes-nous bien loin de la « cité de Dieu » de Saint Augustin ?
Oui et non. Pour le stoïcien, la cité de Zeus est le monde actuel ; pour le chrétien, la cité de Dieu est un monde futur, ciel ou millénarisme théocratique. En outre, pour le chrétien, l’œuvre suppose un ouvrier personnel. Le stoïcien n’adore pas un Dieu sage qui aurait créé ou ordonné le monde ; mais il croit qu’une sagesse abstraite, une loi, le gouverne et le rythme.
Le chrétien affirme en dehors de l’expérience et compense le mal réel par un bien chimérique ; le stoïcien, plus hardi, nie le mal et affirme contre l’expérience.
Tout dans l’univers est mouvement aveugle, mort et renaissance. L’équilibre apparent y est comme on dit statique : fait de chancellements et de luttes qui se compensent ou à peu près. Des étoiles s’éteignent puis se rallument au choc d’autres astres éteints. L’attraction jette des masses incandescentes vers d’autres incendies. La répulsion lance à toute vitesse dans l’étendue des planètes brisées, ruines et débris. Il n’y a pas de pensée même abstraite, dans ce désordre. Le prétendu Cosmos est un chaos.
Il n’y a pas sagesse dans l’effarant gaspillage de germes auquel se livre ce que nous avons le tort d’appeler au singulier la Nature ; dans la mort de tant d’êtres à demi formés pour le développement d’un seul. Quelle fantaisie ridicule charge la femelle enfant d’un nombre d’œufs infiniment plus considérable que la femelle adulte ? Le biologiste Hansemann constate que, chez la femme, l’ovaire contient à deux ans, cinquante mille œufs, vingt-cinq mille à huit ans ; à dix-sept ans, cinq mille. Cinq cents en moyenne parviendront à maturité. Et cette dépense fantastique pour obtenir la fécondation de combien d’œufs ? La nature maladroite fait peu avec beaucoup et, si nous cherchions en elle de la sagesse, nous voici obligés de crier à la folie. Ailleurs elle fait beaucoup avec peu et multiplie les bouches affamées plus rapidement que les nourritures.
L’ordre, le cosmos, simples désirs de notre esprit et de notre cœur. Le chaos mondial est moins encore justice ou amour qu’harmonie.
« L’exploration de notre système solaire — dit Auguste Comte — a fait disparaître toute admiration aveugle et illimitée en montrant que la science permet de concevoir aisément un meilleur arrangement ». Et il remarque, non sans finesse : « Quand les astronomes se livrent à un tel genre d’admiration il porte sur l’organisation des animaux qui leur est inconnue ; les biologistes. qui en connaissent toute l’imperfection, se rejettent sur l’arrangement des astres dont ils n’ont aucune idée approfondie. »
L’observation montre pourtant de la finalité dans la nature, mais jamais une finalité parfaite. Ce qu’on vante le plus souvent, au détail, ce sont des remèdes insuffisants à de graves défauts. Nous ne rencontrons que des finalités boiteuses. Pas seulement partielles, mais divergentes et hostiles les unes aux autres. La lutte pour la vie suffit à faire écarter toute idée de plan universel. La nature se manifeste, à la fois, conspiration pour la vie, conspiration contre la vie. Comment expliquer son incohérence ? Question métaphysique, que nul ne résoudra scientifiquement, que chacun peut résoudre poétiquement, pour lui seul, selon ses tendances. Mais considérer le monde comme l’œuvre d’un Dieu ou comme une pensée divine sans Dieu personnel, ce n’est plus souriante poésie, c’est ridicule démenti à l’expérience.
HAN RYNER.
COTERIE
n. f.
On appelle coterie un nombre d’individus qui s’associent pour soutenir ou discréditer une œuvre, un individu ou un groupe d’individus. Il y a des coteries politiques, sociales, commerciales, littéraires. D’ordinaire la Coterie ne s’embarrasse pas de vains « préjugés » et emploie tous les moyens qui sont susceptibles de lui assurer le succès. « La fin justifie les moyens » pourrait lui être appliquée comme devise.
La coterie est dangereuse car elle n’agit pas franchement et cherche des chemins détournés pour arriver à son but ; elle est un adversaire redoutable qui se cache parfois sous le masque de l’amitié. I1 faut donc s’en méfier.
De tous les temps les hommes de réelle valeur furent victimes des coteries et cela dans toutes les branches de l’activité humaine. En littérature comme en politique lorsque un artiste ou un homme sincère se signale à l’attention du public, immédiatement il est entouré des ambitieux et des incapables qui cabalent contre lui, et cherchent à l’écraser. On pardonne tout à un individu, sauf son intelligence ; car c’est une chose qui ne peut s’acheter et c’est sans doute la raison pour laquelle les hommes de valeur sont les victimes des coteries.
« Que diantre me poussait à vouloir être de l’Académie, moi qui m’étais moqué quarante ans des coteries littéraires. » (P.-L. Courrier.)
On peut regretter que ce ne fut que lorsqu’il se vit refuser l’entrée de l’Académie à laquelle il avait posé sa candidature que Paul-Louis Courrier s’aperçut que cette association de vieillards était une coterie chargée de veiller au respect de la tradition, et qui rejetait tout ce qui semblait être imprégné des idées de progrès.
La Coterie, c’est presque l’histoire du monde, nous dit Lachâtre ; et c’est, hélas ! vrai.
Jusqu’à présent nous avons toujours été gouvernés par des coteries qui se fichent du bonheur du peuple et ne s’intéressent qu’aux jouissances de la faible minorité qui nous exploite ; coterie financière, coterie politique, artistique, littéraire, s’entendent pour asservir notre corps, notre cerveau et notre cœur. Peut-être est-il temps que cela change.
Les opprimés n’en ont-ils pas assez d’être depuis toujours soumis à ces coteries qui font régner leur dictature sur les humains et retardent la marche des civilisations ? La coterie ne peut être maîtresse du monde que grâce à la passivité des peuples qui se refusent à penser et à agir par eux-mêmes et si les hommes avaient un peu plus soin de leurs propres affaires et un peu moins de lâcheté, les coteries d’incapables et de profiteurs auraient bientôt fait de nous débarrasser de leur présence.
COURAGE
n. m.
Fermeté physique ou morale qui nous fait entreprendre certaines actions dangereuses et nous permet de repousser avec hardiesse les revers et les douleurs éventuelles.
Le courage serait une grande qualité, s’il était mis au service d’une noble cause ; malheureusement il n’en est pas toujours ainsi, bien au contraire.
« Le courage, qui n’est pas une vertu, mais une qualité heureuse commune aux scélérats et aux grands hommes, ne l’abandonne pas dans son asile ». (Voltaire.)
En effet, autant le courage peut être bienfaisant, autant il peut être nuisible, car il n’est pas le privilège d’une catégorie d’individus et le plus audacieux des coquins peut être courageux ; et plus il l’est, plus il est malfaisant.
Peut-on considérer de la même essence le courage du savant qui risque sa vie en soignant des malades infectés et celui du bandit inconscient ou intéressé qui attend sa victime et la supprime brutalement ? L’un et l’autre ont des risques à courir et savent ce que peuvent leur coûter leurs dévouements ou leurs crimes, et pourtant ni l’un ni l’autre ne sont arrêtés dans l’accomplissement de leurs actes ; ils sont courageux.
Le courage ne peut pas et ne doit pas toujours être admiré. Le courage du lion est un désastre pour les troupeaux, et il serait certes préférable qu’il soit un peu moins courageux et qu’il ne vienne pas dévaster, à la grande terreur des indigènes, les contrées qu’il habite.
Peut-on admirer le courage militaire ? Certes l’armée la plus courageuse est celle qui a le plus de chance de se couvrir de gloire en emportant d’éclatantes victoires ; mais que de crimes se sont commis, se commettent et se commettront sans doute encore en vertu de ce courage qui se manifeste sur les champs de bataille ! Pour nous, révolutionnaires, un tel courage est loin de nous enthousiasmer car il est une cause de souffrances et de douleurs.
On donne souvent au mot courage une interprétation qui nous paraît erronée. Vauvenargues considère la résignation comme « le courage contre les misères ». Nous ne sommes pas de cet avis et nous considérons, nous, que la résignation est tout au contraire l’opposé du courage, c’est-à-dire « la lâcheté ». Il nous paraît impossible de qualifier de courageux l’homme qui, victime de l’injustice sociale, se résigne à la pauvreté alors que tout, autour de lui, respire la richesse, et qu’il ne profite d’aucune jouissance. Une telle conception du courage nous ramènerait avec rapidité aux jours les plus sombres du passé, car jamais la résignation ne fut une source de progrès et de civilisation ; au contraire ce fut la révolte courageuse des hommes de science et d’action dans leurs luttes contre les préjugés, les iniquités, les injustices, qui permit aux hommes de s’affiner et de sortir dans une certaine mesure de l’esclavage sous lequel les tenaient courbés la nature indomptée et l’autorité brutale et féroce des autocrates.
Il faut être courageux, moralement et physiquement, si l’on ne veut pas être un vaincu de la vie. L’un complète l’autre.
Le courage des premiers chrétiens qui préféraient la torture et la mort, que de renier ce qu’ils pensaient être la vérité est symbolique, et s’ils surent résister à tous les outrages, à toutes les insultes, à toutes les misères, à toutes les tortures, c’est qu’ils puisaient leur courage physique dans leur courage moral. Devant une telle abnégation de soi-même, devant un tel sacrifice à une cause, on ne peut que s’incliner devant les héros livrés à la barbarie des tyrans ; et il faut souligner que si ces hommes et ces femmes surent mourir avec un tel courage, c’est qu’ils étaient animés par l’amour de l’Humanité et que la foi en un avenir meilleur gonflait leurs cœurs.
Le courage sera un des facteurs des victoires prolétariennes et si tout le courage dépensé inutilement depuis des milliers et des milliers d’années l’avait été au service de la civilisation, il y a longtemps que les hommes vivraient heureux dans une société fraternelle ou chacun travaillerait au bonheur de tous.
COURTISAN
n. m.
A l’origine le mot Courtisan désignait un personnage attaché à la Cour d’un monarque. A l’époque où la démocratie n’avait pas encore vu le jour, les rois et les princes étaient tout puissants et exerçaient le pouvoir seuls ou avec le concours de ministres qu’ils nommaient eux-mêmes. La démocratie n’a pas amélioré le sort du peuple mais elle a ébranlé la puissance des souverains.
L’autorité entre les mains d’un seul, faisait de l’homme qui la détenait un demi-dieu, entouré d’adorateurs et d’adulateurs qui cherchaient à plaire au maître pour en obtenir les faveurs. Les courtisans faisant partie de l’entourage direct du monarque, étaient ceux qui avaient le plus de chances de se faire remarquer et de capter la confiance du roi ou du prince auquel ils étaient attachés ; et pour conquérir des privilèges, les courtisans ne reculaient devant aucune bassesse.
Montesquieu a admirablement décrit le caractère du courtisan : « L’ambition dans l’oisiveté, la bassesse dans l’orgueil, le désir de s’enrichir sans travail, l’aversion pour la vérité, la flatterie, la trahison, la perfidie, l’abandon de tous ses engagements, le mépris des devoirs du citoyen, la crainte de la vertu du prince, l’espérance de ses faiblesses, le ridicule jeté sur la vertu, forment le caractère des courtisans ».
Octave Mirbeau n’a pas moins brutalement flétri le courtisan en général et celui du siècle de Louis XIV en particulier, qui, pour obtenir un regard du roi Soleil se rabaissait au rôle de valet de chambre et considérait comme un honneur de présenter la chaise percée au grand monarque. On s’imagine souvent que ces temps sont lointains et que de nos jours le courtisan a disparu. C’est une erreur. Le courtisan se rencontre encore, même en notre troisième République.
Marianne a une cour nombreuse et elle est exploitée par ses courtisans autant sinon plus que les monarques qui l’ont précédée.
Des courtisans on en trouve partout et le peuple lui-même est courtisé, flatté dans ses erreurs et dans ses vices, par ceux qui veulent lui arracher sa confiance. Le député n’est qu’un courtisan qui est capable, comme celui du roi, de mensonge, de dissimulation, d’hypocrisie, pour obtenir les suffrages de ses électeurs, et il est peut-être plus dangereux encore, car il donne au peuple l’illusion qu’il se gouverne lui-même, qu’il se dirige, qu’il est libre enfin, alors qu’en vérité il reste l’éternel esclave.
Tout homme qui détient une parcelle de cette autorité qui dirige le monde est entouré de courtisans avides, qui veulent aussi goûter au gâteau du capital. De là la corruption de la société. Les courtisans ne méritent que le mépris du peuple ; ils sont aujourd’hui ce qu’ils étaient hier, ils sont. disait le grand La Fontaine :
Sont ce qu’il plaît au prince, où s’ils ne peuvent l’être
Tâchent au moins de le paraître.
CRÂNERIE
n. f.
Être crâne ; crâner, avoir de la crânerie. Caractère d’un homme hardi, courageux, et poussant parfois le courage jusqu’à la témérité Dans le langage courant la valeur du mot est dénaturée et s’emploie plus fréquemment comme synonyme de vantard, de fanfaron. On dit aussi d’un individu fier, hautain, qui ne veut pas se confondre avec les autres, que c’est un « crâneur ».
CRAPAUDINE
n. f.
C’est en vain que l’on chercherait dans le « Larousse » ce que c’est que la Crapaudine. Il est vrai qu’officiellement elle n’existe pas, puisqu’en vertu des lois civiles ou militaires il est interdit aux représentants de la force ou du militarisme de faire subir des tortures aux hommes placés sous leur autorité.
C’est le secret de Polichinelle qu’en plein centre de Paris, « capitale du monde et de la Civilisation », les individus supposés coupables d’un crime sont soumis à la torture physique par les agents de la police judiciaire ; comment s’étonner alors qu’en Afrique, dans des contrées éloignées des populations civiles et où le chef militaire règne en maître absolu, de pauvres bougres soient victimes de la brutalité féroce du chaouch ?
La crapaudine est un instrument de torture en usage dans les bagnes militaires de l’Afrique, et il doit son nom à la position dans laquelle il maintient le malheureux supplicié, qui, les pieds et les mains rejetés en arrière et liés ensemble, a l’aspect d’un crapaud.
Le supplice est d’autant plus cruel qu’il s’exerce sous un soleil brûlant et que la victime en plus des douleurs que lui procure la position anormale de ses membres souffre atrocement de la chaleur et de la soif.
On a du mal à s’imaginer qu’en notre vingtième siècle une telle barbarie soit possible et que ces mœurs inquisitoriales ne soulèvent pas la réprobation générale.
De temps en temps lorsqu’une victime succombe sous le poids des souffrances endurées, le scandale éclate et la presse à tout faire élève faiblement la voix ; alors les responsables directs, c’est-à-dire les chefs de gouvernement couvrant leurs inférieurs, déclarent que des enquêtes sont en cours, que des sanctions seront prises contre les coupables et le calme renaît jusqu’au jour où une nouvelle victime de la crapaudine fait éclater un nouveau scandale. Et il en sera ainsi jusqu’au jour où le peuple, en ayant assez, ne se contentera plus des vagues promesses gouvernementales et des faibles protestations d’une presse intéressée. La crapaudine, qui pourrait figurer comme appareil de torture à côté de ceux du Jardin des Supplices d’Octave Mirbeau, doit disparaître ; mais il faut surtout, si l’on veut en finir avec tous ces procédés barbares, en rechercher les causes, et détruire le militarisme qui donne naissance à tant d’atrocités et de crimes.
CRAPULE
n. f.
Etat d’un individu dépourvu de tout sens moral et qui ne se plaît que dans le vice et la débauche. La crapule est plus abjecte encore que le vice ; la « crapule, dit J.-J. Rousseau, endurcit le cœur, rend ceux qui s’y livrent impudents, grossiers, brutaux, cruels ».
La bourgeoisie, pour cacher ses penchants au vice et à la débauche, accuse de crapulerie cette basse catégorie sociale d’inconscients et de malades qui se livrent à la prostitution ou en vit. Certes, le souteneur est loin d’être un individu recommandable et les Anarchistes sont les premiers à le dénoncer comme nuisible à la société ; mais la crapulerie n’est pas le privilège des pauvres, au contraire. Et s’il est des malheureux qui tombent de dégradation morale en dégradation morale dans la crapulerie, ils ont souvent l’excuse de l’ignorance et de la misère. Le riche qui se vautre dans l’orgie, dans l’ignominie, dans la bassesse ; qui recherche des voluptés dans le raffinement du vice et qui ne vit que dans une débauche constante, n’a pas l’excuse du pauvre et l’on peut dire que la crapule prend plutôt sa source dans les palaces, dans les établissements de nuit mondains que dans les bouges où vont se perdre les victimes inconscientes de la société capitaliste.
CRÉATION
n. f.
J’avoue être quelque peu embarrassé par le sujet, en tant que je dois le traiter en article de dictionnaire. D’abord, il acquiert forcément, de par sa nature même, un caractère très personnel. Ensuite, il est extrêmement vaste. Je considère le problème de la création (c’est-à-dire, celui de l’énergie créatrice, force mouvante fondamentale de l’évolution universelle) comme le problème actuel central de toutes les sciences, de tout notre savoir, de toute notre activité de penseurs, de chercheurs, d’explorateurs.
J’ai déjà eu l’occasion de souligner que l’essence et les forces mouvantes (les ressorts primordiaux) de l’évolution générale restent encore pour nous un profond, poignant et complet mystère. Et j’ajoutai que, ce mystère persistant, nous ne pouvons former nos conceptions philosophiques, biologiques ou sociales autrement qu’à tâtons et dans les limites les plus restreintes. Donc, à mon avis, avant que ce mystère ne soit dévoilé, ce problème résolu, nos conceptions, nos affirmations, nos convictions ne pourront être, scientifiquement parlé, que de faibles hypothèses : douteuses, instables, éphémères.
Or, toujours à mon avis, le problème de l’évolution générale, et aussi celui de l’évolution de l’homme ― biologique, psychologique et sociale, ― sont, au fond, des problèmes de l’énergie créatrice de la nature : de son essence et de son fonctionnement. Autrement dit : le problème de l’évolution générale et de l’évolution de l’homme en particulier, conduit infailliblement, d’après moi, à celui de l’essence et du fonctionnement de l’énergie créatrice universelle.
C’est le problème de la création (énergie créatrice) qui se trouve à la base de toutes les questions concernant l’évolution, la vie (comme un phénomène remarquable de l’évolution), l’homme (comme un phénomène remarquable de la vie), l’individu, la société. Telle est ma conviction intime. Depuis longtemps déjà, j’ai l’habitude d’examiner toute question plus ou moins importante de la vie générale ou de la vie humaine ― individuelle ou sociale ― à travers le prisme de ce problème fondamental. De cette façon, nombre de questions m’apparaissent sous un jour nouveau. Leur étude s’enrichit, à mes yeux, d’un facteur également nouveau et fort puissant. J’ajouterai que certains aspects du même problème ont définitivement confirmé mes convictions anarchistes, pour lesquelles j’ai trouvé, ainsi, une base de plus.
Le sujet m’a vivement saisi, de façon presque accidentelle, il y a une vingtaine d’années. Depuis, en dépit de ma vie mouvementée de militant libertaire, je n’ai jamais cessé de m’en occuper. Tant que mes loisirs me le permettaient, je le scrutais constamment. Toutes mes études biologiques et sociales m’y amenaient fatalement dès que je les approfondissais. Finalement, je suis arrivé à certaines conclusions que je m’apprête à développer et à formuler scientifiquement, aussitôt que les circonstances personnelles de ma vie me donneront cette possibilité.
Le lecteur conviendra facilement qu’un tel sujet peut bien faire l’objet d’une étude spéciale, d’un ouvrage à part, mais ne peut être traité à fond sur les quelques pages d’un dictionnaire. Ceci est d’autant plus vrai que beaucoup de mes conclusions se trouvent en contradiction avec des quasi-vérités très répandues de nos jours, et que, par conséquent, je serai obligé de développer mon argumentation de la façon la plus complète possible. Donc, le sujet doit ou bien être traité à fond, ou ne pas être traité du tout.
Ce qui m’a toujours étonné, c’est que le problème de la création (énergie créatrice dans la nature) dont l’acuité et l’importance capitale sont pourtant hors de doute, ― qui, pour ainsi dire, se trouve constamment devant nos yeux (la nature, c’est la création constante), ― reste depuis des siècles presque totalement en dehors de l’étude scientifique. Certes, la science moderne opère surtout au moyen d’analyses et d’expériences concrètes, précises, minuscules, qui, peut-être, aboutiront un jour « automatiquement » à des conclusions générales et vastes. Mais, je partage l’avis de ceux qui prétendent qu’il ne faut pas, pour cela, abandonner totalement l’autre méthode : l’examen général des grands problèmes qui surgissent devant nous et tentent la puissance de notre pensée, armée, surtout, des résultats déjà acquis par les analyses scrupuleuses des « microcosmes ». Les deux procédés pourraient parfaitement coexister, ayant chacun son champ d’action, se complétant mutuellement, au lieu de s’exclure. Or, le grand problème de l’énergie créatrice n’est même pas scientifiquement posé.
Je me bornerai, donc, dans le présent article à formuler, à préciser le problème, tel qu’il se présente à la méditation et à l’étude. J’espère que, laissant de côté ses solutions possibles, une telle précision intéressera déjà le lecteur et lui sera utile.
Admettant définitivement que la méthode d’action de la nature est l’évolution ; admettant, ensuite, que l’essence, la force mouvante, le ressort permanent de l’évolution est l’énergie créatrice, notre question se présente comme suit :
-
Qu’est-ce que l’énergie créatrice, la création ? Quels sont son essence et son rôle dans la nature ? Comment fonctionne-t-elle ? Quels sont ses rapports aux différentes espèces d’énergie ? Qu’est-ce que la vie comme manifestation de l’énergie créatrice ? La situation de l’homme dans l’évolution de la vie. L’homme et les autres animaux. (Partie biologique du problème.)
-
L’homme et l’énergie créatrice. (Partie bio-psychologique du problème).
-
L’essence et le rôle de la création dans la société humaine. Le sens de l’évolution de l’homme en société. L’individu et la société. Le problème du progrès, etc, etc. (Partie sociologique).
Tels sont les traits essentiels du problème de la création (énergie créatrice), sans parler des multiples subdivisions.
La création, c’est-à-dire, l’activité constante de l’énergie créatrice agissant par la méthode d’évolution, est devant nous, est en nous, est partout. Il s’agit d’y fixer notre attention, d’y approcher avec les moyens scientifiques modernes dont nous sommes armés et de l’analyser. C’est la plus belle tâche, la plus attrayante, la plus fructueuse que je connaisse. (Voir aussi : Évolution, Progrès).
― VOLINE.
CRÉATION (sociale, des masses).
Voir Masses.
CRÉATION — CRÉATIONNISME
Si vous demandez à un métaphysicien, imbu d’esprit théologique ― et cette espèce n’est pas rare ― ce que signifie le mot Création, il vous répondra : « La Création c’est l’acte incompréhensible par lequel Dieu produit le monde et lui donne une existence séparée. » Inutile d’insister, car il vous répètera : « Cet acte dépasse l’entendement humain ».
Adressez-vous à un théologien pur, catholique, par exemple, il vous dira : « C’est l’acte par lequel Dieu, sans le secours d’aucune matière préexistante, a produit l’univers par sa seule puissance et son unique volonté ». Et il appuiera sa définition, sur la genèse biblique et l’autorité de Moïse.
C’est, dans ce dernier cas, la création à partir de rien, ex nihilo, qui se trouve affirmée et, chose bizarre, sur l’autorité d’un livre presque unique à ce point de vue, car l’histoire des religions prouve, sans doute possible, que rares, pour ne pas dire nulles, furent celles qui admirent l’idée pure de création. Les plus savants exégètes et en tête Ernest Renan et l’allemand David Frédéric Strauss, ont clairement démontré la remarquable exception que nous offre a ce sujet la religion juive.
L’histoire de la philosophie nous enseigne que la première ou mieux la plus puissante réaction contre l’idée juive de création ex-nihilo, se fit en Grèce, où, 600 ans avant notre ère, Democrite, Anaxagore, Empédocle, Xénophane, etc., etc., repoussaient le surnaturalisme religieux et ne spéculaient que sur la matière formant l’univers. On sait aujourd’hui qu’Anaxagore se montra le plus net et le plus précis, et l’on s’accorde à reconnaître que de lui date l’opposition de l’idée d’évolution à celle de la création.
On reste stupéfait de voir que grâce à l’influence de Platon et à celle d’Aristote, le créationnisme se maintint longtemps, malgré l’effort presque miraculeux de la pensée philosophique au VIème siècle grec. N’est-ce pas cette influence platonicienne et aristotélicienne qui, après les ténèbres du moyen-âge et les premières lueurs de la Renaissance, s’exerçant sur l’esprit puissant de Descartes et sur celui de Leibnitz, en fit les défenseurs de la création pure ? Cette double influence de Platon et d’Aristote, à laquelle surent résister les panthéistes allemands qui combattirent l’idée de création ex-nihilo, nous la retrouvons dans la philosophie contemporaine. L’école spiritualiste française, en effet, admet cette idée ; le philosophe Renouvier que le néocriticisme actuel reconnaît pour initiateur, a écrit pour la défendre ; et nous voyons aujourd’hui le suisse Secrétan, et les philosophes d’Action française rompre des lances en sa faveur dans les revues réactionnaires et catholiques.
On trouvera aux mots Darwinisme et Évolution, l’idée contraire développée avec toute l’ampleur qu’elle comporte.
― P. VIGNÉ D’OCTON
CRÉATION (ex-nihilo)
Quelque conception qu’on ait de ce que les adeptes des religions diverses appellent « Dieu », le geste créateur qu’on attribue à l’Être suprême et éternel, « tirant du néant l’Univers et créant toutes choses de rien » est d’une insoutenable absurdité. Et, dans cet ouvrage destiné à arracher l’esprit humain aux croyances sans fondement et aux préjugés qui nous viennent des siècles d’ignorance d’où nous sommes issus, il me paraît indispensable d’établir fortement l’impossibilité de la création ex-nihilo.
Ouvrez un de ces petits livres que doivent apprendre par cœur les enfants qui s’apprêtent à faire leur première communion : c’est le catéchisme, c’est-à-dire le résumé des Vérités fondamentales sur lesquelles repose toute la Doctrine catholique. À la première page, vous lirez cette question : « Qu’est-ce que Dieu ? » suivie de cette réponse : « Dieu est un Être éternel, infini, tout puissant, qui a fait toutes choses de rien. » Je vous abandonne le récit que nous fait la Genèse des conditions et de l’ordre dans lesquels Dieu créa le Monde en six jours. J’aurais évidemment beau jeu à éplucher ce récit et à en démontrer l’invraisemblance et les erreurs. Cette discussion ne serait ni dépourvue d’intérêt, ni dénuée de valeur ; car, somme toute, cet exposé de la création en six jours est contenu dans les Écritures. Les Écritures (ancien et nouveau Testament) nous sont présentées par l’Église comme contenant la parole de Dieu et, s’il est un point sur lequel le Créateur de toutes choses ne doit pas, ne peut pas se tromper, c’est certainement le récit de la création elle-même, puisqu’il en est l’auteur. Mais si je démontre que Dieu n’a pas créé, qu’il n’a pas pu créer, qu’il est absurde de croire au geste créateur, ne devient-il pas inutile de porter le débat sur les détails et circonstances de ce geste ? Ne deviendra-t-il pas évident que, s’il y a erreur ou mensonge sur la création elle-même, il y a, à plus forte raison, erreur ou mensonge, sur les conditions dans lesquelles cette création se serait accomplie ? Or, je dis que créer est impossible et qu’un être raisonnable ne peut pas admettre la possibilité du geste créateur. Qu’est-ce que « créer » ? Définissons ce mot ; fixons-en clairement l’exacte signification. Que faut-il entendre par ce terme : créer ? Prendre des matériaux épars, séparés, les aller chercher ici et là, en saisir à droite et à gauche ; puis, en vertu de certains principes connus et en application de certaines règles expérimentées, les rapprocher, les grouper, les associer, les ajuster, de façon à en former un objet déterminé, est-ce créer ? S’emparer de certaines idées, impressions, souvenirs, bruits, images, couleurs, qu’on trouve, confus en un ou plusieurs cerveaux, pèle-mêle dans les livres et les musées ; puis comparer, associer, opposer ces divers éléments, de façon à en faire jaillir une idée nouvelle ou à en extraire une théorie ou une technique encore inédites est-ce créer ? Mettre de l’ordre dans ce qui est désordonné, introduire de la symétrie dans ce qui est chaotique, ranger sur une ligne droite ce qui est un indéchiffrable entassement de lignes qui s’entrecroisent, diriger vers un but précis et employer à une fin déterminée ce qui ne paraît avoir ni fin, ni but ; est-ce créer ? Non, cela n’est pas créer.
Le mot créer est un de ces termes dont, à la longue, on a copieusement abusé pour exprimer un tas de choses qui n’en sont pas moins totalement étrangères à l’idée qu’implique l’expression « créer ». Ne s’est-on pas avisé de dire d’un grand couturier ou d’une modiste réputée qu’ils ont créé tel modèle ou tel genre ? Qu’ont-ils fait ? Ils ont fouillé dans les archives, ils ont consulté les ouvrages de la partie, ils ont comparé, ils se sont inspirés des goûts récents, ils ont tenu compte des tissus et des ornements qui se marient le plus agréablement, ils ont supprimé ceci et introduit cela, ils ont ajouté ici et diminué là ; ils ont interrogé leur personnel et leur clientèle ; ils se sont renseignés sur le genre et le modèle qu’allaient lancer leurs concurrents ; ils ont fait des chiffres, afin de savoir quel serait le profit. Enfin, ils ont fait sortir de toutes ces opérations un genre ou un modèle. Peut-on dire qu’ils ont créé ? ― Non.
On a vu des comédiens, des cabots et des danseuses décorés pompeusement du nom de « créateurs », parce que les premiers avaient campé autrement que leurs prédécesseurs un personnage classique ou introduit dans le nouveau répertoire un type encore inédit, parce que les seconds avaient apporté sur la scène une mimique inconnue et les dernières un pas, un saut ou un balancement nouveaux. Peut-on dire qu’ils ont créé ? ― Non.
De tel savant, on a dit qu’il est le créateur de telle science ou de telle branche de celle-ci. Qu’a fait ce savant illustre ? Il a puisé dans les travaux et les recherches de ses prédécesseurs ; il a mis à profit les expériences, les investigations auxquelles se livrent ses contemporains ; il a multiplié les observations et les fouilles ; il a prolongé les résultats acquis ; il a bifurqué aux endroits où ses confrères s’étaient arrêtés et son labeur persévérant l’a mis un jour en face d’une possibilité nouvelle, d’un champ d’expérience inexploré. Il s’y est avancé le premier et il a attaché son nom à un procédé, à une méthode, à une particularité de la science. A t-il véritablement créé ? ― Non.
Tel homme d’État, placé à la direction d’un royaume ou à l’administration d’une république, a, pour consolider le pouvoir, étendre sa domination ou améliorer le sort de la population, ajouté une institution à celles qui existaient déjà ; il a supprimé un rouage de manipulation lente et massive et lui a substitué un rouage plus souple et d’effet plus rapide. On dit de cet homme d’État qu’il a créé ce rouage, cette Institution. Le terme est-il exact ? S’applique-t-il à l’opération dont il s’agit ? A-t-il véritablement créé la dite Institution ? Ne l’a-t-il pas plutôt et tout simplement fondée ?
C’est surtout lorsqu’il s’agit des artistes et des chefs-d’œuvre dus à la magnificence de leurs inspirations qu’on se sert couramment du mot « création ». Sculpture, peinture, architecture, musique, poésie, littérature, je vous accorde que des œuvres superbes ont élevé ces arts jusqu’aux nues, que la Forme et la Beauté ont trouvé dans certains hommes un souffle génial et à l’exécution prestigieuse, d’incomparables traducteurs. Mais qu’eussent-ils fait et qu’eussent-ils pu faire si leur cerveau admirable ne s’était pas au préalable peuplé des idées, des sensations, des souvenirs, des connaissances, des comparaisons, fournis par la diversité des Écoles ; si leur génie, nourri, fortifié, soulevé par la contemplation de ces richesses intellectuelles et de ces trésors artistiques, n’avait pas emprunté à ce fonds inépuisable les matériaux indispensables à l’extériorisation de leurs sublimes édifications intérieures ? Dès lors, peut-on appeler leurs œuvres « Créations » ? ― Non. J’admire, oui, j’admire, je vénère et j’aime ces savants illustres qui, par une divination prodigieuse et un labeur opiniâtre, ont étendu de génération en génération le domaine du savoir ; j’admire oui, j’admire, je vénère et j’aime ces merveilleux artistes qui ont élevé jusqu’au sublime et presque jusqu’à la perfection l’expression de la Beauté. Mais, cet hommage rendu aux sommités de l’Art et de la Science, je reviens à ma question : ces hommes ont-ils créé ? Et je réponds par la négative.
Mais alors, qu’est-ce que créer ? J’avoue qu’une définition n’est pas chose facile, quand il s’agit de donner un sens à une expression qui n’en possède aucun. On n’explique pas l’inexplicable ; on ne définit pas l’indéfinissable ; aussi me trouvé-je fort embarrassé de dire ce que signifie, au juste et sans ambiguïté le terme créer.
Sans le secours de ce petit catéchisme que j’ai fort heureusement sous la main, je ne sais s’il me serait possible de sortir d’embarras. Je consulte cet oracle et le voici qui me répond : « Dieu est un Être éternel, infini, tout puissant, qui a fait toutes choses de rien. » Maintenant, j’y suis. Je ne dis pas que je comprends : on ne comprend pas l’incompréhensible ; mais je dis que j’y suis ; c’est-à-dire que je tiens une définition du mot créer. Créer, ce serait (remarquez que je dis ce serait et non c’est) faire quelque chose avec rien du tout, tirer quelque chose de rien du tout, appeler le néant à l’être. Imaginez les combinaisons les plus ingénieuses, les grossissements les plus fantastiques, les multiplications les plus fabuleuses ; faites sortir d’un gland le chêne le plus majestueux ; tirez d’une unité les totaux les plus élevés ; amenez un grain de poussière à la formation d’un continent ; aucune de ces opérations ne nous donnera l’idée de ce que ce serait que créer, aucune ne pourrait même nous rapprocher de cette idée : un gland, c’est petit, une unité, c’est peu, un grain de poussière, ce n’est presque rien : cela n’empêche qu’un grain de poussière, une unité, un gland, c est toute de même quelque chose et créer ― le catéchisme nous l’enseigne ― c’est faire quelque chose de rien, c’est tirer du néant. Remarquez que le miracle de la création du Monde n’est pas dans le fait ― déjà surprenant en soi ― que, avec rien du tout, Dieu ait pu créer un Univers dont les dimensions sont telles qu’après avoir multiplié les chiffres les plus fabuleux par les chiffres les plus fantastiques et après avoir pris le total de cette multiplication pour la plus infime unité de mesure, il reste impossible de fixer ces dimensions ; le miracle réside dans le fait de faire quelque chose, et si peu que ce soit, avec rien du tout ; le miracle est donc dans la création elle-même et non dans l’étendue ou le volume de la chose créée. Et lorsque les théologiens attirent notre attention sur l’immensité incalculable de l’Univers, c’est ― soyez-en persuadés ― pour nous faire perdre de vue l’impossibilité du petit (l’unité) par le mirage fantastique du grand (le nombre).
Observez encore qu’il y a cent fois, mille fois, des milliards et des milliards de fois plus loin du néant au grain de poussière que du grain de poussière à la totalité des Univers existants ou pouvant exister. Avec rien on ne fait rien, on ne peut rien faire ; de rien on ne fait rien, on ne peut rien faire et l’inoubliable aphorisme de Lucrèce : ex nihilo nihil, demeure l’expression d’une certitude indéniable et d’une évidence manifeste. Je pense qu’on chercherait en vain une personne douée de raison qui puisse concevoir et admettre que de rien on puisse tirer quelque chose et qu’avec rien il soit possible de faire quelque chose. En conséquence l’hypothèse d’un Dieu Créateur est absurde ; la raison la repousse comme inadmissible.
Je ne suppose pas que les gens d’Église soient tous frappés d’aliénation mentale ; je dirai même qu’il y a eu et qu’il y a encore parmi eux des hommes d’une belle intelligence et d’une enviable lucidité. La foi ne peut pas les aveugler au point de leur faire méconnaître l’impossibilité de la Création. D’où vient donc que, non seulement, ils l’admettent quoique impossible, mais encore l’affirment comme hors de conteste ? Car pour eux, du moins à les entendre, c’est une de ces vérités qui se passent de démonstration, une de ces certitudes axiomatiques qui s’imposent d’elles-mêmes, sans qu’il soit utile de l’accompagner d’une preuve quelconque. Je conçois que cette absence d’examen soit un procédé fort commode, puisqu’il dispense de toute controverse et même de toute vérification, sur le fondement même de leur religion, les adeptes de celle-ci.
Le vrai, c’est qu’il est indispensable que leur Dieu soit créateur pour être Dieu. Que si cette qualité vient à lui manquer, il cesse d’être Dieu : il n’est plus l’être nécessaire, l’ordonnateur de toutes choses, le dispensateur de la félicité et de la souffrance.
S’ils avaient pu bâtir leur religion sans cet indispensable fondement, ils s’en seraient probablement passé ; mais sans ce point d’appui : la Création, il n’y aurait plus de religion chrétienne ; sans cette base, tout serait remis en question, ou plutôt rien ne serait plus en question, parce que tout s’effondrerait, ce serait l’édifice construit par l’Église pierre à pierre depuis dix-neuf siècles, réduit brusquement en poussière ; ce serait l’Église catholique condamnée à n’être plus qu’une Institution passagère comme toutes les institutions humaines. Dieu sans la création cesserait d’être Dieu, le Christianisme sans Dieu cesserait d’être le Christianisme et l’Église dont la prétention est d’être éternelle comme son Dieu, deviendrait une puissance périssable que le temps serait appelé à précipiter dans le gouffre du passé. À cette seule idée, l’Église frémit et s’indigne. Elle a vu les trônes chanceler, les dynasties disparaitre, les civilisations se succéder, et, reposant sur le granit de la Divinité, Elle est toujours debout. Près de quinze siècles durant, Elle a exercé, sur notre Europe occidentale et, de là, sur une portion de la Terre, une dictature absolue ; moins puissante aujourd’hui, Elle a lié son destin à celui des classes dirigeantes avec lesquelles Elle partage le Pouvoir ; de ce Pouvoir partagé Elle se contente présentement, mais Elle ambitionna de reconquérir la direction totale et Elle ne désespère pas de réaliser ses ambitieuses visées. Seulement, Elle ne peut raisonnablement nourrir cet espoir qu’à la condition de se maintenir dans la direction des consciences et Elle ne s’y peut maintenir qu’autant qu’Elle représente le Dieu Éternel, immuable, infini tout-puissant, c’est-à-dire le Dieu Créateur. Voilà pourquoi Elle érige en Dogme la Création par Dieu du Ciel et de la Terre.
Dogme, ai-je dit ? ― Oui, c’est-à-dire article de foi qu’il est interdit, sous peine de péché mortel, au catholique de mettre en doute.
« Croyez, mes frères, dit le Curé, croyez et ne cherchez pas à comprendre. Quel serait le mérite de croire, si vous compreniez ? Et, si vous pouviez comprendre, de quel droit réclameriez-vous la récompense promise aux âmes qui s’abîment dans l’adoration ? Méfiez-vous des tentations diaboliques. Satan est habile dans l’art de vous tendre des pièges et c’en est un ― peut-être le plus dangereux ― que de vous inciter à pénétrer le mystère dont il plaît à notre Dieu de s’envelopper. Croyez ; croyez aveuglément ; croyez même, croyez surtout à ce qui vous paraît absurde. Avec le bon chrétien, dites : je crois non pas bien que ce soit absurde, mais parce que c’est absurde ; credo quia absurdurm ! » À l’Église, au cours d’une cérémonie cultuelle, devant un auditoire composé uniquement de fidèles disposés à tout croire et résolus à tout admettre sans piper mot, ce langage suffit. Mais il n’en est plus ainsi quand de la chaire le débat se transporte à la tribune et quand celui qui parle s’adresse à une assemblée composée d’auditeurs réfléchis, avisés, attentifs, éclairés, qui ne se paient pas de mots et ne sont sensibles qu’au raisonnement.
Le débat s’est rarement engagé, entre mes contradicteurs et moi, sur ce point précis de l’acte créateur. Il n’y a pas à s’en étonner : la cause de mes adversaires était malaisée à défendre et peu nombreux ont été ceux qui ont eu le courage ― peut-être ferais-je mieux de dire la témérité et, mieux encore, la maladresse ― de s’y aventurer. Il en fut cependant qui comprirent que l’argument avait porté et qu’il avait trop de poids pour qu’il fût permis à un Chrétien de n’en pas souffler mot. « La création, dirent quelques-uns, est un mystère ; elle est du nombre de ces quelques problèmes qui échappent à la faible compréhension de l’homme ; c’est un article de foi. On croit à la Création ou on n’y croit pas ; mais il est aussi impossible de la prouver que de la nier. La Science et la Raison sont impuissantes à faire la preuve dans un sens comme dans l’autre. Il nous paraît, cependant, que l’affirmation est plus plausible que la négation ; de toutes façons, la doctrine d’un Être Éternel et tout puissant a l’avantage d’apporter à la question des origines de l’Univers une solution, tandis que la doctrine opposée n’en apporte aucune. »
En réponse à cette déclaration (car il n’y a pas dans ces propos un essai de réfutation), il suffit de faire observer :
-
Que, bien qu’elles soient liées l’une à l’autre, la question des origines de l’Univers et celle de la Création sont distinctes ; qu’elles ne doivent pas être étudiées simultanément, mais l’une après l’autre. Il est, en effet, évident que, s’il était prouvé que le Monde n’a pas eu de commencement, qu’il a existé de tout temps, il n’y aurait pas lieu de se demander s’il a été créé, par qui, quand, ni comment. Cette question de la Création ne se pose que dans le cas où il serait démontré que l’Univers a commencé. Alors, mais alors seulement, il peut y avoir lieu d’étudier le problème de la Création. Or, le Christianisme admet tout d’abord, comme si c’était un point acquis, que l’Univers n’a pas toujours existé, puisqu’il affirme qu’il a été créé. C’est ce que, en logique, on appelle une pétition de principe, c’est-à-dire un raisonnement qui accepte comme point de départ l’argument ou le fait dont il est nécessaire de prouver au préalable l’exactitude.
-
Qu’il est faux d’avancer que la doctrine d’un Être éternel et tout-puissant, ayant créé le Monde apporte la solution attendue du problème des Origines de l’Univers. C’est, en effet, une manière étrange de résoudre une question déjà fort obscure en soi que d’en augmenter l’obscurité en lui apportant une solution plus troublante, plus indéchiffrable, plus incompréhensible encore que cette question elle-même. Or, c’est à ce résultat qu’on aboutit infailliblement lorsque, dans le but de résoudre les Énigmes de l’Univers, on tranche la question par une solution plus énigmatique encore, plus invérifiable, plus mystérieuse : la Création.
-
Que, au surplus, ce n’est pas résoudre la question, mais tout simplement en reculer la solution et la compliquer par l’entrée en scène et l’intervention active et directe d’un Être inabordable à l’intelligence de l’homme et qui, par conséquent, échappe fatalement, de ce chef, à tout contrôle comme à tout raisonnement.
Tout récemment (1926) le journal Le Fiqaro, bien connu pour ses attaches avec les milieux catholiques, a ouvert une enquête sur le sujet suivant : « Le sentiment religieux et la Science. Y a t-il opposition entre l’un et l’autre ? » Comme il fallait s’y attendre, il a consulté, dans le monde de la Science officielle, tous les professeurs et docteurs plus ou moins acquis, par leur naissance, leur éducation, leur culture, et... leur clientèle, aux milieux conservateurs et chrétiens. La réponse de ces messieurs peut se résumer ainsi : « Le sentiment religieux et la science appartiennent à deux domaines distincts et ceux-ci ne sauraient être confondus. Le plan sur lequel travaille le savant n’est pas le même que celui sur lequel s’affirme et travaille le croyant. Il n’y a donc aucune opposition entre la Science et le Sentiment religieux. » Cette réponse est, quant an fond, tout un aveu. Celui-ci est entouré d’artifice ; il n’en existe pas moins, c’est dire que la Science et le Sentiment religieux sont étrangers l’un à l’autre, c’est reconnaître que la Science ignore la religion et, par conséquent, que le Sentiment religieux n’a à attendre de l’esprit et de la méthode scientifique aucun appui, aucun concours.
* * *
Je poursuis ma démonstration.
D’autres contradicteurs m’objectèrent qu’en déclarant la Création impossible, je ne tenais pas compte de la toute-puissance de Dieu, que le pouvoir divin étant sans limite, rien ne lui était impossible.
Voici ma réponse : quand on dit que rien n’est impossible à Celui dont la puissance est sans borne, on profère une sottise, si on entend par là prétendre que Dieu peut faire l’impossible. L’impossible, c’est ce qui ne peut pas être ; le possible, c’est tout ce qui peut être.
Voici un bâton ; il a deux extrémités. Il est impossible qu’il n’en ait qu’une et Dieu lui-même ― s’il existait ― ne pourrait pas faire que ce bâton n’en eût qu’une. Il a plu hier. Dites-moi, ― si vous croyez que Dieu existe et qu’il est le maître des éléments et qu’Il peut faire à son gré le beau temps ou la pluie, ― dites-moi que Dieu aurait pu empêcher qu’il plût ; mais ne me dites pas que Dieu peut aujourd’hui faire qu’il n’ait pas plus hier. Mon meilleur ami est mort il y a trois jours ; dites-moi que Dieu, puisqu’il est tout puissant, aurait pu l’empêcher de mourir ; mais ne me dites pas qu’il est au pouvoir de Dieu de faire qu’il ne soit pas mort. Vous me répondrez qu’Il peut le ressusciter. Le ressusciter ? Soit ; mais, dans ce cas, c’est-à-dire si Dieu rend la vie à mon ami, c’est que celui-ci l’avait perdue et donc qu’il était mort ; dites-moi encore qu’il n’a pas été nécessaire qu’Il le ressuscite et qu’il a suffi, son pouvoir aidant, qu’Il rappelle mon ami à la vie et je vous répondrai que dans ce cas, mon ami n’était pas réellement mort, qu’il était plongé dans un état léthargique ou cataleptique lui donnant l’apparence d’un cadavre, mais qu’il n’était pas réellement un cadavre. Dieu ne peut donc pas faire l’impossible ; dans le domaine des impossibilités, il est aussi impuissant que vous et moi... Ce qui serait vrai, indiscutable même, s’Il existait, c’est que dans le domaine des choses possibles, Il pourrait tout, absolument tout, mais dans le domaine des choses possibles, seulement.
Prenez une mouche, attachez à cette mouche un poids de cent grammes, elle ne pourra pas l’enlever ; placez mille kilos sur le dos d’un éléphant, et ce pachyderme enlèvera ces mille kilos sans effort. Cet enfant de six mois ne peut pas marcher, mais ce jeune homme peut courir ; ce cervelet de deux ans ne peut pas agiter utilement les hautes spéculations, mais cet homme de quarante ans peut le faire aisément. Entre la mouche et l’éléphant, entre le bébé et le jeune homme, entre le bambin et le philosophe, il n’y a qu’une différence de force mais tous se meuvent sur le terrain du possible. Dans ce cadre des choses possibles, votre Dieu peut tout ; mais là s’arrête sa puissance. Or, j’ai démontré que créer, c’est-à-dire faire quelque chose avec rien du tout, tirer quoi que ce soit du néant, c’est chose impossible. Puisque Dieu ne peut pas ce qui est impossible, il ne peut pas avoir créé.
On m’a dit alors :
« vous raisonnez comme un homme raisonnant sur un de ses semblables, vous jugez Dieu à votre mesure. Vous divisez tout en possible et impossible ; mais ce qui est impossible à l’homme, ce que le misérable entendement de l’homme considère comme impossible peut fort bien ne pas être impossible à Dieu. Le plan sur lequel agit Dieu n’est pas le même que celui sur lequel l’homme agit ; ces deux plans sont séparés par des cloisons étanches. Ces démarcations absolues, on les constate entre les éléments qui composent les divers règnes de la nature. Nous sommes dans une salle construite en pierre. Nous parlons, nous raisonnons, nous argumentons. Croyez-vous que ces pierres pourraient comme nous, parler, raisonner, argumenter ? Croyez-vous, seulement qu’elles soient en état de nous comprendre ? Non ! n’est-ce pas ? Il est impossible à ces pierres de parler, de raisonner, d’argumenter. Mais ce qui leur est impossible, à elles, pierres, nous est possible, à nous, hommes. Il n’y a cependant qu’un petit fossé entre ces pierres et nous, tandis que, entre l’Homme et Dieu, il y a un abîme. D’où l’on peut conclure que ce qui est impossible à l’homme et ce qui lui paraît impossible peut parfaitement être possible à Dieu. Nous vous accordons qu’avec rien l’homme ne puisse rien faire ; mais cela ne vous permet pas d’en inférer que de rien Dieu ne puisse rien faire. »
Et j’ai répondu :
« Procédons par ordre. L’objection est sérieuse, mais elle est complexe ; je vais en suivre et en discuter les diverses parties.
Et tout d’abord, je raisonne comme un homme raisonnant sur un de ses semblables ; je juge Dieu à ma mesure ― c’est exact ; je ne puis en raisonner autrement ; je dispose de faibles lumières, de connaissances incomplètes et mon jugement est faillible. Mais est-il possible que je juge à une autre mesure qu’à la mienne ? Est-il possible et seulement désirable que je raisonne autrement qu’à l’aide de mes lumières, de mes connaissances et de mes facultés ? Je ne puis voir qu’avec mes yeux, entendre qu’avec mes oreilles, digérer qu’avec mon appareil digestif, respirer qu’avec mes voies respiratoires et raisonner qu’avec mon cerveau. Eh bien ! Et vous ? Auriez-vous l’inconcevable privilège de raisonner autrement qu’un homme et de juger Dieu à une autre mesure qu’à la votre ? De deux choses l’une : ou bien, il ne nous est pas possible d’étudier Dieu, d’en raisonner avec les seules et humbles facultés que nous possédons ; dans ce cas, que faisons-nous ici ? Pourquoi en discutez-vous, en raisonnez-vous vous-mêmes ? ou bien nous pouvons en discuter, en raisonner, et, dans ce cas, avec quoi, par quels moyens, à l’aide de quelles mesures, de quelles lumières, de quelles connaissances et de quelles facultés autres que les nôtres ; les vôtres et les miennes ?... Vous me dites encore : ce qui est impossible à l’homme peut fort bien ne pas l’être à Dieu. Pardon ! Ce qui est impossible est impossible, ce qui ne peut pas être ne peut pas être. Faut-il que je reprenne mes exemples et que j’en ajoute ? Dieu peut-il faire qu’un bâton n’ait qu’un bout ? Peut-il faire que ce qui a été n’ait pas été ? Je vous pose le problème suivant : Je prends un immense tableau noir, je le couvre de zéros ; j’appelle le mathématicien le plus consommé : je le prie de se livrer sur ces zéros à toutes les opérations de la mathématique ; il aura beau additionner, multiplier, additionner encore et encore multiplier, il ne parviendra pas à extraire de ces milliers de zéros une seule unité. Pourquoi, parce que c’est chose impossible et cette chose impossible le sera quel que soit le calculateur, fût-il Dieu. Aussi longtemps qu’il n’opèrera que sur des zéros, c’est le rien du tout, c’est le néant : l’unité, c’est la création. Il est aussi impossible de faire quelque chose avec rien du tout (ce qui est créer) que de faire une unité avec des zéros. Oserez-vous dire, maintenant, que rien n’est impossible à la Toute-Puissance de Dieu ? Oserez-vous dire que la création est possible, ce qui équivaudrait à prétendre que, avec des zéros et rien qu’avec des zéros Dieu peut faire une unité ?
Venons-en à présent à ces pierres qui ne peuvent ni parler, ni raisonner, ni argumenter, tandis que nous le pouvons. Votre raisonnement, se résume ainsi : de même qu’il y a des choses qui, impossibles à la pierre sont possibles à l’homme ; de même il y a des choses qui, impossibles à l’homme, sont possibles à Dieu. Au nombre de ces choses impossibles à l’homme et possibles à Dieu, il y a la création. L’objection est bien présentée ; elle paraît sérieuse, mais je puis la réfuter facilement. Qu’il y ait des choses impossibles à la pierre et cependant possibles à l’homme, cela ne fait pas le doute. La pierre ne parle pas, elle ne raisonne pas, elle n’argumente pas, tandis que l’homme parle, raisonne et argumente. J’en tombe d’accord avec vous. Mais encore convient-il de nous demander pourquoi il en est ainsi. L’homme peut parler, raisonner et argumenter, parce qu’il possède des organes qui lui permettent et dont c’est la fonction de parler, de raisonner et d’argumenter ; tandis que, privée de ces organes, la pierre ne peut accomplir ces fonctions. Il y a, ainsi, dans la nature une multitude de choses que tels corps appartenant à tel règne peuvent faire, tandis que tels autres corps appartenant à tel autre règne, ne peuvent pas les faire. La pierre ne peut pas parler, l’homme le peut ; elle ne peut pas se déplacer d’elle-même, la fourmi le peut ; la pierre ne peut ni crier, ni chanter, ni siffler, le rossignol peut moduler les sons les plus variés et les plus expressifs. Le rossignol peut voler et vivre dans l’air, mais il ne peut pas nager et vivre dans l’eau, tandis que la carpe peut nager et vivre dans l’eau, mais ne peut pas voler et vivre dans l’air. Ces exemples suffisent à prouver qu’il existe entre les règnes divers et, au sein du même règne, entre les diverses espèces des différences très marquées. Ces différences proviennent de la diversité des éléments, des organes, des structures Intérieures, des assemblages et combinaisons des propriétés particulières qui caractérisent et séparent plus ou moins profondément les genres et les espèces. Dans les sciences naturelles, les classifications n’ont pas d’autre origine. Il y a plus : le temps a suffi à établir des différences très marquées sur le plan des possibilités et des impossibilités. C’est le triomphe des découvertes et inventions, c’est leur rôle d’apporter à l’homme de ce siècle des possibilités interdites à l’homme du siècle précédent. Un exemple, rien qu’un, pour ne pas alourdir cette discussion : la navigation aérienne. Parler, raisonner, argumenter, se mouvoir, naviguer dans les airs sont choses possibles, puisque l’homme parle, raisonne, argumente, se meut, circule dans l’espace ; elles sont impossibles à la pierre, c’est vrai ; mais, puisqu’elles sont possibles à l’homme, cela prouve qu’elles ne sont pas impossibles par elles-mêmes, c’est-à-dire en soi, irréductiblement, nécessairement, intrinsèquement. Or, quand je dis que, en dépit de sa Toute-Puissance, Dieu ne peut pas l’impossible je ne dis pas qu’il ne peut pas ce qui est impossible à l’homme (je sais que le pouvoir de l’homme est fort restreint), je dis que Dieu ne peut pas plus que l’homme ce qui est impossible en soi, irréductiblement, nécessairement, intrinsèquement. Sans doute, les plans ne sont pas les mêmes : le plan minéral diffère du plan végétal ; celui-ci diffère du plan animal et, si, pour les besoins de la discussion, j’admets qu’il y ait un plan divin, je confesse qu’il diffère du plan humain. Dans cette gradation des plans qui se superposent, l’échelle des possibilités monte sans cesse, mais des possibilités seulement. En sorte que ce qui est chose impossible sur le plan inférieur devient possible sur le plan supérieur ; tandis que, ce qui est chose impossible en soi, est impossible sur la totalité des plans. Toutes ces possibilités n’en ont pas moins une limite, une borne, une fin. Cette fin, cette borne, cette limite, c’est l’impossible en soi.
Or, j’ai démontré que l’acte créateur est impossible en soi, donc Dieu ne peut pas l’avoir accompli.
Un pasteur crut habile de déplacer la question. Ce protestant avait compris, sans aucun doute, que sur le terrain précis de la création ex nihilo, il était malaisé d’emporter quelque avantage. Il exposa donc avec force circonlocutions et parenthèses, qu’il me faisait grâce de tout débat sur la possibilité ou l’impossibilité du Geste créateur ; qu’au surplus, c’est un point sur lequel il est difficile et, peut-être, impossible de projeter une suffisante clarté, et, conséquemment, de se prononcer catégoriquement. Mais, après avoir épuisé tous les si, les mais, les car, les puisque et les néanmoins, il en vint au point où il voulait amener sans de trop brusques secousses l’auditoire. Il affirma que, à l’origine, l’Univers était dans un état chaotique et désordonné, que, jouets du hasard, n’obéissant à aucun mouvement régulier, les corps suspendus dans l’espace s’y balançaient sans rythme précis, sans but, pour ainsi dire pêle-mêle, s’attirant et se repoussant, se rapprochant et s’éloignant, se choquant, se brisant, se fusionnant ou se fragmentant dans une anarchie (sic) indescriptible. Mais que, à un moment donné du temps, l’ordre s’était établi, ordre qui provoque à juste raison l’admiration de tous ceux qui ne sont pas insensibles au spectacle prodigieux de l’Harmonie Universelle.
Cet ordre, au dire du Pasteur, ne peut pas s’être établi tout seul et comme par miracle ; il ne peut avoir été que l’œuvre d’un ouvrier fabuleux et il ne peut se poursuivre, que grâce à la surveillance incessante qu’exerce cet ouvrier sur les innombrables rouages de cette prodigieuse et gigantesque machine. Cet Ouvrier, c’est Dieu.
Ce joli discours avait été prononcé sur le ton sans emphase et dans le style professoral qu’affectionne l’Église protestante. Je fis tout d’abord remarquer à l’auditoire à quelle incalculable distance du Dieu créateur, rappelant la mort universelle à la vie universelle, se tenait ce Dieu modeste, simple Ouvrier se bornant à mettre de l’ordre et de la régularité dans l’irrégularité et le désordre et il me fut facile de souligner la manœuvre par laquelle le Pasteur espérait, en laissant tomber du lest, beaucoup de lest, permettre au ballon-Dieu de remonter vers les hauteurs d’où je l’avais fait descendre. Il ne s’agissait plus de la Création, c’était une thèse que le Pasteur abandonnait, puisqu’il ne s’en faisait pas le défenseur et tentait de réduire l’impossible création à une modeste « mise en ordre ». Ce point de vue bien compris, j’empoignai mon contradicteur un peu rudement :
« Eh ! quoi, monsieur le Pasteur, que signifie ce galimatias ? Je pourrais me dispenser de vous répondre, car nous en sommes au Dieu Créateur et non Ordonnateur ; mais si, je me bornais à souligner votre « reculade » vous et les vôtres (je vous connais) vous ne manqueriez pas de traiter de dérobade mon absence de réfutation. Je vais donc étaler aux yeux de cette assemblée qui nous écoute, les faiblesses de votre point de vue. Laissez-moi, dès le début, vous dire que vous êtes tombé dans une pétition de principe en négligeant d’assurer à votre raisonnement la solidité nécessaire d’un point de départ incontestable ou démontré. Car votre raisonnement est celui-ci : « l’Ordre dans l’Univers n’a pas toujours existé. Il a donc fallu que, à un moment donné, il y fut établi. Or, il ne peut s’être établi de luimême. Donc il a fallu l’intervention de Dieu pour l’y introduire. » J’ai dit une pétition de principe ; j’aurais dû dire deux. « L’ordre dans l’Univers n’a pas toujours existé. » C’est ce qu’il aurait fallu démontrer avant tout ; vous ne l’avez pas fait : première pétition de principe ; « L’ordre ne pouvait s’établir de lui-même. » C’est ce qu’il aurait fallu démontrer ensuite ; vous ne l’avez pas fait : seconde pétition de principe. Que peut bien valoir un argument en trois propositions, dont les deux premières sont viciées par deux pétitions de principe ? Je vous le demande à vous, Monsieur, qui n’ignorez pas, qui ne pouvez pas ignorer les règles élémentaires de la dialectique. Est-ce oubli et négligence de votre part ? Est-ce parce que vous avez cru sincèrement ces deux premières propositions établies d’avance et hors du débat ? ― Non, Monsieur. Seulement, vous vous êtes sans doute bercé de l’espoir que je ne les discuterai point et c’est en cela que vous vous êtes trompé. Donc, discutons-les.
Sur quelles observations vous appuyez-vous pour affirmer que, à l’origine, l’Univers était dans un état chaotique et désordonné ? À quelle époque en était-il ainsi ? Je vous serais obligé de nous le faire savoir. Où voyez-vous trace de cet état chaotique ? D’où vous vient l’assurance de ce désordre dans l’Univers ? Je reconnais que, par l’observation et le calcul, il est possible de reconstituer avec assez d’exactitude l’état probable dans lequel se trouvaient, il y a des milliers et des milliers de siècles, les corps qui gravitent dans l’espace, je reconnais que cet état n’était pas exactement le même que dans le présent ; je reconnais encore que, à certaines époques, il a dû se produire, il s’est certainement produit de formidables bouleversements, de colossales transformations, voire d’effrayants cataclysmes. Est-ce à dire que ces mouvement, ces heurts, ces disparitions, ces agitations fabuleuses aient été des désordres ? Ces bouleversements, desquels, vous en conviendrez, personne n’a été le témoin et dont vous ne pouvez avoir connaissance, vous en conviendrez aussi, que par des constatations et des calculs basés sur les observations actuelles, de quel droit les traitez-vous de chaotiques ? Sur quelles données faites-vous reposer le jugement que vous portez sur eux ? Pourquoi seraient-ils chaos dans le recul des temps écoulés et ordre aujourd’hui ? Pourquoi seraient-ils désordre il y a des milliards d’années et régularité présentement ? Je répète que vous ne pouvez connaître ces mouvements, que par le calcul, c’est-à-dire en portant dans la nuit des temps, le flambeau que met entre vos mains l’observation des mouvements actuels. C’est en vertu de ces mêmes mouvements que, par l’étude du présent, vous obtenez des indications sur le passé. De ce qui se produit aujourd’hui dans l’Univers vous allez à la découverte de ce qui s’y est produit autrefois. Et je vous enferme dans le dilemme suivant : ou bien les mouvements que vous constatez aujourd’hui obéissent aux mêmes lois que celles qui ont régi de tout temps l’Univers et, dans ce cas, vos calculs sont justes ; mais, alors, pourquoi appeler désordre autrefois ce que vous appelez ordre aujourd’hui ? Ou bien ces mouvements n’obéissent pas aux mêmes lois et, dans ce cas les lois qui régissent l’Univers varient, vos calculs sont faux et personne ne connaît, personne n’est à même de connaître l’État de l’Univers ― il y a des milliards d’années. Pourquoi, dès lors, vous autorisez-vous à en parler ? Voilà ce que j’ai à dire sur votre première proposition. Est-il bien nécessaire maintenant que je m’explique sur la seconde ? Oui ? Eh bien ! j’en dirai quelques mots.
L’ordre, dites-vous, ne peut pas s’être établi tout seul et de lui-même. Je vais sans doute vous étonner, Monsieur le Pasteur, et, cependant, je ne crains pas de dire que s’il y a eu désordre dans l’agencement universel l’ordre n’a pu s’y établir que tout seul et de lui-même, par la force des choses, par le jeu fatal des forces en présence, par la suite nécessaire des mouvements, bouleversements et transformations contenus, à l’état potentiel, dans les corps en lutte. Permettez-moi une petite, toute petite comparaison : supposez l’Océan tourmenté par une formidable tempête, imaginez celle-ci parvenue à son paroxysme. Pour ne pas dramatiser le débat sérieux auquel nous nous livrons, j’éviterai, toute description empruntée à l’horreur de la plus violente tempête, dans la nuit la plus profonde, sous le ciel le plus bouleversé et sur la mer la plus furieuse. Cette tempête est l’image du désordre. En seriez-vous encore à croire que, pour calmer la violence de l’ouragan, le tumulte de l’orage et le soulèvement des flots, il faille qu’intervienne le Pacificateur suprême ; (si vous étiez prêtre, au lieu d’être pasteur, j’ajouterais la Madone, la, Mère de Dieu, la Sainte Vierge !) Laissons au marin Breton ces grotesques superstitions ― et rions de son ignorante crédulité. Mais ne cédons pas à cette crédulité et ne tombons pas dans ces absurdités superstitieuses. Prenez garde, Monsieur le Pasteur, prenez bien garde : en affirmant que pour faire succéder l’ordre au désordre, il faut que se produise l’intervention de l’Ouvrier Divin, vous vous laissez choir dans le même abîme de superstition et de crédulité que le marin breton.
<blockquote>
Sait aussi des méchants arrêter les complots.
</blockquote>
Le poète a pu exprimer en ces termes sa foi en le Souverain Maître ; son excuse est d’abord qu’il n’appartenait pas au siècle de lumière qu’est le nôtre et qu’en suite, il ne discutait pas ; il rimait. Mais vous, monsieur, qui discutez sérieusement une question sérieuse, oserez-vous parler sans rire de « Celui qui met un frein à la fureur des flots » ? Vous savez bien que le calme succède à la tempête, que, après un temps plus ou moins long de bouleversements, d’agitations et de hurlements, le flot s’apaise de lui-même, que l’agitation tombe d’elle-même, et que, de lui-même aussi, le hurlement des flots en fureur se transforme en l’éternelle chanson du flux et du reflux. À supposer qu’il y ait eu tempête, autrefois, c’est-à-dire selon vous, désordre dans l’Univers momentanément bouleversé par les transformations qu’il a subies, l’apaisement, c’est-à-dire l’ordre, se serait fait peu à peu, tout seul et de lui-même, sans qu’il fût besoin qu’intervienne une Puissance extérieure et surnaturelle. Au fait, monsieur le Pasteur, si cet Ouvrier divin est intervenu, d’où sortait-il ? Où était-il avant et pendant l’état chaotique ? Que faisait-il ? Assistait-il, indifférent et impassible, à ce désordre ? Si oui, pourquoi et comment ? Et, alors, d’où vient que, tout d’un coup, il ait abandonné cette attitude impassible ? Pour quelle raison, et dans quel but est-il intervenu ? Allons, allons ; cessons de jeter dans une controverse sérieuse de tels enfantillages. »
On me croira, je l’espère, surtout après avoir lu attentivement ce qui précède, quand j’ose affirmer que je reproduis ici, fidèlement, les objections qui m’ont été faites, chaque fois que je me suis trouvé en présence, non pas seulement de vagues croyants plus ou moins cultivés et capables de controverser, mais encore en face des porte-parole les plus autorisés du culte catholique et protestant.
Il est possible que le lecteur soit étonné du peu de consistance de la thèse chrétienne soutenant l’absurdité de la création ex nihilo. Ce qui est surprenant, ce ne sont pas le ridicule et l’invraisemblance de cette thèse, c’est le crédit qu’elle a trouvé depuis des siècles et qu’elle trouve encore auprès d’une foule de gens qui ne sont pourtant dépourvus ni d’intelligence, ni de culture.
Je m’excuse d’avoir, à propos de la création ex nihilo plus particulièrement mis sur la sellette la religion chrétienne. Ce n’est pas, qu’on veuille bien le croire, parce que je poursuis cette forme spéciale de l’idée religieuse, d’une hostilité particulière ; c’est, tout simplement, parce que, plus que toutes les autres, la religion catholique s’est prodiguée, avec un art incomparable, en démonstrations captieuses touchant ladite création ; c’est parce qu’elle a mis à contribution, sur ce point fondamental de sa doctrine, les ressources intellectuelles de tous ses commentateurs et doctrinaires. Mais il reste hors de doute et, conséquemment, bien entendu, que ma démonstration s’applique à l’ensemble des religions qui, toutes, reposent sur la croyance en un Esprit éternel et tout puissant qui, préexistant à tout ce qui tombe sous nos sens, a tiré du néant l’Univers au sein duquel nous existons.
― Sébastien FAURE.
CRÉDULITÉ
n. f.
Facilité à croire. L’homme crédule est un individu qui croit sans contrôler ce que lui raconte celui ou ceux en qui, à tort ou à raison, il a placé sa confiance. L’homme est un puits inépuisable de crédulité, car depuis le temps qu’il sert de jouet à tous les fantoches qui l’exploitent, ses yeux et ses oreilles auraient dû s’ouvrir et il devrait savoir analyser les sentiments de ceux qui captent sa confiance et profitent de sa crédulité. Il n’en est hélas pas ainsi. Le Lachâtre nous donne une définition assez juste de l’homme crédule : « L’homme crédule ne peut pas mieux être comparé qu’à un individu qui fermerait les yeux et se boucherait les oreilles pour ne plus voir et ne plus entendre que par les yeux et par les oreilles d’un autre ». N’est-ce pas ainsi que cela se passe et plus particulièrement en matière politique ? Comment l’électeur peut-il être assez crédule pour écouter les sornettes de tous les faux prophètes qui lui promettent le bonheur et comment peut-il être assez naïf pour croire en la force et la puissance d’un individu qu’il délègue dans un parlement quelconque ? La crédulité est un sentiment mystérieux comme la Foi, mais il faut espérer que, à force d’en être les victimes, les crédules se guériront de leur crédulité et qu’ils se refuseront un jour à servir de tremplin aux arrivistes et aux coquins.
CRITIQUE
(Etym : criticus, latin ; kritikos, grec)
Si l’on s’en tient à l’étymologie, ce mot signifie difficile, dangereux, pénible. Il qualifie un état de crise. Ex. : période critique, situation critique, point critique, température critique, etc. Mais en art, en littérature, en philosophie, en politique, le terme change de sens et de qualificatif devient substantif. Il désigne alors cette faculté qu’exercent les hommes dans l’examen des choses. Critiquer, c’est voir, étudier, juger, peser ; c’est produire une opinion sur une œuvre, l’analyser, la disséquer. La critique ne vaut, cependant, qu’à la condition d’être étayée sur des connaissances étendues, un goût sûr et une absolue sincérité, exempte de tout parti pris.
La critique remonte à la plus haute antiquité. Toujours les humains se séparèrent en deux catégories : ceux qui créent, ceux qui étudient et discutent les mérites des créateurs. Les uns et les autres ont leur utilité. Le sens critique, même quand il s’accompagne de basse envie, de jalousie, de méchanceté, accomplit une besogne indispensable. Il dépasse le but ; mais sa clairvoyance haineuse permet d’apercevoir les imperfections d’une œuvre d’art ou littéraire. Quand le critique se pique simplement de justice, son action devient bienfaisante. Chez les Grecs, on rencontre ces deux pôles de la critique : Zoïle et Aristarque qui, tous deux, s’attaquèrent à Homère. Mais avec les Grecs, la critique était purement verbale. De même chez les Latins et, dans les débuts, en France. Elle ne devient grammaticale que par la suite. Plus tard encore, elle se divisera en critique historique, critique d’art, critique littéraire, critique dramatique, critique musicale, etc. La spécialisation intervient qui nécessite des compétences particulières.
C’est avec l’école d’Alexandrie que la critique commence à se développer. Jusque-là, Platon, Aristote, ne font que disserter sur la Beauté, la Forme, l’Art, mais ils n’assoient les jugement sur aucune base doctrinaire solide. Ils ne sont dirigés par aucun principe. Les Alexandrins se préoccupèrent de fixer ces principes et d’établir les règles indispensables de la critique : ils furent continués par les Plutarque, les Lucien de Sa mosate. les Longin. Chez les Latins, la critique ne fait pas de grands progrès. Il faut arriver à Horace et à l’Art poétique pour trouver un maître. Puis, après l’éclipse que provoquent les Barbares et la longue nuit du Moyen-Âge, la critique renaît. Joachim du Bellay, au nom de la Pléiade, lance sa fameuse Défense et illustration de la langue française qui fige la poésie dans l’imitation stérile des Grecs et des Romains. Toute la littérature classique suivra ces commandements et, quand Malherbe « vient », les règles de la littérature comme de la grammaire françaises sont sévèrement édictées
Au XVIIIème siècle, il y a des tentatives de libération, avec Diderot et Jean Jacques Rousseau. La critique dramatique et la critique d’art prennent leur essor et la critique sociale fait ses premiers pas (Contrat Social, De l’Inégalité, etc.). Chateaubriand l’oriente ensuite vers l’Histoire et le Romantisme triomphant bouscule les vieux canons, subit l’influence des littératures étrangères, la rend plus compréhensive et plus analytique. C’est alors une magnifique floraison. Ce XIXème siècle, que des écrivains tardigrades qualifient de stupide, a toutes les curiosités et dirige ses investigations de tous les côtés. Politique, Science, Économie, Art, sollicitent les efforts des critiques. Mais sur le terrain purement littéraire les Villemain, les Girardin, les Sainte-Beuve, s’avèrent supérieurs. Taine, à son tour, renouvelle la critique qu’il base sur l’observation directe, apporte une nouvelle méthode d’examen. Brunetière défend la tradition et la morale bourgeoises. Jules Lemaitre, le plus averti et le plus enjoué de nos critiques, s’amuse avec les idées. Lanson, Larroumet, Doumic, Faguet, pèsent leurs contemporains avec toute la lourdeur pédagogique.
Dans le domaine de la critique dramatique, illustrée jadis par Diderot, on peut citer les noms de Jules Janin, Paul de Saint-Victor, Théophile Gautier, Weiss, Francisque Sarcey, Catule Mendès, Brisson, qui tinrent la plume avec plus ou moins d’autorité, d’incompétence ou de mauvaise foi et qui s’opposèrent parfois brutalement aux jeunes et aux novateurs.
La critique d’art a pris, au vingtième siècle, une énorme importance. Elle est née véritablement au dix-septième siècle, avec les conférences imaginées par Lebrun, à l’Académie Royale ; a fleuri avec Diderot, Marmontel, Caylus, pour s’épanouir plus tard sous le sceptre de Ruskin, l’apôtre de la Beauté. Les Baudelaire, les Zola, les Maxime du Camp, les Charles Blanc, les Gustave Planche, les Octave Mirbeau, s’y consacrèrent avec passion. Zola notamment, défendit avec fureur les Manet, les Cézanne ; Mirbeau mit toute son existence au service des jeunes talents et de la vérité. Depuis, comme nous allons le montrer, la diversité des écoles, le bluff organisé, les systèmes les plus inconcevables ont rendu la critique d’art à peu près inopérante.
La critique musicale, peu brillante, trouve néanmoins, sa place dans les Journaux et revues. Le plus illustre de ces critiques est incontestablement Berlioz qui jugeait avec fougue et passion. On peut citer après lui, Arthur Pougin, Ernest Reyer, Adolphe Julien, Camille Bellaigue, et, de nos jours, des écrivains tels que Willy, Georges Pioch, etc...
Aujourd’hui, la critique, dans ses différentes manifestations, s’allie étroitement à la publicité et se détermine le plus souvent par des considérations de boutique et de camaraderie. L’indépendance du critique n’est plus, à quelques exceptions près, qu’un mythe. L’Argent a joué, dans ce domaine, le même rôle dissolvant et pourrisseur que partout ailleurs. Le critique dramatique semble le plus atteint. En réalité, il n’y a pas, il ne peut plus y avoir de véritable critique dramatique. Il n’y a que des comptes rendus dictés par l’intérêt du journal, lequel est lié par des contrats de publicité. Défense de toucher à celui-ci, qui représente une force avec laquelle il faut compter. Ordre d’épargner celui-là qui est l’ami de la maison. Dans ces conditions, le malheureux critique, qui vit d’ailleurs de son métier, ne sait plus comment dire ce qu’il pense de l’œuvre dont il a à entretenir ses lecteurs. Mais, si cette œuvre choque les préjugés, crie de trop cruelles vérités, se mélange de satire, le silence est imposé. On a vu de remarquables exemples de cet esclavage Intellectuel avec les manifestations que provoquèrent des représentations d’œuvres telles que le Foyer de Mirbeau et, plus récemment, la Carcasse, interdite et conspuée par la presse sous le prétexte qu’elle mettait en scène un général grotesque.
La Bourgeoisie est souveraine à notre époque. Les théâtres sont à elle. On ne peut ouvrir un théâtre, aujourd’hui, qu’avec des millions. Les gens qui paient veulent être servis. Une œuvre n’est acceptée et jouée qu’autant qu’elle est susceptible de rapporter de l’argent. On monte une pièce de théâtre comme une affaire et les quelques exceptions que l’on pourrait invoquer ne font que confirmer cette règle. De plus, les acteurs connus et influents, ceux qu’on appelle des vedettes, interviennent, soit pour dicter leurs conditions, soit pour apporter le commanditaire ; cela se voit surtout du côté féminin et il arrive fréquemment qu’une dame armée simplement de ses charmes, parfois surannés, et dépourvue de tout talent, s’impose au directeur de théâtre et au public éberlué sans que les critiques osent protester.
Nous sommes donc très loin de la critique telle qu’on le pratiquait autrefois. La bourgeoisie triomphante, et surtout la fraction de cette bourgeoisie sortie de la guerre ne consent pas à se laisser railler ou fustiger sur la scène. La vérité lui est odieuse. Jadis, un Molière pouvait faire représenter Tartufe devant la cour du Roi-Soleil. Plus tard, un Beaumarchais ne craignait pas de bafouer les nobles de son époque et ces derniers trouvaient très drôles les saillies et réparties de Figaro. Nos modernes bourgeois n’admettent que l’encens des thuriféraires ou les bonnes petites plaisanteries bien salées qui aident à la digestion. Et les critiques payées par la bourgeoisie qui dispose de la presse doivent satisfaire leurs maîtres et seigneurs.
La critique littéraire est également régie par la publicité et soumise à ses exigences. Elle cède aux obligations de la camaraderie et aux désirs des coteries et chapelles. La plupart des écrivains, romanciers, poètes, essayistes, s’adonnent à la critique et rendent le bien pour le bien. Rares sont ceux qui peuvent se proclamer indépendants et disent toute leur pensée. Il faut reconnaître, cependant, qu’Il en est encore quelques-uns et que la critique littéraire n’est point complètement muselée.
La critique d’art est tout simplement inexistante. Elle est faite à peu près des communiqués de marchands de tableaux et de négociants en peinture. On ouvre une exposition comme une boutique d’épicerie. On lance un artiste comme un produit. Il faut ajouter à cela, les faux engouements pour certaines théories projetées par le bluff ou l’impuissance, engouements habilement entretenus par les intéressés qui profitent de la sottise publique et du snobisme. On en est parvenu ainsi à classer, parmi les plus purs chefs-d’œuvres, des tableaux sans dessin ni forme, des blocs de marbre sans ligne. Tout ce que peut imaginer la fantaisie la plus abracadabrante dans l’absurde et l’incohérent, se donne libre essor et recueille tous les suffrages. Quiconque s’avise de protester ou de vouloir des œuvres saines et fortes se voit conspué, qualifié de pompier. Tout métier est rigoureusement banni, toute technique suspecte. Le bon sens devient une denrée méprisable. Dans ce babélisme inouï, où chaque école parle sa langue, où chaque clan a son vocabulaire, les commerçants en art tirent gloire et revenus, au détriment des artistes probes et sincères. Et la critique, inféodée aux hommes d’affaires, se tait ; la critique est impuissante à remonter le courant.
On ne rencontre de libre critique que dans de petits journaux et revues d’avant-garde. Là, le sens critique s’exerce sans retenue et les vérités sonnent à toutes les lignes. Par malheur, ces feuilles dotées d’une clientèle réduite et dépourvues de numéraire n’ont qu’une action limitée sur un petit nombre de lecteurs.
On peut affirmer, cependant, que jamais le sens critique ne se développa et ne s’aiguisa comme à notre époque. La critique sort du domaine de la littérature, de l’art, de l’histoire... Elle est surtout sociale. Elle poursuit ses investigations dans tous les milieux, pose tous les problèmes, étudie les lois et les conditions auxquelles sont soumis les hommes et aboutit, tout naturellement, à dénoncer l’organisation sociale basée sur l’exploitation de l’homme par l’homme. Et, ici, nous touchons à la critique socialiste. Mais les anarchistes vont plus loin et donnent leur attention au principe d’autorité d’où découle toute la malfaisance sociale.
Ainsi la critique, qu’elle touche à la littérature, à l’art, au théâtre, est dominée par des préoccupations sociales, à la condition toutefois, qu’elle demeure libre et échappe à la terrible emprise de l’Argent. Le sens critique qui est la marque même de la raison et se manifeste, en un temps de bas mercantilisme et d’incertitude, par l’ironie, quelquefois par le sarcasme, s’affirme partout, contre les préjugés ridicules et odieux, contre la Bêtise régnante, contre les Dieux, contre les Concepts, contre les Autorités, contre les Mensonges. Il conduit tout droit sur la route de la Révolte.
Le jour où la justice et la logique seront introduites dans l’ordre social, la critique échappant au joug du capital, reprendra tous ses droits.
― Victor MÉRIC.
CROISADE
n. f.
Le mot « croisade » dans le langage consacré, sert à désigner les pèlerinages militaires entrepris par divers monarques européens du XIème siècle au XIIIème siècle. Ces excursions armées se faisaient sous le couvert de la religion et avaient pour but avoué de convertir au catholicisme les infidèles d’Orient ; en vérité leur véritable but était de conquérir la Palestine et d’en chasser les musulmans. La première des Croisades, prêchée par Pierre l’Ermite et décidée au Concile de Clermont, fut conduite par Godefroy de Bouillon, duc de Lorraine et Raymond, comte de Toulouse. Les armées féodales étaient fortement organisées et s’emparèrent de Nicée, d’Antioche et enfin de Jérusalem dont Godefroy de Bouillon se fit proclamer roi. La première Croisade dura de 1096 à 1099. La seconde fut couronnée par un échec. Elle fut entreprise par le roi Louis VII en 1147 et se termina en 1149 après un siège inutile devant Damas. De 1189 à 1270, six autres Croisades furent entreprises. La dernière fut conduite par le roi Louis XI, pour venger l’insuccès de la Croisade précédente où Louis IX fut fait prisonnier et dut payer une forte rançon pour recouvrer sa liberté. Cette dernière expédition coûta la vie au roi qui mourut de la peste devant Tunis. L’armée fut elle-même décimée par le terrible fléau.
Si l’on se reporte à l’époque ou les Croisades furent entreprises, il faut reconnaître qu’elles exercèrent, dans une certaine mesure, une influence heureuse sur l’avenir. C’est par les Croisades que les Européens prirent contact avec les Asiatiques et, durant ces deux siècles de lutte, les uns et les autres apprirent à se connaître. L’historien français Lavallée s’exprime ainsi en parlant des Croisades : « Une commotion violente fut donnée à tous les esprits, à toutes les facultés, à toutes les existences. On était jeté hors de l’isolement féodal ; on promenait ses regards sur un vaste horizon ; on se mettait en contact avec de nouveaux hommes, de nouvelles choses, de nouvelles idées. La féodalité en reçut un immense échec ; elle s’était remuée, elle était sortie de ce qui faisait sa force, de ses châteaux et de ses terres ».
S’il est vrai que les Croisades furent un facteur d’évolution, il ne faudrait pas en conclure que la guerre est parfois utile. La guerre est toujours néfaste et il ne faut pas oublier que les Croisades furent organisées à une époque où la civilisation et le progrès n’étaient, en France, qu’embryonnaire. Il en est autrement de nos jours et les diverses Croisades entreprises par les capitalistes pour accaparer les territoires propres à être exploités, et les guerres coloniales qui se perpétuent malgré les protestations populaires, ont un tout autre caractère. Les Croisades modernes sont plus meurtrières que celles du passé. « Les Croisades, nous dit Voltaire, coûtèrent à l’Europe plus de deux millions d’habitants en deux siècles ». La dernière guerre de 1914 qui, dans l’esprit populaire, prit le caractère d’une Croisade ayant pour but le triomphe de la civilisation et la mort du militarisme, coûta, en quatre ans, près de dix millions de vies humaines. La civilisation en est sortie affaiblie et le militarisme renforcé.
Il est une Croisade qui serait et qui est utile à prêcher : c’est celle contre les préjugés, contre les croyances, contre le mensonge sur lesquels reposent nos sociétés bourgeoises. Et cette Croisade est sainte, car elle a pour but la libération et l’égalité de tous les hommes. Elle soulève, hélas ! moins d’enthousiasme que toutes les aventures dirigées par les conquérants ; et le peuple reste souvent sourd à l’appel de la raison. Espérons que, à la faveur des événements, tout cela changera et que la dernière des Croisades abolira déflnitivement le capitalisme et tous les maux qui en résultent.
CROYANCE
n. f.
Confiance irraisonnée à un dogme, à une religion. Le mot « croyance » s’applique plus particulièrement aux faits sur lesquels reposent les systèmes religieux. La croyance est un phénomène d’ordre sentimental, car elle ne s’adresse jamais à la raison ni à la logique ; elle se refuse à toute analyse car elle ne peut être soumise à l’analyse des bases sur lesquelles elle repose, se perdant dans l’abstraction. Il est faux de prétendre que la croyance ne se manifeste que chez l’individu peu développé et peu cultivé. Il y a des croyants sincères qui, sont, pourtant, pourvus d’une haute culture. Tolstoï était croyant et cependant on ne peut le taxer d’ignorance.
L’homme, à sa naissance, n’hérite pas seulement des tares physiques de ses ancêtres ; il hérite également de leurs tares morales et intellectuelles et ce n’est que lentement que l’individu se transforme. La croyance est un legs du passé. Les siècles d’esclavage qui nous ont précédé, l’obscurantisme religieux ont laissé des empreintes profondes sur les cerveaux. L’ homme est imprégné de croyances : mais le travail d’évolution se poursuit, et de génération en génération, on voit de plus en plus s’effacer les préjugés qui obstruaient la route de la Vérité.
Les croyances disparaissent. Certes l’instinct et le sentiment jouent encore un grand rôle dans la vie des individus et des sociétés ; cependant, ils sont appelés à céder la place à la raison et les générations futures s’orientent de plus en plus vers la lumière, laissant derrière elles les croyances qui sont les derniers vestiges de l’ignorance et de l’erreur.
CRUAUTÉ
n. f.
Inclination à faire souffrir ses semblables. La cruauté, dit Lachâtre, « est toujours un grand mal ; mais quand elle se trouve dans un homme revêtu de quelque autorité, elle devient un fléau ».
L’histoire est remplie d’actes de cruauté et certains d’entre eux sont devenus proverbiaux. Qui donc ignore la cruauté des Borgia et plus particulièrement de César et de Lucrèce qui furent cruels jusqu’au sadisme. Néron fut aussi un maître dans l’art de la cruauté. Ce tyran perverti et sanguinaire ne se plaisait que dans le crime et tout son règne est marqué de boue et de sang. Hélas ! La cruauté n’a pas encore disparu de la terre et, si elle n’emprunte plus la même forme et ne se réclame pas des mêmes principes, elle ne s’exerce pas moins sur une certaine classe d’individus. C’est la cruauté du juge qui s’abat sur le miséreux qui crève de faim et qui se révolte ; c’est celle du policier qui se manifeste au cours des démonstrations populaires ; c’est la cruauté des tortionnaires dont sont victimes les malheureux réfractaires envoyés dans les bagnes lointains. Et cependant, l’homme n’est pas cruel par nature ; il est rendu méchant par les rudes nécessités de l’existence, inhérentes au désordre social créé par le capitalisme et la bourgeoisie. Dans une société où le bonheur des uns ne sera pas fait du malheur des autres, l’homme n’aura aucune raison d’être méchant, et la solidarité effacera la cruauté.
CULTES
Les cultes solaires, origine du christianisme — Les mystères des premiers chrétiens et la communauté des femmes.
Dans mon article sur la Bible, j’ai déjà fait allusion aux ressemblances qui existent entre le christianisme et les religions orientales. Les origines du christianisme sont toujours discutées et donnent lieu à toutes sortes d’hypothèses, parce que c’est l’existence du christianisme primitif qui suppose celle du Christ et non pas l’existence du Christ qui implique le fait chrétien.
On en revient aux idées que Dupuis avait formulées dans un livre fort documenté trop oublié aujourd’hui : L’abrégé de l’origine de tous les Cultes, reprise par Réthoré, Jensen, Robertson, etc., et qui fait du christianisme une religion solaire, à peine modifiée par des juifs messianiques, croyant proche la fin du monde.
A les en croire, ainsi que leurs continuateurs, le christianisme est une religion d’origine solaire, comme l’étaient les autres cultes orientaux, celui d’Adonis en Syrie, d’Attis en Phrygie, de Thammouz et de Mardouk en Mésopotamie, de Dionysos en terre hellénique.
L’idée d’un Dieu qui ressuscite à l’entrée du printemps est commune à tous les cultes orientaux. Réthoré a montré que les dieux Agni, Mithra, Osiris, Thammouz, Adonis, Bacchus, Apollon, Manou, Bouddha, suivent un même cycle. Ils naissent le 25 décembre, au solstice d’hiver, d’une vierge mère dans une grotte ou une étable. Tous meurent et ressuscitent parce que le soleil vaincu périodiquement par la nuit et l’hiver, revient, chaque matin et chaque printemps.
Les grandes paraboles évangéliques, qui se retrouvent dans les Synoptiques sont solaires, ont trait aux semailles, à la moisson, aux vendanges, aux cultivateurs. Par exemple : les paraboles du Semeur, de l’Ivraie, nu Grain de sènevé, du Levain, du Vin nouveau dans les vieilles outres, du Figuier, des Vignerons.
Dans les livres sacrés des chrétiens et surtout dans l’Apocalypse, un de leurs livres d’initiation, Jésus est appelé l’agneau, nom du signe de l’équinoxe de printemps (bélier ou agneau, selon les régions). Cet agneau triomphant paraît debout sur la montagne et les douze tribus l’environnent, leur destin étant de le suivre partout où il va. Ici-bas d’ailleurs, le Christ était suivi de douze disciples. Ce chiffre douze correspond aux 12 signes du zodiaque.
Dans la scène de la Transfiguration (Matth., XVII), le visage de Jésus resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blanc comme la lumière. L’Ostensoir est une représentation du soleil.
Tout cela ne veut pas dire qu’il n’ait pas vécu au siècle d’Auguste un révolté ou un chef de bande juif, rebelle au joug romain et haïssant ceux de ses compatriotes qui s’étaient courbés devant la puissance des Césars. Il se peut qu’il ait été crucifié (on en crucifiait tant, de ces provocateurs d’émeute !) et que, par suite de circonstances ignorées, toute une légende se soit créée autour de cet homme, qu’on en ait fait le porte-nom et le porte-drapeau d’une religion nouvelle.
On a voulu voir dans le Jésus ben Pandéra du Talmud, un de ces types d’agitateurs dont certains traits auraient servi à la construction de la légende du Christ historique. Cela se peut, mais la crucifixion de ce Jésus-là est antérieure d’un siècle au commencement de l’ère vulgaire.
D’ailleurs, rien ne prouve que les chrétiens n’existaient pas, en tant que secte, bien longtemps avant leur apparition dans l’histoire, à Antioche.
Les chrétiens primitifs avaient des mystères appelés Agapes, qui disparurent au IVème siècle et dont un des rites courants était la promiscuité sexuelle.
Les cultes solaires dionysiaques. et orientaux, ont des mystères dont la promiscuité sexuelle fait également partie intégrante, parce qu’elle symbolise l’union du Soleil qui ne refuse à aucune plante ses rayons fécondants avec la Terre qui ne se refuse pas non plus, elle, aux caresses maturatrices du Soleil.
Si le mystère de cette promiscuité s’accomplit parfois dans un lieu où règne l’obscurité, naturelle ou produite artificiellement, c’est parce que le blé germe en hiver, alors qu’il fait froid et sombre, que le soleil parait à peine à l’horizon, qu’il a à lutter avec les ténèbres et les frimas.
Le mystère de la promiscuité sexuelle, dans ces religions, n’est pas un acte de dépravation, c’est un symbole que comprenaient tous les initiés.
Sans doute, il faut procéder avec une extrême précaution lorsqu’on s’en réfère aux Evangiles ou biographes de l’hypothétique fondateur du christianisme. Il est évident qu’au moment où elles sont définitivement classées dans le canon sacré, c’est-à-dire au IVème siècle de notre ère, elles ont été mises au diapason du dogme catholique.
Malgré cette cuisine, pas toujours .très adroite, — en comparant les textes du Nouveau Testament avec les accusations portées contre les premiers chrétiens par les contemporains et avec les pratiques des sectes hérétiques, où la tradition primitive avait beaucoup plus de chance de se conserver que dans une Eglise devenue officielle — en procédant donc d’après la méthode critique qu’on applique à tout récit légendaire ou même historique, on peut se rendre compte des mœurs des chrétiens primitifs.
Ainsi, on s’aperçoit que le Christ légendaire est un homme de mœurs assez « relâchées ». Son attitude aux noces de Cana, ses relations avec la courtisane Marie, sœur de Marthe, sa bonne amie également (c’est cette courtisane hystérique qui baignait ses pieds de larmes et les oignait de parfum), ses festins continuels en compagnie de péagers et de gens de mauvaise vie, ses dispositions à l’égard de la femme adultère, ses entretiens néo-platoniciens avec la Samaritaine qui avait eu cinq maris et dont le compagnon actuel n’était pas le mari, les femmes aisées et énamourées, cela va sans dire qui l’assistaient de leurs bourses — tout cela ne fait pas du Jésus mythique un ascète ni un doctrinaire très rigoureux sur le chapitre des mœurs.
Le rôle de Père la Pudeur, de Modérateur, fut destiné à un certain Saul, natif de Tarse, en Cilicie, un visionnaire doublé d’un épileptique, qui a orienté le christianisme naissant vers le dogmatisme et l’ecclésiasticisme.
À remarquer qu’à Tarse on adorait le dieu Sardan, qui présidait à la végétation, une divinité solaire qui mourait sur un bûcher puis montait au ciel.
Toujours est-il que converti au christianisme, sous le nom de Paul, cet homme, croyant la fin du monde proche (comme les autres chrétiens d’ailleurs), se mit en tête d’édifier et de moraliser à la judaïque les communautés chrétiennes primitives. Dans .ce but, il leur écrivit lettres sur lettres. Ces lettres prêches sont connues sous le nom d’Epitres. Nous ne les connaissons pas dans leur rédaction primitive. L’autorité de certaines est contestée. Il est évident qu’elles ont été mises elles aussi, au diapason de la dogmatique ecclésiastique du IVème siècle.
On veut que ces Epitres aient subi des remaniements dûs aux disciples du gnostique Marcion et aux anti-marcionites. Ce n’est qu’après avoir gratté la couche de ces corrections qu’on retrouve le véritable texte de Saint Paul.
Sans vouloir creuser aussi profondément, contentons nous de dire que ces Epîtres nous présentent Paul sous les traits d’un farouche contempteur de l’œuvre de chair. Il pense « qu’il est bon pour l’homme de ne point avoir de contact avec la femme » (I Corinth. 7/1). S’il autorise le mariage c’est par « condescendance » (id. 7/), et parce qu’il vaut mieux encore se marier que brûler. A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves il déclare, qu’il est bon de rester comme lui, célibataire (id. 7/8). Farouche, partisan de l’autorité paternelle il énonce : « Celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux » (id. 7/38).
Il entreprend une campagne contre les mœurs libres des premiers chrétiens et ce que les censeurs ecclésiastiques ont laissé passer montre ce qu’elles étaient. On entend dire généralement, écrit-il aux Corinthiens (I Corinth. 5/1), qu’il y a parmi vous de l’impudicité et une impudicité telle qu’elle ne se rencontre pas même chez les païens. Mêmes objurgations dans ses épîtres aux fidèles des églises de Colosses, Philippes, Ephèse, Thessalonique, etc... Partout le même refrain : Guerre à l’impureté, l’impudicité, les passions, les désirs, etc…
D’ailleurs, il veut commencer par en haut sa réforme des mœurs :
« Que l’évêque, que le diacre, que l’ancien soit le mari d’une seule femme ». (Ep. à Timothée et à Tité.)
Les exégètes catholiques prétendent que dans ces derniers textes, il faut voir une allusion aux « secondes noces », question qui troublait alors l’Eglise. Un pasteur protestant m’a objecté une fois que la loi romaine autorisant le concubinage, on avait toléré la polygamie dans certains cas, pour ne pas dissoudre la famille. Mais ce sont des explications après coup. Il n’y a qu’à se rendre compte de l’état d’esprit du célibataire Paul et de son attitude arrogante à l’égard des libres mœurs des chrétiens primitifs, pour se rendre compte qu’il ne voulait pas de dignitaires polygames dans les communautés ou églises qu’il dirigeait ou influençait. Il ne voulait de polygames que pour martyrs.
Jude, au verset 12 de son Epître, avoue qu’il y a des hommes qui « souillent leur chair » et qui sont des « écueils » dans les Agapes. Il est forcé ainsi de donner raison aux romains, qui prétendaient que lesdites agapes étaient un lieu « de mystères infâmes », y compris la pédérastie.
Dans l’Apocalypse, les églises de Pergame et de Thyatire sont encore stigmatisées comme impudiques. Et l’Apocalypse est d’une date tardive.
Il ne faut pas prendre au tragique les mines scandalisées des écrivains romains quand ils parlaient des chrétiens primitifs. Les chrétiens primitifs fournissaient aux dirigeants de l’Empire un commode moyen de diversion politique, et l’on criait « aux lions les chrétiens » comme on fait aujourd’hui des procès de tendance aux communistes, aux révolutionnaires, aux anarchistes.
Les adeptes des cultes orientaux faisaient dans leurs mystères les mêmes gestes que les premiers chrétiens dans leurs agapes, mais ils ne se montraient pas rétifs devant l’autorité.
Les premiers chrétiens, au contraire, de par leur ascendance, judaïque de race ou d’intellect — les juifs étaient un peuple au col « roide » — se montraient rebelles au gouvernement impérial. Le service civil leur répugnait, le métier militaire leur était odieux ; enfin — et c’était là le principal — ils ne voulaient pas prêter le serment civique « au nom du génie de l’empereur ». L’Etat ne leur pardonnait pas ce refus et y voyait motif à suspicion.
Ce n’est donc pas à cause de leurs cris au scandale que j’accepte en partie les accusations des Romains contre les premiers chrétiens. C’est parce qu’elles cadrent avec les admonestations des Epîtres, ou ce qui en est parvenu jusqu’à nous.
Quand on veut se faire une idée des mœurs des primitifs, on ne se réfère pas à la morale officiellement en vigueur au sein des civilisations anglo-saxonne ou latine, par exemple.
On s’en va vers les aborigènes de l’Australie de l’Afrique Centrale ou Méridionale, de l’Amérique du Sud. On suppose que moins ils sont en contact avec nos civilisations, plus ils ont conservé de traits primitifs.
De même, quand on veut se faire une idée des mœurs des premiers chrétiens, on ne se réfère pas au catholicisme, à l’orthodoxie grecque, au luthérianisme, à l’anglicanisme, au calvinisme, etc., qui représentent des aspects civilisés du christianisme.
On s’en réfère aux Carpocratiens, aux Turlupins aux Kloeffers, aux Adamites, aux Hommes de l’Intelligence, aux Frères du Libre Esprit, etc., où on a tout lieu de supposer que la tradition primitive avait été conservée avec plus de pureté que dans les Eglises officielles, d’autant plus que ces dernières les traquaient avec une férocité semblable à celles que les civilisés montrent à l’égard des Primitifs.
Or, toutes ces sectes, tous ces hérétiques (et il y en a bien d’autres), ont pratiqué le communisme sexuel ou la communauté des femmes comme corollaires de la communauté des biens.
Et contre eux, les sociétés catholiques ou protestantes ou orthodoxes ont formulé les mêmes accusations que les gouvernants ou chroniqueurs romains décochaient aux premiers chrétiens.
De plus, faisant œuvre documentaire et critique, je n’attache pas plus d’importance aux prétentions émises par Paul d’être en communion avec la Divinité, que j’en attache à des prétentions identiques émises par un Jean de Leyde, le prophète des Anabaptistes communistes, ou d’un Joseph Smith, l’apôtre des Mormons.
Ou j’y attache la même importance, si l’on préfère.
Et je ferai remarquer en passant qu’on possède beaucoup plus de détails sur les faits et gestes de Jean de Leyde ou de Joseph Smith que l’on en a sur l’hypothétique Jésus ou sur l’énigmatique Saint-Paul.
On connaît par le menu l’activité de Jean de Leyde à Munster quand ses coreligionnaires y exerçaient le pouvoir, sous sa dictature ; il n’y a aucun doute sur les phases de son procès, sur son supplice. On connaît la vie de Joseph Smith, son apostolat, son lynchage et le canon des livres sacrés des Mormons a été très rapidement constitué.
Par suite, si on veut nous faire accepter que Paul se rendant à Damas pour y persécuter les chrétiens ait été frappé de cécité à l’ouïe d’une voix qui lui criait : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu (Actes, XXII, 8) » ou qu’une autre fois il ait été ravi au troisième ciel (il ne sait si c’est dans ou hors de son corps), enlevé dans le Paradis « où il entendit des paroles ineffables qu’il n’est pas permis à un homme de répéter » (II Corinth. 12/2). Si on veut nous faire croire à la bonne foi de François d’Assise sur le corps duquel, dans une vision, un séraphin crucifié imprime les « stigmates » de la passion, où à l’apparition de la Vierge à Ignace de Loyola, je veux croire aussi à la bonne foi de Jean de Leyde et de Joseph Smith.
A vrai dire, je pense qu’à tous, Paul y compris, un séjour dans un institut de guérison des maladies nerveuses aurait été nécessaire.
Donc, indifférent aux excommunications séculières ou ecclésiastiques, je tiens comme d’essence chrétienne la doctrine anabaptiste telle que Matthias ou Melchior Hoffmann l’a exposée dans son fameux livre du Rétablissement, qui implique communauté des biens et pluralité des femmes, doctrine appliquée à Munster par Jean de Leyde, choisi, au dire du prophète anabaptiste Tuiscosurer, par « le Seigneur » pour exercer le pouvoir.
Et je considère comme d’essence chrétienne le livre Doctrine and Covenants, révélations faites à Joseph Smith, dont les premières éditions imprimées datent de 1833 et 1835 et qui complètent pour les Mormons les Epîtres du Nouveau Testament.
Or, que trouve-t-on à la section 132 de ce livre, aussi « sacré » à mon sens que tous les autres livres « sacrés » des chrétiens : c’est que Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon, reçurent des femmes et des concubines, que cela leur fut imputé à justice, parce que dans toutes ces choses ils accomplirent ce qui leur avait été commandé.
Dans cette même section, verset 61 :
« Si un homme épouse une vierge et désire en épouser une autre et que la première donne son consentement, et s’il épouse la seconde et qu’elles soient vierges, ne s’étant promises à aucun autre homme, cet homme là est justifié. Il ne peut commettre d’adultère avec qui lui appartient, à lui, et à personne d’autre. Et si dix vierges lui sont données, de par ladite loi, il ne peut pas commettre adultère, car elles lui appartiennent et lui sont données, à lui. C’est pourquoi il est justifié ».
Je ne vois pas que « Le Père Eternel » ait retiré sa bénédiction à la communauté des Mormons. Leur Eglise, dont j’exècre l’organisation hiérarchique, est l’une des plus riches et des plus prospères qui soient au monde. Sans doute le président Wilford Woodruff, en 1890, a fait renoncer officiellement son Eglise à la pluralité des femmes. Mais il n’a joué dans tout cela qu’un rôle analogue à celui de Saint Paul moralisant la seconde ou troisième ou quatrième génération (?) chrétienne. C’est parce qu’ils pratiquaient la pluralité des femmes que les Mormons ont été chassés de l’ouest des Etats-Unis, qu’ils ont dû se réfugier dans l’est, au-delà des Montagnes Rocheuses, et défricher l’Utah, ce qu’ils n’auraient pu faire d’ailleurs sans l’aide de leur nombreuse progéniture. Je les tiens pour des descendants attardés des chrétiens primitifs.
— E. ARMAND.
CUPIDITE
n. f.
La cupidité est le désir de certains de posséder des richesses et de Jouir passionnément des biens terrestres. L’individu cupide n’est jamais satisfait et, plus il possède, plus il veut posséder. Cela frise parfois la folie, car il est impossible à un esprit sain de comprendre la soif insatiable de certains hommes de l’argent et de la propriété. Si la cupidité poussée au paroxysme est une maladie, avouons que c’est une maladie dangereuse dont ne souffrent pas particulièrement ceux qui en sont atteints, mais les autres : ceux qui sont victimes des cupides. Que de mal peut faire à la collectivité humaine la cupidité des Rotschild, des Rockfeller, etc., etc..., qui amassent des fortunes colossales dont ils n’ont nul besoin et dont ils pourraient se passer sans pour cela changer même leur genre de vie. La cupidité est un vice qui engendre de terribles fléaux et la guerre n’est qu’une conséquence de la cupidité. C’est le rôle et le devoir des classes opprimées de la combattre si elles veulent voir le monde, affranchi de l’égoïsme et de l’avidité, marcher rapidement vers la fraternité de tous les hommes.
CURIOSITE
n. f.
Il y a deux sortes de curiosité : la curiosité utile et celle qui est nuisible. La première est louable, parce qu’elle signale un désir de savoir, de connaître, de s’instruire et que, par ses découvertes, elle est bienfaisante à l’humanité. Elle est en lutte constante avec l’ignorance et pénètre les secrets de la nature et du passé. Par ses recherches, elle ouvre la voie de l’Avenir. La seconde est blâmable, car elle a pour but de pénétrer les secrets d’autrui ; elle est indiscrète et impertinente et l’individu qui est atteint de ce défaut commet parfois des bassesses pour satisfaire sa curiosité. La curiosité est souvent déterminée par le désir de nuire ; il faut donc se méfier des curieux qui nous entourent et nous espionnent ; ce sont des êtres dangereux.
CYNISME
n. m.
Doctrine de certains philosophes de l’antiquité qui tenaient leur école à Athènes. Les cyniques méprisaient ou affectaient de mépriser toutes les convenances sociales et leur vie errante les fit comparer au chien. Le chien, était du reste l’emblème de leur secte. Par extension on a donné le nom de cynisme a tout ce qui est impudent, effronté, et qui pousse à l’excès la malpropreté morale. Un homme cynique est un individu qui reconnaît froidement ses méfaits et semblent railler ceux qui en sont victimes. Le cynisme de certains hommes d’Etat est révoltant et les crimes dont ils se sont rendus complices leur sont légers ; malgré l’hostilité qui se manifeste à leur égard, ils ont le « cynisme » de poursuivre leur carrière politique ou sociale et de préparer avec « cynisme » d’autres hécatombes.