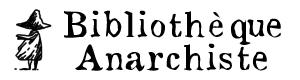Non Fides
Points de vue sur le sexisme
L’ancrage du sexisme
Le sexisme, c’est l’action de discriminer et de poser sur les genres des distinctions morales ou axiologiques (qui établissent une hiérarchie entre les valeurs d’un point de vue éthique et/ou esthétique). Il y a le sexisme qui consiste à différencier ou catégoriser deux personnes selon leurs sexes, à établir des différences autres que purement biologiques entre les hommes et les femmes. Il y a aussi le sexisme qui consiste à nier toute forme d’égalité entre les sexes sous prétexte d’une prétendue infériorité biologique de la femme ou — plus rarement — de l’homme. Or, porter un jugement de valeur sur un organe génital ou des données biologiques est hors propos, il ne s’agit la que d’opinions personnelles travesties en données scientifiques. En effet, dire « je préfère le rouge au noir » est purement subjectif et lutter pour que la science et la société acceptent que le rouge soit « mieux » (jugement de valeur) que le noir en faisant passer des opinions subjectives pour des preuves objectives est contraire à toute raison. Les sexistes qui s’appuient sur des « données scientifiques » pour affirmer l’infériorité de la femme sont donc des imposteurs qui tentent de faire passer des vessies pour des lanternes. Pourtant c’est bien à travers la science que se sont légitimées à travers les ages les idées sexistes.
Prenons par exemple le cas du développement de la craniométrie au XIXe siècle. Paul Broca (1824–1880), professeur de chirurgie clinique à la faculté de médecine fonda en 1859 la Société anthropologique de Paris avec laquelle il fit avancer l’anthropométrie craniale en développant de nouveaux instruments de mesure et de nouveaux indices numériques. Cependant une des prétendues découverte de Broca fut que l’intelligence des êtres se mesurait à la taille de leurs cerveaux. La femme ayant un cerveau plus petit que celui de l’homme, vous pouvez aisément imaginer les conclusions du scientifique qui aujourd’hui servent encore de « preuve » aux idéologues du sexisme et aux racistes (puisque des « preuves » de l’infériorité des noirs seront également fournies). Il est aujourd’hui établi malgré l’acharnement de nombreux réactionnaires que la taille du cerveau et le degré d’intelligence n’ont aucun rapport et que le poids du cerveau a plus à voir avec la masse corporelle qu’avec les facultés intellectuelles. Les exemples de ce type sont légions dans l’histoire des sciences.[1] Pourtant, aussi fausses soient-elles, ces idées reçues fabriquées par les esprits scientifiques du passé perdurent et sont loin de disparaître, notamment à cause d’un retour du religieux infectieux à propagation rapide. Il est de notre devoir de prévenir et de combattre la réaction, qui devient de plus en plus dangereuse au fur et à mesure que math et physique rencontrent métaphysique.
C’est sous le drapeau de la science que l’on impose aux hommes comme aux femmes, un modèle de comportement en nous faisant croire qu’il s’agit de « natures » différentes. Or, ce n’est qu’une construction sociale séculairement ancrée dans nos cultures. Il serait temps de se demander pourquoi les parents et les institutions scolaires continuent de mettre entre les mains des jeunes filles des poupées à habiller et coiffer ou de la dînettes à ranger comme pour habituer la femme à ranger la vaisselle, à devenir esthéticienne, à aimer ça (ou plutôt, apprendre à aimer ça). Pourquoi les garçons eux, n’ont accès qu’à des jeux de violences, des figurines musclées, des armes en plastique et des super héros militarisés ?
C’est parce que le sexisme commence au berceau qu’il est si prononcé. Une des solutions pour l’enrayer est de prendre le problème à la base et de transformer ce que l’on appelle aujourd’hui « l’éducation », qui est en fait le conditionnement/formatage, par une véritable éducation égalitaire (ou les garçons et les filles sont égaux), solidaire (ou l’entraide ne se manifeste pas seulement qu’entre filles ou entre garçons) et fraternelle (ou les différences sexuelles deviennent moteur de curiosité, d’érotisme, de sensualité ou d’instruction plutôt que de haine ou de mépris). Les enfants doivent êtres instruits de façon à ce que pour eux, « homme » et « femme » soient reconnus comme des genres sexuels et non comme des rôles sociaux auxquels ils devront se conformer sans réfléchir aux conséquences morales de ces constructions sociologiques.
Pourtant, le sentiment que les femmes ont tout acquis grâce aux luttes féministes de ces quarante dernières années (contraception, parité, divorce etc.) est largement répandu. En effet, certaines luttes ont abouties à des « droits », mais saurait-on se satisfaire de quelques couches de vernis superficielles dans les manuels juridiques ou dans le vocabulaire légal alors que le fond rance de nos cultures est toujours imprégné de sexisme, et surtout de misogynie ?
Certains progrès sont à remarquer mais les fondement des modèles homme/femme traditionnels n’ont jamais été véritablement remis en question à grande échelle ou par de larges groupes sociaux. Les sciences naturelles, la philosophie, l’Histoire, l’anthropologie ne devraient elles pas aujourd’hui servir à détruire les idées reçues concernant l’infériorité des femmes ? Comment se fait il que des personnages comme Eric Zemmour ou Alain Soral ont aujourd’hui encore droit de cité ? comment se fait il que les étudiants en philosophie (ou de toutes autres sciences humaines) soient abreuvés de philosophie masculine tandis que la qualité des travaux de philosophes telles que Hannah Arendt, Judith Butler, Simone De Beauvoir ou Voltayrine de Cleyre ne sont plus à prouver et pourtant majoritairement mis à la trappe ? Comment se fait il que dans les débats historiques moderne l’on ne reconnaisse toujours pas le sexisme comme élément moteur de certaines périodes et évènements historiques ?
Le sexisme recouvre ainsi des traditions, des comportements et des idéologies qui posent une différence de statut et de dignité entre l’homme et la femme. Dans la mesure où le sexisme définit le rapport hiérarchique ou non des deux sexes, c’est une forme de catégorisation sociale, morale, politique, religieuse, philosophique, économique, qui impose des normes de comportements aux deux sexes, et dont les deux sexes peuvent également souffrir ou jouir (selon leur position hiérarchique).
Abattons les rôles genrés !
Les deux sexes sont deux sexes, pas deux rôles construits socialement !
Le cas des « chasses aux sorcières », deux siècles de sexocide
C’est sur un fond de troubles que paraît en 1486, directement inspiré par la bulle papale Summis desiderantes affectibus d’Innocent VIII, le Malleus maleficarum. Ses auteurs, les inquisiteurs Henry Institoris et Jacques Sprenger, ont le sentiment de vivre la désintégration d’un monde :
« Au milieu d’un siècle qui s’écroule, l’hérésie des sorcières, attaquant par d’innombrables assauts, réalise en chacune de ses oeuvres, son incarnation totale. »
Ce livre se révèle être l’un des éléments déclencheurs des deux vagues de persécutions des sorcières perpétrées par l’Inquisition et par les différents parlements. Ils y font une lecture démonologique centrée sur le maléfice, puis anthropologique et sexologique accablant la femme, accusée d’être la complice de Satan. La théologie s’est alors muée (mais est-t-elle fondamentalement différente aujourd’hui ?) en une idéologie amalgamant hérésie, folie et frénésie sexuelle. Le modèle démonologique de « la femme au diable » est né, aussitôt pris en charge par l’imprimerie, c’est-à-dire véhiculé par une abondante littérature d’où se détache le traité de Jean Bodin Démonomanie des sorciers (1580).
Dans les premières sociétés néolithiques matriarcales, la femme avait socialement, le rôle le plus important. A l’ère chrétienne, les religions et croyances anciennes sont le diable de la nouvelle et c’est pourquoi le christianisme associa les femmes à des rôles maléfiques. Ce qui explique la prépondérance sur les bûchers des sorcières sur les sorciers. la chasse aux sorcières fut donc la répression des croyances ancestrales des cultures populaires par le pouvoir religieux augmentée d’un vaste mouvement de répression de la sexualité féminine et même, de la femme ensoi. A tel point que certains historiens parlent d’un « gynocide » ou encore d’un « sexocide » selon l’écrivaine Françoise d’Eaubonne dans Le sexocide des sorcières (1999). La phrase de Michelet extraite de son plaidoyer La Sorcière (1862), illustre bien l’ampleur de la persécution dont elles ont fait l’objet :
« Pour un sorcier, dix mille sorcières. »
Démontrant l’acharnement des inquisiteurs à juger et parfois brûler des femmes plutôt que des hommes, car entre 70 et 80% des condamnés au bûcher étaient des femmes. La sorcellerie serait donc en partie due à une misogynie tenace autant dans la culture populaire que dans la culture savante, principale responsable de cette extermination. Elles y sont rendues coupables, comme dans la bible avec la figure d’Eve, de la dénaturation de l’être humain en général, et de l’homme en particulier. Il apparaît souvent, au cours des procès du tribunal de l’Inquisition, une dimension sexuelle importante. Ces faits sont à mettre en relation avec les valeurs socioculturelles que l’Eglise et l’Etat tentent d’implanter dans l’esprit des ruraux et dans les fondements de la culture populaire. A travers la persécution des femmes s’exprime une répression plus générale de la sexualité. Les missionnaires de la réforme catholique combattent la relative liberté des mœurs qui existait dans les campagnes avant 1550. Ils imposent au monde paysan des « freins sexuels » efficaces. Les « aveux » extorqués par la torture aux prétendues sorcières peuvent être interprétés par rapport à cette lutte puritaine bien réelle. La copulation avec Satan, ou avec des démons, rappelle la survivance dans le monde rural des « fiançailles à l’essai », des concubinages, que veulent extirper de la culture populaire les autorités. Le sabbat, cette « fête sacrilège », n’est que la transposition diabolique des fêtes populaires multiples qui débouchaient fréquemment, l’ivresse aidant, sur des débordements sexuels. En fait, les multiples péchés imputés aux sorcières résultent d’une insatisfaction profonde des missionnaires devant la résistance d’une conduite sexuelle paysanne qui ne se coule pas suffisamment dans le moule théorique véhiculé par la réforme catholique du concile de Trente. Les procès en sorcellerie, dans ce contexte, permettent de culpabiliser les foules en reliant au diable la femme et la sexualité hors mariage. Dans le Malleus Maleficarum qui inspira ces vagues de répressions, les femmes sont l’emblème de la luxure. Avec elles, la sorcellerie prend la forme d’une débauche sexuelle : orgies, accouplements contre nature avec le diable, la sorcière est succube, fécondable par le diable et susceptible de donner naissance à des êtres démoniaques en transgressant les lois chrétiennes de la procréation. Les sorcières révèlent également en creux les angoisses sexuelles profondes de l’imaginaire masculin : elles sont supposées sectionner le membre viril des hommes à des fins rituelles, attenter à leur puissance sexuelle, ou encore, comme dans certains récits, engloutir des hommes par leur vagin (n’est-ce pas typiquement freudien ?).
Nombres d’historiens, et principalement Jules Michelet (1798–1874) dans La Sorcière, affirment que la pratique de la sorcellerie était l’expression d’une marginalisation volontaire, d’un refus de l’impérialisme religieux et d’une rébellion antisociale. Une révolte naïve de la culture populaire rurale contre les oppressions de l’Eglise et des élites urbaines et savantes, car c’est majoritairement dans les zones géographiques en cours de christianisation et dans lesquelles le pouvoir religieux était faible, dans les zones tardivement conquises, éloignées des centres de décisions et aux confins de la chrétienté qu’ont proliférés ces marginaux rebelles hostiles aux efforts de normalisation, d’intégration et d’acculturation déployés par la réforme catholique et le pouvoir monarchique. En effet, l’impiété est à l’époque baroque, un acte de rébellion. La sorcellerie peut donc être vue comme la réaction de la marginale qui sait son mode d’existence et sa liberté menacés par un nouvel ordre des choses imposé par les autorités religieuses. Loin de la considérer comme la manifestation d’un obscurantisme archaïque ou comme d’absurdes superstitions, Michelet voit dans la sorcellerie à la fois la conséquence de la misère des « temps du désespoir » et l’expression d’une révolte. La naissance, en réaction a l’impérialisme du dogme chrétien, d’une contre-culture féminine ancrée dans le paganisme — à qui l’Eglise et l’Inquisition font la guerre — pour mieux rejeter l’ordre moral chrétien. Seulement, nous pouvons voir que pour l’Eglise et les monarques européens, la plus grande menace est tout simplement la femme.
Le pouvoir, les hommes et parfois même les femmes aiment voir le genre féminin comme la raison de leurs malheurs.
Comme si la femme portait en elle le germe de la subversion.
La Grèce antique, une civilisation misogyne
« Qui se fie à une femme se fie aux voleurs. » (Hésiode, Travaux, v. 375)
Plus connue aujourd’hui pour son héritage culturel (Aristophane, Sophocle…), scientifique (Pythagore, Thalès, Euclide…) politique (la démocratie, l’aristocratie, la tyrannie…) et philosophique (Platon, Aristote, Xénophon, Héraclite…), la Grèce antique était une société profondément misogyne. Les femmes n’y avaient que des devoirs et étaient toute leur vie soumises à une autorité masculine : le père, le mari, le frère et/ou le fils. Elles sortaient peu de chez elles et ne pouvaient pas disposer librement de leur fortune qui était gérée par une des autorités masculine citées plus tôt.
Athènes était une démocratie, le peuple y exerçait le pouvoir et tous, riches ou pauvres, pouvaient voter à condition d’être Athénien de père et de mère, de ne pas faire partie des esclaves et d’être un homme, car à Athènes les femmes ne faisaient pas de politique. Une jeune fille athénienne de bonne famille « vivait sous une stricte surveillance ; elle devait voir le moins de choses possible, en entendre le moins possible, poser le moins de questions possible » (extrait de l’Économique de Xénophon). Les jeunes filles et les femmes participaient pourtant activement à la vie religieuse de leur cité. Pour certaines, les fêtes et les cérémonies étaient les seules véritables occasions de sortir de la maison, et la religion était le seul domaine où elles pouvaient exercer officiellement des fonctions importantes. La principale mission des femmes était de faire des enfants, ce dont se plaint Médée, l’héroïne d’une pièce de théâtre écrite au Ve siècle avant JC par le poète grec Euripide :
« Nous sommes, nous autres femmes, la créature la plus misérable. […] Ils disent de nous que nous vivons une vie sans danger à la maison tandis qu’ils combattent avec la lance. Piètre raisonnement : je préférerais lutter trois fois sous un bouclier que d’accoucher une seule. »
Dans les plus anciens récits légendaires de la Grèce antique, les rôles de héros sont réservés aux hommes… Les femmes, elles, doivent se contenter d’être des mères, des sœurs, des épouses ou des filles de héros. L’histoire de la création du Génos Guneikon (la « race des femmes ») nous est racontée par le poète grec du VIIIe siècle avant JC, Hésiode.
« Zeus, qui gronde dans les nuées, pour le grand malheur des hommes mortels a créé les femmes »
Pourtant, à la même époque en Égypte, les femmes jouissait des mêmes droits que leurs époux, elles pouvaient posséder des biens et il est même arrivé plusieurs fois que l’Égypte soit gouvernée par une reine. Dans la démocratie athénienne, le « féminin » est assuré par l’éphèbe et l’éromène. Des poètes comiques se demanderont pourquoi Zeus obligea l’homme à passer par la femme pour avoir des fils au lieu de se contenter d’une offrande à son autel. Cependant, c’est une société ou les taches ménagères sont accomplies par les esclaves, l’éducation par des pédagogues et où la sexualité est plus souvent pratiquée entre hommes lorsque le but n’est pas la procréation. Ce qui semble justifier dans la pensée grecque la gynophobie explicite des systèmes sociaux grecs, dans lesquels la femme ne sert finalement qu’à la reproduction des mâles. La soumission des femmes est un fait établi qui ne sera quasiment jamais remis en question. Les exemples littéraires sont nombreux, dans la tragédie Antigone de Sophocle, Créon déclare que si une femme ose se dresser, il faut l’écraser. Ou encore la mort de l’amazone abattue par Achille sous les hourras des hoplites :
« Apprends-lui donc à se conduire comme une femme ! »
Que dire également du fait qu’aujourd’hui l’étude de la philosophie antique se résume aux noms de Platon, Aristote, Xénophon et autres philosophes mâles et non pas aux noms de la cinquantaine de femmes philosophes de l’antiquité gréco-romaine récemment redécouvertes avec parfois de très grands noms comme Hypatie. Il s’agit d’un soucis patriarcal de néantisation de la femme et du féminin de l’histoire de l’humanité.
[1] Pour approfondir la question : lire La Mal-mesure de l’homme de Stephen Jay Gould dans lequel l’auteur s’attèle à la remise en cause profonde des théories sur l’intelligence qui ont permis la fondation de multiples préjugés racistes et sexistes.