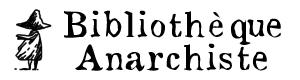Mezioud Ouldamer
Offense à Président
Médéa et Boufarik sont deux villes algériennes de moyenne importance. Toutes deux sont de pures créations coloniales. L’une était célèbre par son vin, l’autre par une friandise appelée zlabia. Aujourd’hui ni ce vin ni cette zlabia n’ont la saveur d’antan. Médéa est devenue un bastion de l’intégrisme. Boufarik est une cité-dortoir endormie.
Quand vous venez d’Alger et arrivez devant Boufarik, si vous abandonnez la route d’Oran et empruntez l’artère principale pour entrer en ville, au bout de quelques centaines de mètres, à votre droite, entre deux arbres énormes, vous voyez une modeste villa gardée par une sentinelle en uniforme de l’armée algérienne : c’est la prison « politico-militaire ».
Non loin de la grand-place, et sur l’artère principale, en plein cœur de la cité médéenne, en allant vers Khemis-Niliana, vous découvrez également sur la droite, une lourde porte avec une petite lucarne : le tout évoque une « boîte de nuit ». C’est en réalité la prison civile. Elle est contiguë, détail significatif, à la brigade de la gendarmerie nationale.
Il y a des dizaines de prisons en Algérie. Les deux évoquées ici pourraient remplir plusieurs volumes si elles avaient le loisir de raconter tout ce qu’elles savent.
On raconte cette petite histoire à propos du « Manchot » - tel est le sobriquet du colonel Ataïla, bras droit sanguinaire de Boumediene, patriote analphabète et tireur d’élite. Lorsque, dans le cadre des remaniements consécutifs à la mort de Boumediene, cet être d’exception fut désigné au commandement de la 1ère région militaire, il effectua une visite surprise à la Ferme, visite qui prit au dépourvu son directeur. Toute visite d’une personnalité à la prison est annoncée longtemps à l’avance, ce qui permet aux subalternes de préparer les lieux pour montrer au chef ce qu’il est censé trouver, c’est-à-dire des locaux propres et des détenus convenablement traités. Le colonel, arrivant donc impromptu, fit mine de s’étonner d’une situation qu’il ne pouvait ignorer.
Et, devant les prisonniers réunis dans la cour, il insulta le directeur, le menaçant de lui retirer tous ses galons et lui faire porter les mêmes haillons que ceux des détenus qu’il avait pour charge de garder. Toujours devant les prisonniers éberlués, il dicta les conditions d’un régime de détention parfaitement abracadabrant : café au lait, ration de chocolat, pain, confiture ou beurre, le matin ; viande tous les jours, midi et soir ; goûter. Plus : octroi de nouvelles tenues comprenant maillot de corps, chemise, chandail, pantalon, veste, chaussures, chaussettes, slip, le tout devant être changé régulièrement ; promenades quotidiennes ; assouplissement général du règlement – possibilité, notamment, de recevoir de la nourriture cuisinée au parloir. Durant un mois, à la grande stupéfaction des prisonniers, ce régime fut rigoureusement appliqué. La popularité du « Manchot » monta en flèche, mais elle ne dura que le temps pendant lequel le nouveau régime fut observé. La « grande toilette » n’avait en fin de compte été qu’une pitoyable ablution.
Dans ce pénitencier, même lorsqu’il baisse sensiblement, le nombre des détenus ne descend jamais au-dessous de six cents personnes, avec une moyenne de cent par salle. Une population composée presque exclusivement de militaires, très jeunes pour la plupart. Si l’on y retrouve des civils, c’est que leur affaire a un rapport avec l’armée – la définition de ce « rapport » étant, bien sûr, infiniment élastique, comme en témoigne mon propre cas. Les prisonniers affluent de toutes les régions, de toutes les villes, de tous les recoins d’Algérie. On peut féliciter l’État d’avoir, ici, réalisé cette unité nationale, qui, ailleurs, relève de la pure fiction. Parmi les jeunes, on note une proportion importante d’enfants d’émigrés. Beaucoup de ces malheureux étaient venus de leur propre chef « remplir leur devoir envers la patrie ». Ils ont vu que cette patrie ne s’est souvenu de leur existence que pour les asservir. Découvrant cette réalité, ils désertent aussitôt, pour être repris aux frontières et jetés en prison.
En raison des distances à parcourir, les prisonniers ne reçoivent pas tous les visites hebdomadaires autorisées – à commencer, évidemment, par ceux dont les parents résident en Europe. D’Oran, de Constantine – c’est-à-dire dans les conditions de transport les plus favorables –, les parents ne viennent, au mieux, qu’une fois par mois. Les prisonniers dont les parents habitent à plus de cinq cents kilomètres n’ont que des visites occasionnelles, deux ou trois fois l’an. Des lointaines ville du sud, de l’est ou de l’ouest, il faut plus d’une journée pour parvenir à Blida. Les parents, dans ce cas, se contentent d’envoyer lettres, argent et colis pour empêcher leur enfant de désespérer totalement, attendant sa libération pour le revoir. Beaucoup de ces prisonniers implorent en vain leur transfert dans une prison proche de leur résidence. J’ai rédigé plus d’une requête en ce sens pour des détenus illettrés : pas une seule n’a reçu de réponse. Étant donné le nombre de requêtes qui parviennent au procureur, je doute même qu’il les lise.
Ceux qui reçoivent leur visite hebdomadaire peuvent donc se considérer comme des privilégiés.
Mais le parloir est une véritable foire d’empoigne. Et ce pour une raison évidente : le nombre de visites est toujours important, et il n’est pas possible, en l’espace d’une demi-journée (le parloir finit à midi) d’admettre les visiteurs à tour de rôle. On place donc visiteurs et détenus en vis-à-vis, de part et d’autre d’un grillage de dix mètres de long. Heureux ceux qui, à ce moment, sont plaqués contre le grillage ; ils s’y cramponnent avec toute leur énergie tandis que, derrière eux, une houle de bras et de jambes s’acharne en vain. Il faut crier, appeler, s’égosiller pour entendre ou se faire entendre.
Pendant que dix visiteurs hurlent ce qu’ils ont apporté, vingt prisonniers essaient de dicter ce dont ils ont besoin. On ne se perd pas en échange de salutations ; on veut des cigarettes, des allumettes, des lames de rasoir, du dentifrice ; on a apporté un poulet, des œufs durs, du café ; mais non, il faut reprendre tout cela, sous peine de confiscation. Il faudrait surtout de l’argent, qui sera déposé chez le trésorier. Si l’on a apporté des cigarettes blondes, il faudra aussi les reprendre, car elles sont interdites. On a surtout besoin de savonnettes, de lessive, de timbres aussi, en grande quantité. En prison, on écrit à tous ceux que l’on connaît. Le linge aussi est interdit. On pourrait peut-être faire passer une paire de chaussettes ? Oui, à condition de trouver le moyen d’amadouer un gardien – en lui laissant, par exemple, quelques paquets de cigarettes. Même certains fruits, comme la pastèque, sont interdits. Motif : un jour on a découvert dans un de ces fruits près d’un litre de whisky. Sont admis les paquets de biscuits – qu’on reçoit souvent éventrés : la censure veut s’assurer qu’ils ne contiennent pas une arme ou de l’argent glissé en fraude. La nourriture n’a pas tellement d’importance ; ce qui compte avant tout, ce sont les cigarettes. On en a reçu une cartouche au parloir précédent : on en redemande au suivant. Car il n’est pas rare qu’un gardien fasse une première « coupe », en prélevant d’autorité quelques paquets. Il faut ensuite payer tribut au prévôt et à ses sbires. Sans leur appui, toute votre parloir peut disparaître le soir même. Du reste, on ne donne rien au prévôt : c’est lui qui prend. Dans la salle, son gourbi recèle tout un trésor : cigarettes, gâteaux, sucre, café, objets usuels en principe interdits. Pour que la loi du prévôt soit appliquée, il convient de le choisir fort et brutal. Il se fait seconder par deux ou trois acolytes, à peu près aussi brutaux que lui. (La salle 7, où l’on m’a placé à chacun de mes passages à la Ferme, constitue l’exception). Il y a une véritable hiérarchie à l’intérieur des gourbis, et le prévôt a ses favoris, avec lesquels il sait se montrer coulant : il peut les oublier pour une corvée, leur faire partager certains privilèges (comme d’aller aux cuisines, où il y a toujours quelque chose à chaparder).
En dehors de la courte période qui a immédiatement suivi la visite du « Manchot », la ration réglementaire du détenu a toujours été réduite à un minimum de famine. Tous ont le teint sans couleur et l’œil jaune des sous-alimentés. La faim est perpétuellement présente, avec ses conséquences normales : vols, trafics, disputes, magouilles, prostitution, etc. Les gourbis les mieux nantis peuvent procéder à des échanges d’objets ou de services : cigarettes contre café, savon contre corvée. Lorsqu’on n’a rien d’autre à proposer, on peut encore échanger son corps contre des cigarettes. La faim pousse à ramasser les pelures d’orange, les rognures de pommes de terre. Pour la corvée des poubelles chacun est volontaire : on y récupère du marc de café qu’on réutilise, un morceau de pain jeté par mégarde, et jusqu’à des feuilles de laitue à moitié pourries. Le jour où il y a du poulet au menu, c’est une véritable ruée sur les poubelles : on se dispute viscères et pattes, ailerons et têtes, qu’on passe sommairement au-dessus de la flamme d’une feuille de papier journal avant de les engloutir. Le dentifrice est une friandise qu’on tartine volontiers sur son pain. Les plus démunis mendient et chapardent – avec les risques que cela comporte. La mendicité ne paie pas, tous ceux qui ont quelque chose veillent jalousement sur leur bien, face au spectre de la pénurie. Les voleurs sont souvent dénoncés, ce qui leur vaut une prolongation de peine. Les jeunes émigrés, et tous ceux qui, par défaut de parloir, doivent affronter les mêmes conditions d’existence, n’hésitent pas à se livrer à la prostitution. La plupart se vendent pour quelques cigarettes. On peut se faire laver son linge pour un mégot ; se faire remplacer à la corvée en échange d’une cigarette. On a droit à une passe pour deux cigarettes ; une nuit de plaisir coûte un paquet ; une liaison durable s’obtient contre la promesse d’une fourniture régulière de cigarettes.
La question sexuelle est à l’origine de luttes féroces entre gourbis – d’autant plus féroces qu’un jeune éphèbe en est l’enjeu. Tout nouvel arrivant dans une salle est d’abord surpris par la manière dont tous rivalisent de courtoisie à son égard. Il est totalement pris en charge. Lorsqu’il accepte de faire partie d’un gourbi, durant les premiers jours, ses occupants ne lui ménagent pas leurs faveurs. Puis, on lui demande ses propres faveurs. S’il refuse, il est rejeté ; un autre gourbi l’accueille, et le même jeu se répète. Il peut finir par choisir de se retirer seul à l’écart. Mais au fil des jours, sa détermination chancelle du fait de la faim, des corvées et vexations qui ne lui seront pas épargnées. Le prévôt l’affectera souvent au nettoyage des toilettes ; s’il s’obstine dans son attitude, on le provoquera ; il sera battu et personne n’interviendra pour prendre sa défense. Des détenus le déculotteront de force. Il finira par accepter la protection d’un gourbi, pour lequel il se déculottera de lui-même.
Ceux qui se prostituent sont doublement méprisés ; comme si l’humiliation n’était pas suffisante, ils supportent en plus le mépris de leurs camarades. Ils subissent les traitements que la société réserve ordinairement aux femmes. Battus, injuriés, répudiés, ils deviennent, parmi toutes ces loques humaines, des chiffons. Certains sont des homosexuels condamnés précisément pour s’être livrés à leur penchant ; la plupart ont trouvé en prison le lieu privilégié pour le satisfaire impunément.
Il y eut même un jour un mariage célébré avec tout le cérémonial d’usage. Le marié était un prévôt, la mariée un jeune réserviste. La Ferme eut vent de l’événement et l’on ne se priva pas de le commenter, sur le mode amusé, dans les couloirs du tribunal. On savait bien, là, qu’il était impossible d’empêcher la sexualité de se manifester, à moins d’affecter un gardien à chaque détenu. Mais ce mariage eut une suite malheureuse : le prévôt reçut un ordre de transfert et sa « femme » ne put le suivre. J’ignore comment et où il a fini. Dans toutes les prisons (il serait plus juste de dire dans toute cette Algérie), la sexualité est cause de toutes sortes de drames dont l’image exemplaire est cet individu mutilé qui mutile à son tour. Ainsi, l’homosexualité, pratiquée à grande échelle, est également un sujet de profond mépris ; et les choses deviennent parfaitement démentielles lorsqu’on sait qu’on ne méprise que celui qui se donne, pas celui qui prend. A cet égard, la position du pouvoir est du reste très cocasse ; il condamne l’homosexualité par principe et invariablement. Mais ceci, c’est pour la galerie. Beaucoup, sinon tous les magistrats qui condamnent cette perversion, s’y adonnent très volontiers, sûrs de l’impunité que leur garantit leur fonction. C’est là tout un art : parvenir au titre qui vous donne la double faculté de condamner la perversion et de la pratiquer à loisir.
On trouve une illustration particulièrement tragique des ravages causés par cette attitude face à l’homosexualité dans une affaire qui faillit porter à la connaissance du public des faits que l’État lui cache généralement, pour préserver la fiction d’une honorabilité à laquelle plus personne ne croit. Il y a quelques années, on apprit que le fils d’un banquier avait été enlevé et que ses ravisseurs demandaient une rançon. Ceux-ci furent vite – un peu trop vite – arrêtés par la police. Quelques jours plus tard, l’un d’eux était passé par les armes après qu’il eut avoué son crime. On ne savait pas alors que le fils du banquier était homosexuel, et le ravisseur son ami intime. Être banquier et avoir un fils homosexuel sont deux choses parfaitement incompatibles : la tare de l’enfant menaçait de rejaillir sur le père. Au départ, il n’y avait qu’une simple affaire de mœurs, et le « ravisseur » avait vraisemblablement menacé de tout déballer devant le tribunal. La police le harcela, dans sa prison de Berrouaghia, pour lui faire signer une déposition accréditant la thèse de l’enlèvement. Il commença par refuser ; mais les policiers s’obstinèrent et lui promirent même de le libérer aussitôt la sentence rendue. Ce dernier argument le décida : il accepta de signer la déposition – et se condamna du même coup à la mort.
La situation à l’Annexe, au point de vue général, était restée sensiblement la même jusqu’à l’arrivée de Benkhellat et de ses compagnons. Durant tout le mois où ils étaient restés au secret, ils n’avaient eu pour se nourrir, se couvrir et dormir que le strict nécessaire fourni par la prison. Benkhellat m’assura qu’il avait assisté à de véritables pugilats pour une bouchée de pain ; une ration jugée légèrement plus généreuse qu’une autre provoquait une rixe ; un mot, un geste étaient prétextes à empoignades. Le détenu le plus faible était invariablement la proie des autres. Celui qui recevait un parloir ne se souciait aucunement d’en faire profiter un détenu moins favorisé que lui. Dans cette promiscuité, le plaisir arraché à l’autre hypothéquait lourdement les relations ; on profitait de la moindre occasion pour se venger de celui qui vous avait pris ce que vous n’aviez cédé que sous la contrainte. Lorsqu’il reçut enfin son premier parloir, Benkhellat eut une attitude réellement courageuse. Il se trouvait alors en salle I avec quinze autres prisonniers, dont l’un de ses amis, qui avait lui aussi eu un parloir. Des deux parloirs il fit exactement seize parts, rigoureusement identiques, et chaque prisonnier eut sa part. Ce fut une énorme surprise, y compris pour son ami, qui lui fit observer que les autres n’avaient pas eu cette générosité à leur égard durant tout ce mois où ils n’avaient reçu aucune visite. Il me dira :
« J’ai dû lui rappeler les idées qui nous avaient valu d’être arrêtés ; ce mois de solitude et de privation l’avait amené à penser comme eux tous. Mais il revint très vite de son premier mouvement d’humeur. Quant aux autres, l’effet de surprise passé, ils eurent très honte de leur comportement à notre égard. »
Au parloir suivant, Benkhellat agit de même ; les autres proposèrent alors de procéder, de manière systématique, au partage de tous les parloirs. Il n’avait forcé personne : il espérait seulement que son exemple servirait à quelque chose. Non seulement il refit seize parts, mais il fit parvenir dans les deux autres salles cigarettes et provisions. Au bout de quelques semaines, les trois salles avaient compris la leçon : de l’une à l’autre, on se faisait parvenir ce dont on manquait, chacun de son côté. La hantise de la privation disparut et avec elle les querelles et les affrontements désastreux. Benkhellat devait encore me dire :
« Il peut arriver qu’une chose manque ; mais alors elle manque à tous. S’il n’y a pas de cigarettes dans une salle, il n’y en a pas dans les deux autres, et on ne peut donc plus s’en servir comme monnaie d’échange pour négocier tel ou tel service. »
Il ne me racontait pas d’histoires : j’étais là pour constater que la situation était bien telle qu’il l’avait décrite. Néanmoins, je lui dis un jour :
« Mais quand vous partirez, et qu’il n’y aura plus personne dans les trois salles pour donner l’impulsion aux autres, ne risque-t-on pas de retomber dans la situation précédente ? »
Il répondit en souriant, du ton invariablement optimiste qui l’animait à chaque fois :
« Non, parce que l’habitude est prise. Les nouveaux venus trouveront toujours au moins un ancien qui leur communiquera cette impulsion. »
Je ne sais aujourd’hui ce qu’est devenue l’Annexe. Benkhellal parti, je me suis efforcé d’entretenir le salubre climat qu’il avait su instaurer. Et, partant à mon tour, j’exhortai ceux que je laissais à ne pas trahir les espoirs de cet incorrigible optimiste.
Mezioud Ouldamer.
P.S. Nous avons appris il y a peu le décès de Mezioud Ouldamer, survenu le 12 juillet 2017 (note de Non Fides).