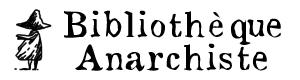Léo Thiers-Vidal
Rupture Anarchiste Et Trahison Pro-Feministe
écris et échanges de Léo Thiers-Vidal
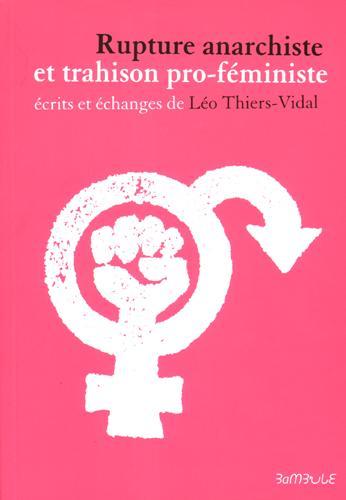
Anarchisme, Féminisme et la transformation du personnel
De l’indignation des mecs anars... en général
Libéralisme libertaire et anarchaféminisme : quelques éléments de réflexion
Suite à la dicussion « Tabous intériorisés face aux féministes »
Le masculinisme de « La domination masculine » de Bourdieu
La fin d’un tabou à l’université
Humaniste, pédocriminalité et résistance masculiniste
Ça se passe près de chez vous : des filles incestueuses aux mères aliénantes
RUPTURE ANARCHISTE ET TRAHISON PROFÉMINISTE
Écrits et échanges de Léo Thiers-Vidal
Préface de Mademoiselle
Présentation
Léo Thiers-Vidal s’est fait connaître dans le domaine universitaire par ses recherches sur les rapports sociaux de sexe. Il a soutenu brillamment sa thèse de doctorat en sociologie fin 2007, deux semaines avant son décès[1] Dans son numéro 3 de 2008, la revue Nouvelles Questions Féministes lui a rendu hommage. Les contributions proposées donnaient déjà quelques éléments biographiques et révélaient, à celles et ceux qui ne connaissaient que la partie universitaire de son engagement, l’ancrage de sa réflexion dans un militantisme commencé en Belgique et poursuivi en France dans les années 1990 et 2000. Depuis ce numéro, la thèse de Léo a fait l’objet d'une publication[2].
Nous avons souhaité rassembler une large sélection de ses écrits, rédigés et diffusés par différents moyens et sur différents supports entre 1996 et 2006, et qui vont bien au-delà du seul cadre académique. La plupart sont disponibles sur la Toile[3] et peuvent se lire séparément. Au-delà de l’hommage à un ami disparu, nous espérons, à travers ce livre, documenter son cheminement intellectuel et faire partager une pensée politique inspiratrice de liberté.
Les textes présentés dans ce recueil n'ont évidemment pas l'ambition de saisir l'intégralité des engagements et des réflexions de Léo, mais par leur diversité ils en restituent les lignes importantes. Ces écrits abordent une pluralité de thématiques telles que celle de la libération animale, de l’anarchisme, du féminisme, du pro-féminisme ou encore des violences masculines, dans des textes dont la forme varie également. Deux fils conducteurs lient ces travaux : leur ancrage dans la pratique personnelle de son auteur et sa constante recherche anti-autoritaire. C’est à la lumière de cette authenticité libertaire que nous nous retrouvons dans la pensée de Léo et que nous vous invitons à la (re)découvrir.
L’entretien avec Mimmo Pucciarelli que nous publions en guise de préambule témoigne des premiers engagements libertaires de Léo, en particulier dans l’antispécisme et l’activisme pour la libération animale. Sa rencontre avec le féminisme date du milieu des années 1990, alors que les théories et pratiques issues des années 1970 font l’objet d’un regain d’intérêt de la part de jeunes femmes de la gauche radicale. À Lyon, cela prend la forme de cortèges féministes dans les manifestations, de la revendication et la mise en place d’espaces non-mixtes dans les lieux associatifs et militants, de publications (« La menstrueuse » et « Et ta sœur ? ! ») et de l’émergence de groupes féministes (notamment « Les folles alliées »). Au mois d’août 1995, Léo participe à un camping antipatriarcal organisé en Ariège par des militant-e-s libertaires ; la dynamique sexiste du camping et sa contestation par des féministes le marquent profondément et renversent ses idées préconçues sur les rapports hommes / femmes. Il ne cessera dès lors d’affiner sa réflexion par des lectures abondantes, des discussions et dans la confrontation avec un milieu libertaire souvent hostile au féminisme radical.
Les deux premières parties du livre, La rupture anarchiste et La trahison pro-féministe, forment un certain ensemble cohérent qui correspond au début de son parcours intellectuel.
La première partie est essentiellement constituée d’articles politiques critiques à l'égard du mouvement anarchiste et du conflit autour de la librairie lyonnaise La Gryffe. C'est une période propice à diverses collaborations marquées entre autres par la publication (avec Corinne Monnet) de Au-delà du personnel (édition Atelier de Création Libertaire, 1998) et c’est aussi une période qui se termine sur un désaccord violent avec la librairie La Gryffe, dont Léo est exclu en 1998. Dans les différents articles de cette partie, Léo, à la suite de contributions de féministes radicales, énonce quelques vérités que certains ont (toujours) des difficultés à entendre ou à mesurer : le patriarcat est un système de domination, d'exploitation et d'oppression des femmes. Ce système social est reproduit au quotidien par des agents précis — les hommes — aux comportements précis ; tout homme en est le bénéficiaire selon des positions différentes (en fonction d’appartenances de classe, de race, de nationalité, de sexualité). Dans ces articles, Léo interpellait également les hommes sur le fait que des outils variés sont à leur portée pour produire le changement, mais constatait que la réponse prédominante était celle d’un continuum de résistances afin de conserver leurs privilèges : dédain, dénigrement, exclusion, coup, meurtre...
Le conflit en 1998 au sein de la librairie La Gryffe apparaît bien comme symptomatique de ce déchaînement anti-féministe de la part des anarchistes. Au-delà des aspirations et de l'utopie égalitaire — qui devraient produire un accord tacite avec les féministes — la réalité du mouvement et des relations en son sein est moins reluisante. Léo consacrera plusieurs articles à ce décalage entre la réalité des faits et les prétentions des libertaires-hommes (lui inclus). Et la désillusion a encore aujourd'hui ce goût amer : le statut, la qualité, l'épithète d'anarchiste n'annule en rien la position dominante des hommes, ne neutralise en rien leurs pratiques oppressives, et il constitue au contraire une forme de résistance à la reconnaissance de l’oppression des femmes par les hommes.
Plutôt que de retravailler les différents textes concernant La Gryffe, nous avons préféré les éditer tels quels, quitte à engendrer une redondance certaine. Nous faisons précéder ces articles par « Anarchie ou patriarchie », bien que ce texte n'ait pas été écrit par Léo. Il nous semblait intéressant de donner une seconde vie à cette prise de position féministe afin d'introduire les propos de Léo sur ces évènements.
Si les critiques que Léo adresse aux anarchistes datent de plus de dix ans, leur actualité demeure intacte. Aujourd’hui en France, la plupart des hommes anars continuent d’opter pour une non-critique effective de la domination masculine et un dénigrement quasi-systématique et caricatural du féminisme ou des féministes. Il est toujours à déplorer chez eux une critique de la domination qui se limite à attaquer l'état, la religion et le capitalisme, et qui soigneusement empêche de pointer les principaux bénéficiaires et agents du patriarcat. De la même manière que pendant des décennies les anars, et toute la gauche, consolidaient le mythe selon lequel LE capitalisme est responsable de l'oppression des femmes, aujourd'hui, avec « l'affaire du voile », la plupart crient avec les néo-laïcards que la responsabilité est dans ce nouveau bouc-émissaire qu’est le sexisme de l’Autre, sous la forme de l’Islam en particulier. Et l'ennemi principal s’en tire toujours à bon compte. L’ignorance et la méconnaissance des analyses féministes radicales — pour ne pas dire leur refus — y sont pour beaucoup et sont aisément constatables : composés d’un public relativement cultivé, la plupart des anars sont pourtant bien en peine dès qu’il s’agit de citer plus de trois théoriciennes féministes.
Et pour ce qui est du « numéro spécial féminisme » ou des quelques articles sur les questions féministes issues de la mouvance libertaire, ils ne changent rien à ce constat général. Car en définitive, l’existence de ces spasmes éditoriaux est gagnée de haute lutte par les féministes qui résistent à l’intérieur.
Cela explique sans doute les conséquences dramatiques pour la vie militante : un milieu majoritairement composé d’hommes qui drainent dans leur sillage les valeurs masculines opprimantes, une reproduction du mépris et des violences contre les femmes, se soldant souvent pas la désertion de ces dernières et en tout cas par la contrainte d’une résistance constante face au déni répété de leur autonomie.
Ce constat n’évacue pas le travail accompli par certaines revues ou groupes libertaires. Nous pensons à un journal comme Offensive (trimestriel de l’organisation « Offensive Libertaire et Sociale ») qui consacre à chaque numéro des articles sur les questions féministes et souvent de façon transversale avec d’autres thématiques. Nous pensons également à la « motion antipatriarcale » produite par la Coordination des Groupes Anarchistes, étonnante de radicalité[4].
La seconde partie de ce recueil rassemble des articles qui ont fait connaître Léo sur le plan universitaire et dont la lecture est sans doute plus ardue. Il ne s’agissait toutefois pas pour lui d’entrer dans les Études Genre pour y décrocher un diplôme professionnalisant avec un poste à la clé. Sans doute est-ce aussi à cela qu'on peut juger de la sincérité de ses engagements. L'étude du genre dans un cadre universitaire lui a simplement permis d'approfondir les analyses développées plus tôt dans son militantisme. En effet, pour ce qui est de la place des femmes, la micro-société libertaire illustre terriblement bien la société au sein de laquelle elle cherche à s'affirmer.
Léo avait une trop grande familiarité avec la pensée féministe et une trop grande acuité concernant le système du genre pour, dans ses écrits, parler à la place des femmes. Il a trouvé dans l'université un cadre pour affiner sa critique des rapports hiérarchiques et pour diffuser le courant dans lequel il s'inscrivait : le féminisme matérialiste. Dans un même mouvement, il s'est opposé au courant faussement subversif émergeant alors en France : le queer. Et il a continué d'inscrire la transformation et l'expérimentation personnelle comme un travail militant primordial pour le changement social. Il s'agissait également de trouver une reconnaissance non pas du monde académique mais des chercheuses situées dans l'académie.
Désabusé vis-à-vis des anarchistes, il le sera tout autant de certains pro-féministes rencontrés à l'université. « Je privilégie le fait de travailler avec des hommes dont je ressens une authentique envie de remise en cause de soi (même si ça coûte). Lorsque je sens une fausseté dans leur engagement, soit je rentre dans le conflit, soit je les délaisse pour en trouver d'autres qui en valent la peine », écrivait-il à l'une de ses correspondantes. D'où les articles sur Bourdieu, Cantat et Cie.
Et d'où aussi la situation que Léo lui-même déplorait : la quasi-absence d’hommes à ses côtés.
La dernière partie Annexes rassemble des textes surtout informatifs, quasi journalistiques, qui illustrent une autre facette de l'activité politique de Léo : la diffusion d'informations « brutes » sur la réalité des violences masculines (incestueuses, pédophiles...) et sur leur banalisation par certains. Loin des analyses, il s'agissait d'informer, de sensibiliser et de mobiliser.
De tout cet ensemble, on voit qu'il s'agissait alors d'un travail réflexif permanent, d’un va-et-vient constant entre théorie et pratique, entre individu, collectif et social. Loin d'être une impasse pour l'action, ces exigences produisent une lucidité stimulante et intransigeante, et pour les dominant-e-s des pratiques humblement prudentes. Car contrairement à la plupart des hommes, Léo reconnaissait publiquement, tout en la trouvant détestable, sa part de responsabilité et sa participation parfois active dans les systèmes de domination (sexe, race, âge, espèce, classe, sexualité). D’ailleurs, et contre toute attente, le quotidien des tâches ménagères n'était pas le fort de Léo, y compris dans les espaces collectifs.
De plus, il reconnaissait également l'impact essentiel et positif des féministes sur son parcours et ses pratiques. À mille lieux des préoccupations de la plupart des hommes, l’une des siennes consistait à résoudre le paradoxe où il ne s'agit pas de prétendre être autre chose qu'un homme, tout en s'en détachant autant que faire se peut. Il a alors cherché à sonder au plus profond de son intimité les implications sociétales et relationnelles auxquelles son sexe est attaché, et à les extirper hors de lui. Et dans une simple logique de solidarité empathique avec les opprimées, il n'a cessé de dénoncer et d'agir contre le masculinisme : refus des solidarités masculines, dévirilisation, etc. Avec l'envie, la sincérité et l'espoir de construire des rapports humains épanouissants.
Et nous suivons encore Léo quand il demande aux hommes « progressistes » de poser un préalable, crucial et indispensable, à leur action militante contre la domination masculine (et même au-delà) : la reconnaissance de leur position sociale spécifique. Cette reconnaissance a en effet plusieurs conséquences pratiques importantes : la visibilité, la mise en lumière de l'inégalité structurelle au détriment des femmes, une prise en compte subjective des effets de la domination, la possibilité d'une explicitation critique de la position des hommes, un garde-fou contre leur égo-andro-centrisme. Et concernant les liens avec les principales concernées dans le conflit d'intérêts ( les féministes), une reddition de compte : à savoir une politique de non-autonomie des hommes engagés contre le sexisme, afin d'éviter une forme de détournement ou d'appropriation de la lutte à leur profit.
L'application des idées politiques était la grande préoccupation de Léo : à quoi bon revendiquer un autre futur ou des principes égalitaires, autogestionnaires et anti-autoritaires, si soi-même on n'incarne pas ses convictions dans des pratiques quotidiennes ? Son parcours l'a amené à construire et faire partie de plusieurs collectifs, notamment : Prolote, Boule de neige, Les cahiers antispécistes, Cabiria, Mères en lutte, Clasches... Sa recherche éperdue d'une cohérence individuelle était certes marquée par l'inquiétude, le doute, la culpabilité, des frustrations épuisantes et des impasses comportementales.
Mais elle était aussi et surtout une (res)source et un mécanisme tenace propice aux rencontres stimulantes, à une participation au changement, et finalement à une intense complicité et une confiance profonde dans / de ses proches.
Son aversion pour les diverses formes d'oppression l'a incité à concevoir l'écriture à la fois comme outil pédagogique mais aussi comme une arme. Et c'est pourquoi nous ré-éditons aujourd'hui ses articles : les armes de Léo, directement issues des féministes, sont les nôtres. Nous les partageons.
Corinne Monnet Sabine Masson Samuel Morin Yeun Lagadeuc-Ygouf (Novembre 2011)
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont apporté leur aide dans la réalisation de cet ouvrage. Nous remercions plus particulièrement Mademoiselle pour sa préface. Nous vous invitons d’ailleurs vivement à lire ses billets dans le journal CQFD et sur son blog : http://blog.entrailles.fr
Préface de Mademoiselle
En tant que féministe, je n'attends pas Le Sauveur. Je sais que, quel que soit l'homme qui est en face de moi, il est celui qui bénéficie de l'oppression des femmes, de l'oppression que, jour après jour, je subis. Quoiqu'il en dise. Qu'il l'admette ou non. Je l'ai appris à mes dépens, après des années de discussions affectueuses mais infructueuses auprès de mes camarades et compagnons. Au départ, je voulais tenter de changer les choses en faisant appel, avec le plus de pédagogie possible, à leur cohérence, amour et amitié. 11 faut bien l'avouer, cette méthode a toujours lamentablement échoué. À présent, je trouve que le petit cri que j'ai longtemps poussé, « s'il te plaît, renonce à tes privilèges et cesse de m'écrabouiller, si tu veux bien, tu seras gentil, s'il te plaît, s'il te plaît ! », était un petit cri assez pitoyable. Mais c'était le seul petit cri que je savais pousser. Quand on vous coince les doigts dans une porte, il est assez surprenant de constater, la première fois, que tout ce qu'on sait faire c'est demander gentiment si on n'a pas sali la peinture avec son sang, avant de s'excuser puis de nettoyer. Pire, plus on se fait coincer les doigts dans cette porte, moins on pense qu'il nous est possible de faire autre chose que de pousser ce petit piaillement. Car nous sommes dressées à nous excuser lorsque l'on nous coince les doigts dans la porte. Nous sommes dressées à croire que c'est de notre faute, qu'on n’aurait pas dû laisser traîner ses doigts et qu'on l'a bien cherché. Nous avons du mal à prendre conscience de notre droit à vivre dotées de nos dix doigts, sans que l'on nous blesse ou nous coince. Nous avons du mal à prendre conscience de notre propre dignité, comme l'écrit Christine Delphy, et à exiger qu'en face, on en tienne compte. Pas par gentillesse ou grandeur d'âme, comme si l’on nous accordait un luxe, une cerise sur le gâteau, non, mais parce que nous avons le droit et nous exigeons de vivre autrement que comme des bêtes, à hanter la cuisine comme les rats hantent les égouts, autrement que comme des balais à chiotte, des trous ou des ventres sur pattes.
J'avais donc tendance à m'excuser quand on me coinçait les doigts dans la porte, mais un jour, j'ai pris conscience que mes mains, si longtemps entravées, pouvaient former un poing. Pour cogner. Et cela notamment grâce aux mots de Christiane Rochefort.
« Il y a un moment où il faut sortir les couteaux. C'est juste un fait. Purement technique. Il est hors de question que l'oppresseur aille comprendre de lui-même qu'il opprime, puisque ça ne le fait pas souffrir : mettez vous à sa place. Ce n'est pas son chemin. Le lui expliquer est sans utilité. L'oppresseur n'entend pas ce que dit son opprimé comme langage mais comme un bruit. C'est la définition de l'oppression [...] L'oppresseur qui fait le louable effort d'écouter (libéral intellectuel) n'entend pas mieux. Car même lorsque les mots sont communs, les connotations sont radicalement différentes. C'est ainsi que de nombreux mots ont pour l'oppresseur une connotation-jouissance, et pour l'opprimé une connotation-souffrance.
Ou : divertissement-corvée. Ou loisir-travail. Etc.
Allez donc communiquer sur ces bases.
C'est ainsi que la générale réaction de l'oppresseur qui a « écouté » son opprimé est, en gros : mais de quoi diable se plaint-il ? Tout ça c'est épatant.
Au niveau de l'explication, c'est tout à fait sans espoir. Quand l'opprimé se rend compte de ça, il sort les couteaux. Là on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pas avant.
Le couteau est la seule façon de se définir comme opprimé. La seule communication audible. (...) »
J’ai alors réalisé que mes plaintes, mes piteuses tentatives d’explications pédagogiques et patientes, se résumaient en réalité à ceci : pisser dans un violon. Si comprendre cela m’a fait du bien, il m'a également été douloureux de réaliser que l’intimité que je partageais avec un homme et les sentiments que j’avais pour lui s’inscrivaient dans le cadre de rapports oppressifs, hiérarchiques et donc violents. « Tout cela est donc si minable, alors ? », me suis-je demandé. Cela a été long pour que j’envisage notre société patriarcale autrement que s’exprimant à l’extérieur de moi ou du couple que je formais. Car comment vivre en sachant qu'elle est en nous, qu'elle infiltre notre manière d'être, de penser, d'agir et de ressentir ? Comment trouver la force de se regarder, de nous regarder ? J'ai commencé à accepter de voir, grâce à de grands textes féministes qui ont dessillé mes yeux. J'étais d'accord pour enfin regarder et essayer de comprendre... mais que faire ? Que faire lorsqu'on découvre que nos compagnons de lutte, ceux-là même qui se disent engagés contre toutes les formes d'oppressions, préfèrent bien souvent ne pas voir celles dont, en tant que mâles, ils tirent d'évidents bénéfices ? Que faire lorsque l'on découvre que si nos camarades veulent bien gueuler contre l'ordre des choses, ils ne veulent surtout pas remettre en cause celui qui vous écrase et leur rend, à eux, tant de services : continuer à pouvoir baiser quand ils veulent et comme ils veulent, rentrer dans un petit chez-soi où l'intendance tourne sans accrocs (et surtout sans eux), que la bouffe arrive, que le slip soit propre ; pouvoir causer tranquillement en tribune en décidant de l’ordre du jour, des combats légitimes et des luttes prioritaires...
Comment accepter qu'il soit si difficile d'être féministe au sein d'espaces où, pourtant, on devrait trouver le repos et l'énergie pour lutter ? Mauvaise foi, déni, ironie, humiliations, violences... tout est fait pour nous conduire, nous militantes, à la résignation : se contenter de, marcher sur des œufs, puis finir par se taire et tenter de digérer un vague sentiment de défaite, une déception dont on espère que l'amertume sera passagère. Bref, renoncer à se battre pour soi, à penser sa place au sein des luttes comme en cuisine... et se préparer à avaler les couleuvres qui, déjà - encore et toujours - se profilent.
Face à ces douloureux constats, beaucoup de féministes sont entées de jeter le bébé avec l'eau du bain en se disant : « puisque je n'ai pas la force de lutter partout, tout le temps, jusqu'au sein des collectifs militants où je suis engagée, jusqu'au cœur de mes amitiés et de mes amours... autant tout arrêter. » Et il faut avouer que cela peut être reposant, au début : plus d'arguties, de débats interminables ni de cruelles déceptions. Parce que c'est épuisant de ne jamais baisser les armes, de toujours être sur le qui-vive et de devoir même se défendre de ceux qu'on aime. On voudrait demander l’asile, un lieu où l'on pourrait, l'espace d'un instant, souffler un peu et se retrouver. Mais on comprend rapidement que c'est un tout autre asile que l'on promet la plupart du temps à la féministe de service : celui-ci est plutôt réservé à la folle qui jamais n'est contente, l'hystérique qui toujours dérange, empêche les réunions de se dérouler comme prévu ; celle qui fout la merde au sein du groupe, qui demande à ne pas toujours être cantonnée au ménage du local, qui ne veut pas accepter les remarques sexistes qu’on lui impose, qui parle de violences là où l'on préfère parler de « drague un peu lourde »... bref, celle qui braque la lampe sur ce que l'on voudrait tant maintenir dans l'ombre.
Si certaines jettent l'éponge, d’autres maintiennent le cap. Mais à quel prix ? Usure, solitude, découragement, stigmatisation, mise à l'écart... Pour continuer dans ces conditions, il faut une énergie sans failles, beaucoup d'humour et de sacrées armes. Les écrits de Léo Thiers-Vidal font indéniablement partie de ces armes-là. Plus encore, en le lisant, on a le sentiment d'avoir trouvé un ami, un frère et un véritable compagnon de lutte. Son humilité, son exigence, son empathie et sa colère forcent le respect. Car il faut bien admettre que ces qualités sont assez rares lorsque l'on discute avec des militants et/ou des chercheurs hommes réfléchissant aux rapports sociaux de sexe. L'humilité par exemple, fait souvent défaut. Combien ai-je rencontré ou lu d'hommes me donnant le sentiment de poser leurs idées comme ils poseraient leurs deux énormes testicules sur le papier ? Ils savent, ils ont compris et se pensent au-dessus de la mêlée. Parce qu'ils ont quelques lectures à leur actif, dont ils ne retiennent généralement que ce qui les arrange, débarrassent parfois le lave-vaisselle et savent changer la couche de leur bébé, ils se mettent à croire que leur grande tête est une ampoule géante qui éclaire le monde. Généralement, quelques mois auparavant, ils écoutaient tes propos, lisaient les livres que tu leur conseillais et essayaient de penser les concepts que tu passais des heures à leur expliquer... Mais très rapidement, ils se sont pris pour la tête pensante du mouvement féministe. Ils se disent plus féministes même que les féministes et savent généralement mieux que toi ce que c'est d'être une femme, ce qu'est le féminisme, quelles sont ses « priorités » et « comment l'articuler aux autres luttes ». Ils reprennent alors leur place sur le devant de la scène et retournent le féminisme comme un gant, en deux temps, trois mouvements. Ils deviennent Le Sauveur que tu attendais, selon eux. Et tu as intérêt à leur en être redevable. On dit merci au Monsieur. Il faut avouer que, la première fois, on trouve le tour de passe-passe assez bluffant.
Renforcer le système patriarcal en ayant Pair, de prime abord, faussement subversif est donc très aisé. Mais le renforcer en croyant, de bonne foi, qu'on tente de le subvertir, est hélas tout aussi facile. Or, l'exigence de Léo Thiers-Vidal lui a permis de dépasser cet écueil. Cette exigence est triple : lire réellement les travaux des chercheuses féministes, c'est-à-dire sans en évacuer ce qui pourrait être susceptible de le déranger ; ne jamais oublier qu'il pense les rapports sociaux de sexe à partir d'une position oppressive et enfin, s’engager concrètement aux côtés de militantes féministes, des femmes et plus largement, des opprimé-e-s.
Cette humilité et cette exigence ont permis aux textes de Léo Thiers-Vidal de sonner juste... et fort, grâce à la colère et l'empathie qui les animent. Ces textes sont comme autant de camarades auxquels on a envie de donner la main, avec la sensation qu'on ne nous écrabouillera pas les doigts, cette fois-ci. Il ne s'agit pas de les regarder avec les yeux mouillés de la groupie reconnaissante. Bien au contraire. Ces textes sont des scalpels pour disséquer le dominant, l'oppresseur — mon dominant, mon oppresseur — ; des scalpels taillés pour couper dans le vif, des armes qui ne s'useront que si on s'en sert.
Mademoiselle.
(Février 2012)
Une tasse de thé avec Léo
[Entretien réalisé en octobre 1996 par Mimmo Pucciarelli, animateur des Éditions Atelier de Création libertaire, dans le cadre de son étude sociologique sur « L'imaginaire des libertaires aujourd'hui » (éd. ACL, 1999).[
Il y a des personnages qu'on découvre lorsqu'on s'intéresse à un mouvement, à un groupe particulier. Parmi ceux-ci il y a Léo. Je l'avais rencontré auparavant dans des manifestations, et surtout au colloque sur la Culture libertaire de Grenoble. Depuis on a pu discuter et j'ai su qu'il était antispéciste, végétalien et qu’il venait de Belgique, d'où ce petit accent qu'on pouvait entendre.
Je me suis rendu chez lui, en fait dans cet appartement collectif sur les pentes de la Croix-Rousse où il habite avec Sébastien, membre d'Alternative libertaire et une autre personne qui a participé au Prolote et qui a vécu en Allemagne une vingtaine d'années. Il est le seul à ne pas manger de viande, donc il a un réfrigérateur pour lui et de la nourriture bio dans un placard. La cohabitation semble possible, puisqu'ils semblaient avoir des rapports détendus entre eux.
Certes Léo se fait tenter dernièrement par des croissants le matin, ce qui peut sembler normal et même agréable pour celles et ceux qui ne se sont jamais préoccupé vraiment d'où provient la nourriture que nous consommons quotidiennement. Mais pour celles et ceux qui moralement ne veulent pas tuer des animaux pour manger leur viande, ou même utiliser leurs graisses ou leur prendre encore leurs œufs, manger un croissant c'est un problème.
Toute cette histoire prêterait à sourire, ou ferait sortir de la bouche des anars mangeurs de viande, des expressions comme : « mais un bon bifteck c'est quand même très appétissant. » Il faut souligner en outre que les antispécistes n’ont pas réussi à amener les libertaires lyonnais dans leur ensemble à discuter sereinement de la « souffrance des animaux », et de la perspective de créer un Front de libération animale ainsi qu'il en existe sous diverses formes plus ou moins pacifistes dans les pays anglo-saxons. Des antispécistes sont ainsi arrivés à traiter les anarchistes mangeurs de viande de « fascistes ». Et de leur côté, les anars ont cherché à ridiculiser les antispécistes : ils leur faisaient des bras d'honneur si ces végétariens convaincus insistaient un peu trop sur cette histoire de « souffrance des animaux ».
Un bras d'honneur disais-je. Ce qui a compliqué encore davantage les « liens » entre les anarchistes mangeurs de viande et ces libertaires qui non seulement s'intéressent aux problèmes de la souffrance des animaux, mais se préoccupent aussi de vivre des rapports de non-domination entre eux, et surtout entre hommes et femmes, ce qui est une des préoccupations essentielles de Léo lui-même.
Il nous fallait bien une tasse de thé et l'émerveillement d'être en face d'une personne aussi jeune et sage comme Léo, pour régler la technique et nous laisser raconter sa vie.
Mimmo Pucciarelli
Mon père est flamand, ma mère est française. Pour les grands-parents du côté de ma mère, il faut dire que mon grand-père était préfet, pas d'une région, mais préfet honoraire, et ma grand-mère était « femme du préfet ». Donc une famille assez riche du côté de ma mère, et politiquement RPR ou UDF. Ma mère est née à Florac, mais a toujours voyagé avec mon grand-père et donc a changé souvent de région.
Le père de mon père était pharmacien, et sa femme était « femme du pharmacien » dans un village. Ça se passait en Flandre orientale, à Tielt. Mon père a repris la pharmacie et, par la suite, il a développé un laboratoire d'analyses biologiques ; donc il était pharmacien biologiste et ma mère était laborantine. Ils se sont rencontrés à Paris et se sont mariés quand ils avaient vingt-sept ou vingt-huit ans, et puis ils sont venus en Belgique, et ils ont ouvert ce laboratoire ensemble.
Moi, je suis né en 1970 en Belgique à Tielt où j'ai vécu pendant quinze ans. Après, ma mère a commencé une instance de divorce avec mon père et je suis resté en internat jusqu'à mes dix-huit ans, après quoi je suis allé à la faculté à Gand jusqu'à la fin de mes études à vingt-trois ans.
Au niveau des études, j'étais dans un lycée catholique non-mixte ce qui est traditionnel là-bas en Flandre, j'ai fait du latin et du grec, des études classiques donc. Ensuite, j'ai fait de la philosophie à Gand.
J'ai un frère et une sœur ; mon frère a deux ans de moins que moi, et ma sœur en a deux de plus. Ils ont suivi le même parcours que moi, un lycée catholique non-mixte. Mais mon frère a arrêté parce qu'il en avait marre, et maintenant il est dans le bâtiment ; ma sœur a une formation de diététicienne, mais elle a ouvert finalement une librairie.
Enfin, j'ai une maîtrise de philosophie et j'ai fait mon mémoire sur l'éthique animale. Après l’avoir terminé, je suis parti de Belgique, c’était donc en 1993. J'ai rencontré Corinne et je suis resté à Lyon parce que je voulais vivre une histoire avec elle. J'ai commencé un DEA de philosophie que j'ai abandonné au bout de six mois parce qu'à l'université de Lyon, la philosophie est trop professionnelle, elle n’éveille pas de sens critique envers la société comme c’était le cas à Gand.
Tes parents avaient quelles attitudes face à la religion et à la politique ?
La politique on n'en parlait jamais. Ils sont chrétiens mais sans être pratiquants du tout. Et je dirais que, politiquement, ils sont de droite. Mais n'ayant jamais parlé politique avec eux je ne sais pas pour qui ils votaient, c'était un secret. De la même manière je n'ai jamais su pour qui votaient mon frère et ma sœur. Personne n'en parlait, à part moi.
Ils n'ont jamais été d'extrême-droite. Peut-être ma mère est-elle aujourd’hui un peu plus proche du parti socialiste qu'avant. Après le divorce, c’était la galère économique pour elle. Je pense que ça l’a rendue un peu plus critique, elle a dû recommencer sa vie. En 1986, elle a trouvé un autre travail qui lui a permis d’être économiquement indépendante de mon père, elle est donc partie travailler en France, à Lille. Elle était aussi en permanence en procès avec mon père, à plusieurs niveaux, le climat était donc très tendu.
Vous avez été baptisé ?
Oui, baptisé et, à douze ans, la communion. J'ai été dans une école catholique jusqu'à mes dix-huit ans, et moi-même j'étais croyant jusqu'à mes quinze ans. Je ne priais jamais, je n'allais presque jamais à la messe, j'avais ça comme un bagage familial.
Ton père était croyant ?
Je ne sais pas, il n'a jamais dit s'il était croyant ou non. Il n'allait jamais à la messe, mais il y avait des crucifix partout à la maison, mais c'est la tradition flamande. Je pense qu'il est croyant, mais il n'en parlait jamais. Ma mère aussi est croyante, mais ce n'est pas important non plus.
Et pourquoi tu ne l'es pas resté ?
Parce que j'ai commencé à réfléchir.
Quand je suis parti en internat, je l'ai très mal vécu, je commençais à déprimer. En gros je me suis renfermé et je me suis mis à bouquiner, et je suis allé, je crois pour la première fois vers les dix-sept ans, à une journée anarchiste. Comme ça, je ne sais pas, mais ça m'intéressait, à Gand. C’était ma première rencontre, et puis après, dès que je suis allé à la faculté je suis rentré dans un collectif anarchiste, et là la politique a commencé.
Tu es arrivé donc un jour à une journée anarchiste à Gand, par hasard ?
J'ai vu une affiche.
Mais on ne va pas à une journée anarchiste comme ça...
Je pense que la musique a joué un rôle, c'est la musique qui m'a introduit dans le phénomène anarchiste. Avant, jusqu'à mes quinze ans, je ne me considérais pas critique, pas politique pour un sou, en contestation permanente par rapport à l'autorité, mais de façon personnelle : toujours des conflits avec mes parents, sur tout. À l'école, aussi, bien que j’étais un bon élève, j'avais beaucoup de conflits avec les professeurs. Et, du coup, ils savaient que j'étais en contestation et ils m'avaient en grippe par rapport à ça. Quand je suis arrivé en internat, j'ai commencé à connaître des gens qui écoutaient de la new wave et du punk. Donc j'ai commencé à écouter des groupes comme Dead Kennedys, et surtout CRASS. La contestation radicale était dans les Dead Kennedys, mais vraiment les idées et les mots c’était dans CRASS, et je pense que c'est ce qui m'a le plus ouvert l’esprit par rapport à l’anarchie.
Ensuite, en effet, j'ai vu cette affiche et je suis allé voir.
Donc ça t'amène à regarder cette affiche pour une journée anarchiste qui n'était donc plus une curiosité, mais plutôt une envie de voir de quoi il s’agissait...
Je peux dire aussi que j'ai commencé vraiment quand je suis devenu végétarien, vers les quinze, seize ans.
Pourquoi ?
Au début parce qu'il y a eu un prof de français qui m'avait fait lire des textes de De Castro sur la famine dans le tiers monde et qui parlait de la fameuse perte de nourriture. C'est-à-dire qu'il fallait vingt protéines végétales pour en avoir cinq animales, et qu’on gaspillait donc quinze protéines. Donc moi par solidarité... je suis devenu végétarien. Et ça représentait vraiment un saut personnel de commencer à me sentir solidaire avec ceux qui souffraient. Ensuite à la faculté, j'ai découvert la philosophie antispéciste avec des livres comme ceux de Peter Singer.
Après avoir lu ce livre je suis devenu végétarien et végétalien. Et tandis qu'au début j'étais végétarien par rapport au tiers monde, par la suite, c’est la réflexion par rapport aux animaux qui m’a conduit à avoir un engagement de plus en plus important sur cette thématique, qui s’est concrétisé dans une lutte politique antispéciste dès la faculté.
Et les liens avec l'anarchisme, alors ?
La solidarité que je ressentais avec les opprimés, avec ceux qui souffraient, a fait que je me suis spontanément tourné vers l'anarchisme - cette théorie qui traite des rapports de domination.
Revenons donc à cette journée anarchiste. Qu'est-ce que tu as trouvé là-bas ? Quelles furent tes impressions ?
J’étais très timide et je n'ai parlé avec personne. J'ai pris des livres qui m'intéressaient, des petites brochures, j'ai écouté les débats et je suis parti.
Ensuite, je n'ai pas eu de rapports directs avec les anarchistes, c'était plutôt vers mes dix-sept ans, je pense. Je me souviens que pendant mes dernières années de lycée, il y avait un collectif de gens qui était engagé par rapport au tiers monde, collectif auquel j'ai participé. On avait organisé des débats et j'avais déjà à ce moment-là un esprit qui se développait par rapport à cette question. Puis à la fac, je me suis engagé dans les activités d’une boutique qui vendait des produits du tiers monde, j’étais un bénévole, c'était un carrefour entre différentes mouvances. Il y avait des anars, des féministes, etc.
Ensuite, je suis entré dans le collectif anar à la fac. Mais je n'arrive pas à savoir l'ordre chronologique. D'abord, c'était ma vie personnelle, puis la solidarité avec le monde qui était opprimé, et après à travers la littérature je me suis intéressé à l'anarchie. Je devais donc encore être au lycée lorsque je me suis rendu à cette journée libertaire et après, à la fac, j'ai vu qu’il y avait un collectif anarchiste, et en même temps je me suis rendu à la boutique pour le tiers monde parce qu’au niveau social c’était plus chaleureux, et j'ai pu m'y engager facilement.
Pourquoi as-tu pris des contacts avec ce collectif anarchiste ? Te disais-tu déjà anarchiste ?
Je sais que je me disais déjà communiste, mais c'était par opposition. Tout le monde crachait sur l'URSS, alors je me disais communiste, sans en connaître les idées du tout. Par la suite, je me suis dit anarchiste, je savais que je sympathisais bien plus avec l'anarchisme, en dehors des idées, il y avait la musique qui allait avec, une mode vestimentaire, parce que je ne sais pas, mais je me sentais bien dedans.
À la fac, alors tu as tout de suite contacté ce collectif anarchiste ? comment ça s'est passé ?
Je savais qu'il existait et un jour j'y suis allé simplement. Il y avait une réunion, mais ce n'était ni agréable ni intéressant. C'était un groupe d'amis qui s'amusaient entre eux, ou qui se disputaient entre eux. J'ai essayé d'y aller plusieurs fois, mais j'ai décroché parce qu’ils ne faisaient rien.
Après j'ai rejoint pendant un an la Ligue anti-impérialiste qui était un groupe émanant d'une mouvance marxiste léniniste, le Parti marxiste léniniste en Belgique, le Parti du travail. Et même si je n'aimais pas l'idéologie marxiste léniniste, parce que je me sentais anarchiste, mais au moins ils faisaient quelque chose, des actes concrets solidaires avec ce qui se faisait ailleurs. Puis, je les ai quittés parce que j'ai senti qu'il n'y avait aucune liberté dans les propositions et dans les actions qu'ils développaient. Et je pense que là je suis allé de nouveau voir les anars, le même groupe à la fac. Puis ça s'est accéléré.
Je savais que ceux qui venaient en fac de philosophie avaient un esprit contestataire. Et j'ai commencé à parler beaucoup de végétarisme, des animaux, d'écologie. C'est là qu'on a développé une campagne pour le papier recyclé, on a envahi et occupé le rectorat pendant une journée par exemple afin que tout le papier acheté soit du recyclé. Ça a été une campagne très importante. On a aussi fait une action par rapport aux animaux, des poneys qui étaient utilisés sur une fête foraine, et on a fait une petite démonstration... Mais ce sont des événements un peu confus aujourd’hui...
Ces activités n'étaient pas vraiment le fait du collectif anar de la fac, mais c'était celui de tout un petit monde qui se fréquentait : des anars, des écolos, des végétariens, des boutiques du tiers monde, etc.
Puis, il y a eu toute une dynamique par rapport au vélo et aux cyclistes. Chaque fois qu'un cycliste ou un piéton mourait à cause d'une voiture, on occupait le carrefour le plus proche pendant une demi-heure. Ces manifestations ont commencé avec une quinzaine de personnes, un mélange d'écolos, d'anars et de contestataires de la fac. Là, il y a eu un brassage continu en permanence et peut-être est-ce là que j'ai vraiment rejoint les anars... C'est finalement à travers ce biais-là que je peux raconter les évènements dans un ordre chronologique.
J'ai habité un an dans une chambre, seul, après avoir contacté la première fois le collectif anarchiste de la fac, mais ça ne m'avait pas plu. La deuxième année, j'ai habité avec deux ou trois personnes dans la même maison. On faisait alors des repas collectifs chez nous et il y avait pas mal de monde qui venait. Dans ma troisième année d'études (j'en ai fait cinq au total parce que j'ai mis deux ans pour faire mon mémoire), j'ai habité dans une communauté où j'ai vraiment rencontré des gens qui étaient dans l'anarchisme et qui se réclamaient de l'anarchisme.
C'était un collectif de vie ou d'habitation ?
Il y avait trois ou quatre petites maisons dans la même ruelle. Dans une maison, il y avait la cuisine collective, dans une autre l'espace de vie collective, un atelier collectif. C'était un vrai lieu de brassage.
Le collectif anar de la fac s'est finalement élargi et ouvert, il y avait plus de monde, au bout d'un moment des écolos y sont allés aussi. En même temps, il y a eu le début des squats à Gand et je fréquentais les squatters aussi. Je n'ai jamais habité dans les squats, mais je les ai fréquentés et soutenus. S’était donc développé finalement dans ce collectif anar un intérêt par rapport à la thématique ou à une façon de lutter. C'était plus l'action directe qui intéressait les gens que la théorie qu'il y avait derrière. Ensuite, je n'ai plus arrêté...
Et puis j'ai participé à la création d'un collectif de libération animale, qui s'appelait « Tous les animaux libres ». À la fac, tu pouvais commencer un collectif et être subventionné, mais en tant que collectif politique. On avait deux mille francs par an et on bénéficiait gratuitement des structures de la faculté.
Enfin, tu as fini ton mémoire et puis tu as rencontré Corinne avant de venir à Lyon ?
Oui. J'ai connu Corinne dans une rencontre antispéciste à Vienne en 1993. On avait bien accroché et je suis resté... Je connaissais déjà Yves, Françoise et David, que j’avais rencontré-e-s sur l’antispécisme.
À Lyon donc j'ai commencé un DEA de philosophie, je me suis intéressé à ce qui existait, mais j'étais aussi antispéciste dans le collectif Boule de neige. J’étais très intéressé par la brochure « Nous ne mangeons pas de viande » qu'ils avaient publiée et j'ai participé aussi aux Cahiers antispécistes. En Belgique, je continuais de publier des trucs en néerlandais. J’ai participé aussi aux actions cyclistes.
La vraie ouverture vers le mouvement anarchiste à Lyon s’est faite avec le squat du Prolote. Ce qui est récent. Avant je connaissais un peu quelques personnes, un peu la FA, un peu les gens de La Gryffe, j'allais dans cette librairie, mais avant le Prolote, ça ne m'avait pas accroché, ça n’était pas vraiment une dynamique collective.
L’antispécisme, qui pour toi représente encore quelque chose d'important, qu'est-ce que c'est pour toi ?
Premièrement, ça représentait la solidarité avec ceux qui sont les plus faibles, et qui n'ont aucun recours. Solidarité au niveau moral et philosophique. C'est une action systématique à aider les animaux parce qu'ils sont animaux, sans considérer ce qu'ils sont autrement qu'animaux, c'est-à-dire que leur complexité intérieure, au niveau de la conscience, du sentiment, de l'ordre social ce n'est pas reconnu, et ça n'a même aucune valeur aux yeux des humains.
Existe-t-il un mouvement antispéciste ?
Oui largement, en France ce n’est pas assez développé, mais il est très présent dans le monde anglo-saxon, États-Unis et Angleterre. Dans ce dernier pays, il y a des groupes officiels de libération animale et il y a surtout le Front de Libération Animale qui mélange une rhétorique et une pratique anarchiste aux idées antispécistes. Ils sont organisés en cellules, personne ne se connaît, et ils font des actions directes et illégales, de sabotage et de destruction de boucheries, de camions et de laboratoires de vivisection, ils libèrent pas mal d'animaux aussi. Par exemple, le Front de Libération Animale aux États-Unis a comme politique de rentrer dans les laboratoires, de piquer du matériel et des animaux, et d'utiliser ce matériel pour montrer l'inutilité ou la cruauté de ce qui se passe. Eux ne sont pas trop anarchistes, tandis qu'en Angleterre c’est vraiment une stratégie de sabotage économique et de libération des animaux.
Dans les autres pays européens, ça existait aussi aux Pays-Bas, en Allemagne, dans les pays du Nord. Le Front de Libération Animale ça existe un peu partout dans les pays occidentaux. En France, il y a eu le mouvement l'Arche de Noé, qui n'était pas antispéciste, mais anti-vivisectionniste. En fait, il y a de grandes différences dans le mouvement par rapport aux animaux, comme par rapport aux humains. Tu peux avoir un rapport à la libération animale d'un point de vue de la misère, et avoir comme pour les humains toute une assistance aux pauvres sans envisager quelque chose de structurel. En fait il y a à peu près toutes les tendances, ce qui serait long à expliquer. À Lyon, il y a eu le groupe Boule de Neige et les Cahiers antispécistes. Pour ces derniers, j'ai participé à des tas
de traductions, puis après j'ai eu des conflits et me suis donc retiré. Des conflits idéologiques et personnels.
Boule de neige a bien fonctionné pendant un bout de temps avec des publications et diffusions de tracts, quelques manifestations, et pas mal de travail interne de discussion et de formation. On a fait une fête à Noël il y a deux ans, une distribution de tracts suivie d'un repas végétarien à Wolnitza. Actuellement, il n’y a presque plus rien...
Qu'est-ce que tu fais pour vivre depuis que tu es à Lyon ?
Quand j'étais étudiant, je vivais avec l’argent de ma mère, de mes parents en général. Jusqu’à mes vingt-cinq ans, mon père suite au divorce m’a versé une pension alimentaire. J'ai fait aussi un peu la plonge au restaurant végétarien de Corinne, Le Vert à Soi. Enfin, j'ai travaillé vraiment pour la première fois de ma vie quelques mois dans l'assistance hollandaise pour les touristes en France. Donc avant, je bénéficiais de la richesse de mes parents, et maintenant je suis au RMI ou travaille de temps en temps.
Et actuellement tu es impliqué dans le projet Au-delà du personnel...
Quand je suis arrivé à Lyon, l'écologie constituait un élément de rupture au niveau théorique. Auparavant, avant même de commencer mon mémoire, je voulais savoir s'il y avait une union possible entre mouvements écologistes et mouvements de libération animale. J'avais lu Bookchin qui était le plus social dans son écologie. Je vois le mouvement de libération animale comme une prolongation et une approche anti-autoritaire et sociale des rapports entre les individus. Et j'ai fait le constat que l'écologie dans sa forme actuelle ne peut pas être considérée comme vraiment sociale. Même Bookchin n'a aucune considération pour les animaux en tant qu'individus. À
ce niveau-là, il est très réformiste. Il dit non à la vivisection, à l'élevage intensif - ce qui n'est pas pour moi une approche de la justice sociale par rapport aux animaux. J'étais en rupture très nette donc avec l'écologie, je l'ai quittée en arrivant ici en fait.
Le climat à Lyon était très violent entre anars et antispécistes. Je me rappelle par exemple une discussion avec un membre de la FA, qui s’est terminée par un bras d'honneur pour me montrer qu'il était anti-antispéciste. Je me suis très vite rendu compte que par rapport au climat conflictuel à Lyon, il n'était pas possible de faire quelque chose sans payer très cher son engagement. Mais j'ai continué pendant un bout de temps. Ce qui fait qu'il y avait une marginalité. Être antispéciste était mal vu chez les squatters, à la FA, partout, et j'ai eu l'impression qu'on ne pouvait pas bouger.
Avec Corinne, on a lancé le projet de publication Au-delà du personnel depuis deux ans, qui était tout d’abord un projet de brochure. Depuis que je connais Corinne, mais déjà avant, j'avais une démarche critique par rapport aux femmes aussi.
Je connaissais des végétaliens, trois femmes et deux garçons, qui vivaient en communauté dans les Pays-Bas, qui se disaient écolo, anarchistes, féministes, végétariens et bio. Deux femmes sont aussi lesbiennes et une bisexuelle. Les trois sont passées dans le mouvement féministe...
Cette rencontre était importante pour moi parce que c'étaient les seules personnes qui combinaient un engagement anarchiste et un engagement antispéciste, ce qui était déjà rare, et qui en plus étaient très féministes dans leurs attitudes et réflexions. C'était un collectif qui était assez important, qui a publié des textes. Ça peut être de la philosophie ou des trucs très pratiques de cuisine végétalienne ou de la philosophie pour les enfants. Bref, ils ont une démarche très critique et très spéciale.
Je les ai fréquentés pendant au moins trois ans où j'allais régulièrement à des réunions qu'ils faisaient parce qu'ils avaient un projet de créer une sorte de village. Ils ont été très importants pour mon évolution.
Donc j'avais déjà un engagement par rapport aux rapports hommes-femmes où j'étais critique de la domination des hommes. Je suis allé à l'école non-mixte jusqu'à dix-huit ans. La première fois que j'ai parlé normalement avec une fille j'étais à la fac. Les premiers rapports avec des femmes que j'ai vraiment eu, j'avais dix-neuf ans et du coup j'avais déjà longuement réfléchi avant de pratiquer. Je ne sais pas si j'avais tellement lu ou si c'est venu comme ça... Mais de fait, en internat, je réfléchissais déjà par rapport aux rapports hommes-femmes et à l'oppression.
Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce projet de publication Au-delà du personnel ?
Entre Corinne et moi, il y a une dynamique au niveau personnel de remise en question des rapports hommes/femmes, sur ce que l'on vit concrètement au quotidien. Dès les débuts, nous avons choisi de ne pas fonctionner sur le mode de la fidélité mais sur celui de la liberté. Comme c'est quelque chose qui demande du travail, sur la relation, sur soi, on s'est posé beaucoup de questions sur la jalousie, la possession, qu'est-ce que ça veut dire l'amour, qu'est-ce que veut dire être amoureux, ou encore aussi par rapport à la bisexualité.
Donc on en est venu à un moment donné à se dire : pourquoi on ne ferait pas une publication sur ce thème-là, parce qu'on y met beaucoup de notre énergie et de notre temps ; en tout cas c'est très important et ça remet en cause non seulement le personnel mais aussi la notion chrétienne de nos sociétés.
Y compris chez les anarchistes...
Oui. J'avais déjà vu avec l’antispécisme que les anarchistes ça marchait quand il fallait gueuler contre l’ennemi, mais quand l'ennemi est soi-même, que le problème est intérieur, le travail est toujours repoussé ou rejeté.
Ainsi, on a fait un petit flyer, un appel à contribution qu'on a diffusé la première fois à La Gryffe puis en France, dans soixante-dix revues, féministes, homos, écolos, de gauche et anars en général, mais on a eu très, très peu de réactions. Puis, je l'ai traduit en anglais, en néerlandais, je l'ai diffusé en Flandres et aux Pays-Bas, en Angleterre et aux États-Unis. Alors, les réactions ont commencé à venir.
Nous avons organisé une conférence sur la bisexualité rue de Crimée à l'époque des repas végétariens.
On a reçu beaucoup de réactions du réseau amour libre aux États-Unis. Il y a pas mal de réflexions et de publications par rapport à l'amour libre et la mise en pratique de l'amour libre, et idem sur la bisexualité. On a eu aussi un peu le monde SM (sado masochiste) qui a réagi. Au début très peu de féministes, puis on s'est mis à chercher plus activement et donc on a eu plus de textes...
Depuis quelque temps, tu as participé aussi au Prolote. Qu’est-ce qui s'est passé dans ce local occupé ?
Ça a été la découverte de la vie politique lyonnaise. Dans le sens qu'avant je fréquentais La Gryffe, les gens de cette librairie, les antispécistes, mais je ne me sentais pas vraiment inséré dans la vie politique lyonnaise. Puis, il y a eu un projet d’ouverture d'un local lancé par des gens. J'y suis allé au départ pour savoir s'il y avait la possibilité de faire des choses antispécistes, ça a été accepté, et j'en ai suivi la dynamique. On a cherché un local à louer, mais évidemment on n'a rien trouvé. Je suis allé voir finalement les gens de Réseau Santé pour voir si on pouvait louer un de leurs locaux, ce qui a été accepté. Ainsi pendant deux ou trois mois on a commencé une activité ensemble, pour voir si ça tenait le coup, mais aussi pour savoir si par rapport à l'extérieur il y avait un intérêt pour ce qu'on pouvait faire.
Le résultat a été assez éblouissant, vingt ou trente personnes venaient manger chaque mercredi pendant trois mois environ, ce qui nous a aussi permis de ramasser de l’argent, 10 000 francs, ce qui était énorme. Puis, il y a eu la rupture de l'été, et finalement le premier novembre de l'année 1995, après avoir visité plusieurs lieux on a décidé de squatter un lieu place Chardonnet. On avait fait une affiche pour un repas de quartier, et puis on a envahi un local, on a tout nettoyé. Au début, nous étions une bonne quinzaine de personnes à vraiment s'occuper de tout ça, pendant quatre mois il y a eu une permanence sur place par crainte d'expulsion. On avait mené des discussions pour légaliser les lieux (par un paiement de loyer). Il y a eu une dynamique assez folle de repas collectifs, de discussions, d’actions. Pendant trois mois, des réunions avaient lieu presque tous les soirs dans le collectif. Mais ce n'était pas un collectif d'habitation, c'était plutôt un squat social qui a duré jusqu'à l'été 1996. Ça fonctionnait très bien pendant six mois, et après, j'ai quitté le lieu deux ou trois mois avant la fin à cause d’une série de mésententes avec le collectif, de désaccords avec la politique de gestion du lieu. Il y avait des gens de certains squats qui venaient nous faire chier. Les désaccords étaient par exemple sur l’exclusion ou non des personnes qui faisaient vraiment chier. Il y a toujours eu une attitude molle au Prolote, en disant : il faut être cool, il faut discuter... Il y a eu ce genre de débats où moi je voulais, comme d'autres, mais en minorité, développer une ligne qui n'envisageait pas seulement l'activité d'un squat social, mais aussi une activité avec une démarche vers l'extérieur. De la gratuité des repas, et tout ce qui est expérimentation et recherche demande un effort en plus par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. Surtout dans les traditions anars, si tu veux par exemple mettre en discussion le fait de fumer ou pas fumer, ou par rapport à la consommation de la bouffe, que ce soit gratuit ou à prix libre, que tout le monde donne quand même, etc. C'est un effort permanent. Et puis s'il y a des gens très chiants, il faut réagir, et ça demande des efforts. Donc je me suis retrouvé assez rapidement avec d'autres personnes à toujours essayer de faire des efforts de groupe, et le groupe en avait marre... donc je suis parti.
Le Prolote a continué encore quelque temps, puis a abandonné ce local et en a réoccupé un nouveau depuis octobre 1996 et tu n'y es pas...
Non, pas du tout. Et d’ailleurs c’est au moins la troisième déception collective, et j'en ai eu un peu marre, je ne crois plus trop dans les démarches collectives surtout parce que je prends trop à cœur ce qu'il se passe dans les projets politiques. C'est dur d'assumer après l'échec de quelque chose auquel tu crois.
Depuis que tu participes dans ce mouvement, depuis cinq ou six ans, est-ce que tu te sens intégré ou pas ?
Non. Je suis trop en rupture sur de nombreux points avec ce qui existe. Avec les autonomes qui ont un mode d'action directe que j'ai pratiqué en Belgique, je suis en désaccord sur les rapports hommes-femmes, quand je suis par exemple avec les gens de la FA, je suis complètement en rupture par rapport à l'antispécisme, quand je suis avec les antispécistes, je suis en rupture par rapport à autre chose. Le problème est de pouvoir fonctionner en collectif...
Maintenant, je me sens anarchiste, ou je me sens anarchiste libertaire... Mais bon pour moi l'anarchisme c'est une théorie ou une approche de la réalité qui totalise, qui ne se limite pas à la lutte des classes, à la lutte des femmes, à la lutte des animaux, etc.
Est-ce que pendant toutes ces années il y a eu des textes libertaires qui t'ont marqué, qui sont plus importants que d'autres...
J'ai très peu lu par rapport à l'anarchisme. C'est seulement en arrivant en France que je me suis vraiment intéressé aux théories anarchistes existantes. J'avais surtout ma propre réflexion, c'était surtout ça. Ma propre réflexion anti-autoritaire.
Est-ce que tu crois qu’il y a quand même des penseurs contemporains anarchistes ou libertaires, qui peuvent un peu représenter ce qu’est l'anarchisme aujourd'hui ?
Non, pas spécialement. Il y a des penseurs qui développent des théories par rapport à des aspects que tu peux avoir, et tu peux dire qu'ils sont libertaires... Il y a des choses que je peux lire qui m'intéressent mais je ne peux pas dire de noms, c'est une réflexion qui est développée en permanence par quiconque est anarchiste. Je lis beaucoup de revues maintenant, mais je ne me réfère pas spécialement à un nom.
Donc quels sont pour toi les principes fondamentaux de la pensée libertaire ou anarchiste ? Les principes de bases...
C'est une notion de la liberté qui n'est pas libérale. Une sorte de liberté qui ne s'arrête pas à soi-même, à sa propre liberté mais qui prend en compte aussi la liberté des autres. En gros, pour moi c'est un peu ça l'anarchisme. Le respect de sa propre liberté et de celle des autres, c’est la base de la pensée anarchiste.
Est-ce que de nouveaux concepts ont apparu dans la pensée libertaire depuis ces derniers temps, de nouvelles idées ou principes...
Ce qui est vraiment nouveau c’est l'antispécisme, le reste c'est du remâché. La non-mixité, le féminisme ce n'est pas nouveau, ce qui est écolo ça vient des années 1970, ainsi que les trucs autonomes, il n'y a rien d’autre de nouveau au niveau de la réflexion. Et puis, au niveau pratique, je n'ai pas non plus l'impression qu'il y ait du nouveau.
Non, pas du tout. Et d’ailleurs c’est au moins la troisième déception collective, et j’en ai eu un peu marre, je ne crois plus trop dans les démarches collectives surtout parce que je prends trop à cœur ce qu’il se passe dans les projets politiques. C’est dur d’assumer après l'échec de quelque chose auquel tu crois.
Depuis que tu participes dans ce mouvement, depuis cinq ou six ans, est-ce que tu te sens intégré ou pas ?
Non. Je suis trop en rupture sur de nombreux points avec ce qui existe. Avec les autonomes qui ont un mode d'action directe que j'ai pratiqué en Belgique, je suis en désaccord sur les rapports hommes-femmes, quand je suis par exemple avec les gens de la FA, je suis complètement en rupture par rapport à l'antispécisme, quand je suis avec les antispécistes, je suis en rupture par rapport à autre chose. Le problème est de pouvoir fonctionner en collectif...
Maintenant, je me sens anarchiste, ou je me sens anarchiste libertaire... Mais bon pour moi l'anarchisme c’est une théorie ou une approche de la réalité qui totalise, qui ne se limite pas à la lutte des classes, à la lutte des femmes, à la lutte des animaux, etc.
Est-ce que pendant toutes ces années il y a eu des textes libertaires qui t’ont marqué, qui sont plus importants que d'autres...
J'ai très peu lu par rapport à l'anarchisme. C'est seulement en arrivant en France que je me suis vraiment intéressé aux théories anarchistes existantes. J'avais surtout ma propre réflexion, c'était surtout ça. Ma propre réflexion anti-autoritaire.
Est-ce que tu crois qu'il y a quand même des penseurs contemporains anarchistes ou libertaires, qui peuvent un peu représenter ce qu’est l'anarchisme aujourd'hui ?
Non, pas spécialement. Il y a des penseurs qui développent des théories par rapport à des aspects que tu peux avoir, et tu peux dire qu’ils sont libertaires... Il y a des choses que je peux lire qui m'intéressent mais je ne peux pas dire de noms, c'est une réflexion qui est développée en permanence par quiconque est anarchiste. Je lis beaucoup de revues maintenant, mais je ne me réfère pas spécialement à un nom.
Donc quels sont pour toi les principes fondamentaux de la pensée libertaire ou anarchiste ? Les principes de bases...
C'est une notion de la liberté qui n'est pas libérale. Une sorte de liberté qui ne s'arrête pas à soi-même, à sa propre liberté mais qui prend en compte aussi la liberté des autres. En gros, pour moi c'est un peu ça l'anarchisme. Le respect de sa propre liberté et de celle des autres, c’est la base de la pensée anarchiste.
Est-ce que de nouveaux concepts ont apparu dans la pensée libertaire depuis ces derniers temps, de nouvelles idées ou principes...
Ce qui est vraiment nouveau c’est l'antispécisme, le reste c'est du remâché. La non-mixité, le féminisme ce n'est pas nouveau, ce qui est écolo ça vient des années 1970, ainsi que les trucs autonomes, il n'y a rien d’autre de nouveau au niveau de la réflexion. Et puis, au niveau pratique, je n'ai pas non plus l'impression qu'il y ait du nouveau.
Donc, il n'y a peut-être même pas une réelle implication sociale et politique des anarchistes ou des libertaires ?
Mon impression est qu’il y a des groupuscules un peu partout, des petites gouttes d'eau un peu partout, il y a des réseaux qui fonctionnent, des gens qui se connaissent. Beaucoup de choses sont temporaires. Quand je vais en Belgique ou aux Pays-Bas il y a aussi des gens qui publient, qui font des actions, qui réfléchissent...
On peut dire enfin que le fait d'être libertaire ça a eu une implication très forte dans ta vie quotidienne ?
Oui, dans le sens... Mais ce n'est pas le fait d'être libertaire, c'est le fait d'être en rupture... Pour moi le fait d'être libertaire c'est l'étiquette que tu peux mettre après l'engagement que j'ai fait. J’ai commencé à être en rupture par rapport au végétarisme, après ça a été par rapport au squat, par exemple, et quand tu prends la totale de tout ça, tu te sens le plus proche des anars, mais ce n’est pas spécialement les anars qui représentent ça.
Est-ce qu’on peut remarquer cet engagement dans des pratiques concrètes et pas seulement dans son aspect philosophique ?
Une séparation entre le politique et le personnel. Et pour moi avec le végétarisme il y a un changement de politique, on doit travailler sur soi. C'est pour ça que j'ai bien aimé aussi ce qu’a dit Dadoun au colloque sur la Culture libertaire [qui s'est tenu en mars 1996 à Grenoble et dont l'ACL a publié les actes], que pour lui la culture libertaire c'est la culture de soi-même. C'est ce que je ressens bien, la théorie m'intéresse, mais c'est essentiellement la culture de soi, la remise en question de soi et des gens autour de soi.
Bon, au début j'étais peut-être un peu autoritaire par rapport à ça, maintenant je suis plus en respect par rapport aux autres...
Est-ce que tu te sens révolutionnaire aujourd'hui ou pas ?
Au niveau théorique je pense que je suis un révolutionnaire, mais c'est un terme qui est assez vide pour moi parce que je ne crois pas à une révolution. Ça ne veut pas dire que je ne sois pas révolutionnaire, je ne suis pas réformiste, mais je suis révolutionnaire dans le sens que je suis pour une rupture totale avec ce qui se passe, mais je ne crois pas dans une révolution du tout...
Tu ne rêves pas à une révolution, alors ?
Oui, j'y rêve, mais dès qu'on réfléchit on voit que ce n'est pas possible... Quand on voit les difficultés pour changer nos relations pour l'amour libre par exemple, c'est quelque chose qui prend toute une vie et ce n'est pas un moment de rupture qui change ça. C'est en permanence. Peut-être qu’au niveau économique ça s'applique, mais même pas, je ne sais pas.
Mais j'ai fait la révolution par rapport aux animaux en tout cas, et veux faire la révolution dans le rapport hommes-femmes, mais ça prendra toute ma vie, et par rapport à tout c'est comme ça. En fait pour moi, au départ l’anarchisme c'est très ressenti, à la base c'est très ressenti et personnel.
Quelle sera la place des libertaires pour les années à venir ?
J'aimerais la révolution demain (rires), mais au fond je suis très pessimiste, je ne crois pas du tout dans la possibilité réelle de changer ce qui se passe. Je me suis toujours identifié au mythe de Sysiphe, de Camus, le mec qui pousse toute sa vie la pierre qui retombe. Tu n'as pas le choix en tant qu'humain, dès que tu réfléchis, dès que tu as un peu de sentiment, tu n'as pas de choix autre que d'agir et de réagir à ce qui se passe. Donc je me sens obligé, de par mes sentiments, de par ma perception, je me sens obligé d'être politique. Rester un an sans m'engager ça ne me semble pas possible au niveau humain existentiel.
Donc je pense qu'il y aura toujours des gens qui lutteront par rapport à ça, mais je ne crois pas à un changement possible avant longtemps...
Il y aura toujours des réseaux temporaires, des réseaux de gens, des lieux, peut-être même des régions... il y aura toujours des espaces de liberté.
C'est l'approche la plus positive ?
Oui, quand je vois des scénarios de science-fiction, je pense qu'il y aura toujours des résistants quelque part, complètement déformés qui n'accepteront pas que le système soit comme ça, qui se battront toujours, qui essayeront de vivre entre eux de la meilleure façon, qui n'accepteront pas la merde, point. Mais je ne pense pas que ça puisse devenir global.
Si on fait encore de la science-fiction et on imagine que d'ici quelque temps on peut établir et vivre dans une société libertaire, est-ce que tu as pensé des fois à ce que tu voudrais faire ?
Oui. J'ai toujours voulu faire du basket, quand j'étais plus jeune j'y jouais... Mais plus sérieux, c'est vrai que si toute ma vie est maintenant en fonction du changement, qu'est-ce que je fais s'il n'y a plus de changement à faire ? Comme je ne crois ni à la révolution, ni au paradis, le travail est permanent. Donc si le travail est à faire en permanence, je pense que je suis assez polyvalent, j'aimerais faire tout ce qui est réflexion, travail, écriture, et en même temps j'aime bien tout ce qui est détente personnelle, tout ce qui est relationnel, amour, enfin je suis amoureux en permanence (rires).
Mais alors aimerais-tu avoir des amours en permanence ?
Oui ça ce n'est pas mal d'ailleurs (rires). C'est l'amour politiquement correct...
Je veux ajouter que mon anarchisme a toujours été très personnel, et très ressenti, ce qui fait que je ne suis pas un vrai militant dans un sens. On m'a un peu parlé des individualistes anarchistes français, je me sens assez proche d’eux dans le sens d’une démarche individuelle de changement et aussi de la société. Mais l'anarchisme pour moi, ça n'a jamais été des dogmes, ça a toujours été un ressenti d'injustice et un sentiment profond de solidarité avec ceux qui en prennent plein la gueule.
Léo merci
« Pour la première fois dans ma vie, je commence petit à petit à ressentir ce à quoi peut ressembler le vécu de nombreuses femmes »
[Témoignage de Léo laissé sur le Cahier des émotions du « Camping antipatriarcal » en Ariège au mois d’août 1995]
Depuis quelques heures, je tourne en rond. Entre les affiches créées par les femmes, le cahier des émotions, les hommes, le groupe mixte, les femmes que je vois et tout ce qui se passe en moi.
Je ne vois pas comment communiquer des choses valables pour vous toutes et tous.
J’ai envie de parler avec ces femmes qui m’ont fait comprendre des choses essentielles que je ne captais pas du tout il y a encore dix jours.
Il y a dix jours, j’avais pas mal d’idées, de formes dans la tête. Et ce qui s’est passé depuis quelques jours, c’est que j’ai commencé à réellement ressentir certaines choses. D’abord ressentir le sérieux et le drame de ce qui se passe ici. Pour la première fois dans ma vie, je commence petit à petit à ressentir ce à quoi peut ressembler le vécu de nombreuses femmes. Pour la première fois, j’essaye de me mettre vraiment à la place de la personne opprimée pour essayer de ressentir ce qu’on a appelé le genre social, que je ne comprenais pas mercredi. Et ce n’est pas pour rien que j’écris « essayer » tant la barrière est immense.
C’est une théorie qui s’est ici transformée en vécu. Une façon de voir est devenue une façon de ressentir. Et je trouve que ces affiches sont de vrais cadeaux pour les personnes présentes.
Et je sais que beaucoup de femmes en ont marre de faire des cadeaux, d’être des mères ou des pédagogues. Mais ces affiches sont vraiment une main tendue, je trouve. Même si elles ont la forme d’un poing.
Quand j’entends qu’un copain est rentré chez lui en pleurant ce soir, j’ose un peu croire à quelque chose de mieux pour le futur.
Avant ce camping, j’avais la petite théorie dans ma tête que les ateliers non-mixtes c’était pas bien parce que tatati tatata... L’histoire habituelle. Mais je repars avec l’expérience que le groupe non-mixte hommes m’a été très très utile et j’espère aussi pour les autres garçons. Ça aussi ça me donne un peu d’espoir et d’envie d’être positif.
Jamais ce camping n’aurait dû être organisé avec la légèreté et le manque de conscience politique féministe (c’est-à-dire conscience de ce que vivent et ressentent tant de femmes dans notre société et marginalité). Je n’arrive pas à comprendre la légèreté qu’a été la nôtre, la mienne.
Mercredi soir, après mon premier atelier hommes, je suis allé vers une femme en disant pour rigoler « C’est bon, les mecs ont compris ce qui ne va pas et le problème a été résolu. » Aujourd’hui, je m’étonne qu’elle ait réagi aussi positivement à une connerie aussi grosse. Déjà ça, c’est une baffe dans la gueule des femmes, la preuve d’un manque de compréhension et la preuve du décalage existant. Non ce n’est pas un mea culpa, mais je voulais dire cela peut être pour montrer que ça bouge, et que vos rages et douleurs ne tombent pas dans un vide total sans réponse...
Je pense mieux comprendre pourquoi mercredi soir, on a tellement insisté sur les « genres sociaux ». Je pensais que vous vouliez parler de sociologie des sexes ou d’une chose dans ce style. Mais c’est vrai qu'on ne peut pas parler de tous ces grands concepts sans d’abord avoir fait une sorte de géographie, de constat de la réalité.
J’ai l’impression que j’ai déjà écrit trop de mots.
Et je ne sais comment faire, car ce n’est pas le rôle des femmes de s’occuper des mecs, mais j’ai envie de vous dire que vous m’avez énormément donné de choses ici. Et normalement on dit merci alors. Mais ce serait trop facile de dire merci, je préfère donc m’en arrêter là.
La rupture anarchiste
Anarchisme, Féminisme et la transformation du personnel
[ Article public dans l'ouvrage collectif aujourd'hui épuisé et, hélas, jamais réédité Au-delà du personnel -pour une transformation politique du personnel (éd. ACL, juin 1998). Une première version du texte avait été publiée dans la revue De Nar n°126 en mars 1998 et des extraits avaient été également publiés dans le journal belge Alternative libertaire en mars 1998 (n° 204) sous le titre « L'expérience anti-patriarcale - pas d'anarchisme sans antipatriarcalisme ! ». Il a été également traduit et publié dans la revue polonaise Mac Pariadka en 2000 (n°3).]
Texte d’une conférence donnée au Centre anarchiste de Gand (Belgique) en novembre 1996. J’ai choisi de publier ce texte après l’écho positif qu’il a reçu dans le milieu anarchiste, lors de cette conférence et sa publication en Belgique et aux Pays-Bas. Depuis, j'ai développé une plus grande conscience de genre, donnant un poids plus important à ma place de dominant dans une société patriarcale. (Note de l’auteur).
Avant de parler des thèmes concrets et des questions de cette soirée, je veux esquisser un cadre au sein duquel ces questionnements ont leur place. Il s’agit clairement d’un cadre anarchiste, anti-autoritaire. Cela veut dire qu’il s’agit en premier lieu d’une approche politique de certains problèmes personnels et sociaux. Des problèmes qui demandent une réponse politique, même s’il peut s’agir de problèmes très personnels comme la sexualité, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou la jalousie. Je veux absolument éviter que ce genre de questionnements soit traité de façon uniquement personnelle ou thérapeutique sans tenir compte des déterminants sociaux, économiques et politiques de ces façons de vivre et des fonctions sociales, économiques et politiques qu’ont ces modèles de vie.
« Les amant-e-s passionné-e-s de la culture de soi-même » Avec Roger Dadoun, un psychanalyste libertaire, j’aimerais parler de la notion de culture libertaire. Traditionnellement et même actuellement, on associe l’anarchisme à un courant politique qui traite surtout de structures ou d’entités publiques et sociales comme l’église, l’état, l’économie capitaliste, le fascisme ou plus récemment les mécanismes de destruction environnementaux. L’anarchisme est souvent une action et réaction critique anti-autoritaire contre les différents mécanismes qui forment, norment et rendent non libre la vie quotidienne. L’anarchisme est souvent une lutte et une action contre ces mécanismes externes qui nous privent de liberté — les plus concrets sont les rapports autoritaires au sein de l’enseignement et du salariat, l’état puissant et son pouvoir répressif, la dictature de l’économie en tant que dimension de la vie... Je suis d’accord avec la nécessité et la crucialité de ces formes de lutte publiques et je désire surtout les enrichir avec ma propre démarche. En effet, trop souvent, l’anarchisme (tel que j’ai appris à le connaître) s’est limité à une lutte premièrement contre des mécanismes externes, deuxièmement contre des mécanismes publics. Tout le monde peut s’imaginer le cliché du mec ( !) anarchiste qui gueule et se bat contre les flics et les capitalistes mais, une fois à la maison, prend son journal libertaire, fume un joint et attend que sa copine ait cuisiné. Et qui, ensuite, parce qu’il a quand même envie de prendre son pied, force plus ou moins subtilement sa copine à baiser ou va trouver son plaisir ailleurs (parce qu’il est pour l’amour libre...).
J’espère que j’exagère mais je n’en suis pas certain. Je veux seulement illustrer à quel point il peut exister un grand clivage entre une attitude politique vis-à-vis de mécanismes de pouvoir publics et l’absence d’une attitude anarchiste vis-à-vis de mécanismes de pouvoir personnels.
J’ai l’impression que depuis les années soixante-dix un certain nombre de choses ont changé quant au public et au privé : le mouvement écolo montre les liens entre des habitudes de consommation individuelles et leurs conséquences au niveau global ; le mouvement de libération animale dénonce les liens entre consommation individuelle et des mécanismes de pouvoir spécistes ; le mouvement gay et lesbien a problématisé l’hétérosexisme et libéralisé l’homosexualité et, surtout, le mouvement féministe a entre autres problématisé la sphère du privé comme étant patriarcale.
De cette façon, l’anarchisme en tant que lutte et courant politique peut véritablement être une lutte totale qui n’est pas qu’économique, politique (au sens traditionnel) ou publique, mais également personnelle, sexuelle et psychique. Ou pour revenir à Roger Dadoun :
* Vœu fondamental de tout libertaire : que l’être humain puisse s’épanouir à la fois en tant que sujet individuel faisant le plein de son irréductible singularité, et en tant qu’être social exerçant la plénitude de ses compétences socio-politiques. »[5]
Et une deuxième citation me rapproche du thème réel de cette soirée. Il s’agit d’une citation de Fernand Pelloutier, un anarcho-syndicaliste.
« L’anarchisme est tout simplement l’art de se cultiver et de cultiver les autres pour que les hommes [sic] puissent se gouverner et jouir eux-mêmes. [...] Nous sommes... des révoltés de toutes les heures, les hommes [sic] vraiment sans dieu, sans maître et sans patrie, les ennemis irréconciliables de tout despotisme, moral ou matériel, individuel ou collectif, c’est-à-dire des lois et des dictatures (y compris celle du prolétariat) et les amants passionnés de la culture de soi-même. »[6]
Et c’est en ça que je reconnais mon approche de l’anarchisme comme un travail permanent sur soi. Je parle de travail car je ne partage pas l’aspect joyeux de Pelloutier. Il s’agit pour moi en première instance d’une recherche pénible, permanente et persistante. Pas parce que je serais un pessimiste mais parce que nous sommes (à la base) peu de plus que le résultat, le produit, la réflexion de déterminismes biologiques, psychiques, sociaux, économiques, culturels. Et en tant que résultat ou réflexion d’un passé nous portons toujours avec nous ce passé : nos rapports souvent autoritaires avec père et mère, à l’école, avec les adultes, etc. Et non seulement portons-nous ces mécanismes mais nous les reproduisons sur le plan personnel ou public et nous les passons aux enfants d’aujourd’hui. Nous devenons ainsi un modèle de comment il ne faut pas être. Y échapper est uniquement possible à travers une relation intense à soi-même et à ses habitudes, une prise de conscience de qui tu es et qui tu veux devenir. Je suis convaincu qu’une attitude de laisser-aller ne peut mener que vers des choses conservatrices. Car si on est convaincu que pour réaliser des changements sociaux, donc publics, il faut se battre durement contre les mécanismes actuels de pouvoir... pourquoi serait-ce différent concernant le personnel, donc le privé ? La façon de vivre l’amour, la sexualité, les relations, notre propre personne est profondément conditionnée socialement, économiquement et politiquement.
Nous vivons dans un patriarcat où le groupe des hommes opprime et exploite les femmes - et nous aussi, libertaires, y participons. Un patriarcat où la norme hétéro opprime d’autres orientations sexuelles et est à la base d’une catégorisation générale. Un patriarcat où la norme monogame maintient les femmes dans un état de dépendance vis-à-vis des hommes.
Nous les libertaires, ultra-gauches, autonomes, anarchistes ne sommes pas une exception. Notre mouvement est viril, hétéro, monogame et en général peu dynamique sur le plan personnel . J’y retrouve peu de réflexions ou de pratiques qui remettent en cause et luttent contre le patriarcat — le mécanisme de pouvoir par excellence de la sphère relation-nelle/personnelle. Je ne vois pas de groupes d’hommes antipatriarcaux qui bossent sur les rapports de pouvoir, peu de dynamiques collectives de femmes afin de libérer les femmes de leur isolement et des habitudes opprimantes, peu de dynamique lesbienne ou gay, pas de groupe de soutien non monogame... En bref, beaucoup de résistance anti-autoritaire traditionnelle, peu de résistance antipatriarcale.
L’anarchisme donc comme un travail permanent sur soi-même. Comme une recherche de nouveaux modèles de vie. Et pour cette recherche je trouve plus de matériel valable dans le mouvement féministe. Ce sont en effet les différentes vagues féministes qui ont le plus remis en cause nos structures de vie personnelle. Par exemple, le conditionnement genré d’individu-e-s en genres opposés ; la suprématie des hommes sur les femmes ; le conditionnement d’individu-e-s en hétérosexuel-le-s ; le conditionnement des relations amoureuses (hétérosexuel, fidèle, inégalitaire, non libre, dépendant). En analysant le conditionnement politique de la sphère du relationnel / personnel, les féministes vont jusqu’à la racine du mécanisme de pouvoir patriarcal. Dès l’enfance les individu-e-s sont préparé-e-s à devenir des guerriers ou des nurses, à se développer psychiquement, émotionnellement, sexuellement de telle façon que le patriarcat soit ressenti comme normal voire naturel ( !), à se sentir plus ou moins bien en tant que femme, homme, hétéro, monogame.
De cette façon nous, les hommes, perpétuons l’oppression des femmes, et les structures de vie et de ressenti généraux. Et c’est aussi à travers une prise de conscience et une transformation active de la dimension politique du personnel que nous pouvons changer quelque chose à la base du mécanisme de pouvoir patriarcal.
Un anarchisme qui n’y travaille pas, qui néglige ce niveau est un anarchisme vide qui néglige d’arracher les racines des mauvaises herbes. Je voudrais donc plaider pour le développement d’un anarchaféminisme en tant que critique totale et déconstruction de notre réalité sociale. Une combinaison de la vision générale anti-autoritaire de l’anarchisme avec la critique profonde du féminisme radical. Parce qu’avec le féminisme radical nous parlons quand même de la libération de plus de la moitié de la population mondiale qui est opprimée de façon brutale et subtile depuis des siècles.
Une brève présentation d’une position féministe radicale :
« 1. Les femmes sont restées opprimées parce qu’elles sont isolées les unes des autres et parce qu’elles sont mises en couple avec des hommes dans des relations de domination et de soumission.
2. Les hommes ne libéreront pas les femmes ; les femmes doivent se libérer elles-mêmes. Cela est impossible si chaque femme tente de se libérer toute seule. Donc, les femmes doivent travailler ensemble sur un modèle d’aide mutuelle.
3. « La communauté des femmes est puissante », mais les femmes ne peuvent pas être sœurs si elles répètent les modèles masculins de domination et soumission.
4. De nouvelles formes organisationnelles doivent être développées. La forme primaire est le petit groupe sans chef ; les comportements les plus importants sont l’égalitarisme, l’entraide, et le partage des capacités et des connaissances. » (Ehrlich Carol, « Socialisme, anarchisme et féminisme » dans Quiet Rumours. An anarcha-feminist anthology. Dark Star, London)
et : « Nous voulons rien de moins que la liberté complète — la révolution sexuelle-sociale. La destruction créative de la triple domination du patriarcat, de l’État et du capital. Comme si à cet instant l’anarchisme n’a pas d’autre choix que de devenir consciemment et activement féministe - et comme l’anarcha-féminisme consiste en un féminisme consciemment anarchiste (ou de cesser d’exister ?). Ce que nous demandons n’est rien de moins qu’une révolution totale, dont les formes inventent un futur dénué d’inégalité, de domination et de manque de respect pour la variété individuelle, en bref, une révolution féministe-anarchiste. Je crois que les femmes ont toujours su comment aller dans la direction de la libération humaine ; il nous faut uniquement nous débarrasser des formes et maximes politiques mâles et nous concentrer sur notre propre analyse anarchiste de femme. » (Kornegger Peggy, * Anarchisme : la connexion féministè. Zero Collective, Anarchism / Feminism » dans Quiet Rumours, Dark Star, London)
Reste quand même le fait que je suis un homme. Que j’ai été éduqué, socialisé et fait un membre du groupe opprimant. Je reflète en tant qu’individu la domination mâle, que je le veuille ou pas. Je bénéficie de tous les avantages des hommes et de l’oppression quotidienne dans laquelle vivent les femmes. Et je participe quelquefois activement à l’oppression des femmes.
Si je veux essayer d’y changer quelque chose, je dois observer, déconstruire et reconstruire ma propre personne et les autres hommes. Évidemment, je suis un humain, un individu avec des sentiments, des pensées et des désirs mais il serait illusoire de ne pas me voir surtout en tant qu’individu masculin, c’est-à-dire quelqu’un qui a appris à être actif, à parler, à prendre des initiatives, à mener, à dominer...
Heureusement, pour une raison ou une autre je n’ai pas réussi à prendre sur moi le rôle masculin de façon générale, ni à devenir un vrai mec. Je pense que ce sont des problèmes de nature personnelle, émotionnelle qui m’ont amené à réfléchir à des choses élémentaires comme la masculinité performante, la féminité passive, l’orientation sexuelle polarisée, la sexualité pénétrante, la domination et l’oppression. En bref, j’étais complexé et coincé en tant que gamin, me sentais mal dans mon rôle de mâle et j’ai essayé de trouver une issue. Et ma réflexion m’a aidé à comprendre certains mécanismes sociaux, conditionnements, rapports de pouvoir. Et récemment s’y est rajouté un fort ressenti. Un ressenti de la violence brute et subtile à laquelle sont confrontées les femmes. Un ressenti de certains mécanismes d’oppression des femmes. C’est comme une plaie ouverte, une sensibilité et une révolte contre les mecs et leurs modèles de vie masculins. Je perçois et ressens souvent à quel
point les mecs prennent de la place, à quel point ils sont égocentriques.
Je ne crois pas être différent, ou avoir réussi à me transformer radicalement. Il s’agit d’une condition de base qui mène à la violence (psychique, émotionnelle, physique, sexuelle) et à l’infliction de souffrance (due à l’absence d’attention, de sensibilité, de soin et de générosité). Une condition de base implique qu’on ne peut pas s’en débarrasser, qu’on y est confronté de façon permanente et qu’il faut y travailler quotidiennement. Une critique de soi continuelle, donc.
Ce serait présomptueux de ma part de donner l’impression que ce chemin est le résultat de mes efforts uniquement. Je dois beaucoup aux femmes (féministes) en général et surtout à une parmi elles avec qui je vis une relation intense et enrichissante depuis trois ans. Cette relation est un laboratoire permanent de réflexions, mises en pratique, apprentissages... Merci à elle.
Afin de prendre conscience de mon oppression des femmes, et de lutter contre, j’entreprends les pas suivants que j’aimerais partager avec vous. Ce sont de possibles outils pour le changement du personnel, des mécanismes politiques contre le patriarcat, donc l’autoritaire. Ces cinq niveaux de travail vont du très personnel au public, sans exclusivité, sans priorité : la psychothérapie, l’égalité bisexuelle, les relations libres, la dynamique non-mixte hommes, les initiatives mixtes.
Psychothérapie
Cet outil est évidemment le moins politique, et en général il est même considéré comme étant dépolitisant. Tu te mets à travailler à tes problèmes individuels, tu tentes de les résoudre sur le plan individuel en laissant de côté le niveau social et politique de « tes » problèmes. Pourtant j’ai remarqué — lors de mes brèves expériences psychothérapeutiques — qu’une thérapie peut avoir un effet bienfaisant, peut te faire comprendre et ressentir comment tu as grandi et pourquoi tu fonctionnes à ta manière spécifique et comment tu peux progressivement innover tes comportements. Je dis bien « innover » car normalement on ne fait que répéter éternellement ces mêmes mécanismes structurels qu’on a développés lors de notre petite enfance mais qui sont souvent (devenus) inadaptés et limités. Je vois la psychothérapie comme une analyse et une déconstruction de tes mécanismes intérieurs afin d’apprendre de nouvelles techniques de vie qui te rendent capable de vivre de façon plus indépendante, libre, heureuse et stable.
Le problème actuel de la thérapie est néanmoins qu’il n’y a peu ou pas de thérapeutes politiques ce qui fait qu’on est confronté à :
1. des tarifs élevés qui ne sont pas adaptés à nos revenus ;
2. des différences de fond importantes concernant par exemple l’orientation sexuelle, la construction genrée ;
3. une pression conformante de la thérapie, les problèmes / choix d’ordre politique étant réduits à des problèmes / choix personnels.
Peut-être que les travaux d’analystes tels que Dadoun, Lesage de la Haye ou Garnier peuvent apporter des réponses d’ordre psychologique et politique. Il semble rester beaucoup de travail, vu le degré élevé de masculinité des théories psychologiques en vigueur.
Quant aux féministes, il y a eu un fort mouvement combinant politique féministe à travail thérapeutique individuel ou collectif. Ce travail a permis de constater que les problèmes prétendus individuels étaient avant tout des vécus de femmes et donc directement liés à l’oppression permanente que vivent les femmes.
« Le but de parler de nos vies personnelles était de mettre en commun nos expériences, de découvrir des bases communes entre nous et de nous en servir comme point de départ d’analyse et d’action politique » (Stevi Jackson et Sue Scott, « Sexual Skirmishes and Feminist Factions. Tuenty Five Years of Debate on Women and Sexuality » Dans : Feminism and sexuality. A reader. Stevi Jackson et Sue Scott [éd.], Edinburgh University Press, 1996).
La thérapie comme outil politisant, donc.
En plus il me semble que le travail thérapeutique est un pas explicite vers le soin et l’amour de soi-même, ce qui est généralement tabou pour les femmes prises dans le système du sacrifice de soi altruiste et, de façon différente, pour ces couillus d’anarchistes durs et autonomes.
L’égalité bisexuelle
Cet outil sera probablement considéré par la plupart des gens comme fou et irréalisable car l’orientation sexuelle est perçue quasi automatiquement comme étant « naturelle » et inchangeable. On est tout simplement hétéro ou homo ou bi.
Pourtant, autant au niveau psycho-social que politique, on peut contester cette perception. L’humain me semble avant tout pan-érotique, pluriforme et pas spécialement fixé de nature. La dimension sexuelle, érotique et affective est dynamique et potentielle. La meilleure preuve est pour moi le choix lesbien des féministes des années soixante-dix, quatre-vingt. Des femmes se sont mises à réfléchir sur le féminisme, ont commencé à partager de plus en plus d’aspects de vie avec d’autres femmes et, évidemment, sont tombées amoureuses de femmes tandis qu’avant elles étaient exclusivement hétérosexuelles. Des hétérosexuelles sont devenues des lesbiennes ou des bisexuelles. Cela me prouve vraiment que l’orientation sexuelle est changeable, non fixée.
Mais pourquoi ? Pourquoi devrais-je essayer de changer mon orientation sexuelle ? Qu’y a-t-il de problématique ?
Ma critique la plus claire envers le phénomène d’orientation sexuelle hétérosexiste est que :
1. il est limitant car il emprisonne les sentiments. En cela il me semble peu anarchiste ; 2. il renforce le conditionnement genré.
L’existence des hétéros, des homos et même des bi-e-s dépend de l’existence des genres masculin et féminin. Une société libertaire est constituée idéalement d’individu-e-s qui se développent librement et qui « choisissent » librement dans une palette d’attitudes, de comportements, de sentiments, de pensées. Maintenant, une personne est faite homme ou femme selon certaines caractéristiques biologiques. Dans une société idéale, ce qui est perçu comme le sexe biologique aura aussi peu d’importance ou de pertinence que la couleur de peau, l’âge, la taille, le poids ;
3. il est une défense efficace du patriarcat.
De l’expérience de certaines femmes bisexuelles, il ressort que leurs rapports avec des femmes les rendent plus puissantes dans les relations hétérosexuelles. Elles apprennent à percevoir leurs propres conditionnements et à y travailler (par exemple en prenant plus de place, en arrêtant de se sacrifier, en étant assertives au niveau de la communication...). Ce n’est pas pour rien que le féminisme a mené beaucoup de femmes vers une pratique lesbienne, le patriarcat implique qu’en tant que femme individuelle dans une relation avec un homme individuel on se trouve dans une structure de pouvoir inégalitaire.
Quant aux hommes, le chemin est évidemment autre. Développer des rapports tendres, amoureux, sexuels avec d’autres hommes peut faire comprendre à quel point leurs relations hétérosexuelles sont dominantes et inégales. L’égalité bisexuelle peut faire prendre conscience aux hommes que le sexisme est bien là et que les rapports entre hommes sont froids, superficiels et durs.
Mon plaidoyer pour une bisexualité recherchée va plus loin que le fait de baiser avec des femmes et des hommes. C’est une tentative de rendre les rapports avec femmes et hommes plus complets, variés et riches. Afin d’apprendre à détruire les rôles genrés. Afin de reconnaître, de déconstruire et de transformer les structures de pouvoir entre hommes et femmes. Vers la réelle liberté pour tout-e-s.
Relations libres
Je suppose que cette idée est connue. Il s’agit de gérer de façon non possessive, non exclusive l’amour, le sentiment amoureux, la tendresse, l’intimité et la sexualité. Déjà au début du XIXe siècle des anarchistes promouvaient l’amour libre et après les années soixante-dix le thème est devenu populaire. Malheureusement l’amour libre était synonyme de baise phallocrate et d’accès libre aux femmes. Les hommes se donnaient la liberté de développer des relations avec d’autres femmes, mais reconnaissaient rarement ce même droit pour « leurs » copines. C’est pourquoi il est important que la recherche de relations libres se fasse avec soin et sensibilité. Peu d’hommes sont capables spontanément de gérer cette liberté de façon positive, autant en ce qui concerne sa propre liberté que celle de sa partenaire. Car les relations libres impliquent qu’on apprenne :
1. à gérer sa propre jalousie, possessivité, incertitude, peur d’abandon et à réellement désirer de façon authentique et totale le bonheur, la liberté, le plaisir de sa partenaire ;
2. à traiter de façon responsable les différentes personnes avec lesquelles on vit une histoire. Et ceci est beaucoup plus difficile qu’on peut penser. Cela implique qu’on prenne en considération les différents désirs et intérêts des autres et qu’on les traite avec soin et précaution.
Le lien entre relations libres et anarchisme est clair : il s’agit de renforcer et d’agrandir la liberté et l’indépendance mutuelle. Par contre le lien avec la lutte antipatriarcale l’est moins et je ne pense pas que les féministes en aient fait un point crucial.
Les relations libres brisent le mythe qu’on peut être et qu’on sera tout pour un-e partenaire et vice-versa. Elles impliquent une certaine humilité et un certain réalisme. En tant qu’individu-e on peut signifier et offrir beaucoup mais d’autres le peuvent également. Les relations libres impliquent qu’on soit honnête et ouvert. Qu’on respecte la liberté de l’autre. Qu’on apprenne à gérer des conflits intérieurs et extérieurs. Il s’agit donc de développer une non-monogamie responsable.
Les groupes hommes
Cet outil se situe beaucoup plus au niveau social ou collectif que les trois outils précédents. Un groupe d’hommes peut être un lieu où les hommes travaillent ensemble à leur conditionnement genré et à leur domination sur les femmes.
La première chose implique de prendre conscience à quel point on est masculin au lieu d’être individu. On apprend à partager des émotions, la tendresse, la tristesse, la douleur avec d’autres hommes. Ceci est rare car notre éducation nous apprend à être froid, distant et fort. Ce travail mène vers un enrichissement, un élargissement de la palette de comportements et d’attitudes. Il s’agit de se libérer de notre masculinité en tant que prison afin de devenir pleinement individu et d’apprendre de ce que les femmes sont traditionnellement : silencieuses, chaleureuses, affectueuses et précautionneuses. Apprendre à fermer sa gueule, à douter ouvertement, à écouter les autres, à déconstruire son égocentrisme, à être fragile.
Ceci doit mener à une deuxième phase, le travail anti-patriarcal. Il ne s’agit alors plus de libération du rôle genré mais de lutte des femmes versus sa position de mâle dominant. Apprendre à changer son égocentrisme et son insensibilité face aux autres. Prendre conscience des mécanismes patriarcaux à différents niveaux. Se familiariser avec la réflexion féministe. Abandonner son anti-féminisme primaire. Assumer la responsabilité de ses actes dominants afin de les changer radicalement.
Tout cela revient à rechercher d’autres pratiques d’hommes, c’est-à-dire des pratiques critiques et égalitaires. Vu mon expérience, il me semble de plus en plus nécessaire que les groupes hommes agissent sous tutelle de (groupes) féministes et qu’ils adoptent une politique de reddition de compte vis-à-vis de celles-ci.
Quant aux groupes femmes, une des meilleures preuves de leur utilité politique est la virulence des réactions des hommes. Dès que des femmes veulent s’organiser de façon indépendante, solidaire, autogérée et revendiquée, elles sont attaquées et accusées de mille « horreurs » (sexisme inversé, séparatisme, drague lesbienne...). Au fond, les hommes ne supportent pas que les femmes puissent s’organiser, travailler, s’amuser, baiser... sans eux. Les espaces femmes sont les centres autonomes et les squats autogérés du mouvement féministe. Et une des premières tâches des hommes qui veulent lutter contre le patriarcat est d’être publiquement solidaires de ces initiatives non-mixtes féministes et des féministes en général.
Un groupe opprimant fera tout afin de diviser et régner. Tout mouvement de libération tente de rapprocher les opprimé-e-s afin de construire plus de puissance individuelle et collective. Ceci tient également pour les femmes.
Initiatives mixtes
En général ça revient à être alerte et conscient que le patriarcat se joue partout et quotidiennement. Les espaces politiques sont des espaces masculins autant au niveau du nombre que de la forme ou du contenu.
Un thème important est celui de la parole. Les femmes se font interrompre, leurs paroles ne sont pas respectées par les hommes lors de rencontres politiques. Souvent certains hommes sont considérés comme des autorités, ce sont rarement des femmes. La place des hommes est dans la solidarité, le silence, l’espace laissé. En négatif, quoi. Sinon on tombe rapidement dans des cercles vicieux où de nouveau les hommes vont poser leur marque sur ce qui se passe.
Des exemples d’outils de transformation politique pour des lieux alternatifs sont : créer un salon de thé au lieu d’un café ; proposer des groupes et musiques de femmes au lieu de hardcore superviril ; l’organisation de débats, soirées, fêtes antisexistes ; la publication de brochures et d’affiches critiques ; mettre à disposition des serviettes hygiéniques et pas seulement des préservatifs ; proposer des logements sur place pour celles qui ne veulent pas rentrer seules ; briser la gestion genrée des tâches...
Il me semble qu’en mixité, une des principales tâches en tant qu’homme est de briser la solidarité masculine, institution essentielle pour le maintien de la domination des hommes sur les femmes. Croire que tout est possible ensemble, en mixité, de façon égalitaire est illusoire et fait preuve de manque de conscience de la profonde emprise du patriarcat sur nos vies entières.
Anarchie ou patriarchie
Collectif des femmes, des féministes et des lesbiennes de Faction féministe lors des journées libertaires du 8, 9 et 10 mai 1998 à Lyon
Du 8 au 10 mai 1998 ont eu lieu des journées libertaires organisées par la librairie La Gryffe à Lyon. Ces journées se voulaient une occasion de « faire le point sur le mouvement social, les formes de lutte, le mouvement libertaire depuis mai 68 et de réfléchir aux moyens futurs pour agir sur le monde ». Ces « jours » ont en fait mis en lumière un paradoxe du mouvement libertaire.
La remise en question de la société dans son ensemble est limitée en réalité à la remise en question dans la sphère « publique », seule considérée comme étant politique, et ne passe pas forcément, hélas, par une remise en question de ce qui se passe dans la sphère « privée », « personnelle » (autant à l’intérieur des groupes militants qu’à la maison), pensée elle comme non politique, et même non sociale. Comme si d’un côté il y avait les individu-e-s, dont la psychologie, les comportements et les relations étaient déterminés en dehors de la société, des rapports sociaux, par leur « libre volonté », et de l’autre côté les rapports sociaux, espèces d’abstractions vides de tout sens puisque vides d’individu-e-s. Malgré une volonté d’ouverture dans l’organisation des « jours » à la lutte anti-patriarcale, nous avons pourtant vécu un déni de l’oppression des femmes et une stigmatisation du mouvement féministe non-mixte qui la dénonce. C’est ce qui a motivé la contestation féministe qui s’est exprimée lors de l’assemblée plénière, le dimanche après-midi.
Que s’est-il donc passé ? Vous avez dit violence institutionnelle ? !
Lors du débat sur « la violence institutionnelle en milieu militant », le vendredi, la question du pouvoir masculin est très vite abordée et nombre d’interventions de femmes tendent à démontrer que la « chefferie militante » est exercée quasi systématiquement par des hommes. Ce problème du pouvoir masculin, quand il n’est pas nié (certain-e-s ont considéré que ces femmes détournaient le sujet) est justifié par quelques arguments récurrents :
- La nécessité de la transmission et/ou du partage du savoir militant et politique, qui, implicitement, est forcément détenu par les « militants formés », les « vieux militants », bref les leaders. Comme ces leaders sont à 99,9 % des hommes, ceci implique que ce serait des hommes exclusivement qui détiendraient le savoir, alors que les femmes seraient « plus pratiques » [sic]. Mais pourquoi n’y a-t-il donc jamais de « vieilles militantes », de « militantes formées » ?
- Le concept de servitude volontaire, qui dédouane les dominants (hommes, blancs, hétéros) de leur responsabilité pour la reporter sur les dominé-e-s. L’oppression devient ainsi un problème personnel, psychologique et donc non social.
On voit ici comment, sur le sujet de l’oppression des femmes, nombre de libertaires prétendent que chaque individu-e peut se constituer en dehors des rapports sociaux de sexe. Pourtant, ils ne nient pas que d’autres rapports sociaux positionnent les individu-e-s les un-e-s par rapport aux autres.
- « Je suis libertaire, donc je suis antisexiste. » Mais quelle forme prend cette lutte antisexiste ? Sur l’extérieur, quelles revendications ? À l’intérieur des groupes, quelle vigilance ? Et quelle remise en question personnelle ? Les quelques actions qui peuvent être menées témoignent surtout de la sphère publique et ne sont jamais mises en relation, n’intègrent pas les formes d’oppression de la sphère privée, dont les hommes libertaires bénéficient aussi. Le concept féministe « le privé est politique » passe donc à la trappe.
La notion de sexisme et la lutte antisexiste telles qu’elles sont utilisées dans le mouvement libertaire, ne rendent aucunement compte de l’existence du patriarcat, c’est-à-dire du rapport social de domination (et donc d’oppression) du genre masculin sur le genre féminin. Ce sexisme, c’est la discrimination selon le sexe, rien de plus : dans la société, il n’y a pas seulement discrimination selon le sexe, mais aussi asymétrie de position sociale selon le sexe. Nous ne sommes pas assigné-e-s à la même place hiérarchique dans la société. Cet antisexisme n’est pas suffisant, car il ne prend en compte qu’une partie du problème, et sert souvent à en masquer le fondement même. De fait cette lutte antisexiste n’admet pas - contrairement au féminisme - une oppression spécifique des femmes par les hommes, oppression différente selon que les femmes soient lesbiennes, bi ou hétérosexuelles, mais pense l’oppression seulement en terme d’aliénation, subie « également » par les hommes et les femmes !
La non-mixité femmes en accusation !
Vendredi soir, nous nous sommes heurtées à des réactions contre la non-mixité lors de la projection en non-mixité de la vidéo < Chroniques féministes ». Ces discussions se sont poursuivies le lendemain lors du débat en non-mixité sur l’anarchaféminisme.
Pendant ce débat, QUI ÉCRIVAIT L’HISTOIRE ?
« 1968 et après, trente ans de mouvements sociaux », ou quatre « chefs historiques », aucune personne pour exprimer l’expérience d’un des mouvements sociaux les plus importants de cette période : le mouvement de libération des femmes. Nous pouvons penser que, même si ce n’était pas intentionnel, il y avait dans cette programmation une reproduction de la mise en marge des luttes des femmes.
Mais, c’est au cours du débat sur l’ordre patriarcal, samedi après-midi, que les réactions anti-féministes ont été les plus violentes, et nous ont donc amenées à réagir : de notre point de vue féministe, il était impossible de laisser passer un tel retour de bâton. En effet, c’est à un PROCÈS et non à un débat auquel nous avons assisté. Par sa forme même, le débat est agressif, il s’agit d’une CONDAMNATION de nos pratiques de lutte :
- Utilisation d’exemples anecdotiques pour remettre en cause de façon générale les luttes féministes et lesbiennes féministes.
- Des hommes utilisent la parole de femmes opposées à la non-mixité pour une fois de plus nous diviser, pour cautionner leur anti-féminisme tout en se mettant- dans une position d’arbitre.
Ce débat a eu pour effet de nier notre engagement, la légitimité de notre réflexion et s’est clairement exprimée la volonté de nous museler. Dénoncer et attaquer comme il a été fait la non-mixité femmes est aussi une façon de supposer qu’une réelle mixité existe, or la mixité est un leurre : soit elle est quasi inexistante (monde du travail, école dès les premières orientations, organisations politiques, syndicales...), soit, les rares fois où elle existe, elle est inégalitaire, c’est-à-dire qu’une minorité d’hommes en est le centre, et que les femmes sont à la périphérie, réduites à un rôle de spectatrices, un rôle de second ordre, soumises aux normes définies par ces hommes et au pouvoir masculin dont ils sont les dépositaires. Ce primat acritique accordé à la mixité nie également la nécessité pour les opprimées de s’auto-organi-ser contre leur oppression et leurs oppresseurs... Que les opprimées deviennent sujets de leurs luttes est pourtant un principe libertaire ; il paraît alors impossible et inutile pour beaucoup d’entre nous de prendre la parole pour une justification qui n’a pas lieu d’être : la manière dont s’est déroulé le débat illustre les rapports de pouvoir qui se créent dans un cadre mixte, bien mieux que n’importe quel argumentaire. Alors que les hommes se plaignent d’être exclus par la non-mixité femmes, lorsqu’ils ont l’occasion de travailler en mixité sur le thème « l’ordre patriarcal », ils détournent le débat en l’orientant et en le limitant à une accusation de la non-mixité... Cela démontre bien la nécessité de réunion non-mixte femmes pour VRAIMENT travailler CONTRE l’ordre patriarcal !
Nous décidons en conséquence d’agir collectivement pour préparer une action lors du dernier débat du dimanche concernant « le futur du mouvement libertaire ». C’était pour nous l’occasion de contester les pouvoirs en place : celui des hommes, celui des chefs.
Quel futur libertaire pour le mouvement libertaire ?
Des intervenants hommes se succèdent pour énoncer les versions officielles de l’histoire, la politique et la stratégie de leurs organisations.
Aucune femme, aucune lesbienne à l’horizon de l’histoire. Notre première action : pancartes « VIOLENCE SEXISTE » et une banderole interrogeant « EST-CE UNE RÉUNION NON-MIXTE ? » ainsi que des panneaux à l’humour grinçant mais néanmoins réaliste. Il s’agissait de présenter, de façon simplifiée pour des raisons matérielles, un décodage en simultané des discours dominants et de leurs fonctionnements. Une autre pancarte « AVEC TOI, AVEC NOUS » s’adressait aux femmes critiquant la non-mixité. Malgré quelques remarques provoquées par notre présence (qui bien que silencieuse est éloquente), le débat continue comme si nous n’existions pas. Nous sommes rendues invisibles comme la situation des femmes, des lesbiennes et de leurs luttes l’est aussi.
Notre deuxième action : notre déplacement de la périphérie au centre de la salle. Il s’agissait pour nous de prendre place au sein de l’espace publique de manière offensive et choisie. Nous sommes rejointes dans notre initiative par d’autres femmes présentes dans la salle. Si nous parlions entre nous, c’était pour rendre visible le fait que dans le « général » les hommes parlent entre eux. La tension monte et on nous crie : « sectaires », « fascistes », « pauv’connes », « lesbiennes ». En outre, on nous accuse de manipulation à l’intérieur de notre groupe, de soi-disant refus de communication et de sectarisme. Il s’agit là de mécanismes classiques du pouvoir, utilisés par les dominants pour maintenir et réaffirmer leur domination : nous retourner tout simplement les critiques que nous leur avons adressées. La plupart des hommes libertaires refusent de s’inclure dans le groupe des oppresseurs alors qu’admettre cette réalité est pourtant le seul point de départ qui pourrait leur permettre une remise en cause de ce rôle et de leur participation à la reconduction du patriarcat. Enfin, certain-e-s stigmatisent notre soi-disante « volonté de saboter le débat » et regrettent donc que le débat sur l’avenir du mouvement libertaire n’ait pu se dérouler « normalement ». Il va de soi que nous regrettons, quant à nous, que certains autres débats (notamment celui sur le patriarcat) n’aient pu se dérouler non plus « normalement ». D’autre part, notre intention était, notamment, de faire prendre en compte, dans le débat, la question de la place des luttes féministes dans l’avenir du mouvement libertaire. Notre intervention était donc en plein dans le vif du sujet.
Une action profondément libertaire.
Cette action avait à la base une motivation commune, mais son déroulement était complètement spontané, ainsi que la démarche des femmes qui nous ont rejointes et était entièrement dépendante des réactions du public. Elle aurait pu tourner tout à fait autrement. Notre action féministe permet de soulever de nombreux débats sur les engagements et les pratiques libertaires :
- La réflexion sur la domination masculine, sur l’oppression des femmes et sur la lesbophobie n’est-elle pas un travail individuel et collectif de toutes et tous ? En fait, que signifie la demande d’explications ou de justifications adressée systématiquement aux féministes ?
- Comment penser l’articulation des diverses luttes dont aucune n’est une question « spécifique » ? Nous ne refusons pas seulement toute hiérarchisation des luttes mais nous considérons qu’une vision transversale de la réalité sociale et politique est nécessaire.
- Comment penser le rapport individu-e / rapports sociaux ? Quels liens entre personnel et politique ? Comment sont produites / reproduites dans l’espace privé ou personnel les relations collectives ? Comment l’individu-e, le sujet individuel s’implique-t-il dans une société construite en catégories et classes inégales ?
Et toujours, Féministes tant qu’il le faudra !
Collectif des femmes, des féministes et des lesbiennes de l’action féministe lors des journées libertaires du 8,9 et 10 mai 1998 à Lyon
[Ce texte a été écrit par le collectif féministe qui s’est constitué pour intervenir lors des journées anniversaires de la librairie libertaire La Gryffe (8, 9 et 10 mai 1998). Il fait suite à la réaction antiféministe exprimée pendant ces journées et les mois qui suivront. Il a été publié une première fois en octobre 1998 dans le n° 11 de la revue de la librairie (La Griffe), mais suivi d'un texte-réponse dans le même numéro par « les chefs » ; ceux-là mêmes que dénoncera plus tard Léo dans « De la mâlerie... » (cf. plus loin dans l'ouvrage).
Une seconde impression d'Anarchie ou... aura lieu fin 1999 à l'occasion de la publication de la brochure Le Grief - du rififi à la librairie libertaire La Gryffe. Cette brochure, auto-éditée en photocopiage, est une réponse aux décisions de la librairie concernant : la « non-intégration » de Corinne, « l'auto-exclusion » de Léo et l'injonction à choisir son camp faite à Fabienne, Céline et Sam.
Bien que n'étant pas un texte de Léo, nous avons souhaité le reproduire pour deux raisons majeures : son contenu radical et critique toujours très actuel et l'introduction qu'il permet quant aux textes de Léo qui suivront dans cet ouvrage.
Les « journées La Gryffe » auront cristallisé les positions réactionnaires des anarchistes vis-à-vis des féministes et leurs contradictions, tant théoriques que pratiques. Elles restent encore aujourd'hui une illustration de l'antiféminisme des anarchistes ; voir à ce sujet l'analyse faite récemment par Francis Dupuis-Deri (« L'anarchisme face au féminisme - comparaison France-Québec ») dans Le sexe du militantisme, sous la direction d'Olivier Fillieule et Patricia Roux (éd. Sciences po. Les presses, 2009).]
De l’indignation des mecs anars... en général
[Deux textes auto-diffusés suite aux journées libertaires organisées par la librairie lyonnaise La Gryffe]
Les journées libertaires de La Gryffe ont permis d'assister à un énième remake de Anti-sexisme « bonne conscience » - le retour (de bâton). Non seulement les débats sur les rapports femmes-hommes ont été marqués par un refus systématique de la part des mecs d’entendre les critiques féministes libertaires dans toute leur ampleur mais en plus les critiques réactionnaires ont vite fait surface, distinguant les « bonnes » féministes libertaires des « mauvaises » - divisons pour mieux régner. Résultat : les mecs se sont évités toute remise en cause, bénéficient encore une fois de leur place de dominants et font payer les féministes qui se sont opposées à leur pouvoir.
Quelques faits qui ont à mon avis mené à l'action symbolique et libertaire des féministes :
- Lors du débat sur le pouvoir en milieu militant (animé par Philippe Coutant) une première discussion a eu lieu sur le machisme et la domination masculine. Si ce débat avait débuté par une remise en cause des hommes, il a rapidement glissé vers une critique du féminisme et des féministes. En effet, plusieurs hommes ont affirmé qu'il ne fallait pas se limiter au patriarcat (comme si ceci était le propos des anarcha-féministes) car il y avait également d'autres oppressions et que de toute façon le pouvoir était une chose diffuse donc on ne pouvait cibler ses critiques sur les hommes concrets, et finalement que les féministes agissaient quelques fois de façon terroriste et culpabilisante vis-à-vis des mecs. Malgré un début intéressant, une remise en cause du pouvoir mâle en milieu militant n’a pas eu lieu.
- Le débat sur l’ordre patriarcal n’a lui non plus pas abordé le pouvoir mâle en général et en milieu libertaire, car plusieurs hommes et femmes ont demandé aux féministes luttant en non-mixité d’expliquer, de réexpliquer et de justifier leur mode d’action. Plusieurs personnes ont pendant une heure et demie accepté d’expliquer pourquoi la non-mixité femmes leur semblait indispensable à la lutte féministe. Le climat général était, à mes yeux, à la critique de la non-mixité et non des hommes et de la domination masculine - ce qui est effarant pour un débat sur l’ordre patriarcal.
- Lors de ce débat un homme a violemment interrompu une femme voulant intervenir sur la non-mixité sans que celui-ci ait été collectivement remis à sa place voire viré.
- Vers la fin du débat, une féministe libertaire a plusieurs fois posé qu’elle voulait enfin aborder le thème de l’ordre patriarcal mais cette demande a reçu une fin de non-recevoir majoritaire, ce qui revenait de fait à un refus d’aborder l’ordre patriarcal.
Tandis que plusieurs débats auraient pu aborder le patriarcat, force est de constater que les libertaires n’ont pas voulu remettre en cause la domination masculine. Il me semble donc logique et réjouissant qu’une vingtaine de féministes ont décidé lors du débat final sur le mouvement libertaire d'intervenir non-verbalement pour dénoncer le silence complaisant des anars concernant l'oppression que subissent les femmes.
De nouveau, les libertaires n’ont pas voulu entendre les critiques anarcha-féministes, ont refusé de s'interroger sur leur propre participation active à l'oppression des femmes et ont préféré s'indigner comme des bons cathos dérangés en pleine messe : « Ces féministes sont des lesbiennes ( !), des séparatistes, des manipulées, des maoïstes voire des fascistes. » Un mec m'a même sorti que si cela se passait dans un événement qu'il avait co-organisé, il aurait fait intervenir le service d'ordre pour virer ces saboteuses à coup de batte de base-ball si nécessaire. En gros, il a été considéré intolérable que des anarcha-féministes dénoncent l'oppression des femmes, et surtout de cette façon-là. « Car si on peut comprendre les motifs (et encore, il y a mieux à faire ailleurs, là-bas, plus loin !), on ne peut tolérer ces méthodes. » Ah, pauvres féministes, vous avez beaucoup à apprendre ! Heureusement que les vrais anars sont là pour vous guider !
Quel pathos ! Quelle pathétique indignation ! On aurait presque pensé être au PS pendant une action libertaire contre le racisme étatique et l’expulsion des sans-papiers. Les mêmes gestes, la même autosuffisance, le même refus d’ouvrir les yeux, le même renfermement sur soi, la même absence totale de recul autocritique. Mais ce qui m’a le plus dégoûté ce sont les rationalisations complaisantes qui ont suivi. Très vite les libertaires se sont découverts libéraux en prônant la diversité et la tolérance au lieu de la lutte contre toutes formes de domination. Les mecs ont oublié toute conscience de genre, de leur position de dominant et se sont permis de critiquer de façon paternaliste et méprisante la lutte des féministes libertaires. Certains ont affirmé que cette intervention n’était pas à l’intention des mecs mais dirigée contre les femmes - quel détournement majestueux ! D’autres l’ont qualifiée de primitive, d’agression violente, d’acte de guerre, de logique de secte et, horreur, de com-mu-nau-ta-risme ! Mais ne soyons pas trop négatifs, aucun anar ne semble avoir traité ces féministes libertaires de malbaisées. La lutte anti-patriarcale avance à petits pas...
Cette intervention collective aura, entre autres, fait passer le message qu’il y a des problèmes très importants au sein du mouvement libertaire sur le plan des rapports femmes-hommes et aura permis de voir où en était la majorité des libertaires. Cela m’a réjoui de voir que quelques hommes ont soutenu (et soutiennent toujours) publiquement cette intervention et ont ainsi brisé à un instant important la solidarité masculine. Ce soutien sans « oui, mais » ou « il aurait fallu » me fait espérer que des hommes peuvent à certains moments capter les rapports de pouvoir entre femmes et hommes, et prendre position contre la domination omniprésente sans se cacher sous des nuances, rationalisations ou excuses. Mais ces quelques points positifs ne changent rien au fait que les hommes libertaires sont largement réactionnaires quand il s’agit de remettre en cause (leur participation à) la domination et l’oppression des femmes, et cela confirme malheureusement ce que chante Brigitte Fontaine : « Quand il s’agit des femmes, il n’y a pas d’hommes de gauche. ».
Dans son commentaire sur les journées libertaires, Gile (Paris) réagit à certains propos auxquels je désire répondre.
« Dans les débats mixtes, une nouvelle donne (ou presque) pour les garçons serait de se taire ou éventuellement de ne faire que répéter des arguments féministes. [...] Il est important que les hommes développent leur propre réflexion et luttent comme l’ont fait et le font les féministes. »
Il me semble que les hommes sont (plus que) libres de leurs actes et paroles, mais qu’en tant que libertaires ils s’engagent contre toute forme de domination, donc la domination masculine contre les femmes. Si dans un débat ces mêmes libertaires tiennent des propos sexistes ou ne reconnaissent pas dans toute son ampleur la domination patriarcale, il est normal que des féministes ou d’autres font remarquer leur incohérence et dénoncent leur complaisance envers leur position de pouvoir. Et pourquoi un homme ne ferait-il que « répéter » les arguments féministes ? Un homme serait-il incapable de reconnaître la pertinence et la justesse des arguments féministes et de les faire siens - de sa place ? Et quelle pertinence peut avoir la propre réflexion des dominants - comparée à la pertinence de la parole et réflexion des dominées elles-mêmes ?
Quand j’ai dit que le fait d’évoquer d’autres formes d’oppression lors d’une discussion sur le pouvoir des hommes, participe à la minimalisation et invisibilisation du patriarcat, je ne nie pas l’existence d’autres axes de domination. De fait, et cela a été confirmé dans le débat sur le pouvoir en milieu militant, évoquer d’autres formes d’oppression sert majoritairement à ne pas se concentrer sur une forme d’oppression rarement adressée de façon ouverte et intègre.
De même, lorsque j’ai critiqué la notion d’aliénation (appliquée aux hommes) et le fonctionnement des groupes hommes, je ne l’ai pas fait comme le présente Gile, c’est-à-dire d’une façon bien réductrice. Ce que j’affirme c’est que les deux éléments me semblent participer actuellement à :
1 une analyse symétrique des rapports sociaux de sexe qui, en effet, nie l’oppression que subissent les femmes (cf. la critique des féministes des journées libertaires dans leur tract).
2 une motivation égocentrique pour combattre le patriarcat basée sur le bien-être des dominants, au détriment d’une motivation altruiste politique basée sur la liberté des dominées.
Actuellement, la majorité des hommes luttant contre le patriarcat me semble en effet avoir besoin d’une motivation égocentrique (épanouissement de soi, meilleurs rapports entre hommes) afin de s’engager. Il leur semble souvent impossible de lutter prioritairement en fonction de la liberté des femmes : pourtant il me semble que cela est bien possible et que notre solidarité avec les féministes peut s’exprimer dans le soutien actif de leurs initiatives et dans une lutte directe contre la domination des hommes (dont la nôtre). Je ne nie pas l’utilité de ce travail général sur soi mais, pour l’instant, les hommes semblent rester coincés là-dedans - au détriment d’un travail directement utile aux féministes et femmes en général.
C’est dans ce constat de blocage égocentrique sur soi et les autres hommes qu’il me semble en effet de plus en plus nécessaire que les groupes hommes anti-patriarcaux établissent des liens de reddition de compte avec des groupes féministes existants. Ce droit de regard des féministes libertaires sur les activités de ces hommes me semble un élément utile afin de réaliser un travail anti-patriarcal digne de ce nom. Contrairement à ce qu’affirme Gile, cela n’implique aucunement que les hommes parlent au nom des femmes. Les groupes hommes peuvent choisir ces groupes en fonction d’affinités politiques communes. Cela n’équivaut pas à une subordination mais à une prise de conscience de la place structurelle opposée et asymétrique des hommes et des femmes et la nécessité d’agir en fonction des intérêts et buts définis par les sujets de la lutte anti-patriarcale, les femmes féministes. Que dirais-tu, Gile, si des féministes libertaires affirmaient que la reddition de compte est nécessaire pour éviter la dérive des groupes hommes ? Les traiter d’autoritaires, de fausses libertaires, de trotskistes anglaises ?
Malgré son soutien affirmé au féminisme, Gile ne s’empêche pas de pointer du doigt les différences entre féministes, et de faire sous-entendre que les féministes de l’action des journées libertaires développeraient des stratégies de rupture et seraient des inconditionnelles de la non-mixité. Et d’affirmer l’extrême nouveauté qu’il faudrait débattre ensemble en mixité - sans réaffirmer par contre l’extrême inégalité de la mixité actuelle. Comme si les féministes libertaires de l’action ne désiraient pas discuter et agir en mixité égalitaire. Lui aussi lance finalement le pavé (bien emballé) contre des féministes et non contre ces hommes qui, réunion après réunion, débat après débat, attaquent les féministes et refusent de se remettre en cause. Quelles que soient ses bonnes intentions, fait est de constater qu’il donne des conseils à des féministes et épargne les hommes libertaires - premiers responsables de l’oppression des femmes dans le milieu libertaire.
Libéralisme libertaire et anarchaféminisme : quelques éléments de réflexion
| Article refusé à la publication en décembre 1998 lors de la préparation du n°12 de La Griffe et également refusé à la diffusion au sein de la librairie. Il a été diffusé via internet par Léo. Il a ensuite été repris dans la revue suisse Flagrant délit n° 9, puis, la revue néerlandaise De Moker en mars 1999. Il servira de prétexte à l’exclusion de Léo du collectif de la librairie. Il sera à nouveau publié dans la brochure Le Grief - du riff à la librairie libertaire La Gryffe en septembre 1999.] |
Cet article a été écrit dans un contexte précis. En tant que membre de la librairie libertaire lyonnaise La Gryffe, j’ai coorganisé trois jours de discussion en mai 1998 « Trois jours pour le grand soir ». Durant ces journées de nombreux débats ont eu lieu dont quelques-uns sur la question des rapports sociaux de sexe. Lors du débat de clôture une trentaine de féministes ont protesté contre le déroulement de ces journées dénonçant le sexisme du mouvement libertaire et l’impossibilité de discuter réellement de la domination masculine - en général et dans le milieu libertaire. Suite à la publication par ces féministes d’un texte exposant les motivations de cette action anarcha-féministe[7], quatre hommes de La Gryffe ont écrit un texte-réponse « Anarchie et mouvement des femmes[8] ». L’article ci-dessous s’appuie sur cet article pour analyser un phénomène d’ordre général : les hommes, se croyant le centre du monde, agissent, pensent et écrivent sans tenir compte de leur statut de dominant, donc sans tenir compte du fait qu’ils font partie d’un groupe social construit qu’est la classe sexuelle des hommes. Ainsi, ils se croient universels tandis qu’ils sont dominants et ils nient de fait la critique féministe des rapports sociaux de sexe. Ceci me semble incompatible avec toute revendication d’ordre égalitaire et libertaire c’est-à-dire opposée à toute forme de domination et d’exploitation, qu’il s’agisse de racisme, de lesbophobie et homophobie, de sexisme, de capitalisme...
Face aux revendications féministes le mouvement libertaire met en œuvre différentes stratégies de défense du statu quo mâle. Si la réaction prédominante envers les féministes est de l’ordre du déni, de la ridiculisation et de la violence, une autre stratégie passe par un discours libéral[9]célébrant la diversité des points de vue. La reconnaissance du bien fondé du féminisme se limite alors à un droit d’existence bien spécifique. Il me semble important d’analyser quelle place les hommes libertaires laissent, octroient, donnent au féminisme et de démontrer les fonctions réactionnaires du discours libéral -discours qui ne se limite pas au mouvement libertaire, mai qui y est encore plus insupportable vu la volonté anarchiste de lutter contre toute forme de domination.
Un premier élément formel exprime très bien la négation de la position masculine de dominant. En effet, les quatre hommes signataires développent tout au long du texte une position de neutralité, d’extériorité voire d’objectivité via des « on », « C’était à nous », « la difficulté de nous réunir », « il ne nous ». Le texte n’exprime quasi nulle part la position située des auteurs : aucune référence n’est faite à leur statut dominant d’hommes. Cette position bien particulière de dominants est donc invisibilisée tandis qu’elle est la condition préalable pour que des hommes puissent développer un discours célébrant la diversité. En effet, ce que des dominants peuvent percevoir comme diversité de perspectives est vécue par des dominées comme absence de liberté et de réelle diversité. Ce n’est donc pas pour rien que le « on » neutre, ou le « nous » pluriel, traversent ce texte : ils expriment l’aveuglement de ces hommes face à leur particularité, spécificité de dominants et, du coup, face aux dominations que subissent les femmes.
Si ces hommes ne se posent pas comme dominants, ils le sont pourtant bien - de la même façon que moi-même. Nous bénéficions de la domination masculine qui structure toute notre société et la perpétuons souvent activement à travers nos prises de parole, regards, comportements... Notre vie est plus agréable grâce à l’exploitation des femmes (par exemples leurs services domestiques, relationnels, communicatifs) et nos choix sont plus grands grâce à la restriction des choix des femmes (par exemple la prise en charge par les femmes du travail domestique et d’élevage des enfants étant la condition de notre épanouissement scolaire, professionnel et militant).
Pourtant ces hommes empruntent un chemin différent des proféministes[10] en choisissant d’invisibiliser leur statut de dominants et de nier la nature profondément sociopolitique de la domination masculine en développant ce discours :
« Les journées libertaires étaient ouvertes, sans exclusive (comme le veut le projet de la Gryffe), à toutes les composantes et points de vue du mouvement libertaire. Or certains d’entre eux considèrent les luttes des femmes comme secondaires ou ne perçoivent pas l’importance de leurs enjeux. D’autres, plus affirmés encore, dénoncent le féminisme, considèrent, de leur point de vue, que le féminisme s’enferme dans une impasse sectaire et particulariste qui s’oppose à une remise en cause de l’ordre social et, finalement, à la libération des femmes. C’est comme ça. Tous ces points de vue contribuent également à composer le mouvement libertaire. [...] »[11]
Ce discours est un discours libéral et non libertaire à mes yeux car il reconnaît une même valeur à des pensées qui s’opposent à la domination et l’exploitation des femmes qu’à des pensées qui nient ou invisibilisent cette domination. Il ne me semble pas nécessaire de démontrer que le mouvement libertaire a connu et connaît des tendances antisémites, misogynes, révisionnistes et qu’il est nécessaire de lutter contre ces tendances[12] de la même façon qu’il faut lutter contre l’antisémitisme, la misogynie ou le révisionnisme de notre société occidentale. Pourtant c’est bien l’opposé que défendent ces hommes en ce qui concerne le féminisme. Le féminisme est selon eux l’expression d’un point de vue, d’un courant de pensée comme le sont par exemple l’anarchisme anti-organisationnel, l’individualisme libertaire, l’anarcho-syndicalisme et il mériterait la même considération que l’anti-féminisme de certains anarchistes.
J’ai quelques difficultés à comprendre ce qui fonde cette catégorisation : qu’est-ce qui permet de ranger le féminisme parmi les différentes tendances libertaires et non parmi ces exigences minimales politiques que sont l’antiracisme, la lutte contre l’antisémitisme ou la lutte contre le capitalisme ? A mon avis aucun raisonnement ne peut justifier ceci et seule la non-reconnaissance de sa position de dominant permet de dépolitiser à ce point les analyses féministes libertaires, de délégitimer les actions féministes libertaires et de rationaliser ainsi la défense de ses intérêts de mâle. Car c’est bien de cela qu’il s’agit selon moi. Célébrer une certaine diversité tant qu’elle ne remet pas en cause les auteurs en tant qu’hommes bénéficiaires d’un système d’exploitation.
De plus cette célébration de la diversité est toute relative car elle se limite aux discours et ne concerne aucunement la mise en œuvre de ces discours. Car l’application concrète toucherait aux intérêts concrets des dominants - comme en témoigne l’intervention féministe lors des journées libertaires. De la même façon, les pouvoirs en place dans notre société occidentale permettent une relative diversité des discours - voire l’expression de critiques profondes de ce système - tant que ces discours restent des discours et ne sont pas appliqués afin de transformer l’organisation concrète de la société, tant que les règles du jeu ne sont pas changées. « Pensez ce que vous voulez, ex-primez-le, respectez les règles que nous fixons et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. » Comment doit-on articuler d’une part l’élaboration par les dominants d’une réglementation précise et stricte des fonctionnements sociaux[13] et d’autre part le fait qu’ils développent un discours libéral célébrant la diversité ? Ce discours serait-il un décor derrière lequel une machinerie précise fonctionne broyant les unes au bénéfice des autres ?
Il me semble donc que l’enjeu fondamental derrière tous ces mots c’est la défense d’un statu quo mâle. Le refus d’une remise en cause personnelle et collective. Le refus d’une critique de soi en tant que dominant. Le refus d’un changement concret des fonctionnements au sein du milieu libertaire - au bénéfice des femmes et non des hommes. C’est bien pour cela que les auteurs écrivent :
« Parce qu’ils tiennent à la totalité des rapports sociaux, à la totalité de l’ordre social où nous vivons et aux racines mêmes de cet ordre, les rapports de domination inclus dans les rapports hommes / femmes, comme tous les autres rapports de domination, ne peuvent pas être résolus localement, à l’intérieur d’un collectif quel qu’il soit (même non-mixte paradoxalement). Se fixer pour objectif prioritaire de les résoudre à l’intérieur de ce collectif est une tâche absurde et impossible qui, au lieu de libérer, et en raison même de son impossibilité, multiplie au contraire, à la façon des groupements religieux, les instruments et les rapports d’oppression. »
Cela me rappelle le discours libéral face aux critiques de l’hétérosexisme[14] et de la lesbo/homophobie : « Moi, je ne suis pas homophobe. Les homos ont le droit de vivre leur vie... mais ils n’ont pas intérêt à me toucher moi ou mes enfants ! Parce que moi, je ne suis pas un pédé ! » On reconnaît une domination sociale et en même temps on ne veut pas se savoir impliqué, touché, directement concerné voire co-responsable. Une réponse plus libertaire - à mon avis - serait de se reconnaître sexiste, hétérosexiste et de tenter de comprendre en quoi nous le sommes et comment nous pouvons agir dessus - en écoutant les principales concernées, les féministes, les lesbiennes. Comme l’écrit Fabienne dans son texte dans le numéro 12 de La Griffe, il y a un travail à faire, et cela commence par la reconnaissance publique du problème. Il nous faut travailler à une zone temporaire autonome de moindre domination, au lieu de défendre de façon égoïste une zone permanente de non-lutte contre la domination.
N’est-ce pas paradoxal pour des anarchistes de nier à ce point toute possibilité d’expérience libératrice au sein d’un collectif ou mouvement ? Ces expériences ont bien lieu concernant le pouvoir informel via la rotation des tâches, les tours de parole, le refus de mandats permanents. Pourquoi ne pourrait-on pas tenter dès aujourd'hui de transformer les rapports sociaux de sexe au sein de notre mouvement ? Il ne s’agit pas, comme l’affirment de façon bien réductrice les auteurs, d’en faire « l’objectif prioritaire » mais d’en faire un objectif important parmi d’autres. Et c’est bien cela que craignent ces hommes à mon avis : de devoir se poser des questions concrètes sur leur comportement et attitude pour les changer en fonction de la liberté des autres ; de devoir dépasser un égoïsme masculin pour aller vers les femmes et leurs revendications multiples de justice.
Plutôt que de dénoncer avec arrogance les soi-disant « fétichisme, communautarisme, séparatisme » des anarcha-féministes, il s’agirait de percevoir le fétichisme masculin axé autour du pénis et des couilles - fétichisme qui ressort par exemple à travers les multiples fantasmes de castration qui ne tardent pas à être exprimés lorsqu’on aborde les rapports femmes-hommes. De déconstruire le communautarisme masculin et sa solidarité mâle au-delà des différences idéologiques. Cette solidarité mâle qui fait que les hommes font quasi toujours front face aux femmes et au féminisme. Et un exemple concret confirme à mon avis que cette solidarité est un enjeu important. J’ai souvent entendu des hommes libertaires exprimer leur rejet du « politiquement correct[15] » et revendiquer le droit à la blague sexiste, à l’insulte misogyne ou lesbophobe - au nom de la liberté d’expression. Pourtant, l’enjeu n’est pas tant la liberté d’expression que la solidarité masculine : « L’humour (sexiste, raciste, homo-lesbo-phobe...), dans l’adhésion qu’il sollicite, traduit les rapports de pouvoir entre groupes sociaux, et par là-même entre individu-e-s. »[16]
La réponse libérale au féminisme réussit cet inversement qui consiste à particulariser une revendication de justice et à invisibiliser un rapport de domination en posant comme neutre un état de fait injuste. Le but de cet article est donc double. D’une part, démontrer à quel point le discours libéral sert les hommes libertaires dans leur refus du féminisme dans sa globalité et transversalité. Il sert à enfermer l’analyse féministe dans le champ des goûts et des couleurs. Il revient, concrètement, à mettre sur un pied d’égalité d’une part des analyses qui attribuent la responsabilité des violences masculines conjugales contre les femmes à ces mêmes femmes (provocation, masochisme...) et d’autre part des analyses qui perçoivent ces violences comme un élément de répression politique contre les femmes de la part de la classe des hommes. De façon ultime, il est une apologie de la loi du plus fort[17] pour laquelle la raison n’a pas lieu d’être. D’autre part, il s’agit pour moi de participer activement à ce que le féminisme ne soit plus considéré comme une perspective mais comme une exigence minimale politique. Notre éducation de dominant est omniprésente et nous structure mais elle n’oblige aucunement les hommes à perpétuer notre dominance individuelle au niveau relationnel ou collectif. Nous avons la possibilité d’agir autrement, de s’ouvrir aux analyses et ressentis des féministes et de participer à leur lutte contre le sexisme - lorsqu’elles le désirent. Nous pouvons lutter en mixité - voire en non-mixité[18] - contre le sexisme intériorisé ou institutionnel. Il suffit d’être prêt à rompre avec la défense égoïste de nos intérêts de dominants et à rompre avec ces hommes autour de nous qui refusent de se remettre en cause.
De la mâlerie à la Gryffe
[Cet article a été publié dans la brochure Le Grief en septembre 1998]
La librairie libertaire La Gryffe semble bénéficier d’une solide renommée dans le milieu libertaire, voire au-delà dit-on. Depuis vingt et un ans elle survit. Mais comment ? Que s’y passe-t-il derrière la façade ? Rien de particulier. Un peu la même chose qu'ailleurs dans la société française. Malgré son étiquette libertaire, elle ne me semble plus très différente ou en rupture avec le monde environnant comme j’ai pu le croire auparavant. Naïvement. Il y a avant tout, surtout et toujours les chefs. Pas des chefs avec des étiquettes de chefs bien sûr puisque la librairie se veut libertaire, mais quand même des chefs. Ils sont là depuis le début et ont réussi à y rester d’une façon plutôt que d’une autre. C’est leur passe-temps favori, un hobby comme il y en a tant d’autres. Il y cultivent plusieurs fois par semaine leurs légumes libertaires. Et ils ont leurs petites habitudes. Un bon saucisson et du pinard à midi et le pastis à l’heure de l’apéro. Ils sont satisfaits de leur jardin. Tout y est comme il leur plaît et ça tourne comme ça leur plaît. Alors pas question que des petits jeunes et surtout des petites jeunes y changent quelque chose. Pas question de se remettre en cause plus que pour la forme libertaire. C’est leur jardin et si ça ne nous plaît pas, on n’a qu’à aller voir ailleurs. C’est comme ça. Malheureusement tout ceci n’est pas affiché à l’intérieur ou noté dans le cahier commun. Ça se devine, ça se pressent ou ça s’apprend à la dure. La parole des uns compte plus que celle des autres surtout quand les autres ne sont pas masculins et hétérosexuels et profs et âgés. Les engagements ne comptent pas de la même façon pour toutes et tous. Les décisions ne se prennent pas quand les chefs ne sont pas là. Les règles inexistantes existent de temps en temps quand ça leur sert. Mais pas question de tomber dans le légalisme, il faut pouvoir être flexible selon le moment, selon l’intérêt en jeu. C’est ainsi que j’ai appris qu’il est interdit à La Gryffe d’exprimer sa solidarité et son soutien à une action féministe libertaire critiquant la domination masculine lors des journées libertaires. Ça s’appelle du « sabotage », de la « rupture du contrat moral » même si on était un des rares à avoir préparé ces fameuses journées. Par contre, il est conseillé pour être bien vu par les chefs de condamner publiquement en tant que membre de La Gryffe cette même intervention. De même il est extrêmement mal vu de critiquer ouvertement en réunion la chefferie et les rapports de domination au sein du collectif. Car nous sommes tous égaux (ça concerne aussi les femmes bien sûr, hein !). Ça ne se fait pas d’analyser et de critiquer k rapports de domination et d’exploitation au sein du collectif Voyons. Ou comme l’exprimait si bien un des sous-chefs serviables « Il ne faut pas voir le pouvoir partout ! ». Ça lui a valu beaucoup de reconnaissance de la part des chefs... il est bien aimé lui. Il en a de la chance... Il est encore plus mal vu d’exprimer ses critiques par écrit et de les diffuser. Malgré l’accord explicite de toutes les personnes présentes durant la réunion et l’annonce dans la revue La Griffe de la disponibilité du texte « Anarcha-féminisme et libéralisme libertaire » refusé de publication car il heurtait la sensibilité d’un chef, mais publié sans aucun problème dans des revues suisses ou néerlandaises, j’ai progressivement été prié d’aller voir ailleurs. Dans une première étape un chef et un sous-chef ont commencé à diffuser publiquement une lettre personnelle d’une membre féministe du collectif. Cette lettre m’avait été envoyée bien auparavant, un échange avait eu lieu entre elle et moi et l’histoire était close. Mais dans l’intérêt supérieur de la boutique, cette lettre a été photocopiée à des dizaines d’exemplaires et distribuée publiquement. Sans autorisation de celle qui l’avait écrite. Et à des buts totalement autres que ceux pour lesquels la lettre avait été écrite. Mais sans scrupules, chef et sous-chef ont continué à diffuser cette lettre tandis que son auteure était en vacances... Courageux, non ? A son retour, cette membre a de suite retiré cette lettre de la table de diffusion et protesté contre cette utilisation abusive. Mais no problem, pas d’auto-exclusion, pas de mise en retrait, pas de discussion, pas d’excuses. Ce que fait un chef est par définition au dessus de tout soupçon. Mais je ne suis pas chef ou sous-chef, du coup la diffusion de mon texte a mené à ce qu’ils appellent l’auto-exclusion. Ça non plus je ne connaissais pas. L’auto-exclusion. C’est probablement l’autogestion appliquée au licenciement arbitraire. Ça plairait énormément aux PDG : « Madame vous vous êtes auto-licenciée pour refus de soumission servile ! » Une lettre m’a donc été envoyée par le collectif mentionnant « Sans que personne ne se soit opposé à cette décision, la majorité des présent-e-s a estimé que tu ne faisais plus partie du collectif », suivi d’un PS : « peux-tu nous faire passer rapidement ton trousseau de clés ? » Voilà, c’est simple. Je me suis viré. Je suis le seul et unique responsable de mon exclusion. Eux, les chefs et sous-chefs serviables n’y sont pour rien. Ils sont bien, vraiment bien. Des anarchistes (donc pas possible qu’ils fassent quelques fois partie du problème). Le problème ?
Ils se servent des gens comme de la main d’œuvre jetable. Ainsi a-t-on pu entendre lors d’une réunion un des chefs dire « S., tu pourrais faire ça demain, de toute façon tu n’as rien de mieux à faire... » Et ça n’a choqué personne, c’est passé inaperçu. On se sert du vide existentiel des gens dans l’intérêt supérieur de la boutique. C’est cool. Et après on s’étonne qu’il y ait des libertaires qui ont envie de se foutre en l’air...
Ils aiment beaucoup que les femmes participent à leur boutique : ça fait bien. Par exemple, à la comptabilité. Mais pas question qu’elles l’ouvrent trop ou qu’elles espèrent être écoutées et respectées. Surtout lorsqu’elles parlent de ce qui les touche directement : le mépris et la violence de la part des hommes libertaires, en particulier des chefs et sous-chefs du collectif. Ça ne se discute pas car comme l’écrivent ces joyeux lascars « les rapports de domination inclus dans les rapports homme / femme comme tous les autres rapports de domination ne peuvent pas être résolus localement à l’intérieur d’un collectif quel qu’il soit. » Alors pourquoi en parler ? « Fermez vos gueules et continuez à nous écouter. Non mais faut quand même pas exagérer ! Tu te rends compte elles veulent qu’on se remette en cause. Nous, des anars expérimentés et tout. Pff... »
Alors on vire tout ce qui gêne. Celui-ci on l’auto-exclue, celle-là on refuse de l’intégrer en inventant des nouvelles règles d’intégration, les deux autres on leur demande de se désolidariser des autres et de nous lécher les pieds plein de gratitude et celle-là, on s’en fout. Elle vaut même pas le temps d’en parler.
Et je ne parle même pas de tout-e-s celles et ceux qui sont parti-e-s dégoûté-e-s après les journées libertaires - dans le désintérêt général...
Voilà une brève impression toute subjective de cette librairie « libertaire ». Je vous ai épargné le pire. Le lynchage collectif, les insultes gratuites, le mépris et l’opportunisme, l’art de se taire, les coups par derrière et bien d’autres techniques de fonctionnement nanars. Et ça revendique l’anarchisme, le refus de l’autorité et de la domination. Ils me dégoûtent profondément avec leurs airs satisfaits et indignés. Ces anars qui refusent de prendre en compte leur classe sociale, blancheur, masculinité, hétérosexualité, âge et surtout leur égoïsme mais qui savent par contre très bien ce qu’est l’Anarchisme Pluriel et Diversifié où tout-e-s ont le droit de s’exprimer, de respirer et de participer également à un mouvement libertaire. Et après il y en a (les mêmes) qui vont se plaindre que les Noire-s, les Femmes, les Homos, les personnes issues de la classe ouvrière ne participent pas à leurs jeujeux...
Pour finir en beauté, voici ce qu’un des sous-chefs voire futur chef affirme. Il lutte pour les sans-papiers. Mais pas avec les sans-papiers, car « si tu bosses avec des sans-papiers, tu n’arrives à rien. Ça ne fait que foutre la merde. » Ça promet pour la révolution.
Elle se fera sans moi cette révolution libertaire.
Je vous emmerde, chefs et sous-chefs « libertaires » enivrés par vos privilèges.
La trahison proféministe
De la masculinité à l’anti-masculisme : penser les rapports sociaux de sexe à partir d’une position sociale oppressive
[Cet article a été publié dans Nouvelles Questions Féministes, Vol. 21, n° 3, pp. 71-83, décembre 2002]
Dans cet article, je propose une réflexion sur la manière dont les chercheurs-hommes engagés dans la lutte contre l’oppression des femmes par les hommes peuvent optimiser leur efficacité politique et scientifique dans l’analyse des rapports sociaux de sexe[19].
En effet, lorsqu’ils prétendent produire des analyses non-biaisées et pertinentes, ils sont confrontés à une double difficulté : d’une part comprendre pleinement des analyses féministes qui désignent leur existence comme source permanente d’oppression des femmes ; d’autre part apprendre à gérer les conflits intérieurs qui en découlent de façon à leur permettre un regard productif, impliqué autant que distancié, sur leur construction et leur action oppressives. L’étude des rapports sociaux de sexe pose avec insistance la question du lien entre sujet connaissant et objet de recherche : en raison de l'ancrage identitaire, affectif, sexuel et corporel qu’engendre l’organisation spécifique des rapports sociaux de sexe, tout questionnement politique et théorique implique que les chercheurs-hommes engagés réévaluent leur construction et leur vécu personnels. En tant que membres du groupe oppresseur, ils doivent apprendre que leur subjectivité est structurée par la position masculine, c’est-à-dire par le fait qu’ils bénéficient de richesses matérielles, de libertés sociales, de qualités de vie et de représentations androcentriques dans la mesure même où ils oppriment les femmes. Les chercheurs-hommes engagés doivent alors, pour produire des analyses non-biaisées et pertinentes, élaborer une conscience anti-masculiniste[20] : une conscience de leur structuration subjective particulière en tant qu’oppresseur, ainsi que la conscience qu’il leur faut développer des façons de saisir pleinement les conséquences de cette structuration pour ne pas reproduire des biais masculinistes. La question centrale émergeant d’une telle conscience est la suivante : de quelle façon la position dominante produite par l’action oppressive structure-t-elle le rapport épistémologique au sujet même des rapports sociaux de sexe ? Autrement dit, de quelle façon les analyses sur les rapports sociaux de sexe sont-elles influencées, voire limitées, par l’appartenance des chercheurs-hommes engagés au groupe social des hommes ?
Analyse des rapports sociaux de sexe : le décalage genré
Plusieurs chercheures féministes ont pensé le lien entre la position sociale des femmes et l’analyse féministe des rapports sociaux de sexe. Christine Delphy écrit ainsi dès 1975 : « L’oppression est une conceptualisation possible d’une situation donnée ; et cette conceptualisation ne peut provenir que d’un point de vue, c’est-à-dire d’une place précise dans cette condition : celle d’opprimé » (1998 : 281). Pourtant, peu de chercheurs-hommes engagés ont tenu compte de cet aspect. Au mieux le prennent-ils en compte de façon sélective, rappelant une certaine idée différentialiste de la complémentarité : les hommes seraient moins bien placés pour penser le vécu opprimé, mais ils seraient autant voire davantage capables de penser le vécu oppresseur, d’où la nécessité d’impliquer plus d'hommes dans les recherches féministes (Welzer-Lang, 1999). Il me semble crucial d’approfondir cette question épistémologique car elle conditionne le rapport des chercheurs-hommes engagés au sujet des rapports sociaux de sexe. Analyser les effets de la position sociale sur la production de savoir peut avoir des répercussions importantes sur l’imaginaire masculiniste du « sujet connaissant neutre, autonome et rationnel » qui nie toute particularité liée au vécu masculin. Cette analyse peut également transformer la façon de s’inscrire dans la recherche masculine engagée : face aux analyses féministes, les chercheurs-hommes engagés ont souvent l’impression qu’ils doivent choisir entre reprendre de façon mimétique et culpabilisée ces analyses, ou développer un propre ordre du jour indépendant et libératoire (Welzer-Lang, 1996). Poser la question épistémologique du lien entre position sociale masculine et analyse des rapports sociaux de sexe permet, au contraire, de sortir de ce faux choix pour envisager de façon innovante l’inscription dans la recherche masculine engagée.
Si les analyses féministes sont une source de réflexion cruciale sur le poids épistémologique du vécu, la participation au militantisme féministe permet d’enrichir cette réflexion. Il suffit en effet de participer à quelques dynamiques militantes non contrôlées par les hommes pour que le slogan « le privé est politique » prenne tout son sens, mais de façon opposée pour les féministes et les hommes engagés. Ainsi, lors d’un camping anti-patriarcal organisé il y a quelques années en Ariège, les groupes de parole non-mixtes et mixtes ont rapidement fait émerger une asymétrie de vécus entre femmes et hommes, et donc de thématiques envisagées et de manières de les traiter. Très rapidement, des oppositions se sont en effet révélées : les hommes engagés ressortaient joyeux des ateliers non-mixtes masculins où ils avaient par exemple abordé les premières expériences sexuelles, les fantasmes, l’expression d’émotions, tandis que les féministes ressortaient graves d’ateliers où elles avaient abordé les violences sexuelles et leurs conséquences sur leur sexualité et leur intégrité. Au cours de ces journées, cette distance a crû jusqu’à provoquer une confrontation : les féministes ont exigé que les hommes engagés prennent conscience de ce décalage, lié à l’oppression vécue par les femmes, et de la hiérarchie des positions genrées. Si elles ont, malgré leur colère et leur douleur, opté pour une approche très pédagogique, les hommes ont, eux, refusé de proposer une réponse collective et d’accepter cette main tendue. De surcroît, elles ont signalé qu’elles avaient été progressivement exclues des interactions mixtes : regards fuyants, disparition d’une convivialité présente auparavant.
Prenons un autre exemple : lors de discussions, de fêtes et de rencontres impulsées par des membres de groupes féministes radicaux lyonnais, certains hommes engagés apprenaient progressivement, à travers un va-et-vient entre pratique et réflexion, que la parole des féministes en matière de rapports sociaux de sexe était plus pertinente que celle des hommes engagés. Ceux-ci n’arrivaient souvent pas à saisir pleinement les thématiques discutées, ni à identifier correctement les tenants et aboutissants d’une question posée, ni à comprendre ce qui faisait de façon évidente sens pour ces féministes radicales. Face à ce décalage genré, la majorité des hommes engagés développait pourtant le jugement suivant : considérer que la parole féministe est plus pertinente que celle des hommes engagés signifie « être culpabilisé, sous la coupe des féministes », voire « castré » ; s’opposer à cette considération signifie « être critique, soutenant les féministes mais vigilant quant à toute soumission ». Ici non plus, la question du lien entre position sociale genrée et analyse des rapports sociaux de sexe n’était pas réellement posée du côté des hommes engagés, et cette résistance bloque toute dynamique constructive entre féministes et hommes engagés.
Le décalage genré apparu lors de ces dynamiques militantes - les conceptualisations opposées des rapports sociaux de sexe comme oppression - n’est pas dû à un manque d’informations du côté des hommes, qui serait à combler pour retrouver une sorte d’équilibre. Les personnes présentes disposaient d’informations relativement proches et variées : hétérosexuel-le-s et homosexuel-le-s, novices et ancien-ne-s, universitaires et non-universitaires... Si seules les féministes ont développé une analyse axée sur les questions de pouvoir, c’est bel et bien parce que, pour elles et en raison de leur vécu, les informations et les expériences partagées résonnaient ainsi... « Car même lorsque les mots sont communs, les connotations sont radicalement différentes. C’est ainsi que de nombreux mots ont pour l’oppresseur une connotation-jouissance, et pour l’opprimé une connotation-souffrance » (Rochefort in Mathieu, 1991 : 132). Le décalage apparu entre féministes et hommes engagés est donc bien une conséquence persistante de l’oppression : tandis que la position structurelle des féministes dans les rapports sociaux de sexe produit des thématiques politiques communes questionnant la réalité en termes de pouvoir, celle des hommes engagés produit des thématiques également communes au groupe mais qui au contraire voilent les rapports d’oppression.
Position sociale, androcentrisme et capacité d’analyse
Si ce décalage genré persistant entre féministes et hommes engagés n’est pas une question d’information mais bien de vécu à partir de positions sociales hiérarchiques, de quelle façon encore plus précise peut-on décrire ce lien genré entre sujet connaissant et objet de connaissance ? L’étude de l’épistémologie féministe du standpoint (Hartsock, 1998) permet de faire émerger deux principales pistes de réflexion. La première tourne autour de la question de l’androcentrisme, défini comme égocentrisme affectif, psychologique et politique masculin, la deuxième concerne la capacité d’analyse, déterminée par une expertise masculine spécifique.
La première piste sur le lien genré entre sujet connaissant et objet de connaissance concerne la motivation respective de féministes et des hommes engagés. Les féministes présentes au camping ont interprété de façon politique leurs expériences, parce que seule cette politisation répondait à leur intérêt objectif : pouvoir élaborer des outils conceptuels permettant d’agir efficacement contre une réalité oppressive. Ce qui a motivé ces femmes c’est précisément le fait que qualifier les hommes d’oppresseurs et leur action d’oppressive correspond à dire ce qu’il en est dans la réalité — et que ceci est source d’émancipation. Au contraire, les hommes engagés n’avaient pas interprété leurs expériences de façon politique car cela les aurait renvoyé à une réalité masculine constituée d’infliction de violences, d’exploitation, d’appropriation et de non-empaempathie envers les femmes. Or, les hommes, s’ils veulent maintenir leur qualité de vie matérielle, psychologique, sexuelle et mentale, ont intérêt à se cacher à eux-mêmes le caractère oppressif de leurs rapports avec les femmes. Ce qui les motive pour participer à ces dynamiques de groupe, c’est de pouvoir parler d’eux-mêmes, « ce qui [les] préoccupe, c’est l’homme, c’est-à-dire [eux-mêmes], encore et toujours » (Mathieu, 1999 : 308). Ils thématisent alors volontiers le « rôle de sexe » ou « carcan » masculin - c’est-à-dire ce en quoi ils pourraient également se sentir victimes - ou ce qui relève d’autres oppressions, en faisant l’impasse sur leur propre action oppressive. Ainsi, c’est bel et bien l’androcentrisme qui caractérise les dynamiques et analyses masculines engagées. Cet andro-centrisme consiste en un égocentrisme affectif et psychologique qui octroie une place démesurée à ses propres sentiments et vécus, et en un égocentrisme politique où le féminisme est un outil pour améliorer son propre sort. Vu de l’intérieur, par un homme engagé ayant participé à des groupes « pro-féministes » dans différents pays, cet égocentrisme affectif et psychologique s’exprime avant tout par un refus d’empathie envers les femmes. Toute évocation de la violence faite aux femmes par les hommes — lorsque celle-ci n’est déjà pas évacuée de prime abord sous prétexte de ne pas se laisser déterminer par l’ordre du jour féministe — est détournée de multiples façons : soit elle sert à évoquer leurs propres souffrances (« mais moi aussi, je souffre »), soit elle est rejetée sur d’autres hommes ou un quelconque système les dépassant (masculinité hégémonique, patriarcat), soit elle est retournée contre les femmes (« mais elles doivent bien y trouver quelque chose, non »), soit elle est évacuée par une auto-culpabilisation permettant de rester centré sur soi-même (« c’est affreux, je souffre d’être dominant »). Il semblerait qu’il soit impossible pour la plupart des hommes « engagés » d’accepter simplement que la (qualité de) vie des femmes est minée voire annihilée par les actes des hommes. Leur refus d’empathie peut être expliqué en faisant l’hypothèse que tout se passe comme si, pour eux, reconnaître pleinement l’existence des femmes reviendrait à menacer leur propre existence. Mais l’androcentrisme se traduit également par un égocentrisme politique : l’évocation des rapports entre femmes et hommes amène ces hommes à parler de leurs vécus personnels en excluant progressivement le vécu des femmes concrètes dans leurs propres vies. Le féminisme fonctionne alors comme un outil thérapeutique destiné à améliorer la qualité de vie masculine : les hommes utilisent l’analyse féministe pour transformer leur vie dans le sens de plus de bien-être ; si cela ne marche pas alors ils rejettent le féminisme.
On peut, grâce à cette première piste de réflexion sur le li genré entre sujet connaissant et objet de connaissance, identifier un obstacle central à la production de savoirs pertinents sur les rapports sociaux de sexe à partir d’une position sociale masculine. La défense égoïste de leurs propres intérêts et de ceux de leur groupe social motive les hommes engagés à exclure de leur analyse le vécu opprimé des femmes, et à rester centrés sur eux-mêmes. C’est aussi en refusant d’empathiser avec les femmes que les hommes engagés demeurent liés au groupe social des hommes en général. Seul un travail théorique, politique et personnel sur cet aspect de la subjectivité masculine permettra de briser le lien avec le groupe social des hommes et d’élaborer une conscience anti-masculiniste.
Une deuxième piste de réflexion sur le lien genré entre sujet connaissant et objet de connaissance concerne la capacité d analyse à proprement parler. Il s’agit de considérer comment le fait de vivre dans une position sociale oppressive structure la façon d'être au monde. L’épistémologie féministe du standpoint permet de comprendre que vivre en tant que femme ou homme dans une société hiérarchisée produit des « expertises » asymétriques, formes de conscience pré-politique du fonctionnement des rapports sociaux de sexe. La notion d’expertise met l'accent sur le fait que femmes et hommes sont des sujets connaissants actifs, agissant dans une structure sociale donnée, qui gèrent des informations et analyses permettant de se repérer et de s’orienter. Elle se distingue des concepts de rôles, de dispositions, de socialisations ou de performativités par le fait qu’elle met en exergue la conscience pratique qu’élaborent les actrices sociales et les acteurs sociaux des rapports de force sociaux. Ces expertises sont asymétriques dans la mesure où les femmes accumulent des informations, sentiments, intuitions et analyses qui partent des conséquences violentes de l'oppression qu’elles subissent pour remonter vers la source de celle-ci, élaborant ainsi des connaissances sur les rapports concrets qu’elles vivent. Dans la mesure où le vécu féminin est en permanence marqué par les effets de l’oppression, cette expertise prend une place importante, reste souvent consciente et concerne la dynamique oppressive en tant que telle. Au contraire, les hommes accumulent depuis l’enfance des informations, sentiments, intuitions et analyses sur le maintien et 1 amélioration de leur qualité de vie puisque ils n’ont pas, en tant qu’hommes, à « rendre des services » ni à se soumettre aux femmes. Aussi ce qu’ils apprennent au quotidien dans leurs rapports avec les femmes reste-t-il axé sur eux-mêmes : une plus grande écoute des femmes est susceptible de remettre en cause leurs comportements et donc de leur coûter de l’énergie psychique et affective, voire l’abandon ou la perte d’avantages concrets ; par ailleurs, quand ils dévoilent leur fonctionnement affectif, cela peut offrir des moyens de résistance aux femmes mais cela peut aussi leur rapporter, à eux, soulagement et soutien thérapeutique de la part des femmes ; un bon dosage de froideur et de distance décourage toute initiative de la part des femmes tandis que l’expression d’intérêt et d’attachement permet d’obtenir certains services affectifs et sexuels. Bref, les hommes ont tout un répertoire d’attitudes consciemment destinées à obtenir tel ou tel résultat dans leurs rapports avec les femmes. On peut dire que leur expertise est égocentrée. Elle prend moins de place que l’expertise relationnelle des femmes parce que le fait d’être oppresseur permet justement de s’intéresser à d’autres choses : études carrière, loisirs, militantisme. Cette expertise masculine est consciente à certains moments, surtout dans l’enfance, mais elle se transforme progressivement en une sorte d’intuition masculiniste. Les hommes construisent ainsi une expertise sur les moyens concrets de l'oppression (Mathieu, 1991) : ils apprennent à tester la fonctionnalité et l’efficacité de certaines attitudes, comportements, paroles, absence de paroles, sentiments, dans leurs rapports avec les femmes.
Et c’est dans cette asymétrie que se trouve le saut qualitatif épistémologique que représente l’expertise à partir du vécu des femmes : elles construisent une expertise importante, consciente et relationnelle, informée par le vécu opprimé permanent, concernant la dynamique de l’oppression, tandis que les hommes construisent une expertise non-relationnelle, concernant les moyens de l’oppression, centrée sur eux-mêmes et d'où le vécu des femmes est quasi absent. Cette asymétrie des expertises pré-politiques, éléments constituants de façons d’être au monde genrés, permet de mieux comprendre la persistance du décalage genré entre féministes et hommes engagés et le lien genré entre sujet connaissant et objet de connaissance. Si les féministes conceptualisent les rapports sociaux de sexe comme oppression contrairement aux hommes engagés, c’est qu’il existe une asymétrie des capacités d’analyse concernant les rapports sociaux de sexe. Cette asymétrie doit être pensée, in fine, en termes de privilège épistémologique pour les féministes et de désavantage épistémologique pour les hommes engagés (Hartsock, 1998). Cette condition épistémologique particulière est à considérer puisqu’elle structure le rapport épistémologique des chercheurs-hommes engagés aux rapports sociaux de sexe. Il importera alors de développer des recherches engagées à partir d’une position sociale oppressive qui mobilisent l’expertise spécifique masculine tout en tenant compte de la capacité moindre des chercheurs-hommes engagés à penser la dynamique de l’oppression.
Comme l’égocentrisme masculin, le particularisme épistémologique masculin constitue un obstacle central à la production d’analyses pertinentes sur les rapports sociaux de sexe. Ces derniers structurent la subjectivité masculine commune et conditionnent donc de façon spécifique les rapports à l’objet de recherche. Ces deux obstacles peuvent expliquer pourquoi aussi peu d’hommes s’engagent sur ce terrain, mais également pourquoi leur traitement de la question des rapports sociaux de sexe reste souvent biaisé, malgré une bonne connaissance des analyses féministes. Cette structuration particulière est avant tout un désavantage : étant donnée leur appartenance au groupe social oppresseur, quasiment rien ne motive les chercheurs-hommes engagés ni ne leur permet de remettre profondément en cause ce qui fonde leur existence. Il faudrait alors transformer la subjectivité masculine afin qu’elle intègre pleinement l’existence des femmes et leur vécu opprimé, ce qui implique pour les hommes une remise en cause personnelle et une rupture avec leur groupe social et avec la masculinité. Mais ce qui constitue d’abord un désavantage permet néanmoins aux hommes engagés de contribuer à l’analyse de certains aspects des rapports sociaux de sexe, dans la mesure où ils sont encadrés par les théorisations féministes.
Transformation de notre subjectivité : deux temps
Je propose d’identifier des éléments qui permettraient av chercheurs-hommes engagés de transformer leur subjectivité particulière. Je distingue deux temps, qui ne sont pas nécessairement aussi séparés dans la réalité mais qui permettent de mieux comprendre ce travail de transformation, d’ailleurs permanent. Si le premier temps tourne autour de la compréhension adéquate des théorisations féministes, le second temps concerne la participation à des pratiques militantes féministes permettant de mieux ancrer cette compréhension.
Le premier temps d’une transformation de la subjectivité masculine consiste à lire et analyser de façon approfondie les théorisations féministes. Celles-ci permettent de transformer les grilles de perception et d’analyse des rapports sociaux de sexe, éléments cruciaux de la subjectivité. En cela les travaux fondateurs de Christine Delphy (1998, 2001), Colette Guillaumin (1992), Nicole-Claude Mathieu (1991), Paola Tabet (1998) et Monique Wittig (2001) restent incontournables car ces théoriciennes posent avec clarté les différentes dynamiques oppressives, les bases méthodologiques et épistémologiques pour un féminisme et lesbianisme radical matérialiste et permettent un investissement intellectuel, affectif, politique et personnel radicalement novateur. La compréhension adéquate de ces thèses représente un enjeu majeur pour pouvoir rompre intellectuellement avec la vision du monde masculiniste. En transformant les grilles de perception et de lecture des rapports sociaux de sexe, les chercheurs-hommes engagés entament une rupture du lien entre eux-mêmes et leur groupe social. Assez logiquement, d’importantes résistances surgissent face à une telle rupture, qui vont donner lieu à différentes façons de s’investir dans la recherche engagée. A l’instar de David Kahane (1998), on peut identifier quatre modes d’engagement. Le poseur veut bien être perçu comme « pro-féministe » mais s’implique de façon superficielle, il refuse d’appliquer ces analyses à ses propres tendances théoriques et pratiques. L'insider s’engage politiquement dans le projet féministe mais voulant garder une image positive de soi, il ne remet pas en cause son comportement genré et projette le patriarcat sur les autres hommes.L'humaniste perçoit le patriarcat comme source de bénéfices mais aussi de dommages pour les hommes et privilégie un ordre du jour masculin, mettant en avant des malaises et douleurs supposés liés à la masculinité. Finalement, l'auto-flagellateur combine une connaissance relativement approfondie des thèses féministes avec une intolérance pour l’ambiguïté : marqué par la culpabilité et l’intransigeance, il se retire à moyen terme dans les idéals-type précédents. Ces quatre modes d’engagement nous rappellent les éléments déjà discutés au sujet des (chercheurs) hommes engagés : le faux choix entre reprise mimétique et culpabilisée des analyses féministes et élaboration d’un propre ordre du jour masculin peut être compris comme opposant l'humaniste et l'auto-flagellateur, tandis que l’égocentrisme affectif, psychologique et politique des hommes engagés traverse de façon différente les quatre modes d’engagement. De fait, un centrage psychologique sur soi-même et ses propres résistances psychologiques continue de prédominer puisque ce premier temps est intellectuel et souvent individuel. Cette catégorisation des attitudes pendant le premier temps de compréhension adéquate des théorisations féministes classifie avant tout les différents degrés de deuil auxquels sont parvenus les différents individus quant à l’imaginaire et la vision du monde masculinistes.
Dans la mesure où ce premier temps permet une transformation intellectuelle, limitée, de la subjectivité masculine, un deuxième temps permettant de dépasser les modes d’investissements décrits s’impose. Celui-ci consiste alors à participer à des dynamiques collectives et militantes, contrôlées par les féministes. Si les chercheuses féministes ont souvent mis en avant la nécessité de l’engagement politique, cela me semble encore plus important pour les chercheurs-hommes engagés puisque ces engagements — qu’ils soient informels et dans la vie quotidienne, ou formalisés et organisationnels — permettent de mieux saisir les enjeux des rapports sociaux de sexe. La participation à des dynamiques de groupe telles que le camping anti-patriarcal, mais surtout à des luttes et du travail de terrain avec des féministes contre différents aspects de l’oppression des femmes permet de transformer plus en avant la subjectivité masculine et de percevoir concrètement les (micro)dynamiques oppressives : la solidarité masculine contre les femmes, les stratégies élaborées ainsi que le caractère général organisé et intentionnel de l’action oppressive des hommes. Pour ancrer de façon ressentie des notions intellectuelles telles que le sexage (Guillaumin, 1992), l’exploitation domestique (Delphy, 1998), le fait de céder et non consentir, l’envahissement mental et l’hétérosocialité (Mathieu, 1991), il faut se laisser la possibilité d’être confronté concrètement aux effets de l’oppression tels que la crainte, la déstructuration psychique, la douleur, les cicatrices, la pauvreté mais également la colère, l’impuissance et les stratégies de résistance. Dans ce second temps, on doit se déprendre de soi assez souvent et assez longtemps pour donner en soi une place affective et psychologique autre qu’annexe et subordonnée au vécu des femmes. Ceci implique une répétition d’abandons momentanés des points de vue oppresseurs afin de faire une place intellectuelle et affective plus importante et plus permanente aux points de vue opprimés. Et c’est précisément ce « décentrement » — le renoncement à l’égocentrisme — qui permet de dépasser les modes d’engagements limités liés à une compréhension purement intellectuelle des théorisations féministes. La reconnaissance à un niveau ressenti du vécu opprimé des femmes, une analyse basée sur l’empathie neutralisent les résistances masculines aux théories féministes et ouvrent la voie à un investissement d’une autre nature, plus engagé, dans l’étude des rapports sociaux de sexe.
Les deux temps de transformation, compréhension intellectuelle des théorisations féministes et participation aux dynamiques militantes féministes, constituent la pré-condition pour les chercheurs-hommes engagés, de parvenir d’une part à mieux comprendre la dynamique de l’oppression masculine en reliant sentiments, sensations, intuitions et pensées et d’autre part de s’investir de façon moins biaisée dans la recherche. Il ne s’agit pas seulement d’identifier les stratégies et les techniques d’autres hommes mais également d’analyser de quelle façon nous-mêmes continuons de les utiliser, y compris dans un contexte féministe. Il est nécessaire de prendre conscience des conflits inhérents à une telle transformation de la subjectivité masculine pour parvenir à se désolidariser de son groupe social et de ce qui le caractérise, la masculinité et le masculinisme. S’étant ainsi désolidarisé, le chercheur-homme pourra ensuite éventuellement produire des analyses plus pertinentes et moins biaisées, dans la mesure où elles prendront en compte sa condition épistémologique désavantagée.
Perspectives de recherches engagées pertinentes
J’ai essayé de démontrer jusqu’ici à quel point le lien entre sujet connaissant « homme » et objet de recherche « rapports sociaux de sexe » est structuré par la position oppressive et l’appartenance au groupe social hommes. Loin d’être des « sujets connaissants neutres, autonomes et rationnels » tel que le véhicule l’imaginaire masculiniste, les chercheurs-hommes engagés sont confrontés à de nombreux obstacles qui les empêchent de faire une contribution à l’analyse des rapports sociaux de sexe. Les deux temps de transformation de la subjectivité masculine permettent de contenir les effets négatifs de l'égocentrisme affectif, psychologique et politique masculin et de la condition épistémologique désavantagée, ils n’indiquent pourtant pas de quelle façon des recherches engagées peuvent être menées. Dans cette dernière partie, je formule des pistes de réflexion sur la façon dont les chercheurs-hommes engagés peuvent tenir concrètement compte de leur subjectivité particulière dans le choix et l’éclairage de leurs objets de recherche et je concrétise cette réflexion à travers l’exemple de la socialisation masculine.
Assez logiquement, les recherches masculines engagées sur les rapports sociaux de sexe sont marquées par les biais également constatés au sein des dynamiques masculines engagées, qui consistent à « [éviter] de se confronter au rapport avec l’autre sexe et à la réalité de ce rapport » (Dagenais et Devreux, 1998 : 11). Leurs auteurs effectuent cet évitement en s’intéressant de façon prioritaire au vécu masculin sans le mettre en rapport avec le vécu féminin, en sous-estimant ce rapport, en ignorant volontairement les aspects intentionnels, conscients, organisés et intéressés de l’action oppressive masculine. Ce biais découle, entre autres, de l’idée répandue selon laquelle les chercheurs-hommes engagés contribueraient de façon suffisante à penser les rapports sociaux de sexe à partir de leur position sociale en choisissant comme thématique le vécu masculin, le groupe social hommes et la masculinité. En raison de l’égocentrisme et du désavantage épistémologique masculins, ce choix thématique ne permet pas de faire émerger dans l’analyse l’action oppressive des hommes. Il est nécessaire d'effectuer un long travail de mise à distance de tout ce qui fait sens — intuitions, ressentis, pensées et sensations — car ce sens masculiniste empêche très concrètement de percevoir différemment le vécu masculin. De la même façon que pour transformer la subjectivité masculine, les chercheurs-hommes engagés ont effectué une répétition d'abandons momentanés de leur point de vue au bénéfice du point de vue des femmes, il s'agit de se défamiliariser de façon progressive mais radicale de l’objet de recherche pour pouvoir l'interroger différemment. Or, contrairement aux chercheures féministes pour lesquelles l'expertise pré-politique concernant la dynamique de l’oppression constitue une ressource importante pour interroger ce sens masculiniste, les chercheurs-hommes engagés ne disposent pas d'un tel atout de départ. La seule démarche qui leur permettra de faire la même rupture épistémologique, c'est de procéder à des va-et-vient réguliers entre l’objet de recherche et le sens féministe. Progressivement ces va-et-vient permettent au sens féministe de devenir la perspective d'interrogation de l'objet de recherche et au chercheur de formuler des questions sur le lien entre la structuration particulière du vécu masculin et l'utilité d’une telle structuration pou améliorer la qualité de vie masculine aux dépens des femmes. En examinant tous les aspects de la façon masculine d’agir, d’être au monde et de voir le monde sous l’angle des bénéfices que les hommes obtiennent dans leurs rapports avec les femmes, les chercheurs-hommes engagés peuvent analyser le pouvoir dans sa dimension genrée. C'est d’ailleurs uniquement après avoir effectué cette rupture qu’ils peuvent également mobiliser leur expertise pré-politique concernant les techniques employées par les hommes pour opprimer les femmes en s’appuyant sur leurs propres expériences, ressentis et perceptions. C'est à ce moment que la réflexion devient réellement anti-masculiniste et qu’elle peut fournir des éléments sur la façon dont les hommes instrumentalisent les femmes.
Il me semble qu’en procédant de cette façon, les chercheurs-hommes engagés peuvent contribuer de façon pertinente à l’analyse des rapports sociaux de sexe en axant de façon centrale leur analyse du vécu masculin sur le rapport à l’autre sexe et les différents aspects constituant ce rapport oppressif. Le travail d’analyse du vécu masculin n’est d'ailleurs pas à penser comme revenant ou appartenant aux chercheurs-hommes engagés. Ceux-ci voient ce vécu de l’intérieur ; cet angle n’est pas meilleur que celui des femmes qui le voient de l’extérieur mais en ressentent les effets, il est différent. La rencontre entre théorisation féministe par des chercheures-femmes et théorisation anti-masculiniste par des chercheurs-hommes sera alors la rencontre entre une théorisation privilégiée épistémologiquement mais dépourvue de regard de l’intérieur et une théorisation désavantagée épistémologiquement mais pourvue de regard de l’intérieur.
Prenons un exemple pour concrétiser cette piste de réflexion, celui de la socialisation masculine. De nombreux chercheurs-hommes engagés l’analysent avant tout comme un lieu de violences pour les hommes, créant différentes formes de masculinité et produisant des « carcans » emprisonnant les hommes,puis ensuite et seulement ensuite comme la source de violences envers les femmes. Ce type d’analyse pense mal, à mon avis, le lien entre cause et effet, exagérant souvent les effets négatifs sur les hommes. Analyser la socialisation masculine avant tout à travers ses effets négatifs sur les hommes (sens masculiniste) empêche en effet de penser que cette socialisation a d’abord pour but et pour effet d’apprendre à une génération d’enfants à devenir des acteurs de l’oppression des femmes (sens féministe). Et si l’apprentissage d’une façon d’être au monde et d’une vision du monde masculinistes peut avoir des coûts secondaires, elle permet avant tout de jouir de privilèges structurels incomparables pour le reste de sa vie. La rupture épistémologique rendue possible par le processus de défamiliarisation permet en revanche d’interroger de quelle façon cette socialisation est bénéfique et même cruciale au maintien du pouvoir des hommes sur les femmes. Apprendre, par exemple, à ne pas exprimer d’émotions ou à les exprimer sélectivement et à certains moments précis, renforce les hommes dans leur rapport aux femmes : « exprimer ses émotions tend fortement à réduire sa position de pouvoir, le pouvoir ayant de forts liens avec la non-expression de vulnérabilité » (Monnet, 1998 197). La thématique de certains chercheurs-hommes, de favoriser l’expression d’émotions chez les hommes, apparaît comme l’apprentissage de l’un des moyens de pouvoir. Les chercheurs-hommes engagés doivent au contraire envisager la socialisation masculine comme constituant différentes façons d’apprendre, souvent avec plaisir et jouissance, à se construire une subjectivité, une corporalité, une sexualité qui permettent à la fois de se servir des femmes et à n’en éprouver ni gêne ni remords.
L’enjeu épistémologique de recherches engagées à partir d’une position masculine et cependant cohérentes avec les théorisations féministes est donc de produire, à partir des analyses féministes de la dynamique de l’oppression, des savoirs qui documentent de l'intérieur toutes les dimensions de l’action oppressive masculine. Ce travail n’est réalisable que dans la mesure où les chercheurs-hommes engagés restent vigilants quant à leur propre subjectivité et action oppressives envers les femmes. Il ne peut pas être pensé ni mis en place de façon isolée ou entre oppresseurs, il ne peut pas non plus être fondé uniquement sur « de bonnes intentions ». Il est donc nécessaire pour nous, chercheurs-hommes engagés, d’établir avec des féministes des interactions régulières non contrôlées par le groupe des hommes, afin de vérifier la pertinence théorique et politique de notre travail. Conscients de l’égocentrisme affectif, psychologique et politique masculin et d’une condition épistémologique désavantagée, il est important de rendre des comptes aux principales concernées afin d’éviter les nombreux écueils déjà documentés, dont celui d’une nouvelle exclusion des féministes par les recherches masculines sur les rapports sociaux de sexe. En effet, si les chercheurs-hommes engagés peuvent analyser de l’intérieur les moyens de l’action oppressive masculine, il ne s’agit pas de créer un nouveau bastion masculin où l’appartenance au groupe social oppresseur serait transformée en privilège épistémologique contre les femmes.
Bibliographie
Dagenais, Huguette et Anne-Marie Devreux (1998). « Les hommes, les rapports sociaux de sexe et le féminisme : des avancées sous le signe de l’ambiguïté ». Nouvelles Questions Féministes, 19 (2-3-4), 1-22.
Delphy, Christine (1998). L’ennemi principal. I. Economie politique du patriarcat. Paris : Syllepse.
Delphy, Christine (2001). L’ennemi principal. II. Penser le genre. Paris : Syllepse.
Guillaumin, Colette (1992). Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée de nature. Paris : Côté-Femmes.
Hartsock, Nancy (1998). The feminist standpoint revisited & other essays. Westview : Oxford.
Kahane, David J. (1998). « Male feminism as oxymoron ». In Tom Digby (Ed.), Men doing feminism (pp. 213-236). London : Routledge.
Le Doeuff, Michèle (1989). L’étude et le rouet. 1. Des femmes, de la philosophie, etc. Paris : Seuil.
Mathieu, Nicole-Claude (1991). L’anatomie politique. Catégories et idéologies du sexe. Paris : Côté-Femmes.
Mathieu, Nicole-Claude (1999). « Bourdieu ou le pouvoir auto-hypnotique de la domination masculine ». Les Temps Modernes, 604, 286-324.
Monnet, Corinne (1998). « A propos d’autonomie, d’amitié sexuelle et d’hétérosexualité ». In Corinne Monnet et al. (Ed.), Au-delà du personnel. Pour une transformation politique du personnel (pp. 31-46). Lyon : ACL.
Tabet, Paola (1998). La construction sociale de l’inégalité des sexes. Des outils et des corps. Paris : L’Harmattan.
Thiers-Vidal, Léo (2001). « Rapports sociaux de sexe et pouvoir. Une comparaison des analyses féministes radicales avec des analyses masculines engagées ». Genève/Lausanne : Mémoire de DEA Femmes/Genre.
Welzer-Lang, Daniel (1996). Les hommes violents. Paris : Côté-Femmes.
Welzer-Lang, Daniel (1999). « Et les hommes ? Étudier les hommes pour comprendre les changements des rapports sociaux de sexe ». Toulouse : Dossier d’habilitation Université Toulouse 2 — Le Mirail.
Wittig, Monique (2001). La Pensée Straight. Paris : Balland.
Notes
Suite à la dicussion « Tabous intériorisés face aux féministes »
[Bien qu’écrit plusieurs années après l’article précédent, nous reproduisons ici ce texte de Léo jamais publié mais posté en mai 2005 sur la liste de discussion internet Prostates. « icm » dans le langage prostatien renvoie à individu de construction masculine ; et « icf » de même : in-dividue à construction féminine.]
Dans le texte qui suit, je vais essayer de mettre des mots sur une séance mal vécue lors du second week-end entre dominants de genre, en mars 2005, à Dijon. Il peut être utile de rappeler quelques phrases de l’appel à la rencontre, phrases particulièrement pertinentes quant aux enjeux discutés ci-dessous :
« Mais ne nous méprenons pas, il s’agit ici bien sûr de créer un cadre de rencontre non-mixte avec des objectifs particuliers et donc aussi différents que possibles de la non-mixité icm qui se retrouve d’ailleurs parfois largement dans notre société, du club de foot, au groupe militant, en passant par un grand nombre de cadres salariés ou amicaux. [..J Nous ne voulons pas conforter les réflexes de solidarité masculine qui s’exercent habituellement contre les iefs mais les remettre en cause. »
Ce week-end, comme le précédent de septembre 2003 à Neuvy-sur-Saône, a débuté avec une séance d’organisation et de planification de l’ordre du jour. Chaque participant proposait des thèmes de débat, d’atelier, d’activité puis ces propositions étaient soumises à un vote à main levée afin de recueillir le nombre de participants intéressés ainsi que l’intensité de cet intérêt (une main, deux mains). Lors de cette séance de préparation, un homme a proposé comme thème de discussion « les tabous intériorisés face aux féministes ». Il a alors brièvement présenté cette proposition de débat en faisant référence à certaines tensions, certains conflits non-ex-primés qu’il avait vécus avec des féministes au sein de la mouvance squat mixte et à son désir de partager ce vécu et son analyse. La proposition a été adoptée comme importante, comme toutes celles ayant finalement été mises sur l’ordre du jour du week-end (environ un tiers de celles proposées au vote).
Lorsque la séance sur les « tabous » a eu lieu, le troisième jour de ce week-end, celle-ci a marqué pour moi une profonde et violente rupture de la teneur, du ton politique personnel critique de la domination masculine qui avait marqué la première rencontre à Neuvy : des paroles au « je » partant de nos propres expériences et vécus qui intègrent de façon critique notre position structurelle de domination et nos propres pratiques de domination.
En guise d’introduction, l’homme ayant initié ce débat est revenu sur ses motivations : il expliquait que dans le cadre du squat au sein duquel il vivait, il avait ressenti une tension conflictuelle avec une féministe qui n’habitait pas dans ce squat mais qui participait à la dynamique locale du milieu squat. Cette femme avait en effet exprimé le désir qu’un autre homme ne puisse pas être présent dans ce squat en même temps qu’elle, parce qu’elle vivait mal cette présence, pour des raisons féministes. Elle considérait que cet homme avait eu des comportements, des attitudes problématiques envers elle-même et d’autres femmes - comportements qui ne relevaient pas de la violence masculine physique ou sexuelle, mais tout de même de la domination masculine interpersonnelle. L’initiateur expliquait alors que la tension qu’il avait ressentie à ce moment était due au fait qu’il était en désaccord avec cette féministe quant aux motivations proprement féministes de refus de la présence de cet homme. Selon lui, il s’agissait de désaccords personnels, d’incompatibilités personnelles qui ne pouvaient être qualifiés avec raison de « féministes ». Du coup, il nous disait avoir le sentiment que cette féministe se servait d’un argumentaire féministe pour appuyer un ordre du jour personnel. Il expliquait également qu’il n’avait pas douté ouvertement des raisons de ce refus face à cette féministe et qu’il avait donc gardé ce désaccord pour lui et quelques proches (dont des féministes), d’où la notion de « tabou ». La décision collective prise à ce moment-là avait par ailleurs, nous disait-il, consisté à demander à cet homme de ne pas être présent en même temps que cette féministe au sein du lieu squatté. Mais toute cette étape avait, nous disait-il, laissé en lui un sentiment amer, non digéré, d’où le désir d’en parler avec nous.
Cette introduction au débat est à mon avis importante pour ce qui allait suivre : un homme se considérant comme engagé accusait de fait une féministe de malhonnêteté politique, ce qui suppose de sa part, une démarche malveillante soit consciente et intentionnelle, soit pathologique. Dans sa présentation, il ne doutait pas (ni la majorité des participants) de la justesse de sa propre analyse, ne remettait pas en cause son interprétation qu’il y avait bien eu manipulation politique pour des raisons personnelles. Ceci est à mon avis important parce qu’il y a là justement une marge d’action anti-masculi-niste cruciale. C’est en effet dans l’interprétation, la sous-interprétation, la sur-interprétation de « faits » genrés que les hommes activent souvent le masculinisme au sens de Michèle Le Dœuff : « (...) ce particularisme qui non seulement n’envisage que l’histoire ou la vie sociale des hommes, mais encore double cette limitation d’une affirmation (il n’y a qu’eux qui comptent et leur point de vue) (...) ».
Autrement dit, c’est en interrogeant notre réception, notre ressenti, notre perception, notre interprétation, notre analyse des interactions genrées que nous pouvons souvent saisir notre « masculinisme-en-action » et le contrecarrer au mieux à l’aide des grilles de lecture féministes. Dès cette première intervention, cette marge de manœuvre anti-masculiniste ne fut donc pas investie par la majorité des participants au débat, et l’attention critique allait de plus en plus se porter sur les féministes : c’était bien leurs actes, leurs analyses, leurs motivations, leurs intentions qui allaient être soumis à un regard scrutateur sûr de lui et hyper-critique.
Après cette première intervention et sa discussion, plusieurs autres hommes ont également pris la parole, témoigné d’expériences plus ou moins similaires... Je ne me rappelle pas exactement du contenu de toutes ces autres interventions, mais nous étions bien rentrés (au nom de l’expression de sentiments « tabouisés ») dans un débat critique des actes féministes, des féministes. Et nous y étions tellement rentrés, que lorsqu’un des participants a raconté que lui aussi avait vécu des tensions, des conflits avec une féministe, parce qu’il « l’avait plus ou moins violée » il n’y eut aucune réaction, aucun arrêt ne fut marqué. Cette contribution à la séance sur « les tabous intériorisés face aux féministes » était passée comme si de rien n’était, comme s’il n’y avait pas là quelque chose d’extrêmement important, à gérer collectivement. Cette absence de réaction au sujet d’un « plus ou moins » viol commis par un des participants exprime de façon criante la logique empathique en cours de construction. L’empathie des participants allait aux autres hommes, la solidarité affective devenait toute masculine, le problème à dénoncer se situait bien du côté des femmes, en particulier des féministes. Si j’ai moi-même été « scotché » par ce témoignage exprimé sur un mode quasi anecdotique, je n’y ai pas plus réagi que les autres.
Une autre intervention, vers la fin, se démarquait un peu de ce climat collectif : cet homme disait qu’il avait pu, lui aussi, ressentir de la crainte, des malaises dans des interactions conflictuelles avec des féministes. Il n’affirmait par contre rier quant à la raison d’être « objective » de ces sentiments, mai posait juste le fait qu’il avait ressenti certaines choses et qu’il ne savait pas trop quoi en faire. Pour moi, il y avait dans cette intervention les éléments qui auraient pu faire l’éventuelle qualité de ce débat : parler de ce que l’on ressent dans ces moments de désaccord, de conflit pour les mettre en commun, en constater d’éventuels aspects partagés de par notre position commune de dominants critiques pour, qui sait, arriver à comprendre ces sentiments différemment et peut-être apprendre à les gérer, sans produire des actes masculinistes. Autrement dit, en maintenant notre regard critique sur nos propres sentiments et actes pour en comprendre la logique et l’origine subjective... sans s’arroger le droit de poser un regard considéré « juste », « pertinent », « objectif » sur les comportements « malveillants » des féministes, de plus, en leur absence.
Mais le climat collectif créé (par les différentes interventions, les différents témoignages, un climat de remise en cause des féministes et de leurs actes... Mais en leur absence, entre dominants de plus en plus solidaires) a incité un autre homme à se saisir de cette discussion pour enfoncer violemment le clou. Cet homme a longuement et haineusement présenté une situation en disant qu’il avait été victime de « méthodes staliniennes », de « manipulations féministes », de « fausse allégation de viol », de « divulgation de rumeurs »... Lui aussi posait son vécu subjectif, son interprétation comme étant la seule possible, la seule juste. Lui aussi supposait de la part de / projetait chez cette femme une démarche malveillante, intentionnelle et consciente. À la base, nous disait-il, il y avait une situation « intime » : cet homme était en relation avec une femme et une nuit, cette femme s’était réveillée avec du sperme sur elle, près d’elle. Elle pensait alors que son ami avait profité de son sommeil pour se masturber contre elle, près d’elle et avait éjaculé contre elle, près d’elle. Après des moments violents pour elle, malaisés pour lui, des discussions, des précisions... cet homme nous disait qu’ils avaient abouti à une sorte d’accord commun, d’interprétation commune : ce qui s’était en fait passé, c’est que lui avait pendant son sommeil, en rêvant, joui et éjaculé. C’était donc, selon ses dires, un malentendu et non un acte d’agression sexuelle. Et, nous disait-il ensuite, il avait appris plus tard par des ami-e-s commun-e-s que cette amie (devenue ancienne amie) « propageait des rumeurs » et « l’accusait de l’avoir violée ».
Pourtant, progressivement, lorsque des participants, dont moi-même, demandaient des précisions, critiquaient les propos tenus... cet homme nous apprenait, malgré lui, que cette femme s’était en fait tout simplement permise ( !) d’aborder cette situation avec des amies, avait partagé avec elles ses sentiments violents de malaise et avait envisagé la possibilité, somme toute réaliste, que son ami avait pu l’agresser / l’avait agressée sexuellement pendant cette nuit. L’intervention de cet homme nous invitait / incitait donc à considérer que lorsqu’une femme (qui a le malheur d’être féministe) s’exprime dans le cadre de ses relations amicales, personnelles, au sujet d’une expérience qu’elle a mal vécue, elle est en fait à dénoncer comme étant manipulatrice, stalinienne, menteuse malhonnête, lanceuse de fausses allégations.
Nous sommes là proches de la racine de cette idée des ru meurs, des fausses allégations... aussi populaires dans la société et les médias : l’interdiction faite aux dominées par les dominants de s’exprimer sur leur vécu, de mettre des mots sur ces vécus, de définir selon leurs propres critères ce qu’elles vivent dans leurs interactions avec des dominants. Liberté de parole ? Liberté et autonomie dans la définition de la réalité vécue ? Que nenni !
Outre la gravité de ces propos mêmes, il y avait, également et encore, l’absence majoritaire d’indignation, de critique politique, de gestion collective critique de tels propos de la part
des autres participants. Bref, il n’était apparemment pas incompatible de se déclarer « proféministe » et de tenir de tels propos lors d'une rencontre anti-patriarcale entre dominants. Pour moi, et également pour quelques autres, quelque chose de très grave avait eu lieu pendant cette séance qui rendait caduque toute la démarche sur laquelle se basait cette rencontre, notamment celle consistant à ne pas conforter les réflexes de solidarité masculine qui s’exercent habituellement contre les iefs mais les remettre en cause.
Cette séance rendait caduque l’éventuelle légitimité politique (encore à démontrer au vu des expériences des dernières décennies !) d’une telle rencontre critique entre dominants. Elle ôtait toute possibilité de faire un travail commun politique personnel au sein de ce groupe sur l’oppression masculine, en particulier celle que nous exerçons dans notre vie quotidienne. Pour moi, cette séance et sa non-remise en cause collective impliquent de retirer à ce week-end la qualification « anti-patriarcale », « anti-masculiniste », « anti-sexiste » ou « pro-féministe ». Si nous n’avons pas un souci de cohérence politique, cessons de suite d’appeler ces rencontres « anti-patriarcales ».
Certains hommes - comme je l’ai appris plus tard — avaient préféré ne pas assister à ce débat, ou l’avaient quitté en cours. Lors d’échanges personnels postérieurs, j’ai pu apprendre que certains appréhendaient ce débat, craignaient une séance antiféministe, ou ne se sentaient tout simplement pas concernés car ils ne vivaient pas ce genre de tensions. Suite à ces échanges informels concernant la réunion sur les « tabous », une réunion de « crise » s’est tenue le lendemain, permettant à tout le monde de s’exprimer sur cette réunion, ces propos. À
mon goût, cette réunion s’est trop limitée à une expression d’impressions, de sentiments personnels et n’a pas permis d’élaborer une analyse collective réellement politique de cette dynamique profondément problématique.
Moi-même, je me suis cantonné à dire à quel point cette réunion m’avait choqué et que j’envisageais de quitter cette rencontre. J’envisageais cela notamment parce que j’avais le sentiment que la majorité des participants ne considéraient pas qu’il y avait eu rupture politique vis-à-vis de l’appel et de l’esprit anti-patriarcal annoncé. De plus, j’ai ensuite eu le net sentiment qu’il y avait de la part des hommes présents une sorte de « relâchement » de la masculinité ; quelque chose avait changé à travers la discussion « tabous », et ce quelque chose ne me semblait pas sans importance. J’ai eu le sentiment qu’une sorte de digue intérieure avait été perforée et que coulait à travers les failles de cette digue, des sentiments de moin. en moins anti-masculinistes. Peut-être que les ateliers « jeux » avaient également contribué à nourrir un « nous » masculin, à encourager une forme de male bonding au détriment des intentions et volontés anti-masculinistes.
Lors de la réunion bilan clôturant ce week-end — où je n’étais pas présent — il a été décidé de ne pas rendre public le compte-rendu très complet rédigé par un des participants concernant la discussion « tabous ». Je ne sais pas comment cela a été décidé, avec quels arguments. Plus tard, lorsque j’ai demandé à recevoir ce compte-rendu pour m’appuyer dessus dans l’éla-boration de ce texte, j’ai appris que suite à un problème informatique ce compte-rendu avait été détruit. Peut-être qu’un jour un nouveau compte-rendu sera rendu accessible, je le souhaite. Je pense même qu’il est absolument nécessaire que ces faits sortent de la non-mixité masculine parce qu’ils renseignent sur ce qui se trame, aussi, dans ces rencontres non-mixtes. Ce sont en particulier de tels propos et dynamiques qui doivent, à mon avis, être soumis à un processus de reddition de comptes en direction des féministes, puisque c’est bien au nom de la lutte féministe et de notre supposée solidarité avec elle(s), que cette réunion a eu lieu. Rendre accessible ce savoir aux principales concernées me semble donc un minimum éthique si nous ne voulons pas nous leurrer et les leurrer quant à la qualité politique des rencontres non-mixtes masculines critiques du genre.
Plus concrètement, je voudrais demander aux autres participants de cette rencontre de Dijon, en particulier ceux qui ont également exprimé des désaccords, de partager leurs impressions, sentiments, analyses au sujet de cette réunion, des propos tenus, de ce texte. De partager leurs comptes-rendus personnels concernant cette réunion. De participer à un travail commun, collectif sur cette rencontre afin de faire un bilan collectif, pluriel. Je ne m’attends pas à un unanimisme, mais j’aimerais savoir où vous en êtes afin de mieux saisir où moi j’en suis vis-à-vis de ce groupe éphémère d’un week-end. Afin de savoir ce que nous entendons lorsque nous disons « anti-patriarcal », « anti-sexiste », « anti-masculiniste » ou « pro-fé-ministe ». Dès le début de cette dynamique libertaire anti-patriarcale, j’ai eu des sentiments très ambivalents notamment de par mes experiences précédentes dans le milieu libertaire. J’ai spontanément peu d’espoir dans ces dynamiques, et la rencontre de Neuvy-sur-Saône avait, de ce point de vue, été une très agréable surprise, justement de par la teneur politique et personnelle très critique de la domination masculine, à commencer par la nôtre. Si le silence consécutif sur les listes « boysdontcry » et « suiteauweekend » m’avait énormément déçu et refroidi, j’avais tout de même espéré retrouver lors de cette rencontre de Dijon l’esprit critique de la première rencontre. Ce ne fut clairement pas le cas et je ne participerai pas à ce qu’une quelconque loi du silence, même libertaire, recouvre ces actes misogynes et anti-féministes.
Pour un regard féministe matérialiste sur le queer. Echanges entre une féministe radicale et un homme anti-masculiniste
[Publié dans la revue Mouvements (n°20—2002/2) intitulée « Sexe : sous la révolution, les normes »J
Voici un dialogue inhabituel dans lequel questionneur/euse et questionné-e ne cessent d'interchanger leurs rôles. Conclusion de la femme comme de l'homme, la pensée dite « queer » les interpelle, mais aussi les dérange et il/elle en expliquent ici les raisons.
Léo Thiers-Vidal : pour toi, est-ce que le queer se définit contre le féminisme ?
Sabine Masson : Je vois vraiment au centre du queer une nouvelle manière de rejeter les catégories binaires de sexe, de même qu’une nouvelle problématisation des sexualités qui mettent ces catégories au défi. Le queer renvoie à « un ensemble de discours et pratiques associés à la transgression des frontières de la différence des sexes et de l’hétéronormativité. [...] Etre queer [...] c’est mélanger les genres[21] ». D’où le poids dans la théorie queer de la critique post-structuraliste du concept de genre contre sa tendance croissante à se confondre avec « sexe » et laissant dans l’ombre les pratiques et discours du/sur le corps rompant cette correspondance[22]. Cette critique du genre rejoint celle de l’hétérosexualité : l’analyse de la masculinité et de la féminité s’est structurée autour de l’acceptation sociale de l’hétérosexualité comme la norme des relations humaines[23]. La théorie queer s’érige contre tout essentialisme des catégories, par son insistance sur l’aspect performatif des pratiques du corps et des discours revendiquant de « choisir son genre[24] ». Le queer marque donc une forte rupture avec le féminisme, puisqu’il relativise très fortement l’idée d’un vécu commun aux femmes. Une question qui me paraît trop souvent passée sous silence c’est : avec quel féminisme ou quel usage du genre le queer rompt-il ? Il s’agit le plus souvent du « féminisme académique » ou du genre « canonisé[25] », au sein d’un contexte anglo-saxon qui a intégré théoriquement et politiquement la critique féministe.
L. T.-V. : D’où vient selon toi le queer par rapport au féminisme ?
S. M. : Premièrement, je pense que la théorie queer trouve une origine dans la critique de l’oppression hétérosexuelle et dans l’histoire récente des mouvements sociaux : à travers l’alliance d’une partie des lesbiennes aux gays — suite à leur oppression / marginalisation dans le mouvement féministe dans une lutte contre une société homo / lesbophobe et contre le contrôle du corps et de la vie des personnes homosexuelles atteintes du sida[26]. Le queer s’est élevé également contre les aspects idéologiques de l’oppression hétérosexuelle, notamment contre la perception hétéro-centrée de beaucoup des études et théories féministes. Je pense aussi que le queer est issu du contexte plus spécifiquement théorique et littéraire du poststructuralisme nord-américain, qui insiste sur la fragmentation des catégories et l’analyse des discours qui s’y rapportent. Ces courants trouvent une inspiration philosophique centrale dans l’analyse foucaldienne du discours, en ce qu’il norme et fixe les comportements (hétéro)sexuels, et produit du pouvoir.
Celle-ci s’appuie sur le rejet d’une conception du pouvoir comme « opposition binaire et globale entre les dominateurs et les dominés[27] » et incite à « l’autocritique des identités et discours que nous adoptons comme partie de nos luttes[28] ». Plus largement, je place le queer dans un vaste contexte idéologique marqué par le rejet de l’analyse en termes de rapports sociaux et qui présuppose la fin de la modernité, des classes, des utopies, du travail, et maintenant : du genre ! Ce n’est pas un hasard si le queer se distingue des études gays et lesbiennes et des « politiques de l’identité », qui ont mis l’accent depuis le début des années soixante-dix sur la défense des droits des homosexuel-le-s, et passe à l'analyse du langage et des discours qui produisent un savoir et des pratiques autour du sexe[29].
S. M. : De la pensée féministe radicale, perçue comme « antimec », ou du queer, laquelle te semble-t-elle pertinente pour un travail masculin sur l’oppression des femmes ?
L. T.-V. : Une des leçons principales que m’a apprise mon implication avec des féministes et lesbiennes radicales est de prendre conscience de ma position sociopolitique, spécifique et structurelle d’homme hétérosexuel et de ses implications psychologiques, épistémologiques, sociopolitiques incontournables[30]. Mon éducation participative à la domination masculine me permet d’avoir une perception et action misogyne, des outils de dominant, et une place matérielle privilégiée. Mon éducation vers et assimilation de l’hétérosexualité / socialité ont parachevé cette position sociale de dominant. Le féminisme matérialiste fonctionne entre autres comme un miroir reflétant ma position matérielle de privilégié, m’ouvrant les yeux et les tripes sur le vécu lié aux positions subordonnées selon l’axe de genre, puis de race, de classe... Il fournit des outils d’analyse et de lutte concrets, applicables immédiatement dans mon vécu des rapports sociaux de genre et dont l’efficacité m’est confirmée jour après jour. Sans ce matérialisme, il me semble impossible d’agir avec pertinence contre l’oppression des femmes par les hommes. La pensée queer par contre ne me renvoie pas vers une position privilégiée mais incite par l’accent qu’elle met sur la performativité, la sexualité, le discursif, à se croire indépendant des structures sociales. Comme si je pouvais aller vers où bon me semblait, et que quasi toute transgression de l’ordre symbolique hétéronormatif était politiquement pertinente. Comme si nous étions tou-te-s des atomes libres survolant genre, hétérosexualité et oppression des femmes par les hommes. Ça ne risque pas trop de faire comprendre aux hommes que c’est plutôt une restriction de notre pouvoir et marge de manœuvre qui serait nécessaire...
Ce qui m’inquiète sérieusement, c’est de voir réapparaître une revendication masculine « pro-féministe » se servant de la critique queer du sujet « femmes » pour minimaliser ou rejeter la notion de groupe social « hommes[31] », donc de l’oppression genrée. La volonté de démontrer l’existence de plusieurs axes oppressifs et la nécessité de les penser simultanément se transforment ici en négation d’une homogénéité des hommes bien matérielle et réelle vis-à-vis des femmes : violences, appropriation et exploitation hétérosexuelle / sociale, exploitation domestique, androcentrisme épistémique... Cette négation politique (qu’on avait déjà connue dans sa version marxiste pointant du doigt les fameuses femmes bourgeoises[32]) est renforcée par l’accent quasi exclusif mis par la pensée queer sur les registres d’analyse discursive, littéraire ou identitaire qui me laissent une impression de légèreté, de jeu. Où sont donc passés les fondements du féminisme ? Un jeune homme découvrant les enjeux sexe / sexualité / genre à travers une grille de lecture queer ne risque pas, à mon avis, de prendre conscience de la violence brute, fondamentale et omniprésente qu’infligent les hommes aux femmes à travers le monde. Il ne risque pas non plus de comprendre en quoi la mixité de genre est un lieu de violence permanente pour les femmes, d’où l’illusion de pouvoir participer de plain-pied aux luttes et études féministes et non depuis une position sociale et un point de vue problématiques, de dominant.
L. T.-V. : Que t’apporte le queer en tant que féministe radicale ?
S. M. : Le principal apport de la pensée queer au féminisme, à mes yeux, c’est quelle critique l’invisibilisation de la (hétérosexualité et la reproblématise. Si les théories féministes radicales ont souvent mis en évidence les liens entre l’appropriation/exploitation des femmes et la contrainte à l’hétérosexualité, il n’empêche que peu ont théorisé l’hétérosexualité comme système d’organisation sociale indétachable de l’analyse du patriarcat. Le féminisme, même radical, laisse ainsi globalement intact l’« imaginaire hétérosexuel[33] », notamment dans certaines études sur la division sexuelle du travail[34]. D’un point de vue matérialiste justement, cette manière de penser le genre — et non pas l’« hétérogenre[35] » — sans penser la sexualité, épargne trop l’idéologie et le pouvoir liés à la norme hétérosexuelle. En ce sens, je trouve le queer potentiellement inspirant sur la question de l’articulation des axes de pouvoir.
Un autre aspect qui m’a stimulée dans la pensée queer, c’est qu’elle rend attentive à « l’essentialisation toujours possible » des concepts, notamment celui de genre. Est-ce seulement parce que le mot s’y prête bien ou plutôt parce que tout concept est menacé par ce type de glissement ? Je penche pour la seconde solution. Cette critique peut donc nous servir pour traquer les distorsions et détournements de nos propres concepts. Cela recoupe une réflexion toujours utile sur la question de l’institutionnalisation du féminisme et des études genre, et sur ses biais idéologiques éventuels.
S. M. : La critique queer des politiques identitaires t’inspire-t-elle des pistes pour la question de l’identité masculine ?
L. T.-V. : Il me semble que la pensée queer et la pensée féministe matérialiste s’accordent jusqu’à un certain point sur la question sexe / genre : ni l’un ni l’autre ne sont simplement naturels, évidents, hors du champ politique et social. Si elles peuvent s’accorder sur le fait que le sexe « biologique » est une production politique permettant l’oppression des femmes à travers la hiérarchie hétérosociale / sexuelle, et que le genre n’est rien d’autre qu’une construction sociale donc transformable, elles ne semblent pas s’accorder sur les objectifs politiques de cette transformation. La pensée queer me rappelle les analyses en termes de rôles sociaux de sexe : si elle a abandonné la notion de fondement biologique, elle oblitère de façon comparable la question du pouvoir, de la hiérarchie[36] et des intérêts sociaux qui motivent l’adoption d’une identité dominante[37]. Ce n’est, par exemple, pas tant la binarité de genre qui me révolte que le fait qu’elle résulte d’actes oppressifs et s’inscrit dans un continuum de violence. À mes yeux, l’identité masculine n’est rien d’autre que la forme humaine spécifique que prend l'oppression actuelle des femmes par les hommes d’où ma relative absence d’intérêt pour une « transgression ou resignification » de l’identité masculine. Autrement dit, cela ne m’intéresse pas de voir multiplier différentes masculinités puisque celles-ci n’exprimeront que différentes façons d’exploiter et d’opprimer les femmes. Oppression sauce macho, gay, transgenre, genderfuck, vanille-S/M... ? Non merci !
Ainsi, du côté des hommes, la prise de conscience de la position sociale oppressive aboutit souvent à revendiquer une autre masculinité. Il me semble pourtant que nous avons (à l’opposé des groupes sociaux opprimés pour lesquels la revendication identitaire reste une question de survie) à faire un chemin vers le refus d’identité genrée donc l’abolition de l’identité masculine. Cette abolition ne peut d’ailleurs que passer par la mise en place d’autres rapports sociaux abolissant progressivement le genre et créant de nouveaux ingrédients relationnels humains. L’utopie du non-genre me semble d’ailleurs bien plus radicale que la création de nouvelles recettes « post-identitaires », à l'aide d’ingrédients entièrement marqués et structurés par l’oppression des femmes par les hommes.
L. T.-V. : De ton côté, comment formules-tu une critique féministe matérialiste à la théorie queer ?
S. M. : Ce qui me dérange le plus c’est que j’y vois la disparition de la question de l’oppression (genre, race, classe) et des rapports sociaux. La fluidité, voire l’irréalité du genre, et la possible dissolution des identités par la performativité visualisent le changement à partir d’actes individuels contre-culturels[38]. La critique matérialiste me paraît essentielle sur ce point : l’effet d’un détournement ou d’une réappropriation des catégories demeure limité par son contexte social et historique. Ce dernier disparaît justement de la rhétorique queer, pourtant clairement allusive à un environnement urbain nord-américain. Après un an de travail de terrain avec des femmes indiennes au Mexique, je ressens un réel malaise devant le décalage béant entre la lutte de ces femmes pour des droits fondamentaux et l’interprétation des pratiques S/M comme la fin du genre ! L’immense entrée « queer » met à plat les relations de pouvoir et les constructions divergentes de l’identité sexuelle en fonction de la race ou du genre[39]. À rejeter toute référence aux catégories et groupes sociaux, à mettre l’accent sur leur hétérogénéité et l’impossibilité de généraliser, elle entretient aussi un mythe du point de vue de « nulle part[40] » qui contribue à l’invisibilisation du pouvoir. Un autre aspect que je reproche au queer, c’est qu’il fait l’impasse sur les apports du féminisme radical et du lesbianisme radical. La déconnexion entre sexe et genre est déjà au cœur de l’analyse matérialiste d. patriarcat et nous permet de penser la variété des associations ou détournements possibles entre sexe et genre. Quant au lesbianisme radical[41], sa critique de l’hétérosexualité comme système fondamentalement interdépendant du patriarcat lui vaut une double marginalisation : dans le queer et dans le féminisme.
S. M. : La critique queer de l’hétéronormativité t’interpelle-t-elle en tant qu’hétérosexuel ?
L. T.-V. : De nouveau, c’est encore auprès des lesbiennes radicales que je continue de puiser le plus de confrontation théorique et politique. Aussi, mon travail consiste avant tout à aménager avec les femmes les relations intimes, concrètes, de telle façon que l’asymétrie de pouvoir soit amoindrie, par exemple à travers la non-cohabitation (renforçant la prise en charge symétrique du travail domestique, le non-envahissement de l’espace personnel des femmes, le choix explicite des rencontres), mais également la non-monogamie (coupant court à l’appropriation exclusive, renforçant l’indépendance affective et les alternatives relationnelles pour les femmes). Mais le lesbianisme comme stratégie politique pour l’abolition des genres exige bien plus que cet aménagement « éclairé » de l’hétérosexualité : la fin des relations hétérosexuelles en tant que telles. Or, à ce niveau, il est clair que je n’ai pas (encore ?) accepté de perdre certains privilèges en termes d’accès affectif, social et sexuel aux femmes. Mais c’est bien en ces termes politiques précis que je continue de me formuler les enjeux sexe/sexualité/genre et que la malléabilité politique des différents registres humains m’importe : l’homosexualité m’intéresse dans la mesure où elle représente une alternative à une sphère cruciale de l’oppression des femmes. Quant aux questions liées à la non-monogamie, la bisexualité, le S/M ou le travail sexuel[42], elles m’intéressent non pas en tant que « transgressions ou resignifications post-identitaires » mais comme des possibles outils de déconstruction de l’oppression des femmes dans ses dimensions sexuelles / relationnelles. Et bien que la sexualité soit un des lieux cruciaux de l’oppression des femmes, il ne faudrait pas oublier que l’oppression des femmes par les hommes est loin de se limiter à ce champ du vécu humain...
S. M. et L. T.-V. : Pour résumer, si la pensée queer nous interpelle dans sa remise en cause de l’hétéronormativité, elle nous dérange dans la mesure où :
-
1. Elle déconnecte genre de sexe, mais néglige le fait que le genre est un système politique d’organisation des humains en oppresseurs et opprimées.
-
2. Elle traite la dimension discursive de l’hétéronormativité comme fondamentale, et non ses structures sociales hiérarchiques.
-
3. Elle sur-visibilise la dimension sexuelle au détriment d’autres dimensions comme la division genrée du travail, l’exploitation domestique, etc., ainsi que les autres axes d’oppression de race, de classe, de continent...
-
4. Elle manque fondamentalement d’utopie radicale et accentue avant tout des modes d’actions individuels au détriment de modes d’action collectifs en vue de l’abolition du genre.
Notes
Le masculinisme de « La domination masculine » de Bourdieu
[Ce texte a été produit à l’occasion d’un séminaire interdisciplinaire en sciences sociales à l'École Normale Supérieure - Lettres et sciences humaines ; il a été mis en ligne en mai 2004 sur le site des « Chiennes de garde » ( http://www.chiennesdegarde.com)]
L’objet de cette intervention est de présenter quelques aspects problématiques de l’analyse produite par Bourdieu dans son livre La domination masculine, qui pourraient servir de guide de vigilance pour les hommes désirant travailler sur la question du genre. Le dénominateur commun de ces aspects pourrait être qualifié de « masculinisme ». Introduit en France par la philosophe féministe Michèle Le Dœuff, celle-ci l’a défini de la façon suivante : « ce particularisme, qui non seulement n’envisage que l’histoire ou la vie sociale des hommes, mais encore double cette limitation d’une affirmation (il n’y a qu’eux qui comptent, et leur point de vue) » (1989 p. 55). Ou avec les propres mots de Bourdieu : « Le propre des dominants est d’être en mesure de faire reconnaître leur manière d’être particulière comme universelle » (p. 69).
Deux citations[43], extraites d’un article de la linguiste féministe Claire Michard (1987 p. 137) peuvent aider à rendre concrète cette définition :
« Le village entier partit le lendemain dans une trentaine de pirogues, nous laissant seuls avec les femmes et les enfants dans les maisons abandonnées » (Claude Lévi-Strauss)
« Encore aujourd’hui une des raisons pour lesquelles les adolescents des classes populaires veulent quitter l’école et entrer au travail très tôt, est le désir d’accéder le plus vite possible au statut d’adulte et aux capacités économiques qui lui sont associées : avoir de l’argent, c’est très important pour s’affirmer vis-à-vis de copains et avec les filles, donc pour être reconnu et se reconnaître comme “un homme” » (Pierre Bourdieu)
J’utiliserai pour ma part la notion de masculinisme de la façon suivante : « le masculinisme consiste à produire ou reproduire des pratiques d’oppression envers les femmes — quel que soit le domaine d’action — et ce à partir de la masculinité la position vécue de domination selon l’axe de genre. »
En quoi consisterait ce masculinisme théorique à la Bourdieu ? Quelques éléments à partir de l’excellente analyse effectuée par Nicole-Claude Mathieu dans « Bourdieu ou le pouvoir auto-hypnotique de la domination masculine » (1999).
-
1. Ignorance, méconnaissance, déformation, sélection, citation erronée[44] d’analyses féministes sur le sujet
Bourdieu, entre autres, ignore le travail théorique fondateur effectué par des théoriciennes féministes francophones[45], telles que Christine Delphy, Colette Guillaumin, Paola Tabet, Nicole-Claude Mathieu ou Monique Wittig, dont il semble considérer l’approche théorique comme relevant d’un « matérialisme primaire ». Ces théoriciennes ont pourtant contribué de façon centrale à rendre possible une analyse critique innovante des rapports sociaux de sexe. Selon l’anthropologue Nicole-Claude Mathieu, ce qui motive ce traitement c’est probablement le fait que ces théoriciennes « ne se cachent pas d’être féministes » (1999 p. 291), et pourrait donc être analysé comme relevant d’un anti-féminisme sélectif. Selon la philosophe Françoise Armengaud, il s’agit d’« un coup sciemment porté aux tendances les plus sociologiques de la recherche féministe et les plus radicales du mouvement des femmes » (in Mathieu, 1999 p. 293).
Cette pratique n’est pas propre à Bourdieu, elle caractérise à mon avis bon nombre de travaux produits par les membres du groupe dominant dont les écrits témoignent de leur ambiguïté profonde à l’égard du féminisme, en particulier le féminisme matérialiste et radical. Elle ne se limite pas à rendre invisibles les études féministes, donc le travail des féministes, donc des femmes (ce qui relève du sexisme classique), mais consiste globalement à refuser de prendre en compte réellement et honnêtement le travail théorique effectué par les femmes, en particulier lorsque celles-ci s’inscrivent dans une démarche féministe. Elle s’apparente à la dynamique politique d’exploitation domestique des femmes dans la mesure où ces auteurs masculins approprient sélectivement les savoirs produits par les femmes, en modifient le sens et la portée politique afin de les redéployer selon un propre ordre du jour, en bénéficiant des retombées positives — symboliques et matérielles—de leurs productions et en omettant de rendre visible le travail de ces femmes. Selon Nicole-Claude Mathieu : « on peut se demander s’il ne s’agit pas [...] d’une démonstration particulièrement voyante de la domination masculine, qui redouble l’oppression des femmes par la suppression ou la distorsion de leurs expériences et de leurs analyses » (1999 p. 298).
-
2. Méconnaissance des enjeux violents de la réalité genrée et de ses rapports de force.
Bourdieu privilégie dans son livre l’analyse de la dimension symbolique de la domination masculine. En soi, cela n’est pas un problème, sauf qu’il ne l’annonce pas explicitement, en particulier dans le titre, et que tout laisse à penser qu’il semble toujours considérer — comme dans son article de 1990 — que cette dimension symbolique « fait l’essentiel de la domination masculine ». En témoigne cette affirmation : « la position particulière des femmes sur le marché des biens symboliques explique l’essentiel des dispositions féminines » (p. 106).
Il évacue de cette façon ce qui a fait l’objet de la majorité des analyses féministes et qui est essentiel à une compréhension adéquate des rapports sociaux de sexe, en particulier sa dimension symbolique : l’analyse des aspects matériels centraux de l’oppression des femmes par les hommes tels que l’exploitation domestique des femmes (Delphy) donc leur exclusion de la vie publique ; l’appropriation masculine des outils complexes, des armes et de la violence (Tabet) ; l’appropriation donc l’exploitation sexuelle des femmes (Guillaumin, Tabet) ; le monopole masculin sur la production de savoir et son déploiement masculiniste (Le Dœuff, Mathieu) ; l’organisation hétérosexuelle des rapports humains (Wittig)... En méconnaissant la dimension matérielle[46], Bourdieu pense, à mon avis, mal le lien entre dimension matérielle et symbolique, ce qui l'amène à faire peser le poids politique sur les femmes, sur ce qu'elles devraient faire ou ne pas faire pour éviter la continuation de la violence symbolique et non sur les hommes, qui disposent pourtant d’une bien plus grande marge de manœuvre symbolique et matérielle pour agir sur les rapports sociaux de sexe.
De nouveau, Bourdieu n’a pas le monopole sur cette pratique. Bon nombre de membres du groupe dominant travaillant sur ce sujet ignorent, minimalisent, sous-estiment le poids des pratiques matérielles oppressives sur le vécu des femmes, et échouent ainsi à penser les dimensions matérielles et symboliques des rapports sociaux de sexe, et leur interaction. La démarche critique de ces hommes consiste paradoxalement, et je cite les sociologues féministes Huguette Dagenais et Anne-Marie Devreux, à « [éviter] de se confronter au rapport avec l’autre sexe et à la réalité de ce rapport » (1998 p. 11).
Or ce geste d’évitement permet à ces auteurs de faire au moins une double économie psycho-politique : celle qui consiste à ne pas reconnaître pleinement les violences structurelles et individuelles que les pairs masculins infligent aux femmes ; celle qui consiste à ne pas quitter une approche avant tout intellectuelle des rapports sociaux de sexe au bénéfice d’une approche intégrant intellect et affect de façon non-biai-sée, c’est-à-dire en ne privilégiant pas les affects des hommes sur ceux des femmes. En effectuant ce geste d’évitement, ces hommes nourrissent également leur identification positive et leur attachement à la masculinité.
-
3. Vision euphémique, dépolitisée et symétrisée des rapports sociaux de sexe.
Assez logiquement, lorsqu’on méconnaît la dimension matérielle des rapports sociaux de sexe, on en arrive à décrire les raisons de l’existence et de la continuation de l’oppression des femmes par les hommes comme ne relevant pas avant tout d’actes violents concrets, s’inscrivant dans une structure sociale hiérarchisée. Actes de la part des hommes, motivés par le maintien de bénéfices matériels et symboliques, conscients[47] de leur position vécue de domination vis-à-vis des femmes et s’appuyant sur une expertise politique genrée élaborée à travers les différentes expériences vécues. Il est donc logique, lorsqu’on développe une vision aussi désincarnée des rapports sociaux de sexe, de mettre l’accent sur une incorporation « comme par magie », « comme par enchantement », « en deçà de la conscience et de la volonté » du principe androcentrique institué dans l’ordre des choses — plutôt que sur la prédominance des violences masculines, symboliques, matérielles et physiques. De façon comparable on mettra l’accent, et je cite Bourdieu, sur : « Le pouvoir symbolique ne peut s’exercer sans la contribution de ceux qui le subissent et qui ne le subissent que parce qu’ils le construisent comme tel » (p. 46), c’est-à-dire sur la responsabilité, l’adhésion ou le consentement des membres du groupe dominé vis-à-vis de leur oppression. En effet, seule la prise en compte de l’influence de la dimension matérielle sur la dimension symbolique permet d’envisager comme question principale la participation des hommes à l’oppression des femmes et non celles des femmes à leur propre oppression. Et Bourdieu de poser ensuite : « les victimes de la domination symbolique peuvent accomplir avec bonheur (au double sens) les tâches subalternes ou subordonnées [...] » (p. 64)
Cette vision désincarnée[48], qui ne pense pas les rapports violents agis par les hommes concrets et leurs effets sur les femmes concrètes, mène alors logiquement à une vision symétrisée des rapports sociaux de sexe où hommes et femmes sont, et je cite Nicole-Claude Mathieu, « quoique différemment quand même, dominées par la domination ». En effet, Bourdieu semble penser le lien entre structure genrée et position vécue de façon relativement symétrique : « Si les femmes, soumises à un travail de socialisation qui tend à les diminuer, à les nier, font l'apprentissage des vertus négatives d’abnégation, de résignation et de silence, les hommes sont aussi prisonniers, et sournoisement victimes, de la représentation dominante » (p. 55).
-
4. Victimisation et déresponsabilisation des hommes
Cela nous permet de pointer un quatrième aspect du masculinisme théorique de Bourdieu, mais qui caractérise également bon nombre des écrits à ce sujet de la part de membres du groupe dominant : la victimisation et la déresponsabilisation[49] des hommes. Selon Bourdieu, le privilège masculin serait également un piège imposant à chaque homme le devoir d’affirmer en toute circonstance sa virilité. Ce devoir de « virilité entendue comme la capacité reproductive, sexuelle et sociale mais aussi l’aptitude au combat et à l’exercice de la violence est avant tout une charge » (p. 57), celle d’être toujours à la recherche d’accroître son honneur dans la sphère publique. La virilité deviendrait ainsi un idéal impossible, « le principe d’une immense vulnérabilité ». Les dominants seraient donc
« obligés » d’appliquer à leur corps, leur être et leurs actes les schèmes de l’inconscient engendrant « de formidables exigences » (p. 76). L’expérience masculine de la domination et ses contradictions serait alors à décrire comme « une sorte d’effort désespéré, et assez pathétique (...) que tout homme doit faire pour être à la hauteur de son idée enfantine de l’homme » (p. 76).
L’homme est selon Bourdieu, « gouverné », « dirigé », « guidé » par l’honneur, qui serait « une force supérieure ».
Outre la charge affective forte marquant ces descriptions du vécu masculin[50] —charge dont ses descriptions du vécu féminin sont dénuées, ce qui est révélateur d’un androcentrisme affectif - il est à noter que Bourdieu se sert — de façon peu cohérente d’ailleurs[51]— de la distinction entre virilité et masculinité, de telle façon à concentrer dans la virilité ce qui serait source de domination des femmes, et source d’aliénation des hommes (on note de nouveau la vision symétrique), lui permettant de maintenir la masculinité comme positive. Or, de cette façon, il ignore de nouveau les apports des analyses féministes matérialistes qui pensent les rapports sociaux de sexe comme relevant d’une construction sociale de la domination, où le genre précède le sexe, c’est-à-dire où les pratiques d’oppression produisent la hiérarchisation qui elle-même donne lieu à la division en masculin et féminin. Comme l’indique la sociologue féministe Christine Delphy : « le masculin et le féminin sont les créations culturelles d’une société fondée, entre autres hiérarchies, sur une hiérarchie de genre » (1991 p. 98).
Et si nous voulons penser une société débarrassée de l’oppression des femmes par les hommes, il faut, selon Delphy, être capable de penser le non-genre. C’est-à-dire, pour revenir à Bourdieu, qu’il ne s’agit pas tant de sauvegarder la masculinité en la distinguant de la virilité, mais bien de tenter de penser l’abolition même de la masculinité en tant que subjectivité et pratique d'oppression.
Note épistémologique finale
Pour finir, Bourdieu semble refuser toute considération de l’influence des circonstances historiques-matérielles sur la façon dont les hommes pensent les rapports sociaux de sexe et c’est là, à mon avis, la clef principale de compréhension de son masculinisme théorique. 11 considère l’idée féministe selon laquelle être un homme, ne pas vivre l’expérience des femmes, serait un obstacle à l’analyse scientifique comme une manière d’« importer dans le champ scientifique la défense politique des particularismes qui autorise le soupçon a priori, et mettre en question l’universalisme qui, à travers notamment le droit d’accès de tous à tous les objets, est un des fondements de la République des sciences » (p. 123)[52].
On retrouve dans cet argument une logique bien masculine d’appropriation, de droit d’accès qui rappelle le droit d’accès sexuel et d’appropriation des hommes à toutes les femmes ; de plus, il ne s’agit pas tant de droit d’accès mais des modalités et des possibilités d’accès à un objet de savoir. En revanche, et cela témoigne de nouveau du masculinisme théorique de Bourdieu, il semble défendre une vision épistémologique opposée lorsqu’il aborde la place des homosexuels dans la re-cherche[53] puisqu’il affirme alors : « les homosexuels sont particulièrement armés pour (...) réaliser [le travail de destruction et de construction symbolique visant à imposer de nouvelles catégories de perception et d’appréciation] et ils peuvent mettre au service de l’universalisme, notamment dans les luttes subversives, les avantages liés au particularisme » (1998, p. 134)[54].
Il me semble en effet que le point de départ de toute analyse des rapports sociaux de sexe à partir d’une position vécue masculine devrait consister à prendre pleinement conscience des implications épistémologiques, psychologiques et affectives du fait d’être présent au monde à partir d’une position socio-politique particulière, celle de dominant selon l’axe de genre (et de sexualité). Ou, avec les propres mots de Bourdieu[55]-lorsqu’il critique Nicole-Claude Mathieu et qu’il parle des femmes et de leurs limitations et incapacités — il s’agit de pousser « jusqu’au bout l’analyse des limitations et des possibilités de pensée et d’action » (p. 47), mais cette fois-ci propres au vécu matériel et symbolique masculin.
Bibliographie de la communication et pistes de lecture
Bourdieu, Pierre (1998). La domination masculine., Paris : Seuil.
Dagenais, Huguette et Anne-Marie Devreux (1998), « Les hommes, les rapports sociaux de sexe et le féminisme : des avancées sous le signe de l’ambiguïté ». Nouvelles Questions Féministes, 19 (2-3-4), 1-22.
Delphy, Christine (1991). « Penser le genre : quels problèmes ? », in Marie-Claude Hurtig, Michèle Kail et Hélène Rouch (dir.), Sexe et genre. De la hiérarchie entre les sexes, Paris, Ed. CNRS, pp. 89-101.
Delphy, Christine (1998). L’ennemi principal. 1. Économie politique du patriarcat. Paris : Syllepse.
Delphy, Christine (2001). L’ennemi principal. II. Penser le genre. Paris : Syllepse.
Guillaumin, Colette (1992). Sexe, race et pratique du pouvoir. L'idée de nature. Paris : Côté-Femmes.
Hartsock, Nancy (1998). The feminist standpoint revisited & other essays. Westview : Oxford.
Le Doeuff, Michèle (1989). L'étude et le rouet. 1. Des femmes, de la philosophie, etc. Paris : Seuil.
Le DoeufF, Michèle (1998). Le sexe du savoir. Paris : Flammarion.
Mathieu, Nicole-Claude (1991). L’anatomie politique. Catégories et idéologies du sexe. Paris : Côté-Femmes.
Mathieu, Nicole-Claude (1999). « Bourdieu ou le pouvoir auto-hypnotique de la domination masculine »,Les Temps Modernes, n° 604, pp. 286-324.
Michard, Claire (1988). « Les valeurs sémantiques « humain » et « humain mâle », in Catherine Fuchs (dir.), L'ambiguïté et la paraphrase, Centre de publications de l’université de Caen, 1988, 135-138.
Michard. Claire (1982). Sexisme et sciences humaines : pratique linguistique du rapport de sexage (en collab. avec Claudine Ribéry). Lille : Presses universitaires de Lille.
Michard, Claire (2002). Le Sexe en linguistique : sémantique ou zoologie ? 1, Les analyses du genre lexical et grammatical des années 1920 aux années 1970. Paris : L’Harmattan.
Pheterson, Gail (2001). Le prisme de la prostitution, Paris : L’Harmattan.
Tabet Paola (1987). « Du don au tarif. Les relation sexuelles impliquant une compensation », Les Temps Modernes, n° 490, pp. 1-53.
Tabet Paola (1991). « Les dents de la prostituée : échange, négociation, choix dans les rapports économico-sexuels », in Marie-Claude Hurtig, Michèle Kail et Hélène Rouch (dir.), Sexe et genre. De la hiérarchie entre les sexes, Paris, Ed. CNRS, pp. 227-244.
Tabet, Paola (1998). La construction sociale de l'inégalité des sexes. Des outils et des corps. Paris : L’Harmattan.
Tabet, Paola (2001). « La grande arnaque. L’expropriation de la sexualité des femmes », Actuel Marx, n° 30, pp. 131-152
Wittig, Monique (2001). La Pensée Straight. Paris : Balland.
Notes
Culpabilité personnelle et responsabilité collective : le meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat comme aboutissement d’un processus collectif
[Cet article est la retranscription d'une intervention dans l'atelier féministe (intitulé « Du crime d’honneur à la violence masculine en passant par le crime passionnel ») au colloque Marx international IV en octobre 2004. L'intervention de Léo avait alors pour titre « Lorsque l'exception confirme la règle ».]
Lorsque, le 27 juillet 2003, Bertrand Cantat a décidé de frapper - à mort — Marie Trintignant, il a engagé sa responsabilité individuelle pour les conséquences de ses actes — quels que puissent être ensuite ses discours de déni, de reconnaissance partielle, de projection de responsabilité ou de pleine re connaissance et éventuelle demande de pardon. Si cette dimension subjective, individuelle de la reconnaissance de culpabilité peut être importante pour les personnes proches de Marie Trintignant et la façon dont celles-ci pourront vivre ce meurtre, elle n’évacue évidemment ni la culpabilité individuelle de Cantat, ni la dimension de responsabilité collective pour ce meurtre. J’entends par responsabilité collective le fait que les actes de Cantat peuvent évidemment être analysés comme reflétant son investissement dans la masculinité hétérosexuelle, c’est-à-dire l’investissement subjectif par un humain d’un certain registre de pratiques de soi et des autres, sources de bénéfices structurels considérables. Les actes de Cantat révèlent ainsi le degré de résistance et/ou de complaisance que celui-ci a au préalable développé face à cette socialisation masculine hétérosexuelle. Plus spécifiquement, les actes de Cantat peuvent également être analysés comme le produit d’une socialisation masculine spécifiquement de gauche radicale. Et c’est en tant que pratique d’une masculinité hétérosexuelle engagée à gauche que les actes de Cantat peuvent collectivement interroger les hommes hétérosexuels de la gauche radicale.
Lorsque, en tant qu’homme hétérosexuel engagé à gauche, on commence à s’intéresser aux rapports sociaux de sexe — en particulier à travers la grille d’analyse féministe radicale — on est très rapidement confronté à l’absence d’une pratique de la responsabilité individuelle et/ou collective au sein de la gauche radicale. La socialisation de gauche implique souvent une projection de ce qui pose problème dans un autre abstrait (le système capitaliste, l’État, les multinationales) ou dans un autre concret (les patrons, les politiciens, les policiers). La rencontre avec le féminisme donne alors souvent lieu à une intégration de la critique féministe selon ce même mode : l’autre abstrait devient le système patriarcal, la socialisation genrée, l’autre concret, les machos, les violeurs. Cette culture politique désincarnée empêche alors souvent ces hommes de jeter un regard politique sur leurs propres pratiques, sur celles au sein de leurs propres collectifs ou organisations et sur celles au sein de leurs vies personnelles. Or cette culture politique désincarnée a une fonction politique précise : le maintien d’une culture politique masculine, c’est-à-dire servant les intérêts et les subjectivités des hommes hétérosexuels de gauche. Cette masculinisation de l’engagement de gauche est donc simultanément une hétérosexualisation : les représentations et pratiques prédominantes de la gauche radicale n’interrogent pas l’organisation hétérosexuelle des rapports sociaux et reconduisent la distinction classique entre vie privée et vie publique. Cette culture politique contribue donc à produire une masculinité hétérosexuelle qui ne s’interroge pas, qui ne doute pas de soi et surtout qui ne tolère pas le fait d’être interrogée par des membres de groupes sociaux subordonnés sur ce qui pose problème dans ses actes, autant au sein de la sphère privée que publique.
L’absence d’une culture de responsabilité, de retours politiques critiques sur soi (ses pratiques, ses émotions, ses désirs, ses objectifs) toujours justifiée au nom d’une cause considérée seule politiquement légitime permet, entre autres, à ces hommes de construire un sentiment moral de puissance, d’intégrité, d’authenticité individuelle devenues synonymes de capacité à agir politiquement sur le monde. Or c’est précisément parce que l’interrogation féministe (en particulier sur le mode « le privé est politique ») bloque ce sentiment moral d’intégrité et d’authenticité, et qu’elle introduit une perception contradictoire de soi comme entre autres négatif, destructeur, violent et égoïste... que les hommes de gauche refusent majoritairement une lecture politique incarnée des rapports sociaux de sexe. S’intégrer soi à cette lecture comme faisant profondément et structurellement partie du problème semble être vécu comme incompatible avec l’engagement politique radical : on ne pourrait et faire partie du problème et vouloir contribuer à sa résolution. Adopter une perception de soi qui est négative et positive et qui oblige avant tout à dé-placer la question vers les pratiques et leurs conséquences politiques sur la vie des autres semble alors devenir synonyme de psychologisation, de dépolitisation, de culture chrétienne / stalinienne de culpabilité - ce qui est paradoxal puisque cette culture de l’irresponsabilité sert précisément à sauvegarder un sentiment moral d’intégrité et d’authenticité.
L’analyse féministe des rapports sociaux de sexe invite en effet les hommes à se percevoir comme faisant profondément partie du problème, comme constituant un obstacle structurel à une société égalitaire. Elle invite les hommes à se percevoir non tant comme des individus mais avant tout comme des membres d’un groupe social, grandement dépourvus d’individualité. La réaction masculine courante à l’interrogation féministe consiste alors à dire : « Oui, mais moi je suis différent. D’ailleurs, je l’ai demandé à ma copine, et moi je ne suis pas comme ça. Je vous l’assure, je fais bien la vaisselle. »
Un enjeu central d’une lecture anti-masculiniste incarnée des rapports sociaux de sexe consiste alors, à mon avis, bien au contraire à se dire : « J’ai beaucoup plus de choses en commun avec Bertrand Cantat que de différent. Les actes meurtriers de Cantat en disent beaucoup plus sur ma façon de vivre et d’agir que je ne veux bien reconnaître. »
C’est en effet lorsqu’ils acceptent de se percevoir comme partie intégrante d’une réalité sociologique oppressive que les hommes de gauche peuvent commencer (à l’aide des analyses féministes) à interroger cette réalité depuis leur position vécue, puis à transformer leur façon d’agir et celle de leurs pairs. Il s’agit donc de relire leur vécu et leurs pratiques à travers l’hypothèse que ceux-ci relèvent plus souvent de l’oppression que non plutôt que d’effectuer une telle relecture en postulant une rupture qualitative avec « les machos ».
C’est entre autres dans ce sens qu’un collectif de féministes participant à un séminaire international sur le genre à Budapest en 1997, avait refusé comme réponse unique l’exclusion d’un homme qui avait violé une femme pendant ce séminaire : elles demandaient à tous les hommes présents de relire leurs comportements et vécus en postulant cette continuité oppressive, refusant ainsi que le « problème patriarcal » soit projeté de façon déresponsabilisante sur l’homme violeur. Elles exigeaient que les hommes — en tant que membres d’un groupe social - effectuent un travail critique personnel et collectif sur leur propre participation à l’oppression des femmes et rendent concrètement accessibles, c’est-à-dire par écrit, les retours critiques sur leurs propres comportements et ce qui avait selon eux rendu possible ce viol. Si cette dynamique critique avait partiellement eu lieu (et uniquement de par la demande répétée de la part de ces féministes), elle avait surtout confirmé l’absence de culture critique chez les hommes de la gauche radicale, même « antisexistes ». En France, c’est également l’absence voire le refus collectif de retour critique sur la masculinité hétérosexuelle de gauche radicale qui avait renforcé un décalage politique genré lors d’un camping anti-patriarcal en 1995 au sein de la gauche libertaire, d’ailleurs également marqué par des violences masculines contre des participantes.
Il semble donc que ce refus masculin et/ou cette incapacité masculine à développer un regard critique sur les pratiques oppressives vis-à-vis des femmes fassent partie intégrante d’une culture politique de gauche associant automatiquement ce type de travail politique à une pratique stalinienne et/ou chrétienne de culpabilité. La difficulté actuelle de penser la façon dont le « je » masculin hétérosexuel est pleinement structuré par un « nous » oppressif peut, à mon avis, être éclairée à travers les notions de culpabilité personnelle et responsabilité collective. Cette démarche est inspirée d’une conférence donnée par la philosophe féministe serbe Dasa Du-hacek sur la notion de responsabilité collective dans le contexte de l’ex-Yougoslavie, et ce à partir du travail théorique de Hannah Arendt.
Selon Arendt, la notion non-politique de culpabilité s’applique à des personnes et est fonction directe de leurs actes : dans ce sens, Bertrand Cantat est seul coupable de ses actes meurtriers au sens légal et moral. La notion de responsabilité collective, par contre, fait référence à un registre politique et est fonction de l’appartenance à une communauté sociopolitique. Ce qui distingue la responsabilité collective, c’est le fait que celle-ci est indirecte (vicarious) et involontaire : elle concerne donc des choses que la personne citoyenne n’a pas faite elle-même et elle résulte d’une appartenance non-choisie (au sens plein du terme) à une communauté politique. L’idée d’une responsabilité collective peut alors être comprise comme l’obligation politique d’appréhender les charges autant que les bénéfices liés à l’appartenance à un groupe sociopolitique précis. Pour citer Arendt[56] : « This vicarious responsibility for things we have not done, this taking upon ourselves the consequences for things we are entirely innocent of, is the price we pay for the fact that we live our lives not by ourselves but among our fellow men, and that the faculty of action, which, after all, is the political faculty par excellence, can be actuali-sed only in one of the many and manifold forms of community » (1987 : 50).
Or une des resistances récurrentes à cette notion de responsabilité collective provient paradoxalement du fait qu’elle n’est pas entendue comme notion politique mais comme notion morale : ceux-là même qui rejettent le travail politique féministe en agitant l’épouvantail de la culpabilité chrétienne et/ou stalinienne, refusent de voir la façon dont leur position vécue et leur pouvoir d’action sont sociologiquement fonction de leur appartenance à un groupe social. De nouveau, la vision désincarnée règne : si les hommes hétérosexuels de la gauche radicale sont généralement bien obligés de reconnaître les privilèges structurels de genre dont ils bénéficient, ils refusent de voir non seulement la façon dont eux-mêmes participent à cette reproduction de l’inégalité de genre mais également la façon dont ces privilèges sont une production collective de la part de leur groupe sociopolitique, préférant maintenir leur attachement à un sentiment moral d’intégrité.
Or lorsqu’on tente de développer un regard critique anti-masculiniste sur sa position vécue et ses actes, de nouveau la distinction entre culpabilité personnelle et responsabilité collective est pertinente. Si la grille de lecture féministe permet d’identifier les actes pour lesquels la responsabilité personnelle et directe est bien en jeu, comme l’exploitation domestique, les violences physiques et sexuelles ou l’instrumentalisation des femmes... elle accentue également la dimension collective, institutionnelle et structurelle des rapports sociaux de sexe, c’est-à-dire ce en quoi l’appartenance sociopolitique à la masculinité hétérosexuelle peut être lue comme une absence d’individualité. Et la dimension politique de la responsabilité collective permet alors de ne pas penser ce dernier registre en termes de culpabilité collective - ce qui donne lieu à des sentiments moraux foncièrement axés sur soi-même donc non politiques — mais comme exigeant justement « une transcendance de l’état subjectif individuel », un décentrement de soi vers les autres qui passe avant tout par l’action politique, dans la sphère privée et publique.
Développer un regard politique sur la responsabilité collective corrélée à l’appartenance à la masculinité hétérosexuelle implique donc avant tout de s’intéresser au monde où les actes sont commis et aux conséquences de ces actes pour les humains n’appartenant pas à ce groupe sociopolitique, et non de s’arc-bouter sur un sentiment moral d’intégrité et d’authenticité. Il implique d’agir aujourd’hui sur les conditions qui ont rendu possible la décision de Bertrand Cantat de porter des coups meurtriers contre Marie Trintignant, en particulier les conditions liées à son appartenance à la gauche radicale. C’est dans ce sens qu’il est à mon avis possible de parler du meurtre de Marie Trintignant comme étant également un aboutissement d’un processus collectif impliquant une responsabilité collective spécifique.
Note
Annexe
La fin d’un tabou à l’université
[Ce texte, co-signé avec Laure Berini, Coline Cardi, Marylene Lieber et Céline Peyraud, a été publié dans Le Monde le 7 mars 2002. Nous les remercions pour leur autorisation à re-publier cet article. Concernant l’évolution juridique sur le harcèlement sexuel, se référer à l’Association Européenne contre les Violences Faites aux Femmes au Travail (www.avft.org). ]
La pétition lancée par notre collectif d'étudiant-e-s, CLASCHES (Collectif de lutte anti-sexiste contre le harcèlement dans l'enseignement supérieur), a recueilli à ce jour plus de onze cents signatures d'étudiant-e-s, d'enseignant-e-s, de cher-cheur-e-s, de personnels administratifs issu-e-s de diverses disciplines et de multiples institutions de l’enseignement supérieur. Un tel écho révèle qu'un débat sur le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur est aujourd'hui possible. Nous nous réjouissons que ce débat public soit, depuis quelques semaines, enfin ouvert. Toutefois, la chronologie médiatique, qui fait coïncider notre pétition et la seule plainte pour harcèlement sexuel déposée à ce jour par une étudiante (Le Monde du 2 février), instaure un climat de confusion entre notre mobilisation collective et cette plainte.
Nous déplorons que, dans plusieurs articles récents, les revendications générales du CLASCHES soient déformées et réduites, plus ou moins explicitement, à une mobilisation autour d'un cas particulier. Le caractère nouveau et exceptionnel de cette plainte ne doit pas faire oublier la récurrence du phé-
nomène, autant que les cas dont nous avions connaissance avant de lancer notre mouvement, et ceux qui nous ont été communiqués depuis. Il nous semble opportun de rappeler que les enjeux d’une action collective contre le harcèlement sexuel sont académiques, et non personnels. Cette confusion dans le traitement des informations traduit les résistances qui contribuent à occulter le caractère social du harcèlement sexuel et en dénient l'importance.
Notre objectif est de mettre en évidence le tabou qui pèse sur le harcèlement sexuel, le manque d'information et l'absence de dispositifs institutionnels qui permettraient d'identifier, de prévenir et de sanctionner les cas de harcèlement sexuel dans les universités et les écoles supérieures françaises. En tant qu'étudiant-e-s, il est de notre responsabilité de mettre au jour l'existence de telles pratiques, trop souvent assourdies ou étouffées par l’institution elle-même. Aujourd'hui, il est nécessaire que tous les acteurs de l'enseignement supérieur s'approprient cette question pour que des mesures concrètes soient mises en œuvre. Nous réaffirmons ici notre volonté de permettre au débat de s'engager dans des voies constructives.
L'université n'est ni plus ni moins propice qu'un autre lieu au harcèlement sexuel. Comme dans l'ensemble de la société, les lois de 1992 (art. 222-33 du code pénal) et de 2002 (Loi 2002-73 du 17 janvier « de modernisation sociale ») doivent pouvoir y être appliquées.
Le harcèlement sexuel est une forme, parmi d'autres, d'abus de pouvoir. Lorsqu'un-e enseignant-e, afin d'obtenir des
contreparties de nature sexuelle de la part de son-sa subordonnée, lui promet une situation plus avantageuse, lui inflige une sanction en cas de refus, il-elle ne se situe pas nécessairement dans une logique de séduction, mais abuse de toute évidence de sa position d’autorité. Même si, le plus souvent, cette relation ne s'inscrit pas dans un rapport salarial, nul ne peut ignorer la relation de dépendance des étudiant-e-s vis-à-vis des enseignant-e-s (bourses ou allocations, lettres de recommandation, renouvellement d'un contrat d'enseignement, intégration dans des équipes de recherche, etc.). Or divers éléments favorisent l'utilisation abusive du pouvoir conféré par la position hiérarchique.
La proximité intellectuelle dans la relation pédagogique est un élément qui brouille les cartes de la subordination. Les étudiant-e-s peuvent être tenté-e-s de l'oublier pour mieux s'intégrer au milieu universitaire. C'est particulièrement vrai des doctorant-e-s, qui sont, potentiellement, les futur-e-s collègues de leurs professeur-e-s.
En outre, l'absence d'instances disciplinaires statuant sur les cas de harcèlement sexuel induit un véritable déni de justice. Tous les acteurs de l'université ne sont pas sur un pied d'égalité. Négliger l'importance de tels recours revient donc à priver les étudiant-e-s du droit de dire non. Il ne s'agit pas de réprimer des désirs ou d’orchestrer une quelconque chasse aux sorcières, mais de permettre à chacun-e un consentement ou un refus sans équivoque.
Nous avons adressé une lettre ouverte au ministre de l'éducation nationale, consultable sur notre site. En réponse, M. Lang nous a adressé une lettre de soutien. Il y inscrit la lutte contre le harcèlement sexuel dans une volonté affirmée de rompre avec les abus de pouvoir et le sexisme dans l'enseignement supérieur. Nous avons également sollicité la Conférence des présidents d'université (CPU), la présidence du CNRS, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) et les syndicats d'étudiants et d'enseignants. Une journée d'étude impliquant tous les acteurs de l'enseignement supérieur est prévue.
Nos propositions suivent trois orientations principales :
- Pour remédier à la loi du silence, nous insistons sur l'importance d’une politique de prévention du harcèlement sexuel par le biais de brochures et d'affichage.
- Les instances de régulation des litiges déjà existantes à l'intérieur de l'enseignement supérieur (section disciplinaire des conseils d'administration et le CNESER) doivent prendre en compte sans ambages la question du harcèlement sexuel, en devenant des lieux d'écoute et de conseil qui accordent de la considération à la parole des victimes, en permettant un traitement préventif des cas avant l'exacerbation des conflits, et, le cas échéant, en appliquant les sanctions disciplinaires actuellement en vigueur (art. 29-1 et 29-2 ajoutés à la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984). Afin que ces instances de recours soient fiables, transparentes et efficaces, il faut en aménager le fonctionnement et la composition (intégrer une véritable représentation étudiante ainsi qu'une représentation paritaire hommes-femmes et nommer des mandataires compétents sur la question et indépendants des deux parties).
- Puisque le harcèlement sexuel est une forme d'abus de pouvoir dans la relation entre étudiant-e-s et enseignant-e-s, il est aujourd'hui plus que nécessaire de soumettre au débat le statut des étudiant-e-s. Afin de préserver la qualité de la relation pédagogique, il importe de clarifier les attentes, les droits et les devoirs de chacun-e au sein du système universitaire. En effet, le harcèlement sexuel risque d'autant plus de sévir que la situation des étudiant-e-s sera plus floue et plus précaire. La réflexion que nous appelons de nos vœux ne saurait donc isoler la question spécifique du harcèlement sexuel du cadre plus général de dépendance dans lequel elle s'inscrit. Notre action vise à en finir avec le déni de justice que la loi du silence impose depuis trop longtemps aux victimes de harcèlement sexuel, et à favoriser l'émergence de leur parole. Notre fonction n'est toutefois pas de parler en leur nom. Le harcèlement sexuel est un problème social auquel nous souhaitons apporter des réponses collectives : trop souvent les victimes de harcèlement sexuel se voient renvoyées à leur propre psychologie, par une inversion de l'ordre des causes et des conséquences.
CLASCHES ne propose ni une plaidoirie ni une thérapie, mais une réflexion politique sur le monde universitaire auquel nous appartenons. Pour préserver des relations pédagogiques de confiance, il est impératif de résoudre collectivement le problème du harcèlement sexuel en tant qu'abus de pouvoir.
Nous espérons, par ce texte, mettre un terme à la confusion entre les revendications de CLASCHES et un cas particulier qui focalise l’attention des médias. Cette confusion nous expose au soupçon d’être manipulé-e-s, instrumentalisé-e-s par les un-e-s ou les autres, niant ainsi notre autonomie de pensée, voire notre existence même. Or dénier aux étudiant-e-s le droit de penser et d’agir publiquement procède de la même logique que celle qui ignore la parole des étudiant-e-s victimes de harcèlement. Refuser notre indépendance de pensée et éluder notre autonomie d'action, c’est vouloir nous garder dans un état de sujétion, ce même état qui favorise le silence autour du harcèlement sexuel. Les réactions qui se font entendre aujourd’hui montrent assez la nécessité de rompre le silence.
Humaniste, pédocriminalité et résistance masculiniste
[Cet article a été écrit fin octobre et mis en ligne en novembre 2004 sur le site Sisyphe (http://sisyphe.org). Bien qu’essentiellement informatif concernant divers acteurs du masculinisme, nous avons jugé important de le rééditer car, malgré les monstruosités défendues par Hubert Van Gijseghem, celui-ci continue d’être régulièrement invité dans des facultés de psychologie.]
Le jeudi 21 octobre 2004, en parallèle au débat « Les résistances des hommes au changement » organisé par Les Cahiers du Genre à l’IRESCO, avait lieu une séance de formation à la résistance au changement. En effet, ce même jour, Le Journal du Droit des Jeunes — Revue d’action juridique et sociale — organisait de nouveau à Paris, à [’Espace Reuilly, une journée de formation avec M. Hubert Van Gijseghem, psychologue belgo-canadien, promoteur en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg... de thèses dénoncées par de nombreuses personnes et associations luttant contre la violence faite aux enfants et aux femmes par les hommes.
Ainsi, l’Association pour la formation à la protection de l’enfance, (AFPE) dans un texte intitulé « Contre l’abus de silence », s’inquiétait en 1998 :
« Nous nous étonnons de l’audience que Monsieur Hubert Van Gijseghem rencontre depuis quelques années, et nous nous étonnons particulièrement de la place quasi-promotionnelle que le Journal du Droit des Jeunes lui consacre. Nous pensons que l’esprit du Journal du Droit des Jeunes et la thèse de Monsieur Van Gijseghem ne sont pas compatibles. Autrement dit, nous pensons que le droit de se taire quand on vous détruit n'est pas un droit, mais le triomphe ironique et cruel du système agresseur. »
L’AFPE poursuivait :
« Apparemment, Monsieur Van Gijseghem consacre quelques phrases dans ses textes et quelques minutes dans ses conférences pour reconnaître que des agressions sexuelles intrafamiliales sur mineurs existent et qu’elles constituent bien un fléau social. Mais aussitôt après, sa pensée se développe dans un tout autre sens et ne va plus se préoccuper désormais que de pourfendre ce qu’il considère comme des excès et des dérives en matière de protection de l’enfance. Il n’hésite pas à dire que c’est la mise en mots qui constitue l’abus, autrement dit que c’est la parole qui est le lieu constitutif de la violence. [...]
Apparemment, Monsieur Van Gijseghem met en garde contre ce qu’il appelle les fausses allégations, notamment dans un contexte de séparation des parents. Au nom de ce qu’il définit comme un « syndrome d’aliénation parentale », il finit par discréditer systématiquement la parole de l’enfant dès l’instant que scs parents sont séparés. Ce qui se présentait comme une règle de prudence est devenue un dogme au service de la surdité.
Apparemment, Monsieur Van Gijseghem dit qu’il faut considérer la mémoire avec prudence. En fait, il joint sa voix aux tenants de la théorie dite des « faux souvenirs ». Avec eux il insiste sur les risques qu’il y a de prendre au pied de la lettre certaines réminiscences ou certaines images de l’inconscient, et avec eux il en profite pour nier l’éventualité d’un retour de mémoire traumatique après un temps d’occultation. Ici encore, la prudence nécessaire est priée de laisser la place au déni systématique.
Apparemment, Monsieur Van Gijseghem met en garde contre les effets pervers possibles des actions de prévention auprès des enfants. Mais en fait, il ne s'occupe pas de les professionnaliser davantage pour les rendre encore plus rigoureuses, il estime qu’elles n’ont pas lieu d’être et qu’il faut les rayer purement et simplement de la carte des écoles élémentaire et maternelle. Il ne concède qu’une action préventive en direction d’adolescents « à risques », comme si seul l’agresseur, potentiel pouvait bénéficier de ses attentions.
Apparemment, Monsieur Van Gijseghem met en garde contre ce qui relève à ses yeux de l’acharnement, tant en matière d’investigation qu’en matière thérapeutique. Mais en fait, il considère d’une part qu’il n’est nul besoin d’une thérapie spécifique pour des enfants victimes d’agressions sexuelles, d’autre part que leur parole doit rester conte-nue dans un espace clos et qu’il n’est nul besoin de la relier à l’instance judiciaire. »
M. Van Gijseghem n’est pas un psychologue marginal ou isolé. Professeur à l’université de Montréal, il est également expert judiciaire et intervient dans la formation de magistrats, de psychologues, de policiers, de gendarmes et de travailleurs sociaux dans différents pays. En France, où il est entre autre conférencier à l’École nationale de la magistrature, un récent rapport du Ministère de la Justice recommandait qu’une méthodologie introduite par Van Gijseghem soit utilisée par les policiers accueillant la parole d’enfants victimes de violences. En Belgique, en pleine affaire Dutroux, des gendarmes ont été formés par ce même Van Gijseghem en matière d’écoute et de recueil de témoignages de victimes de violences. En Suisse, il est intervenu dans la formation de magistrats et de policiers du canton du Tessin et auprès des policiers du canton de Neuchâtel.
Malgré les thèses avancées, relativement peu de critiques ont été entendues et surtout sérieusement prises en considération. Récemment, le député socialiste Giuseppe Bill Arigoni a pourtant interpellé — sans succès — le Conseil d’État du canton du Tessin concernant l’invitation faite à Van Gijseghem pour venir former des magistrats suisses : « [c’est] un auteur controversé, discuté et critiqué pour son ambiguïté, sa partialité, le manque de fiabilité scientifique de ses études. » Aux Pays-Bas, la journaliste et juriste féministe Simone Korkus a dénoncé l’idéologie du syndrome d’aliénation parentale :
« Le plus grand danger lié à l’application du syndrome d’aliénation parentale est le fait que des cas réels d’inceste soient maintenus hors de la sphère de l’intervention de protection des enfants et de l’intervention judiciaire. La vie de milliers d’enfants risque ainsi d’être mise en danger. »
En Allemagne, le journal féministe EMMA a signalé le fait - lors de la journée du droit de la famille de 2001 — que « le syndrome d’aliénation parentale « cette soi-disant théorie » était non scientifique, car elle ne repose pas sur « une observation systématique » mais sur « une agrégation de cas où l’imputation de faute était effectuée de façon monocausale ». » En France, les journalistes Laurence Beneux, France Berlioz et Serge Garde ont écrit : « Plus grave encore, certains « experts » en vogue - tel le Canadien Hubert Van Gijseghem -, vont même jusqu’à affirmer qu’en cas d’inceste « les effets d’un dévoilement (basé sur la réalité ou sur la fiction), d’une investigation et d’une judiciarisation, sont aussi dommageables que l’abus sexuel lui-même. » Bref, il serait préférable de ne pas porter plainte. » Le Collectif féministe contre le viol, dans une interview publiée dans Alternative Santé, a déclaré :
« L’idée de la multiplication des fausses allégations repose sur la subjectivité des personnes et la parole de certains magistrats. Un psychothérapeute d’origine belge, Hubert Van Gijseghem a largement participé à la propagation de cette idée lors de sessions de formation organisées en France ces dernières années pour les professionnels de la maltraitance. »
La sociologue féministe Christine Delphy écrivait — dans Le Monde Diplomatique de mai 2004 — à propos des lobbies mas-culinistes :
« Le plus souvent, ces groupes de pression agissent de façon souterraine, en formant des « experts » qui témoigneront devant les tribunaux, en écrivant des livres de « psychologie » où les avocats des hommes violents et des pères incestueux, ainsi que les auteurs d’ouvrages « baquelachiens », puisent leurs arguments. »
Puis,
* Ils argumentent volontiers sur de « fausses allégations » des enfants ou encore sur le « syndrome des faux souvenirs ». Autant d’expressions popularisées dans les tribunaux et les écoles de magistrature par les « experts » Hubert Van Gijseghem et Paul Bensoussan, notamment. »
La pédopsychiatre belge Catherine Marneffe, quant à elle, s’est inquiétée du fait que Van Gijseghem s’appuyait sur des écrits de « pédophiles notoires »...
Outre les thèses avancées, il est en effet particulièrement inquiétant de constater qu’un tel personnage puisse former des professionnels de l’enfance et ce malgré le fait que Van Gijseghem - qui s’appuie sur leurs travaux — semble considérer les théories pro-pédocriminelles des psychologues et experts judiciaires américains Richard Gardner et Ralph Underwager comme exprimant « une approche humaniste de la pédophilie » — comme il a affirmé lors d’une conférence à Lyon. Gardner, l’inventeur du syndrome d’aliénation parentale, considère par exemple :
« Il est ici pertinent pour ma théorie que la pédophilie sert des buts procréateurs. Évidemment, la pédophilie ne sert pas ce but de façon immédiate puisque les enfants ne peuvent tomber enceintes ni rendre d'autres enceintes. L’enfant attiré dans des interactions sexuelles dès l’enfance est susceptible de devenir hautement sexualisé et de rechercher activement des expériences sexuelles durant les années précédant la puberté. Un tel enfant « chargé à bloc » est susceptible de devenir plus actif au plan sexuel après la puberté et donc susceptible de transmettre rapidement ses gènes à sa progéniture. [...] L’idéal est donc, du point de vue de l’ADN, que l’enfant soit sexuellement actif très tôt, qu’il ait une enfance hautement sexualisée avant d’entamer sa puberté. »
Underwager affirme quant à lui :
« Les pédophiles dépensent beaucoup de temps et d’énergie à défendre leur choix. Je ne pense pas qu’un pédophile ait à faire cela. Les pédophiles peuvent affirmer fièrement et courageusement leur choix. Us peuvent dire que leur volonté est de trouver la meilleure façon d’aimer. Je suis également théologien, et en tant que théologien, je crois que c’est la volonté de Dieu qu’il existe de la proximité et de l’intimité, de l’unité de la chair entre les gens. Un pédophile peut dire : cette proximité est une possibilité pour moi parmi les choix que j’ai faits. Les pédophiles sont trop sur la défensive. »
Il n’est donc pas surprenant de voir que Van Gijseghem semble être très apprécié par le MEDEF des rapports hommes-femmes—ces associations réactionnaires de pères divorcés qui luttent pour maintenir leur droit de propriété sur les enfants et les femmes — pour lequel il intervient et qui le citent souvent dans leurs bibliographies et sur leurs sites internet. Dans une récente interview en Belgique, Van Gijseghem a exprimé un peu plus explicitement que d’habitude ses partis pris idéologiques.
Parti pris de parent, tout d’abord, puisqu’il semble craindre qu’en écoutant et en respectant les décisions des enfants qui ne veulent plus voir un parent, on renonce à son pouvoir sur les enfants :
« Un meurtre parental [sic] veut également dire la destruction de la distance entre les générations, c’est-à-dire parents et enfants. L’enfant n’est plus un enfant. Et ce que nous voyons chez les victimes d’aliénation parentale, c’est que l’enfant — une fois devenu adolescent — prend le pouvoir, non seulement sur le parent assassiné [sic] mais également sur le parent aimé... Car on a toujours respecté son choix, on lui a donné raison, on n’est pas intervenu... Donc l’enfant a, pas seulement de façon virtuelle mais également de toutes les façons... pris le pouvoir. Et cela aura des conséquences sur la façon dont il grandira, dont il deviendra adulte. Il aura probablement du mal avec l’autorité, et souvent avec la loi. »
Parti pris de père, ensuite. Selon Van Gijseghem, depuis les années soixante-dix l’intérêt de l’enfant primerait en matière de droit de garde. « Les hommes étaient, en tout cas ils le pensaient, d’aussi bons fournisseurs de soins que les femmes. La justice les a suivis, car rapidement dans les années soixante-dix, la justice a dit : « Oui, nous pouvons entendre cela qu’un homme est aussi un bon maternant, un bon gardien » et là, les experts sont intervenus, et les experts devaient répondre aux questions formulées par la justice « Qui est le parent psychologique ? », « Qui était jusque-là le meilleur gardien ? »... Et de plus en plus on est arrivé au constat que le père était le meilleur gardien [sic], donc, voilà, le meilleur intérêt de l’enfant. »
Parti pris d’homme, également, car il poursuit : « Assez étonnamment, même si c’est le féminisme qui a revendiqué cet égalitarisme, c’est également le féminisme qui n’a rien voulu en savoir, que cet égalitarisme soit appliqué au droit de garde [sic] ». Puis,
« c’est clairement lié au nombre de divorces, d’abord, mais également au fort succès que le féminisme a eu sur d’autres domaines, par exemple lorsque le féminisme a commencé à dénoncer la violence conjugale elles ont rencontré un fort succès sur le plan judiciaire — et c’est une bonne chose - et, c’est également vrai que tout le phénomène d’aliénation parentale est en effet lié à « la bataille des sexes » [sic]. (...] C’est un paradoxe incompréhensible : lorsque l’homme était assis dans la taverne et le café et ne s’occupait pas des enfants, alors les femmes hurlaient et disaient « ces hommes ne se préoccupent pas de l’éducation des enfants * et maintenant que les hommes veulent s’en occuper activement, maintenant les femmes sont blessées, ne sont pas d’accord et elles trouvent que les hommes ne sont pas qualifiés, ne sont pas aptes pour tenir ce rôle. »
Parti pris d’expert, ensuite, puisque Van Gijseghem fournit régulièrement des expertises judiciaires — entre autre concernant des hommes accusés de violences sexuelles — et que de ce point de vue il considère nécessaire que l’aliénation parentale - telle qu’il l’a repris de Gardner — soit reconnue comme un syndrome psychiatrique officiel.
« L’aliénation parentale n’a pas encore d’existence officielle car elle n’a pas encore été intégrée dans nos classifications officielles. Elle doit être reconnue, elle doit être nommée pour que les juges puissent en tenir compte. Car une fois qu’elle aura une existence scientifique officielle, elle devient un fait. Les juges, je le répète, ont besoin de faits. »
Finalement, Van Gijseghem adhère sans surprise — mais non sans opportunisme — à l’idéologie de la loi « naturelle ».
« La parentalité biologique reste importante car elle est une des racines de l’identité. [...] Et bien, oui, si le parent biologique est correct, c’est-à-dire si c’est un bon parent, alors c’est une loi naturelle qu’un enfant doit avoir des contacts avec ce parent biologique. Bien sûr, si le parent biologique ne veut pas, et bien, à l’impossible personne n’est tenu -comme on dit quelquefois - si le parent biologique ne veut pas [...], alors c’est peut-être mieux que l’enfant reste loin ou éloigné du parent biologique. »
Loin de la neutralité idéologique dont Van Gijseghem se revendiquait récemment dans un journal suisse — suite aux questions formulées par le député socialiste Arigoni — affirmant « je suis un scientifique, un studioso, lui un politique. Nous vivons simplement dans deux mondes différents », on constate en effet que nous avons là affaire à un investissement idéologiquement situé : complaisance envers des écrits propédocriminels, thèses hautement problématiques du point de vue des enfants victimes de violences sexuelles, agenda scientifique influencé par des pratiques judiciaires... Les quelques éléments abordés ci-dessus semblent attester du fait que nous avons là bien affaire à un exemple paradigmatique de la résistance masculiniste face à la lutte pour la reconnaissance juridique et sociétale des violences faites aux enfants et aux femmes par les hommes.
Ça se passe près de chez vous : des filles incestueuses aux mères aliénantes
[Comme pour le texte précédent, il s’agissait pour Léo de faire connaitre les dangers du SAP avancé par Hubert Van Gijseghem, de rendre visible le lobbying masculiniste et de s'y opposer. L'article a été posté via internet fin février 2006.)
Du 27 février au 1er mars 2006, a lieu à Genève — à l’initiative de l’institut de médecine légale et du parquet de Genève et avec le soutien de la Société suisse de psychologie légale — une formation intitulée : « Évaluation de la crédibilité du discours des enfants dans le cadre de procédures pénales en matières d'abus sexuels ». Cette formation sera assurée par le Professeur Hubert Van Gijseghem, psychologue belgo-cana-dien, qui représente selon de nombreux observateurs un des courants les plus réactionnaires sur la question des violences faites aux enfants.
Le 21 octobre 2004, ce même psychologue avait déjà assuré à Paris une « formation » sur un outil socio-judiciaire largement contesté par des acteurs de la lutte contre la pédocriminalité et les violences faites aux femmes : le « Syndrome d’Aliénation Parentale » (SAP). Afin de ne pas répéter les analyses développées au sujet de cet outil socio-judiciaire, je me permets de vous renvoyer au texte « Humanisme, pédocriminalité et résistance masculiniste ».
Je rappellerai brièvement que cet outil peut être considéré comme une arme extrêmement efficace contre la parole des enfants et des femmes qui dénoncent des abus sexuels dans un contexte de séparation parentale ; la promotion du SAP est souvent l'œuvre d’associations de pères séparés et de leurs nouvelles conjointes ainsi que de certains courants du secteur socio-éducatif, incarné en France et en Belgique par la Revue d'action juridique et sociale - Journal du droit des jeunes.
Selon Pierre Lassus, psychanalyste et directeur général de l’Union française pour le sauvetage des enfants, « les considérations [de H. Van Gijseghem] mettent gravement en cause les acquis récents, fragiles et précaires, en matière de prévention des abus sexuels et du soin des enfants victimes. » Dans un article intitulé « Le Faurisson de la maltraitance ? », Pierre Sabourin, psychiatre, psychanalyste, thérapeute familial et cofondateur du Centre des Buttes Chaumont, écrit : « C’est encore une fois du négationnisme en acte dont le procédé habituel, la méthode Faurisson, tente de prouver la réalité d’un postulat (aussi fou soit-il) par tous les amalgames et toutes les confusions possibles, où peuvent se rejoindre allègrement des intellos aux sensibilités inverses, extrême-droite et ultra-gauche, mais avec des pratiques comparables de propagandisme acharné. »
Catherine Marneffe, médecin pédopsychiatre, thérapeute d’enfants et de la famille, fondatrice et ex-directrice du centre SOS-Enfants de la Vrije Universiteit de Bruxelles, précise : « Le Professeur Van Gijseghem est en permanence dans la confusion entre l’aveu et le dévoilement de l’abus, l’aveu étant un terme qu’on attribue habituellement aux coupables, donc plutôt aux abuseurs. En disant « qu’il est capital de permettre à la victime, après le dévoilement, de se taire », il mélange le silence à respecter sur l’acte sexuel en tant que tel et le silence, provoqué par l’impossibilité de mettre en mots tant de sentiments contradictoires suscités par l’abus et son contexte et qu’il faut essayer de briser. » Plus récemment, Philippe D. Jaffé, Professeur de psychologie à l’université de Genève et président de la Société Suisse de Psychologie légale (SSPL), déclare au sujet d’une des références idéologiques principales de H. Van Gijseghem :
« La première raison [à la base de la controverse) tient au personnage même de Richard Gardner. Même si, par hypothèse, le SAP était la découverte du siècle, son auteur est tellement particulier qu’il est impossible d’éviter sa pertinence sans tenir compte du messager dont certaines théories sont fort discutables. La deuxième raison à la base de la controverse est également liée au personnage de Gardner et à certaines de ses affirmations, mais elle est également liée à des considérations sociologiques. En effet, le SAP tel qu’il a été initialement conceptualisé par Gardner était un syndrome qui touchait avant tout les femmes comme parents aliénants. Le SAP pourrait être considéré comme l’un des contrecoups de certains mouvements d’hommes. »
Puis, « l’aliénation parentale est un concept qui est souvent récupéré par des avocats et/ou des parents peu scrupuleux et même brandi par plusieurs milieux associatifs actifs dans 1. promotion des droits du père. »
Pourtant, c’est aujourd’hui ce même Philippe D. Jaffé qui appuie en tant que président de la SSPL cette formation animée par Van Gijseghem, et qui déclarait le 5 décembre 2005 au quotidien suisse 24 heures Région La Côte :
« Oui. Lors de séparations douloureuses, 90 % des accusations de sévices sexuels sont abusives. Il s’agit d’un syndrome connu, celui de l’aliénation parentale. Il y a lavage du cerveau de l’enfant par le parent — parfois de bonne foi — qui veut se venger de son conjoint. Et cela biaise tout. »
Subite conversion à la « découverte du siècle » pour une psychologue qui écrivait encore il y a quelque temps : « le syndrome d’aliénation parentale n’est pas un syndrome et doit être manié avec beaucoup de précautions. » Cette conversion nous en dit beaucoup sur le pouvoir d’attraction qu’exerce ce courant idéologique mais également sur les groupes de pression à l’œuvre. Ainsi, en France une association promouvant le SAP a récemment vu le jour et travaille en étroite collaboration avec le Ministère de la Justice et des associations de pères séparés, notamment à travers des groupes de travail sur les « fausses allégations d’abus sexuel ». Il est remarquable que parmi ses membres fondateurs, on trouve une représentante de l’extrême / nouvelle droite païenne puisque c’est également un adepte des courants celtisants qui a violemment mené campagne contre le psychothérapeute Bernard Lem-pert, membre de l’Association pour La Formation à la Protection de l’Enfance, devenue Droit et Soin, qui s’oppose depuis des années à ce courant réactionnaire. Plus précisément, cet adepte d’extrême droite était un ancien membre du Front national, puis membre du mouvement Troisième Voie (extrême droite radicale), et porte-parole d'un groupuscule autonomiste breton. Dans les deux cas des accusations de violences sur enfants ont été formulées.
Selon certains observateurs, le Professeur H. Van Gijseghem aurait connu une conversion similaire à celle de Philippe D. Jaffé, et ce à travers la rencontre d’un pasteur et psychologue américain, Ralph Underwager, inventeur du « Syndrome des faux souvenirs » (qui s’attaque surtout à la parole de femmes adultes se remémorant des abus sexuels subis pendant leur enfance). Underwager a été accusé de violences sexuelles par sa propre fille et défendait publiquement des thèses pro-pédo-criminelles, appelant les « pédophiles » à « affirmer fièrement et courageusement leur choix ». Van Gijseghem semble avoir rencontré ce pasteur-psychologue au début des années quatre-vingt-dix, lors d’un procès où les deux exerçaient leur « autre » métier, ou devrait-on peut-être dire, étaient prestataires de service en tant que psychologue-expert. Si Van Gijseghem avait initialement conseillé le maintien du lien avec le père, il a complètement changé d’avis en prévenant la justice que la fille était en grave danger chez le père. Il s’approchait ainsi de l’expertise délivrée par Ralph Underwager qui niait l’existence de violences sexuelles contre la fille — allant ainsi à l’encontre de la parole de la fille qui disait avoir été victime de violences sexuelles du côté de sa mère. Van Gijseghem a effectué ce revirement sans effectuer de nouvelles expertises de la fille ou du père.
Ceci n’est pas la seule particularité « méthodologique » des expertises psychologiques effectuées par ce dernier. Dans un procès de 1993, un homme accusé d’avoir sexuellement agressé une fille de dix ans (attouchements et tentative de viol) avait été expertisé par Van Gijseghem : celui-ci lui avait donné quatre tests évidemment « scientifiques et objectifs, donc non projectifs » pour que celui-ci les remplisse... tranquillement chez lui. Lors du procès, Van Gijseghem avait déclaré : « Il n’est pas très probable que M. S. ait posé les gestes qui lui sont imputés. [...] Mon flair clinique ne m’a pas fait voir de danger. » Ni son « flair » clinique, ni ses tests « objectifs » sem-blent très opérationnels, puisque l’homme accusé se révélera plus tard être récidiviste (En 1979, il avait été condamné à six mois de prison pour le viol d’une fille de quinze ans et il avait reconnu un autre viol aux Pays-Bas). Cet homme, M. S., reconnaîtra plus tard non seulement l’agression sexuelle contre cette fille de dix ans, mais également deux autres viols. Il sera condamné à un an de prison ferme. Dans un autre dossier d’agressions sexuelles, Van Gijseghem applique sa fameuse analyse du Syndrome de Rosenthal — version psychologique de la self fulfilling prophecy — déclare constater de nombreuses contaminations de la parole des enfants, et diagnostique la non-fiabilité des accusations d’attouchements et d’agressions sexuelles émises par dix-sept filles à l’encontre d’un enseignant. Grave erreur professionnelle, puisqu’au Canada l’expert psychologue n’est pas supposé s’exprimer sur la crédibilité ou fiabilité de la parole de l’enfant (contrairement à la situation dans des pays européens). La justice canadienne confirmera jusqu’à la Cour Suprême l’erreur professionnelle commise par Van Gijseghem : « le juge du procès ne s’est ni mépris sur l'objectif de l’expertise ni n’a abusé de sa discrétion en disposant du témoignage de l’expert. » L’enseignant sera condamné pour dix-sept chefs d’inculpation, les filles agressées avaient entre dix et treize ans à l’époque des faits.
Un dernier dossier permet d’aborder également l’attitude de Van Gijseghem vis-à-vis de ses pairs et le mépris exprimé envers celles, mères ou médecins, qui ne partagent pas son avis. De nouveau Van Gijseghem intervient en tant que psychologue-expert « pour vérifier les allégations d’abus sexuel et déterminer les droits d’accès que le parent non-gardien [ici, le père] doit avoir ». Le père est accusé d’avoir violé pendant un droit de visite son fils âgé alors de trois ans. Le jugement dit :
« Le docteur [Van Gijseghem) soutient qu’il n’est pas approprié de croire les propos rapportés par l’enfant car celui-ci est incapable de décrire en détail ce qui s’est réellement passé [sic ! ], soit les faits survenus lors de la commission de l’acte reproché. De toute façon, ajoute-t-il, il est généralement impossible d’infirmer ou confirmer des allégations d abus sexuel [sic !]. 11 suggère à Madame de consulter un psychologue car il est à craindre que sa conviction que l’enfant est abusé ne l’amène à porter d’autres accusations. [...] Il maintient que Madame a tout inventé. »
Rappelons que le garçon a été sodomisé à plusieurs reprises par son père et que la médecin qui l’a examiné a constaté : « deux fissures à l’anus [...], l’ouverture anormale de l’anus [...], l’enfant a perdu le réflexe de constriction [...], la muqueuse de l’anus est aplatie. » Van Gijseghem oppose au rapport de cet examen physique « qu’il ne faut pas accorder beaucoup de poids à celui-ci car, dit-il, elle [la médecin] voit des cas d’abus dans la majorité de ces dossiers [puis] il affirme que l’enfant a pu s’autostimuler ou s’automutiler ». Lors d’une conférence à Lyon il y a quelques années, Van Gijseghem avait fait rire un auditoire entier de psychologues, travailleurs sociaux et magistrats en déclarant qu’un de ses collègues britanniques diagnostiquait l’agression sexuelle chaque fois qu’il constatait une constipation chez un enfant. Ce sera également la ligne de défense du père accusé dans ce dossier... la constipation. Au vu de ces faits, la cour décidera de prononcer « la déchéance totale de l’autorité parentale envers l’enfant B. du père G. T. [et même] ordonne au Directeur de l’état civil de modifier l’extrait de naissance de l’enfant » pour que celui-ci n’ait plus à porter le nom de cet homme. On peut facilement imaginer quelle aurait pu être la décision de justice si la médecin n’avait pas pu constater à temps les lésions anales et qu'elle avait dû se prononcer à partir des seules paroles de l’enfant : « papa bobo aux fesses avec un bâton mauve ».
Peut-être Van Gijseghem met-il là en pratique l’adage de son pasteur-psychologue-maître à penser, Ralph Underwa-ger : « Il est plus préférable qu’un millier d’enfants dans des situations d'abus ne soient pas découverts qu’une personne innocente soit condamnée par erreur ». Mais Van Gijseghem semble, en plus de ses « méthodologies », également avoir des convictions particulières : selon lui, « certaines filles mettent des objets dans leur vagin ou vulve et se blessent, et ceci n’est pas quelque chose de rare chez les filles » ; « rien ne distingue les enfants qui ont révélé le secret de ceux qui se sont tus » ; « si [l’enfant] ressent le besoin d’avouer, il le fera ». De nombreux observateurs ont relevé dans ses écrits ce type de particularités et bien d’autres, mais peu se sont attardés sur un de ses anciens articles, lorque Van Gijseghem avait trente cinq ans, intitulé « L’inceste père-fille ». En le lisant, la conversion un-derwagerienne et gardnerienne prend en effet sens. Van Gijseghem s’intéressait à l’époque aux filles délinquantes, et c’est dans le cadre de ces études qu’il s’est intéressé aux « filles incestueuses ». Je me contenterai de reprendre plusieurs phrases, dans la mesure où les mots utilisés sont particulièrement révélateurs de l’idéologie réactionnaire déjà adoptée à l’époque.
« D’après un échantillon représentatif de cent quatre-vingt-six filles, pris dans les institutions pour jeunes filles délinquantes canadiennes-françaises. Nous trouvons cinquante-deux filles qui ont eu des contacts incestueux avec le père (naturel ou adoptif). Cela signifie donc que 28 % des filles délinquantes ont connu leur père en tant qu’objet sexuel. »
« À l’intérieur de cette population, nous avons retrouvé cinquante-deux filles ayant été impliquées dans des agissements incestueux avec le père naturel ou avec le père adoptif. »
« Parmi les cinquante-deux filles, il y en a vingt-deux dont les relations incestueuses avec le père naturel ont débuté avant la puberté, ces relations ayant duré, de façon continue ou intermittente, pendant une période prolongée allant parfois jusqu'à plusieurs années. »
« Les prépubères ne résistent habituellement pas aux avances du père, ce qui aboutit en une relation durable. L'inceste peut parfois prendre fin avec l'avènement de la puberté, et cela, à l'instigation d'un des deux partenaires ; parfois encore, l'inceste peut se continuer pour une durée indéterminée. »
« Le groupe consiste en vingt-deux filles qui ont commencé des relations incestueuses avec le père à un âge qu'on peut appeler « prépubertaire » lequel peut varier entre deux et douze ans. »
« Il est vrai que pour l'observateur ces filles sont les « victimes » de l'inceste, mais très souvent, si, au départ, elles ne séduisent pas déjà le père, par la suite, elles le manipulent à leur aise. L'inceste devient pour elles un moyen puissant pour exploiter le père, faire du chantage, s'assurer argent ou faveurs, et, éventuellement, obtenir son incarcération. »
« Le taux d'homosexualité pourrait être aussi expliqué par l'hypothèse que les incestueuses auraient eu un développement psychosexuel plus primitif et seraient, de ce fait, sexuellement, plus indifférenciées. »
« Plus généralement, l'inceste semble être un événement marquant dans la vie de la fille qui, dans la presque majorité des cas, laisse des blessures psychiques irréversibles. »
La formation dont bénéficieront les magistrats, psychologues et autres professionnels genevois pourrait bien contribuer à maintenir de nombreux enfants dans des situations de violence, à criminaliser de nombreuses femmes « aliénantes » et à exonérer de nombreux hommes agresseurs sexuels. Peut-être est-ce là une des conséquences concrètes de l’affaire d’Outreau, qui a déjà permis d’assister à la montée en puissance médiatique et étatique de ce courant réactionnaire converti à l’idéologie des « fausses allégations », du « syndrome d’aliénation parentale », du « syndrome des faux souvenirs », du « syndrome de Rosenthal »... Comme l’annonce la journaliste suisse Pascale Zimmerman :
« Alors que l’affaire d’Outreau se termine en terrible fiasco et pose le problème de la crédibilité des déclarations d’enfants [sic !] devant les tribunaux, une formation destinée aux psychologues démarre en Suisse. Les premiers cours ont démarré ce week-end à Sion. Entretien avec un des principaux concepteurs du projet, Philip Jaffé, professeur de psychologie à l’université de Genève, ainsi qu’à l’Institut de criminologie et de droit pénal de Lausanne. »
Un certain « flair » me dit que le futur est loin d’être rassurant, en tous cas pour certaines.
Concluons avec Gérard Lopez, psychiatre, directeur médical du centre de psychothérapie de l’institut de victimologie à Paris, enseignant à l’université Paris XIII dans le département de médecine légale :
« L’analyse des stratégies perverses, l'évaluation des forces et des faiblesses en présence sont une entreprise difficile et périlleuse. Il faut toujours déployer des efforts considérables pour vaincre ses propres résistances et celles des autres, confrontées à la « violence impensable ». Toutes les victimes d'emprise se heurtent à l'incompréhension qu'elles rencontrent de la part de leur entourage et dans tous les contacts avec les institutions. Ces aléas les rendent doublement victimes. Les enfants massacrés n'espèrent aucune aide extérieure. Ils savent que les adultes se taisent souvent, même lorsqu'ils se présentent couverts de blessures à l'école. Des milliers de témoignages d'adultes le confirment : le déni a la peau dure ».
Liste des traductions réalisées par Léo
Pour des sites web :
• Harne L. et Hester M. (1999) : « Paternity, children and violence » tiré de Engendering social policy édité par Open University press sous la direction de Doyal L. et Watson S. et mis en ligne sur le site Sisyphe.
• Dallam Stephanie J. (1998) : « Dr. Richard Gardner : a review of his stories and Opinions on Atypical Sexuality, Pedophilia, and Treatment Issues » a été publié dans Treating Abuse Today de janvier-février 1998 (Volume 8, no 1). L’adaptation française a été faite avec Martin Dufresne et Hélène Palma et mise en ligne sur le site sisyphe sous le titre : « Examen critique des théories et opinions du Dr Richard Gardner en matière de sexualité atypique, de pédophilie et de traitement ».
Pour l'ouvrage Au-delà du personnel : • Murray Annie S. (1995) : « Forsaking all others : a bifeminist discussion of compulsory monogamy » tiré de Bisexual Politics. Theories, Queries and Visions (sous la direction de Nao-mie Tucker, éd. The Haworth Press). Traduit avec Karin Vandenhaute et publié sous le titre : « Renoncer à toutes les autres : une discussion biféministe de la monogamie obligatoire ». • Bower Tamara (1995) : « Bisexual women, feminist politics » tiré de Bisexual Politics. Theories, Queries and Visions (sous la direction de Naomie Tucker, éd. The Haworth Press). Tra-duit avec Karin Vandenhaute et publié sous le titre : « Femmes bisexuelles, politique féministe ». • Reinboud Weia (1998). Contribution reçue suite à l’appel à contribution et publiée sous le titre : « @-sexualité ». Traduit avec Karin Vandenhaute. • Major Stanfield (1998). Contribution reçue et publiée sous le titre : « Qu’y a-t-il donc de si drôle au sujet de « Paix, Amour et Polyamour » ? ». Traduit avec Karin Vandenhaute. • Nijboer Simone (1998). Contribution reçue et publiée sous le titre : « Une lettre sur l’amour libre ». Traduit avec Karin Vandenhaute. • Wiersma Rymke (1998). Contribution reçue et publiée sous le titre : « Lettre sur l’amour libre ». Traduit avec Karin Van denhaute. • Matthesen Elise (1995). Contribution tirée de Loving More. New Paradigm Relationships, n° 3 (Vol. 1), et publiée sous le titre : « Comment foutre en l’air une relation ». Traduit avec Karin Vandenhaute. • Davis Katherine (1987) : « What we fear, we try to contain » tiré du recueil Coming To Power, Writings and graphies on lesbian S/M. Samois (éd. Alyson Publications). Publiée sous le titre : « Ce que nous craignons, nous essayons de le maîtriser ». Traduit avec Karin Vandenhaute.
Pour des brochures :
• Lorenzo Kom'boa Ervin (1994) : entretien publié dans la revue américaine The Blast. La traduction a été faite avec Corinne Monnet et publiée en français sous le titre : « La révolution noire dans les années 90 » . La brochure auto-éditée et photocopiée a été réalisée en 1999 avec Corinne, Samuel et Violaine. • Comité Mahila Samanwaya (1997) : « Manifeste des travailleuses du sexe de Calcutta », titre original : « Sex Workers’ Manifesto ». Publié en 2000 par le dragon lune, éditions Cabiria. • Wilson Trish (1998) : article mis en ligne sur le site sisyphe et reproduit dans le dossier de l’association Mères en lutte sous le titre : « Les femmes et les enfants mentent-elles à propos des sévices infligés au sein de la famille ? Beaucoup moins souvent que ce que le lobby masculiniste aimerait faire croire ». Traduit avec Martin Dufresne.
Pour des revues :
• Kärcher K. (1991) : « Tiere, Tod und Tötung ». Il s'agit de la traduction d'un des chapitres du mémoire de philosophie de l'auteure, soutenu à l'université de Hambourg sous le titre : Auf der Suche nach der Bedeutung des Tieres in der Ethik (« A la recherche de la signification de l'animal dans l'éthique »). L'article a été publié dans Les Cahiers Antispécistes n°9 (janvier 1994) sous le titre : « Les animaux, la mort et l'acte de tuer ». • Cooke Miriam (2000) : « Multiple Critique : Islamic Feminist Rhetorical Strategies », tiré de Nepantla : Views from South (Volume 1, n° 1, éd. Duke University Press). Publié dans L'Homme et la société, n°l58 ( 2005/4) sous le titre : « Critique multiple : Les stratégies rhétoriques féministes islamiques ». • Mac Mahon Anthony (1993) « Male Readings of Feminist Theory : The Psychologization of Sexual Politics in the Masculinity Literature », paru dans Theory and Society, n° 5 (vol. 22 ) et remanié-actualisé pour la traduction. L'article a été publié dans L'Homme et la société, n°158 ( 2005/4) sous le titre : « Lectures masculines de la théorie féministe : la psychologi-sation des rapports de genre dans la littérature sur la masculinité ».
Pour des livres :
• Nakano Glenn Evelyn (1992) : « From servitude to service work : Historical continuities in the racial division of paid reproductive labor » publié dans la revue féministe Signs n°l (vol. 18). L'article a été publié dans l'ouvrage Sexe, race, classe - pour une épistémologie de la domination sous la direction d'Elsa Dorlin (éd. PUF, coll. Actuel Marx, 2009) avec pour titre : « De la servitude au travail de service : les continuités historiques de la division raciale du travail reproductif payé ». Elsa Dorlin commence son introduction par une dédicace : « à la mémoire de léo thiers vidal ».
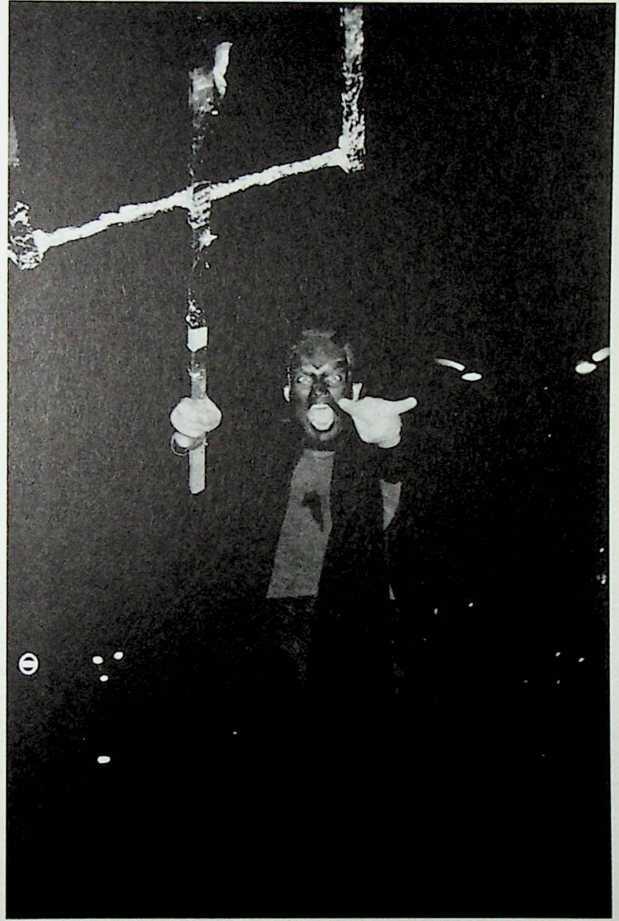
Le diable en personne • Carnaval du blasphème • Lyon, 8 décembre 1995
[1] Léo a mis fin à ses jours dans la nuit du 11 au 12 novembre 2007. Il allait avoir 37 ans le 15 décembre 2007. Il n’a laissé aucune explication sur ce geste tragique.
[2] De « L’ennemi principal » aux principaux ennemis. Position vécue, subjectivité et conscience masculines de domination. Préface de Christine Delphy, Éditions L'Harmattan (2010).
[3] Notamment sur le site de Philippe Coutant à l’adresse : http://1libertaire.free.fr/
[4] http://www.c-g-a.org/?q=content/motion-antipatriarcale-cga
[5] « Les amants passionnés de la culture de soi-même » Dans La Culture libertaire, Actes du colloque international, Grenoble, mars 1996, ACL, 1997.
[6] Cité par Roger Dadoun dans « Les amants... ».
[7] * Nous ne voulons rien de moins que la liberté complète - la révolution sexuelle-sociale, la destruction créative de la triple domination du patriarcat, de l’état et du capital. Comme si, à cet instant, l’anarchisme n'a pas d’autre choix que de devenir consciemment et activement féministe - et comme l’anarchaféminisme consiste en un féminisme consciemment anarchiste - ou de cesser d’exister. Ce que nous demandons n’est rien moins qu’une révolution totale, dont les formes inventent un futur dénué d’inégalité, de domination et de manque de respect pour la variété individuelle - en bref une révolution féministe-anarchiste. Je crois que les femmes ont toujours su comment aller dans la direction de la libération humaine ; il nous faut uniquement nous débarrasser des formes et maximes politiques mâles et nous concentrer sur notre propre analyse anarchiste de femme. » (Kornegger Peggy, Anarchisme : la connexion féministe Zero Collective, Anarchisme / Feminism dans Quiet Rumors, Dark Star, London)
[8] Les deux textes ont été publiés dans la revue La Griffe n° 11.
[9] Ce qui distingue le libéralisme de l’analyse libertaire, c’est que le premier ne remet pas en cause les dominations existantes et prône une notion de « liberté » qui n’est pas sociale c’est-à-dire qui ne tient pas compte des autres lorsqu’il s’agit de réaliser sa liberté. Contrairement au libéralisme qui est par définition répressif, l’analyse libertaire tente de conjuguer le souci de liberté avec le souci de justice sociale.
[10] Ceux-ci intègrent dans leur réflexion et action la critique féministe des rapports sociaux de sexe et l’appliquent dans leur lutte contre l’oppression sexiste à travers la notion de accountability c’est-à-dire la création de liens de reddition de compte avec des (collectifs) féministes -sujets premiers de la lutte pour la libération des femmes.
[11] Il va de soi que plusieurs membres du collectif n’ont pas cette conception du projet de La Gryffe ni des journées libertaires et cela s’est clairement exprimé par la participation et le soutien actif d’une bonne partie de ses membres à l’action féministe libertaire.
[12] Pourtant, dans le n°13 de La Griffe, l’article « Proudhon et les contradictions du peuple » reprend le discours de la multiplicité proudhonienne sans mentionner la misogynie et l’antisémitisme de Proudhon. Il s’agit là d’un même aveuglement face à certaines oppressions considérées comme « secondaires »...
[13] Que ce soit au niveau d’un couple, d’un collectif, d’un mouvement ou de la société.
[14] L’hétérosexisme concerne l’obligation sociale à l’hétérosexualité. Il ne s’agit pas seulement de dénoncer la répression contre les lesbiennes et les gays, mais de problématiser l’hétérosexualité comme une construction sociale au bénéfice des hommes.
[15] Faut-il rappeler que cette notion a été développée et popularisée par la droite américaine en réaction aux avancées concrètes faites par les mouvements antiracistes, féministes ?
[16] Fabienne, dans le numéro 12 de La Griffe.
[17] Le libéralisme n’est même pas un relativisme ou postmodernisme car ceux-ci reconnaissent comme point de départ leur propre perspective et situatedness et nient la possibilité même d’un neutre ou extérieur
[18] En évitant de tomber dans les écueils dé la majorité des groupes hommes qui consistent au mieux à devenir un groupe de développement et d’enrichissement masculin, au pire un lieu réactionnaire contre les avancées féministes.
[19] Cet article est basé sur mon mémoire de DEA (2001). Je tiens à remercier toutes les personnes m’ayant aidé à mieux développer cette réflexion, en particulier Christine Delphy, Marie-Josèphe Dhavernas-Lévy, Sandrine Durand, Judith Ezekiel, Françoise Guille-maut, Rose-Marie Lagrave, Corinne Monnet, Sandrine Pariat, Patricia Roux et Martine Schutz-Samson.
[20] La notion de masculinisme a été introduite en France par Michèle Le Dœuff : « Ce particularisme, qui non seulement n’envisage que l’histoire ou la vie sociale des hommes, mais encore double cette limitation d’une affirmation (il n’y a qu’eux qui comptent, et leur point de vue) » (1989 : 55). J’entends par « masculinisme » l’idéologie politique gouvernante, structurant la société de telle façon que deux classes sociales sont produites : les hommes et les femmes. La classe sociale des hommes se fonde sur l’oppression des femmes, source d’une qualité de vie améliorée. l’entends par « masculinité » un nombre de pratiques — produisant une façon d’être au monde et une vision du monde — structurées par le masculinisme, fondées sur et rendant possible l’oppression des femmes. J’entends par « hommes » les acteurs sociaux produits par le masculinisme, dont le trait commun est constitué par l’action oppressive envers les femmes.
[21] C. Saint-Hilaire, « Crise et mutation du dispositif de la différence des sexes : regard sociologique sur l’éclatement de la catégorie sexe », in D. Lamoureux, Les limites de l’identité sexuelle, Les Éditions du Remue-Ménage, Montréal, 1998, p. 24.
[22] J. Scott, « The millenium phantasy », Symposium der Hans-Si-grist-Stiftung an der Universitât Bern : « Gender, History and Modernity », 1999.
[23] J. Butler, Gender Trouble. Feminism and the subversion of identity, Routledge, New York, 1999. R. Dunphy, Sexual Politics. An introduction, Edinburgh University Press, 2000.
[24] C. Saint Hilaire, * Le paradoxe de l’identité et le devenir-queer du sujet : de nouveaux enjeux pour la sociologie des rapports sociaux de sexe », Recherches sociologiquesy 1999/3, p. 58.
[25] C. Ingraham, « The heterosexual Imaginary : Feminist Sociology and Theories of Gender », in S. Seidman (eds), Queer Theory / Sociology, Blackwell, Oxford, 1996.
[26] Voir notamment D. Halperin, Saint Foucault, Oxford university Press, New York-Oxford, 1995 ; R. Dunphy, Sexual Politics..op. cit.
[27] M. Foucault, La volonté de savoir (Histoire de la sexualité), Gallimard, 1976, p. 124.
[28] Sawicki, in R. Dunphy, Sexual Politics..., op. cit., p. 26.
[29] S. Seidman (eds), Queer Theory..., op. cit.
[30] L. Thiers-Vidal, Rapports sociaux de sexe et pouvoir. Une comparaison des analyses féministes radicales avec des analyses masculines engagées, mémoire de DEA Femmes/Genre, Genève/Lausanne, 2001.
[31] D. Welzer-Lang, Et les hommes ? Étudier les hommes pour comprendre les changements des rapports sociaux de sexe, dossier d’habilitation, Toulouse, 1999.
[32] C. Delphy, L'ennemi principal, tome 1, Syllepse, 1998.
[33] C. Ingraham, « The heterosexual Imaginary... », art. cit., p. 168.
[34] Notamment chez D. Smith, The Everyday World as problematic, Northeastern University Press, Boston, 1987.
[35] C. Ingraham, « The heterosexual Imaginary... », art. cit., p. 167.
[36] S. Jackson, « Théoriser le genre : l’héritage de Beauvoir », Nouvelles questions féministes, vol. 20, n° 4, 1999.
[37] Voir R. W. Connell, Gender and power, Polity press, Cambridge, 1987.
[38] E. Glick, « Sex positive : feminism, queer theory, and the politics od transgression », Feminist review, n° 64, spring 2000 ; R. Dunphy, Sexual Politics..., op. cit.
[39] D. Halperin, Saint Foucault, op. cit. ; T. de Lauretis, « Queer Theory : lesbian and gays sexualities. An Introduction », Differences, vol. 3, n° 2,1991.
[40] S. Bordo, « Feminism, Postmodernism, and gender-scepticism », in L. J. Nicholson, Feminism / postmodernism, Routledge, New York, 1990, p. 140.
[41] Voir notamment M. Wittig, The Straight Mind and Other Essays, Beacon press, Boston, 1992.
[42] C. Monnet et alii, Au-delà du personnel. Pour une transformation politique du personnel, ACL, Lyon, 1998 ; G. Pheterson, Le prisme de la prostitution, L’Harmattan, 2001.
[43] Je remercie Catherine Kerbrat-Orecchioni, professeur en sciences du langage à Lyon 2 et l’IUFM, d’avoir attiré l’attention sur ces citations lors de la journée d’étude « Pour l’usage d’une langue non sexiste dans la communication administrative à l’université » (28/04/04, ISH, Centre Louise Labé), et de m’avoir communiqué ces références bibliographiques.
[44] Par exemple, il confond Jeanne Favret-Saada avec Nicole-Claude Mathieu, les femmes seraient-elles interchangeables ? (p. 46)
[45] Il est à noter qu’il préféré citer les chercheures féministes loin de lui, de préférence anglo-américaines, plutôt que celles vivant et travaillant dans la même ville, le même pays que lui.
[46] Bourdieu tente de dissiper cette critique (p. 40), pourtant ce geste explicatif me semble de nouveau très représentatif des écrits masculins, développant des thèses souvent contradictoires avec les recherches féministes tout en expliquant en quelques mots, paragraphes qu’il ne s’agirait là que d’une mauvaise interprétation de leurs analyses, de la part de femmes voulant « monopoliser » ce domaine d’étude.
[47] Bourdieu affirme à plusieurs reprises qu’il ne s’agit pas de stratégies conscientes, délibérées contrairement à ce que démontrent pas mal d’études féministes, notamment celle en matière de violences physiques ; et symboliques.
[48] « Les divisions constitutives de l’ordre social, et plus précisément les rapports sociaux de domination et d’exploitation qui sont institués entre les genres... ». Où est passé le sujet, l’agent ?
[49] « Les dispositions qui inclinent les hommes à abandonner... » (p.39)
[50] La seule exception où Bourdieu n’est pas dans l’euphémisme, et parle de « tuer, torturer, violer, volonté de domination, d’exploitation ou d’oppression » c’est pour l’expliquer par « la crainte « virile » de s’exclure du monde des « hommes » sans faiblesse de ceux que l’on appelle parfois des « durs » parce qu’ils sont durs pour leur propre souffrance et surtout pour la souffrance des autres - assassins, tortionnaires et petit chefs de toutes les dictatures... » (p. 58). Soit, en remettant l’accent sur le vécu affectif masculin et en situant ces violences loin de la sphère domestique...
[51] Quelques extraits reflétant l’absence d’usage cohérent de ces deux notions : « homme viril et femme féminine » (p. 29) ; « habitus viril donc non-féminin, ou féminin donc non-masculin » (p. 30) ; la circoncision, rite d’institution de la masculinité par excellence, entre ceux dont elle consacre la virilité tout en les préparant symboliquement à l’exercer » (p. 31) ; « émanciper le garçon par rapport à sa mère et d’assurer sa masculinisation progressive » (p. 31) ; « la série des rites d’institution sexuels orientés vers la virilisation » (p. 31) ; « l’intention objective de nier la part féminine du masculin » (p. 32) ; « le travail de virilisation (ou de déféminisation) » (32) ; « actes virils de défloration » (p. 32) ; le travail constant de différenciation [...] qui les porte à se distinguer en se masculinisant ou en se féminisant » (p. 92) ; « la violence virile apaisée » (p. 117).
[52] Pourtant, il affirme lui-même que « les dominés, notamment les femmes » déploient « une perspicacité particulière » propre à leur position vécue (p. 37).
[53] Je remercie Françoise Guillemaut, doctorante féministe en sociologie à l’Université Toulouse-Le Mirail de m’avoir signalé cette contradiction.
[54] Confirmé cette fois-ci : « les homosexuels comprennent mieux le point de vue des dominants que ces derniers ne peuvent comprendre le leur » (p. 37). L’usage du verbe « pouvoir » renvoie bien à la capacité même, liée à la position vécue.
[55] Bourdieu semble se penser non seulement comme dans un ailleurs des rapports sociaux de sexe, cf. « la relation d’extériorité dans la sympathie où je me trouvais placé » mais que cet ailleurs lui permet en plus « d’orienter autrement et la recherche et l’action sur les rapports de genre ».
[56] Collective Responsibility » [19691 in James Bernauer (ed.) Amor Mundi : Explorations in the Faith and Thought of Hannah Arendt, (Dordrecht : Martinus Nijhoff, 1987).