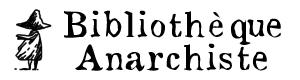Daniel Guérin
L'anarchisme
Première partie : les idées-forces de l’anarchisme
Sus à la démocratie bourgeoise
Critique du socialisme « autoritaire »
Les sources d’énergie : l’individu
Les sources d’énergie : les masses
Deuxième partie : à la recherche de la société future
L’anarchisme n’est pas utopique
Comment gérer les services publics ?
Troisième partie : l’anarchisme dans la pratique révolutionnaire
L’anarchisme s’isole du mouvement ouvrier
Les social-démocrates vitupèrent les anarchistes
Les anarchistes dans les syndicats
Chapitre II. L’anarchisme dans la révolution russe
Une révolution « autoritaire »
III Chapitre III L’anarchisme dans les conseils d’usine italiens
Chapitre IV L’anarchisme dans la révolution espagnole
La tradition anarchiste en Espagne
Avant-propos
L'anarchisme suscite, depuis peu, un renouveau d’intérêt. Des ouvrages, des monographies lui sont consacrés. Il n’est pas certain que cet effort livresque soit toujours vraiment efficace. Les traits de l’anarchisme sont difficiles à cerner. Ses maîtres n’ont presque jamais condensé leur pensée en des traités systématiques. Quand, à l’occasion, il en ont fait l’essai, ce n’a été qu’en de minces brochures de propagande et de vulgarisation, où n’en affleurent que des bribes. De plus, il existe bien des sortes d’anarchismes. Et nombre de variations dans la pensée de chacun des plus grands libertaires.
Le refus de l’autorité, l’accent mis sur la priorité du jugement individuel, incitent particulièrement les libertaires à « faire profession d’antidogmatisme». « Ne nous faisons pas les chefs d’une nouvelle religion, écrivait Proudhon à Marx ; cette religion fût-elle la religion de la logique, la religion de la raison. » Aussi les vues des libertaires sont-elles plus diverses, plus fluides, plus malaisées à apprécier que celles des socialistes « autoritaires», dont les églises rivales essaient, au moins, d’imposer à leurs zélateurs des canons.
Dans une lettre écrite au directeur de la Conciergerie, peu avant d’être envoyé à la guillotine, le terroriste Émile Henry expliquait : « Gardez-vous de croire que l’Anarchie est un dogme, une doctrine inattaquable, indiscutable, vénérée par ses adeptes à l’égal du Coran par les musulmans. Non : la liberté absolue que nous revendiquons développe sans cesse nos idées, les élève vers des horizons nouveaux (au gré des cerveaux des divers individus), et les rejette hors des cadres étroits de toute réglementation et de toute codification. Nous ne sommes pas des “croyants”. » Et le condamné à mort de rejeter l’« aveugle foi » des marxistes français de son temps, « qui croient une chose, parce que Guesde a dit qu’il fallait y croire et qui ont un catéchisme dont ce serait sacrilège de discuter les paragraphes. »
En fait, malgré la variété et la richesse de la pensée anarchiste, malgré ses contradictions, malgré ses disputes doctrinales qui tournent d’ailleurs, trop souvent, autour de faux problèmes, nous avons affaire à un ensemble de conceptions assez homogènes. Sans doute existe-t-il, au moins à première vue, des divergences importantes entre l’individualisme anarchiste de Stirner (1806-1856) et l’anarchisme sociétaire. Mais, si l’on va au fond des choses, les partisans de la liberté totale et ceux de l’organisation sociale sont moins éloignés les uns des autres qu’ils ne se l’imaginent, et qu’on peut le croire à première vue. L’anarchiste sociétaire est aussi un individualiste. L’anarchiste individualiste pourrait bien être un sociétaire qui n’ose pas dire son nom.
La relative unité de l’anarchisme sociétaire provient du fait qu’il a été élaboré, à peu près à la même époque, par deux maîtres, dont l’un a été le disciple et le continuateur de l’autre : à savoir le français Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) et l’exilé russe Michel Bakounine (1814-1876). Bakounine a défini l’anarchisme : « Le proudhonisme largement développé et poussé jusqu’aux extrêmes conséquences. » Cet anarchisme se déclare collectiviste.
Mais ses épigones rejettent l’épithète et se proclament communistes (« communistes libertaires » s’entend). L’un d’eux, Pierre Kropotkine (1842-1921), un autre exilé russe, infléchit la doctrine vers un utopisme et un optimisme dont « le scientisme » dissimule mal les faiblesses. Quant à l’italien Errico Malatesta (1853-1932), il l’oriente vers un activisme téméraire parfois puéril, tout en l’enrichissant de polémiques intransigeantes, et souvent lucides. Plus tard, l’expérience de la Révolution russe a produit un des ouvrages les plus remarquables de l’anarchisme, celui de Voline (1882-1945).
*
Le terrorisme anarchiste de la fin du siècle dernier présente des aspects dramatiques et anecdotiques, une odeur de sang, qui flattent les goûts du grand public. Mais, s’il a été, en son temps, une école d’énergie individuelle et de courage, qui appelle le respect, s’il a eu le mérite d’attirer l’attention de l’opinion sur l’injustice sociale, il apparaît aujourd’hui comme une déviation épisodique et stérilisante de l’anarchisme. Il fait figure de vieillerie. Avoir l’œil fixé, comme le suggère la couverture d’une publication récente, sur la « marmite » de Ravachol conduirait à ignorer, ou à sous-estimer, les traits fondamentaux d’une conception de réorganisation sociale qui, loin d’être destructive, comme ses adversaires le prétendent, apparaît, à l’examen, hautement constructive. C’est sur cet anarchisme-là que l’on prend la liberté de diriger l’attention du lecteur. De quel droit et au nom de quel critère ? Tout simplement parce que les matériaux dont il s’agit ne sont pas sclérosés, mais vivants. Parce que les problèmes posés sont, plus que jamais, actuels. Si les défis tapageurs lancés à la société, les charges d’explosifs appartiennent à un âge antédiluvien et ne font plus trembler, en revanche, les anticipations libertaires appellent la réflexion. On s’aperçoit qu’elles répondent, dans une assez large mesure, aux besoins de notre temps, qu’elles peuvent contribuer à l’édification de notre futur.
À l’inverse de ses devanciers, le petit livre que voici n’a voulu être ni une histoire ni une bibliographie de l’anarchisme. Les érudits, qui lui ont consacré leurs travaux, ont été surtout préoccupés de n’omettre aucun nom dans leurs fichiers. Attirés par des ressemblances superficielles, ils ont cru lui découvrir de multiples précurseurs. Ils ont accordé à peu près la même importance à des génies et à des sous-fifres. Ils ont raconté, avec un luxe de détails parfois superflus, des vies, plutôt qu’ils n’ont réellement approfondi des idées. Le résultat est que leurs savantes compilations procurent au lecteur une impression d’éparpillement, de relative incohérence, et qu’au bout du compte il en est encore à se demander ce qu’est réellement l’anarchisme.
La méthode que l’on a essayé d’adopter est différente. La biographie des maîtres de la pensée libertaire est ici supposée connue. Au surplus, elle éclaire parfois beaucoup moins notre sujet que certains narrateurs le croient. En effet, ces maîtres n’ont pas été uniformément anarchistes tout au long de leur existence, et leurs œuvres complètes recèlent d’assez nombreuses pages qui n’ont guère de rapport avec l’anarchisme.
Ainsi Proudhon a-t-il, dans la seconde partie de sa carrière, donné à sa pensée un tour plus conservateur. Sa prolixe et monumentale Justice dans la Révolution et dans l’Église (1858) est surtout consacrée au problème religieux et la conclusion en est fort peu libertaire, puisque, en dépit d’un anticléricalisme endiablé, il accepte finalement toutes les catégories du catholicisme, sauf à les interpréter, proclame qu’il y aurait un réel avantage, pour l’instruction et la moralisation du peuple, à conserver la symbolique chrétienne, et se montre disposé, au moment de poser la plume, à faire oraison. Par égard pour sa mémoire, on ne mentionne qu’en passant son « salut à la guerre», ses diatribes contre la femme ou ses accès de racisme.
Chez Bakounine, le phénomène est inverse. C’est la première partie de sa carrière agitée de conspirateur révolutionnaire, qui est sans rapport avec l’anarchisme. Il n’embrasse les idées libertaires qu’à partir de 1864, après l’échec de l’insurrection polonaise, à laquelle il a participé. Ses écrits d’avant cette date n’ont guère leur place dans une anthologie anarchiste.
Quant à Kropotkine, la partie purement scientifique de son œuvre, qui lui vaut d’être aujourd’hui célébré en U.R.S.S. comme un brillant porte-drapeau de la géographie nationale, est étrangère à l’anarchisme, tout comme, d’ailleurs, sur un tout autre plan, sa prise de position belliciste au cours de la Grande Guerre.
À la démarche historique et chronologique, on a donc préféré ici une autre méthode, inhabituelle : ce ne sont pas des personnalités qui sont présentées tour à tour, mais les principaux thèmes constructifs de l’anarchisme. N’ont été volontairement écartés que ceux qui ne sont pas spécifiquement anarchistes, tels que la critique du capitalisme, l’athéisme, l’antimilitarisme, l’amour libre, etc. Plutôt que de procéder à un résumé de seconde main, donc affadi, et sans preuves à l’appui, on a laissé, le plus souvent possible, parler les citations. ainsi les thèmes sont-ils accessibles au lecteur dans la forme même, avec toute la chaleur et toute la verve où ils ont surgi sous la plume des maîtres.
Ensuite, la doctrine est reconsidérée sous un autre angle : elle est montrée dans les grands moments où elle s’est trouvée soumise à l’épreuve des faits : la Révolution russe de 1917, l’Italie d’après 1918, la Révolution espagnole de 1936. Un dernier chapitre présente l’autogestion ouvrière, qui est, sans doute, la création la plus originale de l’anarchisme, aux prises avec la réalité contemporaine : en Yougoslavie, en Algérie — qui sait, demain, peut-être, en U.R.S.S.
Ainsi peut-on voir, à travers ce petit livre, s’affronter incessamment et, parfois, s’apparenter deux conceptions du socialisme : l’une « autoritaire», l’autre libertaire. À laquelle des deux appartient l’avenir, tel est, au terme de l’analyse, le sujet de réflexion proposé au lecteur.
Première partie : les idées-forces de l’anarchisme
Questions de vocabulaire
Le vocable anarchie est vieux comme le monde. Il dérive de deux mots du grec ancien : an et arkhé, et signifie quelque chose comme absence d'autorité ou de gouvernement. Mais le préjugé ayant régné pendant des millénaires, selon lequel les hommes ne sauraient se passer de l'un ou de l'autre, anarchie a été entendu, dans un sens péjoratif : un synonyme de désordre, de chaos, de désorganisation.
Grand faiseur de boutades (telles que « la propriété c'est le vol») Pierre-Joseph Proudhon s'est annexé le mot anarchie. Comme s'il voulait choquer au maximum, il engagea, dès 1840, avec le philistin, ce provocant dialogue :
— Vous êtes républicain.
— Républicain, oui ; mais ce mot ne précise rien. Res publica, c'est la chose publique... Les rois aussi sont
républicains.
— Eh bien ! vous êtes démocrate ?
— Non.
— Quoi ! vous seriez monarchique ?
— Non.
— Constitutionnel ?
— Dieu m'en garde.
— Vous êtes donc aristocrate ?
— Point du tout.
— Vous voulez un gouvernement mixte ?
— Encore moins.
— Qu'êtes-vous donc ?
— Je suis anarchiste.
Par anarchie, qu'il fit, parfois, la concession d'orthographier an-archie pour moins prêter le flanc à la meute de ses adversaires, Proudhon, plus constructeur, malgré les apparences, que destructeur, entendait, comme on le verra, tout le contraire de désordre. A ses yeux, c'était le gouvernement qui était fauteur de désordre. Seule une société sans gouvernement pouvait rétablir l'ordre naturel, restaurer l'harmonie sociale. Pour désigner cette panacée, arguant que la langue ne lui fournissait point d'autre vocable, il lui plut de restituer au vieux mot anarchie son strict sens étymologique.
Mais, paradoxalement, il s'obstina, dans le feu de ses polémiques — et son disciple, Michel Bakounine, devait s'obstiner après lui — à employer aussi le mot anarchie dans le sens, péjoratif, de désordre — comme si les cartes n'étaient pas déjà suffisamment embrouillées.
Mieux encore. Proudhon et Bakounine prirent un malin plaisir à jouer de la confusion entretenue par les deux acceptions antinomiques du mot : l'anarchie c'était, pour eux, à la fois, le plus colossal des désordres, la désorganisation la plus complète de la société et au-delà de cette mutation révolutionnaire gigantesque, la construction d'un ordre nouveau, stable et rationnel, fondé sur la liberté et la solidarité.
Cependant les disciples immédiats des deux pères de l'anarchisme hésitèrent à employer un terme dont l'élasticité était déplorable, qui n'exprimait, pour le non-initié, qu'une idée négative et prêtait à des équivoques pour le moins fâcheuses. Proudhon, lui-même, qui s'était assagi, s'intitulait volontiers, à la fin de sa brève carrière, fédéraliste. Au mot d'anarchisme, sa postérité petite-bourgeoise préféra celui de mutuellisme et sa lignée socialiste, le mot collectivisme, bientôt remplacé par communisme. Plus tard, en France, à la fin du siècle, Sébastien Faure reprit un mot forgé, dès 1858, par un certain Joseph Déjacque et en fit le titre d'un journal : Le Libertaire. Aujourd'hui les deux termes : anarchiste et libertaire sont devenus interchangeables.
Mais la plupart de ces termes présentent un sérieux inconvénient : ils omettent d'exprimer l'aspect fondamental des doctrines qu'ils prétendent qualifier. Anarchie, en effet, est, avant tout, synonyme de socialisme. L'anarchiste est, en premier lieu, un socialiste qui vise à abolir l'exploitation de l'homme par l'homme. L'anarchisme n'est pas autre chose qu'une des branches de la pensée socialiste. Une branche où prédominent le souci de la liberté, la hâte d'abolir l'État. Pour Adolphe Fischer, l'un des martyrs de Chicago, « tout anarchiste est socialiste, mais tout socialiste n'est pas nécessairement un anarchiste».
Certains anarchistes estiment que ce sont eux les socialistes les plus authentiques et les plus conséquents. Mais l'étiquette qu'ils se sont donnée, ou dont ils se sont laissé affubler, et qu'au surplus ils partagent avec les terroristes, les a trop souvent fait passer, à tort, comme une sorte de « corps étranger » dans la famille socialiste. D'où une longue suite de malentendus et de querelles de mots, le plus souvent sans objet. Certains anarchistes contemporains ont contribué à dissiper l'équivoque en adoptant une terminologie plus explicite : ils se réclament du socialisme ou du communisme libertaire.
Une révolte viscérale
L'anarchisme est, avant tout, ce qu’on pourrait appeler une révolte viscérale. Augustin Hamon, procédant, à la fin du siècle dernier, à un sondage d'opinion en milieu libertaire, concluait que l'anarchiste est d'abord un individu révolté. Il refuse en bloc la société et ses gardes-chiourme. Il s'affranchit, proclame Max Stirner,de tout ce qui est sacré. Il accomplit une immense déconsécration. Ces « vagabonds de l'intelligence», ces « mauvaises têtes», « au lieu de considérer comme vérités intangibles ce qui donne à des milliers d'hommes la consolation et le repos, sautent par-dessus les barrières du traditionalisme, et s'abandonnent sans frein aux fantaisies de leur critique impudente».
Proudhon rejette en bloc toute la « gent officielle», les philosophes, les prêtres, les magistrats, les académiciens, les journalistes, les parlementaires, etc. pour qui « le peuple est toujours le monstre que l'on combat, qu’on muselle et qu'on enchaîne ; que l'on conduit par adresse, comme le rhinocéros et l'éléphant ; qu'on dompte par la famine ; qu’on saigne par la colonisation et la guerre». Élisée Reclus s’explique pourquoi la société paraît à ces nantis si bonne à conserver : « Puisqu'il y a des riches et des pauvres, des puissants et des sujets, des maîtres et des serviteurs, des césars qui ordonnent le combat et des gladiateurs qui vont mourir, les gens avisés n'ont qu’à se mettre du côté des riches et des maîtres, à se faire les courtisans des césars. »
Son état permanent de révolte conduit l'anarchiste à ressentir de la sympathie pour les irréguliers, les hors-la-loi, à embrasser la cause du forçat ou de tout autre réprouvé. C’est bien injustement, estime Bakounine, que Marx et EngeLs parlent avec le plus profond mépris du lumpenproletariat, du « prolétariat en haillons», « car c’est en lui et en lui seul, et non pas dans la couche embourgeoisée de la masse ouvrière, que résident l'esprit et la force de la future révolution sociale. »
Dans la bouche de son Vautrin, puissante incarnation de la protestation sociale, mi-rebelle, mi-criminel, Balzac fait exploser des propos qu'un anarchiste ne désavouerait pas.
L’horreur de l’État
Pour l'anarchiste, de tous les préjugés qui aveuglent l'homme depuis l'origine des temps, celui de l'État est le plus funeste. Stirner tonne contre celui qui, « de toute éternité», « est possédé par l'État».
Proudhon ne fulmine pas moins contre cette « fantasmagorie de notre esprit, que le premier devoir d'une raison libre est de renvoyer aux musées et aux bibliothèques». Et il en démonte le mécanisme : « Ce qui a entretenu cette prédisposition mentale et rendu la fascination pendant si longtemps invincible, c'est que le gouvernement s'est toujours présenté aux esprits comme l'organe naturel de la justice, le protecteur du faible. » Persiflant les « autoritaires » invétérés qui s'inclinent devant le pouvoir comme des marguilliers devant le saint sacrement», houspillant « tous les partis sans exception » qui tournent incessamment leurs regards vers l'autorité, comme vers leur pôle unique», il appelle de ses vœux le jour où « le renoncement à l'autorité aura remplacé dans le catéchisme politique la foi à l’autorité».
Kropotkine se gausse des bourgeois qui « considèrent le peuple comme une agglomération de sauvages se mangeant le nez dès que le gouvernement ne fonctionne plus». Malatesta, devançant la psychanalyse, décèle la peur de la liberté qui habite le subconscient des « autoritaires».
Quels sont, aux yeux des anarchistes, les méfaits de l'État ?
Écoutons Stirner : « Nous sommes tous deux, l’État et moi, des ennemis. » « Tout État est une tyrannie, que ce soit la tyrannie d'un seul ou de plusieurs. » Tout État est forcément, comme on dit aujourd’hui, totalitaire : « L’État n’a toujours qu’un seul but : borner, lier, subordonner l'individu, l'assujettir à la chose générale (...). L'État cherche, par sa censure, par sa surveillance, sa police, à faire obstacle à toute activité libre et tient cette répression pour son devoir, parce qu'elle lui est imposée (...) par l'instinct de sa conservation personnelle. » « L’État ne me permet de tirer de mes pensées toute leur valeur et de les communiquer aux hommes (...) que si elles sont les siennes (...). Autrement il me ferme la bouche. »
Proudhon fait écho à Stirner : « Le gouvernement de l'homme par l'homme, c'est la servitude. » « Quiconque met la main sur moi pour me gouverner est un usurpateur et un tyran. Je le déclare mon ennemi. » Et il se lance dans une tirade, digne d'un Molière ou d'un Beaumarchais : « Être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, commandé, par des êtres qui n'ont ni le titre, ni la science, ni la vertu (...). Être gouverné, c'est être à chaque opération, à chaque transaction, à chaque mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, autorisé, apostillé, admonesté, empêché, réformé, redressé, corrigé. C'est, sous prétexte d'utilité publique, et au nom de l'intérêt général, être mis à contribution, exercé, rançonné, exploité, monopolisé, concussionné, pressuré, mystifié, volé ; puis, à la moindre résistance, au premier mot de la plainte, réprimé, amendé, vilipendé, vexé, traqué, houspillé, assommé, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu, trahi, et pour comble, joué, berné, outragé, déshonoré. Voilà le gouvernement, voilà sa justice, voilà sa morale ! (...) O personnalité humaine ! Se peut-il que pendant soixante siècles tu aies croupi dans cette abjection ? »
Pour Bakounine l'État est une « abstraction dévorante de la vie populaire», un « immense cimetière où, à l’ombre et sous le prétexte de cette abstraction, viennent généreusement, béatement, se laisser immoler et ensevelir toutes les aspirations réelles, toutes les forces vives d'un pays».
« Loin d'être créateur d'énergie, le gouvernement, selon Malatesta, gaspille, paralyse et détruit par ses méthodes d'action d'énormes forces. » Au fur et à mesure que s'étendent les attributions de l'État et de sa bureaucratie, le péril s'aggrave. Dans une vision prophétique, Proudhon annonce le fléau majeur du XXe siècle : « Le fonctionnarisme (...) pousse au communisme de l'État, à l'absorption de toute vie locale et individuelle dans le machinisme administratif, à la destruction de toute pensée libre. Tout le monde demande à s'abriter sous l'aile du pouvoir, à vivre sur le commun. » Il est grand temps d'y mettre le holà : « La centralisation se fortifiant toujours (...), les choses sont arrivées (...) au point que la société et le gouvernement ne peuvent plus vivre ensemble. » « Il n'y a rien, absolument rien dans l'État, du haut de la hiérarchie jusqu'en bas, qui ne soit abus à réformer, parasitisme à supprimer, instrument de tyrannie à détruire. Et vous nous parlez de conserver l'État, d'augmenter les attributions de l'État, de rendre de plus en plus fort le pouvoir de l'État ! Allez, vous n'êtes point un révolutionnaire ! »
Bakounine n'est pas moins lucide dans sa vision angoissée d'un État de plus en plus totalitaire. A ses yeux les forces de la contre-révolution mondiale « appuyées sur d'énormes budgets, sur des armées permanentes, sur une bureaucratie formidable», dotés « de tous les terribles moyens que leur donne la centralisation moderne » sont « un fait immense, menaçant, écrasant».
Sus à la démocratie bourgeoise
L'anarchiste dénonce plus âprement que ne le fait le socialiste « autoritaire » la duperie de la démocratie bourgeoise.
L’État bourgeois démocratique, baptisé « nation», ne paraît pas moins redoutable à Stirner que l'ancien État absolutiste : « Le monarque (...) était un bien misérable monarque, comparé au nouveau, à la “nation souveraine”. Nous n'avons dans le libéralisme que la continuation de l'antique mépris du Moi. » « Certes beaucoup de privilèges ont été extirpés avec le temps, mais exclusivement au profit de l'État (...) et pas du tout pour fortifier mon Moi. »
De l'avis de Proudhon, « la démocratie n'est rien de plus qu'un arbitraire constitutionnel». C'est par une « ruse » de nos pères que le peuple a été proclamé souverain. En réalité, il est un roi sans domaine, le singe des rois, qui, de la grandeur et de la munificence royales, ne conserve que le titre. Il règne et ne gouverne pas. En déléguant sa souveraineté par l'exercice périodique du suffrage universel, il renouvelle tous les trois ou cinq ans son abdication. Le dynaste a été chassé du trône, mais la royauté a été conservée tout organisée. Le bulletin de vote, entre les mains d'un peuple dont l'éducation a été volontairement négligée, est une supercherie savante dont seule profite la coalition des barons de la propriété, du commerce et de l'industrie.
Mais la théorie de la souveraineté du peuple contient en elle-même sa négation. Si le peuple tout entier était vraiment souverain, il n'y aurait plus de gouvernement, plus de gouvernés. Le souverain serait réduit à zéro. L’État n'aurait plus la moindre raison d'être, il s'identifierait avec la société, il disparaîtrait dans l'organisation industrielle.
Pour Bakounine « le système représentatif, loin d'être garantie pour le peuple, crée et garantit, au contraire, l'existence permanente d'une aristocratie gouvernementale contre le peuple». Le suffrage universel est un tour de passe-passe, un leurre, une soupape de sûreté, un masque derrière lequel « se cache le pouvoir réellement despotique de l'État, fondé sur la banque, la police et l’armée», « un moyen excellent pour opprimer et pour ruiner un peuple au nom même et sous le prétexte d'une soi-disant volonté populaire».
L'anarchiste ne croit guère à l'émancipation par le bulletin de vote. Proudhon est, au moins en théorie, abstentionniste. Il pense que « la révolution sociale est sérieusement compromise si elle arrive par la révolution politique». Voter, ce serait un contresens, un acte de lâcheté, une complicité avec la corruption du régime : « Pour faire la guerre à tous les anciens partis réunis, ce n'est pas dans le parlement que nous devons chercher légalement notre champ de bataille, c'est hors du parlement. » « Le suffrage universel est la contre-révolution. » Pour se constituer en classe, le prolétariat doit, d'abord, « faire scission » de la démocratie bourgeoise.
Mais à cette position de principe, Proudhon le militant fait de nombreuses entorses. En juin 1848, il se laisse élire député et prendre, un moment, dans la glu parlementaire. Deux fois de suite, aux élections partielles de septembre 1848 et à l'élection présidentielle du 10 décembre de la même année, il soutient la candidature de Raspail, un des porte-parole de l'extrême-gauche, alors en prison. Il va même jusqu'à se laisser éblouir par la tactique du « moindre mal», préférant le général Cavaignac, bourreau du prolétariat parisien, à l'apprenti dictateur Louis-Napoléon. Beaucoup plus tard, aux élections de 1863 et 1864, il préconise, certes, le vote par bulletin blanc, mais à titre de manifestation contre la dictature impériale et non par opposition au suffrage universel qu'il baptise maintenant « principe démocratique par excellence».
Bakounine et ses partisans dans la Première Internationale protestent contre l'épithète d'« abstentionnistes » que les marxistes leur décochent. Le boycottage des urnes n'est pas pour eux un article de foi, mais une simple question de tactique. S'ils affirment la priorité de la lutte de classes sur le plan économique, ils n'acceptent pas que l'on dise qu'ils font abstraction de la politique T,. Ils ne rejettent pas la « politique», mais seulement la politique bourgeoise. Ils ne condamnent la révolution politique que si elle devait précéder la révolution sociale. Ils ne se tiennent à l'écart que des mouvements politiques qui n'auraient pas pour but immédiat et direct l'émancipation complète des travailleurs. Ce qu'ils redoutent et dénoncent, ce sont les alliances électorales équivoques avec les partis du radicalisme bourgeois, du type « 1848», ou du type « front populaire», comme on dirait aujourd'hui. Ils appréhendent également que les ouvriers élus députés, transportés dans des conditions d'existence bourgeoises, cessant d'être des travailleurs pour devenir des hommes d'État, deviennent des bourgeois et peut-être même plus bourgeois que les bourgeois eux-mêmes.
Cependant l'attitude des anarchistes à l'égard du suffrage universel est loin d'être cohérente et conséquente. Les uns considèrent le bulletin de vote comme un pis-aller. Il est aussi parmi eux des irréductibles pour lesquels son utilisation est damnable, quelles que soient les circonstances, et qui en font une question de pureté doctrinale. C'est ainsi que Malatesta, à l'occasion des élections du cartel des Gauches de mai 1924, en France, se refusera à toute concession : il conviendra que, dans certaines circonstances, le résultat des élections pourrait avoir des conséquences « bonnes » ou « mauvaises » et que ce résultat dépendrait parfois du vote des anarchistes, surtout lorsque les forces des formations politiques opposées seraient presque égales. « Mais qu'importe ! Même si certains petits progrès étaient la conséquence directe d'une victoire électorale, les anarchistes ne devraient pas courir aux urnes. » Pour conclure : « Les anarchistes se sont maintenus toujours purs et restent le parti révolutionnaire par excellence, le parti de l'avenir, parce qu’ils ont su résister à la sirène électorale. »
L'incohérence de la doctrine anarchiste en cette matière sera illustrée, notamment, en Espagne. En 1930, les anarchistes feront front avec les partis de la démocratie bourgeoise pour renverser le dictateur Primo de Rivera. L'année suivante, malgré leur abstentionnisme officiel, ils seront nombreux à se rendre aux urnes lors des élections municipales qui précipiteront le renversement de la monarchie. Aux élections générales du 19 novembre 1933, ils préconiseront énergiquement l'abstention électorale, qui ramènera au pouvoir pour plus de deux ans une droite violemment antiouvrière. À l'avance, ils prendront soin d'annoncer que, si leur consigne abstentionniste devait amener la victoire de la Réaction, ils y répondraient en déclenchant la révolution sociale. Ce qu'ils tenteront de faire, peu après mais vainement, et au prix de nombreuses pertes (morts, blessés, emprisonnés). Lorsque, au début de 1936, les partis de Gauche s'associeront dans le Front Populaire, la Centrale anarcho-syndicaliste sera fort embarrassée sur l'attitude à prendre. Finalement, elle se prononcera, mais du bout des lèvres, pour l'abstention, et sa campagne sera assez tiède pour n'être point entendue des masses, dont, de toute manière, la participation au scrutin était déjà acquise. En allant aux urnes, le corps électoral fera triompher le Front Populaire (263 députés de gauche contre 181).
Il est à noter que les anarchistes, malgré leurs attaques endiablées contre la démocratie bourgeoise, admettent son caractère relativement progressif. Même Stirner, le plus intransigeant, lâche, de temps à autre, le mot de « progrès». « Sans doute, concède Proudhon, lorsqu'un peuple passe de l'État monarchique au démocratique, il y a progrès» ; et Bakounine : « Qu'on ne pense pas que nous voulons faire (...) la critique du gouvernement démocratique au profit de la monarchie (...). La plus imparfaite république vaut mille fois mieux que la monarchie la plus éclairée (...) Le régime démocratique élève peu à peu les masses à la vie publique. » Ainsi se trouve démentie l'opinion émise par Lénine, selon laquelle « certains anarchistes » professeraient « que la forme d'oppression est indifférente au prolétariat». Et, du même coup, se trouve écarté le soupçon exprimé par Henri Arvon dans son petit livre sur l'Anarchisme que l’antidémocratisme anarchiste puisse se confondre avec l'antidémocratisme contre-révolutionnaire.
Critique du socialisme « autoritaire »
Les anarchistes sont unanimes à soumettre le socialisme « autoritaire » au feu d'une sévère critique. A l'époque où leur réquisitoire à l'emporte-pièce était prononcé, il n’était pas toujours entièrement fondé, car ceux auxquels il s'adressait, ou bien étaient des communistes primitifs ou « grossiers», que n'avait pas encore fécondés l’humanisme marxiste, ou bien, dans le cas de Marx et d’Engels, n'étaient pas aussi unilatéralement férus d'« autorité » et d'étatisme que le prétendaient les anarchistes. Mais, de nos jours, les tendances « autoritaires » qui, au XIXe siècle, ne se manifestaient encore dans la pensée socialiste que d'une façon embryonnaire et velléitaire, ont proliféré. Au spectacle de ces excroissances, la critique anarchiste paraît aujourd'hui moins tendancieuse, moins injuste ; elle revêt même, assez souvent, un caractère prophétique.
Stirner accepte nombre de prémisses du communisme. Mais avec ce corollaire : si, pour les vaincus de la société actuelle, leur profession de foi communiste est un premier pas en avant dans la voie de leur totale émancipation, ils ne seront complètement « désaliénés», ils ne pourront vraiment mettre en valeur leur individualité qu'en dépassant le communisme.
Aux yeux de Stirner, en effet, le travailleur, en régime communiste, demeure soumis à la suprématie d'une société de travailleurs. Ce travail, la société le lui impose, il n’est pour lui qu'un pensum. Le communiste Weitling n’a-t-il pas écrit : « Les facultés ne peuvent se développer qu’autant qu’elles ne troublent pas l'harmonie de la société» ? A quoi Stirner répond : « Que je sois loyal sous un tyran ou dans la “société” de Weitling, c'est, dans un cas comme dans l'autre, la même absence de droit. »
Le communiste ne songerait guère, au-delà du travailleur, à l'homme, au loisir de l'homme. Il négligerait l'essentiel : lui permettre de jouir de soi comme individu, après qu'il a fait sa tâche comme producteur. Mais, surtout, Stirner entrevoit le danger d'une société communiste, où l'appropriation collective des moyens de production conférerait à l'État des pouvoirs beaucoup plus exorbitants que dans la société actuelle : « Le communisme, par l'abolition de toute propriété individuelle, me rejette encore plus sous la dépendance d'autrui, la généralité ou la totalité et, malgré qu'il attaque violemment l’État, son intention est d'établir aussi son État, (...) un état de choses qui paralyse mon activité libre, une autorité souveraine sur moi. Contre l'oppression que je subis de la part des propriétaires individuels, le communiste se soulève à juste titre ; mais plus terrible encore est la puissance qu'il met aux mains de la totalité. »
Proudhon peste tout autant contre le « système communiste, gouvernemental, dictatorial, autoritaire, doctrinaire » qui « part du principe que l'individu est essentiellement subordonné à la collectivité». La notion qu'ont les communistes du pouvoir de l'État est absolument la même que celle de leurs anciens maîtres. Elle est même beaucoup moins libérale. « Comme une armée qui a enlevé les canons de l'ennemi, le communisme n'a fait autre chose que retourner contre l'armée des propriétaires sa propre artillerie. Toujours l'esclave a singé le maître. » Et Proudhon décrit en ces termes le système politique qu'il attribue aux communistes :
« Une démocratie compacte, fondée en apparence sur la dictature des masses, mais où les masses n'ont de
pouvoir que ce qu'il en faut pour assurer la servitude universelle, d’après les formules suivantes, empruntées
à l'ancien absolutisme :
« Indivision du pouvoir ;
« Centralisation absorbante ;
« Destruction systématique de toute pensée individuelle, corporative et locale, réputée scissionnaire ;
« Police inquisitoriale. »
Les socialistes « autoritaires » appellent une « révolution par en haut». Ils « soutiennent qu'après la Révolution, il faut continuer l'État. Ils maintiennent, en l'agrandissant encore, l'État, le pouvoir, l'autorité, le gouvernement. Ce qu'ils font, c'est de changer les appellations (...) Comme s'il suffisait de changer les mots pour transformer les choses ! » Et Proudhon lance cette boutade : « Le gouvernement est de sa nature contre-révolutionnaire (...) Mettez un saint Vincent de Paul au pouvoir : il y sera Guizot ou Talleyrand. »
Bakounine développe cette critique du communisme « autoritaire» : « Je déteste le communisme, parce qu'il est la négation de la liberté et que je ne puis concevoir rien d'humain sans liberté. Je ne suis point communiste parce que le communisme concentre et fait absorber toutes les puissances de la société dans l'État, parce qu'il aboutit nécessairement à la centralisation de la propriété entre les mains de l'État, tandis que moi je veux l'abolition de l'État — l'extirpation radicale de ce principe de l'autorité et de la tutelle de l'État, qui, sous le prétexte de moraliser et de civiliser les hommes, les a jusqu'à ce jour asservis, opprimés, exploités et dépravés. Je veux l'organisation de la société et de la propriété collective ou sociale de bas en haut, par la voie de la libre association, et non de haut en bas, par le moyen de quelque autorité que ce soit (...) Voilà dans quel sens je suis collectiviste et pas du tout communiste. »
Peu après ce discours (1868), Bakounine adhère à la Première Internationale où, avec ses partisans, il se heurte, non seulement à Marx et à Engels, mais à d'autres qui, beaucoup plus que les deux fondateurs du socialisme scientifique, prêtent le flanc à son réquisitoire : d'une part, les social-démocrates allemands, qui ont le fétichisme de l’État et se proposent d'instaurer, par le bulletin de vote et les alliances électorales, un équivoque « État populaire » (Volkstaat) ; d'autre part, les blanquistes, qui prônent une dictature révolutionnaire minoritaire, à caractère transitoire. Bakounine combat à boulets rouges ces deux conceptions divergentes, mais toutes deux « autoritaires», entre lesquelles Marx et Engels, pour des raisons tactiques, oscillent, et qu'ils se résoudront, harcelés par la critique anarchiste, à plus ou moins désavouer.
Mais c'est la manière sectaire et personnelle avec laquelle Marx, surtout après 1870, prétend régenter l’Internationale qui l'oppose violemment à Bakounine. Dans cette querelle, dont l'enjeu est le contrôle de l'organisation, c'est-à-dire du mouvement ouvrier international, il n'est pas douteux que les deux protagonistes ont des torts. Bakounine n'est pas sans reproche et le procès qu'il intente à Marx manque souvent d'équité, voire de bonne foi. Cependant, et c'est ce qui doit compter surtout pour le lecteur d'aujourd'hui, il a le mérite de lancer, dès les années 1870, un cri d'alarme contre certaines conceptions d'organisation du mouvement ouvrier et du pouvoir « prolétarien», qui, beaucoup plus tard, dénatureront la Révolution russe. Dans le marxisme, il croit percevoir, parfois injustement, parfois avec raison, l'embryon de ce qui deviendra le léninisme, puis son cancer, le stalinisme.
Prêtant malignement à Marx et à Engels des intentions que les deux hommes, s'ils les ont réellement nourries, n'ont jamais ouvertement exprimées, Bakounine s'écrie : « Mais, dira-t-on, tous les ouvriers (...) ne peuvent pas devenir des savants ; et ne suffit-il pas qu'au sein de cette association [l'Internationale] il se trouve un groupe d'hommes qui possèdent, aussi complètement que cela se peut de nos jours, la science, la philosophie et la politique du socialisme, pour que la majorité (...) en obéissant avec foi à leur direction (...) puisse être certaine de ne pas dévier de la voie qui doit la conduire à l'émancipation définitive du prolétariat ? (...) Voilà un raisonnement que nous avons entendu, non ouvertement, émettre — on n'est ni assez sincère ni assez courageux pour cela — mais développer sous main, avec toutes sortes de réticences, plus ou moins habiles. » Et Bakounine de foncer : « Ayant adopté pour base le principe (...) que la pensée a priorité sur la vie et que la théorie abstraite a priorité sur la pratique sociale et que, par conséquence, la science sociologique doit devenir le point de départ des soulèvements sociaux et de la reconstruction sociale, ils en sont arrivés nécessairement à la conclusion que, la pensée, la théorie et la science étant, pour le présent du moins, la propriété exclusive d'un très petit nombre de gens, cette minorité devrait diriger la vie sociale. » Le prétendu État populaire ne sera rien d'autre que le gouvernement despotique des masses populaires par une nouvelle et très restreinte aristocratie de vrais ou de prétendus savants.
Bakounine a une vive admiration pour les capacités intellectuelles de Marx, dont il a traduit en russe l'ouvrage majeur, Le Capital, et il adhère pleinement à la conception matérialiste de l'histoire. Il apprécie mieux que quiconque la contribution théorique de Marx à l'émancipation du prolétariat. Mais ce qu'il n'admet pas, c'est que la supériorité intellectuelle puisse conférer un droit de direction du mouvement ouvrier : « Prétendre qu'un groupe d'individus, même les plus intelligents et les mieux intentionnés, sont capables de devenir la pensée, l'âme, la volonté dirigeante et unificatrice du mouvement révolutionnaire et de l'organisation économique du prolétariat de tous les pays, c'est une telle hérésie contre le sens commun et contre l'expérience historique qu'on se demande avec étonnement comment un homme aussi intelligent que M. Marx a pu la concevoir (...) L'établissement d'une dictature universelle (...), d'une dictature qui ferait en quelque sorte la besogne d'un ingénieur en chef de la révolution mondiale, réglant et dirigeant le mouvement insurrectionnel des masses de tous les pays comme on dirige une machine (...), l'établissement d'une pareille dictature suffirait à lui seul pour tuer la révolution, pour paralyser et pour fausser tous les mouvements populaires (...) Et que penser d'un congrès international qui, dans l'intérêt soi-disant de cette révolution, impose au prolétariat de tout le monde civilisé un gouvernement investi de pouvoirs dictatoriaux ? »
L'expérience de la Troisième Internationale a montré, depuis, que, si Bakounine forçait sans doute quelque peu la pensée de Marx en lui prêtant une conception aussi universellement « autoritaire», le danger contre lequel il mettait en garde s'est, beaucoup plus tard, matérialisé.
En ce qui concerne le péril étatique en régime communiste, l’exilé russe ne se montre pas moins clairvoyant. Les socialistes « doctrinaires » aspirent, selon lui, à « placer le peuple dans de nouveaux harnais». Sans doute ils admettent, avec les libertaires, que tout État est un joug, mais ils soutiennent que seule la dictature — bien entendu la leur — peut créer la liberté du peuple ; à cela nous répondons qu'aucune dictature ne peut avoir d'autre but que de durer le plus longtemps possible. Au lieu de laisser le prolétariat détruire l'État, ils veulent le « transférer (...) aux mains de ses bienfaiteurs, gardiens et professeurs, les chefs du Parti communiste». Mais, voyant bien qu'un tel gouvernement sera, « quelles que puissent être ses formes démocratiques, une véritable dictature » ils « se consolent à l'idée que cette dictature sera temporaire et de courte durée». Mais non ! leur rétorque Bakounine. Cette dictature prétendue transitoire aboutira inévitablement « à la reconstruction de l'État, des privilèges, des inégalités, de toutes les oppressions de l'État», à la formation d'une aristocratie gouvernementale « qui recommence à l'exploiter et à l'assujettir sous prétexte de bonheur commun ou pour sauver l'État». Et cet État sera « d'autant plus absolu que son despotisme se cache soigneusement sous les apparences d'un respect obséquieux (...) pour la volonté du peuple».
Bakounine, toujours extra-lucide, croit en la Révolution russe : « Si les ouvriers de l'Occident tardent trop longtemps, ce seront les paysans russes qui leur donneront l'exemple. » La Révolution, en Russie, sera, essentiellement, « anarchique». Mais gare à la suite ! Les révolutionnaires pourraient bien continuer tout simplement l'État de Pierre le Grand « basé sur (...) la suppression de toute manifestation de la vie populaire , car « on peut changer l'étiquette que porte notre État, sa forme (...), mais le fond en restera toujours le même». Ou il faut détruire cet État, ou se « réconcilier avec ce mensonge le plus vil et le plus redoutable qu'ait engendré notre siècle (...) : la bureaucratie rouge». Et Bakounine lance cette boutade : « Prenez le révolutionnaire le plus radical et placez-le sur le trône de toutes les Russies ou conférez-lui un pouvoir dictatorial (...) et avant un an il sera devenu pire que le tsar lui-même !1 »
***
Une fois la Révolution accomplie en Russie, Voline, qui en sera, tout à la fois l'acteur, le témoin et l'historien, constatera que la leçon des faits confirme la leçon des maîtres. Oui, décidément, pouvoir socialiste et révolution sociale « sont des éléments contradictoires». Impossible de les réconcilier : « Une révolution qui s'inspire du socialisme étatiste et lui confie son sort, ne serait-ce qu'à titre « provisoire » et « transitoire», est perdue : elle s’engage sur une fausse route, sur une pente de plus en plus accentuée (...) Tout pouvoir politique crée, inévitablement, une situation privilégiée pour les hommes qui l'exercent (...). S'étant emparé de la Révolution, l’ayant maîtrisée, bridée, le pouvoir est obligé de créer son appareil bureaucratique et coercitif, indispensable pour toute autorité qui veut se maintenir, commander, ordonner, en un mot : « gouverner » (...). Il forme ainsi (...) une sorte de nouvelle noblesse (...) : dirigeants, fonctionnaires, militaires, policiers, membres du parti au pouvoir (...). Tout pouvoir cherche plus ou moins à prendre entre ses mains les rênes de la vie sociale. Il prédispose les masses à la passivité, tout esprit d'initiative étant étouffé par l'existence même du pouvoir (...). Le pouvoir « communiste » est (...) un véritable assommoir. Gonflé de son “autorité”, (...) il a peur de tout acte indépendant. Toute initiative autonome lui apparaît aussitôt suspecte, menaçante, (...) car il veut tenir le gouvernail, et il veut le tenir seul. Toute autre initiative lui paraît être une ingérence dans son domaine et dans ses prérogatives. Elle lui est insupportable. »
D'ailleurs, pourquoi ce « provisoire » et ce « transitoire» ? L'anarchisme en conteste catégoriquement la prétendue nécessité. A la veille de la Révolution espagnole de 1936, Diego Abad de Santillan enfermera le socialisme « autoritaire » dans le dilemme que voici : « Ou bien la révolution donne la richesse sociale aux producteurs, ou elle ne la leur donne pas. Si elle la leur donne, si les producteurs s'organisent pour produire et distribuer collectivement, l'État n'a plus rien à faire. Si elle ne la leur donne pas, alors la révolution n'est qu'un leurre, et l'État subsiste. » Dilemme que d'aucuns jugeront quelque peu simpliste ; mais qui le serait déjà moins si on le ramenait à une direction d'intention, à savoir : les anarchistes ne sont pas assez naïfs pour rêver que les survivances étatiques disparaîtraient du jour au lendemain, mais ils ont la volonté de les faire dépérir au plus vite, tandis que les autoritaires se complaisent, eux, dans la perspective de la pérennité d'un État transitoire, baptisé arbitrairement « ouvrier».
Les sources d’énergie : l’individu
Aux hiérarchies et aux contraintes du socialisme « autoritaire», l'anarchiste oppose deux sources d'énergie révolutionnaire : l'individu, la spontanéité des masses. L'anarchiste est, selon le cas, plus individualiste que sociétaire ou plus sociétaire qu'individualiste. Mais, comme l'a observé Augustin Hamon au cours du sondage d'opinion déjà mentionné, on ne peut concevoir un libertaire qui ne soit pas individualiste.
Stirner a réhabilité l'individu à une époque où, sur le plan philosophique, dominait l'anti-individualisme hégélien et où, sur le plan de la critique sociale, les méfaits de l'égoïsme bourgeois avaient conduit la plupart des réformateurs à mettre l'accent sur son contraire : le mot socialisme n'est-il pas né comme antonyme d'individualisme ?
Stirner exalte la valeur intrinsèque de l'individu « unique», c'est-à-dire à nul autre pareil, tiré par la nature à un seul exemplaire (notion que confirment les plus récentes recherches de la biologie). Pendant longtemps, ce philosophe est resté dans les cercles de la pensée anarchiste un isolé, un excentrique, que suivait seule une petite secte d'individualistes impénitents. Aujourd'hui la grandeur et l'audace de son propos apparaissent en pleine lumière. En effet, le monde contemporain semble se donner pour tâche de sauver l'individu de toutes les aliénations qui l'écrasent, celles de l'esclavage industriel comme celles du conformisme totalitaire. Simone Weil, dans un célèbre article de 1933, se plaignait de ne point trouver dans la littérature marxiste de réponse aux questions posées par les nécessités de la défense de l'individu contre les nouvelles formes d’oppression succédant à l'oppression capitaliste classique. Or cette lacune, grave en effet, Stirner s'est employé, dès avant le milieu du XIXe siècle, à la combler.
Écrivain au style vif, percutant, il s'exprime dans un crépitement d'aphorismes : « Ne cherchez pas dans le renoncement à vous-mêmes une liberté qui vous prive précisément de vous-mêmes, mais cherchez-vous vous-mêmes (...) Que chacun de vous soit un moi tout-puissant. » Il n'y a pas d'autre liberté que celle que l'individu conquiert lui-même. La liberté donnée, octroyée n'est pas une liberté, mais une « marchandise volée». « Il n'y a pas d'autre juge que moi-même qui puisse décider si j’ai raison ou non. » « Les seules choses que je n'ai pas le droit de faire sont celles que je ne fais pas d'un esprit libre. » « Tu as le droit d'être ce que tu as la force d'être. » « Ce que tu accomplis, tu l'accomplis en tant qu'individu unique. » « L'État, la société, l'Humanité ne peuvent dompter ce diable. »
Pour s'affranchir, l'individu doit commencer par passer au crible le bagage dont l'ont obéré ses géniteurs et ses éducateurs. Il doit se livrer à un vaste travail de « désacralisation». A commencer par la morale dite bourgeoise : « Comme la bourgeoisie elle-même, son train propre, elle est encore trop près du ciel religieux, elle est encore trop peu libre, elle lui emprunte sans aucune critique ses lois, qu'elle transplante purement et simplement sur son propre terrain, au lieu de se créer des doctrines propres et indépendantes. »
Stirner en veut tout particulièrement à la morale sexuelle. Ce que le christianisme « a machiné contre la passion», les apôtres du laïcisme le reprennent purement et simplement à leur compte. Ils se refusent à entendre les appels de la chair. Ils déploient leur zèle contre elle. Ils frappent l’« immoralité en pleine gueule». Le préjugé moral que leur a inculqué le christianisme sévit, notamment, au sein des masses populaires : « Le peuple pousse furieusement la police contre tout ce qui lui paraît immoral ou simplement inconvenant, et cette furie populaire en faveur de la morale protège plus l'institution de la police que ne le pourrait jamais faire le gouvernement. »
Stirner, devançant la psychanalyse contemporaine, observe et dénonce l'intériorisation. Dès l'enfance les préjuges moraux nous ont été ingurgités. La morale est devenue « une puissance intérieure à laquelle je ne puis me soustraire». « Son despotisme est dix fois pire qu'antérieurement puisqu'il gronde dans ma conscience. » « On pousse les jeunes en troupeau à l'école afin qu'ils apprennent les vieilles ritournelles et quand ils savent par cœur le verbiage des vieux, on les déclare majeurs». Et Stirner se fait iconoclaste : « Dieu, la conscience, les devoirs, les lois sont des bourdes dont on nous a bourré la cervelle et le cœur. » Les vrais séducteurs et corrupteurs de la jeunesse, ce sont les prêtres, les parents qui « embourbent les jeunes cœurs et abêtissent les jeunes têtes». S'il est une œuvre « diabolique», c'est bien cette prétendue voix divine que l'on a introduite dans la conscience.
Stirner découvre aussi, dans sa réhabilitation de l'individu, le subconscient freudien. Le Moi ne se laisse pas appréhender. Contre lui, « l'empire de la pensée, de la cogitation, de l'esprit, se brise en miettes». Il est l’inexprimable, l'inconcevable, l'insaisissable. Et l'on entend à travers ses brillants aphorismes comme un premier écho de la philosophie existentielle : « Je pars d'une hypothèse en Me prenant pour hypothèse (...). Je m'en sers uniquement pour en jouir et m'en repaître (...). Je n'existe qu'en tant que Je m'en nourris (...). Le fait que je M'absorbe signifie que J'existe. »
Bien entendu, la verve qui emporte la plume de Stirner le fourvoie de temps à autre dans des paradoxes. Il lâche des aphorismes asociaux. Il lui arrive de conclure à l'impossibilité de la vie en société : « Nous n'aspirons pas à la vie commune, mais à la vie à part. » « Mort est le peuple ! Bonjour Moi! » « Le bonheur du peuple est mon malheur. » « Si c'est juste pour moi, c'est juste. Il est possible (...) que ce ne soit pas juste pour les autres ; c’est leur affaire et non la mienne : qu'ils se défendent. »
Mais ces ruades occasionnelles ne traduisent peut-être pas le fond de sa pensée. Stirner, en dépit de ses rodomontades d'ermite, aspire à la vie communautaire. Comme la plupart des isolés, des emmurés, des introvertis, il en a la lancinante nostalgie. A qui lui demande comment son exclusivisme pourrait lui permettre de vivre en société, il répond que seul l'homme qui a compris son « unicité » peut avoir des rapports avec ses semblables. L'individu a besoin d'amis, d'assistance ; si, par exemple, il écrit des livres, il a besoin d'oreilles. Il s'unit avec son prochain pour renforcer sa puissance et accomplir davantage par la force commune que ne le pourrait chacun isolément. « S'il y a derrière toi quelques millions d'autres pour te protéger, vous formez ensemble une puissance importante et vous aurez facilement la victoire. » Mais à une condition : ces rapports avec autrui doivent être volontaires et libres, constamment résiliables. Stirner distingue la société préétablie, qui est contrainte, de l'association, qui est un acte libre : « La société se sert de toi, et c'est toi qui te sers de l'association. » Certes l'association implique un sacrifice, une imitation de la liberté. Mais ce sacrifice n'est pas consenti à la chose publique : « C'est mon intérêt personnel seul qui m'y a amené. »
L'auteur de l'Unique et sa Propriété rencontre, tout particulièrement, les préoccupations contemporaines lorsqu'il aborde le problème du Parti en se référant expressément à celui des communistes. Il se livre à une critique sévère du conformisme de Parti. « Il faut suivre son Parti toujours et partout ; ses principes essentiels, il faut absolument les approuver et les soutenir. » « Les membres (...) se plient aux moindres désirs du Parti. Le programme du Parti doit « être pour eux le certain, l'indubitable (...). On doit appartenir corps et âme au Parti (...). Qui passe d'un Parti à un autre se fait traiter aussitôt de renégat. » Un Parti monolithique cesse, aux yeux de Stirner, d'être une association ; il n'est plus qu'un cadavre. Aussi rejette-t-il un tel Parti, mais non l'espoir d'entrer dans une association politique : « Je trouverai toujours assez de gens qui s'associeront avec moi sans avoir à prêter serment à mon drapeau. » Il ne pourrait rejoindre le Parti que s'il n'avait « rien d'obligatoire». La seule condition de son éventuelle adhésion serait qu'il ne puisse « se laisser prendre par le Parti». « Le Parti n'est toujours pour lui rien d'autre qu'une partie, il est de la partie, il prend part. » « Il s'associe librement et reprend de même sa liberté. »
Il ne manque qu'une explicitation dans le raisonnement de Stirner, bien qu'elle soit plus ou moins sous-jacente à travers ses écrits, à savoir : sa conception de l'unicité individuelle n'est pas seulement « égoïste», profitable à son « Moi», mais elle est rentable aussi pour la collectivité. Une association humaine n'est féconde que si elle ne broie pas l'individu, que si, au contraire, elle développe son initiative, son énergie créatrice. La force d'un parti, n'est-ce pas l'addition de toutes les forces individuelles qui le composent ?
La lacune en question provient du fait que la synthèse stirnérienne de l'individu et de la société demeure incomplète, boiteuse. L'asocial et le social s'affrontent dans la pensée de ce révolté sans toujours se fondre. Les anarchistes sociétaires, à juste titre, lui en feront grief.
Ils le feront avec d'autant plus d'aigreur que Stirner, sans doute mal informé, avait commis l'erreur de ranger Proudhon parmi les communistes « autoritaires » qui au nom du « devoir social » condamnent l'aspiration individualiste. Or, s'il est vrai que Proudhon a persiflé l’« adoration » stirnérienne de l'individu2, son œuvre entière est la recherche d'une synthèse ou, plutôt, d'une équilibration entre le souci de l'individu et l'intérêt de la société, entre la force individuelle et la force collective. « Comme l'individualisme est le fait primordial de l'humanité, l'association en est le terme complémentaire. » « Les uns, considérant que l'homme n'a de valeur que par la société (...) tendent à absorber l'individu dans la collectivité. Tel est (...) le système communiste, la déchéance de la personnalité au nom de la société (....) C'est de la tyrannie, une tyrannie mystique et anonyme ; ce n'est pas de l'association (...). La personne humaine destituée de ses prérogatives, la société s'est trouvée dépourvue de son principe vital. »
Mais, en sens contraire, Proudhon s'en prend à l'utopie individualiste qui agglomère des individualités juxtaposées, sans rien d'organique, sans force de collectivité, et se révèle incapable de résoudre le problème de l'accord des intérêts. Pour conclure : ni communisme, ni liberté illimitée. « Nous avons trop d'intérêts solidaires, trop de choses communes. »
Bakounine, à son tour, est, à la fois, individualiste et sociétaire. Il ne cesse de répéter que c'est en partant de l'individu libre que pourra s'élever une société libre. Chaque fois qu'il énonce des droits qui doivent être garantis à des collectivités, tels que le droit d'autodétermination et de sécession, il prend soin de placer l'individu en tête de ses bénéficiaires. L'individu n'a des devoirs vis-à-vis de la société que dans la mesure où il a consenti librement à en faire partie. Chacun est libre de s'associer ou de ne point s'associer, d'aller, s'il le désire, « vivre dans les déserts ou dans les forêts parmi les bêtes sauvages». « La liberté, c'est le droit absolu de chaque être humain de ne point chercher d'autre sanction à ses actes que sa propre conscience, de ne les déterminer que par sa volonté propre et de n'en être, par conséquent, responsable que vis-à-vis de lui-même d’abord. » La société dont l'individu a choisi librement de faire partie ne figure dans la susdite énumération des responsabilités qu'au second rang. Et elle a vis-à-vis de lui plus de devoirs que de droits : elle n'exerce sur lui, à condition qu'il soit majeur, « ni surveillance ni autorité», mais elle lui doit « la protection de sa liberté».
Bakounine pousse très loin la pratique d'une « liberté absolue et complète». J'ai le droit de disposer de ma propre personne à ma guise, d'être fainéant ou actif, de vivre soit honnêtement, par mon propre travail, soit même en exploitant honteusement la charité ou la confiance privée. Une seule condition : que cette charité et cette confiance soient volontaires et ne me soient prodiguées que par des individus majeurs. J'ai même le droit d'entrer dans des associations qui, par leur objet, seraient, ou paraîtraient « immorales». Bakounine va jusqu'à admettre, dans son souci de liberté, que j'adhère à celles qui auraient pour objet la corruption et la destruction de la liberté individuelle ou publique : « La liberté ne peut et ne doit se défendre que par la liberté ; et c'est un contresens dangereux que de vouloir y porter atteinte sous le prétexte spécieux de la protéger. »
Quant au problème éthique, Bakounine est persuadé que l’« immoralité » est la conséquence d'une organisation vicieuse de la société. Il faut donc détruire cette dernière de fond en comble. On ne peut moraliser que par la seule liberté. Toute restriction imposée sous le prétexte de protéger la morale a toujours tourné au détriment de celle-ci. La répression, loin d'avoir arrêté le débordement de l'immoralité, l'a toujours plus profondément et plus largement développée. Il est donc oiseux de lui opposer les rigueurs d'une législation qui empiéterait sur la liberté individuelle. Pour les personnes parasitaires, oisives, malfaisantes, Bakounine n'admet qu'une sanction : la privation des droits politiques, c'est-à-dire des garanties accordées par la société à l'individu. De même, tout individu a le droit d'aliéner lui-même sa liberté, mais, alors, il est destitué de la jouissance de ses droits politiques pendant la durée de cette servitude volontaire.
S'il s'agit de crimes, ils doivent être regardés comme une maladie et leur punition comme une cure plutôt que comme une vindicte de la société. Au surplus l'individu condamné doit conserver le droit de ne pas se soumettre à la peine encourue en déclarant qu'il ne veut plus faire partie de la société en question. Celle-ci, en retour, a le droit de l'expulser de son sein et de le déclarer en dehors de sa garantie et de sa protection.
Mais Bakounine n'est nullement un nihiliste. La proclamation de l'absolue liberté individuelle ne lui fait pas renier toute obligation sociale. Je ne deviens libre que par la liberté des autres. « L'homme ne réalise sa libre individualité qu'en se complétant de tous les individus qui l'entourent et seulement grâce au travail et à la puissance collective de la société. » L'association est volontaire, mais il ne fait aucun doute pour Bakounine que, vu ses énormes avantages, « l'association sera préférée par tout le monde». L'homme est à la fois « le plus individuel et le plus social des animaux».
Aussi notre auteur n'est-il pas tendre pour l'égoïsme au sens vulgaire du mot, pour l'individualisme bourgeois « qui pousse l'individu à conquérir et à établir son propre bien-être (...) malgré tout le monde, au détriment et sur le dos des autres». « Cet individu humain solitaire et abstrait est une fiction, pareille à celle de Dieu. » « L'isolement absolu, c'est la mort intellectuelle, morale et matérielle aussi. »
Esprit large et synthétique, Bakounine propose de jeter un pont entre les individus et le mouvement des masses : « Toute vie sociale n'est autre chose que cette dépendance mutuelle incessante des individus et des masses. Tous les individus, même les plus intelligents, les plus forts (...) sont à chaque instant de leur vie, à la fois des promoteurs et les produits des volontés et de l'action des masses. » Pour l'anarchiste, le mouvement révolutionnaire est le produit de cette action réciproque ; aussi attache-t-il, du point de vue de la rentabilité militante, une égale importance à l'action individuelle et à l'action collective, autonome, des masses.
Les héritiers spirituels de Bakounine, les anarchistes espagnols, bien que férus de socialisation, n'omettront pas de garantir solennellement, à la veille même de la Révolution de juillet 1936, l'autonomie sacrée de l'individu : « L'éternelle aspiration à l'unicité, écrira Diego Abad de Santillan, s'exprimera de mille manières ; l'individu ne sera pas étouffé par un quelconque nivellement (...) L'individualisme, le goût particulier, la singularité trouveront un champ suffisant pour se manifester. »
Les sources d’énergie : les masses
La Révolution de 1848 a fait découvrir à Proudhon que les masses sont la force motrice des révolutions : « Les révolutions, observe-t-il à la fIn de 1849, ne reconnaissent pas d'initiateurs ; elles viennent quand le signal des destinées les appelle ; elles s'arrêtent quand la force mystérieuse qui les fait éclore est épuisée. » « Toutes les révolutions se sont accomplies par la spontanéité du peuple ; si quelquefois les gouvernements ont suivi l'initiative populaire, ç'a été comme forcés et contraints. Presque toujours ils ont empêché, comprimé, frappé. » « Le peuple, quand il est livré à son seul instinct voit toujours plus juste que lorsqu'il est conduit par la politique de ses meneurs. » « Une révolution sociale (..) n'arrive pas au commandement d'un maître ayant sa théorie toute faite, ou sous la dictée d'un révélateur. Une révolution vraiment organique, produit de la vie universelle, bien qu'elle ait ses messagers et ses exécuteurs, n'est vraiment l'œuvre de personne. » La révolution doit être menée par en bas et non par en haut. Une fois la crise révolutionnaire franchie, la reconstruction sociale devrait être l'œuvre des masses populaires elles-mêmes. Proudhon affirme « la personnalité et l'autonomie des masses».
Bakounine, à son tour, ne se lasse pas de répéter qu'une révolution sociale ne peut être ni décrétée ni organisée par en haut, mais qu'elle ne peut être faite ni amenée à son plein développement que par l'action spontanée et continue des masses. Les révolutions « viennent comme un larron dans la nuit». Elles sont « produites par la force des choses». « Elles se préparent longtemps dans la profondeur de la conscience instinctive des masses populaires — puis elles éclatent, suscitées en apparence souvent par des causes futiles». « On peut les prévoir, en pressentir l'approche (...), mais jamais en accélérer l'explosion. » « La révolution sociale anarchiste (...) surgit d'elle-même, au sein du peuple, en détruisant tout ce qui s'oppose au débordement généreux de la vie populaire afin de créer ensuite, à partir des profondeurs mêmes de l'âme populaire, les nouvelles formes de la vie sociale libre. » Dans l'expérience de la Commune de 1871, Bakounine trouve une confirmation éclatante de ses vues. Les communards avaient la conviction que, dans la révolution sociale, « l'action des individus était presque nulle et l'action spontanée des masses devait être tout».
Kropotkine, comme ses devanciers, célèbre « cet admirable esprit d'organisation spontanée que le peuple (...) possède à un si haut degré et qu'on lui permet si rarement d'exercer». Pour ajouter, narquoisement : « Il faut avoir eu, toute sa vie, le nez dans les paperasses pour en douter. »
Mais l'anarchiste, après ces affirmations généreusement optimistes, se trouve, tout comme d'ailleurs son frère ennemi, le marxiste, aux prises avec une grave contradiction. La spontanéité des masses est essentielle, prioritaire, mais elle ne suffit pas à tout. Pour qu'elle atteigne à la conscience, l'assistance d'une minorité de révolutionnaires capables de penser la révolution se révèle indispensable. Comment éviter que cette élite ne mette à profit sa supériorité intellectuelle pour se substituer aux masses, paralyser leur initiative, voire leur imposer une nouvelle domination ?
Proudhon, après son exaltation idyllique de la spontanéité, en vient à constater l'inertie des masses, à déplorer le préjugé gouvernemental, l'instinct de déférence, le complexe d'infériorité qui entravent l'élan populaire. L'action collective du peuple doit en conséquence être suscitée. Si une révélation ne leur venait pas du dehors, la servitude des classes inférieures pourrait se prolonger indéfiniment. Et il concède que « les idées qui à toutes les époques ont agité les masses étaient écloses antérieurement dans le cerveau de quelques penseurs (...). La priorité ne fut jamais aux multitudes (...). La priorité en tout acte de l'esprit est à l'individualité». L'idéal serait que ces minorités conscientes fissent passer leur science, la science révolutionnaire, dans le peuple. Mais Proudhon semble sceptique quant à la praticabilité d'une telle synthèse : ce serait, selon lui, méconnaître la nature envahissante de l'autorité. Tout au plus pourrait-on en équilibrer les deux éléments.
Bakounine, avant de se convertir, vers 1864, à l'anarchisme, a tenu les fils de conspirations et de sociétés secrètes et il s'est familiarisé avec l'idée, typiquement blanquiste, que l'action minoritaire doit devancer l'éveil des larges masses, pour ensuite, les ayant tirées de leur léthargie, s'adjoindre leurs éléments les plus avancés. Dans l'internationale ouvrière, vaste mouvement prolétarien enfin constitué, le problème se pose de façon différente. Cependant Bakounine, devenu anarchiste, demeure convaincu de la nécessité d'une avant-garde consciente : « Pour le triomphe de la révolution contre la réaction, il est nécessaire qu'au milieu de l'anarchie populaire qui constituera la vie même et toute l'énergie de la révolution, l'unité de la pensée et de l'action révolutionnaires trouve un organe. » Un groupe plus ou moins nombreux d'individus inspirés par la même pensée et tendant vers le même but doit exercer une « action naturelle sur les masses». « Dix, vingt ou trente hommes bien entendus et bien organisés entre eux, et qui savent où ils vont et ce qu'ils veulent, en entraînent facilement cent, deux cents, trois cents ou même davantage. » « Ce que nous devons former, ce sont les états-majors bien organisés et bien inspirés des chefs du mouvement populaire. »
Les moyens préconisés par Bakounine ressemblent fort à ce que le jargon politique moderne désigne sous le nom de « noyautage». Il s'agit de travailler « sous main » les individus les plus intelligents et les plus influents de chaque localité « pour que cette organisation soit autant que possible conforme à nos principes. Tout le secret de notre influence est là». Les anarchistes doivent être comme des « pilotes invisibles » au milieu de la tempête populaire. Ils doivent la diriger, non par un « pouvoir ostensible», mais par une « dictature sans écharpe, sans titre, sans droit officiel et d'autant plus puissante qu'elle n'aura aucune des apparences du pouvoir».
Mais Bakounine n'ignore pas combien sa terminologie (« chefs», « dictature», etc.) diffère peu de celle des adversaires de l'anarchisme et il réplique à l'avance « à quiconque prétendrait qu'une action ainsi organisée est encore un attentat à la liberté des masses, une tentative de créer une nouvelle puissance autoritaire» : Non ! L'avant-garde consciente ne doit être ni le bienfaiteur ni le chef dictatorial du peuple, mais seulement l'accoucheur aidant à son autolibération. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de répandre dans les masses des idées correspondant à ses instincts, mais rien au-delà. Tout le reste ne doit et ne peut se faire que par le peuple lui-même. Les « autorités révolutionnaires » (Bakounine ne recule pas devant ce mot et s'en excuse en exprimant le vœu « qu'il y en ait aussi peu que possible») doivent, non pas imposer la révolution aux masses, mais la provoquer dans leur sein, non les soumettre à une organisation quelconque, mais susciter leur organisation autonome de bas en haut.
Comme l'explicitera, beaucoup plus tard, Rosa Luxembourg, Bakounine entrevoit que la contradiction entre la spontanéité libertaire et la nécessité de l’intervention des avant-gardes conscientes ne sera vraiment résolue que le jour où s'opérera la fusion de la science avec la classe ouvrière, où la masse devenue pleinement consciente n'aura plus besoin de « chefs», mais seulement d'« organes exécutifs » de son « action consciente». Après avoir souligné qu'il manque encore au prolétariat l'organisation et la science, l'anarchiste russe en arrive à la conclusion que l'Internationale ne pourra devenir un instrument d’émancipation « que lorsqu'elle aura fait pénétrer dans la conscience réfléchie de chacun de ses membres la science, la philosophie et la politique du socialisme».
Mais cette synthèse, satisfaisante du point de vue théorique, est une traite tirée sur un lointain avenir. Et, en attendant que l'évolution historique permette son accomplissement, les anarchistes, tout comme les marxistes, demeureront plus ou moins prisonniers d'une contradiction. Elle déchirera la Révolution russe, tiraillée entre le pouvoir spontané des soviets et la prétention du parti bolchevique au « rôle dirigeant», comme elle se manifestera dans la Révolution espagnole, où les libertaires oscilleront entre deux pôles : celui du mouvement de masses et celui de l’élite anarchiste consciente.
On se bornera à illustrer cette contradiction par deux citations :
De l'expérience de la Révolution russe, les anarchistes tireront une conclusion catégorique : la condamnation du « rôle dirigeant » du Parti. L'un d'eux, Voline, la formulera en ces termes : « L'idée maîtresse de l'anarchisme est simple : aucun parti, groupement politique ou idéologique, se plaçant au-dessus ou en dehors des masses laborieuses pour les “gouverner” ou les “guider”, ne réussira jamais à les émanciper, même s'il le désire sincèrement. L’émancipation effective ne pourrait être réalisée que par une activité directe (...) des intéressés, des travailleurs eux-mêmes, groupés, non pas sous la bannière d'un parti politique ou d'une formation idéologique, mais dans leurs propres organismes de classe (syndicats de production, comités d'usines, coopératives, etc.), sur la base d'une action concrète et d'une « auto-administration», aidés, mais non gouvernés, par les révolutionnaires œuvrant au sein même, et non au-dessus, de la masse (...). L'idée anarchiste et la véritable révolution émancipatrice ne pourraient être réalisées par les anarchistes comme tels, mais uniquement par les vastes masses (...), les anarchistes, ou plutôt les révolutionnaires en général, n'étant appelés qu'à éclairer et à aider celles-ci dans certains cas. Si les anarchistes prétendaient pouvoir accomplir la révolution sociale en “guidant” les masses, une pareille prétention serait illusoire, comme le fut celle des bolcheviks, et pour les mêmes raisons. »
Cependant les anarchistes espagnols ressentiront, à leur tour, la nécessité d'organiser une minorité consciente idéologique, la Fédération Anarchiste Ibérique, au sein de leur vaste Centrale syndicale, la Confédération Nationale du Travail, afin d'y combattre les tendances réformistes de certains syndicalistes « purs», aussi bien que les manœuvres des affidés de la « dictature du prolétariat». S'inspirant des recommandations de Bakounine, la F.A.I. s'efforcera d'éclairer plutôt que de diriger, et, aussi, la conscience libertaire relativement élevée de nombreux éléments de base de la C.N.T. l'aidera à ne pas tomber dans les excès des partis révolutionnaires « autoritaires». Toutefois, elle jouera assez médiocrement son rôle de guide, maladroite dans ses velléités de mise en tutelle des syndicats, flottante dans sa stratégie, plus riche en activistes et en démagogues qu'en révolutionnaires conséquents tant sur le plan de la théorie que sur celui de la pratique.
Les rapports entre la masse et la minorité consciente forment un problème dont la solution n'a pas encore été pleinement trouvée, même par les anarchistes, et sur lequel le dernier mot semble n'avoir pas été dit.
Deuxième partie : à la recherche de la société future
L’anarchisme n’est pas utopique
Du fait même qu'il se veut constructif, l'anarchisme rejette, tout d’abord, l’accusation d'utopie. Il recourt à la méthode historique pour tenter de prouver que la société future n’est pas son invention, mais le produit même d'un travail souterrain du passé. Proudhon affirme que l'humanité, sous l’inexorable système de l’autorité qui l'a écrasé depuis six mille ans, a été soutenue par une « vertu secrète » : « Au-dessous de l'appareil gouvernemental, à l'ombre des institutions politiques, la société produisait lentement et en silence son propre organisme : elle se faisait un ordre nouveau, expression de sa vitalité et de son autonomie. »
Le gouvernement, aussi malfaisant qu'il ait été, contient en lui sa propre négation. Il est « un phénomène de la vie collective, la représentation externe de notre droit, une manifestation de la spontanéité sociale, une préparation de l'humanité à un état supérieur. Ce que l'humanité cherche dans la religion et qu’elle appelle Dieu, c'est elle-même. Ce que le citoyen cherche dans le gouvernement (...) c’est lui-même aussi, c'est la liberté». La Révolution Française a accéléré cette marche invincible vers l’anarchie : « Du jour où nos pères (...) posèrent en principe le libre exercice des facultés de l'homme et du citoyen, ce jour-là l'autorité fut mise dans le ciel et sur la terre et le gouvernement, même par voie de délégation, rendu impossible».
La révolution industrielle a fait le reste. La politique est désormais primée, subalternisée, par l'économie. Le gouvernement ne peut plus s'affranchir du concours direct des producteurs, il n'est plus en réalité que le rapport des intérêts. La formation du prolétariat a achevé cette évolution. Le pouvoir, malgré ses protestations, n'exprime plus que le socialisme. « Le code Napoléon est aussi incapable de servir la société nouvelle que la république platonienne : encore quelques années, et l'élément économique, substituant partout le droit relatif et mobile de la mutualité industrielle au droit absolu de la propriété, il faudra reconstruire de fond en comble ce palais de carton. »
Bakounine, à son tour, salue l'« incontestable et immense service rendu à l'humanité par cette Révolution française dont nous sommes tous les enfants». Le principe d'autorité a été anéanti dans la conscience du peuple, l'ordre inspiré d'en haut est devenu à tout jamais impossible. Reste maintenant « à organiser la société de manière qu'elle puisse vivre sans gouvernement». Pour ce faire, Bakounine s'appuie sur la tradition populaire. Les masses, « malgré la tutelle oppressive et malfaisante de l'État», ont, à travers les siècles, « spontanément développé en leur sein, sinon encore tous les éléments, au moins beaucoup des éléments essentiels de l'ordre matériel et moral constitutif de la réelle unité humaine».
Nécessité de l’organisation
L'anarchisme ne se veut point synonyme de désorganisation. Proudhon a été le premier à proclamer que l'anarchie n'est pas le désordre, mais l'ordre, qu'elle est l'ordre naturel, par opposition à l'ordre artificiel imposé d'en haut, qu'elle est l'unité vraie, par rapport à la fausse unité qu'engendre la contrainte. Une société de ce genre pense, parle, agit comme un homme, et cela précisément parce qu'elle n'est plus représentée par un homme, parce qu'elle ne reconnaît plus d’autorité personnelle, parce qu'en elle, comme en tout être organisé et vivant, comme dans l'infini de Pascal, le centre est partout, la circonférence nulle part». L'anarchie, c'est la « société organisée, vivante», « le plus haut degré de liberté et d'ordre auquel l'humanité puisse parvenir». Si certains anarchistes ont pu penser autrement, l’Italien Errico Malatesta les rappelle à l'ordre : « Croyant, sous l'influence de l'éducation autoritaire reçue, que l'autorité est l'âme de l'organisation sociale, pour combattre celle-là ils ont combattu et nié celle-ci (...). L’erreur fondamentale des anarchistes adversaires de l’organisation est de croire qu'une organisation n’est pas possible sans autorité — et de préférer, une fois admise cette hypothèse, renoncer à toute organisation plutôt que d'accepter la moindre autorité (...). Si nous croyions qu'il ne pourrait pas y avoir d'organisation sans autorité, nous serions des autoritaires, parce que nous préférerions encore l'autorité qui entrave et rend triste la vie à la désorganisation qui la rend impossible. »
Voline, anarchiste russe du XXe siècle, renchérit et précise : « Une interprétation erronée — ou, le plus souvent, sciemment inexacte — prétend que la conception libertaire signifie l'absence de toute organisation. Rien n'est plus faux. Il s'agit, non pas d’ “organisation” ou de “non-organisation”, mais de deux principes différents d'organisation (...). Naturellement, disent les anarchistes, il faut que la société soit organisée. Mais cette organisation nouvelle (...) doit se faire librement, socialement et, avant tout, en partant de la base. Le principe d’organisation doit sortir, non d'un centre créé d’avance pour accaparer l'ensemble et s'imposer à lui, mais— ce qui est exactement le contraire — de tous les points, pour aboutir à des nœuds de coordination, centres naturels destinés à desservir tous ces points (...). Tandis que l’autre “organisation”, calquée sur celle d’une vieille société d'oppression et d'exploitation (...) porterait à leur paroxysme toutes les tares de la vieille société (...). Elle ne pourrait se maintenir autrement qu'à l'aide d'un nouvel artifice. »
En fait, les anarchistes ne seront pas seulement des partisans de la véritable organisation mais, comme en conviendra Henri Lefebvre dans un livre récent sur la Commune, « des organisateurs de tout premier ordre». Cependant le philosophe croit apercevoir là une contradiction, « contradiction assez étonnante, observe-t-il, que l'on retrouve dans l'histoire du mouvement ouvrier jusqu'à nos jours et notamment en Espagne». Elle ne peut « étonner » que ceux pour qui les libertaires sont, a priori, des désorganisateurs.
L’autogestion
Alors que le Manifeste Communiste de Marx et d'Engels, rédigé au début de 1848, à la veille de la Révolution de Février, n'entrevoyait d'autre solution — au moins pour une longue période transitoire — que la centralisation entre les mains de l'État fourre-tout de l'ensemble des instruments de production et empruntait à Louis Blanc l'idée autoritaire d'embrigader les travailleurs de la manufacture comme ceux de la terre dans des « armées industrielles», Proudhon est le premier à proposer une conception antiétatique de la gestion économique.
La Révolution de Février a vu naître à Paris, à Lyon, une floraison spontanée d'associations ouvrières de production. Cette autogestion naissante est pour le Proudhon de 1848, beaucoup plus que la révolution politique, le « fait révolutionnaire». Elle n'a pas été inventée par un théoricien, prêchée par des doctrinaires. Ce n'est pas l'État qui a donné la première impulsion. C'est le peuple. Et Proudhon presse les travailleurs de s'organiser pareillement sur tout les points de la République, d'attirer à eux, d'abord la petite propriété, le petit commerce et la petite industrie, puis la grande propriété et les grandes entreprises, puis les exploitations les plus vastes (mines, canaux, chemins de fer, etc.) et, ainsi, de « devenir maîtres de tout».
On a tendance, aujourd'hui, à ne retenir de Proudhon que ses velléités, naïves certes, antiéconomiques sans aucun doute, de faire survivre la petite entreprise artisanale et commerciale. Mais sa pensée est ambivalente sur ce point. Proudhon était une contradiction vivante. Il fustigeait la propriété, source d'injustice et d'exploitation, et il n'avait un faible pour elle que dans la mesure où il croyait voir en elle un gage d'indépendance personnelle. Au surplus, on a trop souvent tendance à confondre Proudhon avec la « petite coterie soi-disant proudhonienne » qui, au dire de Bakounine, s'était formée autour de lui dans les dernières années de sa vie. Cette coterie passablement réactionnaire était « mort-née». Elle tenta vainement, dans la Première Internationale, d'opposer la propriété privée des moyens de production au collectivisme. Et, si elle ne fit pas long feu, ce fut surtout parce que la majorité de ses adeptes, aisément convaincue par les arguments de Bakounine, ne tarda pas à abandonner ses conceptions soi-disant proudhoniennes pour le collectivisme.
D'ailleurs le dernier carré des « mutuellistes», comme ils s'intitulaient, ne rejetaient que partiellement la propriété collective : ils ne la combattaient que dans l’agriculture, eu égard à l'individualisme du paysan français ; mais ils l'acceptaient dans les transports et, en matière d'autogestion industrielle, ils réclamaient la chose tout en repoussant le nom. S'ils avaient si peur du nom, c'était, surtout, parce que le front unique temporaire formé contre eux par les collectivistes disciples de Bakounine et certains marxistes « autoritaires », partisans à peine déguisés de la gestion étatique de l'économie, n'était pas pour les rassurer.
En fait, Proudhon marche avec son temps. Il comprend qu'il est impossible de revenir en arrière. Il est assez réaliste pour apercevoir, comme il le confie dans ses Carnets, que « la petite industrie est aussi sotte chose que la petite culture». Pour la grande industrie moderne, exigeant une importante main-d'œuvre, une mécanisation poussée, il est délibérément collectiviste : « La grande industrie et la grande culture, il faut à l'avenir les faire naître de l'association. » « Nous n'avons pas le choix», tranche-t-il. Et il s'indigne qu'on ait osé le prétendre adversaire du progrès technique.
Mais son collectivisme rejette tout aussi catégoriquement l'étatisme. La propriété doit être abolie. Quant à la communauté (au sens que lui donne le communisme « autoritaire»), elle est oppression et servitude. Proudhon recherche donc une combinaison de la communauté et de la propriété. C'est l'association. Les instruments de production et d'échange ne doivent être gérés ni par des compagnies capitalistes ni par l'État. Étant aux ouvriers qu'ils occupent « ce que la ruche est aux abeilles», leur gestion est à confier à des associations ouvrières. Ainsi seulement les forces collectives cesseraient d'être « aliénées » au profit de quelques exploitants. « Nous, producteurs associés ou en voie d'association, écrit Proudhon dans un style de manifeste, nous n'avons pas besoin de l'État (...). L'exploitation par l'État, c'est toujours de la monarchie, toujours du salariat (...). Nous ne voulons pas plus du gouvernement de l'homme par l'homme que de l'exploitation de l'homme par l'homme. Le socialisme est le contraire du gouvernementalisme (...). Nous voulons que ces associations soient (...) le premier noyau de cette vaste fédération de compagnies et de sociétés, réunies dans le commun lien de la république démocratique et sociale. »
*
Entrant dans le détail de l'autogestion ouvrière, Proudhon en énumère, avec précision, les données essentielles :
Tout individu associé a un droit indivis dans l'actif de la compagnie.
Chaque ouvrier doit assumer sa part des corvées répugnantes et pénibles.
Il doit parcourir une série de travaux et de connaissances, de grades et d'emplois qui lui assurent une formation encyclopédique. Proudhon tient absolument à « faire parcourir à l'ouvrier la série entière des opérations de l'industrie à laquelle il est attaché».
Les fonctions sont électives et les règlements soumis à l'approbation des associés.
Les rémunérations sont proportionnées à la nature de la fonction, à l'importance du talent, à l'étendue de la responsabilité. Tout associé participe aux bénéfices dans la proportion de ses services.
Chacun est libre de quitter à volonté l'association, de faire régler son temps et liquider ses droits.
Les travailleurs associés choisissent leurs conducteurs, leurs ingénieurs, leurs architectes, leurs comptables. Proudhon insiste sur le fait que le prolétariat manque encore de techniciens. D'où nécessité d'associer à l'autogestion ouvrière des « notabilités industrielles et commerciales » qui initieraient les ouvriers à la discipline des affaires et seraient rémunérées par un traitement fixe : il y a a « place pour tout le monde au soleil de la révolution».
*
Cette conception libertaire de l'autogestion est aux antipodes de l'autogestion paternaliste et étatique telle que l'a esquissée Louis Blanc dans un projet de décret du 15 septembre 1849. L'auteur de L'Organisation du Travail veut, lui, créer des associations ouvrières sous l'égide de l'État, commanditées par l'État. Il prévoit pour elles une répartition autoritaire des bénéfices, ainsi ventilés :
25 % à un fonds d'amortissement du capital ;
25 % à un fonds de secours social ;
25 % à un fonds de réserve ;
25 % à partager entre les travailleurs3 .
Proudhon ne veut rien entendre d'une autogestion de ce type. Pour lui, les travailleurs associés ne doivent pas « se soumettre à l'État», mais « être l'État lui-même». « L'association (...) peut tout faire, tout réformer sans l'assistance du pouvoir, envahir et se soumettre le pouvoir lui-même. » Proudhon veut « marcher au gouvernement par l'association, non à l'association par le gouvernement». Et il met en garde contre l'illusion que l'État, tel que le rêvent les socialistes « autoritaires», pourrait tolérer une autogestion libre. Comment, en effet, supporterait-il « à côté d'un pouvoir centralisé la formation de foyers ennemis» ? Proudhon lance prophétiquement cette mise en garde : « Rien n'est faisable par l'initiative, par la spontanéité, par l'action indépendante des individus et des collectivités tant qu'elles seront en présence de cette force colossale dont l'État est investi par la centralisation. »
*
Il convient de faire remarquer ici que c'est la conception libertaire, et non la conception étatique, de l'autogestion qui prévaudra dans les congrès de la Première Internationale. Au congrès de Lausanne (1867), le rapporteur, le Belge César de Paepe, ayant proposé de rendre l'État propriétaire des entreprises à nationaliser, Charles Longuet, alors libertaire, déclare : « D'accord, à la condition qu'il soit bien entendu que nous définissions l'État “la collectivité des citoyens” (...), aussi que ces services ne seront pas administrés par des fonctionnaires de l'État, (...) mais par des compagnies ouvrières... » Le débat reprend l'année suivante (1868) au congrès de Bruxelles et le même rapporteur, cette fois, prend soin d'apporter la précision réclamée : « La propriété collective appartiendrait à la société entière, mais elle serait concédée à des associations de travailleurs. L'État ne serait plus que la fédération des divers groupes de travailleurs. » La proposition, ainsi clarifiée, est adoptée.
*
Cependant l'optimisme dont Proudhon avait fait preuve en 1848 à l'égard de l'autogestion devait être démenti par la leçon des faits. Quelques années plus tard, en 1857, il soumit les associations ouvrières existantes à une sévère critique. Leur inspiration avait été naïve, illusoire, utopique. Elles avaient payé le tribut de l'inexpérience. Elles étaient tombées dans le particularisme et l'exclusivisme. Elles avaient fonctionné comme un patronat collectif, subi l'entraînement des idées de hiérarchie et de suprématie. Tous les abus des sociétés capitalistes « furent exagérés encore dans ces compagnies soi-disant fraternelles», Elles avaient été déchirées par la discorde, les rivalités, les défections, les trahisons. Leurs gérants, une fois initiés aux affaires, s'étaient retirés « pour s'établir à leur compte en patron et bourgeois». Ailleurs, ce furent les associés qui avaient réclamé le partage des produits. De plusieurs centaines d'associations ouvrières créées en 1848, il en restait, neuf ans plus tard, tout juste une vingtaine.
Et Proudhon opposait à cette mentalité étroite et particulariste une conception de l'autogestion « universelle » et « synthétique». Car la tâche de l'avenir, c'était beaucoup plus que « la réunion en sociétés de quelques centaines d'ouvriers», c'était « la reconstitution économique d'une nation de 36 millions d'âmes». Les associations ouvrières futures devraient « au lieu d'agir au profit de quelques-uns», travailler pour tous. L'autogestion exigeait donc « une certaine éducation » des autogestionnaires. « On ne naît point associé, on le devient. » La tâche la plus difficile des associations c'était « de civiliser les associés». Ce qui leur avait manqué c'était « des hommes sortis du sein des masses travailleuses qui aient appris à l'école des exploiteurs à se passer d'eux». Il s'agissait moins de former une « masse de capitaux » qu'un « fonds d'hommes».
Sur le plan juridique, Proudhon avait d'abord envisagé de confier aux associations ouvrières la propriété de leurs entreprises. Maintenant il rejetait cette solution particulariste. Pour ce faire, il distinguait entre possession et propriété. La propriété est absolutiste, aristocratique, féodale, despotique ; la possession est démocratique, républicaine, égalitaire : elle consiste en la jouissance usufruitaire d'une concession incessible et inaliénable. Les producteurs recevraient, à titre d'« alleu», tout comme les anciens Germains, leurs instruments de production. Ils n'en seraient pas les propriétaires. Ce qui succéderait à la propriété, ce serait une copropriété fédérative attribuée, non certes à un État, mais à l'ensemble des producteurs réunis en une vaste fédération agricole et industrielle.
Et Proudhon de s'échauffer sur l'avenir d'une autogestion ainsi revue et corrigée : « Ce n'est pas une vaine rhétorique qui le déclare, c'est la nécessité économique et sociale : le moment approche où nous ne pourrons plus marcher qu'à ces conditions nouvelles (...). Les classes (...) doivent se résoudre dans une seule et même association de producteurs. » L'autogestion réussira-t-elle ? « De la réponse qui sera faite (...) dépend tout l'avenir des travailleurs. Si cette réponse est affirmative, un nouveau monde s'ouvre à l'humanité ; si elle est négative, le prolétaire peut se le tenir pour dit (...). Il n'y a pour lui, dans ce bas monde, point d'espérance. »
Les bases de l’échange
Sur quelles bases assurer les échanges entre les diverses associations ouvrières ? Proudhon a, d'abord, soutenu que la valeur d'échange de toutes les marchandises peut être mesurée par la quantité de travail nécessaire pour les produire. Les diverses associations de production cèdent leurs produits au prix de revient. Les travailleurs rétribués en « bons de travail » achètent dans les comptoirs d'échange ou magasins sociaux les marchandises au prix de revient estimé en heures de travail. Les échanges les plus importants s’effectuent par l'intermédiaire d'un clearing compensateur ou Banque du Peuple, qui accepte en paiement les bons de travail.
Cette Banque joue en même temps l'office d'un établissement de crédit. Elle prête aux associations ouvrières de production les sommes nécessaires à leur bonne marche. Ces prêts sont consentis sans intérêt.
Cette conception dite mutuelliste était quelque peu utopique, en tout cas malaisée à mettre en application dans un régime capitaliste. La Banque du Peuple, fondée par Proudhon au début de 1849, réussit à obtenir, en six semaines, quelque 20.000 adhésions, mais son existence fut brève. Il était surtout chimérique de croire que le mutuellisme ferait tâche d'huile, de s'exclamer, comme le Proudhon d'alors : « C'était vraiment le nouveau monde, la société de promission qui, se greffant sur l'ancienne, la transformait peu à peu ! »
Quant à la rémunération basée sur l'évaluation de l'heure de travail, elle est, à divers titres, contestable. Les « communistes libertaires » de l'école de Kropotkine, Malatesta, Élisée Reclus, Carlo Cafiero, etc., ne se feront pas faute de la critiquer. Tout d'abord, à leurs yeux, elle est injuste. « Trois heures de travail de Pierre, objecte Cafiero, peuvent souvent valoir cinq heures de travail de Paul». D'autres facteurs que la seule durée interviennent dans la détermination de la valeur du travail : l'intensité, la formation professionnelle et intellectuelle, etc. Il faudrait aussi tenir compte des charges de famille de l'ouvrier4. En outre, le travailleur demeure, en régime collectiviste, un salarié, esclave de la communauté qui achète et surveille sa force de travail. La rémunération proportionnelle aux heures de travail fournies par chacun ne peut être un idéal, tout au plus un pis-aller temporaire. Il faudra en finir avec la morale puisée dans les livres de comptabilité, avec la philosophie du « doit et avoir». Ce mode de rétribution procède d'un individualisme mitigé en contradiction avec la propriété collective des moyens de production. Il est incapable d'opérer une transformation de l'homme, profonde et révolutionnaire. Il est incompatible avec l’« anarchie». Une forme nouvelle de possession exige une forme nouvelle de rétribution. Les services rendus à la société ne peuvent être évalués en unités monétaires. Il faudra placer les besoins au-dessus des services. Tous les produits dus au travail de tous doivent appartenir à tous et chacun en prendre librement sa part. A chacun selon ses besoins, telle devrait être la devise du « communisme libertaire. »
Mais Kropotkine, Malatesta et leurs amis semblent avoir ignoré que Proudhon lui-même avait prévu leurs objections et révisé sa conception première. Sa Théorie de la Propriété, publiée après sa mort, explique que c'est seulement dans son Premier Mémoire sur la Propriété, celui de 1840, qu'il avait soutenu l'égalité de salaire à égalité de travail : « J'avais oublié de dire deux choses : la première, que le travail se mesure en raison composée de sa durée et de son intensité ; la seconde, qu'il ne faut comprendre dans le salaire du travailleur ni l'amortissement de ses frais d'éducation et du travail qu'il a fait sur lui-même comme apprenti non-payé ni la prime d'assurance contre les risques qu'il court, et qui sont loin d'être les mêmes dans chaque profession». Cet « oubli», Proudhon affirme l'avoir « réparé » dans ses écrits suivants, où il fait compenser par des sociétés coopératives d'assurances mutuelles les frais et risques inégaux. En outre Proudhon ne considère nullement la rétribution des membres de l'association ouvrière comme un « salaire», mais bien plutôt comme une répartition des bénéfices, librement décidée entre travailleurs associés et coresponsables. Sinon, comme le remarque à ce propos le plus récent des exégètes proudhoniens, Pierre Haubtmann, dans une thèse encore inédite, l’autogestion ouvrière n'aurait aucun sens.
Les « communistes libertaires » croient devoir reprocher au mutuellisme de Proudhon et au collectivisme, plus conséquent, de Bakounine, de n'avoir pas voulu préjuger la forme que prendrait, en régime socialiste, la rétribution du travail. Ces censeurs semblent perdre de vue que les deux fondateurs de l'anarchisme avaient le souci de ne pas enfermer, prématurément, la société dans un cadre rigide. Ils voulaient, sur ce point, réserver aux associations d'autogestion la plus grande latitude. Mais la justification de cette souplesse, de ce refus des solutions précipitées, les « communistes libertaires » la fourniront eux-mêmes, à l'encontre de leurs impatientes anticipations, lorsqu'ils souligneront que, dans le régime idéal de leur choix, « le travail produirait beaucoup plus qu'il ne faut pour tous » : ce n'est, en effet, que lorsque s'ouvrirait l'ère de l'abondance que les normes « bourgeoises » de rémunération pourraient faire place à des normes spécifiquement « communistes». Mais pas avant. Rédigeant, en 1884, le Programme d'une Internationale anarchiste encore dans les limbes, Malatesta conviendra que le communisme n'est immédiatement réalisable que dans des secteurs très restreints et que, « pour le reste», il faudra accepter « à titre transitoire » le collectivisme. « Le communisme, pour être réalisable, a besoin d'un grand développement moral des membres de la société, d'un sentiment élevé et profond de solidarité que l'élan révolutionnaire ne suffira peut-être pas à produire, d'autant plus que manqueront, dans les débuts, les conditions matérielles favorisant un tel développement. »
A la veille de la Révolution espagnole de 1936, où l'anarchisme affrontera l'épreuve des faits, Diego Abad de Santillan démontrera, à peu près dans les mêmes termes, l'impraticabilité immédiate du communisme libertaire. De l'avis de Santillan, le système capitaliste n'y a pas préparé les êtres humains : loin de développer en eux les instincts sociaux, le sens de la solidarité, il tend, au contraire, de toutes les façons, à bannir et à châtier ces sentiments.
Santillan invoquera les expériences révolutionnaires de Russie et d'ailleurs pour adjurer les anarchistes de se montrer plus réalistes. Il leur reprochera d'accueillir avec méfiance ou superbe les leçons les plus récentes du réel. Il est douteux, soutiendra-t-il, qu'une révolution nous conduise immédiatement à la réalisation de notre idéal communiste anarchiste. La consigne collectiviste : « à chacun le produit de son travail » répondrait mieux que le communisme aux exigences de la réalité dans la première phase d'une période révolutionnaire où la vie économique serait désorganisée, où sévirait la pénurie et où le ravitaillement serait une tâche prioritaire. Les formes économiques dont on ferait l’essai marqueraient, tout au plus, une évolution graduelle vers le communisme. Mettre brutalement en cage des êtres humains, les emprisonner dans des formes rigides de vie sociale serait une attitude autoritaire qui ferait obstacle à l'évolution. Mutuellisme, collectivisme, communisme ne sont que des moyens différents en vue d'atteindre les mêmes fins. Revenant au sage empirisme recommandé par Proudhon et Bakounine, Santillan réclamera pour la Révolution espagnole à venir le droit à la libre expérimentation : « Dans chaque localité, dans chaque milieu sera résolu le degré de communisme ou de collectivisme ou de mutuellisme qui pourra être atteint. »
En fait, comme on le verra plus loin, l’expérience des « collectivités » espagnoles de 1936 fera ressortir les difficultés d'application prématurée d'un communisme intégral.
La concurrence
Parmi les normes héritées de l’économie bourgeoise, il en est une dont le maintien, en économie collectiviste ou autogestionnaire, soulève d'épineux problèmes, à savoir la concurrence. Elle est, pour Proudhon, « l'expression de la spontanéité sociale», le gage de la « liberté » des associations. En outre, elle constitue, pour longtemps encore, un stimulant irremplaçable, sans lequel une « immense relâche » succéderait à la tension ardente de l'industrie et il précise : « Vis-à-vis de la société, la compagnie ouvrière s'engage à fournir toujours au prix le plus près du prix de revient les produits et services qui lui sont demandés (...). A cet effet la compagnie ouvrière s'interdit toute coalition [monopolistique], se soumet à la loi de la concurrence, tient ses livres et ses archives à la disposition de la société qui conserve à son égard, comme sanction de son droit de contrôle, la faculté de la dissoudre. » « La concurrence et l'association s'appuient l'une sur l'autre (...). La plus déplorable erreur du socialisme est de l'avoir regardée [la concurrence] comme le renversement de la société. Il ne saurait (...) être (...) question de détruire la concurrence (...). Il s'agit d'en trouver l'équilibre, je dirais volontiers la police. »
Cet attachement au principe de la concurrence valut à Proudhon les sarcasmes de Louis Blanc : « Nous ne saurions comprendre ceux qui ont imaginé je ne sais quel mystérieux accouplement des deux principes opposés. Greffer l'association sur la concurrence est une pauvre idée : c'est remplacer les eunuques par les hermaphrodites. » Louis Blanc voudrait, lui, « arriver à un prix uniforme», fixé par l'État, et empêcher toute concurrence entre les ateliers d'une même industrie. Proudhon lui rétorque que le prix « ne se règle que par la concurrence, c'est-à-dire par la faculté que le consommateur trouve (...) de se passer des services de celui qui les surfait (...). » « Ôtez la concurrence (...), la société, privée de force motrice, s'arrête comme une pendule dont le ressort est détendu. »
Proudhon, certes, ne se dissimule pas les méfaits de la concurrence qu'il a, au surplus, surabondamment décrits dans son traité d'économie politique. Il sait qu'elle est source d'inégalité. Il admet que « dans la concurrence la victoire est assurée aux plus gros bataillons». Tant qu'elle est « anarchique » (dans le sens péjoratif du terme), qu'elle ne s'exerce qu'au profit d'intérêts privés, elle engendre nécessairement la guerre civile, et, en fin de compte, l'oligarchie. « La concurrence tue la concurrence. »
Mais, de l’avis de Proudhon, l’absence de concurrence ne serait pas moins pernicieuse. Il cite l'exemple de la régie des tabacs. Ce monopole, du fait même qu'il est soustrait à la concurrence, est un service trop cher, sa productivité est insuffisante. Si toutes les industries étaient soumises à un tel régime, la nation, dit-il, ne pourrait plus équilibrer ses recettes et ses dépenses.
Mais la concurrence telle que la rêve Proudhon n'est pas la concurrence abandonnée à elle-même de l'économie capitaliste, mais une concurrence dotée d'un principe supérieur qui la « socialise», une concurrence qui voudrait opérer sur la base d'un échange loyal, dans un esprit de solidarité, une concurrence qui, tout en sauvegardant l'initiative individuelle, ramènerait à la collectivité les richesses qu'actuellement l'appropriation capitaliste en détourne.
De toute évidence, il y a dans cette conception une part d'utopie. La concurrence, l'économie dite de marché produisent fatalement l'inégalité et l'exploitation, même si l'on partait d'une situation d'égalité parfaite. Elles ne sauraient être accouplées à l'autogestion ouvrière qu'à titre transitoire, comme un moindre mal nécessaire, en attendant :
1° qu'une mentalité de « sincérité de l'échange», comme dit Proudhon, se soit développée chez les autogestionnaires ;
2° et, surtout, que la société ait passé du stade de la pénurie à celui de l'abondance, à partir duquel la concurrence perdrait sa raison d'être.
Mais, dans cette période transitoire, il paraît souhaitable que la concurrence soit limitée, comme c'est le cas d'ailleurs, aujourd'hui, en Yougoslavie, à la sphère des moyens de consommation, où elle a, au moins, l'avantage de défendre les intérêts du consommateur.
Les « communistes libertaires » s'en prendront à une économie collectiviste de type proudhonien, fondée sur le principe de la lutte, où l'on ne ferait que rétablir parmi les compétiteurs l'égalité du point de départ pour les jeter ensuite dans une bataille comportant nécessairement des vainqueurs et des vaincus, où l'échange des produits finirait par se faire selon le principe de l'offre et de la demande, « ce qui serait tomber en pleine concurrence, en plein monde bourgeois». Ce langage ressemble fort à celui que tiennent aujourd'hui, contre l'expérience yougoslave, certains de ses détracteurs du monde communiste. Ils croient devoir nourrir contre l'autogestion tout entière l'hostilité que leur inspire l'économie de marché concurrentielle : comme si les deux notions étaient, dans leur essence et pour toujours, inséparables l'une de l'autre.
Unité et planification
Proudhon, en tout cas, aperçoit que la gestion par les associations ouvrières ne peut être qu'unitaire. Il insiste sur « le besoin de centralisation et d'unité». Il pose la question : « Est-ce que les compagnies ouvrières pour l'exploitation des grandes industries n'expriment pas l'unité ? » « Ce que nous mettons à la place de la centralisation politique, c'est la centralisation économique. » Toutefois il appréhende une planification autoritaire (et c'est pourquoi il lui préfère, d'instinct, une concurrence d'inspiration solidariste). Mais l'anarchisme s'est fait, depuis, l'avocat d'une planification démocratique et libertaire, élaborée de bas en haut, par la fédération des entreprises autogérées.
Bakounine entrevoit les perspectives de planification à l'échelle mondiale qui s'ouvrent à l'autogestion : « Les associations coopératives ouvrières sont un fait nouveau dans l'histoire ; nous assistons aujourd'hui à leur naissance, et nous pouvons seulement pressentir, mais non déterminer à cette heure l'immense développement que sans aucun doute elles prendront et les nouvelles conditions politiques et sociales qui en surgiront dans l'avenir. Il est possible et même fort probable que, dépassant un jour les limites des communes, des provinces et même des États actuels, elles donnent une nouvelle constitution à la société humaine entière, partagée non plus en nations, mais en groupes industriels. » Ainsi elles formeront « une immense fédération économique», avec, au sommet, une assemblée suprême. A la lumière des « données, aussi larges que précises et détaillées, d'une statistique mondiale», elles combineront l'offre avec la demande pour diriger, déterminer et répartir entre les différents pays la production de l'industrie mondiale, de sorte qu'il n'y aura plus ou presque plus de crises commerciales ou industrielles, de stagnation forcée, de désastres, plus de peines ni de capitaux perdus.
Socialisation intégrale ?
La conception proudhonienne de la gestion par les associations ouvrières comportait une équivoque. Il n'était pas toujours précisé si les groupes autogestionnaires demeureraient en compétition avec des entreprises capitalistes, en un mot si, comme on dit aujourd'hui en Algérie, le secteur socialiste coexisterait avec un secteur privé ou si, au contraire, la production dans son ensemble serait socialisée et mise en autogestion.
Bakounine est un collectiviste conséquent. Il aperçoit clairement les dangers d'une coexistence des deux secteurs. Les ouvriers, même associés, ne peuvent former des capitaux capables de lutter contre les grands capitaux bourgeois. Et, d'autre part, le danger existe qu'au sein même des associations ouvrières, ne surgisse, par la contagion de l'environnement capitaliste « une nouvelle classe d'exploiteurs des travaux du prolétariat». L'autogestion contient en elle tous les germes de l'émancipation économique des masses ouvrières, mais elle ne pourra développer réellement tous ces germes que lorsque « les capitaux, les établissements d'industrie, les matières premières et les instruments de travail (...) deviendront la propriété collective des associations ouvrières productives, tant industrielles qu'agricoles, librement organisées et fédérées entre elles». « La transformation sociale ne pourra s'opérer de façon radicale et définitive que par des moyens agissant sur l’ensemble de la société», c'est-à-dire par une révolution sociale transformant la propriété individuelle en propriété collective. Dans une telle organisation sociale, les ouvriers seraient collectivement leurs propres capitalistes, leurs propres patrons. Ne seraient laissées à la propriété individuelle « que les choses qui servent réellement à l'usage personnel. »
Tant que la révolution sociale n'est pas accomplie, Bakounine, tout en admettant que les coopératives de production ont l'avantage d'habituer les ouvriers à s'organiser, à diriger leurs affaires eux-mêmes, qu'elles créent les premiers germes d'une action ouvrière collective, estime que ces îlots au sein de la société capitaliste ne peuvent avoir qu'une efficacité limitée, et il incite les travailleurs à « s'occuper moins de coopération que de grèves».
Syndicalisme ouvrier
Aussi Bakounine valorise-t-il le rôle des syndicats, « organisation naturelle des masses», « seul moyen de guerre vraiment efficace » que les ouvriers puissent employer contre la bourgeoisie. Pour donner à la classe ouvrière une pleine conscience de ce qu'elle veut, pour faire naître en elle une pensée socialiste qui corresponde à son instinct et aussi pour organiser les forces du prolétariat en dehors du radicalisme bourgeois, il compte beaucoup moins sur les idéologues que sur le mouvement syndical. L'avenir est, selon lui, à la fédération nationale et internationale des corps de métier.
Dans les premiers congrès de l'Internationale, le syndicalisme ouvrier n'était pas mentionné expressément. À partir du congrès de Bâle, de 1869, sous l’influence des anarchistes, il passe au premier plan : les syndicats, après l'abolition du salariat, constitueront l’embryon de l'administration de l'avenir ; le gouvernement sera remplacé par les conseils des corps de métier.
Plus tard, en 1876, James Guillaume, disciple de Bakounine, exposant ses Idées sur l'organisation sociale, intègre le syndicalisme ouvrier dans l'autogestion. Il préconise la constitution de fédérations corporatives par branche de travail, s'unissant « non plus pour protéger leur salaire contre la rapacité des patrons, mais . (.. ) pour se garantir mutuellement l'usage des instruments de travail qui sont en possession de chacun des groupes, et qui deviendront, par un contrat réciproque, la propriété collective de la fédération corporative tout entière». Ces fédérations joueront un rôle planificateur, selon les perspectives ouvertes par Bakounine.
Ainsi se trouve comblée une des lacunes de l'autogestion telle que l'avait esquissée Proudhon. Dans les perspectives qu'il ouvrait, il manquait un terme : le lien qui unirait entre elles les diverses associations de production et les empêcherait de gérer leurs affaires dans un esprit égoïste, avec une mentalité de « clocher», sans se soucier de l'intérêt général, en ignorant les autres entreprises autogestionnaires. Le syndicalisme ouvrier complète l'édifice : il articule l'autogestion. Il apparaît comme l'instrument de la planification et de l'unité de la production.
Les communes
Dans la première partie de sa carrière, Proudhon est uniquement préoccupé d'organisation économique. Sa méfiance de tout ce qui touche au « politique » lui fait négliger le problème de l'administration territoriale. Il se contente d'affirmer que les travailleurs doivent se substituer à l'État, devenir eux-mêmes l'État, mais il ne précise pas sous quelles formes.
Dans les dernières années de sa vie, le problème « politique», qu'il aborde, à la manière anarchiste, de bas en haut, le préoccupe davantage. Les hommes forment entre eux, sur la base locale, ce qu'il appelle un groupe naturel, qui « se constitue en cité ou organisation politique, s'affirmant dans son unité, son indépendance, sa vie ou son mouvement propre et son autonomie». « Des groupes semblables, à distance les uns des autres, peuvent avoir des intérêts communs ; et l'on conçoit qu'ils s'entendent, s'associent et, par cette mutuelle assurance, forment un groupe supérieur. » Mais ici le spectre de l'État abhorré assaille le penseur anarchiste : que jamais, au grand jamais, les groupes locaux « en s'unissant pour la garantie de leurs intérêts et le développement de leurs richesses (...) aillent jusqu'à s'abdiquer par une sorte d'immolation d'eux-mêmes devant ce nouveau Moloch».
Et Proudhon définit, avec une relative précision, la commune autonome. Elle est, par essence, « un être souverain». En cette qualité, elle « a le droit de se gouverner elle-même, de s'administrer, de s'imposer des taxes, de disposer de ses propriétés et de ses revenus, de créer pour sa jeunesse des écoles, d'y nommer des professeurs » etc. « Voilà ce qu'est une commune, car voilà ce qu'est la vie collective, la vie politique (...). Elle repousse toute entrave, elle ne connaît de limite qu'en elle-même ; toute coercition du dehors lui est antipathique et mortelle. »
De même, on l'a vu, que, pour Proudhon, l'autogestion est incompatible avec l'existence d'un État autoritaire, la commune ne saurait coexister avec un pouvoir centralisé de haut en bas. « Point de milieu : la commune sera souveraine ou succursale, tout ou rien. Faites-lui la part aussi belle que vous voudrez ; dès l'instant qu'elle ne relève plus de son droit propre, qu'elle reconnaît une loi plus haute ; que le grand groupe (...) dont elle fait partie est déclaré supérieur (...), il est inévitable qu'un jour ou l'autre elle se trouve en contradiction avec lui, que le conflit s'élève. Or, dès qu'il y aura conflit, la logique et la force veulent que ce soit le pouvoir central qui l'emporte, et cela sans discussion, sans jugement, sans transaction, le débat entre le supérieur et le subalterne étant inadmissible, scandaleux, absurde. »
Bakounine intègre, de façon plus conséquente que Proudhon, la commune dans l'organisation de la société future. Les associations ouvrières de production devront être librement alliées au sein des communes ; et les communes, à leur tour, librement fédérées entre elles. « La vie et l'action spontanée, suspendues pendant des siècles par l'action, par l'absorption toute-puissante de l'État seront rendues aux communes par l'abdication de l'État. »
Quels seront les rapports entre les communes et le syndicalisme ouvrier ? Le district de Courtelary, de la Fédération jurassienne5 , n'hésite pas à répondre, en 1880 : « L'organe de cette vie locale sera la fédération des corps de métier et c'est cette fédération locale qui constituera la future commune. » Pourtant les rédacteurs de ce texte sont pris d'une hésitation, et ils se posent la question : « Sera-ce une assemblée générale de tous les habitants, seront-ce des délégations des corps de métier (...) qui rédigeront le contrat de la commune? » Pour conclure que les deux systèmes peuvent être envisagés. Priorité à la commune ou au syndicat ? Cette question départagera, plus tard, notamment en Russie et en Espagne, les « anarcho-communistes», et les « anarcho-syndicalistes».
Pour Bakounine, la commune est l'instrument tout désigné de l'expropriation des instruments de travail au profit de l'autogestion. En compensation des biens confisqués, c'est elle qui, dans une première phase de la réorganisation sociale, donnera le strict nécessaire à tous les individus « dépossédés». Et de décrire, avec une certaine précision, son organisation interne. Elle sera administrée par un conseil, formée de délégués élus, investis de mandats impératifs, toujours responsables et toujours révocables. Le conseil communal pourra choisir dans son sein des comités exécutifs pour chaque branche de l'administration révolutionnaire de la commune. Cette répartition des responsabilités sur de nombreuses têtes présente l'avantage d'associer le plus grand nombre possible d'éléments de base à la gestion. Elle réduit les inconvénients d'un système de représentation où un petit groupe d'élus accaparerait toutes les tâches, tandis que la population demeurerait plus ou moins passive au sein d'assemblées générales rarement convoquées. Bakounine a saisi d'instinct que les conseils élus doivent être des assemblées « travailleuses», à la fois législatives et exécutives, une « démocratie sans parlementarisme», comme dira plus tard Lénine, dans un de ses moments libertaires. A son tour, le district de Courtelary explicite cette conception : « Pour ne pas retomber dans les errements des administrations centralisées et bureaucratiques, nous pensons que les intérêts généraux de la commune ne doivent pas être administrés par une seule et unique administration locale, mais par différentes commissions spéciales pour chaque branche d'activité (...). Ce procédé enlèverait aux administrations le caractère gouvernemental. »
Un sens aussi avisé des étapes nécessaires du développement historique manquera aux épigones de Bakounine. Dans les années 1880, ils chercheront querelle aux anarchistes collectivistes. Critiquant le précédent de la Commune parisienne de 1871, Kropotkine morigénera le peuple pour avoir « appliqué encore une fois, au sein de la Commune, le système représentatif», pour avoir « abdiqué sa propre initiative entre les mains d'une assemblée de gens élus plus ou moins du hasard», et il s'affligera de ce que certains réformateurs « cherchent toujours à conserver, coûte que coûte, ce gouvernement par procuration». Selon lui, le régime représentatif a fait son temps. Il a été la domination organisée de la bourgeoisie et il doit disparaître avec elle. « Pour une nouvelle phase économique qui s'annonce nous devons chercher un nouveau mode d'organisation politique, basé sur un principe tout autre que celui de la représentation. » La société devra trouver sa forme de rapports politiques. Ils devront être plus populaires que le gouvernement représentatif, « devenir plus self-government, plus gouvernement de soi-même par soi-même».
Cette démocratie directe, poussée à ses dernières conséquences et qui, aussi bien sur le plan de l'autogestion économique que de l'administration territoriale, supprimerait les derniers vestiges d'une autorité quelconque, est, en effet, pour tout socialiste, qu'il soit « autoritaire » ou libertaire, l'idéal à poursuivre. Cependant la condition en est, de toute évidence, un stade d'évolution sociale où la totalité des travailleurs serait en possession de la science aussi bien que de la conscience et, parallèlement, l'effacement du règne de la pénurie devant celui de l'abondance. Dès 1880, le district de Courtelary annonçait, bien avant Lénine : « La pratique plus ou moins démocratique du suffrage universel perdra de plus en plus son importance dans une société organisée scientifiquement. » Mais pas avant.
Un mot litigieux : « l’État »
Le lecteur sait déjà que les anarchistes se refusaient à employer, même à titre transitoire, le mot État. Sur ce point, le fossé n'a pas toujours été infranchissable entre « autoritaires » et libertaires. Dans la Première Internationale, il arriva aux collectivistes dont Bakounine était le porte-parole d'admettre comme synonyme de l'expression « collectivité sociale » celui d'État régénéré, d'État révolutionnaire et nouveau, voire d'État socialiste. Mais assez vite les anarchistes s'aperçurent qu'il n'était pas sans danger pour eux d'employer le même mot que les « autoritaires», tout en lui donnant un sens fort différent. Ils estimèrent qu'à une conception nouvelle il fallait un mot nouveau et que l'emploi de l'ancien pouvait amener de dangereuses équivoques ; en conséquence ils cessèrent de désigner sous le nom d'État la collectivité sociale de l'avenir.
De leur côté, les marxistes, anxieux d'obtenir le concours des anarchistes pour faire triompher, dans l’Internationale, le principe de la propriété collective contre le dernier carré réactionnaire des individualistes post-proudhoniens, se montrèrent prêts à des concessions de vocabulaire. Ils acceptèrent, du bout des lèvres, le substitut proposé par les anarchistes au mot État, celui de fédération ou de solidarisation des communes. C'est dans le même esprit que, quelques années plus tard, Engels, chapitrant son ami et compatriote August Bebel, au sujet du programme de Gotha de la social-démocratie allemande, croira expédient de lui proposer « de remplacer partout l'expression État par Gemeinwesen, un bon vieux mot allemand dont le sens équivaut à celui du mot Commune en français. »
Au congrès de Bâle, en 1869, les anarchistes collectivistes et les marxistes avaient décidé, d'un commun accord, que la propriété une fois socialisée devait être exploitée par les « communes solidarisées». Bakounine, dans un discours, mit les points sur les i : « Je vote pour la collectivité du sol en particulier et en général, de toute la richesse sociale, dans le sens de la liquidation sociale. J'entends par liquidation sociale l'expropriation en droit de tous les propriétaires actuels, par l'abolition de l'État politique et juridique qui est la sanction et la seule garantie de la propriété actuelle. Quant à l'organisation postérieure (...) je conclus à la solidarisation des communes (...) d'autant plus volontiers que cette solidarisation implique l'organisation de la société de bas en haut. »
Comment gérer les services publics ?
Le compromis intervenu était loin de dissiper les équivoques, d'autant plus qu'au même congrès de Bâle des délégués socialistes « autoritaires » ne s'étaient pas gênés pour vanter la gestion de l'économie par l'État. Par la suite, le problème se révéla particulièrement épineux lorsque fut abordée la gestion des grands services publies tels que les chemins de fer, les postes, etc. A ce moment, la scission avait été consommée dans l'Internationale, au congrès de La Haye de 1872, entre partisans de Bakounine et partisans de Marx. Ce fut donc au sein de l'Internationale dite improprement « antiautoritaire», qui avait survécu à la scission, que la question des services publics fut mise en discussion. Elle ne manqua pas de susciter de nouveaux désaccords entre les anarchistes et ceux des socialistes plus ou moins étatiques qui, se désolidarisant de Marx, avaient tenu à demeurer avec eux dans l'Internationale.
Ces services publies, du fait même qu'ils sont d'intérêt national, ne sauraient, de toute évidence, être gérés ni par les seules associations ouvrières ni par les seules communes. Proudhon avait déjà tenté de résoudre la difficulté en « équilibrant » la gestion ouvrière par une initiative publique trop vaguement explicitée. Qui donc administrerait les services publics ? La fédération des communes, répondaient les libertaires, l'État, étaient tentés de répondre les « autoritaires».
Au congrès de Bruxelles de l’Internationale, en 1874, le socialiste belge César de Paepe tenta un compromis entre les deux thèses en présence. A la commune seraient répartis les services publics locaux, sous la direction de l'administration locale, elle-même nommée par les syndicats ouvriers. Quant aux services publics plus étendus, ils seraient gérés, tantôt par une administration régionale, elle-même nommée par la fédération des communes et fonctionnant sous le contrôle d'une chambre régionale du travail, tantôt, dans le cas des grandes entreprises nationales, par l'« État Ouvrier», c'est-à-dire l'État « basé sur le groupement des libres communes ouvrières». Mais cette définition ambiguë parut suspecte aux anarchistes. De Paepe ne voulut voir dans cette méfiance qu’un malentendu. Peut-être ne s'agissait-il, après tout, que d'une querelle de mots. S'il en était ainsi, il laisserait volontiers le mot de côté, tout en conservant et même en étendant la chose, « sous le couvert plus agréable d'une autre dénomination quelconque».
Mais la plupart des libertaires crurent apercevoir que le rapport bruxellois aboutissait à la reconstitution de l'État : à leurs yeux, la logique des choses devait fatalement conduire l'« État ouvrier » à être un « État autoritaire». Et, s'il ne s'agissait vraiment que d'une querelle de mots, ils ne voyaient pas pourquoi ils auraient à baptiser la nouvelle société sans gouvernement du nom même qui avait servi à désigner l'organisation abolie. A un congrès ultérieur, à Berne, en 1876, Malatesta admit que les services publics avaient besoin d'une organisation unique et centralisée ; mais il se refusa à les faire administrer d'en haut par un État. Ses contradicteurs lui paraissaient confondre l’État avec la société, « corps organique vivant». L'année suivante, en 1877, au congrès universel socialiste de Gand, César de Paepe admit que le fameux État ouvrier ou État populaire « pourrait effectivement, pendant un certain temps, n'être qu'un État de salariés». Mais ce ne « devait être qu'une phase transitoire imposée par les circonstances » au-delà de laquelle l'importun quidam ne manquerait pas de se dessaisir des instruments de travail pour les remettre aux associations ouvrières. Cette perspective aussi lointaine que problématique n'amadoua pas les anarchistes : ce que l'État avait pris, il ne le rendrait jamais.
Fédéralisme
En résumé, la société future libertaire devait être dotée d'une double structure : économique, la fédération des associations ouvrières d'autogestion ; administrative, la fédération des communes. Restait à couronner, en même temps qu'à articuler, l'édifice par une conception d'envergure, susceptible d'être étendue au monde entier : le fédéralisme.
Au fur et à mesure que mûrit la pensée de Proudhon, l'idée fédéraliste s'y dégage et y prévaut. Un de ses derniers ouvrages porte pour titre : Du principe fédératif et l'on sait déjà qu'à la fin de sa vie il se déclarait plus volontiers fédéraliste qu'anarchiste. Nous ne vivons plus à l'âge des petites cités antiques, qui, d'ailleurs, même en leur temps, s'unirent parfois entre elles par un lien fédératif. Le problème moderne, c'est l'administration de grands pays. « Si l'étendue de l'État, observe Proudhon, ne devait jamais dépasser celle d'une cité ou commune, je laisserais chacun en juger à sa guise, et tout serait dit. Mais n'oublions pas qu'il s'agit de vastes agglomérations de territoires, où les villes, bourgs et hameaux se comptent par millions. » Pas question de fragmenter la société en microcosmes. L'unité est indispensable.
Mais les « autoritaires » ont la prétention de régir ces groupes locaux selon les lois de la « conquête»,« ce que je déclare, leur objecte Proudhon, en vertu de la loi même d'unité, absolument impossible». « Tous ces groupes (...) sont des organismes indestructibles (...), qui ne peuvent pas plus se dépouiller de leur indépendance souveraine que le membre de la cité ne peut, par la qualité de citoyen, perdre ses prérogatives d'homme libre (...). Tout ce que l'on obtiendrait (...) serait de créer un antagonisme irréconciliable entre la souveraineté générale et chacune des souverainetés particulières, d'élever autorité contre autorité ; en un mot, tandis que l'on s'imagine développer l'unité, d'organiser la division. »
Dans un tel système d'« absorption unitaire » les cités ou groupes naturels seraient « toujours condamnés à s'effacer au sein de l'agglomération supérieure, qu'on peut appeler artificielle». La centralisation, qui consiste à « retenir dans l'indivision gouvernementale des groupes que la nature a faits autonomes», « telle est, pour la société moderne, la vraie tyrannie». C'est un système d'impérialisme, de communisme, d'absolutisme, tonne Proudhon, qui ajoute, dans un de ces amalgames dont il a le secret : « Tous ces mots sont synonymes. »
En revanche l'unité, l'unité véritable, la centralisation, la centralisation véritable, seraient indestructibles si un lien de droit, un contrat de mutualité, un pacte de fédération étaient conclus entre les diverses unités territoriales. « Ce qui fait la centralisation d'une société d'hommes libres (...), c'est le contrat. L'unité sociale (...) est le produit de la libre adhésion des citoyens (...). Il faut, pour qu'une nation se manifeste dans son unité, que cette unité soit centralisée (...) dans toutes ses fonctions et facultés, il faut que la centralisation s'effectue de bas en haut, de la circonférence au centre, et que toutes les fonctions soient indépendantes et se gouvernent chacune par elle-même. Vous avez une centralisation d'autant plus forte que vous en multipliez davantage les foyers. »
Le système fédératif est l'opposé de la centralisation gouvernementale. L'autorité et la liberté, ces deux principes en lutte perpétuelle, sont condamnés à transiger l'un avec l'autre. « La Fédération résout toutes les difficultés que soulève l'accord de la liberté et de l’autorité. La Révolution française a fondé les prémisses d'un ordre nouveau, dont son héritière, la classe ouvrière, possède le secret. Cet ordre nouveau, le voici : réunir tous les peuples en une « confédération des confédérations». L'expression n'est pas employée au hasard : une confédération universelle serait trop vaste ; il faut fédérer entre eux de grands ensembles. Et Proudhon, qui aime vaticiner, annonce : Le XXe siècle ouvrira l’ère des fédérations.
Bakounine ne fait que développer et approfondir les vues fédéralistes de Proudhon. Comme lui il vante la supériorité de l'unité fédérative sur l'unité « autoritaire » : « Lorsqu'il n'y aura plus la maudite puissance de l'État pour contraindre les individus, les associations, les communes, les provinces, les régions à vivre ensemble, elles seront beaucoup plus étroitement liées, et constitueront une unité beaucoup plus vivante, plus réelle, plus puissante que celles qu'elles sont forcées de former aujourd'hui, sous la pression pour tous également écrasante de l'État. » Les autoritaires « confondent toujours (...) l'unité formelle, dogmatique et gouvernementale, avec l'unité vivante et réelle, qui ne peut résulter que du plus libre développement de toutes les individualités et de toutes les collectivités et de l'alliance fédérative et absolument libre (...) des associations ouvrières dans les communes et, au-delà des communes dans les régions, des régions dans les nations. »
Bakounine insiste sur la nécessité d'un intermédiaire, d'un relais, entre la commune et l'organisme fédératif national : la province ou région, fédération libre de communes autonomes. Mais qu'on ne s'imagine pas que le fédéralisme aboutisse à l'isolement, à l'égoïsme. La solidarité est inséparable de la liberté. « Les communes, tout en restant absolument autonomes, se sentent (...) solidaires entre elles et, sans rien sacrifier de leur liberté, elles s'unissent étroitement. » Dans le monde moderne, les intérêts matériels, intellectuels, moraux ont créé entre toutes les parties d'une même nation, de même qu'entre les différentes nations, une unité puissante et réelle. Et cette unité-là survivra aux États.
Mais le fédéralisme est une arme à double tranchant. Le fédéralisme girondin, pendant la Révolution française, fut contre-révolutionnaire. L'école royaliste de Charles Maurras a prôné le régionalisme. Dans certains pays, comme les États-Unis, le caractère fédéral de la constitution est exploité par ceux qui dénient les droits civiques aux hommes de couleur. Seul le socialisme, pense Bakounine, peut apporter au fédéralisme un contenu révolutionnaire. C'est pourquoi ses partisans espagnols se montrèrent plutôt tièdes pour le parti fédéraliste bourgeois de Pi y Margall, qui se disait proudhonien, et même pour son aile gauche « cantonaliste», au cours du bref épisode de la république avortée de 18736.
Internationalisme
Le principe fédéraliste conduit logiquement à l'internationalisme, c'est-à-dire à l'organisation fédérative des nations « dans la grande et fraternelle union internationale humaine». Ici encore Bakounine démasque l'utopie bourgeoise d'un fédéralisme qui ne procéderait pas d'un socialisme internationaliste et révolutionnaire. Fort en avance sur son temps, il est « européen», comme on dit aujourd'hui ; il appelle de ses vœux les États-Unis d'Europe, seul moyen de « rendre impossible la guerre civile entre les différents peuples qui composent la famille européenne». Mais il prend soin de mettre en garde contre toute fédération européenne qui grouperait les États « tels qu'ils sont aujourd'hui constitués» :
« Aucun État centralisé, bureaucratique et par là même militaire, s'appelât-il même république, ne pourra entrer sérieusement et sincèrement dans une confédération internationale. Par sa constitution, qui sera toujours une négation ouverte ou masquée de la liberté à l'intérieur, il serait nécessairement une déclaration de guerre permanente, une menace contre l'existence des pays voisins. » Toute alliance avec un État réactionnaire serait une « trahison contre la Révolution». Les États-Unis d'Europe, d'abord et, plus tard, ceux du monde entier, ne pourront être créés que lorsque, partout, l'ancienne organisation fondée, de haut en bas, sur la violence et sur le principe d'autorité, aura été renversée. Par contre, en cas de triomphe de la révolution sociale dans un pays donné, tout pays étranger qui se serait soulevé au nom des mêmes principes serait reçu dans la fédération révolutionnaire sans égard pour les frontières actuelles des États.
L'internationalisme véritable repose sur l'autodétermination et son corollaire le droit de sécession. « Tout individu, développe Bakounine après Proudhon, toute association, toute commune, toute province, toute région, toute nation ont le droit absolu de disposer d'eux-mêmes, de s'associer ou de ne point s'associer, de s'allier avec qui ils voudront et de rompre leurs alliances, sans égard aucun pour les soi-disant droits historiques, ni pour les convenances de leurs voisins. » « Le droit de la libre réunion et de la sécession également libre est le premier, le plus important de tous les droits politiques, celui sans lequel la confédération ne serait jamais qu'une centralisation masquée. »
Mais ce principe, dans l'esprit des anarchistes, n'est point d'inspiration scissionniste ou isolationniste. Ils ont, au contraire, la « conviction que le droit de sécession une fois reconnu, les sécessions de fait deviendront impossibles, parce que les unités nationales, cessant d'être le produit de la violence et du mensonge historique, seront formées librement». Alors, alors seulement, elles deviendront « vraiment fortes, fécondes et indissolubles».
Plus tard, Lénine et, à sa suite, les premiers congrès de la Troisième Internationale, emprunteront à Bakounine cette conception dont les bolcheviks feront la base, à la fois de leur politique des nationalités et de leur stratégie anticolonialiste — pour finalement la démentir au profit de la centralisation autoritaire et d'un impérialisme camouflé.
Décolonisation
Il est à noter que le fédéralisme, par une déduction logique, conduit ses fondateurs à anticiper prophétiquement le problème de la décolonisation. Distinguant l’unité « conquérante » de l'unité « rationnelle», Proudhon aperçoit que « tout organisme qui dépasse ses justes bornes et qui tend à envahir ou s’annexer d’autres organismes, perd en puissance ce qu'il gagne en étendue, et tend à sa dissolution». Plus une cité (lisez : une nation) étend sa population et son territoire, plus elle marche à la tyrannie et, finalement, à la rupture.
« Qu'elle établisse à côté d'elle à quelque distance des succursales, des colonies : tôt ou tard ces colonies ou succursales se transformeront en de nouvelles cités, qui ne conserveront avec la cité mère qu'un lien de fédération, ou même n'en conserveront pas du tout (...).
« Quand la cité nouvelle est à même de se subvenir, elle proclame d'elle-même son indépendance : de quel droit la cité mère prétendrait-elle la traiter en vassale, en faire une exploitation, une propriété ?
« C'est ainsi que nous avons vu de nos jours les États-Unis s'affranchir de l'Angleterre ; que le Canada s'est également affranchi, au moins de fait, sinon d'une manière officielle ; que l'Australie est déjà en voie de séparation, du consentement et avec la satisfaction entière de la mère patrie ; c'est ainsi que tôt ou tard l'Algérie se constituera en une France africaine, à moins que, par d'abominables calculs, nous ne persistions à la retenir par la force et la misère, dans l'indivision. »
Bakounine, lui, a l'œil sur les pays sous-développés. Il doute que l'Europe impérialiste « puisse maintenir dans l'asservissement huit cents millions d'Asiatiques. » « L’Orient, ces huit cents millions d'hommes endormis et asservis qui constituent les deux tiers de l'humanité, sera bien forcé de se réveiller et de se mettre en mouvement. Mais dans quelle direction, pour quoi faire ? »
Il proclame « hautement ses sympathies pour toute insurrection nationale contre toute oppression». Il propose aux peuples opprimés l'exemple fascinant du soulèvement national des Espagnols contre Napoléon, qui, malgré la disproportion formidable entre les maquis autochtones et les troupes impériales, ne put être maîtrisé par l'occupant, dura cinq ans et finit par expulser les Français d'Espagne.
Chaque peuple « a le droit d'être lui-même et personne n'a celui de lui imposer son costume, ses coutumes, sa langue, ses opinions et ses lois. » Mais ici encore il n'est point, selon lui, de véritable fédéralisme sans socialisme. Il souhaite que la libération nationale s'accomplisse « dans l'intérêt tant politique qu'économique des masses populaires » et non « avec l’intention ambitieuse de fonder un puissant État». Toute révolution d'indépendance nationale, se faisant en dehors du peuple et ne pouvant, par conséquent, triompher sans s'appuyer sur une classe privilégiée (...), se fera nécessairement contre le peuple » et sera, en conséquence « un mouvement rétrograde, funeste, contre-révolutionnaire».
Il serait regrettable que les pays décolonisés s'affranchissent du joug extérieur pour retomber sous un joug autochtone politique et religieux. Ce qu'il faut faire pour les émanciper, « c'est détruire dans leurs masses populaires la foi en toute autorité soit divine soit humaine. » La question nationale s'efface historiquement devant la question sociale. Il n'y a de salut que dans la révolution sociale. Le succès d'une révolution nationale isolée est impossible. La révolution sociale devient nécessairement une révolution mondiale.
Au-delà de la décolonisation, Bakounine entrevoit une fédération internationale de plus en plus extensive des peuples révolutionnaires : « L'avenir appartient en première ligne à la constitution de l'internationalité européo-américaine. Plus tard, beaucoup plus tard, cette grande nation européo-américaine se confondra organiquement avec l'agglomération asiatique et africaine. »
Nous voici projetés, au terme de cette analyse, en plein XXe siècle.
Troisième partie : l’anarchisme dans la pratique révolutionnaire
Chapitre I. de 1880 à 1914
L’anarchisme s’isole du mouvement ouvrier
Il nous faut maintenant regarder l'anarchisme en action. Nous entrons ainsi dans le XXe siècle. Sans doute l'idée libertaire n'a-t-elle pas été entièrement absente dans les révolutions du XIXe siècle. Mais elle n'y a guère joué de rôle propre. Proudhon, avant même qu'elle n'éclatât, avait pris la Révolution de 1848 à contre-pied. Il lui reprochait d'être une révolution politique, un attrape-nigaud bourgeois, ce qu'elle fut d'ailleurs dans une large mesure. Et surtout, de surgir de façon inopportune, par les vieux moyens des barricades et des batailles de rues, alors que, lui, rêvait de faire triompher tout autrement sa panacée : le collectivisme mutuelliste. Quant à la Commune, si elle rompit spontanément avec le « centralisme étatique traditionnel», elle fut le fruit, comme l'observe Henri Lefebvre, d'un « compromis», d'une sorte de « front commun » entre proudhoniens et bakouninistes d'une part, jacobins et blanquistes de l'autre. Elle fut une « négation audacieuse » de l'État, mais les anarchistes internationalistes, de l'aveu de Bakounine, n'y formèrent « qu'une très infime minorité».
Cependant, l'anarchisme avait réussi, grâce à l'impulsion de Bakounine, à se greffer sur un mouvement de classes, de caractère prolétarien, apolitique et internationaliste : la « Première Internationale». Mais, aux alentours de 1880, il se mit à persifler « la timide Internationale des premiers temps » et prétendit lui substituer, selon les termes employés par Malatesta en 1884, une « Internationale redoutée » qui eût été, tout à la fois, communiste, anarchiste, antireligieuse, révolutionnaire et antiparlementaire. L'épouvantail ainsi agité ne fut que squelettique : l'anarchisme s'isola du mouvement ouvrier, et, par voie de conséquence, s'étiola, s'égara dans le sectarisme, dans un activisme minoritaire.
Pourquoi ce repliement ? Une des raisons en fut le rapide développement industriel et la conquête accélérée de droits politiques qui rendirent les travailleurs plus réceptifs au réformisme parlementaire. D'où l'accaparement du mouvement ouvrier international par la social-démocratie, politicienne, électoraliste, réformiste, visant, non à la révolution sociale, mais à la conquête légale de l'État bourgeois et à la satisfaction de revendications immédiates.
Demeurés une faible minorité, les anarchistes renoncèrent à l'idée de militer au sein de larges mouvements populaires. Sous couleur de pureté doctrinale — d'une doctrine où l'utopie, combinaison d'anticipations prématurées et d'évocations nostalgiques de l'âge d’or, se donnait maintenant libre cours. — Kropotkine, Malatesta et leurs amis tournèrent le dos à la voie ouverte par Bakounine. Ils reprochèrent à la littérature anarchiste, et à Bakounine lui-même, d'avoir été trop « imprégnés de marxisme». Ils se recroquevillèrent sur eux-mêmes. Ils s'organisèrent en petits groupes clandestins d'action directe, où la police eut beau jeu d'infiltrer ses mouchards.
Ce fut à partir de 1876, après la retraite, bientôt suivie de la mort de Bakounine, que le virus chimérique et aventuriste s'introduisit dans l'anarchisme. Le congrès de Berne lança le slogan de la « propagande par le fait». Une première leçon de choses en fut administrée par Cafiero et Malatesta. Le 5 avril 1877, sous leur direction, une trentaine de militants armés surgirent dans les montagnes de la province italienne de Bénévent, brûlèrent les archives communales d'un petit village, distribuèrent aux miséreux le contenu de la caisse du percepteur, tentèrent d’appliquer un « communisme libertaire » en miniature, rural et infantile, et, finalement, traqués, transis de froid, se laissèrent capturer sans résistance.
Trois ans plus tard, le 25 décembre 1880, Kropotkine clama dans son journal, le Révolté : « La révolte permanente par la parole, par l'écrit, par le poignard, le fusil, la dynamite (...), tout est bon pour nous qui n'est pas de la légalité. » De la « propagande par le fait » aux attentats individuels, il n'y eut plus qu'un pas. Il fut vite franchi.
Si la défection des masses ouvrières avait été une des causes du recours au terrorisme, en contrepartie, la « propagande par le fait » contribua, dans une certaine mesure, à réveiller les travailleurs assoupis. Comme le soutint Robert Louzon dans un article de la Révolution Prolétarienne (novembre 1937), elle a été comme le coup de gong qui releva le prolétariat français de l'état de prostration où l'avaient plongé les massacres de la Commune (...), le prélude à la fondation de la C.G.T. et du mouvement syndical de masses des années 1900-1910». Affirmation quelque peu optimiste, que rectifie, ou complète7 , le témoignage de Fernand Pelloutier, jeune anarchiste passé au syndicalisme révolutionnaire : pour lui, l'emploi de la dynamite a détourné les travailleurs, pourtant combien désabusés du socialisme parlementaire, de faire profession de socialisme libertaire ; aucun d'eux n'osa se dire anarchiste, de crainte de paraître opter pour la révolte isolée au préjudice de l'action collective.
La combinaison de la bombe et des utopies kropotkiniennes fournirent aux social-démocrates des armes dont ils ne manquèrent pas d'user contre les anarchistes.
Les social-démocrates vitupèrent les anarchistes
Pendant de longues années, le mouvement ouvrier socialiste fut divisé en deux tronçons irréconciliables : tandis que l'anarchisme glissait, à la fois, dans le terrorisme et l'attente du millenium, le mouvement politique, se réclamant plus ou moins frauduleusement du marxisme, s'enlisait dans le « crétinisme parlementaire». Comme le rappellera, plus tard, l'anarchiste, devenu syndicaliste, Pierre Monatte, « l'esprit révolutionnaire, en France, se mourait (...) d'année en année. Le révolutionnarisme de Guesde (...) n'était plus que verbal ou, pis encore, électoral et parlementaire ; le révolutionnarisme de Jaurès allait, lui, beaucoup plus loin : il était tout simplement, et d'ailleurs, très franchement, ministériel et gouvernemental». En France, le divorce entre anarchistes et socialistes fut consommé lorsque, au congrès du Havre en 1880, le parti ouvrier naissant se lança dans l'action électorale.
En 1889, les social-démocrates de divers pays décidèrent, à Paris, de ressusciter, après une longue éclipse la pratique des congrès socialistes internationaux, ouvrant ainsi la voie à la Deuxième Internationale. Quelques anarchistes crurent devoir participer à cette réunion. Leur présence y donna lieu à de violents incidents. Les social-démocrates, ayant la force du nombre, étouffèrent toute contradiction de la part de leurs adversaires. Au congrès de Bruxelles, de 1891, les libertaires furent expulsés au milieu des huées. Cependant une partie importante des délégués ouvriers, anglais, hollandais, italiens, tout réformistes qu'ils étaient, se retirèrent en manière de protestation. Au congrès suivant, qui se tint à Zurich en 1893, les social-démocrates prétendirent n'admettre, à l'avenir, outre les organisations syndicales, que ceux des partis et groupements socialistes qui reconnaîtraient la nécessité de l’« action politique», c'est-à-dire de la conquête du pouvoir bourgeois par le bulletin de vote.
Au congrès de Londres, en 1896, quelques anarchistes français et italiens tournèrent cette condition éliminatrice en se faisant déléguer par des syndicats. Ce n'était d'ailleurs pas qu'une ruse de guerre : les anarchistes venaient, comme on le verra plus loin, de retrouver le chemin du réel ; ils étaient entrés dans le mouvement syndical. Mais quand l'un deux, Paul Delesalle, essaya de monter à la tribune, il fut jeté violemment au bas de l'escalier et blessé. Jaurès accusa les anarchistes d'avoir transformé les syndicats en groupements révolutionnaires et anarchistes, de les désorganiser comme ils étaient venus désorganiser le congrès, « au grand profit de la réaction bourgeoise».
Les chefs social-démocrates allemands, électoralistes invétérés, Wilhelm Liebknecht et August Bebel, se montrèrent, comme ils l'avaient déjà été dans la Première Internationale, les plus acharnés contre les anarchistes. Secondés par Mme Aveling, fille de Karl Marx, qui traita de « fous » les libertaires, ils menèrent l'assemblée à leur guise et lui firent adopter une résolution excluant des congrès futurs les « antiparlementaires » à quelque titre qu'ils se présentent.
Plus tard, dans L'État et la Révolution, Lénine, leur tendant un bouquet où les épines se mêleront aux fleurs, rendra justice aux anarchistes contre les social-démocrates. Il reprochera à ces derniers d'avoir « abandonné aux anarchistes le monopole de la critique du parlementarisme » et d'avoir « qualifié d'anarchiste » cette critique. Rien d'étonnant si le prolétariat des pays parlementaires, dégoûté de tels socialistes, a réservé de plus en plus ses sympathies à l'anarchisme. Les social-démocrates ont taxé d'anarchiste toute tentative de briser les reins à l'État bourgeois. Les anarchistes ont indiqué « avec justesse le caractère opportuniste des idées sur l’État professé par la plupart des partis socialistes».
Marx, toujours selon Lénine, s'accorde avec Proudhon en ce que tous deux sont pour la « démolition de la machine présente de l'État». « Cette analogie entre le marxisme et l'anarchisme, celui de Proudhon, celui de Bakounine, les opportunistes ne veulent pas la voir. » Les social-démocrates ont engagé la discussion avec les anarchistes de façon « non marxiste». Leur critique de l'anarchisme se réduit à cette pure banalité bourgeoise ; « Nous admettons l'État, les anarchistes non ! » Aussi les anarchistes sont-ils en bonne posture pour riposter à cette social-démocratie qu'elle manque à son devoir, qui est de faire l’éducation révolutionnaire des ouvriers. Et Lénine de fustiger une brochure antianarchiste du social-démocrate russe Plekhanov « très injuste envers les anarchistes», « sophistique», « pleine de raisonnements grossiers tendant à insinuer que rien ne distingue un anarchiste d'un bandit».
Les anarchistes dans les syndicats
Les anarchistes, dans les années 1890, s'étaient enfoncés dans une impasse. Isolés du monde ouvrier que monopolisaient les social-démocrates, ils se calfeutraient dans de petites chapelles, se barricadaient dans des tours d'ivoire pour y ressasser une idéologie de plus en plus irréelle ; ou bien ils se livraient et applaudissaient à des attentats individuels, se laissant prendre dans l'engrenage de la répression et des représailles.
Kropotkine, un des premiers, eut le mérite de faire son mea culpa et de reconnaître la stérilité de la « propagande par le fait». Dans une série d'articles, en 1890, il affirma « qu'il faut être avec le peuple, qui ne demande plus l'acte isolé, mais des hommes d'action dans ses rangs». Il mit en garde contre « l'illusion que l'on peut vaincre les coalitions d'exploiteurs avec quelques livres d'explosifs». Il prôna le retour à un syndicalisme de masses, tel celui dont la Première Internationale avait été l'embryon et le propagateur : « Des unions monstres, englobant les millions de prolétaires. »
Pour détacher les masses ouvrières des prétendus socialistes qui les bernaient, le devoir impérieux des anarchistes était de pénétrer dans les syndicats. Dans un article que publia, en 1895, un hebdomadaire anarchiste, Les Temps nouveaux, sous le titre « L'anarchisme et les syndicats ouvriers», Fernand Pelloutier exposa la tactique nouvelle. L'anarchisme pouvait fort bien se passer de la dynamite et il devait aller vers la masse. A la fois pour propager dans un très large milieu les idées anarchistes et pour arracher le mouvement syndical au corporatisme étroit, dans lequel il s'était jusqu'alors enlisé. Le syndicat devait être une « école pratique d'anarchisme». Laboratoire des luttes économiques, détaché des compétitions électorales, s'administrant anarchiquement, n'était-il pas l'organisation à la fois révolutionnaire et libertaire qui, seule, pourrait contrebalancer et détruire la néfaste influence des politiciens social-démocrates ? Et Pelloutier de rattacher les syndicats ouvriers à la société « communiste libertaire » qui demeurait l'objectif ultime des anarchistes : le jour où éclaterait la révolution, demandait-il, « n'y aurait-il pas là, prête à succéder à l'organisation actuelle, une organisation quasi libertaire, supprimant de fait tout pouvoir politique et dont chaque partie, maîtresse des instruments de production, réglerait toutes ses affaires elle-même, souverainement et par le libre consentement de ses membres ? »
Pierre Monatte déclara, plus tard, au congrès anarchiste international de 1907 : « Le syndicalisme (...) ouvre à l'anarchisme trop longtemps replié sur lui-même des perspectives et des espérances nouvelles. » D'une part « le syndicalisme (...) a rappelé l'anarchisme au sentiment de ses origines ouvrières ; d'autre part, les anarchistes n'ont pas peu contribué à entraîner le mouvement ouvrier dans la voie révolutionnaire et à populariser l'idée de l'action directe». A ce même congrès fut adoptée, après une discussion assez vive, une résolution de synthèse, s'ouvrant par cette déclaration de principe : « Le congrès anarchiste international considère les syndicats à la fois comme des organisations de combat dans la lutte de classes en vue de l'amélioration des conditions de travail et comme des unions de producteurs pouvant servir à la transformation de la société capitaliste en une société communiste anarchiste. »
Mais ce n'était pas sans peine que les anarchistes syndicalistes s'efforçaient d'entraîner l'ensemble du mouvement libertaire dans la voie nouvelle qu'ils avaient choisie. Les « purs » de l'anarchisme nourrissaient à l'égard du mouvement syndical une méfiance incoercible. Ils lui en voulaient d'avoir trop les pieds sur la terre. Ils l'accusaient de se complaire dans la société capitaliste, d'en être partie intégrante, de se cantonner dans la revendication immédiate ; Ils lui contestaient la prétention de résoudre à lui seul le problème social. Au congrès de 1907, Malatesta répliquant âprement à Monatte, soutint que le mouvement ouvrier n’était pour les anarchistes qu'un moyen et non une fin : « Le syndicalisme n'est et ne sera jamais qu'un mouvement légalitaire et conservateur, sans autre but accessible — et encore ! — que l'amélioration des conditions de travail. » Rendu myope par la poursuite d'avantages immédiats, le mouvement syndical détournait les travailleurs de la lutte finale : « Ce n'est pas tant à cesser le travail qu'il faut inviter les ouvriers ; c'est bien plutôt à le continuer pour leur propre compte. » Enfin Malatesta mettait en garde contre le conservatisme des bureaucraties syndicales : « Le fonctionnaire est dans le mouvement ouvrier un danger qui n'est comparable qu'au parlementarisme. L'anarchiste qui a accepté d'être le fonctionnaire permanent et salarié d'un syndicat est perdu pour l'anarchisme. »
A quoi Monatte répliqua que le mouvement syndical, comme toute œuvre humaine, n'était, certes, pas dénué d'imperfections : « Loin de les cacher, je crois qu'il est utile de les avoir toujours présentes à l'esprit afin de réagir contre elles. » Il admettait que le fonctionnarisme syndical soulevait de vives critiques, souvent justifiées. Mais il protestait contre le reproche de vouloir sacrifier l'anarchisme et la révolution au syndicalisme : « Comme tout le monde ici, l'anarchie est notre but final. Seulement, parce que les temps sont changés, nous avons modifié aussi notre conception du mouvement et de la révolution (...). Si, au lieu de critiquer de haut les vices passés, présents ou même futurs du syndicalisme, les anarchistes se mêlaient plus intimement à son action, les dangers que le syndicalisme peut receler seraient à tout jamais conjurés. »
L'ire des sectaires de l'anarchisme n'était d'ailleurs pas tout à fait sans fondement. Mais le type de syndicats qu'ils réprouvaient appartenait à une ère déjà révolue : c’étaient ceux, d'abord purement et platement corporatifs, ensuite à la remorque des politiciens social-démocrates, qui avaient proliféré en France durant les longues années consécutives à la répression de la Commune. En sens contraire, le syndicalisme de lutte de classes, régénéré par la pénétration des anarcho-syndicalistes, présentait pour les anarchistes « purs » un inconvénient inverse : il prétendait sécréter son idéologie propre, se « suffire à lui-même». Son porte-parole le plus mordant, Émile Pouget, soutint : « La suprématie du syndicat sur les autres modes de cohésion des individus réside en ce fait que l'œuvre d'améliorations partielles et celle plus décisive de transformation sociale y sont menées de front et parallèlement. Et c'est justement parce que le syndicat répond à cette double tendance (...) sans plus sacrifier le présent à l'avenir et celui-ci au présent, c'est pour tout cela que le syndicat s'érige comme le groupement par excellence. »
Le souci du nouveau syndicalisme d'affirmer et de préserver son indépendance , proclamé dans une Charte célèbre qu'adopta, en 1906, le congrès de la C.G.T., à Amiens, était beaucoup moins dirigé contre les anarchistes qu'inspiré par le souci de rejeter la tutelle de la démocratie bourgeoise et de son prolongement dans le mouvement ouvrier : la social-démocratie. Et, accessoirement, par la volonté de préserver la cohésion du mouvement syndical face à une prolifération de sectes politiques rivales, comme il en avait existé en France avant l'« unité socialiste». De l'ouvrage de Proudhon, De la capacité politique des classes ouvrières, qui était leur bible, les syndicalistes révolutionnaires avaient retenu, notamment, l'idée de « séparation » : constitué en classe distincte, le prolétariat avait à refuser tout apport de la classe adverse.
Mais certains anarchistes s'offusquèrent de la prétention du syndicalisme ouvrier à se passer de leur chaperonnage. Doctrine radicalement fausse, s'exclama Malatesta, et qui menaçait l'anarchisme dans son existence même. Et le sous-fifre Jean Grave de faire écho : « Le syndicalisme peut — et doit — se suffire à lui-même dans la lutte qu'il mène contre l'exploitation patronale, mais il ne peut avoir la prétention de résoudre à lui seul le problème social. » Il « se suffit si peu à lui-même qu'il a fallu que la notion de ce qu'il est, de ce qu'il doit être, de ce qu'il doit faire, lui vînt du dehors».
En dépit de ces récriminations, et grâce au ferment révolutionnaire qu'y déposèrent les anarchistes convertis au syndicalisme, le mouvement syndical, en France, comme dans les autres pays latins, était devenu, dans les années qui précédèrent la Grande Guerre, une puissance avec laquelle durent compter, non seulement la bourgeoisie, le gouvernement, mais aussi les politiciens social-démocrates, auxquels échappait, désormais, pour une large part, le contrôle du mouvement ouvrier. Le philosophe Georges Sorel considérait cette entrée des anarchistes dans les syndicats comme l'un des plus grands événements de son temps. La doctrine anarchiste s'était diluée dans un mouvement de masses, mais pour s'y retrouver, sous des formes nouvelles, et s'y retremper.
De la fusion opérée entre l'idée anarchiste et l'idée syndicaliste, le mouvement libertaire devait demeurer imprégné. La C.G.T. française, jusqu'en 1914, fut le produit, éphémère, de cette synthèse. Mais son fruit le plus accompli et le plus durable devait être la C.N.T. espagnole (Confederación Nacional del Trabajo), fondée en 1910, à la faveur de la désagrégation du parti radical du politicien Alexandre Lerroux. L'un des porte-parole de l'anarcho-syndicalisme espagnol, Diego Abad de Santillan, ne manquera pas de rendre hommage à Fernand Pelloutier, à Émile Pouget et aux autres anarchistes qui comprirent la nécessité de faire fructifier leurs idées, en premier lieu, dans les organisations économiques du prolétariat.
Chapitre II. L’anarchisme dans la révolution russe
L'anarchisme, après avoir trouvé un deuxième souffle dans le syndicalisme révolutionnaire, en puisa un troisième dans la Révolution russe. Cette affirmation peut, au premier abord, surprendre le lecteur, habitué à considérer la grande mutation révolutionnaire d'Octobre 1917 comme l'œuvre et comme l'apanage des seuls bolcheviks. En réalité, la Révolution russe fut un vaste mouvement de masses, une vague de fond populaire qui dépassa et submergea les formations idéologiques. Elle n'appartint à personne, sinon au peuple. Dans la mesure où elle fut une authentique révolution, impulsée de bas en haut, produisant spontanément des organes de démocratie directe, elle présenta toutes les caractéristiques d'une révolution sociale à tendances libertaires. Toutefois la faiblesse relative des anarchistes russes les empêcha d'exploiter des situations exceptionnellement favorables au triomphe de leurs idées.
La Révolution fut finalement confisquée et dénaturée par la maîtrise, diront les uns, l'astuce, diront les autres, de l'équipe de révolutionnaires professionnels groupée autour de Lénine. Mais cette défaite, à la fois de l'anarchisme et de l'authentique révolution populaire, ne fut pas entièrement stérile pour l'idée libertaire. Tout d'abord, l'appropriation collective des moyens de production ne fut pas remise en cause et le terrain ainsi sauvegardé sur lequel, un jour peut-être, le socialisme par en bas prévaudra sur l'encasernement étatique ; ensuite, l'expérience de l'U.R.S.S. fournit l'occasion à un certain nombre d'anarchistes russes et non russes de tirer les leçons complexes d'un temporaire échec — leçons dont Lénine lui-même semblait prendre conscience à la veille de mourir —, de repenser, à ce propos, les problèmes d'ensemble de la révolution et de l'anarchisme. En un mot, selon l'expression de Kropotkine, reprise par Voline, elle leur enseigna, si besoin était, comment il ne faut pas faire une révolution. Loin de prouver l'impraticabilité du socialisme libertaire, l'expérience soviétique, dans une large mesure, a confirmé, au contraire, la justesse prophétique des vues exprimées par les fondateurs de l'anarchisme et, notamment, de leur critique du socialisme « autoritaire».
Une révolution libertaire
Le point de départ de la Révolution de 1917 avait été celle de 1905, au cours de laquelle avaient surgi des organes révolutionnaires d'un type nouveau : les soviets. Ils étaient nés dans les usines de Saint-Pétersbourg au cours d'une grève générale spontanée. Vu l'absence à peu près complète d'un mouvement syndical et d'une tradition syndicaliste, ils avaient comblé un vide en coordonnant la lutte des usines en grève. L'anarchiste Voline fut du petit groupe qui, en liaison étroite avec les ouvriers et sur leur suggestion, eut l'idée de créer le premier soviet. Son témoignage rejoint celui de Trotsky qui, quelques mois plus tard, devait devenir le président du Soviet, et qui sans aucune intention péjorative, bien au contraire, écrit, dans son témoignage sur 1905 : « L'activité du soviet signifiait l’organisation de l'anarchie. Son existence et son développement ultérieurs marquaient une consolidation de l'anarchie».
Cette expérience s'était gravée pour toujours dans la conscience ouvrière et, quand éclata la Révolution de Février 1917, les dirigeants révolutionnaires n'eurent rien à inventer. Les ouvriers s'emparèrent spontanément des usines. Les soviets resurgirent d'eux-mêmes. Une nouvelle fois, ils prirent à l'improviste les professionnels de la Révolution. De l'aveu même de Lénine, les masses ouvrières et paysannes étaient « cent fois plus à gauche » que les bolcheviks. Le prestige des soviets était tel que l'insurrection d'Octobre ne put être déclenchée qu'au nom et à l'appel de ces derniers.
Mais, en dépit de leur élan, ils manquaient d'homogénéité, d'expérience révolutionnaire, de préparation idéologique. Ils étaient, de ce fait, la proie facile de partis politiques aux conceptions révolutionnaires vacillantes. Bien qu'organisation minoritaire, le parti bolchevique était la seule force révolutionnaire réellement organisée, et qui savait où elle allait. Il n'avait guère de rivaux à l'extrême-gauche, ni sur le plan politique, ni sur le plan syndical. Il disposait de cadres de premier ordre. Il déploya, comme l'admet Voline, « une activité farouche, fébrile, foudroyante».
Cependant l'appareil du Parti — dont Staline était encore à cette époque, un des obscurs fleurons — avait toujours regardé avec une certaine méfiance les soviets, concurrence gênante. Au lendemain de la prise du pouvoir, la tendance spontanée et irrésistible à la socialisation de la production fut d'abord canalisée par le moyen du contrôle ouvrier. Le décret du 14 novembre 1917 légalisa l'ingérence des travailleurs dans la gestion des entreprises, dans le calcul du prix de revient, abolit le secret commercial, obligea les patrons à exhiber leur correspondance et leurs comptes. « Les intentions des dirigeants de la Révolution, rapporte Victor Serge, n'étaient pas d'aller au-delà. » En avril 1918, ils envisageaient encore (...) la constitution de sociétés mixtes par actions, auxquelles eût participé, avec l'État soviétique, le capital russe et étranger». « L'initiative des mesures expropriatrices partit des masses et non du pouvoir. »
Dès le 20 octobre 1917, au premier congrès des conseils d'usine, fut présentée une motion, d'inspiration anarchiste, qui demandait : « Le contrôle de la production et les commissions de contrôle ne doivent pas être seulement des commissions de vérification, mais (...) les cellules de l'avenir qui, dès maintenant, préparent le transfert de la production aux mains des ouvriers. » « Au lendemain de la Révolution d'Octobre, observe A. Pankratova, ces tendances anarchistes s'affirmèrent avec d'autant plus de facilité et de succès que les capitalistes opposèrent la plus vive résistance à l'application du décret sur le contrôle ouvrier et continuèrent à refuser l'ingérence des travailleurs dans la production. »
Le contrôle ouvrier, en effet, se révéla vite une demi-mesure, inopérante et boiteuse. Les employeurs sabotaient, dissimulaient leurs stocks, soustrayaient l'outillage, provoquaient ou lock-outaient les ouvriers ; parfois ils se servaient des comités d'usine comme de simples agents ou auxiliaires de la direction, ou bien même ils croyaient profitable d'essayer de se faire nationaliser. Les ouvriers répondirent à ces manœuvres en s'emparant de l'usine et en la remettant en marche pour leur propre compte. « Nous n'écarterons pas nous-mêmes les industriels», disaient les ouvriers dans leurs motions, « mais nous prendrons en main la production s'ils ne veulent pas assurer le fonctionnement des fabriques. » Pankratova ajoute que, dans cette première période de socialisation « chaotique » et « primitive», les conseils d'usine « prenaient fréquemment la direction des usines dont les propriétaires avaient été éliminés ou avaient pris la fuite».
Très vite le contrôle ouvrier dut s'effacer devant la socialisation. Lénine violenta littéralement ses lieutenants timorés en les jetant dans le « creuset de la vivante création populaire», en les obligeant à parler un langage authentiquement libertaire. La base de la reconstruction révolutionnaire devait être l'autogestion ouvrière. Elle seule pouvait susciter dans les masses un enthousiasme révolutionnaire tel que l'impossible deviendrait possible. Lorsque le dernier manœuvre, lorsque n'importe quel sans-travail, quelle cuisinière, verrait les usines, la terre, l'administration confiées aux associations d'ouvriers, d'employés, de fonctionnaires, de paysans, aux comités démocratiques du ravitaillement, etc., créés spontanément par le peuple, « quand les pauvres gens verront et sentiront cela, aucune force ne sera en état de vaincre la révolution sociale». L'avenir s'ouvrait à une république du type de la Commune de 1871, à une république des soviets.
« Afin de frapper l'esprit des masses, raconte Voline, gagner leur confiance et leurs sympathies, le parti bolchevique lança (...) des mots d'ordre qui, jusqu'alors, caractérisaient (...) l'anarchisme. » Tout le pouvoir aux soviets, ce slogan, les masses, intuitivement, le comprirent dans le sens libertaire. « Les travailleurs, témoigne Archinoff, interprétèrent l'idée du pouvoir soviétique comme celle de leur libre disposition d'eux-mêmes, socialement et économiquement. » Au IIIe congrès des soviets (au début de 1818) Lénine lança : « Les idées anarchistes revêtent maintenant des formes vivantes», et, peu après, au VIIe congrès du Parti (6-8 mars), il fit adopter des thèses où il était question, entre autres, de socialisation de la production administrée par les organisations ouvrières (syndicats, comités d'usines, etc.), d'abolition des fonctionnaires de métier, de la police et de l'armée, d'égalité des salaires et traitements, de participation de tous les membres des soviets à la gestion et à l'administration de l'État, de suppression complète progressive dudit État et du signe monétaire. Au congrès des Syndicats (printemps 1918), Lénine décrivit les usines comme des « communes se gouvernant elles-mêmes de producteurs et de consommateurs». L'anarcho-syndicaliste Maximoff va jusqu'à soutenir : « Les bolcheviks avaient abandonné non seulement la théorie du dépérissement graduel de l'État, mais l'idéologie marxiste dans son ensemble. Ils étaient devenus des sortes d'anarchistes. »
Une révolution « autoritaire »
Mais l'alignement audacieux sur l'instinct et sur la température révolutionnaire des masses, s'il réussit à donner aux bolcheviks la direction de la Révolution, ne correspondait pas à leur idéologie traditionnelle ni à leurs intentions véritables. De longue date, ils étaient des « autoritaires», férus des notions d'État, de dictature, de centralisation, de parti dirigeant, de gestion de l'économie par en haut, toutes choses en contradiction flagrante avec une conception réellement libertaire de la démocratie soviétique.
L'État et la Révolution, écrit à la veille de l'insurrection d'Octobre, est un miroir où se reflète l'ambivalence de la pensée de Lénine. Certaines pages en pourraient être signées d'un libertaire et, comme on l’a vu plus haut, hommage y est rendu, au moins partiellement, aux anarchistes. Mais cet appel à la révolution par en bas se double d'un plaidoyer en faveur de la révolution par en haut. Les conceptions étatiques, centralisatrices, hiérarchiques ne prennent pas la forme d'arrière-pensées, plus ou moins dissimulées ; elles sont, au contraire, franchement étalées : l’État survivra à la conquête du pouvoir par le prolétariat, il ne dépérira qu'après une période transitoire. Combien de temps durera ce purgatoire ? Il ne nous est pas celé — on nous le dit sans regret, mais bien plutôt avec soulagement — que le processus sera « lent», de « longue durée». Ce que la Révolution enfantera sera, sous l'apparence du pouvoir des soviets, l'« État prolétarien » ou « dictature du prolétariat», « l’État bourgeois sans bourgeoisie», lâche même l'auteur, quand il consent à aller au fond de sa pensée. Cet État omnivore a bien l'intention de tout absorber.
Lénine se met à l'école de son contemporain, le capitalisme d'État allemand, la Kriegswirtschaft (économie de guerre). L'organisation de la grande industrie moderne par le capitalisme, avec sa « discipline de fer», est un autre de ses modèles. Il se pâme, notamment devant un monopole d'État tel que les P.T.T. et il s'écrie : « Quel mécanisme admirablement perfectionné ! Toute la vie économique organisée comme la Poste, (...) voilà l'État, voilà la base économique qu'il nous faut. » Vouloir se passer d'« autorité » et de « subordination», ce sont là des « rêves anarchistes», tranche-t-il. Tout à l'heure il s'échauffait à l'idée de confier aux associations ouvrières, à l'autogestion, la production et l'échange. Mais il y avait maldonne. Il ne cache pas sa recette magique : tous les citoyens devenus « les employés et les ouvriers d'un seul trust universel d'État», toute la société convertie en « un grand bureau et une grande fabrique». Les soviets, bien sûr, mais placés sous la coupe du parti ouvrier, d'un parti dont c'est la tâche historique de « diriger » le prolétariat.
Les plus lucides des anarchistes russes ne s'y trompèrent pas. A l'apogée de la période libertaire de Lénine, ils adjuraient déjà les travailleurs d'être sur leurs gardes :dans leur journal, Golos Truda (La Voix du Travail), on pouvait lire, dès les derniers mois de 1917 et le début de 1918, sous la plume de Voline, ces avertissements prophétiques : « Une fois leur pouvoir consolidé et légalisé, les bolcheviks — qui sont des socialistes, politiciens et étatistes, c'est-à-dire des hommes d'action centralistes et autoritaires — commenceront à arranger la vie du pays et du peuple avec des moyens gouvernementaux et dictatoriaux imposés par le centre (...). Vos soviets (...) deviendront peu à peu de simples organes exécutifs de la volonté du gouvernement central (...). On assistera à la mise en place d'un appareil autoritaire politique et étatique, qui agira par en haut et se mettra à écraser tout avec sa poigne de fer (...) Malheur à celui qui ne sera pas d'accord avec le pouvoir central. » « Tout le pouvoir aux Soviets deviendra, en fait, l'autorité des leaders du Parti. »
Les tendances de plus en plus anarchisantes des masses obligeaient Lénine, toujours selon Voline, à s'écarter pour un temps de l'ancien chemin. Il ne laissait subsister l'État, l'autorité, la dictature que pour une heure, pour une toute petite minute. Et, après, ce serait « l’anarchisme». « Mais, grands dieux, ne prévoyez-vous pas (...) ce que dira le citoyen Lénine lorsque le pouvoir actuel sera consolidé et qu'il deviendra possible de ne plus prêter l'oreille à la voix des masses ? » Il reviendra alors aux vieux sentiers battus. Il créera un « État marxiste», du type le plus accompli.
Bien entendu, il serait hasardeux de soutenir que Lénine et son équipe tendirent consciemment un piège aux masses. Il y avait moins duplicité en eux que dualisme doctrinal. La contradiction était si évidente, si flagrante entre les deux pôles de leur pensée qu'il était à prévoir qu'elle ne tarderait pas à éclater dans les faits. Ou bien la pression anarchisante des masses obligerait les bolcheviks à oublier le versant autoritaire de leurs conceptions, ou, au contraire, la consolidation de leur pouvoir, en même temps que l'essoufflement de la révolution populaire, les amèneraient à ranger au magasin des accessoires leurs velléités anarchisantes.
Un élément nouveau intervint, qui bouleversa les données du problème : les terribles circonstances de la guerre civile et de l'intervention étrangère, la désorganisation des transports, la pénurie de techniciens. Elles poussèrent les dirigeants bolcheviques à des mesures d'exception, à la dictature, à la centralisation, au recours à la « poigne de fer». Mais les anarchistes contestèrent que ces difficultés eussent seulement des causes « objectives » et extérieures à la Révolution. Pour une part, elles étaient dues, à leur avis, à la logique interne des conceptions autoritaires du bolchevisme, à l'impuissance d'un pouvoir bureaucratisé et centralisé à l'excès. Selon Voline, c'était, entre autres, l'incompétence de l'État, sa prétention à vouloir tout diriger et contrôler qui le rendirent incapable de réorganiser la vie économique du pays et le conduisirent à une véritable « débâcle», marquée par la paralysie de l'activité industrielle, la ruine de l'agriculture, la destruction de tous liens entre les diverses branches de l'économie.
Voline raconte, par exemple, que l'ancienne usine de pétrole Nobel, à Petrograd, ayant été abandonnée par ses propriétaires, ses quatre mille ouvriers décidèrent de la faire marcher collectivement. Ils s'adressèrent en vain au gouvernement bolchevique. Ils tentèrent alors de faire rouler l'entreprise par leurs propres moyens. Ils s'étaient répartis en groupes mobiles qui s'efforcèrent de trouver du combustible, des matières premières, des débouchés, des moyens de transport. Au sujet de ces derniers, ils avaient déjà entamé des pourparlers avec leurs camarades cheminots. Le gouvernement se fâcha. Responsable devant l'ensemble du pays il ne pouvait admettre que chaque usine agît à sa guise. S'obstinant, le conseil ouvrier convoqua une assemblée générale des travailleurs. Le commissaire du peuple au Travail se dérangea en personne pour mettre en garde les ouvriers contre « un acte d'indiscipline grave». Il fustigea leur attitude « anarchiste et égoïste». Il les menaça de licenciement sans indemnité. Les travailleurs rétorquèrent qu'ils ne sollicitaient aucun privilège : le gouvernement n'avait qu'à laisser les ouvriers et les paysans agir de la même façon dans tout le pays. En vain. Le gouvernement maintint son point de vue, et l'usine fut fermée.
Le témoignage de Voline est corroboré par celui d'une communiste : Alexandra Kollontaï. Elle devait se plaindre, en 1921, de ce que d'innombrables exemples d’initiatives ouvrières eussent sombré dans la paperasserie et de stériles palabres administratives : « Combien d'amertume parmi les ouvriers (...) quand ils voient et savent [ce] que, si on leur avait donné le droit et la possibilité d'agir, ils auraient pu réaliser eux-mêmes (...) L'initiative s'affaiblit, le désir d'agir meurt. »
*
Le pouvoir des soviets ne dura, en fait, que quelques mois, d'octobre 1917 au printemps de 1918. Très vite les conseils d'usine furent dépouillés de leurs attributions. Le prétexte invoqué fut que l'autogestion ne tenait pas compte des besoins « rationnels » de l'économie, qu'elle entretenait un égoïsme d'entreprises se faisant l'une à l'autre concurrence, se disputant de maigres ressources, voulant à tout prix survivre, bien que d'autres usines fussent plus importantes « pour l'État » et mieux équipées. En un mot, l'on aboutissait, selon les termes d'A. Pankratova, à une fragmentation de l'économie en « fédérations autonomes de producteurs du type rêvé par les anarchistes». Sans aucun doute, la naissante autogestion ouvrière n'était pas sans reproche. Elle avait cherché péniblement, à tâtons, à créer de nouvelles formes de production qui n'avaient eu aucun précédent dans l'histoire humaine. Il lui était arrivé, certes, de se tromper, de faire fausse route. C'était le tribut de l'apprentissage. Comme le soutenait Kollontaï, le communisme ne pouvait naître que dans un processus de recherches pratiques, avec des erreurs peut-être, mais à partir des forces créatrices de la classe ouvrière elle-même».
Tel n'était pas le point de vue des dirigeants du Parti. Ils étaient trop heureux de reprendre aux comités d'usine les pouvoirs que, dans leur for intérieur, ils ne s'étaient que résignés à leur abandonner. Lénine, dès 1918, marquait ses préférences pour la « volonté d'un seul » dans la gestion des entreprises. Les travailleurs devaient obéir « inconditionnellement » à la volonté unique des dirigeants du processus de travail. Tous les chefs bolcheviques, nous dit Kollontaï, étaient « méfiants à l'égard des capacités créatrices des collectivités ouvrières». Au surplus l'administration était envahie par de nombreux éléments petits-bourgeois, résidus de l’ancien capitalisme russe, qui s'étaient adaptés un peu trop vite aux institutions soviétiques, s'étaient fait attribuer des postes responsables dans les divers commissariats et entendaient que la gestion économique fût confiée, non aux organisations ouvrières, mais à eux-mêmes.
On assista à l'immixtion croissante de la bureaucratie étatique dans l’économie. Dès le 5 décembre 1917, l'industrie fut coiffée par un Conseil Supérieur de l'Économie, chargé de coordonner autoritairement l'action de tous les organes de la production. Le congrès des Conseils de l'Économie (26 mai-4 juin 1918) décida la formation de directions d'entreprise dont les deux tiers des membres seraient nommés par les conseils régionaux ou le Conseil Supérieur de l’Économie et le troisième tiers seulement élu sur place par les ouvriers. Le décret du 28 mai 1918 étendit la collectivisation à l'ensemble de l'industrie, mais, du même coup, transforma les socialisations spontanées des premiers mois de la Révolution en nationalisations. C'était le Conseil Supérieur de l'Économie qui était chargé d'organiser l'administration des entreprises nationalisées.
Les directeurs et cadres techniques demeuraient en fonctions, en tant qu'appointés de l'État. Au IIe congrès du Conseil Supérieur de l’Économie, à la fin de 1918, les conseils d'usine furent vertement tancés par le rapporteur pour diriger pratiquement l'usine, au lieu et place du conseil d'administration.
Des élections aux comités d'usine continuèrent, pour la façade, à avoir lieu, mais un membre de la cellule communiste donnait lecture d'une liste de candidats fabriquée à l'avance et l'on procédait au vote à main levée, en présence des « gardes communistes», armés, de l'entreprise. Quiconque se déclarait contre les candidats proposés se voyait infliger des sanctions économiques (déclassement de salaires, etc.). Comme l'expose Archinoff, il n'y eut plus qu'un seul maître omniprésent, l'État. Les rapports entre les ouvriers et ce nouveau patron redevinrent ceux qui avaient existé entre le travail et le capital. Le salariat fut restauré, à la seule différence qu'il prenait désormais le caractère d'un devoir envers l’État.
Les soviets n'eurent plus qu'une fonction nominale. Ils furent transformés en institutions de pouvoir gouvernemental. « Vous devez devenir les cellules étatiques de base » déclara Lénine, le 27 juin 1918, au congrès des conseils d'usine. Ils furent réduits, selon les termes de Voline, au rôle d'« organes purement administratifs et exécutifs, chargés de petites besognes locales sans importance, entièrement soumis aux “directives” des autorités centrales : gouvernement et organes dirigeants du Parti». Ils n'eurent même plus « l'ombre d'un pouvoir». Au IIIe congrès des syndicats (avril 1920), le rapporteur, Lozovsky, avoua : « Nous avons renoncé aux vieilles méthodes de contrôle ouvrier et nous n'en avons gardé que le principe étatique. » Désormais ce « contrôle » était exercé par un organisme de l’État : l’Inspection ouvrière et paysanne.
Les fédération d'industrie, de structure centraliste, avaient, d'abord, servi aux bolcheviks à encadrer et à subordonner les conseils d'usine, fédéralistes et libertaires par nature. Dès le 1er avril 1918, la fusion entre les deux types d'organisation était un fait accompli. Désormais les syndicats, surveillés par le parti, jouèrent un rôle disciplinaire. Celui des métallurgistes de Petrograd interdit les « initiatives désorganisatrices » des conseils d'usine et blâma leurs tendances des plus dangereuses à faire passer aux mains des travailleurs telle ou telle entreprise. C'était là, disait-on, imiter de la pire façon les coopératives de production « dont l'idée avait, depuis longtemps, fait faillite et qui ne manqueraient pas de se transformer en entreprises capitalistes». « Toute entreprise laissée à l'abandon ou sabotée par un industriel, dont la production était nécessaire à l'économie nationale, devait être placée sous la gestion de l'État. Il était « inadmissible » que les travailleurs prissent en main des entreprises sans l'approbation de l'appareil syndical.
Après cette première opération d'encadrement, les syndicats ouvriers furent, à leur tour, domestiqués, dépouillés de toute autonomie, épurés, leurs congrès différés, leurs membres arrêtés, leurs organisations dissoutes ou fusionnées en unités plus larges. Au terme de ce processus, toute orientation anarcho-syndicaliste fut anéantie, le mouvement syndical étroitement subordonné à l'État et au parti unique.
Il en fut de même en ce qui concerne les coopératives de consommation. Au début de la Révolution, elles avaient surgi de partout, s'étaient multipliées, fédérées. Mais elles avaient le tort d'échapper au contrôle du parti et un certain nombre de social-démocrates (mencheviks) s’y étaient infiltrés. On commença par priver les magasins locaux de leurs moyens de ravitaillement et de transport, sous le prétexte de « commerce privé » et de « spéculation», ou même sans le moindre prétexte. Ensuite furent fermées d'un coup toutes les coopératives libres, et, à leur place, installées, bureaucratiquement, des coopératives d'État. Le décret du 20 mars 1919 absorba les coopératives de consommation dans le commissariat au ravitaillement et les coopératives de production industrielle dans le Conseil Supérieur de l'Économie. De nombreux coopérateurs furent jetés en prison.
*
La classe ouvrière ne réagit ni assez vite ni assez vigoureusement. Elle était disséminée, isolée dans un immense pays arriéré et en grande majorité rural, épuisée par les privations et les luttes révolutionnaires, plus encore, démoralisée. Ses meilleurs éléments, enfin, l'avaient quittée pour les fronts de la guerre civile ou avaient été absorbés par l'appareil du parti et du gouvernement. Cependant assez nombreux furent les travailleurs qui se sentirent plus ou moins frustrés de leurs conquêtes révolutionnaires, privés de leurs droits, mis en tutelle, humiliés par l'arrogance ou l'arbitraire des nouveaux maîtres, et qui prirent conscience de la véritable nature du prétendu « État prolétarien». Ainsi, au cours de l'été 1918, des ouvriers mécontents élurent, dans les usines de Moscou et de Petrograd, des délégués pris dans leur sein, cherchant ainsi à opposer leurs authentiques « conseils de délégués » aux soviets d'entreprises déjà captés par le pouvoir. Comme en témoigne Kollontaï, l'ouvrier sentait, voyait et comprenait qu'il était mis à l’écart. Il put comparer le mode de vie des fonctionnaires soviétiques avec la façon dont il vivait lui — lui sur lequel reposait, au moins en théorie, la « dictature du prolétariat».
Mais quand les travailleurs virent tout à fait clair, il était déjà trop tard. Le pouvoir avait eu le temps de s'organiser solidement et disposait de forces de répression capables de briser toute tentation d'action autonome des masses. Au dire de Voline, une lutte âpre mais inégale, qui dura quelque trois ans et resta à peu près ignorée hors de Russie, opposa une avant-garde ouvrière à un appareil étatique qui s'obstinait à nier le divorce consommé entre lui et les masses. De 1919 à 1921, les grèves se multiplièrent dans les grands centres, à Petrograd, surtout, et même à Moscou. Elles furent, comme on le verra plus loin, durement réprimées.
A l'intérieur même du Parti dirigeant, une « Opposition ouvrière » surgit qui réclama le retour à la démocratie soviétique et à l'autogestion. Au Xe congrès du Parti, en mars 1921, l'un de ses porte-parole, Alexandra Kollontaï, distribua une brochure qui demandait pour les syndicats la liberté d'initiative et d'organisation ainsi que l'élection par un « congrès de producteurs», d'un organe central d'administration de l'économie nationale. L'opuscule fut confisqué et interdit. Lénine fit adopter par la presque unanimité des congressistes une résolution assimilant les thèses de l'Opposition ouvrière aux déviations petites-bourgeoises et anarchistes : « Le « syndicalisme», le « semi-anarchisme » des oppositionnels était, à ses yeux, un « danger direct » pour le monopole du pouvoir exercé par le Parti au nom du prolétariat.
La lutte se poursuivit au sein de la direction de la centrale syndicale. Pour avoir soutenu l'indépendance des syndicats par rapport au Parti, Tomsky et Riazanov furent exclus du présidium et envoyés en exil, tandis que le principal dirigeant de l'Opposition ouvrière, Chliapnikov, subissait le même sort, bientôt suivi par l’animateur d'un autre groupe oppositionnel. G. I. Miasnikov. Cet authentique ouvrier, justicier en 1917 du grand-duc Michel, qui comptait quinze années de présence dans le parti et, avant la Révolution, plus de sept ans de prison et soixante-quinze jours de grève de la faim, avait osé, en novembre 1921, imprimer dans une brochure que les travailleurs avaient perdu confiance dans les communistes, parce que le Parti n'avait plus de langage commun avec la base et qu'il tournait maintenant contre la classe ouvrière les moyens de répression mis en œuvre, de 1918 à 1920, contre les bourgeois.
Le rôle des anarchistes
Dans ce drame, où une révolution de type libertaire fut transmuée en son contraire, quel rôle jouèrent les anarchistes russes ? La Russie n'avait guère de traditions libertaires. C'était à l'étranger que Bakounine et Kropotkine étaient devenus anarchistes. Ni l'un ni l'autre ne militèrent jamais comme anarchistes en Russie. Quant à leurs œuvres, elles avaient paru, au moins jusqu'à la Révolution de 1917, à l'étranger, souvent même en langue étrangère. Seuls quelques extraits en avaient été introduits clandestinement, difficilement, en Russie, en quantités très restreintes. Toute l'éducation sociale, socialiste et révolutionnaire des Russes n'avait absolument rien d'anarchiste. Tout au contraire, assure Voline, « la jeunesse russe avancée lisait une littérature qui, invariablement, présentait le socialisme sous un jour étatiste». L'idée gouvernementale habitait les esprits : la social-démocratie allemande les avait contaminés.
Les anarchistes n'étaient « qu'une petite poignée d'hommes sans influence» ; tout au plus quelques milliers. Leur mouvement, toujours selon Voline, était « encore bien trop faible pour avoir une influence immédiate et concrète sur les événements». En outre, ils étaient, pour la plupart, des intellectuels, de tendances individualistes, trop peu mêlés au mouvement ouvrier. Nestor Makhno, qui, avec Voline, fit exception et, dans son Ukraine natale, œuvra au cœur des masses, écrit, sévèrement, dans ses Mémoires, que l'anarchisme russe « se trouva en queue des événements et même parfois tout à fait en dehors d'eux».
Pourtant il semble y avoir quelque injustice dans ce jugement. Le rôle des anarchistes ne fut nullement négligeable entre la Révolution de Février et la Révolution d'Octobre. Trotsky en convient à plusieurs reprises au cours de son Histoire de la Révolution russe. « Hardis » et « actifs » malgré leur petit nombre, ils furent des adversaires de principe de l'assemblée constituante à un moment où les bolcheviks n'étaient pas encore antiparlementaires. Bien avant le parti de Lénine, ils inscrivirent sur leurs drapeaux le mot d'ordre : Tout le pouvoir aux soviets. Ce furent eux qui animèrent le mouvement de socialisation spontanée du logement, souvent contre le gré des bolcheviks. Ce fut en partie sous l'impulsion de militants anarcho-syndicalistes que les ouvriers s'emparèrent des usines, avant même Octobre.
Pendant les journées révolutionnaires qui mirent fin à la république bourgeoise de Kerensky, les anarchistes furent à la pointe du combat militaire, notamment au sein du régiment de Dvinsk qui, sous les ordres de vieux libertaires tels que Gratchoff et Fedotoff, délogea les « cadets » contre-révolutionnaires. Ce fut l'anarchiste Anatole Gelezniakoff, avec l'aide de son détachement, qui dispersa l'assemblée constituante : les bolcheviks ne firent que ratifier le fait accompli. De nombreux détachements de partisans, formés par des anarchistes ou conduits par eux (ceux de Mokrooussoff, de Tcherniak et autres), luttèrent sans trêve contre les armées blanches, de 1918 à 1920.
Il n'y eut guère de ville importante qui ne comptât un groupe anarchiste ou anarcho-syndicaliste diffusant un matériel imprimé relativement considérable : journaux, magazines, tracts, brochures, livres. À Petrograd deux hebdomadaires, à Moscou un quotidien avaient un tirage de 25.000 exemplaires chacun. L'audience des anarchistes s'accrut au fur et à mesure que la Révolution s'approfondit, puis se détacha des masses.
Le 6 avril 1918, le capitaine français Jacques Sadoul, en mission en Russie, écrivait dans un rapport : « Le parti anarchiste est le plus actif, le plus combatif des groupes de l'opposition et probablement le plus populaire (...). Les bolcheviks sont inquiets. » A la fin de 1918, affirme Voline, « cette influence devint telle que les bolcheviks, qui n'admettaient aucune critique, et encore moins une contradiction, s'inquiétèrent sérieusement». Pour l'autorité bolchevique, rapporte Voline, « tolérer la propagande anarchiste équivalait (...) au suicide. Elle fit son possible pour empêcher d'abord, interdire ensuite, et supprimer finalement, par la force brutale toute manifestation des idées libertaires».
Le gouvernement bolchevique « commença par fermer brutalement les sièges des organisations libertaires, par interdire aux anarchistes toute propagande ou activité». C'est ainsi que dans la nuit du 12 avril 1918, à Moscou, des détachements de gardes rouges, armés jusqu'aux dents, nettoyèrent, par surprise, vingt-cinq maisons occupées par les anarchistes. Ceux-ci, se croyant attaqués par des gardes blancs, ripostèrent à coups de feu. Puis, toujours selon Voline, le pouvoir passa rapidement « à des mesures plus violentes : la prison, la mise hors la loi, la mise à mort». « Quatre ans durant, ce conflit tiendra en haleine le pouvoir bolchevique (...) jusqu'à l'écrasement définitif du courant libertaire manu militari (fin 1921). »
La liquidation des anarchistes put être menée d'autant plus aisément qu'ils s'étaient divisés en deux fractions, l'une qui refusa d'être domestiquée, l'autre qui se laissa apprivoiser. Ces derniers invoquèrent la nécessité historique pour faire acte de loyalisme vis-à-vis du régime et approuver, au moins momentanément, ses actes dictatoriaux. Pour eux, il s'agissait, d'abord, de terminer victorieusement la guerre civile, d'écraser la contre-révolution.
Tactique à courte vue, estimèrent les anarchistes intransigeants. Car, précisément, c'était l'impuissance bureaucratique de l'appareil gouvernemental, la déception et le mécontentement populaires qui alimentaient les mouvements contre-révolutionnaires. En outre, le pouvoir finissait par ne plus distinguer l'aile marchante de la Révolution libertaire, qui contestait ses moyens de domination, des entreprises criminelles de ses adversaires de droite. Accepter la dictature et la terreur, c'était, pour les anarchistes, qui allaient en être eux-mêmes les victimes, une politique de suicide. Enfin, le ralliement des anarchistes dits « soviétiques » facilita l'écrasement des autres, des irréductibles, qui furent traités de « faux » anarchistes, de rêveurs irresponsables n'ayant pas les pieds sur la terre, de stupides brouillons, de diviseurs, de fous furieux et, finalement, de bandits, de contre-révolutionnaires.
Le plus brillant, donc le plus écouté, des anarchistes ralliés fut Victor-Serge. Employé du régime, il publia, en français, une brochure qui tentait de le défendre contre la critique anarchiste. Le livre qu'il écrivit plus tard, L'An I de la Révolution russe est pour une large part, une justification de la liquidation des soviets par le bolchevisme. Le parti — ou plutôt son élite dirigeante — y est présenté comme le cerveau de la classe ouvrière. C'est aux chefs dûment sélectionnés de l'avant-garde de découvrir ce que peut et doit faire le prolétariat. Sans eux les masses organisées dans les soviets ne seraient « qu'une poussière d'hommes aux aspirations confuses traversées de lueurs d'intelligence».
Victor-Serge était trop lucide, certes, pour se faire la moindre illusion sur la nature véritable du pouvoir soviétique Mais ce pouvoir était encore tout auréolé du prestige de la première révolution prolétarienne victorieuse ; il était honni par la contre-révolution mondiale ; et c'était une des raisons — la plus honorable — pour lesquelles Serge — comme tant d'autres révolutionnaires — crut devoir mettre un bœuf sur sa langue. Au cours de l’été 1921, il confia, dans le privé, à l'anarchiste Gaston Leval, venu à Moscou, dans la délégation espagnole, pour le IIIe congrès de l'Internationale communiste : « Le Parti communiste n’exerce plus la dictature du prolétariat mais sur le prolétariat. » De retour en France, Leval publia dans Le Libertaire des articles, où, s'appuyant sur des faits précis, il mit en parallèle ce que Victor-Serge lui avait glissé à l’oreille et ses propos publics qualifiés de « mensonges conscients». Dans Living my Life, Emma Goldman, la libertaire américaine qui le vit à l'œuvre à Moscou, n'est pas non plus tendre pour Victor-Serge.
La « Makhnovtchina »
Si la liquidation des anarchistes urbains, petits noyaux impuissants, devait être relativement aisée, il n'en fut pas de même dans le sud de l'Ukraine où le paysan Nestor Makhno avait constitué une forte organisation anarchiste rurale, à la fois économique et militaire. Fils de paysans pauvres ukrainiens, Makhno avait vingt ans en 1919. Tout jeune, il avait participé à la Révolution de 1905 et était devenu anarchiste. Condamné à mort par le tsarisme, sa peine avait été commuée et les huit années qu'il passa, presque toujours aux fers, à la prison de Boutirki, avaient été sa seule école. Avec l'aide d'un codétenu, Pierre Archinoff, il combla, au moins en partie, les lacunes de son instruction.
L'organisation autonome des masses paysannes dont il prit l'initiative, au lendemain d'Octobre, couvrait une région peuplée de 7 millions d'habitants, formant une sorte de cercle de 280 kilomètres de hauteur sur 250 de large. A son extrémité sud elle touchait à la mer d'Azov, où elle atteignait le port de Berdiansk. Son centre était Gulyai-Polyé, un gros bourg de 20 à 30.000 habitants. Cette région était traditionnellement rebelle. Elle avait été, en 1905, le théâtre de troubles violents.
Tout avait commencé avec l'établissement, en Ukraine, d'un régime de droite, imposé par les armées d'occupation allemande et autrichienne et qui s'était empressé de rendre à leurs anciens propriétaires les terres que les paysans révolutionnaires venaient de leur enlever. Les travailleurs du sol défendirent leurs toutes récentes conquêtes les armes à la main. Ils les défendirent aussi bien contre la réaction que contre l'intrusion intempestive, à la campagne, des commissaires bolcheviques, et leurs trop lourdes réquisitions. Cette gigantesque jacquerie fut animée par un justicier, une sorte de Robin des Bois anarchiste, surnommé par les paysans : « Père Makhno». Son premier fait d'armes fut la prise de Gulyai-Polyé, à la mi-septembre 1918. Mais l'armistice du 11 novembre amena le retrait des forces d'occupation germano-autrichiennes, en même temps qu'il offrit à Makhno une occasion unique de constituer des réserves d'armes et de stocks.
Pour la première fois dans l'histoire, les principes du communisme libertaire furent mis en application dans l'Ukraine libérée et, dans la mesure où les circonstances de la guerre civile le permirent, l'autogestion pratiquée. Les terres disputées aux anciens propriétaires fonciers furent cultivées en commun par les paysans, groupés en « communes » ou « soviets de travail libres». Les principes de fraternité et l'égalité y étaient observés. Tous, hommes, femmes, enfants devaient travailler dans la mesure de leurs forces. Les camarades élus aux fonctions de gestion, à titre temporaire, reprenaient ensuite leur travail habituel aux côtés des autres membres de la commune.
Chaque soviet n'était que l'exécuteur des volontés des paysans de la localité qui l'avait élu. Les unités de production étaient fédérées en districts et les districts en régions. Les soviets étaient intégrés dans un système économique d'ensemble, basé sur l'égalité sociale. Ils devaient être absolument indépendants de tout parti politique. Aucun politicien ne devait y dicter ses volontés sous le couvert du pouvoir soviétique. Leurs membres devaient être des travailleurs authentiques, au service exclusif des intérêts des masses laborieuses.
Lorsque les partisans makhnovistes pénétraient dans une localité, ils apposaient des affiches où l'on pouvait lire : « La liberté des paysans et des ouvriers appartient à eux-mêmes et ne saurait souffrir aucune restriction. C'est aux paysans et aux ouvriers eux-mêmes d'agir, de s'organiser, de s'entendre entre eux dans tous les domaines de leur vie, comme ils le conçoivent eux-mêmes et comme ils le veulent (...). Les makhnovistes ne peuvent que les aider, leur donnant tel ou tel avis ou conseil (...). Mais ils ne peuvent ni ne veulent en aucun cas les gouverner. »
Quand, plus tard, à l'automne de 1920, les hommes de Makhno furent amenés à conclure, d'égal à égal, un accord éphémère avec le pouvoir bolchevique, ils insistèrent pour l'adoption de l'additif suivant : « Dans la région où opérera l'armée makhnoviste, la population ouvrière et paysanne créera ses institutions libres pour l'autoadministration économique et politique ; ces institutions seront autonomes et liées fédérativement — par pactes — avec les organes gouvernementaux des Républiques soviétiques. » Abasourdis, les négociateurs bolcheviques disjoignirent cet additif de l'accord, afin d'en référer à Moscou, où, bien entendu, il fut jugé « absolument inadmissible».
Une des faiblesses relatives du mouvement makhnoviste était l'insuffisance d'intellectuels libertaires dans son sein. Mais, au moins par intermittence, il fut aidé, du dehors. Tout d'abord, de Kharkov et de Koursk, par les anarchistes qui, à la fin de 1918, avaient fusionné en un cartel dit Nabat (le Tocsin), animé par Voline. En avril 1919, ils tinrent un congrès où ils se prononcèrent « catégoriquement et définitivement contre toute participation aux soviets, devenus des organismes purement politiques, organisés sur une base autoritaire, centraliste, étatique». Ce manifeste fut considéré par le gouvernement bolchevique comme une déclaration de guerre et le Nabat dut cesser toute activité. Par la suite, en juillet, Voline réussit à rejoindre le quartier général de Makhno où, de concert avec Pierre Archinoff, il prit en charge la section culturelle et éducative du mouvement. Il présida un de ses congrès, celui tenu en octobre, à Alexandrovsk. Des Thèses générales précisant la doctrine des « soviets libres » y furent adoptées.
Les congrès groupaient à la fois des délégués des paysans et des délégués des partisans. En effet, l'organisation civile était le prolongement d'une armée insurrectionnelle paysanne, pratiquant la tactique de la guérilla. Elle était remarquablement mobile, capable de parcourir jusqu'à cent kilomètres par jour, non seulement du fait de sa cavalerie, mais grâce aussi à son infanterie qui se déplaçait dans de légères voitures hippomobiles, à ressorts. Cette armée était organisée sur les bases, spécifiquement libertaires du volontariat, du principe électif, en vigueur pour tous les grades, et de la discipline librement consentie : les règles de cette dernière, élaborées par des commissions de partisans, mis validées par des assemblées générales, étaient rigoureusement observées par tous.
Les corps francs de Makhno donnèrent du fil à retordre aux armées « blanches » interventionnistes. Quant aux unités de gardes-rouges des bolcheviks, elles étaient assez peu efficaces. Elles se battaient seulement le long des voies ferrées sans jamais s'éloigner de leurs trains blindés, se repliant au premier échec, s'abstenant souvent de rembarquer leurs propres combattants. Aussi inspiraient-elles peu de confiance aux paysans qui, isolés dans leurs villages et privés d'armes, eussent été à la merci des contre-révolutionnaires. « L'honneur d'avoir anéanti, en automne de l'année 1919, la contre-révolution de Denikine revient principalement aux insurgés anarchistes», écrit Archinoff, le mémorialiste de la makhnovtchina.
Mais Makhno refusa toujours de placer son armée sous le commandement suprême de Trotsky, chef de l'Armée Rouge, après la fusion dans cette dernière des unités de gardes-rouges. Aussi le grand révolutionnaire crut-il devoir s'acharner contre le mouvement insurrectionnel. Le 4 juin 1919, il rédigea un ordre, par lequel il interdit le prochain congrès des makhnovistes, accusés de se dresser contre le pouvoir des Soviets en Ukraine, stigmatisa toute participation au congrès comme un acte de « haute trahison » et prescrivit l'arrestation de ses délégués. Inaugurant une procédure qu'imiteront, dix-huit ans plus tard, les staliniens espagnols contre les brigades anarchistes, il refusa des armes aux partisans de Makhno, se dérobant au devoir de leur porter assistance, pour ensuite les accuser de trahir et de se laisser battre par les troupes blanches.
*
Cependant les deux armées se retrouvèrent d'accord, par deux fois, lorsque la gravité du péril interventionniste exigea leur action commune, ce qui se produisit, d'abord, en mars 1919 contre Denikine, puis au cours de l'été et de l'automne 1920, quand menacèrent les forces blanches de Wrangel que, finalement, Makhno détruisit. Mais, aussitôt le danger extrême conjuré, l'Armée Rouge reprenait les opérations militaires contre les partisans de Makhno, qui lui rendaient coup pour coup.
A la fin de novembre 1920, le pouvoir n'hésita pas à organiser un guet-apens. Les officiers de l'armée makhnoviste de Crimée furent invités par les bolcheviks à participer à un conseil militaire. Ils y furent aussitôt arrêtés par la police politique, la Tchéka, et fusillés, leurs partisans désarmés. En même temps une offensive en règle était lancée contre Gulyai-Polyé. La lutte — une lutte de plus en plus inégale — entre libertaires et « autoritaires » dura encore neuf mois. Mais, à la fin, mis hors de combat par des forces très supérieures en nombre et mieux équipées, Makhno dut abandonner la partie. Il réussit à se réfugier en Roumanie en août 1921, puis à gagner Paris, où il mourut plus tard, malade et indigent. Ainsi se terminait l'épopée de la makhnovtchina, prototype, selon Pierre Archinoff, d'un mouvement indépendant des masses laborieuses et, de ce fait, source d'inspiration future pour les travailleurs du monde.
Cronstadt
Les aspirations des paysans révolutionnaires makhnovistes étaient assez semblables à celles qui poussèrent conjointement à la révolte, en février-mars 1921, les ouvriers de Petrograd et les matelots de la forteresse de Cronstadt.
Les travailleurs urbains souffraient, à la fois, de conditions matérielles devenues intolérables du fait de la pénurie de vivres, de combustibles, de moyens de transport et d'un régime de plus en plus dictatorial et totalitaire, qui écrasait la moindre manifestation de mécontentement. A fin février, des grèves éclatèrent à Petrograd, Moscou et dans quelques autres centres industriels. Les travailleurs, marchant d'une entreprise à l'autre, fermant les usines, attirant dans leurs cortèges de nouveaux contingents d'ouvriers, réclamaient pain et liberté. Le pouvoir répondit par une fusillade, les travailleurs de Petrograd par un meeting de protestation, qui rassembla 10.000 ouvriers.
Cronstadt était une base navale insulaire, à trente kilomètres de Petrograd, dans le golfe de Finlande, gelé en hiver. Elle était peuplée de matelots et de plusieurs milliers d'ouvriers occupés dans les arsenaux de la marine militaire. Les marins de Cronstadt avaient joué un rôle d'avant-garde dans les péripéties révolutionnaires de 1917. Ils avaient été, selon les termes de Trotsky « l'orgueil et la gloire de la Révolution russe». Les habitants civils de Cronstadt formaient une commune libre, relativement indépendante du pouvoir. Au centre de la forteresse une immense place publique jouait le rôle d'un forum populaire pouvant contenir 30.000 personnes.
Certes, les matelots n'avaient plus, en 1921, les mêmes effectifs ni la même composition révolutionnaire qu'en 1917 ; ils étaient, bien plus que leurs prédécesseurs, issus de la paysannerie ; mais ils avaient conservé l'esprit militant et, du fait de leurs performances antérieures, le droit de participer activement aux réunions ouvrières de Petrograd. Aussi envoyèrent-ils aux travailleurs en grève de l'ancienne capitale des émissaires, qui furent refoulés par les forces de l'ordre. Au cours de deux meetings de masses tenus sur le forum, ils reprirent à leur compte les revendications des grévistes. A la seconde réunion, le 1er mars, ils étaient 16.000 présents, marins, travailleurs et soldats, et nonobstant la présence du chef de l'État, le président de l'exécutif central, Kalinine, ils adoptèrent une résolution demandant la convocation, en dehors des partis politiques, dans les dix jours suivants, d'une conférence des ouvriers, soldats rouges et marins de Petrograd, de Cronstadt et de la province de Petrograd. En même temps ils exigeaient l'abolition des « officiers politiques», aucun parti politique ne devant avoir de privilèges, ainsi que la suppression des détachements communistes de choc dans l'armée et de la « garde communiste » dans les usines.
C'était bel et bien le monopole du parti dirigeant qui était visé. Un monopole que les rebelles de Cronstadt n'hésitaient pas à qualifier d'« usurpation». Feuilletons, pour le résumer, le journal officiel de cette nouvelle Commune, les Izvestia de Cronstadt. Laissons parler les matelots en colère. Le Parti communiste, après s'être arrogé le pouvoir, n'avait, selon eux, qu'un souci : le conserver par n'importe quel moyen. Il s'était détaché des masses. Il s'était révélé impuissant à tirer le pays d un état de débâcle générale. Il avait perdu la confiance des ouvriers. Il était devenu bureaucratique. Les soviets, dépouillés de leur pouvoir, étaient falsifiés, accaparés et manipulés, les syndicats étatisés. Une machine policière omnipotente pesait sur le peuple, dictant sa loi par des fusillades et la pratique de la terreur. Sur le plan économique régnait, au lieu et place du socialisme annoncé, basé sur le travail libre, un dur capitalisme d'État. Les ouvriers étaient de simples salariés de ce trust national, des exploités, tout comme naguère. Les sacrilèges de Cronstadt allaient jusqu'à contester l'infaillibilité des chefs suprêmes de la Révolution. Ils se gaussaient, avec irrévérence, de Trotsky, et même, de Lénine. Au-delà de leurs revendications immédiates : restauration des libertés, élections libres à tous les organes de la démocratie soviétique, ils visaient un objectif d'une portée plus lointaine et d'un contenu nettement anarchiste : une « troisième Révolution. »
Les rebelles, en effet, entendaient demeurer sur le terrain révolutionnaire. Ils s'engageaient à veiller sur les conquêtes de la révolution sociale. Ils affirmaient n'avoir rien de commun avec ceux qui auraient voulu « rétablir le knout du tsarisme», et, s'ils ne cachaient pas leur intention de renverser le pouvoir des « communistes», ce n'était pas pour que « les ouvriers et les paysans redeviennent esclaves». Ils ne coupaient pas non plus tous les ponts entre eux et le régime, avec lequel ils espéraient encore « pouvoir trouver un langage commun». Enfin, s'ils réclamaient la liberté d'expression, ce n'était pas pour n'importe qui, mais seulement pour des partisans sincères de la Révolution : anarchistes et « socialistes de gauche » (formule qui excluait les social-démocrates ou mencheviks).
Mais l'audace de Cronstadt allait beaucoup plus loin que ne le pouvaient supporter un Lénine, un Trotsky. Les chefs bolcheviks avaient identifié, une fois pour toutes, la Révolution avec le Parti communiste et tout ce qui allait à l'encontre de ce mythe ne pouvait être, à leurs yeux, que « contre-révolutionnaire». Ils virent toute l'orthodoxie marxiste-léniniste s'effilocher. Cronstadt leur parut d'autant plus effrayant qu'ils gouvernaient au nom du prolétariat et que, soudain, leur pouvoir était contesté par un mouvement qu'ils savaient authentiquement prolétarien. Au surplus, Lénine s'en tenait à la notion quelque peu simpliste qu'une restauration tsariste était la seule alternative à la dictature de son Parti. Les hommes d'État du Kremlin de 1921 raisonnèrent comme, plus tard, ceux de l'automne 1956 : Cronstadt fut la préfiguration de Budapest.
Trotsky, l'homme « à la poigne de fer», accepta de prendre personnellement la responsabilité de la répression. « Si vous persistez, on vous canardera comme des perdreaux», fit-il savoir, par la voie des ondes, aux « mutins». Les matelots furent traités de « blanc-gardistes», de complices des puissances occidentales interventionnistes et de la « Bourse de Paris». Leur soumission serait obtenue par la force des armes. Ce fut sans succès que les anarchistes Emma Goldman et Alexandre Berkman, qui avaient trouvé asile dans la patrie des travailleurs, après avoir été déportés des États-Unis, firent valoir, dans une lettre pathétique adressée à Zinoviev, que l'usage de la force ferait « un tort incalculable à la Révolution sociale » et adjurèrent les « camarades bolcheviks » de régler le conflit par une négociation fraternelle. Quant aux ouvriers de Petrograd terrorisés, soumis à la loi martiale, ils ne purent se porter au secours de Cronstadt.
Un ancien officier tsariste, le futur maréchal Toukhatchevsky, fut chargé de commander un corps expéditionnaire composé de troupes qu'il avait fallu trier sur le volet, car nombre de soldats rouges répugnaient à tirer sur leurs frères de classes. Le 7 mars commença le bombardement de la forteresse. Sous le titre : « Que le monde sache ! » les assiégés lancèrent un appel ultime : « Le sang des innocents retombera sur la tête des communistes, fous furieux enivrés par le pouvoir. Vive le pouvoir des Soviets ! » Se déplaçant sur la glace du golfe de Finlande, les assiégeants réduisirent, le 18 mars, la « rébellion», dans une orgie de massacres.
Les anarchistes n'avaient guère joué de rôle dans l'affaire. Cependant le comité révolutionnaire de Cronstadt avait invité à le rejoindre deux libertaires : Yartchouk (animateur du soviet de Cronstadt en 1917) et Voline ; en vain, car ils étaient, à ce moment, détenus par les bolcheviks. Comme l'observe Ida Mett, historienne de La Révolte de Cronstadt, l'influence anarchiste ne s'y exercera « que dans la mesure où l'anarchisme propageait lui aussi l'idée de la démocratie ouvrière». Mais, s’ils n’intervinrent pas directement dans l’événement, les anarchistes s'en réclamèrent : « Cronstadt, écrivit plus tard Voline, fut la première tentative populaire entièrement indépendante pour se libérer de tout joug et réaliser la Révolution sociale : tentative faite directement, (...) par les masses laborieuses elles-mêmes, sans « bergers politiques», sans « chefs » ni « tuteurs». Et Alexandre Berkman : « Cronstadt fit voler en éclats le mythe de l'État prolétarien ; il apporta la preuve qu'il y avait incompatibilité entre la dictature du Parti communiste et la Révolution. »
L’anarchisme mort et vivant
Bien que les anarchistes n'aient pas joué un rôle direct dans le soulèvement de Cronstadt, le régime profita de cet écrasement pour en finir avec une idéologie qui continuait à les effrayer. Quelques semaines plus tôt, le 8 février, le vieux Kropotkine était mort sur le sol russe, et sa dépouille avait été l’objet de funérailles imposantes. Elle fut suivie par un immense convoi d'environ cent mille personnes. Mêlés aux drapeaux rouges, les drapeaux noirs des groupes anarchistes flottaient au-dessus de la foule et l'on pouvait y lire en lettres de feu : « Où il y a autorité il n'y a pas de liberté. » Ce fut, racontent les biographes du disparu, « la dernière grande manifestation contre la tyrannie bolchevique et bien des gens y prenaient part autant pour réclamer la liberté que pour rendre hommage au grand anarchiste».
Après Cronstadt, des centaines d'anarchistes furent arrêtés. Quelques mois plus tard, une libertaire, Fanny Baron, et huit de ses camarades, devaient être fusillés dans les caves de la prison de la Tchéka, à Moscou.
L'anarchisme militant avait reçu le coup de grâce. Mais, hors de Russie, les anarchistes qui avaient vécu la Révolution russe entreprirent le vaste travail de critique et de révision doctrinales qui revigora et rendit plus concrète la pensée libertaire. Dès le début de septembre 1920, le congrès du cartel anarchiste d'Ukraine, dit Nabat, avait rejeté catégoriquement l'expression « dictature du prolétariat » qu'il voyait conduire fatalement à la dictature sur la masse d'une fraction du prolétariat, celle retranchée dans le Parti, des fonctionnaires et d'une poignée de chefs. Peu avant de disparaître, dans un Message aux travailleurs d'Occident, Kropotkine avait dénoncé avec angoisse la montée d'une « formidable bureaucratie » : « Pour moi, cette tentative d'édifier une république communiste sur des bases étatistes fortement centralisées, sous la loi de fer de la dictature d'un parti, s'est achevée en un fiasco formidable. La Russie nous enseigne comment ne doit pas s'imposer le communisme. »
Dans son numéro des 7-14 janvier 1921, le journal français Le Libertaire faisait publier un appel pathétique des anarcho-syndicalistes russes au prolétariat mondial : « Camarades, mettez fin à la domination de votre bourgeoisie tout comme nous l'avons fait ici. Mais ne répétez pas nos erreurs : ne laissez pas le communisme d'État s'établir dans vos pays ! »
Sur cette lancée, l'anarchiste allemand Rudolf Rocker rédigea, dès 1920, et publia, en 1921, La Banqueroute du Communisme d’État, la première analyse politique qui ait été faite de la dégénérescence de la Révolution russe. A ses yeux, ce n'était pas la volonté d'une classe qui trouvait son expression dans la fameuse « dictature du prolétariat», mais la dictature d'un parti prétendant parler au nom d'une classe et s'appuyant sur la force des baïonnettes. « Sous la dictature du prolétariat s'est développée en Russie une nouvelle classe, la commissarocratie, dont l'oppression est ressentie par les larges masses tout autant que jadis celle des tenants de l'ancien régime. » En subordonnant systématiquement tous les éléments de la vie sociale à la toute-puissance d'un gouvernement doté de toutes les prérogatives, « on ne pouvait qu'aboutir à cette hiérarchie de fonctionnaires qui fut fatale à l'évolution de la Révolution russe. » Les bolcheviks n'ont pas seulement emprunté l'appareil de l’État à l'ancienne société, ils lui ont donné une toute-puissance que ne s'arroge aucun autre gouvernement. »
En juin 1922, le groupe des anarchistes russes exilés en Allemagne, sous la plume de A. Gorielik, A. Komoff et Voline, publia à Berlin un petit livre révélateur : Répression de l’anarchisme en Russie soviétique. Une traduction française, due à Voline, en parut au début de 1923. On y trouvait, classé alphabétiquement, un martyrologe de l'anarchisme russe. Alexandre Berkman, en 1921 et 1922, Emma Goldman, en 1922 et 1923, publièrent coup sur coup plusieurs brochures sur les drames auxquels ils avaient assisté en Russie.
A leur tour, les rescapés du makhnovisme réfugiés en Occident, Pierre Archinoff et Nestor Makhno lui-même, produisirent leurs témoignages.
Beaucoup plus tard, au cours de la deuxième guerre mondiale, furent rédigés, avec la maturité d'esprit que conférait le recul des années, les deux grands ouvrages libertaires classiques sur la Révolution russe, celui de G.P. Maximoff, celui de Voline.
Pour Maximoff, dont le témoignage a paru en langue anglaise, les leçons du passé apportent la certitude d'un avenir meilleur. La nouvelle classe dominante de l'U.R.S.S. ne peut et ne doit vivre éternellement. Le socialisme libertaire lui succédera. Les conditions objectives poussent à cette évolution : « Est-il concevable (.. ) que les travailleurs veuillent le retour des capitalistes dans les entreprises ? Jamais ! Car c'est précisément contre l'exploitation par l'État et ses bureaucrates qu'ils se rebellent. » Ce que les travailleurs veulent, c'est remplacer cette gestion autoritaire de la production par leurs propres conseils d'usine, c’est unir les conseils en une vaste fédération nationale. Ce qu'ils veulent, c’est l'autogestion ouvrière. De même les paysans ont compris qu'il ne saurait être question de revenir à l’économie individuelle. La seule solution, c'est l’agriculture collective, la collaboration des collectivités rurales avec les conseils d'usine et les syndicats : en un mot, l'expansion du programme de la Révolution d'Octobre dans la liberté.
Toute tentative inspirée de l'exemple russe, affirme hautement Voline, ne pourrait aboutir qu'à un « capitalisme d'État basé sur une odieuse exploitation des masses», le « pire des capitalismes et qui n'a absolument aucun rapport avec la marche de l'humanité vers la société socialiste». Elle ne pourrait que promouvoir « la dictature d'un parti qui aboutit fatalement à la Répression de toute liberté de parole, de presse, d'organisation et d'action, même pour les courants révolutionnaires, sauf pour le parti au pouvoir», qu'à une « inquisition sociale » qui étouffe « le souffle même de la Révolution». Et Voline de soutenir que Staline « n'est pas tombé de la lune». Staline et le stalinisme ne sont, à ses yeux, que la conséquence logique du système autoritaire fondé et établi de 1918 à 1921. « Telle est la leçon mondiale de la formidable et décisive expérience bolchevique : leçon qui fournit un puissant appui à la thèse libertaire et qui sera bientôt, à la lumière des événements, comprise par tous ceux qui peinent, souffrent, pensent et luttent. »
III Chapitre III L’anarchisme dans les conseils d’usine italiens
A l'exemple de ce qui s'était passé en Russie, les anarchistes italiens firent, au lendemain de la grande guerre, un bout de chemin ensemble avec les partisans du pouvoir des soviets. La révolution soviétique avait suscité un écho profond chez les travailleurs italiens, et, notamment, leur avant-garde, les métallurgistes du nord de la péninsule. Le 20 février 1919 la Fédération italienne des ouvriers métallurgistes (F.I.O.M.) obtint un contrat instituant l'élection, dans les entreprises, de « commissions internes » élues. Par la suite, elle tenta de transformer ces organismes de représentation ouvrière en conseils d'usine à vocation gestionnaire, à travers une série de grèves avec occupation des entreprises.
La dernière en date, à la fin août 1920, eut pour origine un lock-out patronal. L'ensemble des métallurgistes décidèrent de continuer la production par leurs propres moyens. Bien qu'ayant usé tour à tour de la persuasion et de la contrainte, ils ne réussirent guère à obtenir la collaboration des ingénieurs et du personnel de maîtrise. Ils eurent donc à assurer la direction des entreprises au moyen de comités ouvriers, techniques et administratifs. L'autogestion fut poussée assez loin. Dans une première période, elle obtint le concours des banques. Quand celui-ci cessa de lui être accordé, elle émit ses propres signes monétaires en paiement des salaires ouvriers. Une autodiscipline très stricte fut instaurée, la consommation des boissons alcooliques interdite, l'autodéfense organisée au moyen de patrouilles armées. Une étroite solidarité fut établie entre les entreprises autogestionnaires. Les minerais et la houille furent mis en commun, répartis équitablement.
Mais une fois ce stade atteint, il fallait ou élargir le mouvement, ou battre en retraite. L'aile réformiste des syndicats opta pour un compromis avec le patronat. Après un peu plus de trois semaines d’occupation gestionnaire, les travailleurs durent évacuer les usines, contre la promesse — non tenue — d'un contrôle ouvrier. Ce fut en vain que l'aile révolutionnaire, socialistes de gauche et anarchistes, cria à la trahison.
Cette aile gauche possédait une théorie, un organe, un porte-parole. Le premier numéro de l'hebdomadaire l'Ordine Nuovo avait paru, à Turin, le 1er mai 1919. Son directeur était le socialiste de gauche Antonio Gramsci, assisté d'un professeur de philosophie à l'université de Turin, d'idées anarchistes, qui signait du pseudonyme de Carlo Petri, et de tout un noyau de libertaires turinois. Dans les usines, le groupe de l'Ordine Nuovo s'appuyait, entre autres, sur deux militants anarcho-syndicalistes de la Métallurgie, Pietro Ferrero et Maurizio Garino. Socialistes et libertaires signèrent ensemble le manifeste de l’Ordine Nuovo, s'accordant pour regarder les conseils d'usine comme des « organes adaptés à la future gestion communiste de l'usine et de la société».
L'Ordine Nuovo tendait, en effet, à substituer la structure des conseils d'usine à celle du syndicalisme traditionnel. Il n'était pas absolument hostile aux syndicats qu'il regardait comme « les vertèbres solides du grand corps prolétarien». Mais il critiquait, à la manière du Malatesta de 1907, la décadence d'un mouvement syndical bureaucratique et réformiste, devenu partie intégrante de la société capitaliste ; il dénonçait l'incapacité organique des syndicats à jouer le rôle d'instruments de la révolution prolétarienne.
En échange, l'Ordine Nuovo prêtait toutes les vertus au conseil d'usine. Il voyait en lui l'organe unificateur de la classe ouvrière, seul capable d'élever les travailleurs au-dessus des particularismes de métier, de lier les « inorganisés » aux « organisés». Il inscrivait à l'actif des conseils la formation d'une psychologie du producteur, la préparation du travailleur à l'autogestion. Grâce à eux, le plus modeste ouvrier découvrait que la conquête de l'usine était une perspective concrète, à portée de sa main. Les conseils étaient regardés comme une préfiguration de la société socialiste.
Les anarchistes italiens dont la tournure d'esprit était plus réaliste, moins verbeuse, que celle d'Antonio Gramsci, ironisaient parfois sur les excès « thaumaturgiques » de la prédication en faveur des conseils d'usine. Ils en reconnaissaient, certes, les mérites, mais se refusaient à l'hyperbole. Si Gramsci dénonçait, non sans raison, le réformisme des syndicats, les anarcho-syndicalistes faisaient remarquer que les conseils d'usine couraient le risque, eux aussi, dans une période qui ne serait pas révolutionnaire, de dégénérer en organismes de collaboration de classes. Ceux d'entre eux qui étaient le plus attachés au syndicalisme trouvaient également injuste que l’Ordine Nuovo englobât dans une même condamnation le syndicalisme réformiste et le syndicalisme révolutionnaire que pratiquait leur centrale, l’Union Syndicale Italienne8.
Enfin et surtout, les anarchistes éprouvaient un certain malaise quant à l'interprétation contradictoire et équivoque que proposait l'Ordine Nuovo du prototype, les conseils d'usine : les soviets. Certes, Gramsci laissait souvent l'épithète « libertaire » revenir sous sa plume et il avait rompu des lances avec Angelo Tasca, autoritaire invétéré, qui défendait une conception anti-démocratique de la « dictature du prolétariat», réduisait les conseils d'usine au simple rôle d'instruments du parti communiste et dénonçait même comme « proudhonienne » la pensée gramsciste. Mais Gramsci n'était pas assez au courant de l'évolution en Russie pour distinguer entre les soviets libres des premiers mois de la Révolution et les soviets domestiqués par l'État bolchevique. Aussi les formules qu’il employait étaient-elles ambiguës. Il voyait dans le conseil d'usine le « modèle de l'État prolétarien», dont il annonçait l'incorporation dans un système mondial : l'Internationale communiste. Il croyait pouvoir concilier le bolchevisme avec le dépérissement de l'État et une conception démocratique de la « dictature du prolétariat».
*
Les anarchistes italiens avaient commencé par saluer les soviets russes avec un enthousiasme d’où l'esprit critique était absent. Le 1er juin 1919, l'un d'eux, Camillo Berneri, avait donné pour titre « L'autodémocratie», à un article où il saluait le régime bolchevique comme « l'expérimentation la plus pratique et sur l'échelle la plus vaste de la démocratie intégrale » et « l'antithèse du socialisme d'État centralisateur». Mais, un an plus tard, au congrès de l'Union anarchiste italienne, Maurizio Garino tenait un langage tout autre : les soviets tels qu'ils avaient été édifiés en Russie par les bolcheviks étaient substantiellement différents de l'autogestion ouvrière, telle que la concevaient les anarchistes. Ils formaient la « base d'un nouvel État, inévitablement centralisateur et autoritaire».
Par la suite, les anarchistes italiens et les amis de Gramsci allaient suivre des voies divergentes. Les seconds, après avoir soutenu que le parti socialiste, tout comme le syndicat, était un organisme intégré dans le système bourgeois et qu'il n'était, par conséquent, ni indispensable ni recommandable d'y adhérer, firent une « exception » pour les groupes communistes à l'intérieur du parti socialiste, qui formèrent plus tard, après la scission de Livourne du 21 janvier 1921, le parti communiste italien, enrégimenté dans l’Internationale Communiste.
Quant aux libertaires italiens, ils durent abandonner certaines de leurs illusions et se souvenir que, dès l'été 1919, dans une lettre de Londres, Malatesta les avait mis en garde contre « un gouvernement nouveau qui est venu s'installer [en Russie] au-dessus de la Révolution pour la freiner et l'assujettir aux fins particulières d'un parti (...) ou plutôt des chefs d'un parti». C'était une dictature, soutenait prophétiquement le vieux révolutionnaire, « avec ses décrets, ses sanctions pénales, ses agents exécutifs et, par-dessus tout, sa force armée qui sert aussi à défendre la Révolution contre ses ennemis extérieur, mais qui servira demain à imposer aux travailleurs la volonté des dictateurs, à arrêter le cours de la Révolution, à consolider les intérêts nouveaux qui se seront constitués et à défendre contre la masse une nouvelle classe privilégiée. Lénine, Trotsky et leurs compagnons sont certainement des révolutionnaires sincères, mais ils préparent les cadres gouvernementaux qui serviront à ceux qui viendront après eux pour profiter de la révolution et la tuer. Ils seront les premières victimes de leur propres méthodes».
Deux ans plus tard, l'Union Anarchiste Italienne, réunie en congrès à Ancône, les 2-4 novembre 1921, devait se refuser à reconnaître le gouvernement russe comme le représentant de la Révolution, le dénoncer, bien plutôt, comme « l'ennemi majeur de la Révolution», « l'oppresseur et l'exploiteur du prolétariat au nom duquel il prétend exercer le pouvoir». Et l'écrivain libertaire Luigi Fabbri de conclure, la même année : « L'étude critique de la Révolution russe est d'une immense importance (...) parce que les révolutionnaires occidentaux peuvent régler leur action en vue d'éviter si possible les erreurs que l'expérience russe a pu mettre en lumière. »
Chapitre IV L’anarchisme dans la révolution espagnole
Le mirage soviétique
Le retard de la conscience subjective par rapport à la réalité objective est une des constantes de l'histoire. La leçon que les anarchistes russes, ou témoins du drame russe, tirèrent à partir de 1920 ne devait être connue, admise, partagée que des années plus tard. Le prestige, le rayonnement de la première révolution prolétarienne victorieuse sur un sixième du globe furent tels que le mouvement ouvrier devait rester longtemps fasciné par un aussi prestigieux exemple. A l'image des soviets russes, les « Conseils » naquirent un peu partout, non seulement en Italie, comme on l'a vu, mais en Allemagne, en Autriche, en Hongrie. En Allemagne, le système des Conseils fut l'article essentiel du programme de la Ligue Spartakiste, de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht.
A Munich, en 1919, après l'assassinat du ministre-président de la République bavaroise, Kurt Eisner, une république soviétique fut proclamée avec, à sa tête, l'écrivain libertaire Gustav Landauer, assassiné, à son tour, par la contre-révolution. Son ami et compagnon de lutte, le poète anarchiste Erich Mühsam, composa une Räte-Marseillaise (« Marseillaise des Conseils»), où les travailleurs étaient appelés aux armes, non plus pour former des bataillons, mais pour former des Conseils, à l'image de ceux de Russie et de Hongrie, afin d'en finir avec le vieux monde d'esclavage séculaire.
Cependant, au printemps 1920, un groupe oppositionnel allemand qui prônait le Räte-kommunismus (« Communisme des Conseils » se sépara du Parti Communiste pour former un Parti communiste ouvrier allemand (K.A.P.D.).9 En Hollande, un mouvement frère s'inspira de l'idée des Conseils, sous l'impulsion de Hermann Gorter et d'Anton Pannekoek. Le premier, au centre d'une vive polémique avec Lénine, ne craignit pas de riposter, dans le plus pur style libertaire, au conducteur infaillible de la Révolution russe : « Nous sommes encore à la recherche des chefs véritables qui ne cherchent pas à dominer les masses et ne les trahissent pas, et, aussi longtemps que nous ne les aurons pas, nous voulons que tout se fasse de bas en haut, et par la dictature des masses elles-mêmes. Si j'ai un guide dans la montagne et qu’il me conduise à l'abîme, j'aime mieux n'en pas avoir. » Le second proclama que les Conseils étaient la forme d'autogouvernement qui remplaçait les formes gouvernementales de l'ancien monde ; tout comme Gramsci, il ne savait pas les distinguer de la « dictature bolchevique».
Un peu partout, et notamment, en Bavière, en Allemagne, en Hollande, les anarchistes participèrent, de façon positive, à l'élaboration théorique et pratique du système des conseils.
En Espagne, les anarcho-syndicalistes ne furent pas moins éblouis par la Révolution d'Octobre. Au congrès de Madrid de la C.N.T. (10-20 décembre 1919), un texte fut adopté où il était dit que « l'épopée du peuple russe a électrisé le prolétariat universel». Par acclamations, « sans réticence aucune, comme une belle se donne à l’homme de ses amours», le congrès vota l'adhésion provisoire à l'Internationale communiste, pour son caractère révolutionnaire, tout en souhaitant la convocation d'un congrès ouvrier universel qui déterminerait les bases sur lesquelles édifier la véritable Internationale des travailleurs. Pourtant quelques timides voix dissonantes s'étaient fait entendre : la Révolution russe était une révolution « politique » et elle n'incarnait pas l'idéal libertaire. Le congrès passa outre. Il décida l'envoi d'une délégation au IIe congrès de la Troisième Internationale qui s'ouvrit, à Moscou, le 15 juillet 1920.
Mais, à cette date, le pacte d'amour était déjà chancelant. Pressé de participer à la constitution d'une Internationale syndicale révolutionnaire, le délégué de l'anarcho-syndicalisme espagnol renâcla devant un texte où il était question de « conquête du pouvoir politique», « de dictature du prolétariat», et d'une liaison organique qui dissimulait à peine une subordination de fait des syndicats ouvriers aux partis communistes : aux prochains congrès de l'I.C., les organisations syndicales nationales seraient représentées par les délégués du parti communiste de leurs pays respectifs ; quant à l'Internationale Syndicale Rouge projetée, elle serait coiffée ouvertement par l'Internationale communiste et ses sections nationales. Le porte-parole espagnol, Angel Pestaña, après avoir exposé la conception libertaire de la révolution sociale, s'écria : « La Révolution n'est pas, ne peut pas être, l'œuvre d'un parti. Un parti peut tout au plus fomenter un coup d'État. Mais un coup d'État n'est pas une révolution. » Pour conclure : « Vous nous dites que sans parti communiste la révolution ne peut se faire et que sans conquête du pouvoir politique aucune émancipation n'est possible et que sans dictature vous ne pouvez détruire la bourgeoisie : c'est lancer des affirmations purement gratuites.
Devant les réserves formulées par le délégué de la C.N.T., les communistes firent mine de retoucher la résolution en ce qui concerne la « dictature du prolétariat». Losovsky, en fin de compte, n'en publia pas moins le texte dans sa forme première, sans les modifications introduites par Pestaña, mais avec la signature de Pestaña. Trotsky, à la tribune, avait pris à partie le délégué espagnol pendant près d'une heure et, lorsqu’il demanda à répondre à ces attaques, le président déclara clos le débat.
Après plusieurs mois passés à Moscou, Pestaña quitta la Russie, le 6 septembre 1920, profondément déçu par tout ce qu'il avait pu y observer. Rudolf Rocker, à qui il rendit visite à Berlin, raconte qu'il était comme le « rescapé d'un naufrage». Il ne se sentait pas le courage de révéler la vérité à ses camarades espagnols. Détruire les immenses espoirs qu'avait suscités en eux la Révolution russe lui paraissait comme un « assassinat». Aussitôt rentré en Espagne, il fut jeté en prison, se voyant ainsi épargner le pénible devoir de parler le premier.
Au cours de l'été 1921, une nouvelle délégation de ]a C.N.T. participa au IIIe congrès de l'Internationale communiste ainsi qu'au congrès constitutif de l'Internationale Syndicale Rouge. Parmi les délégués de la C.N.T., il y avait de jeunes néophytes du bolchevisme russe, tels que Joaquin Maurin et Andrès Nin, mais il y a avait aussi un anarchiste français, à la tête froide, Gaston Leval. Au risque d'être accusé de « faire le jeu de la bourgeoisie » et d'« aider la contre-révolution», il préféra ne point se taire. Ne pas dire aux masses que ce qui avait échoué, en Russie, ce n'était pas la Révolution, mais l'État, « ne pas leur faire voir, derrière la Révolution pantelante, l'État qui la paralyse et la poignarde», eût été bien pire, à ses yeux, que le silence. Tel fut le langage qu'il tint, en France, dans Le Libertaire, en novembre 1921. A son retour en Espagne, estimant que « toute collaboration honnête et loyale » avec les bolcheviks était impossible, il recommanda à la C.N.T. d'annuler son adhésion à la Troisième Internationale et à sa filiale prétendue syndicale.
Ainsi devancé, Pestaña se décida à publier son premier rapport et à le compléter, ensuite, par un second ou il dévoilait l'entière vérité sur le bolchevisme : « Les principes du Parti communiste sont tout le contraire de ce qu'il affirmait et proclamait aux premiers moments de la Révolution. La Révolution russe et le Parti communiste sont, dans leurs principes, les moyens qu'ils mettent en œuvre et leurs buts finaux, diamétralement opposés (...). Le Parti communiste, une fois maître absolu du pouvoir, a décrété que celui qui ne pensait pas communiste (entendez : « communiste » à sa manière) n'avait pas le droit de penser (...). Le Parti communiste a dénié au prolétariat russe les droits sacrés qui lui avaient été conférés par la Révolution. » Et Pestaña de mettre en doute la validité de l'Internationale communiste : simple prolongation du Parti communiste russe, elle ne pouvait incarner la révolution vis-à-vis du prolétariat mondial.
Le congrès national de Saragosse, en juin 1922, à qui était destiné ce rapport, décida le retrait de la Troisième Internationale, ou, plus exactement, de son succédané syndical, l'Internationale Syndicale Rouge, et l'envoi de délégués à une conférence internationale anarcho-syndicaliste, qui se tint à Berlin, en décembre, et d'où sortit une « Association Internationale des Travailleurs». Internationale fantomatique, car, mise à part l'importante centrale espagnole, elle ne réunit, dans les autres pays, que de très maigres effectifs10.
Cette rupture marqua le début de la haine inexpiable que Moscou devait vouer à l'anarchisme espagnol. Désavoués par la C.N.T., Joaquin Maurin et Andrès Nin la quittèrent pour fonder le Parti communiste espagnol. En mai 1924, Maurin, dans une brochure, déclara une guerre à mort à ses anciens compagnons : « L'élimination définitive de l'anarchisme est une tâche difficile en un pays dont le mouvement ouvrier porte en lui un demi-siècle de propagande anarchiste. Mais, on les aura. »
La tradition anarchiste en Espagne
Ainsi donc la leçon de la Révolution russe fut tirée de bonne heure par les anarchistes espagnols et elle contribua à les stimuler dans la préparation d'une révolution antinomique. La dégénérescence du communisme « autoritaire » accrut leur volonté de faire triompher un communisme libertaire. Cruellement déçus par le mirage soviétique, ils virent dans l'anarchisme, comme l'écrira plus tard Santillan, « l'ultime espérance, le renouveau en cette sombre période. »
La révolution libertaire était plus ou moins préparée dans la conscience des masses populaires aussi bien que dans la pensée des théoriciens libertaires. L'anarcho-syndicalisme était, comme l'observe José Peirats, « par sa psychologie, son tempérament et ses réactions, le secteur le plus espagnol de toute l'Espagne». Il était le double produit d'un développement combiné. Il correspondait, à la fois, à l'état arriéré d'un pays retardataire, dont les conditions de vie rurales étaient demeurées archaïques, et au développement, dans certaines régions, d'un prolétariat moderne enfanté par l'industrialisation. L'originalité de l'anarchisme espagnol résidait dans un mélange singulier de passéisme et de futurisme. Entre les deux tendances, la symbiose était loin d'être parfaite.
La C.N.T., en 1918, réunissait plus d'un million de syndiqués. Elle était forte, sur le plan industriel, en Catalogne et, dans une moindre mesure, à Madrid, à Valence11 ; mais elle ne plongeait pas moins ses racines dans les campagnes, parmi les paysans pauvres, où survivait la tradition d'un communalisme villageois, teinté de localisme et d'esprit coopératif. L'écrivain Joaquin Costa avait inventorié, en 1898, les survivances de ce Collectivisme agraire. Nombreux étaient encore les villages qui possédaient des biens communaux, dont ils concédaient des parcelles aux non-possédants, ou qui mettaient en commun avec d'autres villages pâturages et autres « communaux». Par ailleurs, dans le Sud, région de grande propriété, la préférence des journaliers agricoles allait à la socialisation plutôt qu'au partage de la terre.
Le collectivisme agraire, en outre, avait été préparé par de nombreuses décennies de propagande anarchiste à la campagne, telles les petites brochures de vulgarisation de José Sanchez Rosa. La C.N.T. était puissante, notamment, parmi les paysans du Sud (Andalousie), de l'Est (région du Levant, autour de Valence) et du Nord-Est (Aragon, autour de Saragosse).
Cette double assise, industrielle et rurale, de l'anarcho-syndicalisme espagnol, avait orienté le « communisme libertaire » dont il se réclamait dans deux directions quelque peu divergentes ; l'une communaliste, l'autre syndicaliste. Le communalisme avait une tonalité plus particulariste — et plus rurale, on pourrait presque écrire : plus méridionale, car un de ses principaux bastions était l'Andalousie, le syndicalisme une tonalité plus intégrationniste et plus urbaine — plus septentrionale aussi, puisque son foyer majeur était la Catalogne. Les théoriciens libertaires étaient quelque peu flottants et partagés à ce sujet.
Les uns, qui avaient donné leur cœur à Kropotkine et à son idéalisation, érudite mais simpliste, des communes du Moyen âge, identifiées par eux avec la tradition espagnole de la communauté paysanne primitive, avaient volontiers, à la bouche le slogan de la « commune libre». Divers essais pratiques de communisme libertaire avaient eu lieu au cours des insurrections paysannes qui avaient suivi l'avènement de la République en 1931. Par accord mutuel et libre, des groupes de petits paysans propriétaires avaient décidé de travailler en commun, de se répartir les bénéfices en parts égales et de consommer en « puisant dans le tas». Ils avaient destitué les municipalités et les avaient remplacées par des comités élus. Ils avaient cru naïvement s'affranchir de la société ambiante, de l'impôt et du service militaire.
Les autres, qui se réclamaient de Bakounine, fondateur en Espagne, du mouvement ouvrier collectiviste, syndicaliste et internationaliste, et de son disciple, Ricardo Mella, étaient plus préoccupés du présent que de l'âge d'or, plus réalistes. Ils avaient le souci de l'intégration économique et ils croyaient sage, pour une longue période transitoire, de rémunérer selon les heures de travail accomplies et non de distribuer selon les besoins. Ils voyaient dans la combinaison des unions locales de syndicats et des fédérations de branches d’industrie la structure économique de l'avenir.
Cependant, le monopole dont jouirent longtemps, au sein de la C.N.T., les sindicatos unicos (unions locales), plus proches des travailleurs, indemnes de tout égoïsme corporatiste et qui étaient comme les foyers, matériels et spirituels, du prolétariat12, avait, de bonne heure, plus ou moins confondu dans l'esprit des militants de base les notions de syndicat et de commune.
Un autre problème départageait les anarcho-syndicalistes espagnols, faisant resurgir dans la pratique le débat théorique qui avait, au congrès anarchiste international de 1907, opposé les syndicalistes aux anarchistes. Au sein de la C.N.T. l'action revendicative quotidienne avait sécrété une tendance réformiste, contre laquelle la F.A.I. (Federación Anarquista Iberica), fondée en 1927, s'attribua la mission de défendre l'intégrité de la doctrine anarchiste. En 1931, la tendance syndicaliste lança un Manifeste dit des « Trente», s'insurgeant coutre la « dictature » des minorités au sein du mouvement syndical, et affirmant l'indépendance du syndicalisme, sa prétention de se suffire à lui-même. Un certain nombre de syndicats abandonnèrent la C. N.T. et, si la scission put être colmatée à la veille de la Révolution de juillet 1936, un courant réformiste n'en persista pas moins dans la centrale syndicale.
Bagage doctrinal
Les anarchistes espagnols n'avaient jamais cessé de publier dans leur langue les écrits majeurs (et même mineurs) de l'anarchisme international, préservant ainsi de l'oubli, et parfois de la destruction pure et simple, les traditions d'un socialisme à la fois révolutionnaire et libre. Comme l'écrit Augustin Souchy, anarchosyndicaliste allemand passé au service de l'anarchisme espagnol : « Dans leurs assemblées de syndicats et de groupes, dans leurs journaux, leurs brochures et leurs livres, le problème de la révolution sociale fut discuté sans cesse et d'une façon systématique. »
Au lendemain de la proclamation de la République espagnole, en 1931, ce fut une floraison d'écrits « anticipationnistes » : Peirats en donne une liste, très incomplète, dit-il, de près de cinquante titres et souligne que cette « obsession de construction révolutionnaire», se traduisant par une prolifération livresque, contribua beaucoup à ouvrir au peuple la voie de la Révolution. C'est ainsi que la brochure de James Guillaume, de 1876, Idées sur l'Organisation sociale, fut connue des anarchistes espagnols à travers les larges emprunts que venait de lui faire Pierre Besnard, dans son livre Les Syndicats ouvriers et la révolution sociale, paru à Paris, en 1930. En 1931, Gaston Leval publia, en Argentine, où il avait émigré, Les Problèmes économiques de la Révolution espagnole, qui inspira directement l'important ouvrage de Diego Abad de Santillan, dont il sera question plus loin.
En 1932, le docteur Isaac Puente, médecin de campagne, qui, l’année suivante, devait animer un comité insurrectionnel en Aragon, publia une esquisse, quelque peu naïve et idéaliste, de Communisme libertaire dont les idées furent reprises, le 1er mai 1936, par le congrès de Saragosse de la C.N.T.
Le programme de Saragosse définit avec une certaine précision le fonctionnement d'une démocratie directe villageoise : un conseil communal est élu par l'assemblée générale des habitants et formé de représentants de divers comités techniques. L'assemblée générale se réunit chaque fois que les intérêts de la commune le nécessitent, à la requête des membres du conseil communal ou par la volonté des habitants eux-mêmes. Les divers postes responsables ne comportent aucun caractère exécutif ni bureaucratique. Leurs titulaires (à l'exception de quelques techniciens et statisticiens) accomplissent, comme les autres, leur tâche de producteurs, se réunissant à la fin de la journée de travail pour discuter des questions de détail qui n'ont pas besoin d'être ratifiées par l'assemblée générale.
Les travailleurs actifs reçoivent une carte de producteur sur laquelle s'inscrivent les prestations de travail évaluées en unités de journées fournies, à échanger contre des marchandises. Les éléments passifs de la population reçoivent une simple carte de consommateur. Aucune norme absolue : l’autonomie des communes est respectée. Si elles le jugent bon, elles peuvent établir un système différent d'échange intérieur, à condition, toutefois, de ne léser en rien les intérêts des autres communes. Le droit à l’autonomie communale, en effet, n'exclut pas le devoir de solidarité collective au sein des fédérations cantonales et régionales des communes.
La culture de l'esprit est au premier rang des préoccupations des congressistes de Saragosse. Elle doit assurer à tous les hommes, au long de leur existence, l'accès et le droit à la science, à l'art, aux recherches de tous genres, compatibles avec la production des ressources matérielles. L'exercice de cette double activité garantit l'équilibre et la santé de la nature humaine. Plus de division de la société en manuels et intellectuels : tous sont, en même temps, l'un et l'autre. Une fois terminée sa journée de producteur, l'individu est maître absolu de son temps. La C.N.T. prévoit que les besoins d'ordre matériel étant satisfaits dans une société émancipée, les besoins spirituels se manifesteront de façon plus pressante.
Depuis longtemps, l'anarcho-syndicalisme espagnol se souciait de sauvegarder l'autonomie de ce qu'il appelait les « groupes d'affinités». Entre autres, le naturisme et le végétarisme comptaient de nombreux adeptes dans ses rangs, notamment parmi les paysans pauvres du Sud. Ces deux modes de vie étaient regardés comme susceptibles de transformer l'être humain et de le préparer à la société libertaire. Aussi la C.N.T. n'omet-elle pas, à Saragosse, de se pencher sur le sort des groupes de naturistes et de nudistes, « réfractaires à l'industrialisation». Comme ils ne sauraient, de ce fait, subvenir à tous leurs besoins, le congrès prévoit que leurs délégués aux assises de la confédération des communes pourraient négocier des accords économiques avec les autres communes, agricoles et industrielles. Doit-on sourire ? A la veille d'une grande, et sanglante, mutation sociale, la C.N.T. ne croit pas risible de chercher à satisfaire les aspirations infiniment variées de l'homme.
Sur le plan pénal, fidèle aux enseignements de Bakounine, le congrès de Saragosse affirme que l'injustice sociale est la cause principale des délits et qu'en conséquence, cette cause une fois supprimée, ils cesseront, le plus souvent, d'être commis. Elle affirme que l'homme n'est pas naturellement mauvais. Les manquements de l'individu, aussi bien dans l'ordre moral que dans ses fonctions de producteur, seront examinés par les assemblées populaires qui, pour chaque cas, s'efforceront de trouver une solution juste.
Le communisme libertaire ne veut connaître d'autres moyens correctionnels que les préventifs de la médecine et de la pédagogie. Si un individu, victime de phénomènes pathologiques, porte atteinte à l'harmonie qui doit régner entre ses semblables, son déséquilibre sera l'objet de soins, en même temps que sera stimulé en lui le sens de léthique et de la responsabilité sociale. Comme remède aux passions érotiques, que ne suffirait pas à contenir le respect de la liberté d'autrui, le congrès de Saragosse recommande le « changement d'air», efficace aussi bien pour les maladies corporelles que pour celles de l'amour. La centrale syndicale doute cependant qu'une telle exaspération puisse encore se produire dans une ambiance de liberté sexuelle.
Lorsque le congrès de la C.N.T. avait adopté, en mai 1936, le programme de Saragosse, personne n'escomptait, certes, que, deux mois plus tard, l’heure sonnerait de son application. En fait, la socialisation de la terre et de l'industrie, qui suivra la victoire révolutionnaire du 19 juillet, s'écartera sensiblement de cet idyllique programme. Alors que le mot « commune » y revenait à chaque ligne, le terme adopté pour les unités de production socialistes sera celui de collectivités. Il ne s'agira pas que d'un simple changement de vocabulaire : les artisans de l'autogestion espagnole puiseront davantage à une autre source.
*
D'une inspiration assez différente, en effet, était l'esquisse de construction économique que, deux mois avant le congrès de Saragosse, Diego Abad de Santillan avait présentée dans son livre : El organismo economico de la Revolución.
Santillan n'est pas, comme tant d'autres de ses congénères, un épigone plus ou moins stérilisé et figé des grands anarchistes du XIXe siècle. Il déplore que la littérature anarchiste des vingt-cinq ou trente dernières années se soit préoccupée si peu des problèmes concrets de l’économie nouvelle et qu'elle n'ait pas ouvert des perspectives originales vers l'avenir, alors que, dans toutes les langues, l'anarchisme a enfanté une surabondance d'œuvres où le concept de liberté est ressassé d'une manière exclusivement abstraite. Comparés à cette production indigeste, combien brillants lui apparaissent les rapports présentés aux congrès nationaux et internationaux de la Première Internationale : on y trouve, observe Santillan, une bien meilleure compréhension des problèmes économiques que dans les périodes subséquentes.
Santillan n'est pas un attardé, mais un homme de son temps. Il a conscience que « le développement formidable de l'industrie moderne a créé toute une série de problèmes nouveaux, jadis imprévisibles». Il n'est pas question de revenir à la charrue romaine ni aux formes primitives et artisanales de production. Le particularisme économique, la mentalité de clocher, la patria chica (petite patrie) chère, en Espagne rurale, aux nostalgiques de l'âge d'or, la « commune libre » de Kropotkine, particulariste et moyenâgeuse, sont à reléguer au musée des antiquités. Ce sont là les vestiges de conceptions communalistes périmées.
Il ne peut exister de « communes libres » du point de vue économique : « Notre idéal est la commune associée, fédérée, intégrée dans l'économie totale du pays et des autres pays en révolution». Le collectivisme, l'autogestion, ce n'est pas le remplacement du propriétaire privé par un propriétaire multicéphale. La terre, les usines, les mines, les moyens de transport sont l'œuvre de tous, doivent servir à tous. L'économie, aujourd'hui, n'est ni locale, ni même nationale, mais mondiale. La caractéristique de la vie moderne est la cohésion de toutes les forces productives et distributives. « Une économie socialisée, dirigée et planifiée est impérative et correspond à l'évolution du monde économique moderne. »
Pour assumer la fonction coordinatrice et planificatrice, Santillan prévoit un Conseil fédéral de l'économie, qui n'est pas un pouvoir politique, mais un simple organisme de coordination, un régulateur économique et administratif. Il reçoit d'en bas ses directives, à savoir des conseils d'usine, fédérés à la fois en conseils syndicaux de branches d'industrie et en conseils locaux de l’économie. Il est donc l'aboutissement d'une double filière, l'une locale, l'autre professionnelle. Les organes de base lui fournissent les statistiques qui lui permettent à tout moment de connaître la situation économique effective. Il peut ainsi repérer les déficiences majeures, déterminer les secteurs où il est le plus urgent de promouvoir de nouvelles industries, de nouvelles cultures. « Plus besoin de gendarme quand l'autorité suprême sera dans les chiffres, dans les statistiques. » La coercition étatique, dans un tel système, n'est pas rentable, elle est stérile, voire impossible. Le Conseil fédéral veille à la propagation de nouvelles normes, à l'interpénétration des régions, à la formation de la solidarité nationale. Il stimule la recherche de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux procédés de fabrication, de nouvelles techniques rurales. Il distribue la main-d'œuvre d'une région à l'autre, d'une branche économique à l'autre.
Santillan a, incontestablement, beaucoup appris de la Révolution russe. D'un côté, elle lui a enseigné la nécessité de parer le danger d'une résurrection de l'appareil étatique et bureaucratique ; mais, de l'autre, elle lui a appris qu'une révolution victorieuse ne peut éviter de passer par des formes économiques intermédiaires, où subsiste, pour un temps, ce que Marx et Lénine appellent le « droit bourgeois». Pas question, entre autres, de supprimer d'un seul coup le système bancaire et monétaire. Il faut transformer ces institutions et les utiliser comme moyen provisoire d'échange pour maintenir en activité la vie sociale et préparer la voie à de nouvelles formes d'économie.
Santillan occupera d'importantes fonctions dans la Révolution espagnole : il sera, tour à tour, membre du comité central des Milices antifascistes (fin juillet 1936), membre du Conseil Économique de Catalogne (11 août), ministre de l'Économie de la Généralité (mi-décembre).
Une révolution « apolitique »
La Révolution espagnole était donc relativement mûre dans le cerveau des penseurs libertaires, comme elle l'était dans la conscience populaire. Aussi ne faut-il pas s'étonner que la victoire électorale du Frente Popular, en février 1936, ait pu être considérée par la droite espagnole comme le début d'une révolution. De fait, les masses ne tardèrent pas à faire éclater les cadres trop étroits du succès remporté aux urnes. Se moquant des règles du jeu parlementaire, elles n'attendirent même pas la formation d'un gouvernement pour libérer les prisonniers. Les fermiers cessèrent de payer leurs fermages. Les journaliers agricoles occupèrent et labourèrent les terres. Les villageois se débarrassèrent de leur conseil municipal et s'empressèrent de s'administrer eux-mêmes. Les cheminots se mirent en grève pour exiger la nationalisation des chemins de fer. Les maçons madrilènes revendiquèrent le contrôle ouvrier, première étape vers la socialisation.
A ces prodromes de révolution, les chefs militaires, avec, à leur tête, le colonel Franco, répondirent par un putsch. Mais ils ne réussirent qu'à accélérer le cours d'une révolution déjà commencée en fait. A l'exception de Séville, dans la plupart des grandes villes, à Madrid, à Barcelone, à Valence, notamment, le peuple prit l'offensive, assiégea les casernes, érigea des barricades dans les rues, occupa les points stratégiques. De partout, les travailleurs accoururent à l'appel de leurs syndicats. Avec un mépris total de la mort, la poitrine découverte et les mains nues, ils se lancèrent à l'assaut des bastions franquistes. Ils réussirent à enlever à l'ennemi ses canons. Ils entraînèrent les soldats dans leurs propres rangs.
Grâce à cette furia populaire, l'échec de l'insurrection militaire fut consommé en vingt-quatre heures. Alors, spontanément, la révolution sociale commença. De façon inégale, certes, selon les régions et les villes, mais nulle part avec autant d’impétuosité qu’en Catalogne et, notamment, à Barcelone. Lorsque les autorités constituées furent remises de leur stupeur, elles s’aperçurent que, tout simplement, elles n’existaient plus. L’État, la police, l’armée, l’administration semblaient avoir perdu leur raison d’être. Les « gardes civils » avaient été chassés ou liquidés. Le service d’ordre était assuré par les ouvriers vainqueurs. La tâche la plus urgente était d’organiser le ravitaillement ; des comités distribuèrent les vivres sur les barricades transformées en campements, puis ouvrirent des restaurants communautaires. Les comités de gestion organisèrent l’administration, les comités de guerre le départ des milices ouvrières vers le front. La maison du peuple était devenue la véritable mairie. Ce n’était plus simplement la « défense républicaine » contre le fascisme, c’était la Révolution. Une Révolution qui n’eut pas besoin, comme en Russie, de créer de toutes pièces ses organes de pouvoir : l’élection de soviets était rendue inutile par l’omniprésence de l’organisation anarcho-syndicaliste dont les divers comités de base émanaient. En Catalogne, la C.N.T. et sa minorité consciente, la F.A.I., étaient plus puissantes que les autorités devenues fantomatiques.
Rien n’empêchait, surtout à Barcelone, les comités ouvriers de saisir de jure le pouvoir qu’ils exerçaient déjà de facto. Ils ne le firent pas. L’anarchisme espagnol, depuis des dizaines d’années, n’avait cessé de mettre en garde le peuple contre les duperies de la « politique», de lui vanter la primauté de l’« économique», de le détourner d’une révolution bourgeoise démocratique afin de l’entraîner, par l’action directe, à la révolution sociale. A l’orée de la Révolution, les anarchistes raisonnaient à peu près ainsi : que les politiciens fassent ce qu’ils veulent ; nous, les « apolitiques», nous mettrons la main sur l’économie. Dans un article intitulé : « L’inutilité du gouvernement » publié le 3 septembre 1936 par le Bulletin d'information C.N.T.-F.A.I., il était escompté que l'expropriation économique en cours allait entraîner ipso facto « la liquidation de l'État bourgeois, réduit par asphyxie».
Les anarchistes au gouvernement
Mais, très vite, cette sous-estimation du gouvernement fit place à une attitude inverse. Brusquement les anarchistes espagnols devinrent gouvernementalistes. A Barcelone, peu après la Révolution du 19 juillet, une entrevue eut lieu entre l'activiste anarchiste Garcia Oliver et le président de la Généralité de Catalogne, le bourgeois libéral Companys. Celui-ci, bien que disposé à s'effacer, fut maintenu en fonctions. La C.N.T. et la F.A.I. renoncèrent à exercer une « dictature » anarchiste et se déclarèrent prêtes à collaborer avec les autres formations de gauche. Dès la mi-septembre, la C.N.T. réclama du président du conseil du gouvernement central, Largo Caballero, la constitution d'un « Conseil de défense » de quinze membres, où elle se contentait de cinq sièges. C'était se rallier à l'idée d'une participation ministérielle sous un autre nom.
Les anarchistes acceptèrent finalement des portefeuilles dans les deux gouvernements : celui de la Généralité de Catalogne, d'abord, celui de Madrid, ensuite. Dans une lettre ouverte du 14 avril 1937 à la camarade ministre Frederica Montseny, l'anarchiste italien Camillo Berneri, présent à Barcelone, leur reprocha d'être seulement au gouvernement pour servir d'otages et de paravents « à des politiciens flirtant avec l'ennemi13 » [de classe]. De fait, l'État dans lequel ils s’étaient laissé intégrer, demeurait un État bourgeois, dont les fonctionnaires et le personnel politique manquaient souvent de loyalisme républicain. La raison de ce reniement ? L'occasion de la Révolution espagnole avait été la riposte prolétarienne à un coup d'État contre-révolutionnaire. La nécessité de combattre par des milices antifascistes les cohortes du colonel Franco conféra, dès le début, à la Révolution un caractère d'autodéfense, un caractère militaire. Les anarchistes, contre le péril commun, estimèrent, bon gré mal gré, qu'ils ne pouvaient éviter de s'unir avec toutes les autres forces syndicales et même avec les partis politiques disposés à barrer la route à la rébellion. Au fur et à mesure que les puissances fascistes accrurent leur soutien au franquisme, la lutte « antifasciste » dégénéra en une véritable guerre, du type classique, une guerre totale. Les libertaires n'y pouvaient participer qu'en reniant toujours davantage leurs principes, aussi bien sur le plan politique que sur le plan militaire. Ils firent le faux raisonnement qu'il n'était possible d'assurer la victoire de la Révolution qu'en gagnant d'abord la guerre, et à la guerre, comme en conviendra Santillan, « ils sacrifièrent tout». En vain Berneri contesta la priorité de la guerre tout court et soutint que la défaite de Franco ne pouvait être obtenue que par une guerre révolutionnaire. De fait, freiner la Révolution, c'était émousser l'arme majeure de la République : l'active participation des masses. Plus grave encore : l'Espagne républicaine, soumise au blocus des démocraties occidentales et gravement menacée par l'avance des troupes fascistes, avait besoin, pour survivre, de l'aide militaire russe et cette aide était assortie d'une double condition : 1° Devait surtout en profiter le Parti communiste et, le moins possible, les anarchistes ; 2° Staline ne voulait à aucun prix du triomphe, en Espagne, d'une révolution sociale, non seulement parce qu'elle eût été libertaire, mais parce qu'elle eût exproprié les capitaux investis par l'Angleterre, alliée présumée de l'U.R.S.S. dans la « ronde des démocraties » contre Hitler. Les communistes espagnols nièrent jusqu'à l'existence de la Révolution : un gouvernement légal se bornait à réduire une mutinerie militaire. Après les journées sanglantes de mai 1937 à Barcelone, où les ouvriers furent désarmés par les forces de l'ordre sous commandement stalinien, les anarchistes, au nom de l'unité d'action antifasciste, interdirent aux travailleurs de riposter. La lugubre persévérance avec laquelle, ensuite, ils s'enfoncèrent dans l'erreur du Frente Popular, jusqu'à la défaite finale des Républicains, se situe en dehors du cadre de ce livre.
Les succès de l’autogestion
Pourtant, dans le domaine auquel ils tenaient le plus, le domaine économique, les anarchistes espagnols se montrèrent, sous la pression des masses, plus intransigeants et les compromis auxquels ils durent consentir furent de caractère beaucoup plus limité. Dans une large mesure, l'autogestion agricole et industrielle vola de ses propres ailes. Mais, au fur et à mesure que l'État se renforça et que le caractère totalitaire de la guerre s'aggrava, la contradiction devint plus aiguë entre une république bourgeoise belligérante et une expérience de communisme ou, plus généralement, de collectivisme libertaire. A la fin, ce fut l'autogestion qui, plus ou moins, dut battre en retraite, sacrifiée sur l’autel de l’« antifascisme».
Cette expérience dont, selon Peirats, l'étude méthodique est encore à faire, étude malaisée, car l'autogestion présenta une foule de variantes, selon le lieu et le temps, il convient de s'y arrêter. Avec d'autant plus d'attention qu'elle est relativement peu connue. Au sein même du camp républicain elle a été plus ou moins passée sous silence ou décriée. La guerre civile l'a submergée, et la supplante aujourd'hui encore, dans la mémoire des hommes. On ne la trouve point dans le film Mourir à Madrid. Et, pourtant, elle est peut-être ce que l'anarchisme espagnol a légué de plus positif.
Au lendemain de la Révolution du 19 juillet 1936, foudroyante riposte populaire au pronunciamiento franquiste, les industriels, et les grands propriétaires terriens, avaient, en toute hâte, abandonné leurs biens et s’étaient réfugiés à l'étranger. Les ouvriers et paysans prirent en charge ces biens vacants. Les journaliers agricoles décidèrent de continuer à cultiver le sol par leurs propres moyens. Spontanément, ils s'associèrent en « collectivités». Le 5 septembre, en Catalogne, un congrès régional des paysans convoqué par la C.N.T. décida la collectivisation de la terre, sous contrôle et gestion syndicale. Seraient socialisés la grande propriété et les biens des fascistes. Quant aux petits propriétaires, ils choisiraient librement entre propriété individuelle et propriété collective. La consécration légale ne vint qu’un peu plus tard : le 7 octobre 1936, le gouvernement central républicain confisqua sans indemnité les biens des « personnes compromises dans la rébellion fasciste. » Mesure incomplète du point de vue légal, puisqu'elle ne sanctionnait qu'une petite partie des prises de possession déjà effectuées spontanément par le peuple : les paysans avaient procédé aux expropriations sans distinguer entre ceux qui avaient ou non pris part au putsch militaire.
Dans les pays sous-développés ou manquent les moyens techniques nécessaires pour la culture sur une large échelle, le paysan pauvre est davantage tenté par la propriété privée, dont il n'a pas encore fait l'expérience, que par l'agriculture socialiste. Mais, en Espagne, l’éducation libertaire en même temps que la tradition collectiviste ont compensé le sous-développement technique, contrecarré les tendances individualistes des paysans en les poussant, d'emblée, vers le socialisme. Ce furent les paysans pauvres qui prirent cette option, lorsque les plus aisés, comme en Catalogne, se cramponnèrent à l'individualisme. La grande majorité (90%) des travailleurs de la terre préférèrent, dès le départ, entrer dans les collectivités. Ainsi se trouva, du même coup, scellée l'alliance des paysans avec les ouvriers des villes, ces derniers étant, par leur fonction même, partisans de la socialisation des moyens de production. Il semble même que la conscience sociale ait été encore plus élevée à la campagne qu'à la ville.
*
Les collectivités agricoles se donnèrent une double gestion : à la fois économique et locale. Les deux fonctions étaient distinctes, mais, le plus souvent, ce furent les syndicats qui les assumèrent ou qui les contrôlèrent.
Pour l'administration économique, l'assemblée générale des paysans travailleurs élisait, dans chaque village, un comité de gestion. A part le secrétaire, tous les membres continuaient à travailler manuellement. Le travail était obligatoire pour tous les hommes valides entre dix-huit et soixante ans. Les paysans étaient répartis en groupe de dix et plus, avec un délégué à leur tête. Chaque groupe se voyait attribuer une zone de culture ou une fonction, compte tenu de l'âge de ses membres et de la nature du travail. Chaque soir le comité de gestion recevait les délégués des groupes. Sur le plan de l'administration locale, la commune convoquait fréquemment les habitants, en assemblée générale de quartier, pour des comptes rendus d'activité.
Tout était mis en commun, à l'exception des vêtements, du mobilier, des économies personnelles, du petit bétail, des parcelles de jardin et de la volaille destinées à la consommation familiale. Les artisans, les coiffeurs, les cordonniers, etc., étaient regroupés en collectifs, les moutons de la communauté répartis en troupeaux de plusieurs centaines de bêtes, confiés à des pâtres et méthodiquement distribués dans la montagne.
En ce qui concerne le mode de partage des produits, divers systèmes furent expérimentés, les uns relevant du collectivisme ; les autres du communisme plus ou moins intégral, d'autres résultant d'une combinaison des deux. Le plus souvent, la rémunération était établie en fonction des besoins des membres de la famille. Chaque chef de famille recevait, à titre de salaire journalier, un bon libellé en pesetas qui ne pouvait être changé que contre des biens de consommation dans les magasins communaux, souvent installés dans l'église ou ses dépendances. Le solde non consommé était porté en pesetas au crédit d'un compte de réserve individuel. Il était possible de percevoir sur ce solde de l'argent de poche en quantité limitée. Les loyers, l'électricité, les soins médicaux, les produits pharmaceutiques, l’assistance aux vieillards, etc., étaient gratuits, de même que l'école, souvent installée dans un ancien couvent, et obligatoire pour les enfants de moins de quatorze ans, à qui le travail manuel était interdit.
L'adhésion à la collectivité demeurait volontaire. Ainsi l'exigeait le souci fondamental de liberté des anarchistes. Aucune pression n'était exercée sur les petits propriétaires. Se tenant volontairement à l'écart de la communauté, ils ne pouvaient en attendre des services ou prestations puisqu'ils prétendaient se suffire à eux-mêmes. Cependant il leur était loisible de participer, de leur plein gré, aux travaux communs et de remettre aux magasins communaux leurs produits. Ils étaient admis aux assemblées générales, bénéficiaient de certains avantages collectifs. On les empêchait seulement de posséder plus de terres qu'ils n'en pouvaient cultiver et on leur posait une seule condition : que leur personne ou leur bien ne cause aucune perturbation de l'ordre socialiste. Ici et là les terres socialisées furent remembrées, par voie d'échange volontaire avec des parcelles appartenant à des paysans individuels. Dans la plupart des villages socialisés, les individuels, paysans ou commerçants, devinrent de moins en moins nombreux. Se sentant isolés, ils préférèrent rejoindre les collectivités.
Toutefois il semble que les unités appliquant le principe collectiviste de la rémunération par journée de travail résistèrent mieux que celles, moins nombreuses, où l'on voulut instaurer, trop vite, le communisme intégral et faire fi de l'égoïsme encore ancré dans la nature humaine, notamment, chez les femmes. Dans certains villages, où l'on avait supprimé la monnaie d'échange, où l'on puisait dans le tas, où l'on produisait et consommait en vase clos, les inconvénients de cette autarcie paralysante se firent sentir ; et l'individualisme ne tarda pas à reprendre le dessus, provoquant la rupture de la communauté, par le retrait de certains petits propriétaires, qui y étaient entrés sans avoir acquis une véritable mentalité communiste.
Les communes étaient unies en fédérations cantonales, coiffées par des fédérations régionales. Toutes les terres d'une fédération cantonale ne formaient plus, en principe14, qu'un seul terroir, sans bornages. Entre les villages la solidarité était poussée à l'extrême. Des caisses de compensation permettaient d'assister les collectivités les moins favorisées. Les instruments de travail, les matières premières, la main-d'œuvre excédentaire étaient mis à la disposition des communautés dans le besoin.
La socialisation rurale varia en importance selon les provinces. En Catalogne, pays de petite et moyenne propriété, où le paysan a de fortes traditions individualistes, elle se réduisit à quelques collectivités-pilotes. En revanche, en Aragon, plus des trois quarts des terres furent socialisées. Le passage d’une milice libertaire, la colonne Durruti, en route vers le front Nord pour y combattre les franquistes, et la création subséquente d'un pouvoir révolutionnaire issu de la base, unique en son genre dans l'Espagne républicaine, stimulèrent l'initiative créatrice des travailleurs agricoles. Environ 450 collectivités furent constituées, groupant 500.000 membres. Dans la région (cinq provinces) du Levant (capitale Valence), la plus riche d'Espagne, surgirent quelque 900 collectivités. Elles englobèrent 43% des localités, 50% de la production des agrumes et 70% de leur commercialisation. En Castille, environ 300 collectivités furent formées, avec un chiffre rond de 100.000 adhérents. La socialisation gagna également l'Estramadure et une partie de l'Andalousie. Elle manifesta quelques velléités, vite réprimées, dans les Asturies.
Il est à noter que ce socialisme à la base ne fut pas, comme certains le croient, l’œuvre des seuls anarcho-syndicalistes. Les autogestionnaires étaient souvent, selon le témoignage de Gaston Leval, « libertaires sans le savoir». Dans les provinces qui viennent d'être énumérées en dernier, ce furent des paysans social-démocrates, catholiques, voire communistes dans les Asturies, qui prirent l'initiative de la collectivisation15.
Quand elle ne fut pas sabotée par ses adversaires, ou entravée par la guerre, l'autogestion agricole fut une incontestable réussite. Les succès remportés le furent, pour une part, du fait de l'état arriéré de l'agriculture espagnole. Il n'était pas difficile de battre les records de la grande propriété privée, car ces records avaient été déplorables. Quelque dix mille féodaux du sol avaient possédé la moitié du territoire de la péninsule. Ils avaient préféré conserver une bonne partie de leurs terres en friche plutôt que de laisser se créer une couche de fermiers indépendants et d'accorder à leurs journaliers des salaires décents, qui eussent menacé leur position de seigneurs moyenâgeux. Ainsi ils avaient retardé la mise en valeur des richesses naturelles du sol espagnol.
La terre fut remembrée, cultivée sur de grandes étendues, selon un plan général et les directives d'agronomes. Grâce aux études de techniciens agricoles, les rendements s'accrurent de 30 à 50 %. Les superficies ensemencées augmentèrent, les méthodes de travail furent perfectionnées, l'énergie humaine, animale et mécanique utilisée de façon plus rationnelle. Les cultures furent diversifiées, l'irrigation développée, le pays en partie reboisé, des pépinières ouvertes, des porcheries construites, des écoles techniques rurales créées, des fermes-pilotes aménagées, le bétail sélectionné et multiplié, des industries auxiliaires mises en marche. La socialisation démontra sa supériorité tant sur la grande propriété absentéiste, qui laissait inculte une partie du sol, que sur la petite propriété cultivant selon des techniques rudimentaires, avec des semences médiocres et sans engrais.
La planification agricole fut, au moins, esquissée. Elle eut comme base les statistiques de production et de consommation émanant des collectivités, rassemblés par les comités cantonaux respectifs, puis par le comité régional qui contrôlait, en quantité et en qualité, la production de la région. Le commerce extérieur à la région était assuré par le comité régional qui rassemblait les produits à vendre contre lesquels il procédait aux achats en commun de la région.
C'est dans le Levant que l'anarcho-syndicalisme rural démontra le mieux ses capacités d'organisation et d'intégration. L'exportation des agrumes exigeait des techniques commerciales modernes et méthodiques ; elles furent brillamment mises en œuvre, en dépit de quelques conflits, parfois vifs, avec de riches producteurs.
Le développement culturel alla de pair avec le développement matériel : l'alphabétisation des adultes fut entreprise ; les fédérations régionales établirent un programme de conférences, séances de cinéma, représentations théâtrales, dans les villages.
Ces réussites furent dues non seulement à la puissante organisation du syndicalisme, mais aussi, pour une large part, à l'intelligence et à l'initiative du peuple. Bien qu'en majorité illettrés, les paysans firent preuve d'une conscience socialiste, d'un bon sens pratique, d'un esprit de solidarité et de sacrifice qui provoquèrent l'admiration des observateurs étrangers. Le travailliste indépendant Fenner Brockway, aujourd'hui Lord Brockway, après une visite à la collectivité de Segorbe, en témoigna : « L'état d'esprit des paysans, leur enthousiasme, la manière dont ils apportent leur part à l'effort commun, la fierté qu'ils en ressentent, tout cela est admirable. »
L'autogestion fit également ses preuves dans l'industrie, notamment en Catalogne, région la plus industrialisée de l'Espagne. Les ouvriers dont les employeurs avaient pris la fuite entreprirent spontanément de faire marcher les usines. Pendant plus de quatre mois, 109 entreprises de Barcelone, sur lesquelles flottait la bannière rouge et noire de la C.N.T., furent gérées par les travailleurs groupés en comités révolutionnaires, sans aide ou interférence de l'État, parfois même sans une direction expérimentée. Cependant la chance du prolétariat fut d'avoir à ses côtés les techniciens. A l'inverse de ce qui s'était passé en Russie, en 1917-1918, en Italie en 1920, pendant la brève expérience d'occupation des usines, les ingénieurs ne refusèrent pas leur concours à la nouvelle expérience de socialisation ; ils collaborèrent étroitement, dès les premiers jours, avec les travailleurs.
En octobre 1936 se tint à Barcelone un congrès syndical représentant 600.000 travailleurs avec pour objet la socialisation de l'industrie. L'initiative ouvrière fut institutionnalisée par un décret du gouvernement catalan en date du 24 octobre 1936, qui, tout en ratifiant le fait accompli, introduisit dans l'autogestion un contrôle gouvernemental. Deux secteurs furent créés, l'un socialiste, l'autre privé. Étaient socialisées les usines de plus de cent ouvriers (celles de cinquante à cent pouvaient l'être sur la demande des trois quarts des travailleurs), également celles dont les propriétaires avaient été déclarés « factieux » par un tribunal populaire ou avaient abandonné l'exploitation, celles enfin dont l'importance dans l'économie nationale justifiait qu'elles fussent enlevées au secteur privé (en fait, nombre d'entreprises endettées furent socialisées).
L’usine autogérée était dirigée par un comité de gestion de cinq à quinze membres, représentant les divers services, nommés par les travailleurs en assemblée générale, avec mandat de deux ans, la moitié étant renouvelable chaque année. Le comité désignait un directeur auquel il déléguait tout ou partie de ses pouvoirs.
Dans les entreprises très importantes, la nomination du directeur devait être approuvée par l'organisme de tutelle. En outre, un contrôleur gouvernemental était placé auprès de chaque comité de gestion. Ce n'était plus tout à fait de l'autogestion, mais plutôt une cogestion, en liaison étroite avec l'État.
Le comité de gestion pouvait être révoqué, soit par l'assemblée générale, soit par le Conseil général de la branche d'industrie (composé de quatre représentants des comités de gestion, huit des syndicats ouvriers, quatre techniciens nommés par l'organisme de tutelle). Ce conseil général planifiait le travail et fixait la répartition des bénéfices. Ses décisions étaient exécutoires.
Au sein des entreprises demeurées privées, un comité ouvrier élu avait à contrôler la production et les conditions de travail, « en étroite collaboration avec l’employeur».
Le salariat subsistait intégralement dans les usines socialisées. Chaque travailleur demeurait rétribué par un salaire fixe. Les bénéfices n'étaient pas partagés à l'échelon de l'entreprise. Les salaires ne furent guère relevés après la socialisation et ils le furent encore moins que dans le secteur demeuré privé.
Le décret du 24 octobre 1936 était un compromis entre l'aspiration à la gestion autonome et la tendance à la tutelle étatique, en même temps qu'une transaction entre capitalisme et socialisme. Il fut rédigé par un ministre libertaire, et entériné par la C.N.T., parce que les dirigeants anarchistes participaient au gouvernement. Tenant eux-mêmes les leviers de commande étatiques, comment ces derniers auraient-ils pu s'offusquer de l'ingérence de l'État dans l'autogestion ? Une fois le loup introduit dans la bergerie, il finit, peu à peu, par s'y comporter en maître.
A l'usage, il apparut, malgré les pouvoirs considérables dont avaient été dotés les conseils généraux de branches d'industrie, que l'autogestion ouvrière risquait de conduire à un particularisme égoïste, à une sorte de « coopérativisme bourgeois», comme le note Peirats, chaque unité de production ne se souciant que de ses intérêts propres. Il y eut des collectivités riches et des collectivités pauvres. Les unes pouvaient se permettre de verser des salaires relativement élevés, tandis que les autres n'arrivaient pas même à supporter la charge des salaires d'avant la Révolution. Les unes étaient abondamment pourvues de matières premières, les autres en manquaient, etc. Il fut remédié assez rapidement à ces déséquilibres par la création d'une caisse centrale d'égalisation, permettant de distribuer équitablement les ressources. En décembre 1936, des assises syndicales, tenues à Valence, décidèrent de coordonner les divers secteurs de la production en un plan général et organique, permettant d'éviter les compétitions nuisibles et les efforts en ordre dispersé.
Les syndicats entreprirent dès lors la réorganisation systématique de professions entières, fermant des centaines de petites entreprises et concentrant la production dans celles les mieux équipées. Un exemple : en Catalogne les fonderies furent réduites de plus de 70 à 24, les tanneries de 71 à 40, les verreries d'une centaine à une trentaine. Mais la centralisation industrielle sous contrôle syndical ne put se développer aussi rapidement et aussi complètement que les planificateurs anarcho-syndicalistes l'eussent souhaité. Pourquoi ? Parce que les staliniens et les réformistes s'opposaient à la confiscation des biens de la classe moyenne et respectaient religieusement le secteur privé.
Dans les autres centres industriels de l'Espagne républicaine, où ne s'appliquait pas le décret catalan de socialisation, les collectivisations furent moins nombreuses qu'en Catalogne ; mais les entreprises demeurées privées furent souvent, comme ce fut le cas pour les Asturies, dotées de comités de contrôle ouvrier.
*
Comme l'autogestion agricole, l'autogestion industrielle fut, largement, une réussite. Les témoins ne tarissent pas en éloges, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement des services urbains en autogestion. Un certain nombre d'usines, sinon toutes, furent gérées de façon remarquable. L'industrie socialisée apporta une contribution décisive à la guerre antifasciste. Le petit nombre d'usines d'armements créées en Espagne avant 1936 l'avaient été hors de Catalogne : le patronat, en effet, avait manqué de confiance dans le prolétariat catalan. Il fallut, dans la région de Barcelone, reconvertir en hâte les usines pour les mettre au service de la défense républicaine. Ouvriers et techniciens rivalisèrent d'ardeur et d'esprit d'initiative. Très vite arriva au front un matériel de guerre fabriqué principalement en Catalogne. Un effort aussi important porta sur la mise en fabrication de produits chimiques indispensables à la guerre. Sur le plan des besoins civils, l'industrie socialisée n'alla pas moins de l'avant. Elle se lança dans la transformation de fibres textiles, jusqu'alors non pratiquée en Espagne, traita le chanvre, le spart, la paille de riz, la cellulose.
L’autogestion sapée
Cependant le crédit, le commerce extérieur étaient demeurés, par la volonté du gouvernement bourgeois républicain, entre les mains du secteur privé. L'État, certes, contrôlait les banques, mais il se gardait de les mettre au service de l'autogestion. Manquant de fonds de roulement, nombre de collectivités vécurent sur des disponibilités saisies au moment de la Révolution de juillet 1936. Par la suite, elles durent recourir, au jour le jour, à des moyens de fortune, tels que la mainmise sur des bijoux et des objets précieux appartenant à des églises, à des couvents, à des franquistes. Pour financer l'autogestion, la C.N.T. envisagea la création d'une « banque confédérale». Mais il était utopique de vouloir faire concurrence au capital financier qu'avait épargné la socialisation. La seule solution eût été de faire passer tout le capital financier entre les mains du prolétariat organisé. La C.N.T., prisonnière du Frente Popular, n'osa pas aller jusque-là.
Mais l'obstacle majeur fut l'hostilité, d'abord sourde, puis ouverte que nourrirent à l'égard de l'autogestion les divers états-majors politiques de l'Espagne républicaine. Elle fut accusée de rompre l'« unité de front», entre la classe ouvrière et la petite bourgeoisie, donc de « faire le jeu » de l'ennemi franquiste. (Ce qui n'empêchait pas ses détracteurs de refuser des armes à l'avant-garde libertaire, réduite, en Aragon, à affronter les mains nues les mitrailleuses fascistes, pour se voir ensuite reprocher son « inertie».)
Le décret du 7 octobre 1936 légalisant une partie des collectivisations rurales avait été pris par le ministre communiste de l’Agriculture, Uribe. Sous des apparences contraires, il était imprégné d'un esprit anticollectiviste et visait à démoraliser les paysans socialisés. Il soumettait à des règles juridiques très rigides et très compliquées la validation des collectivisations. Un délail-limite péremptoire était imposé aux collectivités. Celles qui n'avaient pas été légalisées en temps voulu se trouvaient placées automatiquement en marge de la loi et leurs terres étaient passibles d'être restituées aux anciens propriétaires.
Uribe incita les paysans à ne pas entrer dans les collectivités ou les indisposa contre elles. Dans un discours de décembre 1936 à l'adresse des petits propriétaires individualistes, il leur déclara que les fusils du Parti communiste et du gouvernement étaient à leur disposition. Il leur distribua les engrais importés qu'il refusait aux collectivités. Lui et son collègue de l'Économie de la Généralité de Catalogne, Comerera, groupèrent en un seul syndicat réactionnaire les petits et moyens propriétaires, auxquels s'ajoutèrent les commerçants et même quelques gros possédants camouflés en petits. Ils enlevèrent aux syndicats ouvriers l'organisation du ravitaillement de Barcelone et le confièrent au commerce privé.
En fin de compte, la coalition gouvernementale, après l'écrasement de l'avant-garde de la Révolution à Barcelone, en mai 1937, n'hésita pas à liquider, manu militari, l'autogestion agricole. Un décret du 10 août 1937 prononça la dissolution du « conseil régional de défense » d'Aragon, sous le prétexte qu'il était « resté en marge du courant centralisateur». Son animateur, Joaquin Ascaso, fut inculpé pour « vente de bijoux», destinée, en réalité, à procurer des fonds aux collectivités. Aussitôt après, la 11e division ambulante du commandant Lister (un stalinien), appuyée par des chars, passa à l'action contre les collectivités. Elle pénétra en Aragon comme en pays ennemi. Les responsables des entreprises socialisées furent arrêtés, leurs locaux occupés, puis fermés, les comités de gestion dissous, les magasins communaux dévalisés, les meubles brisés, les troupeaux démembrés. La presse communiste dénonça « les crimes de la collectivisation forcée». 30% des collectivités d'Aragon furent complètement détruites.
Cependant, malgré sa brutalité, le stalinisme ne réussit pas, dans l'ensemble, à contraindre les paysans aragonais à devenir des propriétaires privés. Aussitôt après le passage de la division Lister, la plupart des actes de propriété, que les paysans avaient été contraints de signer sous la menace du pistolet, furent détruits et les collectivités reconstruites. Comme l'écrit G. Munis, « ce fut un des épisodes les plus exemplaires de la Révolution espagnole. Les paysans affirmèrent une nouvelle fois leurs convictions socialistes malgré la terreur gouvernementale et le boycottage économique dont ils étaient l’objet».
La restauration des collectivités d'Aragon eut, par ailleurs, une cause moins héroïque : le Parti communiste s'était aperçu, après coup, qu'il avait atteint dans ses forces vives l'économie rurale, mis en péril, faute de bras, les récoltes, démoralisé les combattants du front d’Aragon, renforcé dangereusement la classe moyenne des propriétaires terriens. Il essaya donc de réparer ses propres dégâts, de ressusciter une partie des collectivités. Mais les nouvelles ne retrouvèrent ni les superficies, ni la qualité des terres des premières, ni leurs effectifs, nombre de militants ayant fui les persécutions, cherché asile, au front, dans les divisions anarchistes, ou été emprisonnés.
Dans le Levant, en Castille, dans les provinces de Huesca et de Teruel, des attaques armées du même genre furent perpétrées — par des républicains — contre l'autogestion agricole. Elle survécut tant bien que mal, dans certaines des régions qui n'étaient pas encore tombées aux mains des franquistes, notamment dans le Levant.
La politique pour le moins équivoque du gouvernement de Valence en matière de socialisme rural contribua à la défaite de la République espagnole : les paysans pauvres ne surent pas toujours clairement que leur intérêt était de se battre pour la République.
En dépit de ses succès, l'autogestion industrielle fut sabotée par la bureaucratie administrative et les socialistes « autoritaires». Une formidable campagne préparatoire de dénigrement et de calomnie, menée par la voie de la presse et des ondes, et qui mettait en cause, notamment, l'honnêteté de la gestion par les conseils d'usine, fut déclenchée. Le gouvernement central républicain refusa tous crédits à l'autogestion catalane, même lorsque le ministre libertaire de l'Économie en Catalogne, Fabregas, eut offert, en garantie d'avances à l'autogestion, le milliard de dépôts des Caisses d'Épargne. Quand, en juin 1937, le stalinien Comorera prit le portefeuille de l’Économie, il priva les usines autogérées de matières premières qu'il prodiguait au secteur privé. Il omit aussi de régler aux entreprises socialisées les fournitures commandées par l'administration catalane.
Le gouvernement central disposait d'un moyen radical pour étrangler les collectivités : la nationalisation des transports, qui lui permettait d'approvisionner les unes et de couper toute livraison aux autres. Par ailleurs, il achetait à l’étranger des uniformes destinés à l'armée républicaine au lieu de s'adresser aux collectivités textiles de Catalogne. Il tira prétexte des nécessités de la défense nationale pour suspendre, par un décret du 22 août 1937, dans les entreprises métallurgiques et minières, l'application du décret catalan de socialisation d'octobre 1936, présenté comme « contraire à l'esprit de la Constitution». Les anciens agents de maîtrise, les directeurs évincés par l'autogestion ou, plus exactement, qui n'avaient pas voulu accepter des postes de techniciens dans les entreprises autogérées, reprirent leurs places, avec un esprit de revanche.
Le point final fut mis par le décret du 11 août 1938 qui militarisa les industries de guerre au profit du ministère de l'Armement. Une bureaucratie pléthorique et abusive s'abattit sur les usines. Elles subirent l'intrusion d'une foule d'inspecteurs et directeurs qui ne devaient leur nomination qu'à leur appartenance politique — en l'espèce, à leur adhésion récente au Parti communiste. Les ouvriers furent démoralisés en se voyant frustrés du contrôle d'entreprises qu'ils avaient créées de toutes pièces, durant les premiers mois critiques de la guerre, et la production s'en ressentit.
L'autogestion industrielle catalane survécut, toutefois, dans les autres branches, jusqu'à l'écrasement de l'Espagne républicaine. Mais au ralenti, car l'industrie avait perdu ses principaux débouchés et les matières premières manquaient, le gouvernement ayant coupé les crédits nécessaires à leur achat.
*
En bref, les collectivités espagnoles, à peine nées, furent corsetées dans le cadre rigoureux d'une guerre menée par les moyens militaires classiques, au nom ou sous le couvert de laquelle la République coupa les ailes à son avant-garde et transigea avec la réaction intérieure.
La leçon que les collectivités ont laissée derrière elles est, pourtant, stimulante. Elle a inspiré, en 1938, à Emma Goldman cet hommage : « La collectivisation des industries et de la terre apparaît comme la plus grande réalisation de n'importe quelle période révolutionnaire. Au surplus, même si Franco devait l'emporter et les anarchistes espagnols être exterminés, l’idée qu'ils ont lancée continuera à vivre. » Et Frederica Montseny, dans un discours du 21 juillet 1937, prononcé à Barcelone, fit ressortir les deux termes de l'alternative : « D'une part, les partisans de l'autorité et de l'État totalitaire, de l'économie dirigée par l'État, d'une organisation sociale qui militarise tous les hommes et convertit l'État en un grand patron, en une grande entremetteuse ; de l'autre, l'exploitation des mines, des champs, des usines et des ateliers par la classe laborieuse elle-même, organisée en fédérations syndicales. » Dilemme qui n'a pas été seulement celui de la Révolution espagnole, mais qui, à l'échelle mondiale, pourrait bien être, demain, celui de tout socialisme.
En matière de conclusion
La défaite de la Révolution espagnole a privé l'anarchisme de son seul et unique bastion dans le monde. De l'épreuve, il sortit écrasé et dispersé, et, dans une certaine mesure, discrédité. La condamnation prononcée contre lui par l'histoire était d'ailleurs sévère et, par certains côtés, injuste. Ce n'était pas lui le vrai, ou en tout cas le principal, responsable de la victoire franquiste. L'expérience des collectivités, rurales et industrielles, menée dans les circonstances les plus tragiquement défavorables, laissait derrière elle un bilan largement positif. Mais elle fut méconnue, sous-estimée, calomniée. Pendant des années le socialisme autoritaire, enfin débarrassé de l'indésirable concurrence libertaire, demeura, de par le monde, maître du terrain. La victoire militaire remportée par l'U.R.S.S. en 1945 contre l'hitlérisme, d'incontestables et même de grandioses réussites sur le plan technique, semblèrent, un moment, donner raison au socialisme d'État.
Mais les excès mêmes de ce régime ne tardèrent pas à engendrer leur propre négation. Ils firent naître l'idée que la paralysante centralisation étatique devrait être assouplie, les unités de production disposer d'une plus large autonomie, que les ouvriers seraient incités à travailler mieux et davantage s'ils avaient leur mot à dire dans la gestion des entreprises. Dans un des pays vassalisés par Staline furent engendrés ce qu'on appelle, en médecine, des « anticorps». La Yougoslavie de Tito s'affranchit d'un joug trop pesant et qui faisait d'elle une sorte de pays colonisé. Elle procéda à une réévaluation de dogmes dont le caractère antiéconomique sautait maintenant aux yeux. Elle se remit à l'école des maîtres du passé. Elle découvrit, elle lut, discrètement, l'œuvre de Proudhon, elle puisa dans ses anticipations. Elle explora également les zones libertaires, trop méconnues, de la pensée de Marx et de Lénine. Elle creusa, entre autres, la notion de dépérissement de l'État qui, certes, n'avait pas été tout à fait rayée du vocabulaire politique, mais qui n'était plus qu'une formule rituelle, vidée de toute substance. Remontant à la courte période où le bolchevisme s'était identifié avec la démocratie prolétarienne par en bas, avec les soviets, elle y glana au mot prononcé, puis vite oublié, par les conducteurs de la Révolution d'Octobre : celui d'autogestion. Elle ne prêta pas moins d'attention aux embryons de conseils d'usine que la contagion révolutionnaire avait fait surgir, à la même époque, en Allemagne et en Italie, beaucoup plus récemment, en Hongrie, et elle se demanda, comme l'écrivit dans Arguments l'Italien Roberto Guiducci, si l’« idée des conseils, que le stalinisme avait pour des raisons évidentes étouffée » ne « pourrait être reprise en termes modernes».
Lorsque l'Algérie décolonisée accéda à l'indépendance et que ses nouveaux dirigeants s'avisèrent d'institutionnaliser les occupations spontanées de biens vacants européens auxquelles avaient procédé les paysans et les ouvriers, elle s'inspira du précédent yougoslave, démarqua sa législation en la matière.
L'autogestion est, incontestablement, si les ailes ne lui sont pas rognées, une institution de tendances démocratiques, voire libertaires. A l'instar des collectivités espagnoles de 1936-1937, elle vise à confier la gestion de l'économie aux producteurs eux-mêmes. A cet effet, elle installe dans chaque entreprise, par voie d'élection, une représentation ouvrière, à trois échelons : l'assemblée générale souveraine, son abrégé délibératif, le conseil ouvrier, enfin l'organe exécutif : le comité de gestion. La législation prévoit certaines garanties contre la menace d'une bureaucratisation : les élus ne peuvent faire reconduire indéfiniment leurs mandats, ils doivent être engagés directement dans la production, etc. En Yougoslavie, les travailleurs, en dehors des assemblées générales, peuvent également être consultés par référendum. Dans les très grandes entreprises, les assemblées générales ont lieu par unité de travail.
En Yougoslavie comme en Algérie, une fonction importante est assignée, au moins en théorie, ou en tant que perspective d'avenir, à la commune, où l'on se targue de faire prévaloir la représentation des travailleurs autogestionnaires. En théorie toujours, la gestion des affaires publiques devrait tendre à la décentralisation, s'exercer de plus en plus sur le plan local.
Mais la pratique s'écarte sensiblement de ces intentions. Dans les pays en question, l'autogestion fait ses premiers pas dans le cadre d'un État dictatorial, militaire, policier, dont l'ossature est formée par un parti unique, le gouvernail tenu par un pouvoir autoritaire et paternaliste échappant à tout contrôle, à toute critique. Il y a donc incompatibilité entre les principes autoritaires de l'administration politique et les principes libertaires de la gestion économique.
Par ailleurs, en dépit des précautions prises par le législateur, une certaine bureaucratisation tend à se manifester au sein même des entreprises. La majorité des travailleurs n'est pas encore suffisamment mûre pour une participation effective à l'autogestion. Elle manque d'instruction, de connaissances techniques, elle n’a pas suffisamment dépouillé la vieille mentalité salariale, elle abdique trop volontiers ses pouvoirs entre les mains de ses délégués. Le résultat est qu'une minorité restreinte assume la gestion de l'entreprise, s'arroge toutes sortes de privilèges, n'en fait qu'à sa guise, se perpétue dans la fonction dirigeante, gouverne sans contrôle, perd le contact avec la réalité, se coupe de la base ouvrière qu'elle traite parfois avec orgueil et dédain, et, ce faisant, démoralise les travailleurs, les indispose contre l'autogestion.
Enfin, le contrôle de l'État s'exerce souvent de façon si indiscrète et si oppressive que la véritable gestion échappe aux « autogestionnaires». L'État place des directeurs aux côtés des organes de l'autogestion sans trop se soucier de leur agrément, qui, aux termes de la loi, devrait pourtant être sollicité. L'ingérence de ces fonctionnaires dans la gestion est souvent abusive et, parfois, ils se comportent avec la même mentalité arbitraire que les anciens employeurs. Dans les très grandes entreprises yougoslaves, la nomination des directeurs est exclusivement une affaire d'État : ces postes sont distribués par le maréchal Tito à sa vieille garde.
En outre, l'autogestion dépend étroitement de l'État sur le plan financier. Elle vit des crédits que celui-ci veut bien lui consentir. Elle n'a la libre disposition que d'une partie restreinte de ses bénéfices, le reste étant versé à titre de redevance au trésor public. L'État ne se sert pas seulement des revenus de l'autogestion pour développer les secteurs retardataires de l'économie, ce qui n'est que justice, mais il les affecte à la rétribution de l'appareil gouvernemental, d'une bureaucratie pléthorique, de l'armée, des forces de l'ordre, à des dépenses de prestige parfois démesurées. La sous-rémunération des autogestionnaires compromet l'élan de l'autogestion et en contredit les principes mêmes.
Par ailleurs, l'entreprise est soumise aux plans économiques du pouvoir central, établis arbitrairement et sans consultation de la base, d'où une limitation considérable de sa liberté d'action. En Algérie, l'autogestion doit, au surplus, abandonner complètement à l'État la commercialisation d'une part importante de sa production. En outre, elle y est mise en vasselage par des organes de tutelle, qui, sous couleur de lui fournir une assistance technique et comptable désintéressée, ont tendance à se substituer à elle et à devenir en elles-mêmes gestionnaires.
D'une façon générale, la bureaucratie de l'État totalitaire voit d'un mauvais œil la prétention à l'autonomie de l'autogestion. Comme l'entrevoyait déjà Proudhon, elle ne souffre aucun autre pouvoir en dehors du sien. Elle a la phobie de la socialisation et la nostalgie de la nationalisation, c'est-à-dire de la gestion directe par les fonctionnaires de l'État. Elle vise à empiéter sur l'autogestion, à réduire ses attributions, voire à l'absorber.
Le parti unique ne regarde pas l'autogestion avec moins de méfiance. Lui non plus ne saurait tolérer de rival. S'il l'embrasse, c'est pour mieux l'étouffer. Il a des sections dans la plupart des entreprises. La tentation est forte pour lui de s'immiscer dans la gestion, de faire double emploi avec les organes élus par les travailleurs ou de les réduire au rôle d'instruments dociles, de fausser les élections en confectionnant à l'avance les listes des candidats, de faire entériner par les conseils ouvriers des décisions qu'il a déjà prises à l'avance, de manipuler et d'infléchir les congrès nationaux des travailleurs.
Contre ces tendances autoritaires et centralisatrices, certaines entreprises autogérées réagissent par la manifestation de tendances autarciques. Elles se comportent comme si elles étaient composées de petits propriétaires associés. Elles entendent fonctionner au bénéfice exclusif des travailleurs en place. Elles sont enclines à réduire les effectifs de manière à partager le gâteau en moins de parts. Elles voudraient produire un peu de tout, au lieu de se spécialiser. Elles s'ingénient à tourner les plans ou règlements qui prennent en considération l’intérêt de la collectivité entière. En Yougoslavie où la libre concurrence a été maintenue entre les entreprises, à la fois à titre de stimulant et pour la protection des consommateur, la tendance à l'autonomie conduit à des inégalités flagrantes dans les résultats d'exploitation des entreprises, en même temps qu'à des irrationalités économiques.
Ainsi l'autogestion est-elle animée d'un mouvement de pendule qui la fait balancer continuellement entre deux comportements extrêmes : excès d'autonomie, excès de centralisation, « autorité ou anarchie», « ouvriérisme ou caporalisme». La Yougoslavie, en particulier, à travers les années, a corrigé la centralisation par l'autonomie, puis l'autonomie par la centralisation, remodelant sans cesse ses institutions, sans réussir encore à atteindre un « juste milieu».
La plupart des faiblesses de l'autogestion seraient, semble-t-il, évitées ou corrigées s'il existait un authentique mouvement syndical, indépendant du pouvoir et du parti unique, émanant des autogestionnaires et les encadrant tout à la fois, animé de l'esprit qui fut celui de l'anarcho-syndicalisme espagnol. Or, en Yougoslavie comme en Algérie, le syndicalisme ouvrier, ou bien joue un rôle secondaire, fait figure de « rouage inutile», ou bien il est subordonné à l'État, au parti unique. Il ne remplit donc pas, ou il ne remplit que très imparfaitement, la fonction de conciliation entre autonomie et centralisation qui devrait être la sienne et qu'il assumerait beaucoup mieux que les organismes politiques totalitaires ; dans la mesure, en effet où il émanerait strictement des travailleurs, qui se reconnaîtraient en lui, il serait l'organe le plus apte à harmoniser les forces centrifuges et centripètes, à « équilibrer», comme disait Proudhon, les contradictions de l'autogestion.
*
Cependant le tableau ne devrait pas être poussé trop au noir. L'autogestion, certes, a de puissants et tenaces adversaires, qui n'ont pas renoncé à l'espoir de la faire échouer. Mais c'est un fait qu'elle a démontré, dans les pays où elle est en cours d'expérimentation, sa dynamique propre. Elle a entrouvert aux ouvriers de nouvelles perspectives et leur a restitué une certaine joie au travail. Elle a commencé à opérer dans leur mentalité une véritable révolution. Elle y a fait pénétrer les rudiments d'un socialisme authentique, caractérisé par la disparition progressive du salariat, la désaliénation du producteur, son accession à la libre détermination. Elle a contribué ainsi à relever la productivité. Malgré les tâtonnements inévitables d'une période de noviciat, elle a inscrit à son actif des résultats non négligeables.
Les petits cercles d'anarchistes qui suivent, d'un peu trop loin, l'autogestion yougoslave et algérienne la regardent avec un mélange de sympathie et d'incrédulité. Ils sentent bien qu'à travers elle des bribes de leur idéal sont en train de passer dans le réel. Mais l'expérience ne se déroule guère selon le schéma idéal prévu par le communisme libertaire. Elle est tentée, tout au contraire, dans un cadre « autoritaire » qui répugne à l'anarchisme. Et ce cadre lui confère, sans aucun doute, un caractère de fragilité : il est toujours à craindre que le cancer autoritaire ne la dévore. Si, pourtant, l'autogestion était scrutée de plus près, et sans parti pris, il serait possible d'y relever des signes plutôt encourageants.
En Yougoslavie, l'autogestion est un facteur de démocratisation du régime. Grâce à elle, le recrutement se fait sur des bases plus saines, en milieu ouvrier. Le Parti en vient à animer plutôt qu'à diriger. Ses cadres deviennent de meilleurs porte-parole des masses, plus sensibles à leurs problèmes et à leurs aspirations. (comme l'observait récemment Albert Meister, un jeune sociologue qui a pris la peine d'étudier le phénomène sur place, l'autogestion possède un « virus démocratique » dont la contagion, à la longue, s'exerce sur le parti unique lui-même. Elle est pour lui comme un « tonique». Elle soude ses échelons inférieurs avec la masse ouvrière. L'évolution est si nette qu'elle amène les théoriciens yougoslaves à tenir un langage que ne désavouerait pas un libertaire. C'est ainsi que l'un d'eux, Stane Kavcic, annonce : « La force de frappe du socialisme en Yougoslavie ne peut être à l'avenir un parti politique et l'État agissant du sommet vers la base, mais le peuple, les citoyens ayant un statut leur permettant d'agir de la base au sommet. » Et de proclamer hardiment que l'autogestion affranchit « de plus en plus de la discipline rigide et de la subordination qui sont caractéristiques de tout parti politique».
En Algérie, la tendance est moins nette, l'expérience trop récente, et elle risque, au surplus, d’être remise en cause. Pourtant, à titre indicatif, il convient de mentionner que le responsable de la commission d'orientation du F.L.N., Hocine Zahouane, (depuis, il est vrai, relevé de ses fonctions par un coup d'État militaire et devenu l'animateur d'une opposition clandestine socialiste), avait dénoncé publiquement, à la fin de 1964, la propension des organes de tutelle à se placer au-dessus des autogestionnaires et à les « caporaliser » : « Alors, s'écriait-il, il n'y a plus de socialisme. Il y a seulement changement de forme dans l'exploitation des travailleurs». L'auteur de cet article demandait, en conclusion, que les producteurs « soient réellement maîtres de leur production», et non plus « manipulés à des fins étrangères au socialisme».
*
En bref, quelles que soient les difficultés auxquelles se heurte l'autogestion, les contradictions dans lesquelles elle se débat, elle apparaît, d'ores et déjà, à l'usage, posséder, pour le moins, le mérite de permettre aux masses de faire leur apprentissage de la démocratie directe orientée de bas en haut, de développer, d'encourager, de stimuler leurs libres initiatives, de leur inculquer le sens de leurs responsabilités au lieu d'entretenir chez elles, comme c'est le cas sous la houlette du communisme d'État, les habitudes séculaires de passivité, de soumission, le complexe d'infériorité que leur a légués un passé d'oppression. Même si cet apprentissage est parfois laborieux, même si le rythme en est un peu lent, même s'il grève la société de frais supplémentaires, même s'il ne peut être effectué qu'au prix de quelques erreurs et de quelque « désordre», ces difficultés, ces retards, ces frais supplémentaires, ces troubles de croissance semblent à plus d'un observateur moins nocifs que le faux ordre, le faux éclat, la fausse « efficience», du communisme d'État qui anéantit l'homme, tue l'initiative populaire, paralyse la production et, en dépit de certaines prouesses matérielles obtenues à quel prix, discrédite l'idée même de socialisme.
L'U.R.S.S. elle-même, pour autant que la tendance en cours vers la libéralisation ne soit pas annulée par une nouvelle rechute autoritaire, semble procéder à une réévaluation de ses méthodes de gestion économique. Khrouchtchev, avant sa chute, le 15 octobre 1964, semblait avoir compris, bien que tardivement et timidement, la nécessité d'une décentralisation industrielle. Au début de décembre 1964, sous le titre « L'État de tout le peuple», la Pravda publia un long article s'attachant à définir les changements de structure grâce auxquels la forme de l'État « dite du peuple tout entier » diffère de celle de la « dictature du prolétariat», à savoir : progrès de la démocratisation, participation des masses à la direction de la société par la voie de l'autogestion, revalorisation des soviets et des syndicats, etc.
Sous le titre : « Un problème majeur : la libération de l'économie», Michel Tatu, dans Le Monde du 16 février 1965, a mis à nu les maux les plus graves « dont souffre toute la machine bureaucratique soviétique, et au premier chef l'économie». Le niveau technique atteint par celle-ci rend de plus en plus insupportable le joug de la bureaucratie sur la gestion. Les directeurs d'entreprises ne peuvent, dans l’état actuel des choses, prendre une décision en aucune matière sans en référer à au moins un bureau et plus souvent à une demi-douzaine. « Personne ne conteste le progrès économique, technique et scientifique remarquable qui a été réalisé en trente ans de planification stalinienne. Mais le résultat est précisément que cette économie se range aujourd'hui dans la catégorie des économies développées, et que les vieilles structures qui ont permis de conduire à ce stade s'y révèlent totalement et de plus en plus gravement inadaptées. » « Pour venir à bout de l'énorme force d'inertie qui règne du haut en bas de la machine, il faudrait donc beaucoup plus que des réformes de détail, un changement spectaculaire d'esprit et de méthode, une sorte de nouvelle déstalinisation. » A condition toutefois, comme l'a fait remarquer Ernest Mandel, dans un récent article des Temps Modernes, que la tendance à la décentralisation ne s'arrête pas au stade d’une simple autonomie des directeurs d'entreprises, mais qu'elle aboutisse à une véritable autogestion ouvrière.
Dans un petit livre tout récent, Michel Garder pronostique, lui aussi, en U.R.S.S., une « inévitable » révolution. Mais, en dépit de ses tendances visiblement antisocialistes, l'auteur doute, probablement à contrecœur, que l’« agonie » de l'actuel régime puisse aboutir à un retour du capitalisme privé. Tout au contraire, il pense que la révolution à venir reprendrait le vieux slogan de 1917 : Tout le pouvoir aux soviets. Elle pourrait aussi s'appuyer sur un syndicalisme réveillé et redevenu authentique. Enfin, elle ferait succéder à la stricte centralisation actuelle une fédération plus décentralisée : « Par un de ces paradoxes qui abondent dans l'histoire, c'est au nom des Soviets que risque de disparaître un régime faussement appelé soviétique. »
Cette conclusion rejoint celle d'un observateur de gauche, Georges Gurvitch, pour qui le succès possible, en U.R.S.S., des tendances vers la décentralisation et même vers l'autogestion ouvrière, bien que seulement amorcées, montrerait « que Proudhon a visé juste plus qu'on ne pouvait le croire».
A Cuba, ou l'étatiste « Che » Guevara a dû abandonner la direction de l'industrie, s'ouvrent peut-être de nouvelles perspectives. Dans un livre, René Dumont, spécialiste de l'économie castriste, vient d'en déplorer l’« hypercentralisation » et la bureaucratisation. Il a souligné, notamment, les erreurs « autoritaires » d'un département ministériel qui cherche à gérer lui-même les usines et qui aboutit au résultat exactement inverse : « A vouloir réaliser une organisation fortement centralisée, on finit pratiquement (...) par tout laisser faire, faute de pouvoir contrôler l'essentiel. » Même critique en ce qui concerne le monopole étatique de la distribution : la paralysie qui en résulte aurait pu être évitée « si chaque unité de production avait gardé la faculté de s'approvisionner directement». « Cuba recommence inutilement tout le cycle des erreurs économiques des pays socialistes » confia un collègue polonais, bien placé pour le savoir, à René Dumont. L'auteur conclut en adjurant le régime cubain d'en venir à l'autonomie des unités de production et, dans l'agriculture, à des fédérations de petites coopératives de production agricole. Il n'hésite pas à résumer d'un mot le remède au mal : l’autogestion, qui se pourrait concilier parfaitement avec la planification.
*
Ainsi l'idée libertaire est, depuis peu, ressortie du cône d'ombre où ses détracteurs la reléguaient. L'homme d'aujourd'hui, qui vient d'être, sur une large surface du globe, le cobaye du communisme étatique et qui émerge, encore à moitié étourdi, de cet « assommoir», se penche, soudain, avec une vive curiosité, le plus souvent avec profit, sur les esquisses de société nouvelle autogestionnaire que proposaient, au siècle dernier, les pionniers de l'anarchie. Il ne les accepte pas en bloc, certes, mais il y puise des enseignements, il s'en inspire pour tenter de mener à bien la tâche de cette seconde moitié du siècle : briser, sur le plan économique comme sur le plan politique, le carcan de ce qu'on a appelé, d'un mot trop approximatif, le « stalinisme», sans, pour autant, renoncer aux principes fondamentaux du socialisme — bien au contraire, en découvrant — ou en retrouvant — les formules d'un socialisme, enfin, authentique, c'est-à-dire conjugué avec la liberté.
Proudhon, en pleine Révolution de 1848, pensait sagement que c'eût été trop demander à ses artisans que d'aller, d'emblée, jusqu'à l'« anarchie», et, à défaut de ce programme maximum, il esquissait un programme libertaire minimum : désarmement progressif du pouvoir de l'État, développement parallèle des pouvoirs populaires par en bas, qu'il appelait les clubs, que l'homme du XXe siècle appellerait les Conseils. La recherche d'un tel programme semble être le propos, plus ou moins conscient, de nombre de socialistes contemporains.
*
Mais l'anarchisme, si une chance de renouveau lui est ainsi offerte, ne parviendra à se pleinement réhabiliter que s'il sait démentir, dans sa doctrine comme dans son action, les interprétations controuvées dont il a été trop longtemps l'objet. Impatient d'en finir avec lui en Espagne, aux alentours de 1924, Joaquin Maurin suggérait qu'il ne pourrait se maintenir que dans quelques « pays retardataires», au sein de masses populaires qui se « cramponnent » à lui parce que totalement dépourvues « d'éducation socialiste » et « livrées à leur impulsion naturelle», pour conclure : « Un anarchiste qui parvient à voir clair, à s'élever, à apprendre, cesse automatiquement d être anarchiste. »
Confondant, purement et simplement, « anarchie » et désorganisation, son historien en France, Jean Maitron, s'imaginait, il y a quelques années, que l'anarchisme était mort avec le XIXe siècle, car notre époque « est aux plans, à l'organisation, à la discipline». Plus récemment, le Britannique George Woodcock a cru pouvoir accuser les anarchistes d'être des idéalistes allant contre le courant dominant de l'histoire, se nourrissant de la vision d'un futur idyllique, tout en restant attachés aux traits les plus attrayants d'un passé en train de mourir. Un autre spécialiste anglais de l'anarchisme, James Joll, veut absolument que les anarchistes soient inactuels, car leurs conceptions seraient à l'opposé du développement de la grande industrie, de la production et de la consommation de masses et qu'elles reposeraient sur la vision romantique, rétrograde, d'une société idéalisée appartenant au passé, composée d'artisans et de paysans, enfin sur un rejet total des réalités du XXe siècle et de l'organisation économique.
Au long des pages qui précèdent, on a essayé de montrer que cette image de l'anarchisme n'est pas la vraie. L'anarchisme constructif, celui qui a trouvé son expression la plus accomplie sous la plume de Bakounine, repose sur l'organisation, sur l’autodiscipline, sur l'intégration, sur une centralisation, non pas coercitive, mais fédéraliste. Il prend appui sur la grande industrie moderne, sur la technique moderne, sur le prolétariat moderne, sur un internationalisme aux dimensions mondiales. A ce titre, il est de notre temps, il appartient au XXe siècle. Ce n'est pas lui, ce pourrait être, bien plutôt, le communisme d'État qui ne correspond plus aux besoins du monde contemporain.
Joaquin Maurin concédait, en 1924, en maugréant, qu'au cours de son histoire les « symptômes d'affaiblissement » de l'anarchisme avaient été « suivis d'un impétueux relèvement». Peut-être — l'avenir en jugera — est-ce seulement dans ce contravis que le marxiste espagnol avait été bon prophète.
Postface
La Révolution de Mai 1968 a été un grand coup de balai. Donné par la jeunesse, non seulement la jeunesse estudiantine mais, liée à elle en raison de la solidarité de l'âge et de la commune aliénation, la jeunesse ouvrière. A l'université comme à l'usine et au syndicat, la dictature des adultes en place, qu'ils fussent maîtres, patrons ou bonzes syndicaux, a été contestée, mieux : profondément ébranlée. Et cette explosion inattendue, surgie comme un coup de tonnerre, contagieuse et dévastatrice, a été, dans une large mesure, anarchiste.
Elle a eu pour origine une critique non seulement de la société bourgeoise mais du communisme post-stalinien s'approfondissant d'année en année dans le milieu universitaire. Elle a été nourrie, en particulier, par la déclaration de guerre du petit groupe « situationniste » à la Misère en milieu étudiant. Elle s'est inspirée de la rébellion étudiante en divers pays du monde et, notamment, en Allemagne.
Elle a pris pour armes l'action directe, l'illégalité délibérée, l'occupation des lieux de travail ; elle n'a pas hésité à opposer à la violence des forces de répression la violence révolutionnaire ; elle a tout remis en cause, toutes les idées reçues, toutes les structures existantes ; elle a répudié le monologue professoral comme le monarchisme patronal ; elle a mis fin au règne de la vedette, à la gloriole des signatures ; elle s'est voulue anonyme et collective ; elle a fait, en quelques semaines, le fulgurant apprentissage de la démocratie directe, du dialogue aux mille voix, de la communication de tous avec tous.
Elle a bu goulûment à la gargoulette de la liberté. Dans ses innombrables assises et forums de toutes sortes, chacun s'est vu reconnaître le droit de pleinement s'exprimer. Sur la place publique, transformée en amphithéâtre, car la circulation y était interrompue et les contestataires assis à même la chaussée, la stratégie de la guerre de rues à venir a été longuement, amplement et ouvertement discutée. Dans la cour, les couloirs et les étages de la Sorbonne, ruche révolutionnaire où quiconque pouvait pénétrer, toutes les tendances de la Révolution, sans exclusive, ont disposé de stands où s'étalaient leur propagande et leur littérature.
A la faveur de cette liberté conquise, les libertaires ont pu sortir de leur insularité antérieure. Ils ont combattu côte à côte avec les marxistes révolutionnaires de tendances « autoritaires», presque sans animosité réciproque, dans l'oubli, temporaire, des frictions du passé. Au moins pendant la phase ascendante de la lutte où tout était subordonné à la fraternisation contre l'ennemi commun, le drapeau noir s'est jumelé au drapeau rouge, sans compétition ni préséance.
Toute autorité a été honnie ou, pis encore, tournée en dérision. Le mythe du vieillard providentiel de l'Élysée a été moins sapé par le discours sérieux que pulvérisé par la caricature et par la satire : la chienlit c'est lui. Le moulin à paroles parlementaire a été nié par l'arme mortelle de l'indifférence : une des longues marches des étudiants à travers la capitale vint à passer, un jour, devant le Palais-Bourbon sans daigner même s'apercevoir de son existence.
Un mot magique a fait écho durant les glorieuses semaines de Mai 1968, dans les facultés comme dans les usines. Il a été le thème d'innombrables débats, de demandes d'explication, de rappels de précédents historiques, d'examens minutieux et passionnés des expériences contemporaines y relatives : l'autogestion. En particulier, l'exemple des collectivisations espagnoles de 1936 a été largement mis à contribution. Des ouvriers venaient le soir, à la Sorbonne, pour s'initier à cette nouvelle solution du problème social. Quand ils étaient de retour à l'atelier, des discussions s'ouvraient sur elle autour des machines immobilisées. Certes la Révolution de Mai 1968 n'a pas mis en pratique l'autogestion, elle s'est arrêtée au seuil, disons mieux : tout au bord. Mais l'autogestion s'est logée dans les consciences, et, en dépit de ses détracteurs, elle en resurgira tôt ou tard.
Bibliographie sommaire
Vu leur grand nombre il n'est pas possible de donner ici toutes les références des textes cités ou résumés.
On se bornera à suggérer au lecteur quelques indications bibliographiques.
Tout d'abord, un certain nombre de textes anarchistes épuisés ou inédits sont reproduits dans mon livre : NI
DIEU NI MAÎTRE, anthologie de l'anarchisme, 4 vol., 1970, Petite collection Maspero16 .
On pourra consulter également mon livre : POUR UN MARXISME LIBERTAIRE, 1969, Robert Laffont, éditeur.
ANARCHISME
Henri Arvon, L'Anarchisme, 1951.
Augustin Hamon, Psychologie de l’anarchiste-socialiste, 1895 ; Le Socialisme et le Congrès de Londres,
1897.
Irving L. Horowitz, The Anarchists, New York, 1964.
James Joll, The Anarchists, Oxford, 1964.
Jean Maitron, Histoire du mouvement anarchiste en France (1880-1914), 1955
Alain Sergent et Claude Harmel, Histoire de l'Anarchie, 1949.
George Woodcock, Anarchism, Londres, 1962.
Ettore Zoccoli, L'Anarchia, Milan, 1906.
STIRNER
Max Stirner, L’Unique et sa propriété, réed 1960 ; Keinere Schriften, Berlin, 1898.
Henri Arvon, Aux sources de l’existentialisme : Max Stirner, 1954.
PROUDHON
P.J. Proudhon, Œuvres complètes et Carnets, Ed. Rivière ; Manuel du spéculateur à la Bourse, 3e édition,
1857 ; La Théorie de la Propriété, 1865 ; Mélanges 1848-1852, 3 vol. 1868.
Goerges Gurvitch, Proudhon, 1965.
Pierre Haubtmann, thèses de doctorat (inédites) sur Proudhon.
BAKOUNINE
Michel Bakounine, Œuvres, 6 vol. éd. Stock ; Archives Bakounine, Leiden, 1961-1965, 4 vol. parus ; Correspondance de Michel Bakounine (éd. par Michel Dragomanov), 1896 ; Bakounine, La Liberté (morceaux choisis), 1965 ; Max Nettlau, Michael Bakunin, Londres, 1896-1900, 3 vol.
PREMIÈRE INTERNATIONALE
James Guillaume, L’Internationale, Documents et Souvenirs (1894-1878), 4 vol., 1905-1910 ; Idées sur
l’organisation sociale, 1876.
Jacques Freymond, La Première Internationale, Genève, 1962, 2 vol.
Miklos Molnar, Le Déclin de la Première Internationale, Genève, 1963.
César de Paepe, De l’organsiation des services publics dans la société future, Bruxelles, 1874.
Mémoires du district de Courtelary, Genève, 1880.
COMMUNE DE 1871
Bakounine, La Commune de Paris et la notion de l’État, 1871.
Henri Lefebvre, La Proclamation de la Commune, 1965.
O.H. Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, rééd., 1964.
Karl Marx, La guerre civile en France, 1871.
KROPOTKINE
Pierre Kropotkine, Œuvres diverses.
Woodcock et Avakoumovitch, Pierre Kropotkine le prince anarchiste, trad. fr. 1953. Article dans le Journal de l’université de Moscou, n°1, 1961.
MALATESTA
Malatesta, Programme et organisation de l’Association Internationale des Travailleurs, Florence, 1884,
reproduit dans Studi Sociali, Montevideo, mai-novembre 1934.
Errico Malatesta, L’Anarchie, Paris, 1929.
SYNDICALISME
Pierre Besnard, Les Syndicats ouvriers et la révolution sociale, 1930.
Pierre Monatte, Trois Scissions syndicales, 1958.
Fernand Pelloutier, « L’anarchisme et les syndicats ouvriers», Les Temps Nouveaux, 1895 ; Histoire des
Bourses du Travail, 1921.
Émile Pouget, Le Syndicat (s. d.) ; Le parti du travail, rééd, 1931 ; Ad Memoriam, 1931.
Congrès anarchiste tenu à Amsterdam..., 1908.
Ravachol et les anarchistes, ed. Maitron, 1964.
RÉVOLUTION RUSSE
Pierre Archinoff, Histoire du mouvement makhnoviste, 1928.
Alexandre Berkman, La Révolution russe et le Parti communiste, 1921 ; The Bolshevik Myth (1920-1921),
1922 ; The Russian Tragedy, Berlin, 1922 ; The Kronstadt Rebellion, Berlin, 1922 ; The Anti-Climax, Berlin,
1925.
Isaac Deutscher, Trotsky, 3 vol., 1963-1965.
Luigi Fabbri, Dittatura e Rivoluzione, Milan, 1921.
Ugo Fedeli, Dalla Insurrezione dei contadini in Ucraina alla Rivolta di Constadt, Milan, 1960.
Emma Goldman, Les Bolcheviks et la Révolution russe, Berlin, 1922 ; My disillusion in Russia ; My further
disillusion with Russia, N.Y., 1923 ; Living my Life, N.Y. 1934 ; Trotsky protests too much, N.Y., 1938.
Alexandra Kollontaï, L’Opposition ouvrière, 1921, rééd. in « Socialisme ou Barbarie», n°35, 1964.
M. Kubanin, Makhnoshchina, Leningrad, s. d.
Lénine, L’État et la Révolution, 1917 ; Sur la Route de l’Insurrection, 1917 ; La Maladie infantile du
communisme, 1920.
Gaston Leval, « Choses de Russie», Le Libertaire, 11-18 novembre 1921 ; Le Chemin du socialisme, les
débuts de la crise communiste bolchevique, Genève, 1958.
Nestor Makhno, La Révolution russe en Ukraine, 1927 (vol I.) ; id. (en russe), 3 vol.
G.P. Maximoff, Twenty years of Terror in Russia, Chicago, 1940.
Ida Mett, La Commune de Cronstadt, 1938, nouv. éd. 1948.
A. Pankratova, Les comités d’usine en Russie (...), Moscou, 1923.
Rudolf Rocker, Die Bankrotte des russischen Staatskommunismus, Berlin, 1921.
Georges Sadoul, Notes sur la Révolution bolchevique, 1919.
Léonard Shapiro, Les bolcheviks et l’Opposition (1917-1922), 1957.
I. Stepanov, Du contrôle ouvrier à l’administration ouvrière (...), Moscou, 1918.
Trotsky, 1905, rééd. 1966 ; Histoire de la Révolution russe, rééd., 1962.
Victor-Serge, L’an I de la Révolution russe, rééd. 1965.
Voline [Vsévolod Mikhailovich Eichenbaum], La Révolution inconnue 1917-1921, 1947.
E. Yartciuk, Kronstadt, Barcelone, 1930.
St Antony’s Papers n°6 (sur Cronstadt et Makhno), Oxford, s. d.
Répression de l’anarchisme en Russie soviétique, 1923.
CONSEILS
Antonio Gramsci, L’Ordine Nuovo 1919-1920, 1954.
Hermann Gorter, Réponse à Lénine, 1920. éd. 1930.
Pier Carlo Masini, Anarchici et communisti nel movimiento dei Consigli, Milan, 1951 ; Antonio Gramsci e
l’Ordine Nuovo visti da un libertario, Livourne, 1956 ; Gli anarchici italiani e la rivoluzione russa, 1962.
Erich Müsham, Auswahl, Zurich, 1962.
Anton Pannekoek, Workers Councils, rééd. Melbourne, 1950.
Paolo Spriano, L’occupazione delle fabbriche septembre 1920, turin, 1964.
RÉVOLUTION ESPAGNOLE
Burnet Bolloten, The Grand Camouflage, Londres, 1961.
Franz Borkenau, The Spanish Cockpit, Londres, 1937, rééd. University of Michigan Press, 1965.
Gerald Brenan, Le Labyrinthe espagnol, tad. fr., 1962.
Pierre Broué et Émile Témine, La Révolution et la guerre d’Espagne, 1961.
Gaston Leval, Problemas economicas de la Revolución social española, Rosario, 1931 ; Ne Franco Ne Stalin,
Milan, 1952.
Joaquin Maurin, L’anarcho-syndicalisme en Espagne, 1924 ; Révolution et contre-révolution en Espagne,
1937.
G. Munis, Jalones de Derrota (...), Mexico, 1946.
José Peirats, La C.N.T. en la Revolución española, 3 vol., 1958 ; Los anarquistas en la crisis politica
española, Buenos Aires, 1964.
Angel Pestaña,1°) Memoria... 2°) Consideraciones... (2 rapports à la C.N.T.), Barcelone, 1921-1922 ; Setenta
dias en Russia, Barcelone, 1924.
Dr Isaac Puente, El communismo libertario, 1932.
Henri Rabasseire, Espagne creuset politique, sd.
Vernon richards, Lessons of the Spanish Revolution, Londres, 1953.
D.A. de Santillan, El organismo economico de la Revolución, 1936 ; La Revolución y la guerra en España,
1938.
Trotsky, Écrits, t. III, 1959.
El Congresso confederal de Zaragoza, 1955.
Collectivisations, l’œuvre constructive de la Révolution espagnole, trad. fr., 1937, rééd. 1965.
Les Cahiers de « Terre libre », avril-mai 1938.
Collectivités anarchistes en Espagne révolutionnaire, Noir et Rouge, mars 1964 ; Collectivités espagnoles,
idem, n° 30, juin 1965.
AUTOGESTION CONTEMPORAINE
Stane Kavcic, L’autogestion en Yougoslavie, 1961.
Albert Meister, Socialisme et Autogestion, l’expérience yougoslave, 1964.
Les Temps Modernes, numéro de juin 1965
©opyleft
1 « La Science et la tâche révolutionnaire urgente», Kolosol, Genève, 1870.
2 Sans nommer Stirner, donc il n'est pas certain qu'il l'ait lu.
3 A comparer avec les décrets de mars 1963 par lesquels la République algérienne a institutionnalisé l'autogestion, à l'origine création spontanée de la paysannerie. La ventilation — sinon la fixation de pourcentages — entre les divers fonds prévus est à peu près la même et le dernier quart, « à partager entre les travailleurs», n'est autre que le « reliquat » qui, en Algérie, a suscité des controverses.
4 La même discussion dans la Critique du programme de Gotha (rédigée par Karl Marx en 1875, publiée seulement en 1891).
5 Une branche de l'Internationale, en suisse romande, qui avait adopté les idées de Bakounine.
6 Quand, en janvier 1937, dans une conférence publique à Barcelone, Frederica Montseny, ministre anarchiste, porta aux nues le régionalisme de Pi y Margall, Gaston Leval lui reprocha d’être peu fidèle à Bakounine.
7 Robert Louzon fait observer à l’auteur du présent livre que, d'un point de vue dialectique, les deux témoignages, celui de Pelloutier et le sien, ne s’excluent nullement : le terrorisme a eu pour le mouvement ouvrier des effets contradictoires.
8 La discussion entre anarcho-syndicalistes sur les mérites respectifs des conseils d'usine et des syndicats ouvriers n'était, d'ailleurs, pas une nouveauté : elle venait, en Russie, de départager les anarchistes et avait même provoqué une scission au sein de l'équipe du journal libertaire Golos Truda, les uns restant fidèles au syndicalisme classique, les autres, avec G. P. Maximoff, optant pour les conseils.
9 Le K.A.P.D. devait constituer, en avril 1922, avec les groupes d’opposition néerlandais et belge une « Internationale ouvrière ouvrière».
10 En France, les syndicalistes de la tendance Pierre Besnard qui, exclus de la Confédération Générale du Travail Unitaire (C.G.T.U.), formèrent, en 1926, la Confédération Générale du Travail Syndicaliste Révolutionnaire (C.G.T.S.R.).
11 En Castille, dans les Asturies, etc. prédominait une Centrale Syndicale social-démocrate, l'Union Générale des Travailleurs (U.G.T.).
12 Ce fut seulement en 1931 que la C.N.T. décida la création de fédérations d’industrie, repoussée en 1919, dont les « purs » de l’anarchisme appréhendaient la propension au centralisme et à la bureaucratie ; mais il était devenu indispensable de répondre à la concentration capitaliste par la concentration des syndicats d’une même industrie. Il fallut attendre 1937 pour que de grandes fédérations d’industrie fussent réellement structurées.
13 L'Association Internationale des Travailleurs, à laquelle était affiliée la C.N.T., tint à Paris un congrès extraordinaire, les 11-13 juin 1937, où la centrale anarcho-syndicaliste fut blâmée pour sa participation gouvernementale et les concessions qui en avaient été la conséquence. Ainsi couvert, Sébastien Faure se décida à publier, dans Le Libertaire des 8, 15 et 22 juillet, sous le titre « La pente fatale», des articles sévères pour le passage au gouvernement des anarchistes espagnols. Mécontente, la C.N.T. provoqua la démission du secrétaire de l' A.I.T, Pierre Besnard.
14 On écrit « en principe», car il y eut à ce sujet des litiges entre villages.
15 Toutefois, dans les localités du Sud qui n'étaient pas contrôlées par des anarchistes, les appropriations de grands domaines opérées autoritairement par des municipalités ne furent pas ressenties par les journaliers comme une mutation révolutionnaire : leur condition salariale ne fut pas changée ; il n'y avait pas autogestion.
16 Réédité aux éditions de La Découverte en deux tomes.