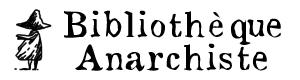Adolphe Retté
Promenades subversives
La magistrature est le trait d’union entre la féodalité bourgeoise et son ultima ratio : la guillotine.
⁂
Idées en faveur chez les Bourgeois : quintessences frelatées de consensus omnium.
⁂
Ce que les Bourgeois appellent la Morale, c’est le droit à l’hypocrisie.
⁂
Quand les Maîtres commencent à s’apitoyer sur leurs esclaves, ils sont perdus. − Quand les Bourgeois parlementaires votent des lois de « protection pour les ouvriers », c’est qu’ils ont peur.
⁂
Voir les choses sous leur vrai jour ; dire, par exemple, que les soldats sont des assassins à gages inconscients c’est, suivant les Bourgeois, « saper les bases de la Société. » On vous met en prison pour cela.
⁂
Lu ce règlement affiché au mur des cellules de Mazas : « Défense de siffler et de chanter même à voix basse. » La prison est une cage où l’on défend aux oiseaux de chanter.
⁂
« Vous avez le droit de vous mettre en grève » disent les Bourgeois aux ouvriers. « Très bien, répondent les ouvriers des manufactures de l’Etat, comme nous crevons un peu de faim, nous allons nous mettre en grève. » − Pardon, reprennent les Bourgeois, vous autres vous n’êtes plus des ouvriers, vous êtes des fonctionnaires. Nous allons faire une loi qui vous interdise la grève au nom de la liberté des gens qui veulent circuler sur le chemin de fer, acheter des allumettes ou des armes à feu ou du tabac. » − « Mais alors, nous, nous ne sommes plus libres ? » disent les ouvriers. « Vous êtes libres de vous en aller si nos règlements ne vous conviennent pas. » − « Et manger ? » objectent les ouvriers. « Cela ne nous regarde pas » répondent les Bourgeois.
⁂
Des ouvriers se mettent en grève. Le fils de leur patron leur tire un coup de fusil chargé avec du gros plomb et en blesse cinq. Coût : 100 fr. d’amende avec application de la loi Bérenger. − (Affaire récente à Avesnes). Deux employés des omnibus engagent leurs camarades à résister à la Compagnie. Coût six et huit mois de prison, sans loi Bérenger. Les Bourgeois trouvent cela fort judicieux.
⁂
Un Simple tue l’homme qui symbolise la Bourgeoisie et cette bizarre mécanique qu’elle intitule en son patois : le jeu régulier des institutions parlementaires. Il a frappé au nom d’une Idée, qu’il comprenait plus ou moins bien − on le guillotine.
Un Homicide professionnel massacre beaucoup de nègres au nom de la civilisation. On lui plante sur la tête un bouquet de plumes blanches et on lui attache sur la poitrine une amulette en émail. Et les patriotes de la tribu dansent autour du totem.
Dialogue entendu au moment de la mort d’Alexandre III.
− L’un disait « À cause de la décomposition récente d’une charogne illustre, les gens ont arboré à leurs fenêtres des morceaux d’étoffe peints crûment en trois couleurs ; puis il les ont roulés autour d’un bâton surmonté d’une losange de cuivre et d’une petite loque de crêpe noir… C’est curieux. »
L’autre répondit : « Ce sont les totems de deuil. La tribu pleure le Grand-Sauvage des Kalmoucks. »
⁂
Les socialistes parlementaires disent : « le totem en trois couleurs ne vaut rien. Voici un totem rouge qui est bien plus beau. Aidez-nous à « faire la conquête des pouvoirs publics », nous vous le donnerons. »
⁂
Les Anarchistes disent : « Tas de sauvages, combien de temps encore vous laisserez-vous leurrer avec des morceaux d’étoffe bariolés ? »
⁂
Le fils d’un gros industriel millionnaire met en vente une propriété. « Sans doute, lui dit quelqu’un, vous avez beaucoup travaillé pour acquérir cette propriété ? » L’autre répond : « C’est mon père qui me l’a léguée. Moi je ne travaille pas. » Et les assistants l’envient. Entendant cela, le fils d’un voleur met en vente de l’argenterie prise par son père au gros industriel. Le fils du millionnaire la voit et s’écrie : « Ceci est à moi, d’où le tenez-vous ? » Et le fils du voleur répond : « C’est mon père qui me l’a léguée. » Les assistants le mènent chez le commissaire.
⁂
Quand les Sauvages d’Afrique ont remporté une victoire, ils se réjouissent. S’ils sont vaincus, ils se tapissent dans leurs cases et pleurent. Quand les Sauvages d’Europe ont subi une défaite, ils élèvent des monuments à leurs morts, et ils viennent périodiquement y suspendre des couronnes. Ils s’écrient : « Gloire au vaincu ! » et ils boivent de l’alcool. On appelle cela : une pieuse cérémonie patriotique.
⁂
Du moment que les Bourgeois admettent qu’il est des cas où l’on a le droit et même le devoir de tuer son prochain, ils reconnaissent implicitement qu’on a le droit de les tuer eux-mêmes.
⁂
Traductions d’aphorismes bourgeois. Obéir à la loi = se soumettre au bon plaisir d’autrui. Faire des affaires = voler autrui. Aimer sa Patrie = détester quiconque s’habille autrement que vous et parle une autre langue. Avoir des espérances = désirer la mort de ses proches. Un gouvernement fort = une bande d’aigrefins à poigne. Attendre tout de réformes progressives et modérées = ayant soif, verser de l’eau dans un tamis et attendre qu’elle y séjourne pour se désaltérer. Question sociale = mauvaise conscience des Bourgeois. C’est un original = c’est un homme qui pense par lui-même. C’est un fou = c’est un homme qui raisonne juste. Les ouvriers sont des fainéants qui deviennent importuns = les esclaves sont las d’avoir faim. M. Untel a eu, dit-on, quelques démêlées jadis avec la justice, mais il est très riche et reçoit fort bien = C’est un filou qui a réussi ; tâchons de l’imiter. Certains individus = les Anarchistes. La Justice = l’Iniquité.
⁂
Les journaux — parangons d’honnêteté et de bonne foi comme on sait — se sont tous fort indignés contre les gens du Panama — et auparavant ils ont tous publié, moyennant finances, les réclames de cette association de malfaiteurs bien rentés.
⁂
Quand un quotidien vante quelque chose ou quelqu’un avec insistance, prenez le contre-pied de ses assertions, vous serez à peu près sûr d’être dans le vrai.
⁂
Journal complètement indépendant signifie : consciences à vendre.
⁂
Où en est une race quand elle se glorifie de posséder des engins de destructions de plus en plus perfectionnés ?
⁂
Lors de l’affaire Turpin, cet état d’esprit se vérifia ! « Turpin veut donner sa mitrailleuse aux Allemands ! — Le misérable !… Turpin nous donne sa mitrailleuse ! — Le grand homme ! »
⁂
Les anarchistes disent : « Tas d’insensés, quand cesserez-vous de vous massacrer les uns les autres. »
⁂
C’est parce que les hommes ont peur d’eux-mêmes que la Propriété individuelle peut se maintenir avec son symbole l’Autorité. Celui qui a conscience de soi-même, qui n’a pas peur de raisonner voit l’ordure de l’une et de l’autre.
⁂
Quiconque vote se reconnaît incapable de se conduire soi-même. Quiconque obéit, sans répugnance, aux gouvernants qu’il se donna, ressemble à un mouton qui viendrait s’offrir bénévolement au couteau du boucher.
⁂
Se résigner, par abnégation, c’est pire encore. Cela ravale l’homme au rang de fakir ou de bétail ahuri. Le comble de l’art gouvernemental consiste à inculquer cette résignation au nom d’un Bon Dieu. De là, l’utilité des prêtres.
⁂
Les habitudes métaphysiques ont amené à faire du terme Société une entité antagonique à l’individu. Quiconque veut diriger, gouverner, régir, invoque le salut de la Société pour empêcher la libre expansion des individus — comme si chacun ne pouvait trouver en soi ce qui convient le mieux à son développement. Grâce au dogme Société, les individus ont tellement pris le pli d’obéir qu’ils se laisseraient toujours dépouiller par les Habiles qui leur vantent « l’intérêt général » si des Révoltés ne se levaient pour leur apprendre ceci : « Rien ne doit prévaloir contre la liberté individuelle. »
⁂
Que nul ne soit contraint, fut-ce au nom de la majorité, que nul ne contraigne, fut-ce au nom de sa science — voilà la liberté selon la raison.
⁂
On dit : « Mais la plupart des hommes ne savent pas raisonner. » Laissez-les libres, ne leur imposez rien, ils apprendront à raisonner par leur propre expérience. Aujourd’hui, il n’en va pas ainsi. — Au collège, qui est mal noté ? le Raisonneur. Au régiment, de même. Dans les administrations, aussi — et partout, dans la vie telle qu’elle nous est faite. C’est parce que le Raisonneur est celui qui veut se rendre compte. Cette qualité lui vaut les tracasseries d’autrui — et sa propre satisfaction.
⁂
Le sentiment de justice c’est l’instinct de sauvegarde individuelle élargi : si je moleste mon voisin, je lui donne un prétexte de me molester à son tour. Il y entre aussi une part d’esthétique : la souffrance est laide. Si mon voisin souffre, cela me déplaît, cela me donne l’impression d’un manque d’harmonie. Ne pas tolérer qu’il ait faim alors que je suis rassasié, ne pas admettre qu’il soit esclave alors que je suis libre, c’est me faire plaisir à moi-même.
⁂
On parle toujours des paresseux. Il n’y a de paresseux que dans une société où le bien commun est mal réparti, les uns possédant tout sans avoir travaillé, les autres, rien bien qu’ils travaillent sans cesse, il en résulte que le travail est considéré comme une souffrance par ceux-ci, comme une dégradation par ceux-là. Mais laissez le bien commun à la disposition de tous, vous verrez les individus travailler avec plaisir à augmenter leur bien-être et laisser le surplus de ce qu’ils auront produit à autrui dès que leurs besoins seront satisfaits.
⁂
Le travail c’est l’action. Or, l’homme ne se porte bien que lorsqu’il agit. — Et quand il agit, il est heureux.
⁂
Rien de plus curieux que les revirements de cette caste bourgeoise : la gent-de-lettres. Naguère, comme il était bien porté de se donner des allures subversives, beaucoup de la jeune littérature prônaient volontiers l’anarchisme, réclamaient la Révolution. Bientôt, à cause de certains incidents bruyants — et justifiés, cette ferveur tomba. Il devenait impolitique d’afficher de telles explosives opinions. Alors la plus grande prudence remplaça cette mode de se dire révolté. Les plus adroits insinuèrent « qu’on allait trop loin », que « l’aristocratie de la pensée ne pouvait admettre aucune alliance avec les grossières revendications d’un imbécile prolétariat », que « l’anarchie, bonne en tant que prétexte à dilettantisme, ne valait rien en application », que « les intellectuels se devaient de vivre dans le monde supérieur de l’art »…
Pauvres « intellectuels », que ferez-vous donc le jour où la Révolution éclatera pour de bon ?…
Les poltrons, eux, déclarèrent que leur humanité souffrait trop de ces abominables désordres. Ils tirèrent leur épingle du jeu et se tinrent cois jurant qu’on ne les reprendrait plus à plaindre les Pauvres. Il y eut aussi ceux qui se targuèrent de leurs efforts antérieurs pour ne plus bouger.
Cependant les sincères, minorité infime, ne variaient pas et combattaient de plus belle pour l’Idée qui les avait conquis. — Aussi furent-ils traités de fous, de naïfs ou, mieux encore, de malins qui cherchaient à se distinguer, à « ne pas dire comme tout le monde » afin de conférer à leurs écrits un cachet de singularité.
Belle folie qui consiste à rester honnête vis-à-vis de soi-même. Louable naïveté qui, ayant adopté un idéal, ne le tient pas pour un sujet de dialectique mais bien pour une règle d’existence. Et puis ces étranges Malins ne récoltent que des injures, des calomnies, les tracasseries policières, la haine et le dédain des vieilles prostituées qui font du sentiment et se pavanent en vedette sous la lanterne à gros numéro des feuilles publiques, le mauvais-vouloir des chers confrères — et aussi l’estime des esprits courageux. Tels quels, ils sont tranquilles et confiants dans la justice de l’avenir.
⁂
Il y a quelque chose de plus étonnant que l’hypocrisie des bourgeois, c’est la résignation des pauvres. On dirait que ceux-ci goûtent de profondes jouissances à se laisser piler et piller…
Pourtant, ne pas trop s’y fier. Sous le nuage qui les couvre, on commence à entendre de sourds grondements. L’orage approche.
⁂
Rien désormais ne peut empêcher la révolution sociale d’éclater. Aveugle qui ne la voit pas venir.
⁂
Une des causes les plus déterminantes de la révolution, ce sera le machinisme. Nous assistons en effet à ce singulier phénomène : la machine produisant davantage et en moins de temps que le travail manuel devrait être un moyen de développer le bien-être général. Or, grâce au régime de propriété individuelle, il en va tout autrement. À mesure qu’une nouvelle machine est inventée qui permet de produire plus vite, beaucoup et avec moins d’efforts, les salariés qu’elle supplée voient leur salaire, déjà insuffisant, se réduire encore — à moins qu’on ne les congédie. Mal rétribués ou mis sur le pavé, ils consomment moins. Et, comme ils sont le plus grand nombre, on aboutit à ce bizarre résultat que : plus la production augmente, plus la consommation diminue. En outre, la concurrence entre salariés, se portant sur un nombre d’emplois beaucoup moindre, devient de plus en plus désespérée. Déjà dévorés par les riches qui jetteraient leurs marchandises à l’eau plutôt que de leur abandonner le surplus de la production, ils se dévorent encore entre eux. Et naturellement, chaque jour, le nombre des sans-travail augmente.
Ce fait de salariés réduits à la mendicité par un instrument de richesse eut lieu récemment pour les cordonniers d’Angers, les tisserands de Verviers et les allumettiers de Pantin. — Le cas de ces derniers présente une particularité comiquement sinistre : rongés par la nécrose, ils demandaient qu’on substituât aux ingrédients nocifs qui les décimaient d’autres ingrédients inoffensifs employés d’ailleurs à peu près partout sauf en France. On leur promit de faire droit à leur juste demande, on les flatta, on les caressa, on fit appel à leur patriotisme, on les détermina à reprendre le travail. Quand ils furent rentrés dans leurs ergastules, on y installa des machines dont le maniement exigeait un personnel infiniment moins nombreux — et on les congédia en masse…
Ils ne sont pas encore revenus de leur stupéfaction — d’autant que Mossieur le Ministre d’alors, un vieux Panama du nom de Ribot avait daigné distribuer… des poignées de mains à leurs délégués.
⁂
Sans doute l’ignorance, la domestication, la timidité des Pauvres sont bien invétérées. Cependant ils commencent à comprendre qu’on les berne. Ils commencent à voir que les machines pourraient produire largement pour tous. Bientôt au lieu de faire la grève des « bras croisés », c’est-à-dire d’entamer la lutte du sou contre le milliard, ils feront la Grève Générale. Ils s’empareront des moyens de production ; ils rendront à tous ce qui appartient à tous, d’après la formule de l’avenir : à chacun selon ses besoins.
⁂
La Bourgeoisie ne cédera qu’à la force. Plutôt que d’abandonner un seul de ses privilèges, elle aura recours à tous les moyens : recrudescence de la syphilis patriotique, guerres lointaines ou guerres entre voisins.
Ce dernier expédient pourrait bien se retourner contre elle si elle y a recours en désespoir de cause. Il est, en effet, fort probable que la défaite amènera chez le vaincu un bouleversement social un peu plus sérieux que la Commune de 1871 — et peut-être aussi chez le vainqueur.
⁂
La colonisation peut se définir : la dépossession brutale pratiquée à l’encontre d’une race plus faible par une race mercantile et conquérante, celle-ci apportant en retour aux vaincus les bienfaits d’une civilisation marquée par l’alcoolisme, le militarisme et la syphilis.
Pour célébrer nos récentes « victoires » à Madagascar, on éleva des arcs de triomphe, on se soûla, on exalta nos héroïques troupiers. Il y avait lieu, en effet, de manifester beaucoup d’enthousiasme : 300 millions dépensés tout d’abord, 57 soldats tués à coups de fusil par les Malgaches, 7.000 tués par la fièvre et la dysenterie. 3.000 revenus bons pour la réforme et désormais incapables de gagner leur vie. Les dividendes de deux ou trois grosses maisons commerciales augmentés dans une notable proportion…
Du coup, maints journalistes se sont précipités, en sanglotant d’allégresse, dans les bras de l’Invalide à la tête de bois.
⁂
Quand le peuple comprendra-t-il qu’il n’est nullement glorieux d’aller crever de la peste et de la diarrhée sous un climat atroce pour que prospèrent quelques Ventres considérables ?
⁂
J’ai fait partie cinq ans de cette « école de l’honneur, des bonnes mœurs et de l’abnégation » qu’on appelle l’armée. Voici une partie de ce que j’ai vu : deux maréchaux des logis chefs, un adjudant vaguemestre et un capitaine-trésorier condamnés pour vol. Un grand nombre de gradés vivant aux crochets de femmes en cartes ou vendant leur protection aux soldats fortunés. La pédérastie et la masturbation fort répandues. — Un homme de mon peloton était entretenu par un fonctionnaire de la ville. Il s’en vantait et beaucoup l’enviaient. Un autre homme, atteint de la typhoïde, agonisa trois jours dans son lit sans que le médecin-major daignât se déranger bien qu’on l’eut réclamé trois fois. Il vint à la fin et fit transporter le malade à l’hôpital. L’homme mourut en arrivant. Trois malades, non reconnus comme tels par le médecin, traités de carottiers, mis à la salle de police en plein hiver, morts à la suite. — Une nourriture infecte et insuffisante. Les soldats affamés se volaient leur pain les uns les autres.
L’état d’esprit qui prédominait était celui-ci : chez les officiers, en dehors des manœuvres, la fainéantise avachie sur des banquettes de café et le jeu. Chez les soldats : l’ennui profond, la conscience de faire une besogne inutile — l’un et l’autre journellement exprimés par des phrases lugubres d’exaspération — l’impatience fébrile de se voir libérés. Pour distractions : des soûleries furieuses et des coups distribués aux civils tenus pour des inférieurs bons à exploiter et à tarabuster. Cela fort encouragé par maints officiers comme susceptible de développer l’esprit militaire. Toute occupation intellectuelle tenue en mépris. De celui qui lisait, l’on disait : « Tiens, Untel est en train de s’abrutir ! » — Ce régiment n’était ni pire ni meilleur que tous les autres. Quiconque a passé par l’armée dira que je n’exagère rien.
⁂
Il y a d’honnêtes citoyens, bons père et bons époux qui trouvent tout naturel qu’on apprenne à leurs enfants l’art d’assassiner autrui. Quand ils voient piétiner autour de la loque tricolore quelques bestiaux à massacre, leur poitrine se gonfle d’une « noble émotion patriotique » — et les Coppée sentent « se hérisser le bonnet à poils qu’ils ont dans le cœur. »
⁂
En somme, le militarisme sert à former des individus brutaux, féroces, lubriques, ivrognes, ignorants et paresseux.
⁂
Les bourgeois vantent volontiers la prospérité de notre état social. Cette prospérité est tellement évidente qu’en France seulement il y a 500.000 vagabonds (statistiques officielles) sans compter ceux qu’on ne connaît pas. Chaque année, 90.000 personnes meurent de faim — à la lettre (statistiques officielles) sans compter ceux qu’on ne connaît pas. Les salaires baissent tous les jours dans presque toutes les branches de l’industrie, mais quelques industriels font de grosses fortunes. La natalité diminue dans une proportion constante. L’alcoolisme gagne sans cesse. Les crimes de toutes sortes augmentent et les impôts aussi. La population ouvrière s’atrophie.
Cependant on tente des remèdes. Les parlementaires ont nommé une commission du travail qui a nommé quatre sous-commissions, lesquelles ont rédigé trois mille rapports. — Sur quoi, l’on a déclaré que les grrrandes réformes commenceraient un de ces jours, quand on aurait le temps et qu’on ne serait pas trop absorbé par la dispute des portefeuilles. Les socialistes, eux, ont ouvert des magasins où l’on vend le savon des Trois-Huit, le chocolat des Trois-Huit, etc.
Il y a aussi le conseil général d’Indre-et-Loire qui propose de déporter sans jugement quiconque est assez impertinent pour ne pas avoir de domicile.
Et puis la justice — ou du moins la chose qu’on affuble de ce sobriquet — opère. On a condamné Cyvoct à mort pour un article de journal qu’il n’avait pas écrit. Après une réflexion, on se contenta de l’envoyer au bagne perpétuel. Et comme il avait l’audace de demander sa grâce, on la lui refusa vertement. On a condamné Girier-Lorion, malfaiteur de dix-huit ans, à vingt ans de travaux forcés sur une dénonciation reconnue calomnieuse après coup. À Cayenne, à la suite du guet-apens d’octobre 1894 où l’on massacra plusieurs anarchistes déportés, quoique n’ayant nullement pris part à la révolte provoquée par les moutons et les gardiens. Lorion fut condamné à mort. Son avocat demanda sa grâce. On lui fit attendre la réponse huit mois. Pendant ces huit mois Lorion fut enfermé, les fers aux pieds et aux mains dans une étroite cellule sans air et sans lumière et où il gisait à même la terre boueuse. Sa condamnation a été commuée en cinq ans de détention à faire dans ladite cellule. Ses lettres à son avocat ont été publiées : elles donnent le frisson. — Lorion et Cyvoct avaient le tort grave d’être anarchistes.
La justice militaire vaut mieux encore. Le soldat Chédel est garrotté, bâillonné, privé de nourriture et d’eau, battu, torturé pendant huit jours par un sergent et un officier. Il meurt. Les bourreaux passent en conseil de guerre. Acquittés.
Le soldat Cheymol, souffrant, ne pouvant plus suivre la colonne dont il faisait partie, est attaché à la queue du cheval d’un spahi, roué de coups de matraque. Il meurt. Le médecin-major, chargé de faire une enquête, déclare gravement que Cheymol a succombé à une congestion pulmonaire.
⁂
Cependant on dépense un million pour galonner les larbins officiels chargés d’aller lécher les pieds du khan des kalmouks, empereur de toutes les Russies, à son couronnement. Et les feuilles publiques ruissellent de larmes enthousiastes.[1]
⁂
Ce qui écarte de l’Anarchie beaucoup d’esprits mous, même de ceux qui vous disent tout bas d’un air effaré : « Croyez que je sympathise avec vous » — c’est l’effroi de marcher sans lisières. L’hérédité servile, d’une part, les règles auxquelles ils se plient, d’autre part, leur ont faussé l’entendement. Ce sont des arbres noués : ils ne peuvent que végéter — non se développer — que grâce à un tuteur. C’est avec eux que les Sauvages de gouvernement bâtissent leurs palissades. Ce sont eux qui suivent les totems. Ce sont eux qui entravent. Ils approuvent, votent, saluent, subissent.
Ceci est une partie du raisonnement. — Emile Henry, en sa déclaration, a conclu.
⁂
Avant que les soldats exécutent la sentence prononcée par les juges, des prêtres vinrent obséder Paulino Pallas. Ils lui vantèrent certaines amulettes et pratiques superstitieuses qu’ils nommaient : les sacrements. Ils le menacèrent du courroux d’une idole qu’ils appelaient le Bon Dieu. Ils lui représentèrent que s’il persistait dans son endurcissement, son corps ne serait pas mis en terre mais bien jeté à la voirie parmi les cadavres des infâmes et des animaux immondes. Sa femme et ses enfants vinrent aussi le supplier, en pleurant, de croire aux prêtres. Mais Paulino Pallas répondit à tous : « Pour moi, la terre sainte, c’est l’univers entier. »
Les prêtres, l’ayant maudit, se retirèrent alors. Et les soldats survinrent qui le tuèrent aussitôt.
⁂
L’Anarchie est le signe évident d’un développement de fonctions intellectuelles jusqu’à présent rudimentaires dans l’espèce : esprit de justice, logique, volonté. C’est elle qui sortira l’homme définitivement de l’animalité.
⁂
On dit aux Anarchistes : « Vous n’êtes pas nombreux. »
Ils répondent : « Prouvez-nous que nous avons tort. »
— Vous serez écrasés…
— Prouvez-nous que nous avons tort.
— Déportés ! Fusillés ! !
— Prouvez-nous que nous avons tort.
— Mais quels sont vos moyens d’action ?
— Crois en toi-même. Prends selon tes besoins, donne selon tes forces. Tous pour un, un pour tous.
— Vous avez raison : c’est bien beau… On vous suivrait volontiers si cela ne devait mal finir pour vous.
— Qu’importe la fin, puisque nous avons raison.
[1] Résultat immédiat et symbolique de ce couronnement : 3.000 morts, 4.000 blessés.