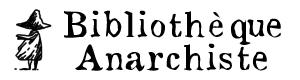L’Encyclopédie anarchiste — D
D
Historique — Les précurseurs de Darwin — Son œuvre
Après le Darwinisme. Neo-Lamarckiens et Neo-Darwiniens. Essor donné aux sciences biologiques.
Fausse interprétation du Darwinisme. La sélection à rebours.
Derniers échos de la croisade contre le Darwinisme. L’affaire Scopes.
DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN (Déclarations des)
III. DÉCLARATION DE L’AN I (OU DE 1793) :
IV. DÉCLARATION DE L’AN III (OU DE 1795) :
DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN (Ligue française pour la défense des)
DANSE
Le Dictionnaire de l’Académie Française définit ainsi la danse : « Mouvement du corps qui se fait en cadence, à pas mesurés et ordinairement au son des instruments ou de la voix ». Définition médiocre, qu’on retrouve à peu près dans les mêmes termes dans tous les dictionnaires, elle décrit sèchement la mécanique de son objet mais en laisse ignorer complètement le caractère. Larive et Fleury, en la répétant, ont cependant ajouté que la danse est « l’expression particulière de la sentimentalité » et « l’expansion naturelle de la joie et de la gaieté ».
Le véritable caractère de la danse est indiqué par M. Zaborowski, qui la fait dériver directement du besoin psychologique impérieux « d’épuiser par des mouvements le surcroît d’influx nerveux engendre par toute émotion vive ». C’est ce besoin qui a donné à la danse une importance sociale telle qu’elle a toujours été mêlée aux circonstances les plus diverses de la vie des individus et qu’il n’est pas, on peut dire, d’événements publics ou privés auxquels elle ne participe. La transformation des mœurs l’a modifiée plus qu’elle ne lui a enlevé de son importance sociale, car elle est toujours l’exutoire naturel, instinctif, des grandes émotions. Les peuples les plus « civilisés » retournent à elle dans les temps de leurs plus grandes joies comme de leurs plus grandes douleurs, et il n’est pas alors, d’obligations, de convenances quelles qu’elles soient, qui puissent endiguer le flot du besoin psychologique formulé par M. Zaborowski.
L’individu danse comme il chante, pour exprimer la joie qui déborde de lui, pour la communiquer aux autres et en prendre à témoin tout ce qui l’entoure. Et il danse comme il pleure, lorsqu’il ne peut plus contenir sa douleur, qu’elle l’étouffe et lui donne un irrésistible besoin de s’étourdir, d’oublier…La danse, hymne de la joie et de la vie, est aussi la lamentation de la désespérance qui s’abandonne jusqu’à l’oubli définitif, jusqu’à la mort. Le temps de la « Grande Guerre » en a fait la démonstration la plus récente et la plus complète.
Mais le grand animateur de la danse, celui qui la domine comme il domine la vie et tous les sentiments, c’est l’amour. C’est par lui que la danse « multiplie les sens », comme disait Victor Hugo. Toutes les danses auxquelles les femmes participent sont des danses d’amour ; or, il n’est guère de danses véritables sans la participation de la femme. Celles qui sont exclusives aux hommes sont généralement d’origine guerrière et sont plutôt du sport. D’autres, d’origine religieuse, ne sont que la manifestation d’une exaltation mystique spéciale sortant de la commune mesure des sentiments humains, car elles sont pratiquées par des hommes qui se sont mis hors de la nature, soit en se mutilant, soit en ayant fait vœu de chasteté.
Dans les développements successifs de la civilisation, la danse a pris des aspects très divers et une importance des plus variable. Mais chez tous les peuples elle a été, et est toujours, dans ses formes les plus caractéristiques, la manifestation de l’amour, le moyen de charmer et d’exciter les sens, qu’elle soit les pantomimes néo-calédoniennes, la trimorodie polynésienne, la chika africaine, les ébats lascifs des ghawazies égyptiennes et des bayadères de l’Inde, le tango des lupanars argentins, ou qu’elle soit les rondes villageoises, la pavane de cour, la valse des salons ou les pratiques d’onanisme mondain des dancings actuels.
La danse a été souvent combattue ; on a voulu, pour des raisons appelées « morales », la supprimer ou tout au moins limiter son domaine, mais on a fait de vains efforts, tout comme si on avait voulu interdire aux hommes de rire, de pleurer et d’aimer... Quelles que soient les conventions sociales observées, il suffit qu’une émotion particulière passe sur le monde pour que, du haut en bas de l’échelle sociale, l’homme se mette à danser. On voit alors les gens les plus « respectables », les plus décoratifs, les plus haut placés dans la hiérarchie, retourner au vieil instinct avec une fureur et un oubli des convenances qui n’existent habituellement que dans les bas-fonds sociaux. Ce qu’on a réussi à faire a été de bannir la joie de la danse, de lui enlever ce qu’elle avait de santé et de moralité. La cafardise, en soufflant sur elle son haleine empoisonnée comme sur toutes les formes de la vie, en a fait de plus en plus le trémoussement d’une humanité composée de « cochons tristes ». Aussi, est-il inexact de dire, comme M. Zaborowski, que « chez nous, surtout dans nos grands centres urbains, elle n’est plus qu’une survivance dénuée de signification ». M. Zaborowski, qui écrivait avant la « Grande Guerre », ne se doutait pas de la place que la danse reprendrait à l’occasion de cet événement parmi les formes de la folie collective.
Une légende dit que la danse fut inventée par Minerve, lorsqu’elle manifesta sa joie de la défaite des Titans. Les êtres ont dansé bien avant l’existence des temps mythologiques pour exprimer l’amour, la joie et la douleur. D’après Lucien, « elle est née avec toutes choses et elle est aussi ancienne que l’Amour, le plus ancien des dieux ». Elle naquit, comme la musique, « du rythme de la vie » a dit plus exactement Elisée Reclus. Les premières formes de la danse ont été dans les mouvements cadencés des animaux, dans leurs pantomimes amoureuses comme celles des oiseaux qui se pavanent en saluant devant leurs femelles et que les hommes ont imitées. Elles ont été dans les ébats des animaux et des enfants qu’a dépeints Théocrite, ceux du jeune Daphnis qui :
Semblable au faon joyeux qui bondit vers sa mère.
Elles ont été dans les attitudes éplorées de la douleur, la mimique de l’effroi et du désespoir en face de la mort. En multipliant ses sentiments, l’homme a multiplié les motifs et les formes de la danse. La guerre lui a apporté un premier élément d’exaltation ; la religion, ensuite, l’a influencée de toute la diversité de ses pratiques. Ce sont elles, la religion surtout, qui ont développé ce qu’il y a de folie dans la danse. Elles ont exaspéré les sentiments qu’elle exprime et l’ont conduite à ses pires aberrations. A l’amour, à la joie et à la douleur, dont la variété d’expression fait qu’elle est calme ou emportée, solennelle ou vive, mesurée ou désordonnée, elles ont ajouté la cruauté et la superstition ; elles lui ont inoculé le sadisme, pour en faire le plus furieux mélange « du sang, de la volupté et de la mort » célébré par M. Maurice Barrès, chantre des décompositions esthétiques.
Elie Reclus a dit, dans ses Primitifs, toute l’importance de la danse chez ces peuples : « La danse, geste cadencé auquel tout le corps participe, est l’art suprême par excellence, le langage très expressif des populations primitives... Ce que la poésie est à la prose, la danse l’est au geste. Mouvements rythmiques l’une et l’autre, ils émanent de l’intelligence et de la passion. Avec les yeux et le geste il est moins facile de mentir qu’avec la langue et les lèvres ; le geste, en tant qu’expression immédiate du sentiment, précède le langage articulé ; d’où l’importance de la danse et de la pantomime chez les sauvages ».
Elie Reclus a aussi dépeint de nombreuses cérémonies, de caractères très divers et toujours mêlées de danses, des primitifs. Chez les Esquimaux, le prêtre apprend la danse aux jeunes filles en même temps qu’il les initie aux plaisirs de l’amour. On danse pour célébrer le souvenir des morts dans une fête qui correspond à la Toussaint chrétienne. On danse aussi pour le Nouvel An, au clair de lune, en dépouillant ses vêtements même par les temps les plus froids, car « la nudité est le vêtement sacré ; l’homme le revêt pour approcher la divinité ». Ce sont de véritables ballets que représentent les Aléoutes dans les réjouissances qu’ils offrent à leurs voisins et à leurs amis. La danse est aussi d’une grande importance dans les cérémonies nuptiales et funèbre chez les monticules des Nilgherris, dans l’Inde. Elie Reclus remarque à leur sujet que « chez les Primitifs, la distinction entre le plaisir et la peine, la douleur et la joie, est moins marquée que chez nos civilisés. A leurs enterrements, nos monticules chantent et dansent, dépensent toutes les provisions qu’ils peuvent avoir, passent du rire aux pleurs et des sanglots à la folle gaieté ». La coutume n’est pas complètement disparue chez les civilisés, dans certaines campagnes, des repas qui suivent les enterrements et où, grâce à des libations nombreuses, la joie succède à la tristesse. Les Kolariens du Bengale jouent la comédie du rapt des femmes dans laquelle ils dansent avec accompagnement de chants. Chez les mêmes Kolariens, les divertissements de la paix et de la guerre se confondent :
« Les belligérants suspendent les massacres pour se rencontrer à des fêtes de réjouissances où ils se traitent avec courtoisie et s’amusent, semble-t-il, avec une parfaite insouciance, pour s’entr’égorger le lendemain avec autant de férocité que de bonne humeur ».
C’est ce qu’on voit chez les civilisés où on se bat, a dit Victor Hugo :
Qui, vous à peine enterrés,
Se feront des politesses
Pendant que vous pourrirez.
Il n’y a pas très longtemps que les Kolariens ne procèdent plus à des sacrifices humains en l’honneur des dieux. Les victimes sont remplacées par des animaux. La danse du sacrificateur « qui se sent envahi par son dieu » n’en a pas moins de violence. Le sacrifice est suivi de réjouissances qui ont tous les caractères des saturnales antiques et du Carnaval d’aujourd’hui. On y voit les Asadis (danseuses et prostituées) monter à califourchon sur les épaules des plus graves personnages comme on le voyait à Rome aux fêtes de Saturne et comme on le voit de nos jours au bal de l’Opéra. L’anecdote du Gai d’Aristote, née en Perse il y a deux mille ans, et renouvelée par Zola dans Nana, est toujours actuelle, répétée sous toutes les latitudes et chez les sauvages comme chez les civilisés, avec le même oubli des différences sociales. La danse a encore une grande place, chez les Primitifs, dans les pratiques de sorcellerie et les manifestations démoniaques. Ces pratiques et manifestations ont de nombreux rapports avec celles de la sorcellerie civilisée, celles des messes noires en particulier. (Voir : Sorcellerie). Citons encore, parmi les danses des Primitifs, celles du feu, du scalp et des funérailles chez les Indiens d’Amérique.
Lorsque aux excitations multiples des sens et de la passion, de la guerre et de la religion, s’ajoute la fureur alcoolique chez les malheureux Primitifs qui ont appris des Européens à « boire comme des blancs », certaines de leurs cérémonies sont d’épouvantables orgies de rut et de sang, mélangées de pernod, telle cette fête des « Ga’nzas », ou de la circoncision et de l’excision, qu’on célèbre dans la région de l’Oubangui-Chari, en Afrique Equatoriale Française, et que M. René Maran a décrite dans Batouala.
La danse est devenue un art lorsqu’elle a commencé à s’accompagner de musique. Le rythme, que l’homme avait appris du gorille frappant sur une calebasse, la régularisa. Elle fut accompagnée d’abord de chant vocal et d’un instrument primitif connue le sifflet, le chalumeau, puis la lyre qui parut aux temps homérides. Elle était déjà un art bien perfectionné lorsque Pan animait les ébats des nymphes en jouant de sa flûte et que, suivant Théocrite, des génisses dansaient au son de la flûte de Dametas et de la syrinx de Daphnis. Successivement s’ajoutèrent d’autres instruments : tambourins, crotales, sistres, etc.… La danse suivit ainsi les progrès de la musique et, dans l’antiquité, particulièrement en Grèce, elle ne tint pas une moins grande place. Elles étaient réunies dans toutes les cérémonies. De cette union naquit la chorégraphie qui est « l’application du rythme musical aux mouvements du corps » (Grande Encyclopédie). Les Grecs lui donnèrent des règles qui la distinguèrent de la pantomime « représentation dramatique réduite à la gesticulation » (id.).
En Grèce la danse fut cultivée dans toutes les classes de la société ; aussi y prit-elle, avec le goût des arts alors si répandu, une infinie variété. Les plus grands et les plus célèbres personnages la pratiquèrent. Socrate l’apprit d’Aspasie. Epaminondas était un bon danseur. Un professionnel de la danse, Aristodème, fut ambassadeur d’Athènes auprès de Philippe de Macédoine, et ce roi épousa la danseuse Larisséa. L’art grec a laissé de très nombreux témoignages de la place que la danse a occupée dans la vie de l’époque. Elle était personnifiée par la muse Terpsichore, souvent représentée ainsi que nombre de divinités amies de la danse : les autres muses, les Faunes, les Satyres, les Nymphes, les Bacchantes, les Ris, les Amours, les Grâces, etc....
A Rome, la danse fut, en dehors des temples, le divertissement de la plèbe. Les patriciens la méprisaient, lui préférant la pantomime et les sports. Dans son Grand Dictionnaire historique (1759), Moreri qui voyait les « vertus » romaines à travers le « plutarquisme » pompeux du classicisme, a écrit : « Les Romains n’avaient que du mépris pour cette sorte d’exercice et la gravité de leurs mœurs faisait qu’ils y attachaient une espèce d’infamie ». Pour Cicéron, un danseur était un homme ivre ou fou ; il reprochait au consul Gabinius d’avoir compromis sa dignité en dansant. Tibère chassa les danseurs de Rome et Domitien destitua de leur fonction des sénateurs qui avaient dansé. Salluste blâmait Sempronia qui dansait avec une grâce « inconvenante chez une honnête femme ». Mais les Romains, comme tous ceux qui exagèrent la vertu, exagérèrent aussi la licence, dans les temps des bacchanales entre autres. Ils montrèrent dans la danse, comme en bien d’autres chocs, qu’ils manquaient du sens de la mesure possédé à un si haut degré par les Grecs. Ils étaient plus cabotins qu’artistes.
Les anciens classaient les danses en quatre catégories : particulières, religieuses, lyriques et dramatiques. Nous allons résumer l’histoire de la danse dans cet ordre, en divisant les danses particulières en danses populaires et danses de société et en rattachant les danses lyriques aux danses dramatiques.
LA DANSE POPULAIRE
Toutes les danses ont été, à leur origine, des danses populaires ; elles sont nées du peuple comme un des moyens d’expression naturels de ses sentiments.
Populaire était la danse religieuse en l’honneur du feu, du soleil, de la terre féconde, des esprits bienfaisants, avant que le prêtre vint l’obscurcir de mystère et la souiller de sacrifices sanglants. C’est une omelette que la population des Andrieux, dans les Alpes françaises, offre encore aujourd’hui au soleil lorsqu’il reparaît le 10 février au-dessus des montagnes qui enserrent leur village et après une éclipse de cent jours. Cette fête de l’offrande au soleil s’accompagne de danses. Elle était l’hommage de l’homme primitif à l’astre qui lui apportait la lumière, réchauffait ses membres, faisait mûrir la moisson, avant que les sorciers religieux, ensanglantant ce culte naïf et simple, en eussent fait ceux de Mythra, de Moloch, de Bouddha, d’Horus, d’Apollon, de Jésus et de cent autres personnages créés par leur imagination fertile en impostures. C’est du culte du feu et du soleil qu’est sorti celui, druidique, de Beal et que s’est conservé l’usage d’allumer des feux sur les montagnes. Sont aussi de même origine les feux et les danses de la saint Jean et tant de fêtes qu’on retrouve dans les coutumes de tous les pays comme les processions et danses grotesques des ramoneurs de Londres à la Noël, et les calendo de Provence avec leur cacho-fio, ou bûche de Noël, symbole de la renaissance du feu.
Les survivances sont aussi nombreuses des fêtes qui célébraient les cultes d’animaux fabuleux ou les victoires remportées sur eux, telles celles du serpent (l’Isère) et du dragon (le Drac), qui menaçaient Grenoble :
Mettront Grenoble en savon.
Celles de la tarasque (Provence), du graouilli (Metz), de la gargouille (Rouen), etc. Il en est resté des danses comme la moresque (Provence), le bacchu ber ou danse des épées, à Gap, la bravado, à Riez, etc.... Tous les esprits des airs, de la terre et des eaux, ces êtres de rêve qui poétisent encore les vieilles croyances populaires : les fées, les follets, les sylphes, les lutins, les robolds, les gobelins, les elfes, les djiners, les ondines, se présentaient toujours dansants à l’imagination.
Populaire aussi la danse de guerre et de chasse où l’homme, fier de sa force et de son adresse, célébrait naïvement sa victoire dans la lutte. Certains peuples allaient à la bataille en dansant. On appelait danse persique la marche de la milice grecque imitée des Perses. Après les festins, on exécutait en Grèce la danse des Lapithes qui simulait leur combat contre les Centaures. Il reste de nombreux souvenirs des danses guerrières représentant des combats. Elles étaient surtout des pantomimes et des acrobaties. On les retrouve à l’état primitif chez les peaux-rouges, les néo-zélandais, les nègres. Ceux-ci s’amusent fort à imiter de façon grotesque les animaux dans leurs attitudes. Dans l’antiquité, et depuis, ces danses furent surtout des exercices de préparation guerrière. Elles donnèrent naissance aux sports et se confondirent avec eux. Les Romains bannissaient de leurs gymnases la véritable danse. Elle demeura plus ou moins dans les exercices militaires et c’est ainsi qu’à plusieurs reprises des ordonnances autorisèrent des écoles de danse dans les casernes françaises. La dernière, en 1818, fut rendue pour encourager la danse et l’escrime.
Mais la danse populaire par excellence est celle d’amour et de joie, le divertissement où l’on s’efforçait de plaire par son esprit et sa grâce, où l’on se délassait du travail, se distrayait des soucis journaliers et où l’on donnait libre cours à sa bonne humeur, à son exubérance de corps et de sentiment. Cette danse d’amour et de joie se trouva tout naturellement unie à la poésie et à la musique pour produire la chanson (voir Littérature) inventée par les hommes « qui eurent les premiers le sentiment des mouvements, des cadences, des retours périodiques qui constituent le fond de tout art lyrique » (Julien Tiersot). Il n’est pas de peuple chez qui la danse et la chanson ne se soient ainsi manifestées comme un produit spontané du lyrisme humain. Les primitifs kolariens chantent en exécutant leur comédie du rapt des femmes :
Filles à marier ;
Nous nous en allâmes
Dans un pré danser.
Au pré mes compagnes,
Qu’il fait bon danser !
Un berger arrive, et d’autres, qui veulent embrasser les filles ; il y a lutte, séduction, enlèvement : c’est le thème universel et immortel de l’amour et de la chanson de danse, chez les civilisés comme chez les sauvages. C’était celui des pâtres et de leurs compagnes dansant au temps de l’Iliade en chantant : « Où trouverai-je des roses ?... Où trouverai-je des violettes ?... » et qui trouvaient l’amour. La description de leurs danses faite par Homère, et leur représentation sur le bouclier d’Achille, sont les images frappantes des caroles ou danses françaises du moyen-âge qui s’accompagnaient de chansons semblables.
C’est toujours dans les éléments populaires que l’art de la danse s’est renouvelé et a trouvé ses plus remarquables inspirations. Un journal citait dernièrement cette opinion du musicien Maurice Ravel, assistant en Suède à des danses populaires : « c’est plus beau que les ballets suédois ». De même, les danses populaires françaises, russes, nègres, sont plus belles que les ballets français, russes, nègres. Elles ne sont pas la représentation de la joie ; elles sont la joie elle-même.
Le caractère de la danse populaire a varié avec celui des populations, de leurs milieux, de leurs occupations et de leurs goûts ; mais l’amour en est le fond immuable chez toutes. Il n’est pas de contrée où l’on n’ait pas dansé et où l’on n’ait pas eu sa danse de prédilection, même en Chine où la danse serait considérée depuis longtemps comme un amusement ridicule et peu digne.
A Athènes, les danses dionysiaques reçurent du peuple cette variété qu’elles devaient transmettre à la danse dramatique avec l’emmélie, noble et grave, la cordace, plus vive, violente et licencieuse, qui se retrouve dans la saltarelle romaine et la tarentelle napolitaine, la sicinnis, véhémente et satirique. Dans le Pont et en Ionie, une des formes de la sicinnis était la bachique, en l’honneur de Pan et de sa compagnie de satyres, silènes, nymphes et ménades. Les Lacédémoniens préféraient les danses guerrières, la pyrrhique en particulier. Lycurgue voulait qu’elle fût apprise à l’enfant dès l’âge de sept ans. Mêlée à des éléments dionysiaques qui la rendirent moins violente, la pyrrhique se répandit dans toute la Grèce. D’après une description d’Apulée dans les milésiennes, on y retrouve les figures du quadrille. La pyrrhique est aujourd’hui l’albanaise. Une de ses contrefaçons fut la bocane qui a donné son nom au boucan. Les Syracusains et les Crétois portaient leur préférence sur les danses lyriques accompagnées de chants sacrés en l’honneur d’Apollon.
Indépendamment des danses pratiquées dans les fêtes collectives qui avaient un caractère religieux ou national, il y avait en Grèce toute la variété des danses particulières, depuis la comique aposkélésis, exécutée par des enfants, jusqu’à la funèbre danse des robes qui a encore sa place dans les obsèques. Dans l’Epithalame d’Hélène, Théocrite a dépeint les douze vierges qui, devant la porte des époux :
D’une molle couronne où fleurit l’hyacinthe.
….La jeune troupe, avec un art ingénieux,
Croise les pieds et bat le sol harmonieux ;
Sur un seul rythme, avec ses doux chants entrainée,
Elle emplit la maison d’un brillant hyménée ».
(Traduction SENERS.)
Plus ou moins mêlés de pantomimes et de tours de force étaient : le mothon, violent et licencieux, spécial aux Lacédémoniens de bas étage ; la phrygienne, danse paysanne avec chants et attitudes grotesques, qui suivait des libations copieuses, de même que l’angélique et la cidaris ; l’apokinos, ou « danse du pétrin ». avec ses mouvements des reins et des hanches ; le callibas, dansé en se frappant les flancs ; le bibasis, avec coups du talon ; l’épilénios, ou « danse du pressoir », décrite dans Daphnis et Chloé ; la lamprotera, accompagnée de chants licencieux ; la morphasmos, imitation comique des animaux ; l’ascoliasmos, avec sauts sur des outres pleines et frottées d’huile ; la kybistésis, marche sur les mains et jet de feu par la bouche ; l’eclactismos, élévation du talon au-dessus de l’épaule ; la thermistris, ou « danse du creuset » avec les exercices de clownerie etc.... A Rome, les bergers dansaient le tripudium en frappant trois fois du pied.
Nous verrons plus loin comment le trouble et l’inquiétude apportés par l’Eglise dans la joie populaire influencèrent la danse. L’Eglise arriva à tarir ses sources chez le peuple, mais elle ne parvint pas à la supprimer ; elle ne réussit qu’à lui faire prendre les formes guindées et hypocrites de la « danse de société ». Avant d’en arriver là, les danses populaires connurent un remarquable épanouissement.
En Italie, le peuple dansait la giga, la gagliarda, la tarentella, la saltarello, la siciliano, la forlane, la bergamasque, pour ne citer que des danses qu’on voit encore aujourd’hui.
Les danses espagnoles ont toujours eu un caractère particulièrement voluptueux qu’elles ont hérité des danseuses de Gadsé (Cadix) d’origine phénicienne, et des danses maures apparentées à la chika des nègres, grande danse exprimant toutes les péripéties de la lutte d’amour. On retrouve la première influence dans le fandango et le boléro ; la seconde dans la moresque, dansée aussi en Provence, en Corse ct dans les Balkans. Il y avait encore le jaleo, à Xérès ; l’ole gaditano, à Cadix ; la rondeña, à Ronda, et les différentes danses basques. Plus modernes sont les gamoelas, potto, rastroso, gorrona, pena mora, zapaleado, gira, etc ... Eurent une grande vogue les gallarda, sarabande, chaconne, zorouzo, escarraman, qui sont passés du peuple au théâtre. Les séguidillas, moins libres que les précédentes, ont fourni le fond des danses populaires actuelles qui combinent la danse et le chant.
En Allemagne, la danse populaire se manifesta de bonne heure dans les danses guerrières et les danses champêtres. Certaines ont un caractère religieux comme la Siebensprung. La coutume sauvage des duels d’étudiants paraît une survivance des jeux guerriers germaniques que décrivait Tacite. Les danses champêtres, très répandues au moyen-âge, paraissent avoir été empruntées à la France.
L’Angleterre et l’Ecosse ont des danses populaires originales de la plus grande variété. Les œuvres de Shakespeare et de Walter Scott contiennent de fréquentes allusions à la danse. Les réunions d’hiver des populations celtiques de l’Highland sont de véritables écoles où la jeunesse apprend les anciennes danses nationales exécutées au son de la cornemuse. Au pays de Galles, il n’y a pas longtemps qu’on dansait encore en célébrant la primitive fête des lacs. Les Ecossais ont conservé, entre autres danses de jadis, celle des épées où figurent les saints les plus populaires qui chantent et dansent. Le Dancing-Master donnait en 1716 la description et les airs de 560 danses anglaises.
En Scandinavie, on a relevé environ 400 danses populaires. Une danse des elfes n’a pas complètement disparu en Suède.
Dans les Pays-Bas, la danse populaire la plus curieuse est celle des matelots.
Chez tous les slaves, la danse tient la plus grande place, Elle est « un trait fondamental de leur psychologie » (Grande Encyclopédie). Elle est profondément attachée aux coutumes locales et s’est maintenue avec elles. C’est chez ces populations qu’on retrouve le plus de danses anciennes. La Bohème a conservé longtemps la chodowska, danse guerrière des paysans du Bœhmenvald ; la husistska, danse religieuse des hussites ; l’umrleo, danse des morts qui remonte aux temps païens. Les danses qui sont mêlées à la poésie populaire ont subsisté, telles la strasak et la baborak. La Pologne a la mazurka, la cracovienne, la polonaise, parmi les plus célèbres qui sont passées du peuple dans les salons et au théâtre. En Russie, chaque province a ses danses populaires. En Roumanie, la pumanieska est la plus répandue. En Serbie, c’est le kolo.
Les Magyars ont des danses apparentées à celles des Cosaques et caractérisées par la musique tsigane. La csardas est leur danse nationale ; toutes les classes la pratiquent. D’anciennes danses étaient celle des trois cents veuves exécutée aux enterrements et une danse des morts où l’on simulait la toilette d’un cadavre.
Chez les Turcs, qui semblent, comme la Beauté de Baudelaire, haïr « le mouvement qui déplace les lignes », la danse est surtout un spectacle auquel ils assistent paresseusement. Ils aiment voir des danses voluptueuses, telle la romaïque, ou « danse du mouchoir ». En Egypte, le spectacle de la danse est donné par les ghawazies (danseuses) et les oualems (chanteuses) qui vivent en parias dans des quartiers spéciaux, mais se mêlent à la population à l’occasion des fêtes. Dans son Voyage en Orient, Gérard de Nerval a dépeint leur danse « représentation exacte de celle des femmes de Gadès telle qu’elle est décrite par Martial et Juvénal » et telle que, bien avant encore, les ghawazies la pratiquaient pour le divertissement des premiers Pharaons, comme en témoignent les sculptures de nombreux tombeaux. Gérard de Nerval a fait aussi le récit d’une « Noce aux flambeaux », à laquelle ces danseuses participaient, et celui d’une fête de la circoncision où les ghawazies, que la famille trop pauvre n’avait pu payer, étaient remplacées par des Nubiennes dansant pour leur plaisir au son des tarabouks (tambours de terre cuite).
Dans les pays d’Extrême-Orient, les danses, même publiques, ont gardé un caractère religieux primitif comme toutes les cérémonies. Les danses des bayadères, qui s’exécutent dans les temples de l’Inde, n’en sont pas moins des plus provocantes et d’un voluptueux raffinement. Méry, dans sa Guerre du Nizam, a décrit la fête indienne de Dourga, déesse de la destruction, célébrée dans le Bengale.
La France a vu la plus remarquable éclosion de la danse populaire dans son union intime avec la poésie de même caractère. Toutes deux sont à l’origine de l’œuvre littéraire la plus belle du moyen-âge. Ensemble, elles se sont répandues dans les pays voisins et les ont marqués d’une influence profonde. L’ancien français avait de nombreux mots pour désigner la danse ; aucun n’était d’origine latine. C’était d’abord le mot dansee, qui venait, soit de l’allemand dansôn (d’après Littré), soit de formes celtiques (Larousse), soit d’une autre origine, inconnue d’après G. Paris. On disait aussi : dansement, danserie. On employait en outre les mots tresce et tresche avec leurs dérivés, les verbes trescier, treschier, treschoier, les substantifs treschement, trescherie, qui avaient à la fois le sens de ronde, sarabande, danse, bal, assemblée. Il y avait encore espringuier, d’origine allemande, qui signifiait ; trépigner, frapper des pieds, sauter, sautiller, s’élancer. Ses dérivés : espringaller, avait le sens de sauter, et espringuerie désignait une sorte de danse haute. Mais le nom qui convenait le mieux à la danse populaire et la caractérisait parfaitement était : carole, du verbe caroler qui venait d’un mot grec dont la signification était : « accompagner de la flûte une danse en rond ». En France, caroler avait le sens spécial de « danser en rond en s’accompagnant de chansons ». Des danses absolument semblables aux caroles françaises, se voient encore en Grèce, telle la ronde des femmes de Souli qui remonte à l’époque byzantine.
Les caroles étaient exécutées, soit par des femmes seules, soit par des groupes des deux sexes. Il y avait un chanteur à qui les autres répondaient en reprenant le refrain tout en formant une ronde qui tournait de droite à gauche autour de lui. Parfois, la chaîne n’était pas fermée ; elle formait une tresque et évoluait comme dans la farandole provençale. Les plus anciennes carolesétaient accompagnées de chansons héroïques et guerrières mais plutôt romanesques et, de bonne heure, s’y mêlèrent les chansons plus légères qui l’emportèrent. Ces chansons, qui célébraient les joies de l’amour et du printemps, avaient leur origine dans les fêtes païennes consacrées à Vénus et au renouveau de la nature. Les caroles se dansaient aux fêtes de mai ou du printemps et en étaient la partie la plus marquante. Ces fêtes s’appelaient maieroles ou kalende de mai en pays de langue d’oïl. Dans le Midi, elles étaient les kalendas mayas et, en Italie, les calendimaggio. Elles se sont conservées dans certaines provinces, dans des formes plus ou moins complètes, en même temps que les autres anciennes fêtes où la danse était plus ou moins mêlée. On les retrouve entre autres dans les jeux des petites filles qui choisissent une « reine de mai » et qui dansent des rondes en chantant par exemple :
Il y a encore des traces des caroles en Allemagne d’où elles se sont répandues en Danemark et en Norvège. Dans les îles Féroé, elles sont restées telles qu’au moyen-âge.
En même temps que la carole, on dansait le branle, autre danse chantée. Chaque province avait son branle particulier, accompagné d’un instrument, le violon en Bretagne, la cornemuse en Poitou, le hautbois en Bourgogne et en Champagne, le tambour basque en Béarn, le tambourin en Provence, etc.... Chaque profession avait aussi son branle.
Les caroles et les branles ont été très souvent décrits dans la littérature du moyen-âge. Dans la vie de Saint Chilian, on a cité une chanson du XIIème siècle qui accompagnait des rondes de femmes. Dans les Carmina Burana du XIIème siècle, dans les romans de Raoul de Houdan, de Guillaume le Vinier, de Chrétien de Troyes, de Guillaume de Lorris, de Froissart, dans les commentaires de l’Art d’aimer d’Ovide au XIVème siècle, on en trouve des descriptions. Ces écrits marquent les transformations de la danse et de la chanson populaires devenues peu à peu aristocratiques ; ils donnent une idée de plus en plus effacée de ce qu’elles étaient chez le peuple. Dans leurs inspirations populaires, elles avaient été « de légères merveilles de grâce et de poésie, pleines de la senteur du printemps et de l’innocente gaieté de la jeunesse, du plaisir de la danse et d’une sorte de mysticisme amoureux à la fois troublant et enfantin » (G. Paris)... Elles devinrent de plus en plus savantes avec l’amour « courtois » et la littérature, d’abord allégorique du Roman de la Rose, ensuite pédante des rhétoriqueurs du XVème siècle, jusqu’au moment où elles furent renvoyées à leur origine première par « l’étiquette » de cour. Le peuple continua à danser dans ses formes habituelles, avec la même ardeur, mais plus avec la même originalité inventive.
Les hommes de la Révolution française ne favorisèrent pas la danse populaire et ne surent pas en tirer 1e parti qu’elle aurait pu donner. La danse eut place dans les fêtes de la Révolution, mais sous une forme solennelle, dans les cérémonies nationales. (Voir : Les Fêtes et Chants de la Révolution Française, par Julien Tiersot). Ces cérémonies ne comportèrent pas de danses proprement dites. Leur gravité, et l’élévation des sentiments qu’elles suscitaient, ne s’accommodaient que d’évolutions majestueuses autour de l’autel de la patrie et de défilés de grandes foules. Les hommes sévères qui honoraient comme des déesses antiques la Liberté, l’Egalité, la Fraternité, la Raison, l’Etre Suprême et les héros morts pour la Patrie, redoutaient les excès de la joie populaire. Flaubert a raconté qu’une de ses parentes, ayant figuré la Liberté dans une fête de la Révolution, portait un bonnet phrygien avec cette inscription : « Ne me tournez pas en licence ». M. Mathiez a parlé de « la gravité sévère et moralisante des cérémonies, du sérieux des assistants » ; il a constaté que « la mascarade, les scènes burlesques et gauloises ne se trouvèrent qu’à l’état d’exceptions très rares, dans quelques grandes villes et surtout dans la capitale ».
La danse se retrouvait, avec la véritable joie populaire, en marge des cérémonies et après. Elles prenaient des revanches inattendues lorsque le mauvais temps interrompait la fête officielle ; le peuple se mettait alors à danser sous la pluie comme on le vit pour la Fête de la Fédération. Elles se retrouvaient encore mieux après les cérémonies. C’est la joie populaire qui dressa spontanément le fameux écriteau : « Ici on danse ! » le soir de la prise de la Bastille. C’est des bals parisiens qu’est sorti le Ça ira ! chanté pour la première fois par le peuple travaillant aux préparatifs du Champ de Mars pour le 14 juillet 1790. « Ce chant, dit Michelet, fut un viatique, un soutien, comme les proses que chantèrent les pèlerins qui bâtirent révolutionnairement au moyen-âge les cathédrales de Chartres et de Strasbourg ». L’air du Ça ira ! était celui d’une contredanse de Bécourt, appelée le Carillon national. C’est aussi sur un air de danse populaire que se chanta la Carmagnole. Cet air vint de Provence où il faisait danser les « carmagnola », ouvriers italiens occupés aux travaux des champs. Les Marseillais l’apportèrent à Paris en même temps que la Marseillaise. La danse populaire ne fut auxhonneurs officiels pendant la Révolution que pour la plantation des « arbres de la Liberté ». A cette occasion, Grétry composa une ronde sur des vers pompeux, dans le goût de l’époque :
Soit le signal de la gaieté !
Plantons l’arbre sacré, l’honneur de ce rivage ! etc…
Nous ne savons si villageois et villageoises chantèrent et dansèrent beaucoup cette ronde.
Depuis la Révolution, en France en particulier, le peuple a abandonné la véritable danse qui était née de lui pour s’adapter aux danses de société. Il en a été de la danse comme de toutes les formes de la vie qui tiraient du peuple leur caractère. La mode, qui a unifié les individus dans leurs gestes et leurs apparences, a fait de la danse ce qu’elle fait de tout ce qu’elle touche : une chose qui n’a plus d’âme et de beauté. Le peuple s’est mis de plus en plus à danser sans joie véritable. Il ne chante plus en dansant, mais il boit. La danse n’est plus unie à la chanson, l’expression de ses sentiments ; elle est, arrosée d’alcool, unes des marques de sa déchéance, une des formes de la lamentable neurasthénie qu’il traîne dans tous ses plaisirs. C’est ainsi que pour fêter « l’anniversaire de La liberté », le 14 juillet, aux carrefours et sous l’œil réjoui du bistro, il noie sa raison en « balançant ses dames ». Il en est arrivé à faire des matches de danse où il tourne pendant cent heures, dans une sorte d’abrutissement somnambulique, avec l’obstination des ivrognes qui luttent devant un comptoir à celui qui avalera le plus de petits verres.
LA DANSE DE SOCIÉTÉ
Ses premières formes ont été dans l’antiquité. On en faisait, en Grèce, l’accompagnement des festins et des fêtes de famille. Elle ne se différenciait guère de la danse populaire. Au Moyen-âge, la formation de la société « courtoise » fit délaisser la danse populaire par les nobles dames et leurs chevaliers. La danse de société naquit avec des règles qu’enseignèrent des professeurs et elle fit partie de l’éducation aristocratique. Elle emprunta d’abord les anciennes caroles qui se modifièrent avec la poésie des troubadours et la littérature romanesque. Les branles populaires, adoptés aussi, se transformèrent de même mais demeurèrent des danses gaies. D’autres plus graves furent adoptées, appelées danses basses parce qu’elles étaient glissées et que le saut ou sautillement en était banni. Les danses basses étaient précédées de la pavane, particulièrement à la Cour où sa solennité répondait à celle des danseurs. Dans les ballets, c’est en dansant la pavane que les dieux et les monarques faisaient leur entrée. La gravité des danses basses était telle qu’on les accompagnait du chant des Psaumes. Les personnages les plus officiels, et parmi eux les grands dignitaires de l’Eglise, la pratiquaient malgré l’ostracisme que la religion jetait sur la danse.
Formée d’abord en Italie, la danse de société se développa surtout en France pour se répandre avec ses règles françaises dans toutes les cours d’Europe où elles ne cessèrent pas de régner. Aussi, les diplomates français délégués dans ces cours ont-ils toujours dû être, avant tout, de bons danseurs. C’est la seule qualité qu’apporta en Pologne Henri de Valois, quand il devint roi de ce pays avant de monter sur le trône de France sous le nom d’Henri III. A la suite de cette formation, on donna le nom de bals (du latin ballo) aux assemblées réunies pour la danse et aux lieux où se tenaient ces assemblées. Le premier bal dont parle l’histoire est celui qui se tint à Amiens, en 1385, pour le mariage de Charles VI. L’arrivée de Catherine de Médicis en France fit prendre encore plus de vogue à la danse. Cette reine apporta avec elle des nouveautés italiennes qui animèrent les bals de cour. On organisa les premières mascarades qui remplacèrent les tournois chevaleresques. Les longues et lourdes robes de cour devinrent plus courtes et plus légères pour la danse. On préféra alors aux danses basses toute la variété des branles : le passe-pied breton, la bourrée auvergnate, la gavotte dauphinoise, le tambourin et le rigodon provençaux, etc.... Des danses nouvelles encore plus vives, la plupart sautées, parurent : la gaillarde, la voile, la courante, la sarabande espagnole, l’allemande, dont le nom indique l’origine et d’où la valse devait sortir plus tard. La courante fut la grande danse qui établit la suprématie française à l’étranger. Le menuet dériva d’elle et la détrôna au XVIIIème siècle. Le mélange des danses basses et légères produisit des effets curieux, C’est ainsi que dans un bal masqué, Diane de Poitiers chanta le De Profundis arrangé sur l’air d’une volte, qu’elle dansa en même temps. C’est d’ailleurs là un des traits de ce temps où la farce et 1a religion étaient mêlées de façon à la fois si comique et si tragique. Les bals ne furent pas moins nombreux sous Henri IV et même sous le triste Louis XIII ils étaient la grande occupation des gens de Cour.
En Italie, la Renaissance, réveillant le goût des divertissements classiques, avait créé le ballet qui fut d’abord une forme de la danse de société. Il représentait, avec un luxe de plus en plus grand des scènes bibliques, héroïques et allégoriques. Il était mêlé de pantomime et de scènes comiques jouées par des masques. Il en sortit la comédie italienne et la danse dramatique moderne. Les ballets furent introduits en France où le premier dansé en 1581, fut le Ballet comique de la reine, dont le sujet avait été tiré de la Circé de d’Agrippa d’Aubigné. Le ballet fut d’abord produit par la collaboration, très variée et telle qu’elle devait être réunie au théâtre, des poètes, musiciens, chorégraphes, costumiers, décorateurs. A la Cour s’ajoutait celle des seigneurs qui étaient les danseurs. Le ballet de Cour atteignit son apogée lorsque Louis XIV lui-même y figura. Il s’y montra pour 1a première fois en 1651, dans Cassandra, de Benserade.Il avait treize ans. Le dernier ballet où il dansa fut celui de Flore, en 1669. Sa retraite fut attribuée à l’impression que lui causèrent les vers de Britannicus où Racine blâmait les amusements de Néron ; elle amena la fin du ballet de Cour. Ce divertissement s’était de plus en plus transformé dans le sens du théâtre où il allait prendre sa place. (Voir : la Danse dramatique).
La Cour retourna alors aux grands bals. Ils devinrent ennuyeux et le furent encore bien davantage sous Napoléon 1er, lorsque ce monarque voulut imposer aux Mmes Angot, devenues duchesses de l’Empire, la pompe des temps de Versailles. Après Louis XIV, un élément nouveau se forma en marge des cérémonies officielles, pour établir une sorte de pont entre le bal de Cour et le bal populaire en fournissant à la noblesse l’occasion de « s’encanailler » et aux gens du commun celle de se frotter aux gens de qualité. Cet élément fut fourni d’abord par le théâtre, où le ballet était entré et n’était plus dansé que par des professionnels, surtout des professionnelles, la plupart sorties du peuple, dont les seigneurs et les traitants, les Richelieu et les Mercadet faisaient leurs maîtresses. Le ballet de l’Opéra venait danser à la Cour. Celle-ci alla danser à l’Opéra, lorsque, en 1715, une ordonnance royale créa le bal qui s’y donna trois fois par semaine. Ces bals eurent une vogue extraordinaire ; toutes les classes s’y mêlèrent, surtout après la Révolution et le premier Empire ; ils continuent aujourd’hui. Des industriels exploitèrent cette vogue et organisèrent des lieux de danse publics. On créa le jardin Ruggieri en 1766 aux Porcherons, le Vaux-Hall de la rue de Lancry en 1767, le Colisée des Champs-Elysées en 1771, le Ranelagh en 1774, le Vaux-Hall de la foire Saint-Germain en 1775, etc.... Les bals se multiplièrent après l’Empire et de plus en plus s’y trouvèrent mêlés « l’élite du rebut et le rebut de l’élite », suivant le mot de Michel Georges Michel sur la clientèle que réunissent aujourd’hui Deauville et les autres lieux de plaisir à la mode. En même temps, les bals de l’Opéra atteignaient leur plus grand succès sous la direction de Musard. La vogue des bals publics était favorisée par les danses nouvelles. Celles de l’ancienne Cour étaient devenues des danses classiques passées au théâtre avec le ballet. Elles avaient été remplacées par les danses anglaises plus vives et la contredanse plus facile, qui fut le premier quadrille, on quadrille français. Le répertoire dansant s’enrichit successivement des danses tournées allemandes, d’abord la valse qui en est le type. Mise à la mode en 1787, puis modifiée par Weber dans son invitation à la valse, elle arriva à sa pleine gloire lorsque Strauss lui donna une allure tourbillonnante. Ce furent ensuite la scottish, qui est une valse écossaise, la polka, née en Bohême, la mazurka, venue de Pologne et portée d’abord au théâtre, mais qui perdit son originalité quand on en fit la polka- mazurka des salons. On inventa aussi le boston, combinaison des danses précédentes, et le cotillon, jeu de société exécuté en dansant, dont le nom vient d’une ancienne chanson :
Mon cotillon va-t-il bien ?
Quelques-unes de ces danses, le cotillon en particulier, demeurèrent dans les salons et les bals de société. Les autres furent rapidement adoptées dans les bals publics où on leur donna les allures les plus libres. Le quadrille surtout a pris les formes les plus variée, depuis les plus correctes, celles du quadrille des lanciers jusqu’aux plus fantaisistes, celles du cancan ou chahut inventé par Chicard et dansé par ces célébrités excentriques qui se sont appelées : la Mogador, devenue comtesse de Chabrillan, la reine Pomaré, Pritchard Brididi, Tortillard, Mercure, Mme Panache, Rose Pompon, Clara Fontaine, Rigolboche, Zouzou Toquée, Tata Rigolo, Grille d’Egout, la Goulue, la Gueule Plate, Pas d’lapin, et cent autres. Ces danseurs étaient des attractions des bals Mabille, la Grande Chaumière, le Prado, Valentino, la Closerie des Lilas (devenue Bullier), le Moulin Rouge, etc.... Moins spectaculaires, mais encore plus pittoresques, étaient les bals de barrière, où triomphait la valse chaloupée et où les « gens chics » faisant ce qu’on a appelé « la tournée des grands ducs », allaient chercher le « frisson du crime ». C’est des bals de Belleville que se faisait, le Mardi-Gras, la descente de la Courtille, dirigée par « mylord l’Arsouille ».
Déjà, avant la guerre, les bals de barrière n’offraient rien de plus spécial que le spectacle que se donnaient à eux-mêmes les « gens chics » dans leurs dancings. Des danses étrangères nouvelles étaient devenues à la mode, le tango en particulier. Importé des bas-fonds de l’Argentine où il était pratiqué par des cow-boys mis en rut par des semaines de solitude dans les pampas, « il n’est que la danse du ventre à deux » (Sem, La Ronde de Nuit). Depuis la guerre se sont ajoutées, au tango, des danses américano-nègres, les fox-trots, shimmy, one-steps et autres « frottements » qui s’accompagnent de la musique sauvage du jazz-band et permettent aux gens « honorables », comme aux autres, de s’exciter en public sans encourir le moindre blâme. Car le dancing a unifié toutes les classes de même que la danse, grâce à la frénésie gigotante que la guerre a produite et dont nous reparlerons plus loin.
La danse des salons n’existe plus que comme un morne exercice du « monde où l’on s’ennuie ». Ce monde, lorsqu’il a de l’argent à sa disposition, s’évade de ses anciennes formes de vie pour mener celle des palaces. C’est là qu’il danse dans ce qu’on appelle des « fêtes de charité » où il « fait le bien en s’amusant », selon la formule de ces fêtes inaugurées il y a une centaine d’années. Elles ne sont souvent que des escroqueries et les malheureux au profit de qui elles sont, dit-on, organisées n’en voient pas un centime ; mais les gens qui s’amusent ne vont pas chercher si loin et puis « ça fait marcher le commerce ». Ainsi, la danse se trouve associée au muflisme contemporain qui est, d’après Flaubert, la troisième évolution de l’humanité, à la suite du paganisme et du christianisme.
LA DANSE RELIGIEUSE
A. Maury a écrit : « La danse, qui n’est plus pour les peuples civilisés qu’un amusement frivole avait, dans les premiers âges, une importance qui la fit rattacher au culte des dieux ». Il n’est pas douteux qu’elle a précédé, dans les formes du culte l’installation des prêtres, de même que l’homme a cherché la divinité dans la nature avant de la chercher dans des temples. La danse, qui est pour les populations primitives « l’art suprême » et « leur langage très expressif », devait tenir une grande place sinon la première, dans ses hommages à la divinité. En ce temps-là, elle dut être véritablement « l’offrande de l’adoration, la dîme des liesses » (J. K. Huysmans). L’homme devait s’adresser aux « puissances supérieures » avec une complète innocence de cœur, familièrement, n’ayant pas encore été tourmenté dans sa chair et dans son esprit par les artifices des imposteurs qui se sont interposés entre elles et lui.
Les prêtres se servirent de la danse comme de tous les usages auxquels les hommes étaient profondément attachés, pour les amener à eux et les dominer. Aux pratiques de sorcellerie qui furent les premières manifestations sacerdotales, correspondit la première chorégraphie religieuse. Elle se développa en même temps que les dogmes, mais tout de suite elle devint furieuse, sadique, par sa participation aux sacrifices et à toutes les formes de la folie mystique. Les troubles que 1es religions apportèrent dans les esprits, les inquiétudes, les terreurs, les extases, les excitations malsaines et toutes leurs aberrations, se traduisirent dans la danse pour en faire un divertissement démoniaque donnant un avant-goût de l’enfer. Aussi, n’est-ce pas dans les représentations théâtrales qu’il faut rechercher la véritable danse religieuse. Sa transposition sur la scène, avec les sentiments et dans les décors classiques, lui a donné une dignité qui n’était certainement pas la sienne, même dans les cérémonies les plus solennelles. L’art a idéalisé la danse religieuse en lui donnant les nobles attitudes des déesses d’opéra et en l’enveloppant dans la musique de Gluck. Pour se rendre compte de son caractère exact, il faut voir celui des événements auxquels elle participait, de ces cultes mystérieux en l’honneur de divinités monstrueuses où le meurtre se mêlait à l’orgie. La véritable danse religieuse est dans les trémoussements frénétiques, les scènes d’hystérie, les rondes de cauchemar, accompagnements des sacrifices de l’autel, que conduisaient des prêtres vivant hors de la vie, mutilés comme ceux d’Atys, ayant fait vœu de chasteté comme ceux du catholicisme. Aussi, la danse religieuse ne fut-elle jamais que la parodie de la danse, la grimace de l’amour et de la joie, la flétrissure de la vie. Par contre, elle donna à la douleur les formes les plus désespérées, les plus féroces, les plus horribles. Elle a été la mise en scène de la sorcellerie, le décor de la terreur, la manifestation la plus hallucinante du détraquement des cerveaux emportés par la folie religieuse.
L’adaptation théâtrale de la danse religieuse en a retenu ce qui pouvait être représenté dans des tableaux décents : les théories de prêtres et de prêtresses évoluant, suivant le mouvement des astres, autour des autels où fumait l’encens, et faisant des libations sacrées sur les tombeaux des héros. On célébrait ainsi Apollon (le soleil), et Diane (la lune), en Grèce et à Rome. Virgile a chanté Vénus conduisant dans les enfers mythologiques la danse des bienheureux. Les Egyptiens, les Chinois, les Indiens, avaient des danses astronomiques et sacrées comme les Grecs et les Romains. Chez les Hébreux, la danse se mêlait au culte à la gloire de Jehova. Les lévites formaient deux groupes, chanteurs et danseurs. D’après la Bible, les filles de Silo dansaient au son des flûtes lorsqu’elles furent enlevées par les enfants de Benjamin. David dansa « de toute sa force » devant l’arche lorsqu’elle fut apportée à Jérusalem. Revenus de l’exil, les Israélites dansaient aux flambeaux sur le parvis du Temple lors de la fête des Tabernacles. La danse doit être une des joies de la Jérusalem nouvelle, car il est écrit : « Réjouis-toi, fille de Sion, un jour viendra où tu reprendras tes chants et tes danses ». I1 y avait une certaine innocence dans la danse de ce nom que les jeunes filles de Lacédémone exécutaient, nues, devant l’autel de Diane. De même dans le culte de Vénus, lorsqu’il était pratiqué par les prêtresses dévouées à Vénus-Uranie, la déesse austère et idéale, la Céleste que les néo-platoniciens d’Alexandrie opposèrent à la Vierge chrétienne. Les amours mystiques de Polyphile et de Polia, qui s’étaient consacrés à Vénus, ne sont pas moins édifiantes que celles d’Abélard et d’Héloïse, et la messe de Vénus, où deux tourterelles étaient sacrifiées pendant que les prêtresses, « portant un rameau de myrte et chantant d’accord avec les flûtes, dansaient autour de l’autel » (G. de Nerval), était à peine plus barbare que la messe actuelle où le sacrifice est réduit à un symbole. Mais cette douceur était l’exception dans les manifestations religieuses.
De la religion primitive et des cultes qui en étaient sortis, les prêtres avaient tiré et développé une théogonie et des dogmes aussi sanguinaires que variés. A la source était Cybèle, la grande déesse de Phrygie, la Rhéa des Grecs, dont le nom changeait suivant les régions. Elle était la mère des dieux, personnifiant les forces naturelles et tout ce qui était utile aux hommes dans les airs, sur la terre et dans ses profondeurs. Elle avait eu des amours tragiques avec Atys, dieu de Phrygie, qui avait été mutilé, tué, puis était ressuscité. Cette légende donnait lieu, chaque année, à l’équinoxe du printemps, à des cérémonies d’où sont sorties celles de la Semaine Sainte des chrétiens. Les cultes de Cybèle et des sous-divinités dépendant d’elle, avaient à leur service une foule variée de prêtres. Suivant les pays, ils étaient appelés corybantes, curètes, telchines, cabires, etc.…, d’après les noms des esprits mystérieux et des dieux en qui chaque peuple voyait ses protecteurs particuliers, ceux des travaux champêtres, ceux de la navigation, ceux de l’industrie, etc.... Ces cultes s’accompagnaient de mystères sanglants, d’orgies mêlées de danses. D’après la légende, Cybèle avait appris la danse à ses prêtres. Les attributs de ses thuriféraires étaient à la fois le couteau du sacrifice, les épées, les boucliers et les instruments de musique accompagnant leurs chants et leurs danses. Les curètes, en particulier, se livrant aux danses guerrières ; ils furent les fondateurs des jeux olympiques. Les mêmes curètes sont à l’origine des fêtes dionysiaques comme ayant été les nourriciers de Dionysos. Le culte de Cybèle fit naître, à Rome, les jeux mégalésiens qui comportèrent d’abord des récitations poétiques et les danses des prêtres appelés « Galli ». Aux temps de la décadence, qui virent les scandales des bacchanales, on leur ajouta les jeux du cirque et les taurobolies dans lesquelles on prétend voir les traditions de la tauromachie (voir ce mot), spectacle qui doit, dit-on, nous ramener à la « civilisation latine », comme le « fascisme », sans doute !...
Indépendamment des danses auxquelles ils se livraient dans l’accomplissement de leurs mystères, des prêtres de Cybèle dansaient dans les rues, y disaient la bonne aventure, se livraient à des acrobaties, en demandant l’aumône. Ils ont été les ancêtres des saltimbanques, paladins, acrobates, montreurs d’animaux, et aussi des moines mendiants. D’autres transportaient sur les voies publiques une des formes les plus répugnantes du sadisme de leurs mystères, la coutume des flagellations par lesquelles ils s’entraînaient à ces répugnantes débauches qu’a décrites Apulée dans l’Ane d’or. Des flagellations semblables caractérisaient les lupercales, fêtes de la fécondité. Après les sacrifices au dieu Pan, les prêtres « luperques » couraient à travers la ville en hurlant et en frappant la foule de lanières de cuir. Des femmes enceintes offraient leur ventre à ces coups. C’est de ces manifestations, caractéristiques du délire mystique, que sont sorties les pratiques des flagellants perpétuées à travers les siècles jusqu’à nos jours où viennent de se produire les aventures du curé de Bombon. Une extase particulière était attribuée aux corybantes qui exécutaient des danses armées comme les curètes et les telchines. C’était une autre forme de folie mystique. Elle s’est appelée corybantisme lorsqu’elle s’est manifestée au XVIème et au XVIIème siècle. (Voir plus loin au sujet de toutes ces aberrations renouvelées par le Christianisme).
Comme les prêtres de Cybèle, les prêtres saliens chantaient et dansaient, aux carrefours, pour les fêtes de mars et d’Hercule. Les prêtres d’Isis faisaient de même sous des accoutrements étranges.
Au culte de Cybèle se rattachait particulièrement celui de Déméter, sa fille, symbolisant la fécondité de la terre et que les Romains identifièrent avec Cérès. C’est en l’honneur de Déméter que se célébraient les mystères d’Eleusis, Les bacchantes et les ménades y dansèrent lorsque ces mystères réunirent les cultes dionysiaque et orphique à celui de Déméter. Des fêtes de Cérès sont sorties celles, chrétiennes, des Rogations.
La plupart des mystères et des danses religieuses avaient le caractère orgiaque qui marqua les réjouissances populaires lorsque le culte des dieux devint public, tel, à Rome, ceux de Vitula, déesse de la joie, de Volupia, déesse de la volupté, et de nombre d’autres. Mais les plus grandes réjouissances étaient pour les fêtes de Dionysos, en Grèce, appelé Bacchus à Rome. Les dionysies grecques furent d’abord réservées à des initiés. Les bacchantes, prêtresses de Bacchus, y dansaient accompagnées de chants dithyrambiques. Lorsque les dionysies devinrent populaires, elles comprirent des divertissements champêtres, des banquets, des processions grotesques, des concours poétiques, des danses où les bacchantes se mêlèrent à la foule. Elles conservèrent en Grèce une certaine décence, mais lorsqu’elles passèrent à Rome et devinrent les bacchanales, du nom des bacchantes qui fut donné à toutes les femmes qui y participèrent, elles furent le prétexte d’une débauche sans frein. Tite-Live en a fait la description. Les dionysies eurent une importance très grande au point de vue de l’art. C’est d’elles que sortit le théâtre. La danse antique leur doit ses manifestations collectives les plus caractéristiques dans ses trois formes : populaire, religieuse, dramatique. Le théâtre leur doit en particulier la sicinnis, ou danse des prêtres de Bacchus-Sabazios, et la bacchique.
Les Romains célébraient aussi les saturnales, semblables aux bacchanales par leurs excès. On voit de quelle façon Moreri était justifié quand il parlait de « la gravité des mœurs romaines » ! Les saturnales étaient en l’honneur de Saturne qui avait appris l’agriculture aux peuples d’Italie. Elles duraient plusieurs jours, aux calendes de janvier. Comme les bacchanales, elles effaçaient les distinctions sociales parmi ceux qui s’y mêlaient. Des esclaves prenaient la place de leurs maîtres et on voyait des propriétaires faire remise de leurs loyers à leurs locataires ! Ces mœurs étaient certainement le souvenir d’une époque d’égalité et de communisme qui avait été universelle car on les retrouve chez tous les peuples. Elles sont une sorte de revanche de la justice en faveur des opprimés et, en même temps, une caricature de cette justice que les opprimés sont incapables de vouloir et d’exiger. Le lendemain des saturnales, l’esclave reprenait docilement sa place sous le fouet. Les saturnales antiques se sont perpétuées sous des formes semblables de réjouissances populaires et on en retrouve l’esprit dans le Carnaval d’aujourd’hui. Le carnaval est la seule royauté du peuple appelé « souverain ».
Chez les Druides, le culte avait le même caractère que ceux de Cybèle et de Bacchus. On en retrouve des traces dans les traditions demeurées en Irlande, en pays de Galles et en Armorique. Les sacrifices sanglants, les formes de sorcellerie les plus barbares, étaient pratiqués par les druides. Des magiciennes et des prophétesses y associaient les danses les plus échevelées.
« Quelquefois, ces femmes devaient assister à des sacrifices nocturnes, toutes nues, le corps teint de noir, les cheveux en désordre, s’agitant dans des transports frénétiques » (Michelet).
Parmi les prophétesses étaient les vierges de l’île de Sein. Les prêtresses de Nanettes, à l’embouchure de la Loire, étaient mariées mais habitaient seules dans une île et venaient voir leurs maris sur le continent à des époques déterminées. Dans les cérémonies des druides, les Grecs retrouvèrent le culte de Bacchus et les orgies de Samothrace. Leurs rites étaient ceux des cabires, entre autres leur danse mystique que le poète gallois Cynddeler a décrites : « ils se mouvaient rapidement encercles et en nombres impairs, comme les astres dans leur course, en célébrant le conducteur ».
Les fêtes .religieuses du sang, de la volupté et de la mort se retrouvent avec la danse dans toutes les religions et sous toutes les latitudes. Nous allons voir comment elles ont continué avec le Christianisme, de quelle façon il se servit de la danse tout en la combattant et comment, tout en prétendant supprimer les excès de ses manifestations collectives, il les rendit encore plus démentes et plus tragiques.
LE CHRISTIANISME ET LA DANSE
Les usages des fêtes et de la danse étaient trop implantés dans les mœurs pour qu’il fut possible, à un moment quelconque, de les faire disparaître. D’ailleurs, quelle puissance les aurait attaqués sérieusement ? Ne sont-ils pas la soupape de sûreté de la chaudière sociale ? Au cirque, dans les saturnales, l’esclave oubliait sa misère. Lorsqu’il danse en souvenir de la prise de la Bastille, le peuple oublie que des centaines d’autres bastilles ont été reconstruites contre lui. Le Christianisme put détruire les temples du paganisme, en brûler les bibliothèques, en massacrer les adeptes ; il ne put changer les mœurs populaires et il prit le parti le plus habile, celui de s’adapter à elles en déclarant chrétien ce qui était païen. C’est ainsi que les fêtes antiques se retrouvent avec la théogonie païenne dans la religion catholique. C’est par les cérémonies et ses réjouissances habituelles que le peuple fut attiré vers le nouveau Dieu. L’Eglise prétend qu’elle a toujours condamné la danse ; en principe, peut-être, mais non en fait. Avec ce remarquable opportunisme qui, s’il lui a enlevé tout droit à l’autorité morale qu’elle prétend exercer, a fait sa force et sa fortune, elle s’en est servie comme de toutes les formes de ce qu’elle appelle « le péché ».
Les premiers ordres monastiques furent formés de réunions d’hommes et de femmes qui se retiraient dans des solitudes pour danser et faire leur salut. On les appelait choreutes du nom des danseurs grecs. Dans les premiers temps du Christianisme, à Antioche, les fidèles dansaient dans les églises et devant les tombeaux des martyrs. Chaque jour avait ses hymnes avec des danses propres, et la veille des grandes fêtes, on se réunissait la nuit, à la porte des lieux de culte, pour chanter et danser. Grégoire le Thaumaturge introduisit la danse dans le culte, et son développement devint de plus en plus grand à mesure que les cérémonies prirent plus d’éclat devant un plus grand nombre de fidèles. Les prêtres la conduisaient alors dans le chœur des églises. On disait que Saint Paul avait préconisé la danse comme une forme du culte. Les pères de l’Eglise en faisaient l’éloge et rappelaient que les Hébreux l’avaient pratiquée. D’après Saint Basile, elle était « par excellence l’occupation des anges dans le ciel ». L’église favorisait les anciennes fêtes païennes du 1er janvier, les dionysiaques et les saturnales, les brumalies célébrées en mars et en septembre en l’honneur de Bacchus, les vota, premières fêtes votives dont l’usage est demeuré, particulièrement dans les romérages des villages de Provence. C’est ainsi que s’organisèrent peu à peu dans les églises, et dans le même esprit que celui des saturnales, les fêtes des Innocents, des Fous, de l’ Ane, des Sous-diacres ou des Diacres-saouls, des Cornards, des Libertés de Décembre et nombre d’autres dont les noms varièrent suivant les provinces. De ces fêtes, devait sortir le théâtre du moyen-âge. (Voir Théâtre). Elles avaient un caractère carnavalesque et leur fond principal était la parodie des cérémonies du culte. Des ecclésiastiques en étaient les organisateurs et les principaux acteurs. Dans la fête de l’Ane, cet animal était conduit en grande pompe dans l’église ; une messe était célébrée à laquelle était mêlée la prose de l’âne. Les prêtres et le peuple chantaient et dansaient ensuite autour du baudet. La fête des Fous durait pendant les trois jours des saints Etienne, Jean et des Innocents, à la fin décembre. On élisait un pape ou évêque des fous qui prenait place dans le siège épiscopal, revêtu des ornements pontificaux. Les prêtres, barbouillés de lie, masqués et travestis, entraient en dansant dans le chœur et chantaient des obscénités. On mangeait sur l’autel des boudins et des saucisses, on y jouait aux cartes et aux dés, on brûlait de vieilles savates dans des encensoirs. Les danses continuaient au dehors ; les diacres et les sous-diacres étaient charriés par les rues dans des tombereaux remplis d’ordures où ils prenaient des poses lascives et faisaient des gestes impudiques. Ces « joyeusetés cléricales » se déroulaient non seulement dans les églises, mais aussi dans les couvents des deux sexes. La bibliothèque de Sens possède le manuscrit de l’Office de la fête des fous de Sens, attribué à l’archevêque Pierre de Corbeil. A Evreux, pour la fête des Cornards, qui avait lieu le 1er mai, on se couronnait de feuillages. Les prêtres mettaient leur surplis à l’envers et se jetaient du son dans les yeux puis dansaient avec le peuple. A Auxerre, la fête des fous se célébra jusqu’en 1407 et, en 1538, les chanoines jouaient encore à la balle dans la nef de la cathédrale, après quoi venaient le banquet et la danse. Ce ne fut qu’en 1467 que le duc de Bourgogne enleva au peuple de Liège son antique privilège de danser dans l’église.
On voit qu’au moyen-âge, et encore après, l’Eglise ne s’effarouchait pas de ces licences qui se manifestaient dans la danse comme dans toutes les formes de l’art, dans les farces, dans les fabliaux, dans les sculptures des cathédrales. Pour établir sa puissance, elle avait besoin que ce peuple, alors primesautier et épris de liberté, fit bon ménage avec le « bon Dieu ». Elle était indulgente aux simples et offrait des lieux d’asile aux persécutés. La maison de Dieu était « le domicile du peuple ... la vie sociale y était réfugiée tout entière ... On y mangeait puis on y dansait » (Michelet) ». L’Eglise ne songea d’abord à proscrire les divertissements religieux que lorsqu’ils risquèrent de trop faire oublier la religion. Elle les attaqua ensuite plus vivement lorsque, sa puissance définitivement établie, elle voulut imposer l’hypocrisie d’une vertu qu’elle avait de plus en plus perdue. Elle donna alors à Tartufe « le plus sale des deux masques que Satan avait au sabbat » (Michelet). Mais les mesures qu’elle prit furent toujours inopérantes et c’est d’ailleurs parmi les ecclésiastiques eux-mêmes qu’elle rencontra la plus forte résistance. Les prêtres dansaient entre autres le jour de leur première messe. En Allemagne, au milieu de sa messe d’installation, le nouveau curé allait prendre sa mère par la main et dansait avec elle. Il fallut un arrêt du Parlement de Paris, rendu en 1547, pour faire cesser cet usage en France. Celui des danses dans les églises, des « ballets dévots », comme dit Huysmans, persista dans certaines provinces jusqu’au XVIIème siècle. Un autre arrêt du Parlement de Paris fut rendu contre elles le 3 septembre 1667, et des ecclésiastiques résistaient toujours. A Limoges, le curé de Saint-Léonard dansait avec ses paroissiens dans le chœur. Il y avait encore des traces de ces ballets dans le Roussillon, au XVIIIème siècle. La cathédrale de Séville n’a pas cessé de posséder un corps de danseurs appelés seises qui évoluent devant le maître-autel au son de castagnettes en ivoire. On voit encore, dans certaines localités françaises, des danses ambulatoires, longues processions auxquelles participent des prêtres et qui sont des représentations plus ou moins parodiques des scènes de la vie de Jésus-Christ.
La transformation des mœurs fut plus efficace que les arrêts de l’Eglise, qui a plus suivi les mœurs qu’elle ne les a dirigées. On le voit encore de nos jours par les manifestations isolées et inutiles de certains prélats qui veulent lutter contre la danse et contre les modes nouvelles.
Après avoir favorisé les fêtes païennes, on voulut les interdire. Les conciles de Laodicée (362–370), d’Agde (506), de Tolède (582), celui de Trullo (691) défendirent de danser. On n’en dansa pas moins dans les églises et jusque dans les cimetières d’où les fêtes baladoires ne furent définitivement bannies, en France, qu’après un arrêt du Parlement de Paris, en 1667. Mille ans après le concile de Tolède, l’évêque Ximenès rétablissait dans la cathédrale de cette ville l’usage des danses dans le chœur, pendant le service divin ! ... Le pape Grégoire III intervint tout aussi inutilement, ainsi que les écrivains religieux. Après avoir loué la danse en s’appuyant sur l’Ecriture Sainte, en rappelant que David dansait devant l’arche, on la blâma en invoquant la même Ecriture et l’histoire de Salomé qui dansa pour obtenir que Jean-Baptiste fût décapité. Jean Chrysostome condamna toutes les danses, disant qu’elles étaient des « pompes de Satan », Saint-Augustin prononça de même et les théologiens s’accordèrent pour déclarer que la danse « est une occasion inévitable de pêché et une pratique incompatible avec les pudeurs et les sérénités de la chasteté » (Vollet : La Grande Encyclopédie). On n’en vit pas moins, pendant longtemps, les plus hauts dignitaires de l’Eglise prendre part à des danses. Les grands prélats de la Renaissance italienne participaient à des fêtes où la danse était la partie la plus innocente du programme. Le pape Alexandre VI aimait les ballets où des femmes dansaient sans voiles et l’on a dit que sa fille Lucrèce, et ses autres enfants, y distribuaient des prix aux plus impudiques. Les cardinaux de Narbonne et de Saint Séverin dansèrent à Milan à un bal donné par Louis XII en 1501, et les pères du concile de Trente dansèrent aussi dans une fête qu’ils offrirent à Philippe II d’Espagne, en 1562. Nous n’en finirions pas de citer les interdictions de l’Eglise contre la danse et leur violation par les propres représentants de cette Eglise. N’oublions pas, à ce sujet, de rappeler la spirituelle « Pétition à la Chambre des députés pour les villageois que l’on empêche de danser », de P.-L. Courier, et terminons sur ce point en constatant qu’aujourd’hui, comme toujours, l’Eglise accommodante préfère que ses « fidèles » dansent plutôt que de les voir l’abandonner.
Le Christianisme ne fit pas davantage disparaître les formes de folie collective que le paganisme traduisit dans la danse. Non seulement il s’en accommoda et s’adapta à elles, mais encore il en aggrava l’aberration. Au détraquement des esprits provoqué par l’ancienne sorcellerie, il ajouta les formes nouvelles de désespoir d’une religion qui se présentait comme celle de la mort, qui méprisait la vie et ses joies, enseignait l’horreur de la chair qu’elle livrait aux macérations les plus répugnantes et menaçait les âmes, pour après la mort, des tortures infernales. Les malheurs des temps ne suffisaient pas aux peuples pour les accabler. Aux guerres, aux pillages, aux famines, à la peste qui ravageaient des régions entières, l’Eglise ajoutait l’épouvante de ses inventions maladives et faisait de Dieu une puissance si terrible que les pauvres hommes se retournaient vers le Diable pour trouver de la pitié et de la consolation. (Voir : sorcellerie). La révolte n’était-elle pas inutile ? Les « pastoureaux », les « jacques », les « gueux », avaient payé cruellement leurs soulèvements. L’Eglise encourageait la répression dont elle faisait son profit et elle brûlait Jeanne d’Arc en qui s’était incarnée la révolte populaire, révolte impie de ceux qui devaient rester éternellement courbés sous l’esclavage et la douleur.
Aussi, tous les égarements se mêlèrent-ils à la danse au moyen-âge. Il vit la danse des morts que n’avait pas connue l’antiquité, les rondes hallucinantes dans les cimetières, les trémoussements frénétiques d’une chienlit qui représentait, mêlés et confondus, le pape, le roi, le chevalier, la dame, le bourgeois, le moine, l’écolier, le serf, le truand, la ribaude.
« La moralité de cette danse était l’expression populaire du désespoir universel et du sentiment égalitaire qui, malgré tout, subsistait dans les masses et se traduisait par la forme la plus satirique et la plus irrévérencieuse pour les autorités établies. C’était la revanche anticipée de tous les malheureux pillés, torturés, maltraités de toute manière » (La Grande Encyclopédie).
L’art des peintres, des sculpteurs, des enlumineurs, a souvent représenté la danse des morts, ou danse macabre, sur les murs des églises et des cimetières, sur les manuscrits et les livres d’heures. Les plus célèbres de ces œuvres qui existent encore sont : la danse macabre de Berne, peinte de 1515 à 1520 par Nicolas Manuel ; celle du cloître de Saint Maclou, à Rouen, sculptée sur trente et un piliers ; la danse des morts de Bâle et les figures de la mort d’Holbein dont il reste des gravures. De nos jours, le musicien C. Saint-Saëns a composé, sous le titre Danse macabre, un poème symphonique sur des vers de H. Cazalis. Des écrivains qui se dévouent à l’effacement des trop noires réalités du passé ont prétendu que les danses des morts n’avaient jamais été dansées réellement. Les témoignages du contraire sont nombreux et aussi de choses pires nous allons le voir. Les Chroniques de Saint-Denis ont fait le récit des fêtes que Charles VI donna dans l’abbaye royale à l’occasion de l’enterrement de Duguesclin et du bal qui s’y déroula.
« Trois jours, trois nuits, Sodome roula sur les tombes. Le fou qui n’était pas encore idiot, força tous ces rois, ses aïeux, ces os secs sautant dans leur bière, de partager son bal. La mort, bon gré mal gré, devint entremetteuse, donna aux voluptés un cruel aiguillon. Là éclatèrent les modes immondes de l’époque où les dames, grandies du hennin diabolique, faisaient voir le ventre et semblaient toutes enceintes. L’adolescence, d’autre part, effrontée, les éclipsait en nudités saillantes. La femme avait Satan au front dans le bonnet cornu ; le bachelier, le page, l’avaient au pied dans la chaussure à fine pointe de scorpion. Sous masque d’animaux, ils s’offraient hardiment par les bas côtés de la bête. Toutes ces grandes dames de fiefs, effrénées Jezabels, moins pudibondes encore que l’homme, ne daignaient se déguiser. Elles s’étalaient à face nue. Leur furie sensuelle, leur toute ostentation de débauche, leurs outrageux défis, furent pour le roi, pour tous, — pour les sens, la vie, le corps, l’âme, — l’abîme et le gouffre sans fond » (Michelet).
En même temps que cette fête aristocratique se déroulait à Saint-Denis, des joyeusetés semblables étaient offertes au peuple, dans les rues de Paris, pour l’entrée d’Isabeau de Bavière. Enfin, Charles VI étant allé voir le pape à Avignon, Froissart a raconté les fêtes données à cette occasion ; roi et seigneurs, pape et cardinaux, « ne pouvaient se tenir ... que toute nuit ils ne fussent en danses, en caroles et en esbattements avec les dames et damoiselles d’Avignon ».
Des foules de possédés se livraient aux danses des morts comme aux rondes du sabbat. Ils étaient pris du mal de Saint-Guy, « vésanie épidémique », dit le Dr P. Langlois dans la Grande Encyclopédie, « qui les faisait s’agiter quand ils étaient ensemble dans des monomanies dansantes et saltatoires ». Des vésanies semblables étaient celles des ardents, atteints du feu Saint-Antoine, et des flagellants :
« Des populations entières partirent, allèrent sans savoir où, comme poussées par le vent de la colère divine, ils portaient des croix rouges ; demi-nus, sur les places, ils se frappaient avec des fouets armés de pointes de fer, chantant des cantiques qu’on n’avait jamais entendus » (Michelet).
Or avant, entre nous tous frères,
Battons nos charognes bien fort,
En remembrant la grant misère
De Dieu et sa piteuse mort.
Les Chroniques de Saint-Denis ont évalué à 800.000 le nombre de flagellants qu’il y a eu à Noël de 1349, après la peste noire.
Aux temps de la Ligue, le roi Henri III et ses « mignons » qui associaient aux pratiques religieuses celles de la pédérastie, faisaient avec les moines des processions dans Paris et se flagellaient réciproquement en chantant des cantiques et en criant : « Sus aux huguenots ! »
En Espagne, l’Eglise encourageait le peuple à danser aux autodafés de l’Inquisition. On le distrayait ainsi de la tentation qu’il aurait pu avoir de réfléchir devant ces ignobles spectacles.
A toutes les pratiques de la sorcellerie antique, le Christianisme ajouta des motifs d’aberrations nouvelles. « Fraternité humaine, défi au ciel chrétien, culte dénaturé du dieu nature », c’est le sens, a dit Michelet, de la messe noire née de la réaction exaspérée de la vie et des sens que provoqua contre lui ce Christianisme. Les participants de cette messe y dansaient la ronde du sabbat :
« Ils tournaient dos à dos, les bras en arrière, sans se voir ; mais souvent les dos se touchaient. Bientôt personne ne connaissait plus son voisin, ni soi-même ». (Michelet)
Au pays basque, au XVIIème siècle :
« le prêtre dansait, portait l’épée, menait sa maîtresse au sabbat. Cette maîtresse était sa sacristine ou bénédicte, qui arrangeait l’église. Le curé ne se brouillait avec personne, disait à Dieu sa messe blanche le jour, la nuit au Diable la messe noire, et parfois dans la même église » (Pierre de Lancre cité par Michelet).
Les messes noires avaient de nombreuses ressemblances avec les bacchanales romaines. Comme elles, elles eurent leurs procès aux XVIIème et XVIIIème siècles. (Voir : Sorcellerie).
Ce sont des vésanies du genre des précédentes qui produisirent, au XVIIème siècle, le tarentisme en Italie, et qui se manifestent encore aujourd’hui dans le tigretier, en Abyssinie, les danses convulsives des nègres, les tournoiements des derviches et tous les trémoussements dans lesquels l’individu, emporté par une ivresse spéciale, perd la notion de son environnement. Et ce sont des vésanies épidémiques comme celles créées par les temps de misère du moyen-âge qui reparaissent aux époques tourmentées de l’humanité. La Révolution a vu les bals des victimes où n’étaient admis que les parents de gens guillotinés. Les temps de la « Grande Guerre » ont provoqué une véritable ruée des populations vers les dancings. Vésanies incontestablement religieuses car, en même temps, on ne vit jamais tant de monde dans les églises. Depuis les « demi-vierges » les plus acides jusqu’aux « barbonnes » les plus mûres, toutes les « possédées » du tango se sont multipliées, venues de tous les mondes et s’abandonnent aux promiscuités les plus déconcertantes de la ronde de nuit. Mais, « n’en doutez pas, ces gens, après avoir mêlé leur souffle, leur transpiration, leur jus, enchevêtré leurs genoux, tressé leurs jambes, fondu leur chair hérissée de désir, après avoir été brassés, amalgamés, fouillés pendant des heures par le doux mécanisme de ce barattage en musique, reprendront, à la sortie, avec leur vestiaire, leurs préjugés, leurs dédains et leurs distances » (Sem) .Et, entre deux de ces séances, l’Eglise leur donne solennellement l’absolution.
LA DANSE DRAMATIQUE
Nous arrivons à la catégorie de la danse la plus intéressante depuis que la danse populaire a perdu son originalité et que, surtout, elle s’est flétrie aux contacts interlopes des dancings. La danse dramatique a pris, d’ailleurs, dans ces dernières années un épanouissement qui en a fait le genre théâtral le plus remarquable à côté de la poésie et de la musique dramatiques qui, sauf de rares exceptions, n’arrivent pas à se libérer des vieilles formules où le drame, la comédie, l’opéra, restent enfermés. (Voir : Théâtre et Musique).
Le théâtre, tel qu’en France on en observe encore les traditions, est né en Grèce de la collaboration de la poésie, de la musique et de la danse. Il est sorti des fêtes dionysiaques. Avec les premières formes du théâtre classique (tragédie-comédie) parurent les premières danses dramatiques. On attribue à Eschyle l’introduction, dans la tragédie de l’emmélie qui comportait des danses, des chants et des airs de flûte d’un caractère grave. Une variété de l’emmélie, la xiphrismos, était guerrière. Ce serait Aristophane d’autre part qui aurait mêlé la cordace à la comédie et qui aurait fait prendre à cette danse un caractère plus vif et plus licencieux que celui qu’elle possédait. Au drame satirique on avait adjoint la sicinus et la bachique, danses encore plus animées et plus expressives. Ces premières danses dramatiques avaient eu leur origine dans les dionysies ; d’autres s’ajoutèrent qui étaient des danses religieuses ou des danses lyriques. Celles-ci étaient de trois catégories qui correspondaient aux trois précédentes et aux trois genres du théâtre : tragique, comique, satirique.
La gymnopédie avait le caractère de l’emmélie et de la tragédie. Elle était la danse des jeunes garçons Lacédémoniens dans les fêtes en l’honneur d’Apollon-Pythien, de Latone, de Diane, Ils dansaient presque nus, en rondes autour de l’autel, en se frappant mutuellement dans le dos et en chantant des péans pleins de gravité, comme leur danse. L’hyporchématique était 1a danse lyrique par excellence. Joyeuse, comme la cordace et la comédie, elle s’accompagnait des hyporchèmes ou chants sacrés à la gloire d’Apollon, Elle fut perfectionnée par Xénodème et Pindare qui la divisèrent en trois classes : la monodie (un seul chanteur et danseur), l’amébus (deux chanteurs et danseurs), le chœur (plusieurs chanteurs et danseurs). La pyrrhique, véhémente comme la sicinnis, convenait au drame satirique. Elle était au début essentiellement militaire. Ses danseurs se frappaient avec des glaives. A Athènes, elle figurait dans les Panathénées où des jeunes gens mimaient les combats qui célébraient les dieux. Elle se modifia pour prendre place dans les dionysies puis au théâtre. D’après Suétone, une pyrrhique représentait la fable de Pasiphaé.
Sauf certaines danses de caractère guerrier, la plupart étaient exécutées par les deux sexes, soit séparément, soit ensemble. La danse était orchestique avec un seul danseur ou plusieurs considérés isolément. On l’appelait choristique quand plusieurs formaient un ensemble. Le mot, qui se disait aussi choreia, avait pour synonyme ballismos d’où sont sortis le latin ballo et les français bal et ballet. L’union d’un groupe dansant et d’un groupe chantant formait une chorodie. Ses participants étaient les chorenies. Le chef du chœur s’appelait prœsultor.
Comme la tragédie et la comédie, la danse dramatique dut avoir dans l’antiquité une vivacité d’expression qu’elle ne retrouva pas lorsque l’art moderne l’a ressuscitée avec elles dans le théâtre appelé classique. Elle fut aussi châtrée, aussi truquée, que le furent les fureurs d’Oreste, les salacités de Lysistrata, les éructations de Trimalcyon. Comme disait Tailhade des traducteurs de Plaute : « De madame Dacier à Naudet, ce ne sont que périphrases, bandeaux sur l’œil, cataplasmes, feuilles de vigne et caleçons de bain ... Ils ont fait de son théâtre une manière de jardin botanique, plein de chicots herbacés, de feuilles moribondes ». Rien d’étonnant que la danse n’ait pas retrouvé immédiatement sa place dans ce théâtre lorsque, au XVIIème siècle, Hardy et ses successeurs lui donnèrent ses premières formes en créant la tragédie française.
La danse dramatique moderne se forma en dehors du théâtre, dans les ballets qui prirent de plus en plus des développements spectaculaires et devinrent l’ouvrage de plus en plus exclusif des spécialistes de la scène. Les premiers spécialistes chorégraphes avaient été les villageois appelés au château pour apprendre la carole et le branle aux châtelaines et à leurs pages. Ils devinrent des maîtres de danse de plus en plus importants et célèbres qui formulèrent et rédigèrent les règles de la chorégraphie. Il y avait une vieille chanson de maître de danse qui disait :
Et trois pas du côté du lit,
Trois pas du côté du coffre,
Et trois pas. Revenez ici.
L’italien Fabrizio Caroso de Semoneta publia le premier, à Venise, en 1581, un ouvrage : Le Ballarino, où il décrivit un grand nombre de danses et en formula les règles. En 1588, le chanoine Tubourot, de Langres, faisait paraître son Orchésoqraphie, manuel technique de chorégraphie où il donnait en particulier des détails sur les branles. Le travail de Tabourot fut repris et complété en 1700 par Feuillet ; En 1662, une Académie de danse avait été fondée à Paris. Beauchamp, professeur de Louis XIV, en devint directeur en 1664. Il fut aussi surintendant du corps de ballet. Le ballet était devenu à la Cour un spectacle complet, d’une technique de plus en plus compliquée. Des auteurs célèbres y travaillaient : Benserade, Quinault, Monère, Lulli, etc ... Molière fournit à Lulli des comédies-ballets : Le Sicilien (1667), Psyché (1671), les intermèdes de l’Amour médecin (1665) où la comédie, le ballet et la musique chantaient ensemble :
Deviendraient malsains,
Et c’est nous qui sommes
Leurs grands médecins.
Ceux de Monsieur de Pouceaugnac (1669), du Bourgeois Gentilhomme (1670), du Malade Imaginaire (1673).
Lorsque Lulli obtint le privilège de directeur de l’Académie royale de musique, ou Opéra, en 1672, le ballet de Cour, auquel il avait donné le plus grand éclat, disparut et la danse entra à l’Opéra. Elle n’y fut, pendant un certain temps, qu’un intermède dans les opéras. Elle allait y prendre sa véritable place à la suite de la réforme réalisée par Beauchamp qui fit paraître des danseuses sur la scène. Jusque-là on n’y avait vu que des danseurs. Cette révolution se fit en 1681, pour les représentations du Triomphe de l’Amour, ballet de Quinault et Lulli. Elle donna tous ses effets au fur et à mesure que les danseuses affirmèrent leur supériorité sur les danseurs. En même temps, on enleva à ceux-ci les masques qu’ils portaient et les accoutrements grotesques qui convenaient aux farces du théâtre italien mais non à un art qui allait se distinguer par toujours plus de grâce.
Pécourt, qui succéda à Beauchamp, inventa de nombreuses danses appelées « galantes ». Elles sont décrites, avec celles de Beauchamp, dans l’ouvrage de Feuillet : La Chorégraphie ou l’art de décrire la danse.
Au commencement du XVIIIème siècle, la comédie-ballet fut remplacée par le ballet-pantomime devenu le ballet d’aujourd’hui. La duchesse du Maine, qui eut l’idée de cette transformation, fit mettre en musique par Mouret, comme pour les chanter, les vers des Horaces qui furent mimés par les danseurs. Chamfort devait demander plus tard, en plaisantant, qu’on fit danser les Maximes de La Rochefoucauld. On a vu danser depuis sur des sujets encore plus hermétiques, du Schopenhauer pat exemple, à qui des danseuses « inspirées » rendirent ainsi la monnaie de ses boutades contre les femmes. La création du ballet-pantomime spécialisa davantage 1es danseurs en les distinguant complètement des comédiens et des chanteurs. L’expression des sentiments de leurs personnages n’étant plus que dans leurs gestes, ils donnèrent à leur mimique et à leur danse une perfection grandissante. Marcel, le grand maître de danse de l’époque, s’efforça de débarrasser la danse de tout ce qui était disgracieux et de la rendre distinguée. Son enseignement fut réalisé surtout par le danseur Dupré, appelé « l’Apollon de la danse ». Son successeur, Noverre fit atteindre à la danse dramatique tout son éclat en formant des élèves comme Gardel et surtout les Vestris. Le musicien Rameau avait fait paraitre son maitre à danser en 1748. Noverre écrivit ses Lettres sur les arts en général et la danse en particulier (1760). Les écrits de Rameau et de Noverre et les perfectionnements pratiques réalisés fournirent les éléments de l’ouvrage le plus complet qui soit paru sur la danse, celui de Magny, Principes de chorégraphie (1765).
Noverre mit à la scène les ballets des opéras de Gluck et de Piccinni où brillèrent les Vestris non sans que Gluck, en particulier, ait eu des démêlés avec eux. Le succès des Vestris fut immense. L’aîné, Gaëtan, fut aussi remarquable par sa vanité que par son talent. Il disait : « Il n’y a que trois grands hommes au monde : moi, Voltaire et le roi de Prusse ». Gluck devait se taire devant ce « grand homme » qui voulait bien danser sur sa musique. Toute la Cour allait chez les Vestris pour apprendre les révérences. Mais les grands danseurs allaient être éclipsés par les grandes danseuses. Les premières furent Mlle Prévost, son élève et sa rivale la Camargo qui la première « battit l’entrechat à quatre », et Mlle Sallé qui passa du Théâtre de la Foire à l’Opéra. Vinrent ensuite la Guimard, célèbre par ses folies amoureuses autant que par sa danse, et nombre d’autres, sans oublier Mlle Bigottini qui fit pleurer tout Paris par l’expression de sa mimique dans Nina ou la Folle par amour.
A la suite de Lulli, Mozart, Rameau, Méhul, Berton, Cherubini, Kreutzer, écrivirent la musique des ballets. Mais ce n’est qu’après la Révolution et l’Empire que ce genre prit toute son importance et que les musiciens lui donnèrent une réelle originalité.
Le corps de ballet de l’Opéra, sinon la danse, occupa a côté des chanteurs, une grande place dans les fêtes de la Révolution. Il dut se multiplier pour participer aux cérémonies nationales. (Voir Julien Tiersot : Les fêtes et les chants de la Révolution Française). Mais la cérémonie où la danse aurait eu le plus de part n’eut pas lieu. Le programme en avait été préparé par David pour le transfert au Panthéon des cendres de Bara et Viala. Les danseurs y participaient autant que les musiciens et les chanteurs, comme dans la chorodie antique. Ils devaient exprimer les regrets de patriotes « par des pantomimes lugubres et militaires », puis, dans l’apothéose, « pendant que les danseuses, d’un pas joyeux, répandraient des fleurs sur les urnes et feraient disparaître les cyprès, les danseurs, par des attitudes martiales, célèbreraient la gloire des deux héros ». La chute de Robespierre arrêta la réalisation de ce programme. La danse allait prendre une allure moins héroïque pour participer aux orgies de la République de Barras. Pendant la Révolution, on représenta dans les théâtres des ballets de circonstance comme la Rosière républicaine ou deux danseuses, costumées en religieuses, dansèrent avec Vestris qui était en « sans-culotte», dans le costume que les révolutionnaires avaient emprunté aux images du dieu Atys le Phrygien.
Lorsque l’art fut débarrassé du joug napoléonien et qu’il connut l’épanouissement de l’époque romantique, la danse dramatique vit s’ouvrir devant elle de nouveaux horizons. M. de La Rochefoucauld, continuant la tradition des maniaques de tous les siècles, avait voulu allonger les jupes des danseuses sous la Restauration. On les raccourcit au contraire jusqu’à la taille en créant le « tutu ». En même temps, la danseuse se dressant sur les « pointes », gravit ce que M. Levinson appelle lyriquement, de nos jours, le « deuxième échelon de l’ascension verticale de l’humanité », le premier ayant été franchi lorsque le quadrumane redressa son échine pour marcher sur ses pattes de derrière. C’est le piqué, ou danse sur les pointes des pieds, renouvelé d’ailleurs de la Grèce et de la Renaissance, qui réalise ce noble symbole, crée « l’axe de l’aplomb », émancipe la forme humaine de ce que Nietzsche appelait « l’esprit de pesanteur » et constitue ainsi « un sommet de l’art idéaliste ». Bien des demoiselles de ballet ne pensent pas à toutes ces choses lorsqu’elles se dressent sur leurs orteils.
Hérold, Schneittzhoeffer et Adolphe Adam, composèrent les nouveaux ballets appelés « d’action » où triomphèrent ces « étoiles » dont les principales furent Marie Taglioni, Fanny Elssler et Carlotta Grisi. Les succès de Taglioni furent dans la Belle au bois dormant, la Sylphide, la Révolte au Sérail, la Fille du Danube. Ceux de Fanny Elssler dans le Diable boiteux et la Tarentule. Carlotta Grisi triompha dans Giselle, la Jolie fille de Gand et le Diable à quatre. Plus près de nous, Léo Delibes écrivit ces œuvres charmantes qui sont Coppelia et Sylvia. D’autres musiciens produisirent Namouna (Lalo), la Korrigane (Widor), les Deux pigeons (Messager), la Maladetta (Vidal), l’Etoile (Wormser).
La dernière forme de ces ballets a été dans la présentation de grands ensembles chorégraphiques faisant manœuvrer des masses nombreuses de danseurs et de figurants. Elle a pris tout son développement en Italie, dans les ballets-spectacles appelés Sieba, Excelsior, Messaline. Elle est demeurée dans le music-hall où l’on fait évoluer, pour des effets les plus inattendus et les plus étrangers à l’art, des armées de danseuses. C’est ainsi qu’un des « clous » de ce genre de spectacle fut, pendant la guerre, le défilé des drapeaux de toutes les nations alliées présentés sur des bataillons de fesses féminines. Les callipygies les plus opulentes étaient, bien entendu, réservées patriotiquement aux couleurs françaises et avaient le plus de succès. Ces exhibitions de « marcheuses », de « girls », de petites « grues », de grosses « poules », dévêtues sous des oripeaux de couleurs criardes et des flots de lumière violente, gigotant aux sons d’orchestres qui font comprendre pourquoi Th. Gautier considérait la musique comme le plus insupportable de tous les bruits, sont de véritables marchés de pauvre viande humaine où les cochons viennent s’exciter mais d’où l’artiste et l’homme simplement normal sortent écœurés. Le corps humain mérite d’autres apothéoses que celles de la prostitution. Les titres de ces spectacles, qui raccrochent comme les lanternes des maisons à gros numéros, suffisent pour les faire juger.
A côté des ballets « d’action », la tradition des divertissements dansés mêlés aux opéras se continua pendant tout le XIXème siècle avec la plus grande faveur. Wagner lui-même ne put faire représenter Taunhauser à l’Opéra, en 1861, qu’en acceptant d’introduire dans son ouvrage le ballet du Vénusberg, et encore ne parvint-il pas à vaincre la cabale du Jockey-Club soulevée contre la « musique de l’avenir ». Malgré ce, bien des compositeurs, Berlioz en tête, protestaient contre les ballets d’opéra, leur reprochant de « brutaliser l’idée du musicien », et lorsque l’art wagnérien parvint à s’imposer, la danse fut peu à peu éliminée du « drame lyrique ».
Aujourd’hui les deux genres paraissent bien séparés, ayant chacun son expression propre. C’est dans la danse, et à la suite de l’essor que lui ont donné les ballets russes, que se manifestent les initiatives les plus intéressantes, non seulement scéniques mais aussi musicales. Alors que la musique dramatique ne s’est plus renouvelée, sauf quelques exceptions, depuis Wagner (voir : Musique), la musique de danse s’est évadée, avec la danse elle-même, vers les formes les plus neuves et les plus hardies, entraînant par un renouvellement constant la curiosité des esprits qui ne sont pas incrustés dans un conservatisme imbécile. Plus que tous les arts, 1a danse dramatique donne en ce moment l’impression de la vie multiforme et toujours jeune. Elle va « par-delà les tombeaux », à l’avant-garde de l’art et n’attend plus qu’une véritable inspiration populaire, née de l’enthousiasme de tout un peuple, pour atteindre à sa plus haute expression. Elle s’est débarrassée des conventions de l’ancien ballet, de ce qui était à la mode et par conséquent éphémère, sans racine profonde. Elle s’est rapprochée de la pantomime pour rendre au geste l’éloquence qu’il avait perdue et l’émotion qu’il n’inspirait plus. Elle a rendu à la vie et à ses variétés infinies les mouvements qui s’étaient figés dans des attitudes. Les acrobaties les plus hardies lui permettent d’ajouter à la grâce du corps humain toute sa souplesse, son adresse et son audace. Certes, la danse nouvelle n’est pas débarrassée des loufoqueries du snobisme ; elle subit comme tous les arts la tutelle malsaine de l’argent et des imbéciles qui confondent le grotesque et le beau ; mais elle s’affirme, malgré tout, comme la forme la plus indépendante et la plus vivante du vieil instinct humain qui aspire à la beauté et qui trouva de tout temps dans la danse, son expression la plus complète et la plus sincère, celle de la ligne et du mouvement que ne trahit pas le mensonge de la parole.
Il y a, devant la façade morne de ce monument qu’on appelle l’Opéra de Paris et dont on pourrait faire tout ce qu’on voudrait, une balle, une gare, sauf un temple de la musique, une œuvre qui jette sur lui un rayonnement incomparable : c’est le groupe de la danse de Carpeaux. Il n’est peut-être rien qui soit si admirable dans l’immense ville où se côtoient toutes les beautés et toutes les laideurs. Il est le plus magnifique sourire de la joie humaine. Vienne le temps où la danse, ayant retrouvé la santé et la pureté sera, avec les autres arts, victorieuse de toutes les aberrations pour exprimer le bonheur des hommes. Alors, devant la Maison du Peuple, on pourra mettre à sa véritable place la danse de Carpeaux pour dire à tous :
« C’est ici le palais de la vie, de la joie, de la beauté ».
-Edouard ROTHEN.
DARWINISME
n. m.
Système philosophique qui prit corps dans la théorie de l’évolution, précisée par le célèbre naturaliste anglais Charles Robert Darwin (18091882) dans son ouvrage sur L’Origine des espèces au moyen de la Sélection naturelle,
Lamarck, le grand naturaliste français (1744–1829) avait déjà tenté de démontrer qu’il existait entre les diverses espèces animales et végétales, et entre les individus de ces espèces, une lutte constante pour la possession des substances ; le système de Lamarck ne fut pas écouté et lorsqu’en 1830 Etienne Geoffroy Saint Hilaire s’y rallia, il fut vaincu en Académie des Sciences par les arguments de Cuvier combattant l’hypothèse de Lamarck.
Après Lamarck, mais avec une somme de matériaux beaucoup plus considérable, Darwin entreprit de démontrer que dans la bataille que se livrent les diverses espèces et les individus les composant, les plus forts, les plus vigoureux, les plus sains triomphent toujours et que les plus faibles sont éliminés par voie de « Sélection naturelle ». Il en résulte une transformation continuelle des espèces et des individus.
S’appuyant sur de multiples observations, Darwin déclare que les espèces et les individus qui subissent des modifications consécutives à la bataille pour la vie (struggle for life) sont des éléments perfectionnés, puisque les autres disparaissent dans la mêlée. « La lutte constante pour l’existence détermine la conservation des déviations de structure ou d’instinct qui peuvent être avantageuses ».
Si l’on prend au mot et à la lettre les théories issues des déductions darwiniennes on en arrive à conclure que les espèces et les individus vont se modifiant, se transformant et s’améliorant chaque jour. C’est du reste ainsi que conclut Darwin : « Comme toutes les formes actuelles de la vie descendent en ligne directe de celles qui vivaient longtemps avant l’époque cambrienne, nous pouvons être certains que la succession régulière des générations n’a jamais été interrompue et qu’aucun cataclysme n’a bouleversé le monde entier. Nous pouvons donc compter avec quelque confiance sur un avenir d’une incalculable longueur. Or, la Sélection Naturelle n’agit que pour le bien de chaque individu, toutes les qualités corporelles et intellectuelles doivent progresser vers la perfection ».
Le darwinisme a donné naissance à diverses écoles rivales et particulièrement à celle des néo-lamarckiens et celle des néo-darwiniens. Le Dantec (1869–1917), l’éminent biologiste français, a tenté de concilier ces deux écoles en démontrant que Lamarck et Darwin n’étaient nullement opposés l’un à l’autre et que la vie des espèces et des individus était soumise à deux influences : l’hérédité et l’adaptation. C’est sur ce principe que repose le transformisme actuel.
Bien des individus entraînés dans la lutte sociale se demandent quel intérêt présente pour les classes opprimées ces diverses écoles scientifiques, et si ce n’est pas une simple spéculation philosophique que de rechercher quelles sont les origines des espèces et la façon dont la vie s’est transmise à travers les siècles. Le darwinisme a exercé une très grosse influence non seulement dans le domaine scientifique mais aussi dans le domaine social, et ce serait une erreur de croire que la classe ouvrière n’est pas servie par les recherches et les découvertes des savants.
En démontrant que « les êtres ont habité le globe dès une époque dont l’antiquité est incalculable, longtemps avant le dépôt des couches les plus anciennes du système cambrien » (Darwin, l’Origine des Espèces) c’est-à-dire depuis des centaines de milliers d’années, la science naturaliste a détruit la légende de la création du monde « puisque la vie ne peut être engendrée que par la vie ».
Sur le terrain social nous ne pouvons certes pas partager entièrement l’optimisme du darwinisme. S’il est vrai que pour les espèces végétales et les espèces animales inférieures, la Sélection naturelle agit avantageusement et que la lutte pour l’existence élimine les individus tarés pour ne laisser subsister que les êtres forts ; d’autres facteurs entrent cependant en jeu surtout lorsqu’il s’agit des espèces supérieures et plus particulièrement de l’espèce humaine.
L’espèce humaine, pas plus que les autres espèces, n’échappe au « struggle for life » et la lutte entre les divers individus de l’espèce humaine se poursuit sans cesse. Cette bataille pour l’existence est la source de l’évolution continuelle et ininterrompue de la race humaine, mais les hommes ne peuvent pas attendre simplement de la Sélection naturelle la perfection de l’espèce et de l’individu.
L’homme combat pour sa vie contre les autres hommes et tous les facteurs qui déterminent ce combat nous portent à croire que les plus forts triompheront ; mais les plus forts ne sont pas forcément les meilleurs. Ce n’est pas physiquement que se manifestent 1a faiblesse des uns et la supériorité des autres. Les individus qui se trouvent en haut de l’échelle sociale, éduqués au grand livre de la science, profitent de tontes les découvertes, étudient tout ce qui peut être une arme utile dans le combat de géant que se livrent les individus de l’espèce humaine, tandis que ceux qui sont en bas de l’échelle sociale sortent à peine de l’ignorance, et subissent encore l’influence néfaste de leurs sentiments. Ce sont ces sentiments qu’il faut détruire pour n’être enfin conduit que par 1a raison. La Sélection naturelle est un cas du problème de l’Evolution ; elle a consolidé les principes, mais elle n’est pas tout et il faut tenir compte des autres facteurs. La perfection de l’homme ne sera réalisée que lorsque l’individu débarrassé de tout préjugé sera éclairé à la lumière de la science.
« Le raisonnement » nous dit Le Dantec « nous enseigne que la lutte est la grande loi, mais le raisonnement scientifique est incomplet ; il ne tient pas compte des vieilles erreurs qui sont peut-être ce que nous avons de meilleur en nous ; la dernière lutte dont nous devrions parler ici est la lutte du sentiment contre la raison » (Le Dantec, La lutte universelle). Le Dantec a raison il ne faut pas parler de la lutte du sentiment contre la raison, mais de celle de la raison contre le sentiment. Ce n’est que par le triomphe de la raison que l’espèce humaine et l’individu se transformeront, s’amélioreront et se perfectionneront.
- J. C.
DARWINISME
Historique — Les précurseurs de Darwin — Son œuvre
On donne le nom de darwinisme à l’ensemble des théories du naturaliste anglais Charles Robert Darwin qui, réduites à leur plus simple expression, se ramènent à cette formule : l’homme descend du singe. Ce n’est là qu’une partie du système de Darwin, et c’est une interprétation erronée que de voir uniquement dans le darwinisme la théorie qui fait descendre l’homme du singe. Mais c’est ainsi que le fanatisme a envisagé dès sa naissance l’évolutionnisme darwinien qui, expliquant l’origine des êtres vivants, donc de l’homme, par des lois naturelles, détruisait du même coup la création divine de l’homme selon la Bible. Et c’est bien, en somme, la conclusion des travaux de Darwin qui ne s’est exprimé au sujet de l’origine de l’homme qu’à demi-mot, ayant tenu à s’entourer de précautions oratoires afin de ne pas choquer la susceptibilité de ses lecteurs, tolérance dont on ne lui sut aucun gré. Darwin n’a d’ailleurs pas été le premier à soutenir cette théorie subversive, mais son mérite a consisté à l’exposer d’une façon originale et par-là même à la créer une seconde fois. L’idée avait déjà fait du chemin lorsque Darwin se présenta pour l’aider à continuer sa route semée d’obstacles. Si Lamarck a été le père du transformisme, Charles Darwin en fut le tuteur. Le transformisme est la doctrine d’après laquelle toutes les espèces, animales et végétales, descendent d’un type ou de types originels peu nombreux, par voie de transformation. Si ces espèces, dont l’origine est commune, ont pu varier, c’est, répond Darwin, grâce à la sélection naturelle qui a assuré la survivance du plus apte. Le darwinisme était une interprétation nouvelle du transformisme : il présentait sous un jour différent cette doctrine qui ruinait le principe de la fixité des espèces, soutenue par la réaction religieuse et scientifique. Non seulement le « darwinisme » nous révèle un des côtés du transformisme, mais il nous oblige à l’examiner dans son ensemble ; l’étudier c’est connaître celui-ci dans ses tenants et ses aboutissants, c’est pénétrer au cœur même de la biologie.
« Le transformisme, c’est-à-dire la théorie d’après laquelle les espèces animales et végétales vivant actuellement descendraient d’espèces antérieures et différentes » (Le Dantec), est une des hypothèses scientifiques les plus fécondes qui, comme toutes les hypothèses créatrices, a partagé l’humanité en deux camps, et permis ainsi de reconnaître les esprits d’avant-garde et ceux qu’on pourrait qualifier justement d’arrière-garde. Cette hypothèse qui a fini par s’imposer aux esprits n’est pas nouvelle : elle existait en germe chez les philosophes de l’antiquité. Il faudrait remonter à Lucrèce, à Aristote et même plus loin pour trouver les ancêtres de l’évolutionnisme. Le moyen-âge lui-même l’a pressenti. Pendant la Renaissance, Bacon croyait que les mutations d’espèces étaient dues à des variations accumulées. Le siècle de Louis XIV n’a pas ignoré les grandes lois directrices de l’évolutionnisme ; en cherchant bien, on les découvrirait dans quelques auteurs. Au XVIIIème siècle, où tant d’idées s’ébauchèrent ou se précisèrent, l’évolutionnisme fut soupçonné. Un certain Benoît de Maillet, auteur des Entretiens d’un Philosophe indien avec un missionnaire français sur la diminution de la mer (1748), raillé par Voltaire, qui voyait dans cet écrivain un partisan de la Bible, soutenait que la mer primitive était le berceau de la vie, s’appuyant sur ce fait que des fossiles marins avaient été trouvés dans un terrain montagneux. De Maillet n’examinait pas seulement la façon dont s’était constitué l’univers, mais il examinait en détail le problème de l’origine des êtres vivants. Pour De Maillet rien ne se perd dans la nature. Les mondes se renouvellent sans cesse, ils exercent une attraction les uns sur les autres, des germes ou semences peuplent l’univers, que les planètes recueillent au passage. Les espèces animales et végétales n’ont pas été créées en même temps, mais elles sont apparues successivement, sous l’influence de circonstances favorables, à mesure que les mers ont baissé. Des semences proviennent toutes les espèces marines, d’où sont issues les espèces terrestres et aériennes, dont l’homme fait partie. Les herbes et les plantes, comme les animaux, ont la mer pour origine. Le transformisme de Maillet, reposant sur des réflexions souvent justes, ne fut pas compris par Voltaire qui y voyait, avons-nous dit, une thèse en faveur du déluge, l’eau jouant le principal rôle dans le système exposé par le philosophe indien. Pour Voltaire, les coquilles font éclore des systèmes nouveaux ! L’origine aqueuse des êtres est une plaisanterie. « Il y a peu de gens qui croient descendre d’un turbot ou d’une morue ». Cette appréciation de Voltaire prouve tout simplement que des esprits libérés ne comprennent pas toujours d’autres esprits libérés.
Vingt ans après les Entretiens d’un philosophe indien, en 1768, René Robinet expose des idées intéressantes dans ses Considérations philosophiques de la gradation naturelle des formes de l’être ou Essais de la nature qui apprend à faire l’homme. Pour Robinet, la nature ne fait point de sauts, elle est un tout continu. Il n’établit aucune distinction entre la matière brute et la matière organisée. Tout dans la nature est vivant. Tout être est un animal. L’univers lui-même est un animal. Il n’y a dans la nature que des individus, qui jamais ne se répètent. Tout change, se transforme, varie. Aucun être ne ressemble à un autre. Robinet, prévoyant le surhomme, admet qu’il peut y avoir « des puissances plus actives que celles qui composent l’homme ». Des mondes nouveaux peuvent se produire. L’homme est un chef-d’œuvre sorti d’une foule d’ébauches. L’orang-outang est une de ces ébauches. Certaines pierres imitent le cœur et le cerveau de l’homme. Robinet parle d’hommes marins, et il entrevoit le règne des hermaphrodites, réunissant les attributs de Vénus et d’Apollon. Il n’y a point d’espèces pour Robinet, mais seulement des individus différents qui ont tiré leur substance du fonds commun de la nature, tandis que pour De Maillet il y avait des espèces nées les unes les autres par transformation.
Arrivons à Buffon (1707–1788). Buffon rassembla des faits et fit de nombreuses observations. Ce naturaliste était aussi grand savant que grand écrivain. Buffon n’était pas, comme pourraient le faire supposer certains passages de son Histoire naturelle (1749), partisan de la fixité des espèces. S’élevant contre le système de classification adopté par Linné, comme compromettant la fixité des espèces, que Linné admettait d’ailleurs, Buffon en arrive à montrer le bien fondé du transformisme, tout en s’opposant à lui : « Si l’on admet une fois, disait-il, qu’il y ait des familles dans les plantes et dans les animaux, que l’âne soit de la famille du cheval et qu’il n’en diffère que parce qu’il a dégénéré, on pourra dire également que le singe est de la famille de l’homme, qu’il est un homme dégénéré, que l’homme et le singe ont une origine commune, comme le cheval et l’âne ; que chaque famille, tant dans les animaux que dans les végétaux, n’a eu qu’une seule souche, et même que tous les animaux ne sont venus que d’un seul animal, qui, dans la succession des temps, a produit, en se perfectionnant ou en dégénérant, toutes les races des autres animaux. Darwin et Haeckel ne diront pas autre chose. Dans l’œuvre de Buffon, on trouve des arguments pour et contre le transformisme. Tantôt, il se montre partisan de la fixité des espèces, celles-ci étant à peu près aujourd’hui ce qu’elles étaient quand Dieu les a créées, tantôt il annonce l’évolutionnisme. Il est certain que Buffon est gêné par ses croyances religieuses. Buffon ne peut réaliser ce miracle de concilier sa science et sa foi. C’est pourquoi on trouve de tout dans ses écrits, et la pensée libre comme la pensée esclave peuvent y puiser des arguments. Buffon fut à la fois partisan de l’invariabilité et de la mutation et dérivation des espèces. Position intenable ! Il admettait que les planètes ont un père commun, le Soleil, et que la Terre a son histoire comme l’homme. Sa conception du monde le rapproche du transformisme, en lui faisant écrire (tome IX de l’Histoire naturelle), que « bien que la nature se montre toujours et constamment la même, elle roule néanmoins dans un mouvement continuel de variations successives, d’altérations sensibles ; elle se prête à des combinaisons nouvelles, à des mutations de matière et de forme, se trouvant différente aujourd’hui de ce qu’elle était au commencement et de ce qu’elle est devenue dans la succession des temps ». De ce que les animaux d’un continent ne se trouvent pas dans l’autre, Buffon conclut que la nature des animaux « peut varier et même se changer avec le temps », et que les espèces « les moins armées ont déjà disparu ou disparaîtront ». N’est-ce pas là cette sélection naturelle que nous allons retrouver chez l’auteur de l’origine des espèces ? Non seulement on trouve Darwin dans Buffon, mais aussi Lamarck ; car il tient compte de l’influence du milieu, c’est-à-dire le climat, la nourriture, etc... Transformiste, on ne saurait dire que Buffon le soit d’une façon bien nette ; son transformisme est timide, mais enfin il n’est pas niable. De plus, Buffon n’est point finaliste, il ne pense pas que la nature se soit jamais proposée une fin dans la composition des êtres. Pour Buffon, le végétal tire du minéral les molécules indispensables à sa nutrition, comme les animaux les tirent du végétal. Mais Buffon ne va pas plus loin, et sa doctrine est toujours modérée, comme l’homme lui-même. L’intendant de Jardin du Roi n’aimait point les polémiques. Batailler n’était point dans ses habitudes. Cet homme, qui mettait des manchettes pour écrire, aimait sa tranquillité. La sérénité fut la marque distinctive de son caractère. Ainsi, pour l’homme de génie qu’était Buffon, prisonnier de la tradition par certains côtés, les animaux ont subi des modifications dues à la température, au climat et à l’alimentation. Il explique l’origine de la terre et de la vie par l’évolution. Il faut croire que les opinions de Buffon étaient quelque peu subversives pour l’époque, puisque la Sorbonne s’émut, porte-parole de l’Eglise. Comme Galilée niant l’immobilité de la Terre, Buffon dut se rétracter, quitte ensuite à revenir à ses premières idées, quand il eut assez de prestige pour le faire, quinze ans plus tard.
Combien Lamarck (1744–1829) est différent qui, essayant, lui aussi, de ne pas trop contredire ses croyances, en arrive à libérer cependant sa conscience, et ne s’arrête plus à des considérations accessoires ! Il est vrai que depuis Buffon il y avait eu quelque chose de nouveau dans le monde. Ce quelque chose, c’était la Révolution. Il convient de considérer dans Lamarck le père du transformisme, que l’officiel Cuvier, adepte du créationnisme et inventeur du catastrophisme biblique, réduisit presque à la mendicité. Lamarck a exposé son système dans sa Philosophie Zoologique (1809) et son Histoire des animaux sans vertèbres (1815–1822, 7 vol.).
Buffon avait encouragé Lamarck qui avait publié sous ses auspices en 1778 une Flore française en trois volumes. Il lui avait même confié l’éducation de son fils. La carrière de botaniste de Lamarck s’annonçait brillante (on lui doit la méthode dichotomique encore en usage aujourd’hui), lorsque la Révolution l’orienta dans une autre direction : deux chaires de zoologie ayant été créées au Muséum, la Convention lui en confia une, celle des animaux sans vertèbres. Lamarck apporta en zoologie la méthode qu’il avait employée avec succès pour les plantes. Chose singulière, le père du transformisme avait d’abord été anti-transformiste en botanique. L’esprit critique modifia par la suite sa manière de voir, qui s’exprima pour la première fois dans son Discours d’ouverture du Cours de l’an VIII. Dans l’appendice de ses Recherches sur l’organisation des corps vivants, il dira avec noblesse : « J’ai longtemps pensé qu’il y avait des espèces constantes dans la nature, et qu’elles étaient constituées par des individus qui appartenaient à chacune d’elles. Maintenant, je suis convaincu que j’étais dans l’erreur à cet égard et qu’il n’y a réellement dans la nature que des individus ». Comme il est réconfortant d’entendre un véritable savant confesser une erreur, et marcher résolument dans la voie de la vérité. En 1802, dans son Hydréologie, il défendit la doctrine des évolutions insensibles en géologie par le jeu des causes actuelles ; il fut en somme le premier paléontologiste des Invertébrés, et ses vues en géologie contribuèrent certainement à préparer ses idées sur l’évolution des êtres vivants » (V. Delbos). Le naturaliste philosophe étudia les animaux sans vertèbres, qu’il qualifie de « singuliers animaux ». « Toute science, disait-il, doit avoir sa philosophie ... Ce n’est que par cette voie qu’elle fait des progrès réels ». Lamarck peut être considéré comme le fondateur de la Biologie, nom qu’il a donné à l’explication scientifique des phénomènes naturels dans lesquels la vie entière doit entrer.
Pour Lamarck, dont le génie divisa les animaux en invertébrés et en vertébrés, les espèces ne nous semblent fixées que parce que nous les considérons pendant un temps très court, tandis qu’elles se transforment constamment. Les espèces descendent les unes des autres par la transmission des variations, et l’homme n’échappe pas à la loi commune : il ne constitue pas une exception en dehors de la règle. Il est soumis aux mêmes lois que tous les êtres. Les animaux se transforment, mais sous quelles causes ? Le milieu extérieur influe sur la forme et l’organisation des êtres. Ne croyez pas que ce soit là une influence directe, vous méconnaîtriez la pensée de Lamarck, qui s’est expliqué suffisamment à ce sujet. L’animal ne subit point passivement l’influence du milieu extérieur, des facteurs internes, parmi lesquels l’habitude, née des besoins, entraînant l’usage ou non d’un organe (d’où modification ou disparition de cet organe) joue un rôle essentiel. Il y faut joindre l’hérédité. Lamarck, comme Buffon, a entrevu la loi de sélection naturelle. Cependant, pour lui, le progrès des êtres ne provient point de leurs conflits. L’inorganique passe selon Lamarck à l’organique, mais entre l’homme et les animaux supérieurs ont dû exister des intermédiaires ; l’homme a sans doute eu pour précurseur un quadrumane arboricole, voisin du singe.
Lamarck a été l’un des premiers à reconnaître le rôle joué dans l’origine de la vie par les forces physicochimiques. Il a parlé avant Huxley et Haeckel, de « petites masses de matières gélatineuses » douées de mouvement et d’irritabilité. La nature produit des générations spontanées en ce qui concerne les êtres rudimentaires, d’où descendent les espèces les plus élevées. Ces modifications ont été graduelles, et se sont produites sous l’influence du milieu et de l’habitude. Les besoins des animaux changeant leurs habitudes, leur organisation change également. L’emploi d’un organe développe cet organe, le non-usage l’atrophie. D’où des transformations progressives, et des transformations régressives. Lamarck explique par ces transformations l’apparition des espèces. Son œuvre fourmille d’exemples. Les carnassiers ont des griffes parce que les circonstances les ont obligés à manger de la chair. Chez les mammifères aquatiques le bassin a disparu, n’ayant pas d’utilité, tandis que les chez les mammifères terrestres les nécessités de la locomotion l’ont développé. Les fossiles nous prouvent que ces animaux n’avaient point les mêmes besoins que leurs descendants, dont ils diffèrent.
L’évolutionnisme s’élevait contre le récit de la genèse, d’après lequel les animaux ont été créés une fois pour toutes, selon un type déterminé et immuable, alors que la raison appuyée sur l’observation fait sortir les espèces d’espèces antérieures par évolution ou différenciation, sous l’influence de diverses causes. Avec Lamarck, le dogme de la fixité de l’espèce s’écroule. L’être n’est point stable, mais varie lentement, donnant naissance à de nouvelles espèces. Lamarck ne s’expliquait point, il est vrai, pourquoi les Paléothériums et les Mastodontes s’étaient éteints ; il pensait que nos ancêtres les avaient détruits. On peut objecter à Lamarck que le besoin ne crée pas toujours l’organe. Vraie ou non, sa théorie n’en a pas moins puissamment contribué à dissiper l’ignorance.
On voit combien la pensée de Kant était fausse, lorsqu’il disait dans sa Critique du Jugement, ne pouvant expliquer autrement que par la finalité la genèse de l’être organisé : « Il est absurde d’espérer que quelque nouveau Newton viendra un jour expliquer la production d’un brin d’herbe par des lois naturelles auxquelles aucun dessin n’a présidé ». En dépit de Kant, ce Newton est venu, il avait nom Lamarck.
Gœthe (1749–1832), peut être considéré comme l’un des précurseurs du transformisme. Dans ses recherches sur les Métamorphoses des Plantes (1790), le grand poète examine les organes dans ce qu’ils ont de commun, leur forme originelle, ensuite les modifications de cette forme originelle, ensuite les modifications de cette forme. Les organes de la plante sont, d’après lui, le résultat de la métamorphose de la feuille. Toute forme — et il appliquait cette théorie à la boîte crânienne qu’il considérait comme composée de vertèbres modifiées — recèle le type primitif qui se modifie sous l’influence du milieu. Chez Gœthe le transformisme était encore une vue de l’esprit. Il n’en tira pas toutes les conséquences que devait en tirer Lamarck.
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772–1844), dont l’enseignement fut continué par son fils Isidore (1805–1861), est aussi l’un des précurseurs du Darwinisme. C’est à lui que la Convention avait confié une des deux chaires de zoologie, du Jardin des Plantes, qui fut consacrée aux vertébrés. Geoffroy Saint-Hilaire fut l’un des adversaires de Cuvier, créationniste impénitent. Il servit grandement les idées de Lamarck, qu’il défendit contre le grand pontife de l’époque. L’auteur de la Philosophie anatomique admet la mutualité des espèces, comme celui de la Philosophie zoologique, mais il l’explique différemment. Il supprime la réaction de l’individu, dont Lamarck tenait grand compte. L’influence du milieu n’est plus indirecte, mais directe. L’animal reste passif au sein des transformations qu’il subit. Geoffroy Saint-Hilaire reconnaît que les espèces actuelles proviennent d’espèces fossiles, l’absence d’intermédiaires n’ayant point l’importance que lui attribue Cuvier. Proche de Lamarck sous certains rapports, il s’en éloigne sous d’autres : il n’y a point de type unique pour lui, malgré l’unité de composition organique qui existe, croit-il, dans la série animale. On sait qu’Etienne Geoffroy Saint-Hilaire a découvert un véritable système dentaire chez les oiseaux et que pour lui la tête est formée d’un ensemble de vertèbres. Non seulement il a signalé les analogies qui existent entre les squelettes des vertébrés, mais il a fondé l’embryologie et fait concourir la tératologie ou étude des êtres anormaux à l’étude vies êtres normaux.
Il était réservé à Charles-Robert Darwin (1809–1882) de faire triompher les idées transformistes que Lamarck avait le premier défendues d’une façon précise. Quarante-quatre ans après l’Histoire des animaux sans vertèbres, Darwin publiait son Origine des Espèces, qui attira l’attention sur une théorie sur laquelle on faisait systématiquement le silence dans les Universités. Darwin avait lu le Traité de la Population de Malthus (voir Malthusianisme) qui le mit sur la voie, car Malthus y parlait de la disparition des individus moins bien doués que les autres. Son grand-père Érasme Darwin, médecin et poète, auteur des Amours des Plantes, qui reconnaissait une parenté réelle entre l’aile de l’oiseau et le bras de l’homme, l’avait lui-même précédé. Oken, Haeckel, Spencer et d’autres philosophes anglais et allemands ont servi la cause du darwinisme, soit en lui préparant le terrain, soit en prenant fait et cause pour lui. L’illustre géologue anglais Charles Lyell, dont Darwin avait épousé la cousine, avait engagé la géologie sur le chemin de l’évolutionnisme avec Les principes de géologie (1830), livre dans lequel il combattait le catastrophisme cuviérien en expliquant les transformations subies par le globe terrestre dans le passé par les mêmes causes que les phénomènes, actuels (théorie des causes actuelles). Il devait aussi écrire un ouvrage sur l’ancienneté de l’homme prouvée par la géologie. Enfin, n’oublions pas que la formule « L’homme descend du singe » est due à Huxley qui, d’abord partisan de la Bible, se rallia à l’hypothèse darwinienne, qu’il généralisa en l’appliquant à l’homme. Comme Huxley était moins prudent que Darwin, il y gagna de perdre sa chaire de professeur, alors que son ami obtint les honneurs officiels.
A quoi tiennent les découvertes scientifiques, les systèmes philosophiques ou autres ? Le hasard y joue souvent un grand rôle. Nous devons au nez de Darwin de pouvoir parler aujourd’hui de l’évolutionnisme ! Darwin avait décidé de faire un voyage sur le Beagle, bateau peu solide, sur lequel il fallait un certain courage pour s’embarquer. « Ce voyage a été de beaucoup, nous dit-il, l’événement le plus important de ma vie et a déterminé ma carrière scientifique ». Or, ce voyage dépendit de la forme de son nez, Darwin ayant voulu prouver aux disciples de Lavater qu’il ne manquait point d’énergie. Sans le nez de Darwin nous ne saurions peut-être pas que l’homme descend du singe. Il a joué dans l’histoire un rôle aussi grand que celui de Cléopâtre ! Pendant cinq ans, Darwin explora l’Amérique du Sud et les îles du Pacifique, il recueillit dans ce voyage une foule de matériaux pour l’Origine des espèces. Mais il ne se décida que très tard à exposer son système. Nul travail ne fut moins improvisé. Vingt ans Darwin médita son sujet, et il ne mit le public au courant de ses travaux que sur l’insistance de ses amis.
Darwin se plaçait à un autre point de vue que Lamarck. Il ne cherchait nullement l’origine de la vie et ne croyait pas à la génération spontanée. Il philosophe le moins possible, laissant ce soin à ses amis, et se contente d’accumuler des faits et d’en tirer les conclusions. Avec lui, il ne s’agit plus de l’influence du milieu, mais de la sélection naturelle. Darwin constatait que plus de cent formes animales transmissibles par voie de reproduction normale dérivent d’une forme spécifique unique : toutes les races de pigeons descendent du biset seul. Darwin retrouvait dans la nature la sélection opérée par les éleveurs, qui font varier les espèces. D’un nombre restreint d’espèces la nature a fait naître de nombreuses espèces, au moyen de la lutte pour la vie dans laquelle triomphe le plus apte. A la sélection naturelle s’ajoute la sélection sexuelle, les procréateurs les plus avantageux pour l’espèce étant les plus forts. Cette sélection sexuelle a une très grande importance pour Darwin. Il a bien vu le sens esthétique chez les oiseaux : les mâles s’ornent en vue de plaire aux femelles, qui savent désarmer les plus beaux d’entre eux.
Darwin appuie ses théories sur une foule d’observations. C’est cette abondance de détails qui a fait la force de son Origine des espèces, paru en novembre 1859 (cette même année Albert Gaudry qui a démontré l’évolution par la paléontologie prenait la défense de Boucher de Perthes contre ceux qui niaient l’ancienneté de l’homme). Cet ouvrage était impatiemment attendu depuis la communication faite l’année précédente à la Société Linnéenne par Darwin et Wallace. Les deux savants avaient soutenu presque en même temps les mêmes idées, Alfred Wallace lui avait envoyé un mémoire sur La tendance des variétés à s’écarter indéfiniment du type originel. Il y exprimait une hypothèse qui différait de celles de Lamarck, puisqu’à l’influence du milieu il substituait l’idée de sélection naturelle. Darwin hésitait à publier ses recherches, à cause de leur analogie avec celles de Wallace, mais Lyell parvint à le décider. Il résuma alors sa doctrine dans l’Origine des espèces, qu’il communiqua à la Société Linnéenne. L’ouvrage eut un immense succès, mais en même temps il déchaîna la colère de la réaction.
L’Origine des Espèces fut le point de départ d’une campagne de mauvaise foi et de calomnies dirigée contre l’évolutionnisme par les gens d’Eglise. Le premier épisode de la « bataille de l’évolution » se déroula à. Oxford, en 1860, au sein de l’Assemblée de la British Association, présidée par l’évêque Wilberface qui s’efforça, mais en vain d’être spirituel. Darwin, qui avait eu la chance de convertir à ses idées le grand naturaliste Huxley, vit celui-ci aux prises avec l’évêque qui lui demanda rageusement si c’était par son grand-père ou sa grand-mère qu’il descendait du singe. Huxley, dont la devise était : « Détruire toutes les charlataneries, si vastes soient-elles » répondit qu’il était plus honorable pour lui de descendre du singe que d’être parent avec un homme de mauvaise foi, qui parlait ce qu’il ne connaissait point. Huxley a beaucoup fait pour la propagande des idées darwiniennes. On peut dire qu’il se donna tout entier à la cause de son ami. N’est-ce pas lui qui disait fort sagement : « Mieux vaut un singe perfectionné qu’un Adam dégénéré » ? Huxley exposa dans différents journaux et dans ses livres les théories honnies, les répandit dans de nombreuses causeries en 1861 et 1862, sur les rapports zoologiques entre l’homme et les animaux intérieurs, repoussant dédaigneusement les armes perfides employés contre lui par la réaction pour entraver l’idée en marche. Huxley qui professait en philosophie l’agnosticisme et pratiquait à sa manière le socialisme en faisant l’éducation des masses ouvrières dans des cours populaires, publia en 1863 son principal ouvrage : Place de l’homme dans la nature, qui fut suivie d’une série de conférences sur Les diverses races humaines. Cet ouvrage augmenta le nombre de ses adversaires résolus à n’en point admettre les conclusions résultant des similitudes constatées par l’auteur entre la structure du cerveau de l’homme et des singes (Huxley était alors professeur de biologie dans ses rapports avec la paléontologie) :
« Les différences de structure entre l’homme et les primates qui s’en rapprochent le plus, ne sont pas plus grandes que celles qui existent entre ces derniers et les autres membres de l’ordre des primates. En sorte que si l’on a quelques raisons pour croira que tous les primates, l’homme excepté, proviennent d’une seule et même souche primitive, il n’y a rien dans la structure de l’homme qui appuie la conclusion qu’il a eu une origine différente. »
Saluons en Huxley le meilleur collaborateur de Darwin. Sa tâche fut de vulgariser l’évolutionnisme et le transformisme, tout en menant de front ses travaux personnels. On peut le compter au nombre des principaux émancipateurs de la pensée humaine au XIXème siècle.
Les adversaires du transformisme, devant l’affirmation que le singe ne diffère point de l’homme, réclamèrent des intermédiaires ou passages, mais lorsqu’on en eût trouvé, comme le pithécanthrope, ils nièrent leur valeur ou authenticité.
En 1871, Darwin publia la Descendance de l’homme par voie de sélection naturelle. C’était le pendant et 1e complément de l’Origine des espèces. Dans ce nouveau livre, l’auteur, pratiquant la tolérance la plus large et ménageant la susceptibilité de ses lecteurs, n’en affirme pas moins avec plus d’autorité que jamais l’idée directrice de son œuvre. Parmi les autres ouvrages de Darwin, citons son Voyage d’un naturaliste autour du monde, de 1831 à 1836 (1840–1842), contenant les résultats de l’expédition scientifique du Beagle sur les côtes de l’Amérique du Sud ; Les récifs de corail (1842), Variation des animaux et des plantes à l’état domestique (1860), La fécondation des orchidées pm’ les insectes (1801), L’expression des émotions de l’homme et des animaux (1872), Les mouvements et les habitudes des plantes grimpantes (1875), Les plantes carnivores (1875), Les effets de la fécondation directe et de la fécondation croisée dans le règne végétal (1878), La faculté du mouvement chez les plantes (1880), Le rôle des vers de terre dans la formation de la terre végétale (1881), dans lequel il examine le rôle des infiniment petits, etc....
Lorsque Darwin mourut, en 1882, il laissait une œuvre qu’on peut qualifier de monumentale. Par la somme d’idées qu’il avait remuées, il avait engagé la philosophie dans une voie nouvelle. L’élan était donné. La pensée humaine marchait dans la voie de l’émancipation. Un coin du voile qui nous dérobe la réalité avait été soulevé. Le darwinisme n’était pas autre chose qu’une réponse rationnelle faite au problème de l’origine de l’homme. Celui-ci n’est pas sorti parfait des mains d’un prestidigitateur divin, qui l’a tiré du néant, par un tour de passe-passe, mais il est l’œuvre de la nature qui a mis des siècles à le former. D’une cellule originelle, qui a pris naissance au sein des mers primitives, sont sorties en se diversifiant toutes les espèces vivantes, plantes et animaux (dans lesquels entrent les substances dont sont formés les minéraux). Les pré-vertébrés sont devenus des vertébrés marins d’abord, ensuite terrestres. L’un de ces derniers, le rameau simien, a donné naissance à l’homme.
Si la théorie de l’évolution s’applique à l’animal, pourquoi ne s’appliquerait-elle pas à l’homme ? Pourquoi serait-elle fausse en ce qui le concerne ? L’homme, comme les animaux, dont il fait partie, n’a pas été créé, selon son espèce, comme chacun d’eux, il n’a pas fait l’objet d’une création spéciale. Il rentre dans le rang. Cette doctrine rabaisse l’orgueil des imbéciles, convenons-en.
Darwin remit en honneur une théorie que le dogmatisme de Cuvier avait failli étouffer. Sans doute, Darwin croit beaucoup à Lamarck, qu’il paraît ignorer, car il ne lui rend point justice, mais Lamarck doit au darwinisme d’être revenu en faveur, triomphe auquel il n’a point assisté, mais que sa fille Cornélie, lui avait prédit lorsque, découragé, lâché par tous, aveugle, il se promenait tristement, à son bras, dans les jardins du Muséum. Il fallut le darwinisme pour que le transformisme fût tiré de l’oubli. Le darwinisme remplaça désormais le transformisme que l’on continua dé combattre en sa personne.
Le darwinisme appliquait aux êtres organisés la même méthode qu’à la matière inorganique. D’où protestations de la part des fanatiques de la religion et aussi de la science, car celle-ci a ses fanatiques, qui en font une pseudoscience. L’autoritarisme sous toutes ses formes voyait dans le darwinisme l’ennemi ! Celui-ci heurtait de front la tradition qui n’avait jamais subi un pareil assaut. Pour la première fois, elle chancelait. Le monstre était mortellement atteint.
Le darwinisme était, comme le lamarckisme, une réaction contre le créationnisme, solution paresseuse, qui explique tout, sans rien expliquer.
Avec le darwinisme, point d’intervention surnaturelle dans l’explication des phénomènes de la vie. Point de création miraculeuse, mais au contraire explication logique, naturelle, des faits, ne pouvant se produire sans cause. Tous les faits se tiennent, sont solidaires. Le présent provient du passé, et lui-même contient l’avenir. Avec le darwinisme, ni la terre n’est le centre de l’univers, ni l’homme n’est le principal habitant de la terre. Il fait justice à la fois et du géocentrisme et de l’anthropocentrisme. Ainsi, il ouvre à l’esprit de perspectives inouïes. Même si cette doctrine était fausse, elle serait encore créatrice parce que, en rejetant le point de vue téléologique, le finalisme, dont se contentent les cerveaux simplistes, elle a renouvelé les méthodes des sciences.
Le fanatisme sert les idées en les faisant connaitre. Celui-ci n’a retenu du « darwinisme » que la descendance de l’homme, ce qui a attiré sur elle l’attention. « L’homme descend du singe » est devenu la terreur des gens bien pensants. Ils n’ont vu que cela dans le transformisme, et parce qu’ils n’ont vu que cela, ils ont contribué malgré eux à l’évolution des idées. Darwin, nous l’avons dit, ne s’était pas étendu là-dessus outre mesure, mais cette conclusion découlait de tous ses écrits. Pour les partisans de la Bible, l’arche de Noé tranchait la question ! Les libres-penseurs, auxquels les socialistes s’étaient joints, transportant la question sur le terrain sociologique comme les croyants l’avaient fait sur le terrain de la foi, prirent parti pour le diable. Haeckel qui, avec Darwin, a puissamment contribué à la diffusion des idées transformistes, voulait extraire un « catéchisme » du darwinisme, en quoi il avait peut-être tort : tous les catéchismes se valent, c’est-à-dire qu’ils ne valent rien.
A peine né, s’il rallia les meilleurs esprits, le darwinisme s’était heurté à une opposition systématique de la part de certains tardigrades résumant l’indignation et les scrupules des gens honnêtes et bien pensants. La doctrine qui niait la création distincte de chaque espèce et de l’homme trouva devant elle l’ignorance et la mauvaise foi. Ajoutons cependant que des savants se fourvoyèrent dans cette opposition, ne voulant pas démordre de leurs théories.
Le suisse Agassiz, dont il faut louer la haute probité, fut de ceux-là. Agassiz était finaliste. Il croyait de bonne foi qu’une pensée créatrice avait présidé ù l’adaptation de chaque être à son milieu. Cela lui suffisait. En vain ses propres travaux venaient à l’appui du, transformisme. Agassiz se contentait de sa première idée : chaque espèce avait été créée par Dieu distinctement, et elle n’avait point varié. Ainsi accordait-il sa science et sa foi. Cependant, avant Serres et Muller, il avait reconnu que la succession des fossiles reproduisait les étapes de l’embryon au cours de son développement. Mais c’était encore l’œuvre de Dieu. N’empêche qu’il se mettait en contradiction ouverte avec la genèse, en affirmant que chaque race humaine avait été créée à part, alors que le genre humain avait, d’après elle, une seule origine unique. Darwin admirait beaucoup Agassiz dont les idées, au fond, servaient sa doctrine.
Autre fixiste de moindre envergure, l’académicien Flourens, protégé de Cuvier et père du communard Gustave Flourens, qui lui succéda dans sa chaire du Collège de France. Flourens père était le type du parfait réactionnaire. Esprit étroit, il ne pouvait admettre l’évolution. Ce physiologiste, qui ne croyait pas à la contemporanéité de l’homme et des grands mammifères antédiluviens, démontrée par Boucher de Perthes, fut en France un des adversaires les plus acharnés du transformisme. Il niait que la nature ait le pouvoir de créer et le pouvoir de détruire des êtres. Pour ce partisan de la fixité des espèces, qui répondait toujours à côté de la question, il n’y avait que deux systèmes possibles : la génération spontanée ou la main de Dieu. Mais la génération spontanée n’est qu’une chimère. Reste la main de Dieu. Dès qu’on remonte à Dieu, tout s’explique. C’est avec des arguments de ce genre qu’on a combattu et qu’on combat encore le darwinisme. Piètre argument qui s’explique par la bêtise et le fanatisme de ceux qui, à court d’arguments, n’en ont pas d’autre à opposer aux observations de la science que « la main de Dieu ».
Mon grand oncle Henri de Lacaze-Duthiers, savant officiel, membre de l’Institut et professeur à la Sorbonne pendant trente-cinq ans, était partisan de la fixité des espèces. Il resta le disciple de Cuvier jusqu’à l’heure de sa mort, survenue en 1901. Cependant, nul plus que le fondateur de la zoologie expérimentale, qui se méfiait des théories, n’a, par ses études d’embryogénie, contribué à montrer l’excellence de la doctrine de l’évolution. On ne s’explique pas comment il s’entêta à soutenir des idées que ses propres travaux démentaient constamment. Tous ses élèves, et non des moindres, se séparèrent de lui et passèrent dans le camp adverse, formant une équipe d’évolutionnistes comme on n’en vit jamais, parmi lesquels Albert Gaudry, Alfred Giard, Edmond et Rémy Perrier, Yves Delage, Pruvot, Boutan, Joubin, Roule, Cuénot, Pérez. Il n’est pas aujourd’hui de savant digne de ce nom qui ne soit plus ou moins évolutionniste.
Rompant avec Lacaze-Duthiers, qui lui avait fait passer sa thèse de doctorat ès sciences en 1872, Alfred Giard se jeta dans la bataille, professant, sous les fenêtres mêmes de son ancien maître, un cours sur l’évolution des êtres organisés, subventionné par la Ville de Paris. Giard fut vraiment un initiateur. Cet anarchiste de la science, qui combattait toutes les superstitions, avait été frappé par ce fait que l’embryon reproduit l’évolution de l’espèce au cours de son développement : il passe par les différents stades par où sont passés les animaux dont les fossiles ont été trouvées dans les terrains datés par la géologie : dans les entrailles de la terre comme dans le ventre de la mère, c’est la même succession, et le même ordre d’apparition des espèces : l’être devient poisson, batracien, reptile et mammifère. Dans l’embryon, il est vrai, la récapitulation des formes est rapide et synthétique.. La nature ne met plus des siècles à former l’être vivant, mais seulement quelques mois. C’est une création en miniature, qui rappelle la création primitive. L’ontogénie ou évolution de l’individu reproduit en petit la phylogénie ou évolution de l’espèce. Serres, Fr. Muller et Haeckel, ont insisté là-dessus. On a pu objecter à la loi biogénétique (ou de patrogonie) que certains stades sont « brûlés » au cours du développement de l’embryon, et que la larve, vivant dans des conditions différentes, s’écarte du type ancestral. Pour Vialleton, cette récapitulation des formes ancestrales ne serait qu’une métaphore. Ajoutons que la suite des fossiles ne forme guère une série continue, ce qui complique le problème. Il n’en est pas moins vrai que l’embryologie vient apporter son appui à la théorie de l’évolution que la paléontologie confirme de son côté. Ces deux sciences s’accordent pour nous prouver que l’être humain a passé par différentes phases avant d’arriver à sa forme actuelle. De plus, comment douter de l’évolution quand on constate, chez l’homme, les transformations de certains organes rudimentaires ?
« L’idée transformiste est la seule qui nous apparaisse maintenant comme capable de fournir une réponse satisfaisante à la question de l’origine des êtres vivants qui peuplent la terre. » (Yves Delage)
Non seulement cette doctrine éclaire l’origine des espèces végétales et animales, mais encore l’origine de l’homme, et c’est ici que la réaction élève ses protestations. L’animal ne compte pas, qu’importe qu’il ait été créé par la nature. Mais l’homme, l’homme qui a été racheté par le sang d’un Dieu, l’homme ne peut pas avoir la même origine que l’animal. Il y a entre eux un abîme.
Une des raisons de l’opposition au, transformisme réside dans la paresse intellectuelle et l’esprit misonéiste qui font que les bourgeois conservent leurs vieilles erreurs, ne voulant pas se donner la peine de faire un effort de pensée et de rompre leurs habitudes de tout repos. Ces gens-là ne veulent rien savoir quand une vérité nouvelle prend la place d’une vérité ancienne. Ils ne veulent rien modifier à leur façon de faire : comment accepteraient-ils de gaieté de cœur la théorie de l’évolution des espèces ? Ce serait se condamner eux-mêmes. Ils préfèrent obéir à la fausse tradition que leurs parents leur ont transmise plutôt que de regarder en avant et de vivre. Il ne faut rien attendre de ces tardigrades. L’hypothèse de la création est simple, elle satisfait les cerveaux médiocres : pas besoin de travailler pour la formuler. Tout esprit critique est écarté ; il n’y a point de discussion possible. On se contente d’affirmer : c’est plus facile. Le transformisme, au contraire, exige l’étude de toutes les sciences et un renouvellement de la mentalité. Il exige des esprits ouverts à toutes les recherches désintéressées, des âmes curieuses, avides de savoir. Avouons que certains cerveaux ne se transformeront jamais : l’exemple donné par certains individus — qui n’évoluent que pour se renier- nous ferait mettre en doute l’évolution, conçue comme un progrès, et une marche en avant. On se demande si l’humanité se transformera jamais, quand on voit la façon dont agissent les brutes de tous clans, de toutes classes !
Après le Darwinisme. Neo-Lamarckiens et Neo-Darwiniens. Essor donné aux sciences biologiques.
Tandis que les adversaires du darwinisme continuaient leur lutte à outrance contre les théories évolutionnistes, leur opposant des arguments sentimentaux ou pseudo-scientifiques, les savants sérieux tiraient du système toutes ses conséquences, y adhéraient sans restriction ou le modifiaient et le rectifiaient. Lamarck avait encore ses partisans, restés fidèles à l’influence du milieu, tandis que les disciples de Darwin ne juraient que par la sélection naturelle. D’autres savants tentèrent de concilier les deux tendances. Le darwinisme, en créant de nouveaux courants d’idées, avait bien mérité de la science. Pour les néo-darwiniens, l’action du milieu sur l’organisme fut rejeté. Le représentant le plus « absolu » de cette tendance fut Weissmann. Weissmann niait l’hérédité des caractères acquis. Il écrivit dans ce but un ouvrage sur la « Toute-puissance de la sélection naturelle ». Un dogme scientifique en remplaçait un autre ! Weissmann fit, par la suite, des concessions et atténua la rigueur de son système. Il y laissa filtrer l’idée lamarckienne de l’influence du milieu, en la rattachant à la lutte pour l’existence et à la sélection dont l’action restait primordiale. Darwin avait reconnu lui-même l’erreur qu’il avait faite en ne tenant pas suffisamment compte de l’action du milieu. L’étude de ce que Weissmann appelle « le plasma germinatif » nous entraînerait trop loin. Bornons-nous à rappeler que, d’après Weissmann, chacun de nous possède le plasma germinatif de ses parents, de ses grands-parents et de tous ses ancêtres dans ses cellules sexuelles : l’hérédité s’expliquerait par la transmission de ces plasmas ancestraux. La théorie Weismanienne ou sélection germinale a été critiquée par Yves Delage. Le néo-darwinien Weissmann, qui s’est souvent contredit, n’a pas réussi, avec sa théorie des biophores, à nous donner une explication suffisante de la variation et de l’hérédité. Une mise au point du darwinisme s’est accomplie et, entre les deux écoles transformistes des néo-lamarckiens, fidèles aux principes exposés dans la Philosophie zoologique, et pour lesquels les variations des espèces ne sont point dues au hasard, et les néo-darwiniens, qui prétendent qu’elles sont fortuites, un terrain d’entente est possible. Les darwiniens expliquant tant par la sélection naturelle, les lamarckiens par l’influence du milieu, quelles que soient les divergences de vues qui les séparent, n’en ont pas moins servi grandement le progrès des sciences biologiques. En effet, depuis Darwin, que de recherches ont été faites, dans un sens ou dans l’autre, dans la voie qu’il a ouverte ! Des correctifs ont été apportés aux théories darwiniennes par De Vries avec sa théorie de la pangénèse et des mutations brusques ; par Naegeli, avec ses micelles ; par Galton, avec son « retour à la moyenne » ; par le moine Mendel, qui distingua parmi les caractères hérités des caractères dominants et des caractères récessifs ; par W. Roux, qui a montré le rôle de l’excitation fonctionnelle ; par Chauveaud, qui a appliqué aux plantes la loi de Fr. Muller ; par Delage, et ses « causes actuelles » ; par Le Dantec, élève de Giard, qui part de la chimie pour démontrer l’évolution. Combien d’autres, partis de Darwin, ont développé les idées transformistes : Cape, Correns, Baldwin, Osborn, Packard, Depéret, Raphaël Dubois, Korschinsky, Edmond et Rémy Perrier, Houssay, Cuénot, Henneguy, I. Lœb, G. Bohn, Le Duc, Herrera, Roule, Bataillon, Dastre, Rabaud, Quinton, Albert Mary, Matisse, Anglas, Becquerel, etc.... Noble phalange de travailleurs, qui nous repose des agités de la politique.
« La notion d’évolution, écrit Yves Delage, est devenue une des généralisations les plus vastes — sinon la plus vaste — de notre temps ; elle dépasse de beaucoup les limites des sciences au sein desquelles elle a surgi et embrasse tout l’ensemble des conceptions humaines, jusqu’aux problèmes philosophiques les plus obscurs et les plus difficiles. »
On voit combien le darwinisme a servi le progrès des sciences et de l’esprit humain. La doctrine de l’évolution s’est étendue à toutes les sciences : la méthode historique et sociologique a remplacé la méthode déductive, ontologique, dogmatique. Elle a permis d’expliquer l’histoire, le langage, les mœurs, les religions, les morales, les institutions, les lois, les arts et les littératures. On connaît l’application, plus ou moins juste il est vrai, que Brunetière en fit à la critique chargée de décrire « l’évolution des genres ». Brunetière essayait à sa manière d’appliquer à l’étude de la littérature les méthodes de l’histoire naturelle, voie dans laquelle Taine s’était engagé à la suite de Sainte-Beuve, dont les précurseurs étaient Mme de Staël, De Bonald, avec leur formule :
« L’art est l’expression de la Société. »
L’influence du milieu dans les arts avait été constatée par Cousin, Chateaubriand, Montesquieu, Fontenelle, Saint-Evremond, Dubos, etc.... La méthode évolutionniste (influence du milieu et concurrence vitale) a renouvelé la philosophie : la psychologie (travaux de Ribot) et la sociologie s’en sont inspirées, autant que l’esthétique, qui tient de ces deux disciplines.
Fausse interprétation du Darwinisme. La sélection à rebours.
Yves Delage fait observer :
« Il faut tracer une ligne de démarcation entre le côté transformiste des idées darwiniennes et leur côté sélectionniste. Si le transformisme darwinien a rendu à l’émancipation de l’esprit humain le service le plus grand peut-être dont on ait jamais été redevable à une théorie scientifique, l’idée de la sélection naturelle n’a pas, bien au contraire, les mêmes titres à notre reconnaissance. »
On a tiré de la sélection naturelle des conclusions fausses. Toute grande doctrine, philosophique ou littéraire, est rapetissée par la médiocrité. Les arrivistes ont trouvé dans les théories darwiniennes la justification de leur égoïsme ; les faibles doivent être sacrifiés, piétinés, pour le plus grand bien de l’espèce. Or, les faibles dont il s’agit ici ne sont point ces résignés qui, par leur inertie, justifient les violences et l’autorité des soi-disant forts, ce sont les vrais forts, c’est-à-dire les indépendants et les sincères, ceux qui se séparent du troupeau sur toutes les questions. La haute pègre, qui légifère et domine, tient à garder ses privilèges et elle combat sans pitié toute velléité d’action et de pensées libres. Le darwinisme ainsi compris — comme le triomphe du plus rusé et du plus habile sur celui qui refuse de s’adapter et de se plier aux exigences de l’élite ou du nombre — cadre bien avec le régime barbare des sociétés dites civilisées, dans lesquelles le mensonge seul est honoré, et où la crapule dorée se vautre et fait la loi. Avec cette conception, dans laquelle la vie n’apparaît plus que comme une lutte de bas intérêts, lutte pour l’or ou la propriété, tantôt l’individu, subit la tyrannie du nombre, tantôt le nombre subit la tyrannie de l’individu. Maîtres et serviteurs sont pareillement esclaves. Le darwinisme est la justification des moyens dont usent et abusent guerriers, diplomates, mercantis, prêtres de toutes les églises, politiciens, chefs d’Etat. La lutte pour la vie est la forme la plus aiguë de la lutte pour la mort. Le « struggle for life » a dressé les individus les uns contre les autres, multipliant les besoins et les appétits. L’homme est devenu un loup pour l’homme. L’enfer que les chrétiens placent hors de la vie est dans la vie même, cette vie qui nous est imposée chaque jour par les maîtres de l’heure. Le plus roublard l’emporte ; l’hypocrisie et la ruse se revêtent du masque de l’honnêteté pour exercer leurs méfaits ; la sincérité n’est plus de mode. Les bourgeois pratiquent à rebours la sélection, brimant les meilleurs esprits, leur imposant leurs lois, les envoyant au bagne ou à l’abattoir, favorisant les brutes, les ignares, les cuistres, Comprendre ainsi la sélection — qui est le triomphe intégral des brutes — c’est n’y rien comprendre. C’est une conception fantaisiste qui n’a pu éclore qu’en des cerveaux dégénérés. Ce darwinisme-là n’est point le vrai. Au nom de la justice et de l’amour, nous le répudions. Toute doctrine saine est détournée au profit des brutes : il est arrivé à Darwin ce qui est arrivé à Nietzsche et à quelques autres : on leur a fait dire exactement le contraire de ce qu’ils avaient dit, et on s’est servi de leurs noms pour justifier tous les crimes. Or, les évolutionnistes étaient des hommes sincères, et non des pantins, convaincus, comme Lamarck, de la nécessité de la solidarité (Lamarck combattait les inégalités sociales et la propriété, l’autoritarisme sous toutes ses formes), comme Darwin, que la sympathie est nécessaire au bonheur des individus, sympathie dont Guyau, influencé par Darwin, faisait le principe de l’art, de la religion et de la sociologie. Il y a dans le darwinisme une loi de progrès implicite, au lieu des conclusions que l’arrivisme et l’égoïsme en tirent chaque jour. On n’a voulu retenir — et pour cause — que le côté négatif de la doctrine, comme on n’a retenu de celle de Nietzsche que son envers. Il y a autre chose dans le darwinisme que le triomphe de la bêtise sur l’intelligence, de la brute sur l’esprit pacifique. Le fils de l’auteur de « L’Origine des Espèces ». Léonard Darwin, a soutenu que la reproduction de l’espèce devait être entreprise au nom de la sélection. Il n’est point partisan d’engendrer des êtres misérables et laids, mais des hommes véritables, la qualité étant bien préférable à la quantité. L’évolution doit aider à peupler l’humanité de vivants, et non pas à la surpeupler d’idiots et de dégénérés. Que voyons-nous aujourd’hui ? La société d’après-guerre est au-dessous de tout. C’est que la sélection se fait à rebours, la mentalité des individus n’ayant de nom dans aucune langue, mentalité inférieure à celle du dernier des sauvages. Il est grand temps de réagir.
On peut objecter à Darwin qua la lutte des individus contre les conditions naturelles dépasse de beaucoup celle que se livrent entre eux les individus d’une même espèce. C’est le point de vue auquel s’est placé Kropotkine. Kropotkine voyait un facteur d’évolution dans l’entraide, et non dans la lutte pour l’existence (L’Entraide, un facteur d’évolution.) Cette évolution positive est autrement noble et utile que l’évolution négative, qui sacrifie les meilleurs aux pires scélérats. Ce qui résulte pour nous de l’examen des doctrines évolutionnistes c’est la nécessité de la liberté de chaque individu au sein d’une société libre, d’où mensonges, préjugés, dogmes et lois auront été impitoyablement bannis.
Haeckel dans son « Histoire de la Création des êtres organisés d’après les lois naturelles », rappelle que le peuple de Sparte n’a dû son haut degré de force virile qu’en pratiquant la sélection artificielle, et qu’il en est de même pour les tribus des peaux-rouges de l’Amérique du Nord qui mettent à mort les nouveau-nés débiles. Et le philosophe du monisme en profite pour montrer dans la sélection militaire pratiquée dans notre société dite civilisée un crime abject, les hommes les plus sains et les plus robustes étant immolés au Moloch insatiable.
« Au contraire, tous les jeunes gens débiles, malades, affectés de vices corporels, sont dédaignés par la sélection militaire. »
Opposant à la sélection artificielle du militarisme, la sélection naturelle, Haeckel voit dans celle-ci « le plus fort levier du progrès, le principal agent de perfectionnement ». Il croit que dans la nature, le parfait triomphe de l’imparfait.
« Or, dans l’espèce humaine, cette lutte pour vivre devient de plus en plus une lutte intellectuelle, de moins en moins une bataille avec des armes guerrières. Grâce à l’influence ennoblissante de la sélection naturelle, l’organe qui se perfectionne plus que tout autre chez l’homme, c’est le cerveau. En général, ce n’est pas l’homme armé du meilleur revolver, c’est l’homme doué de l’intelligence la plus développée qui l’emporte, et il léguera à ses rejetons les facultés cérébrales qui lui ont valu la victoire. Nous avons donc le droit d’espérer, qu’en dépit des forces rétrogrades, nous verrons, sous l’influence bénie de la sélection naturelle, se réaliser toujours de plus en plus le progrès de l’humanité vers la liberté et par conséquent vers le plus grand perfectionnement possible ».
Nous pensons qu’en fait de sélection artificielle, la meilleure c’est encore celle qui n’attend pas la naissance de l’enfant pour le supprimer ou le conserver, mais prépare sa venue, ne le jetant pas dans la vie nanti de tares alcooliques ou autres.
Préparons une humanité meilleure en devenant meilleurs nous-mêmes, en réformant notre mentalité et nos mœurs, en n’obéissant qu’à la justice et à la vérité. Refusons d’imiter le troupeau, élargissons sans cesse notre idéal. L’individualisme conçu comme l’épanouissement de l’être vivant en beauté, libéré moralement et physiquement, est la meilleure sélection.
Derniers échos de la croisade contre le Darwinisme. L’affaire Scopes.
Le procès du darwinisme avait été engagé avant le darwinisme même. Avec celui-ci il est entré dans une voie aiguë. Il dure encore. La croisade contre l’origine simiesque de l’homme se continue chez les bourgeois bien pensants, rentés, assis, par l’entremise de leurs prêtres, de leurs moralistes et de leurs politiciens. Il n’est pas de théorie qui n’ait été plus mal comprise que le darwinisme, et qui n’ait été combattue avec d’aussi piètres arguments. Le procès engagé depuis plus d’un siècle entre Moïse et Darwin est un des moments de la lutte éternelle que se livrent l’esprit de mensonge et l’esprit de vérité. Darwin n’a dû qu’à sa prudence et à sa modération d’avoir la vie sauve.
On croyait qu’enfin le darwinisme, après une mise au point qui le plaçait au nombre des hypothèses fécondes de la science n’allait plus être discuté. On comptait sans le fanatisme, qui ne désarme jamais. Il est comme le feu, qui couve sous la cendre. On pensait close la lutte, lorsqu’elle a repris de plus belle, avec une extrême violence. Si tous les esprits sérieux ont accepté le darwinisme, en le corrigeant, le complétant ou le dépassant, les esprits rétrogrades voient toujours dans cette doctrine une doctrine diabolique, immorale et pernicieuse. Nous en avons eu récemment une preuve éclatante dans un procès intenté en Amérique à un jeune professeur. Ce procès a couvert de ridicule ceux qui l’ont provoqué, et il faut espérer qu’après cette expérience la bêtise ne récidivera plus. Elle a donné toute sa mesure. Jamais les adversaires du transformisme ne s’étaient montrés aussi plats, en pensées, en paroles et en actes. On voulut frapper un grand coup. L’Amérique, pays de bluff, se chargea de la besogne. La Croisade contre la théorie de l’évolution a eu cette fois pour théâtre le nouveau monde avec, pour chef, un politicien du nom de Bryan, ancien secrétaire d’Etat du cabinet Wilson. Le père du régime sec n’a guère brillé dans cette affaire. Se présentant, pour la quatrième fois à la Présidence des Etats-Unis, ce singulier homme d’Etat avait cherché par tous les moyens d’attirer sur lui l’attention, s’efforçant de provoquer de l’agitation dans le pays de Carlyle et de Walt Whitman. Il voulait essayer de déclencher un mouvement religieux « afin d’introduire la Bible dans la Constitution américaine ». Il tenta de faire les élections sur le dos du darwinisme, mêlant stupidement la religion et la politique à la science. L’antiévolutionnisme était devenu un mot d’ordre électoral, La bataille allait s’engager entre évolutionnistes et antiévolutionnistes ! William J. Bryan espérait bien faire triompher sur son nom la sainte cause de la Bible. Il pensait que l’incohérence du suffrage universel déciderait de quel côté est la vérité. Un procès fut intenté dans la libre Amérique au professeur John Scopes, coupable du crime de darwinisme. Il était accusé d’avoir violé la constitution de l’Etat du Tennessee en enseignant la doctrine de l’évolution, proscrite au nom de la Bible par ces braves protestants. Bryan se porta partie civile contre lui et se montra le plus enragé des antidarwinistes. C’est lui qui, en réalité, dirigeait les débats. Ce qui ne lui profita guère, car cet apôtre de la tempérance mourut d’indigestion, dans la ville même où avait lieu le procès. Le meilleur champion de cette mauvaise cause fut frappé en pleine bataille (en quoi Dieu, d’où il descend, se montra fort ingrat, en le faisant remonter au ciel). Si ces pudiques protestants avaient été tant soi peu logiques, ils auraient dû voir dans cette mort que Dieu même ne pactisait pas avec leurs gesticulations. Ce procès vaut d’être rappelé ici, en détail, car il est toujours bon de montrer à l’œuvre le fanatisme et de dénoncer les petits moyens qu’il emploie.
Le procès du darwinisme, du transformisme et de l’évolutionnisme réunis eut lieu à Dayton (Ohio), que des plaisants qualifièrent à cette occasion de Monkeyville (Ville des Singes). Le candidat des démocrates, battu deux fois aux élections présidentielles par Mac Kinley, et une fois par Caft, n’avait rompu le silence après une vie mouvementée que pour se ridiculiser dans le procès Dayton. Pour Bryan, politicien roublard, à la mentalité étroite, l’affaire Scopes n’était qu’un moyen de réclame en vue des élections, l’occasion cherchée depuis longtemps, de prendre la défense des gens de la campagne contre ceux de la ville. Ce procès, sorte d’affaire Dreyfus de la science, dura du 11 au 21 juillet 1925 Le maniaque Bryan, affirmait sans sourciller que « les savants qui prétendent que nous descendons du singe sont des individus malhonnêtes ». Il n’y avait qu’à s’incliner. L’homme qui avait donné sa démission de secrétaire d’Etat lorsque Wilson protesta contre la guerre sous-marine, était l’auteur de deux ouvrages pauvres d’idées et de style, dans lesquels il avait déjà combattu la doctrine de l’évolution : « La menace du Darwinisme » (1917) et « La Bible et ses ennemis (1918) ». Enhardi par ses triomphes précédents, il déclarait avec emphase que :
« Cette guerre n’engage pas seulement l’église orthodoxe, mais la Religion elle-même. C’est une guerre jusqu’au bout, ajoutait le nouveau Pierre l’Ermite. Toutes les églises sont engagées, parce qu’une fois l’autorité du verbe divin détruite, il n’y aura aucun besoin d’églises ou de prêtres. Tout le monde ira au cinéma au lieu d’aller au temple. »
On se demande où serait le mal, si le cinéma aidait à dissiper toutes les superstitions. En vérité, étrange procès qui mit de nouveau aux prises le fanatisme et la pensée libre. Naturellement la presse réactionnaire du monde entier en profita pour prendre fait et cause pour Bryan et condamner une fois de plus l’évolutionnisme. Elle sauva encore une fois l’honneur des bourgeois qui ne peuvent, en aucune manière, descendre du singe.
Le Tennessee est un des endroits du monde, après la France, où il y a le plus d’illettrés (on peut savoir lire, et n’être qu’un illettré!) Si les gens du Tennessee pratiquent la culture, ce n’est point celle des idées. La Bible est le seul livre qu’aient jamais lu les montagnards de ce pays. Elle résume pour eux toute la civilisation ! Le jeune romancier américain Floyd Dell, l’auteur d’Un Phénomène, homme d’un rare courage et d’un mérite non moins rare, caractère indomptable, comme l’un de ses héros, Félix Fay, a affirmé, leur faisant trop d’honneur, que « les gens de Tennessee sont les restes fossilisés de périodes évanouies ». Pour « ces montagnards arriérés », l’évolution est une invention du diable, et ils croient qu’elle sert les desseins du capitalisme. Les jeunes filles, faites à l’image de Dieu, portaient des rubans brodés sur lesquels on lisait : « Vous ne ferez pas de nous des guenons ! » La petite ville de Dayton devint aussitôt célèbre : on y vit affluer les amateurs de sensations rares, les opérateurs de cinéma, les photographes et les reporters. Ce fut un champ de bataille où s’affrontèrent deux conceptions de la vie diamétralement opposées : la conception autoritaire et la conception libertaire. Singulier procès, qui montre à quel point la réaction a peur de la vérité et s’efforce, par tous les moyens, de l’étouffer. Les noms des douze jurés furent tirés au sort par un enfant de deux ans. Ces jurés, parmi lesquels figuraient six baptistes, un analphabète, un méthodiste et un maître d’école, n’assistèrent pas aux débats, le juge ayant demandé leur exclusion (ils déambulaient pendant ce temps à travers la ville). Ce juge, du nom de Raulston, un nom à retenir, qui était lui-même un des plus ardents adversaires du darwinisme (il avait eu soin de se munir d’une Bible et d’un dictionnaire avant de présider) déclara, après les prières traditionnelles, que les jurés avaient à dire si M. Scopes a, ou non, violé la loi du Tennessee qui défend d’enseigner les doctrines de l’évolution, et non pas de juger cette loi elle-même. C’était étrangler les débats ! Ceux-ci furent, comme toujours, une parodie de la justice. Ils ne furent pas publics, afin d’empêcher les idées de pénétrer dans les consciences, le tribunal ayant exigé que les arguments de la défense fussent présentés par écrit. « La question ne sera pas posée », fut invoquée ici comme dans les tribunaux militaires. Le fanatisme alla si loin que les adeptes de l’Eglise méthodiste menacèrent d’expulser un docteur qui voulait exposer les théories évolutionnistes. On ne veut même pas entendre la défense. Elle est là pour la forme. C’est le moyen classique de toute bourgeoisie, catholique, protestante ou juive, de tous les Etats, quels qu’ils soient... Le Juge refusa d’entendre les savants cités comme témoins, car, disait Bryan, qui s’efforçait de légitimer la décision du tribunal « les savants étrangers ne peuvent pas venir empoisonner les enfants du Tennessee ... ». Et l’illustre bimétalliste vitupéra pendant deux heures « contre les hérétiques de l’évolution qui discutent le miracle de la naissance du Christ et nient tout le surnaturel de la Bible ». Pour Bryan, les avocats de Scopes étaient des « assassins », et Nietzsche était responsable du « meurtre spirituel moderne ». On voit à quelles stupidités on aboutit quand on mêle la science à la politique et à la religion.
Le célèbre avocat Clarence Darrow et le féministe Malone avaient offert gratuitement leurs services à la défense (même en Amérique, pays des dollars, il y a des gens désintéressés). L’avocat, que Bryan avait représenté comme celui du Diable, réussit malgré tout à faire le procès du christianisme, auteur des guerres les plus meurtrières, et riposta en ces termes à Bryan :
« Je crois que M. Bryan est bien prétentieux de dire que Dieu est fait à son image et qu’on n’a qu’à agrandir sa photo pour obtenir celle de Dieu. »
La défense ajouta (audience du 14 juillet) « que la théorie selon laquelle le soleil, et non la terre, est le centre de l’Univers, va aussi à l’encontre de la Bible » et que d’ailleurs la théorie de Darwin concernant l’évolution est elle-même imprécise. Les débats se poursuivirent à l’extérieur, avec plus de liberté pour la défense. Voici l’un des arguments fournis par Bryan contre la « cruauté de l’évolutionnisme : Si l’animal descend du même royaume que l’homme, nous sommes des meurtriers lorsque nous tuons une mouche, et des cannibales lorsque nous mangeons la chair des mammifères ». A ce sujet, il n’avait peut-être pas tort. Mais les autres arguments n’offraient point la même sagesse. Le même Bryan voulait fonder une « Université » que fréquenteraient les étudiants qui refusent de connaître les théories de Darwin. On ne veut même pas savoir : on nie sans connaître le premier mot d’une théorie. Quand les savants apportèrent leur témoignage, Raulston fit sortir les membres du jury, ce qui était une singulière façon d’éclairer leur religion. Le journaliste Mencken, qui avait décrit les débats avec humour, fut hué par la foule, et ne dut qu’à son sang-froid de ne pas être déshabillé, et enduit de goudron, roulé dans un tas de plumes, puis promené dans ce costume à travers la ville. On se serait cru en plein moyen-âge. On alla jusqu’à révoquer de ses fonctions de professeur de mathématiques dans l’état de Kentucky la sœur de Scopes, coupable d’avoir refusé de déclarer à la direction de son Lycée qu’elle ne croyait pas à l’évolution. Le procès de Monkeyville donna lieu à de multiples incidents, comiques ou tragiques. On vit des écoliers, stylés pour la circonstance, venir témoigner contre leur professeur. L’un d’eux fit cette déposition, résumant, en se dandinant, l’enseignement de son maître : « La terre avait été brûlante, peu à peu elle se refroidit, alors la mer forma un petit animal à cellule unique, qui évolua et devint l’homme, M. Scopes nous a classés avec les chats, les chiens, les singes, les vaches et autres animaux. Il a dit que nous avions tous des mamelles ». A ce mot de « mamelles » les mères de famille se voilèrent la face et firent sortir leurs filles, précaution bien inutile, car un haut-parleur proclamait sans pitié la vérité, que les chastes oreilles recueillaient avidement (17 juillet). Autre détail amusant : les sectes se chamaillèrent à propos des prières. Les clergymen de l’Eglise moderniste déclarèrent qu’un pasteur fondamentaliste, ne jouissant d’aucun crédit auprès de Dieu, ne devait pas dire la prière, et ce fut un membre de l’Eglise unitarienne, qualifié d’infidèle par les fondamentalistes, qui jouit de cet honneur insigne. On vit un dresseur de singes faire de la propagande antiévolutionniste en exhibant plusieurs de ces animaux qui, déclarait-il, « descendent de l’homme ». Les diseurs de bonne aventure et les charlatans s’en mêlèrent et l’on entendit un « champion de Dieu » offrir moyennant 40 dollars de mettre n’importe qui en relations avec le Seigneur. Il y eut mieux : Dayton ayant abrité des athées, Dieu se vengea en infectant l’eau potable, ce qui provoqua une épidémie. Le typhus fit ses ravages, le plafond s’écroula sur le tribunal, les escaliers sous le poids du public. Les gens devenaient fous à Dayton. Enfin, celui qui avait provoqué tous ces incidents, mourut subitement le 26 juillet d’avoir trop mangé (il avait absorbé un copieux repas où figuraient, entre autres, du bœuf rôti, des épis de maïs et des pommes de terre, cinq entremets glacés, sept grands verres de thé glacés et deux tasses de café!) Le président du conseil municipal de Dayton ordonna aux habitants de mettre les drapeaux en berne en l’honneur du « premier citoyen du monde entier ».
Résultat de cette campagne maladroite et ridicule : l’instituteur Scopes fut condamné par le tribunal de Dayton à une amende de cent dollars (2.100 Fr.), comme n’ayant pas le droit, en tant que professeur dans une école de l’Etat, d’enseigner des doctrines qui ne sont pas reconnues par l’Etat, ni d’exposer à des contribuables une théorie qui leur répugne, étant payé par eux, etc.... Bien entendu, il interjeta appel. L’éteignoir est un des moyens « légaux » de propager l’instruction : on refuse d’exposer toutes les thèses : tel est l’enseignement idéal. Et l’on vient dire après cela qu’il n’y a point d’enseignement d’Etat et que l’Etat est neutre ! Combien d’Etats d’Europe (petits ou grands), sont dignes de celui du Tennessee, sous ce rapport comme sous beaucoup d’autres ! L’avocat lui-même de Scopes connut les bienfaits d’un tel régime. A la dernière audience (21 juillet), le juge, peu suspect, on l’a vu, d’impartialité, après avoir annoncé qu’il avait été saisi de plusieurs pétitions lui demandant de défendre la dignité du tribunal, infligea une amende de 5.000 dollars à Carence Darrow, comme ayant manqué d’impartialité, somme qui dut être immédiatement versée, sous peine d’emprisonnement. Darrow n’était-il pas, d’après l’illustre Bryan « le militant antichrétien le plus actif du pays ? » Cela valait bien une amende plus sévère que celle de John Scopes. La farce du procès Dayton était terminée.
Malgré cette condamnation prévue, le procès de Dayton se termina à l’avantage des darwinistes. Son utilité a été de nous montrer une fois de plus quels pitoyables arguments emploie le fanatisme, depuis Socrate jusqu’à Darwin, en passant par. Galilée et tant d’autres, pour étouffer la vérité. Mais comme dans tout procès où l’iniquité et la bêtise jouent le principal rôle, on peut dire à propos de celui de Dayton, au sujet de la vérité scientifique :
« L’évolution est en marche, rien ne l’arrêtera plus. »
Le procès de Dayton a servi les idées vivantes en les propageant dans les coins les plus reculés d’Amérique et d’Europe. Il a, selon l’expression de Floyd Dell, « porté un rude coup à la sottise et à l’intolérance humaines ». En effet, de même que lorsque la justice bourgeoise condamne un livre sous un prétexte quelconque, tout le monde l’achète, tous les ouvrages de Darwin furent vendus à des milliers d’exemplaires. Les libraires, comme les aubergistes de Dayton, y trouvèrent leur compte. Ainsi, les adversaires de l’évolution obtinrent-ils un résultat contraire à celui qu’ils poursuivaient. Néanmoins, comme le déclarait Floyd Dell à un journaliste, les Américains cultivés conçurent de cette affaire « plutôt que de l’indignation une sorte de tristesse amère, et ils dissimulèrent sous le rire et la plaisanterie leur dégoût et leur colère ».
Un membre du cabinet du président Coolidge, fort ennuyé de cette affaire qui divisait l’Amérique en deux camps, déclara que « l’évolution n’était pas en contradiction avec les enseignements de la Bible, car elle présupposait un plan dans l’organisation du monde ».
L’affaire Scopes avait été une affaire politique. Mais elle dépassait de beaucoup ces mesquineries. Elle mettait en conflit deux idées, deux morales, deux philosophies. Elle était un symbole, le symbole de l’ignorance et de l’erreur dressées contre l’esprit critique. Deux camps se formèrent (heureusement pour l’Amérique il se trouva des esprits pour se ranger aux côtés des « scélérats » qui osaient affirmer que l’homme descend du singe. Sans quoi le professeur Scopes eut subi le sort réservé à Sacco et Vanzetti).
Cependant l’intolérance et le fanatisme ne désarmèrent pas. Le coup de Dayton n’ayant pas réussi, les adversaires de l’évolution durent trouver autre chose. Le secrétaire du gouvernement découvrit quelque part une vieille loi « interdisant de dilapider les fonds électoraux pour l’enseignement des sciences contraires aux enseignements de la Bible », et là-dessus on ne parla rien moins que d’interdire dans le district de Washington « l’enseignement des théories de l’évolution et autres » et dans toutes les écoles d’Amérique l’enseignement de la chimie, de la physique, de l’anthropologie, de l’astronomie et de la philosophie par-dessus le marché. Ce singulier secrétaire qui répond au nom de Loren S. Wittner — autre nom à retenir dans les annales de l’obscurantisme -, déclarait dans un rapport adressé à la Cour suprême de Justice que « l’enseignement de la biologie doit être interdit parce qu’il est en contradiction avec l’histoire de la Bible sur les origines de l’homme et qu’il prétend que les organismes se décomposent après la mort, tandis que la Bible parle de résurrection au jour du Jugement dernier ; que l’enseignement de la chimie doit être interdit parce qu’il prétend qu’une matière ne peut pas se transformer en une autre, tandis que la Bible dit que Christ changea du vin en eau et Dieu la femme de Loth en une colonne de sel ». L’enseignement de la physique est également contraire à celui de la Bible, de même celui de l’astronomie, qui prétend que le Soleil est le centre de l’Univers, tandis que d’après la Bible, la terre, créée quatre jours avant le soleil, est le centre du monde. L’enseignement de la philologie est également à rejeter, car elle enseigne l’évolution des langues depuis leur origine, alors que la Bible les fait remonter à la Tour de Babel. Notez que cet inénarrable secrétaire, fier de sa trouvaille qui lui permettait d’interdire l’enseignement des sciences « irrespectueuses pour la Bible », demandait que les professeurs de chimie, de physique, d’anthropologie et de biologie soient suspendus de leurs fonctions. Pour aboutir à ce résultat, il ne craignit pas de faire subir une entorse à la loi. C’était complet ! Mais ce qu’il y a de plus extraordinaire dans son cas, c’est que Wittner, qui se disait « athée convaincu », prétendait avoir agi par « pur patriotisme ». Le patriotisme va de pair avec la bêtise. Le rapport de Wittner causa un certain trouble dans les milieux éclairés américains. A la suite de ce rapport, six Etats interdirent l’enseignement des théories évolutionnistes sur leur territoire. En somme, dans les Etats de l’Oklahoma, du Mississipi, de Tennessee, dans le Texas, où « aucun fidèle, athée, ou agnostique, ne peut remplir aucune fonction dans l’Université », dans la Caroline du Nord, et dans une foule d’autres Etats où des projets de lois antiévolutionnistes étaient à l’étude (Floride, Kentucky, etc.), le mot évolution fut effacé des livres, des écoles, et l’enseignement de la Bible recommandé ou rendu obligatoire (on explique la Bible dans 48 Etats).
D’après les fondamentalistes ou partisans de l’origine divine de l’homme, les évolutionnistes « écartent l’Adam de la Genèse pour le remplacer par le squelette du Musée Métropolitain, rajusté par de soi-disant savants aux os de singe », « l’enseignement de l’athéisme, camouflé du nom de science, c’est de la contrefaçon frauduleuse », etc. Pour ces fanatiques, la vaccination viole les lois de Dieu, et se laver le derrière est un crime. L’ignorantisme et l’obscurantisme des protestants valent bien ceux des catholiques qui déraisonnent à propos des miracles de Lourdes et autres.
Le Ku-Klux-Klan, cette Association de malfaiteurs, crut bon, dans un but de réclame, de prendre part aux débats, un an après le procès de Dayton. Il s’est prononcé contre le darwinisme, annonçant qu’il le combattrait par tous les moyens, y compris le crime. Cependant, même au sein du Ku-Klux-Klan, il n’y a pas que des imbéciles, et une scission s’est produite, un des principaux organisateurs de cette Société, M. E. J. Clarke, d’Atlanta, ayant désapprouvé cette décision grotesque, et formé une nouvelle Société qui admet l’enseignement libre des théories darwiniennes et accepte dans son sein tous les cultes.
Conclusion
Les adversaires du darwinisme ont vite fait de voir en lui « une doctrine qui s’effondre », alors que rectifiée et élargie, elle est plus solide que jamais. Les géologues, paléontologistes, anthropologistes, biologistes et préhistoriens sont aujourd’hui convaincus — sauf M. de Lapparent, dernier survivant du créationnisme — qu’il existe un ou plusieurs intermédiaires entre les grands singes anthropomorphes et l’homme, et que celui-ci descend d’eux directement ou indirectement. C’est l’opinion de Marcelin Boule, dans ses « Hommes Fossiles », et aussi de Verneau qui, dans son dernier ouvrage « Les Origines de l’Humanité » (1926), est fondé à écrire : « Les liens de parenté se resserrent et se précisent à tel point que le nombre des savants qui les niaient naguère diminue de jour en jour. Les uns admettent que les premiers êtres humains descendent en ligne directe de ces singes anthropomorphes, les autres inclinent à croire que ces singes et l’homme sont issus d’une souche commune qu’il faudrait rechercher plus loin dans le passé. De toute façon, l’Humanité n’en aurait pas moins une origine mienne ». Que peuvent les adversaires du darwinisme, contre les preuves que nous apportent les géologues, sur l’ancienneté de certaines roches recélant des fossiles ? Plus ou moins habilement les partisans de la Bible essaient de concilier la science et la foi. Le transformisme ne serait plus en désaccord avec la religion (Albert Gaudry, savant catholique, était sincère en l’affirmant).
Voici que l’abbé Moreux doute aussi de la valeur des textes sacrés : « On objecte la chronologie biblique, mais la Bible ne nous offre aucun élément de cette nature. Les chiffres que l’on y trouve, ce n’est un secret pour personne, ont été matériellement altérés par les copistes et diffèrent suivant les manuscrits ; il est donc impossible de se baser sur ces documents pour en faire le point de départ d’une théorie quelconque » (D’où venons-nous ?).
D’après la Bible, Dieu aurait créé le monde en six jours, il n’y a guère plus de six mille ans. Comme les géologues ont démontré que la formation du monde a duré des milliers de siècles, les partisans de la genèse répondent que le mot « jour » n’a plus ici sa signification habituelle : il ne s’agit plus de 24 heures, mais de millénaires. Finalement, Moïse et Darwin, sont du même avis : Dieu a créé l’homme le sixième jour, après les autres espèces. On ne voit vraiment pas pourquoi les fondamentalistes américains, français, anglais ou autres, en veulent tant à ce pauvre Darwin. L’auteur de 1’« Origine des Espèces », loin de contredire celui de la Bible, lui apporte son témoignage. L’homme de Darwin, comme celui de Moïse, est le dernier venu de la création. Pour l’un comme pour l’autre, il est le plus parfait de tous les êtres. La solution darwinienne est par certains côtés une solution religieuse. On peut objecter au savant anglais que, loin d’être le dernier venu parmi les animaux, l’homme est beaucoup plus ancien que la plupart d’entre eux, ses caractères intellectuels ne suffisant pas pour le placer le dernier de tous. Il n’est pas si jeune qu’on le prétend. L’homme, qui fait partie du groupe des primates, a sa place parmi les grands singes « dont il est d’ailleurs un type extrêmement perfectionné » (Rémy de Gourmont). Mais une espèce animale étant d’autant plus récente que sa température est plus élevée, les oiseaux ont fait leur apparition après l’homme. Cette dernière théorie — qui élargit l’évolution – est elle-même discutable. En résumé, que l’homme soit ou ne soit pas le dernier des êtres vivants, qu’il descende ou non du singe (et pour ma part, je ne vois aucun inconvénient à ce qu’il ait pour ancêtres les grands singes anthropomorphes du tertiaire, comme j’essaye de le montrer dans ma « Philosophie de la Préhistoire » (janvier 1927), cessons de considérer le primate plus ou moins civilisé que constitue l’homme actuel comme le chérubin de la nature. L’homme n’est pas une exception dans l’univers, le monde n’a pas été créé pour lui. Il ne saurait constituer le terme final de l’évolution. Après l’homme, coopérons que naîtra le surhomme qui vivra sans lois et sans morale. Concluons avec Rémy de Gourmont, en remplaçant toutefois le mot « créateur » par le mot « nature », encore enveloppé, il est vrai de mysticisme chez certains auteurs :
« Sans doute, l’homme continuera toujours à dominer de très haut le reste du règne animal, mais il est impossible de le considérer comme la dernière pensée du créateur ».
-GÉRARD DELACAZE-DUTHIERS
DEBACLE
n. f.
Au sens propre, la débâcle est la conséquence d’une élévation de la température qui, en provoquant le dégel, brise la glace qui recouvre les rivières. Cette rupture partage la glace en une quantité innombrable de glaçons qui, flottant à la dérive, sont parfois très dangereux. Au sens figuré, la « débâcle » est synonyme de déroute, de désordre, de confusion. La « débâcle » d’un gouvernement, c’est-à-dire l’impuissance de celui-ci à faire face à une situation de fait. La « débâcle » d’une armée, c’est-à-dire l’abandon de la lutte et la fuite précipitée et confuse des troupes devant l’ennemi. « La débâcle du capitalisme ouvrira la route au Prolétariat ». « La Débâcle » : célèbre roman d’Emile Zola. Dans ce remarquable ouvrage, le grand écrivain décrit certains épisodes de la guerre de 1870 et plus particulièrement de la retraite de Sedan.
DEBINAGE
n. m.
Action de débiner, de dire du mal, de dénigrer. Le débinage est l’arme des faibles ou des sournois. Celui qui n’ose pas attaquer de front un individu agit par derrière, afin de lui nuire. Il cherche des concours extérieurs et par le « débinage » tente de créer un courant d’hostilité contre son adversaire. Le débinage est dangereux, car il se trouve toujours des gens pour prêter une oreille complaisante aux commérages et s’associer à une mauvaise action ; celui qui se livre au débinage n’hésite jamais à user du mensonge et de la calomnie lorsqu’il n’a rien à reprocher à sa victime. Il arrive parfois que le débinage n’est pas déterminé par la méchanceté ou le désir de nuire, mais simplement par l’insouciance d’un individu bavard. Il faut néanmoins se méfier des « débineurs », car le « débinage » a souvent de graves conséquences et est toujours malfaisant.
DEBINER
verbe
Le dictionnaire Larousse donne « débiner » comme synonyme de « dénigrer », autrement dit chercher à nuire, à faire tort, apprécier péjorativement un geste ou un acte. Quiconque fréquente les milieux d’avant-garde a pu remarquer avec quelle facilité (indigne d’humains qui se présentent comme porteurs d’idées, de pensées, de doctrines destinées à rénover la face du monde) on y « débine » les militants qui ont une façon de se conduire ou de s’exprimer qui ne plaît pas au débineur. On est étonné d’entendre des anarchistes — c’est-à-dire des négateurs et des contempteurs de l’Etat et de ses institutions — qui s’affirment dépouillés des préjugés ou des habitudes vulgaires, porter sur telle façon de se comporter des jugements qui ne seraient pas hors de saison dans la bouche d’un procureur de la République ou d’un président de tribunal correctionnel. Qu’est-ce que juger un geste, apprécier une façon de se conduire ? C’est opiner que, se trouvant dans telles ou telles circonstances, on aurait agi, avec le déterminisme qui nous est propre, autrement que celui dont on qualifie les actions, lequel a agi, lui, selon son déterminisme personnel. Or, celui qui juge ou apprécie omet de dire cela ; si bien que son appréciation ou son jugement est entaché de « débinage », de nature à nuire ou à porter tort à un camarade, dont le seul crime est d’avoir un tempérament différent du sien.
Il n’y a pas que des « débinages » se rapportant à des actions individuelles ; il y a aussi des « débinages » de méthodes, de tactiques ; d’œuvres de nature à porter tort également à ceux qui les emploient ou s’y adonnent.
D’ailleurs, une façon de se conduire, une manière d’agir, un rejet, une réalisation sont anarchistes dès lors qu’ils n’ont pas recours à l’appui de l’Etat ou à l’intervention d’une autorité gouvernementale quelconque, dès lors qu’ils n’ont pas en vue, et dans aucun sens, la domination ou l’exploitation. « Débiner » un camarade, chercher à lui porter tort dans ce qu’il est ou ce qu’il fait, simplement parce que l’on ne comprend pas ou ne parvient pas à s’assimiler son déterminisme, son tempérament, son caractère, ce n’est pas seulement faire acte d’anti-camaraderie, c’est montrer qu’on est un ignorant.
DEBROUILLAGE
n. m.
Action de se débrouiller, de se tirer facilement d’affaires, de sortir d’embarras, etc., etc…Si on le considère au point de vue social comme moyen d’existence, le débrouillage est un pis-aller ; il peut donner des résultats positifs à l’individu, mais il ne saurait résoudre le problème du collectif. Les débrouillards sont nombreux dans la société bourgeoise et il est facile à comprendre que dans une organisation sociale où le capital est tout-puissant et où le travail est un esclavage, quantité d’individus refusent de se soumettre à la terrible loi et aux effets de l’exploitation et cherchent à se « débrouiller » pour subvenir à leurs besoins. Il ne nous appartient pas de rechercher et de juger les formes diverses du débrouillage et de critiquer ceux qui s’en servent. Ce que nous croyons, c’est qu’il n’offre pas des possibilités de vie supérieures à celles des ouvriers, qu’il ne libère pas l’individu des contraintes sociales et qu’il n’est nullement un facteur d’évolution ou de révolution. En tenant compte des exceptions, nous ne croyons pas nous tromper en affirmant que le « débrouillage » ne nourrit pas son homme, surtout dans la classe ouvrière. Dans la bourgeoisie, c’est différent ; la bourse, la banque, le commerce, l’industrie, sont des terrains propices à être exploités par les débrouillards ; mais il faut alors se livrer à des spéculations malpropres et user de procédés que combattent les Anarchistes.
En un mot, il n’est pas plus anarchiste de vivre du « débrouillage » que de vivre en travaillant et ce serait une grave erreur de croire que l’on se soustrait à l’exploitation et à l’autorité en se débrouillant. A condition de ne pas nuire à son prochain, chacun organise sa vie comme il l’entend, mais une société libre ne peut être bâtie que par le travail de tous et nous avons la ferme conviction que le débrouillage disparaîtra avec le capitalisme qui l’engendre.
DEBROUILLAGE
Des bourgeois qui défendent leurs privilèges et des pseudo-bourgeois qui se croient à l’avant-garde du mouvement social parce qu’ils parlent dans des « meetings » ou écrivent dans des feuilles avancées, ont reproché ou reprochent encore à des individualistes anarchistes de chercher à « se débrouiller », autrement dit à retirer le plus qu’ils peuvent du milieu humain actuel, en lui laissant le moins possible de leur effort. Ceux qui font de tels reproches oublient de quelle façon est cimentée la « société ». Ils oublient qu’elle repose sur un contrat social imposé et unilatéral, qui noie l’unité constituante, forcée de le subir, dans un océan de réglementations et de vexations contradictoires et insupportables. Reprocher à un anarchiste de « se débrouiller » dans un pareil conglomérat, c’est comme si on reprochait au serpent d’échapper à qui le poursuit en se raidissant et en prenant l’apparence d’une branche d’arbre, ou à la seiche de s’entourer d’un nuage d’encre noire pour désorienter ses ennemis. Qu’on se rende compte de la situation de l’anarchiste dans le milieu humain actuel : antiautoritaire, il est entouré de tous côtés par toutes sortes de membres de partis politiques ou économiques qui ne croient pas possible que les hommes s’entendent sans lois et sans maîtres. A ces partis se rattachent force miséreux et déshérités du sort, dont la mentalité ne diffère pas de celle des possédants et des monopoleurs. On comprend que des camarades se refusent à donner tout leur effort à perpétuer un tel milieu et qu’ils s’insoucient de sa prospérité, de son équilibre économique, etc... Dans aucun cas, un anarchiste ne peut avoir intérêt à ce que vive un milieu où le « contrat social » est imposé par un autocrate, un groupe, une majorité ou le plus grand nombre, sans possibilité de résiliation pour l’unité individuelle. C’est un cercle infernal dont l’individualiste cherchera à s’évader au plus tôt, relativement tout au moins. C’est un milieu dont il faut hâter au plus tôt la décomposition, la démoralisation, la pourriture, la crevaison enfin. Vouloir se préoccuper du bon fonctionnement d’une société pareille, participer à son existence régulière, c’est tout bonnement — affirment les « débrouillards » — faire gestes de dupes ou actions de complices.
Il y a donc des camarades qui se débrouillent et donnent le moins de leur soi au milieu humain actuel, se livrant à une besogne irrégulière, sanctionnée ou non par l’autorité, pour se tirer d’affaires économiquement, refusant de faire, des heures durant, acte de présence dans un chantier, une usine ou ailleurs pour concourir à une production souvent inutile, dont ils ne profitent pas dans la majorité des cas. Qui peut sérieusement les en blâmer ?
Reste la question de la « dignité » personnelle dans le choix du procédé de « débrouillage ». Mais c’est là affaire d’appréciation personnelle, qui regarde l’anarchiste qui se débrouille personnellement, et nul autre. Il est parfois comique de rencontrer chez certains anarchistes des scrupules quand il s’agit de s’en prendre aux bourgeois, alors que ceux-ci en montrent si peu quand on menace de toucher à leurs privilèges ou à leur coffre-fort. Peut-être est-ce plus désespérant que comique, après tout.
- E. ARMAND.
DECADENCE
n. f. (du latin cadencia, de cadere, tomber)
Commencement de la ruine, de la dégradation, de la destruction, d’un édifice, d’une organisation, d’un peuple, d’un Etat, d’une civilisation. La décadence des lettres, des arts, de la science.
« Quand la décadence d’un Etat a commencé il est rare qu’elle s’arrête. » (Raynal)
L’Histoire du monde nous offre le spectacle de nombreuses décadences au cours des siècles passés. Il semble que lorsqu’une nation ou une fraction de l’humanité est arrivée à un certain degré de connaissance et de culture, elle a usé toute sa sève, toute sa force et qu’il faut qu’elle disparaisse pour faire place à des forces plus jeunes, plus neuves qui, à leur tour, prennent en mains le flambeau et poursuivent la marche en avant sur la route de la civilisation. On pourrait considérer comme une fatalité historique la décadence de certains peuples qui occupèrent, à différentes époques, la première place dans le monde, et qui s’écroulèrent pour ne laisser d’eux qu’un pâle souvenir. Et pourtant cela s’explique. Lorsqu’un peuple a fourni plusieurs siècles de travail physique et intellectuel, lorsqu’il a dépensé une somme considérable d’énergie pour conquérir une place dominante sur la terre, lorsqu’il a donné sa force et sa puissance pour enrichir le domaine artistique, littéraire, philosophique et social de l’humanité ; alors, pareil au vieillard qui s’éteint après une vie de labeur, ce peuple s’éteint lentement pour que d’autres achèvent l’œuvre commencée.
S’il est vrai que les décadences préparent les éléments des nouvelles civilisations, elles sont cependant une source de souffrances pour les générations précipitée ; dans ces périodes de destruction et d’enfantement. La société mourante veut lutter contre le destin implacable qui la poursuit ; elle ne veut pas mourir et, dans la fièvre de l’agonie, elle combat l’avenir qui couve en elle et qu’elle voudrait étouffer. Il en résulte des catastrophes. La folie s’empare des hommes. Secoués par la soif de vivre, ils se livrent à tous les débordements, à toutes les incohérences d’un être malade qui voit approcher l’heure fatale et qui veut jouir des quelques instants qui lui restent encore à vivre ; et la décadence, ignorante des mesquineries et des petitesses humaines, se poursuit parfois pendant des siècles et des siècles, jusqu’au jour où les vieilles associations s’écroulent sous le poids du passé et sombrent dans le néant le plus profond, laissant le passage libre pour les sociétés nouvelles. Est-il besoin de rappeler la décadence des grands empires égyptiens, perses, chinois et plus près de nous dans l’histoire, la décadence de la Grèce et la décadence romaine ? Que de richesses matérielles, intellectuelles, artistiques furent accumulées par les générations successives qui ne prévoyaient pas la chute vertigineuse d’une civilisation arrivée à son apogée et qu’elles croyaient étayée sur de solides fondations ! Tout cela fut emporté alors que ces peuples paraissaient s’être élevés au plus haut degré de perfectionnement social et que rien de supérieur ne semblait possible dans l’organisation du monde.
Après cette terrible et meurtrière guerre de 1914, la civilisation que nous subissons n’est-elle pas prête à s’éteindre comme se sont éteintes les civilisations précédentes ? Depuis la chute du grand empire romain, aucune secousse aussi formidable que celle qui agite en ce moment le vieux monde n’a été ressentie. Ce n’est pas une lutte de nation à nation, ce n’est pas une bataille de peuple à peuple, de race à race qui bouleverse l’humanité moderne ; mais c’est bel et bien une organisation puissante qui est arrivée au point culminant de la trajectoire, une civilisation qui est en décadence et qui se défend et qui ne veut pas céder la place.
Les guerres qui déchirent les populations, les révolutions qui éclatent aux quatre coins du globe, ne sont que des incidents de cette décadence. La civilisation capitaliste se meurt, elle doit disparaître. Elle ne le veut pas. Qu’importe ; idéologiquement le capitalisme a vécu ; pratiquement il ne se maintient que faiblement en équilibre comme un danseur de cirque sur sa corde. Son agonie peut être longue ; mais ni l’habileté, ni l’adresse des politiciens ne peut la sauver de la débâcle. Arrivée à son apogée, la société moderne ne repose plus que sur des illusions. Les illusions sont fragiles et demain elle sera précipitée dans le vide. Entraînés dans le tourbillon d’une situation désaxée, les hommes auront à se défendre contre l’imprévu des événements. La lutte qui s’engage en ce vingtième siècle est la lutte entre la bourgeoisie qui représente la civilisation d’hier et les forces productrices du monde qui représentent la civilisation de demain. Nous avons dit plus haut que le capital et la bourgeoisie ne pouvaient pas sortir victorieux de cet immense conflit du passé contre l’avenir. Il est possible de prolonger de quelques heures, de quelques jours parfois la vie d’un agonisant ; il est impossible de lui rendre la vie, de lui donner l’éternité. Le rôle social et historique du capitalisme est terminé et c’est à ce moment que s’ouvrent de larges perspectives pour les anarchistes et les communistes libertaires. Quoi qu’on en dise, l’établissement d’un organisme viable, aussi élémentaire soit-il, exige de la méthode et de la compétence et l’Anarchiste doit s’attacher à rechercher les formes pratiques qui permettront à l’humanité d’évoluer rapidement vers la civilisation que représente, à nos yeux, le communisme libertaire.
Le Révolutionnaire est l’homme qui dans les grandes périodes historiques conserve tout son sang-froid, toute sa présence d’esprit, toute sa logique, toute sa raison et sait, au cours des événements catastrophiques inhérents à toutes les époques décadentes, tracer le chemin qui mène à la liberté.
La société bourgeoise est décadente, parce qu’elle ne répond plus aux besoins et aux aspirations de l’humanité.
« Le vêtement qui habille un enfant ne saurait être porté par un adulte. L’humanité fut cet enfant. Aujourd’hui elle est adulte. Faudrait-il donc qu’elle supportât encore les maillots et les langes, sous prétexte que ceux-ci furent utiles autrefois ? Ses chairs sont fermes, ses membres robustes, ses muscles solides ; elle veut marcher seule, aller où bon lui semble, circuler selon sa fantaisie. Elle ne veut plus de maîtres, plus de tyrans. » (Sébastien Faure, La Douleur Universelle, p. 418)
Voilà clairement définies en quelques lignes les aspirations de l’humanité. Les Anarchistes seront-ils à la hauteur de la lourde tâche et sortiront-ils vainqueurs de la bataille gigantesque qu’ils ont engagée contre toutes les forces de décadence ? Nous ne pouvons aujourd’hui que l’espérer ; l’avenir dira que nous avions raison.
DECADENT
adj.
Ce qui est en décadence. Ce qui périclite. Tomber en décadence, c’est-à-dire perdre progressivement sa force, son énergie, son pouvoir. « Le Mouvement Décadent » formé vers la fin du XIXème siècle par une catégorie de littérateurs et d’artistes symbolistes, en opposition à la rigidité littéraire et artistique des Parnassiens. Verlaine et Mallarmé furent les maîtres des « Décadents ».
DECENTRALISATION
n. f.
La Centralisation est une des nombreuses plaies dont sont victimes les populations modernes et, malheureusement, loin de s’améliorer, le mal ne va qu’en s’aggravant. La décentralisation est devenue une nécessité absolue et, cependant, on ne remarque pas que les hommes qui président aux destinées des peuples soient enclins à s’imprégner de cette vérité que la centralisation est néfaste et qu’elle ne peut produire que des erreurs et les abus.
La décentralisation est le facteur le plus important de la liberté collective et individuelle. Politiquement et économiquement aucune évolution ne sera possible tant que subsistera cette autorité brutale qu’exerce le centralisme.
Tous les rouages sociaux sont corrompus par la centralisation industrielle, commerciale, politique et administrative des états modernes. En France, le législateur a cru, en votant la loi du 10 août 1871 sur les Conseils Généraux et celle du 5 avril1884 sur l’organisation communale, donner une certaine autonomie aux communes et décentraliser administrativement les institutions secondaires du pays. Nous savons trop qu’aucune loi n’est opérante en cette matière, que les difficultés de décentralisation ont des causes profondes, et que ce n’est pas dans les Parlements qu’il faut chercher les remèdes propices à résoudre cette question.
Francis Delaisi dans son ouvrage de vulgarisation « La Démocratie et les Financiers », nous montre que le monde est dirigé par une poignée d’hommes tout puissants qui sont à la tête de tous les grands organismes financiers et industriels. Ce sont ces quelques individualités qui contrôlent tous les rouages des sociétés et ce sont eux qui tiennent entre leurs mains la vie et la mort des peuples. Or la décentralisation ne pourra devenir effective que lorsque l’on aura détruit la puissance de ces ploutocrates. La décentralisation ne peut être que le fruit de la Révolution.
Au lendemain de la catastrophe qui entraînera la chute du régime capitaliste, il faut se garder de tomber dans les mêmes erreurs révolutionnaires précédentes et ne pas pousser à la centralisation mais à la décentralisation. Décentralisation ne veut pas dire désordre, et les anarchistes comprennent qu’il est indispensable à une Société de s’organiser sur des bases solides pour être viable. Or l’exemple démontre que la centralisation a toujours été un facteur de désagrégation et non pas d’organisation et, d’autre part, qu’elle a été incapable d’assurer le bonheur des peuples. Par décentralisation nous entendons l’organisation sociale de la base au faîte, et non pas du faîte à la base. La liberté absolue des peuples ne peut pas venir d’en haut, mais d’en bas et elle ne peut se maintenir et se perpétuer que si les hommes, conscients de leurs devoirs et de leur force, refusent d’abdiquer en faveur d’une minorité qui dirige tout l’organisme social.
Décentralisation économiquement et politiquement, telle est la tâche à laquelle doivent se livrer les travailleurs. Ils doivent acquérir les compétences indispensables pour diriger, chacun dans sa branche respective, le monde de demain. Lorsque la richesse n’appartiendra plus à quelques-uns, mais à tous, lorsque la terre et la machine auront été reprises par les travailleurs, et que la décentralisation se sera opérée par la révolte des opprimés contre leurs oppresseurs, la liberté et l’égalité se réaliseront dans une société fraternelle.
DECHANTER
verbe
Au sens propre « déchanter » signifie : chanter en partie ou encore chanter faux ou mal. Ce mot est peu usité au sens propre et est, surtout dans le langage courant, employé au sens figuré pour signaler le changement d’avis ou de sentiment d’individus vaniteux et prétentieux. « Faire déchanter quelqu’un », c’est-à-dire : lui enlever les espérances ou les prétentions qu’il avait conçues, lui faire baisser le ton et le rendre plus traitable.
DECHEANCE
n. f.
Déchoir, être abaissé, avili. Tomber dans une situation moins avantageuse que celle que l’on occupait primitivement. La déchéance d’un individu, d’un monarque, d’une société, d’un Etat, d’une civilisation.
La déchéance, au sens bourgeois du mot, emprunte différentes formes. Il y a d’abord la déchéance commerciale qui est prononcée en vertu des articles 168 et suivants du Code pénal, contre tout commerçant ne faisant pas « honneur » à sa signature. Pourtant la bourgeoisie se moque magistralement de cette déchéance, et lorsque ses intérêts le guident sur cette route, le commerçant n’hésite jamais à se laisser déclarer en faillite, car au bout d’un certain temps « la déchéance » est prescrite et le voleur légal, redevenu honnête homme, peut recommencer ses forfaits.
La déchéance d’un prince, d’un monarque est parfois la conséquence d’un coup d’Etat et souvent l’effet d’un soulèvement populaire. La déchéance du roi Louis XVI fut prononcée par la Convention, elle fut définitive car le peuple grondait et en avait assez du régime monarchiste. Celle de Napoléon 1er offre le spectacle le plus répugnant de la lâcheté et de la bassesse des courtisans. Ce fut le 3 avril 1814 que le Sénat qui s’était courbé si humblement devant Napoléon s’empressa de prononcer sa déchéance et celle de sa famille ; mais lorsque l’Empereur revint au mois de Mars suivant, il retrouva pour plier le genou devant lui tous ceux qui avaient été les premiers à le déclarer déchu de ses droits et de ses titres.
Plus près de nous nous avons la déchéance de Guillaume II, ex-empereur d’Allemagne, qui à la suite de la guerre meurtrière de 1914 fut obligé d’abandonner la couronne, et de céder la place à l’organisation républicaine. Espérons que bientôt la monarchie ne sera plus qu’un vestige du passé et qu’une fois prononcée universellement, les peuples se mettront à l’ouvrage pour prononcer la déchéance du capital.
Mais la déchéance ne se manifeste pas seulement dans les classes privilégiées, et bien des individus appartenant aux classes opprimées se dégradent et s’avilissent. N’est-ce pas une déchéance que de se livrer à la boisson et de se laisser dominer par ce vice terrible qui cause tant de ravages dans les populations ouvrières ? N’est-ce pas une déchéance de prêter, tel le policier, le gardien de prison, son concours au capitalisme pour lui permettre d’exploiter le prolétariat ; n’est-ce pas déchoir que de tirer sur les hommes en grève lorsque l’on a revêtu l’uniforme militaire ?
Par ses vices, par ses crimes, par ses orgies, la bourgeoisie est plongée dans une période de déchéance, et si nous voulons remplacer le régime capitaliste par une société idéale, il faut s’élever, s’agrandir, être meilleurs que nous le sommes et apposer à la déchéance du capitalisme l’évolution progressive du prolétariat manuel et intellectuel.
DECHRISTIANISATION
n. f.
Malgré la propagande anticléricale, malgré les efforts des libres-penseurs militants et convaincus — et il n’en manque pas sur la planète — les milieux d’avant-garde en général et les groupements anarchistes en particulier sont loin d’être « déchristianisés ». Je ne parle pas seulement ici du mariage à l’église, du baptême, de la première communion et autres fariboles sacramentelles que des anarchistes acceptent encore — les uns pour avoir « la paix chez soi » — les autres parce qu’ils s’imaginent « avoir eu » les prêtres (on m’a donné cette explication, un jour). A la vérité, cette forme de ruse (?) va à l’encontre de son but, puisqu’en agissant ainsi, les mécréants démontrent qu’ils ne peuvent faire finalement fi de l’Eglise.
Mais ce n’est pas de cette « déchristianisation » — là que je veux écrire. Je reproche aux anarchistes de trop considérer le globe terraqué comme « une vallée de larmes », de trop « mépriser la chair ». Dans les publications anarchistes, on ne parle pas assez de se récréer, de s’amuser, pas assez de la joie de vivre, des jouissances de l’existence quand on ne la considère plus comme un lieu d’expiations.
Il se peut que les lignes ci-dessous dérangent toutes les idées admises jusqu’ici par les anarchistes marxistes et proudhoniens, communistes et individualistes. Il se peut que je fasse erreur. Mais comme je ne me suis jamais dit infaillible, que je me contente modestement de présenter des thèses et de poser des problèmes, cela n’est pas bien important.
Après avoir examiné la question à fond, je me demande si les réformateurs et les révolutionnaires anarchistes et sociaux ne se sont pas trompés en présentant comme but de réformes ou de révolutions la solution du problème économique, refoulant ainsi et mettant au second plan la satisfaction de ceux des instincts individuels et collectifs qui sont les plus anarchiques.
Je pense quant à moi que s’ils s’étaient préoccupés en premier lieu d’exalter ce qui rend agréable et joyeuse à vivre la vie quotidienne — s’ils avaient cherché d’abord à glorifier l’allégresse, la joie, la volupté de vivre — s’ils avaient enseigné aux hommes que vertu ou morale est conséquence ou synonyme de plaisir ou jouissance et non plaisir ou jouissance synonyme de travail ou de peine, je pense que « la révolution » marcherait d’un pas plus rapide qu’elle ne le fait.
Je pense que si les éducateurs, les animateurs, les stimulateurs, les initiateurs d’avant-garde avaient incité les hommes à jouir d’abord de la vie, à ne lui attribuer de valeur que dans la mesure où elle procure la satisfaction des sens, nous serions très proches d’une révolution, d’une révolution qui exclurait toute possibilité d’une rétrogradation vers l’anarchisme.
Au contraire, réformateurs et conservateurs sociaux rivalisent pour décrire ou à peu près la vie comme une manifestation de production ou de consommation ; à les en croire, le problème de la vie économique devra être résolu avant qu’on s’occupe du problème de la distraction ou de la récréation (j’entends par « distraction et récréation » l’ensemble des jouissances qui excluent la pine). Comme le travail nécessaire à la vie économique, le travail à peine occupe ou fatigue considérablement l’unité humaine lorsqu’il est placé en premier lieu, il ne reste pour ainsi dire plus de temps pour qu’elle puisse se récréer ou se distraire tout son saoul, en toute franchise.
Supposons que disparaissent les préjugés engendrés par cette idée que la distraction et la récréation doivent céder le pas à la peine et au travail — supposons que les hommes fassent une révolution afin que le plus clair de leurs énergies créatrices ou inventives soient consacrées — en dehors de toute contrainte ou de toute loi ou de toute morale religieuse ou laïque à la satisfaction de leurs besoins ou de leurs appétits récréatifs — je pose en thèse que le but de cette révolution correspondrait tellement à l’aspiration générale, universelle que le travail nécessaire à la vie économique, devenant un aspect ou une conséquence des réalisations et des jouissances générales, — s’accomplirait sans qu’il y ait besoin de contrainte.
La question a été à peine effleurée jusqu’ici. Le travail est considéré comme quelque chose de « supérieur », de sacré, à accomplir coûte que coûte, d’abord. Je rêve d’une humanité où le travail aux fins économiques se placera à la suite de l’assouvissement des activités de distraction ou de récréation. Dans une humanité où prévaudra cette mentalité, on n’accumulera plus, comme dans la société actuelle, pour se procurer des plaisirs ou des jouissances accessibles seulement à des privilégiés, que la fortune place au-dessus de la morale courante.
Il y a beaucoup trop de restricteurs, de refouleurs, de limitateurs, de modérateurs parmi les réformateurs et les révolutionnaires. La société pour l’établissement de laquelle ils nous demandent de nous donner tom entiers, être et avoir, ressemble trop à la vallée de larmes christiano-capitaliste. Il est trop souvent question de devoirs, de peine, de labeur. Qu’on nous propose une fois pour toutes une l’évolution en vue d’instaurer un milieu social où, sans contrôle gouvernemental ou étatiste, sans obstruction ou surveillance archiste, la distraction et la récréation passeront eu première ligne. Voilà qui serait faire œuvre de « déchristianisation » véritable.
- E. ARMAND.
DECHRISTIANISATION
Faire cesser d’être chrétien ; enlever la qualité de chrétien. On pourrait penser qu’en notre siècle de science et de progrès le Christianisme n’est plus un danger. Ce serait une erreur car l’Eglise est encore puissante et c’est un devoir que de s’attacher à en amoindrir les effets. La déchristianisation est donc une œuvre qu’il faut poursuivre.
Le christianisme repose sur une erreur ; il est possible qu’à une certaine période de l’histoire il ait eu son utilité, mais de nos jours il est périmé et ne répond à aucun besoin social, sinon à celui de la bourgeoisie qui l’utilise pour asservir le peuple et le maintenir en esclavage.
« Nous nions le christianisme, comme nous nions les théories générales scientifiques du passé, comme nous nions la politique du passé, comme nous nions le régime des républiques d’Aristote ou de la monarchie de Louis XIV... Persuadé que la religion de l’Avenir ne sera pas la synthèse chrétienne, nous croyons que le respect superstitieux qui s’attache encore à la religion du passé est un des plus grands obstacles aux progrès de tout genre que la Société doit faire » (Pierre Leroux).
En effet, le Christianisme, par son idéologie, par ses pratiques, perpétue ou cherche à perpétuer un état de chose qui n’est plus en rapport avec les aspirations du peuple ; d’autre part, il s’est sensiblement éloigné de la doctrine de Jésus et « celui » qui prêcha sur la montagne se refuserait à servir de base à la comédie qui se joue depuis des siècles autour de son nom. La déchristianisation est donc une œuvre d’utilité et de salubrité sociales.
Pourtant il faut être juste et « rendre à César ce qui appartient à César ». Le christianisme n’est pas seul à corrompre la neutralité collective. Toutes les religions ont une part égale de responsabilité dans le désordre moral et intellectuel des humains, Juifs, protestants, etc., etc., sont également les victimes des exploitants de la crédulité populaire, et déchristianiser les uns, sans libérer les autres du dogme qui pèse sur eux et les écrase serait un travail inachevé. Il faut combattre toutes les religions quelles qu’elles soient ; il faut ouvrir à la lumière tous les cerveaux plongés depuis si longtemps dans l’obscurité, sans omettre les religions modernes, les religions terrestres que sont le nationalisme et le parlementarisme.
DECISION
n. f.
Action de décider, de prendre une résolution ; ce qui est décidé. Avoir de la décision, c’est-à-dire être prompt à prendre un jugement, à résoudre une question embarrassante. « Si l’on manque le moment « décisif », surtout en révolution, on court fortune de ne jamais le retrouver ». Il faut avoir le courage de prendre des décisions lorsque le besoin s’est fait sentir, et surtout appliquer ces décisions lorsque c’est nécessaire. Manquer de décision, c’est partir à l’aventure et échouer dans toutes ses entreprises. Une décision claire et logique est toujours préférable à des résolutions embrouillées prises par un nombre incalculable d’individus. Les anarchistes doivent savoir être décisifs et hardis et être capables, au moment opportun, de prendre les décisions que comportent les événements.
DECLAMATION
n. f.
Action de déclamer ; traduire en paroles une pièce de théâtre ou de littérature ; réciter à haute voix. Le mot déclamation est peu usité pour signifier simplement la lecture à haute voix d’une pièce de vers ; on l’emploie surtout pour désigner l’art de débiter et de jouer une œuvre théâtrale, et plus particulièrement la tragédie. Ce terme sert aussi à signaler la recherche, l’affectation, l’usage de phrases pompeuses dans le discours, et il est toujours péjoratif lorsqu’on l’applique dans ce sens. « Ce discours n’est qu’une ennuyeuse, une plate déclamation » (Lachâtre). En dehors de la scène, il faut donc se garder d’user de la déclamation, car un discours, simple, clair et précis obtient toujours de meilleurs résultats et produit une impression plus avantageuse que tout l’art déclamatoire que l’on peut posséder.
DECLASSE
adj.
S’emploie pour les personnes et les choses. Ce qui est sorti de sa classe, ce qui sort du rang qu’il occupait. La bourgeoisie, et surtout la vieille noblesse, considère comme un « déclassé » celui qui, abandonnant les vieilles traditions, s’allie avec une personne appartenant à une classe « inférieure » ; et naturellement on considère comme inférieurs ceux qui travaillent. On peut cependant constater que l’usage de rester enfermé dans les cadres établis par la tradition se perd, et que les « déclassés » deviennent de plus en plus nombreux. L’évolution et le progrès en sont la cause.
La classe ouvrière, elle aussi, a ses « déclassés ». Ce sont tous ceux qui, sortis de son sein, n’hésitent pas à se livrer à la bourgeoisie et à défendre ses intérêts.
DECLENCHER
verbe
La clenche est une des pièces du loquet qui tient la porte fermée et le mot déclencher signifie : lever la clenche pour ouvrir la porte. Ce mot est surtout employé au sens figuré où il acquiert une signification plus ample qu’au sens propre. « Déclencher » la guerre, c’est-à-dire profiter de certains événements pour mettre fin à une ère de paix et ouvrir une période de sanglantes batailles. Le carnage de 1914 fut déclenché par la tourbe des capitalistes ambitieux et avides. Lorsque leurs intérêts particuliers sont en jeu, les capitalistes n’hésitent jamais à déclencher un mouvement guerrier dans l’espoir de retrouver l’équilibre, mais il arrive parfois que leurs espérances sont déçues et qu’à la suite du carnage se déclenche la Révolution.
Ce fut ce qui se produisit en Russie et en Allemagne. Las d’être courbé, le peuple se révolta et chassa les maîtres : mais il ne sut pas profiter entièrement de son geste et il faudra « déclencher » d’autres révolutions encore à travers le monde pour libérer définitivement l’humanité.
DECLIN
n. m.
Ce qui touche à sa fin : ce qui arrive à son terme. Le déclin du jour ; le déclin de la vie. S’emploie également pour signaler la perte de l’influence exercée par un état, un gouvernement etc., etc.…L’empire est à son « déclin » ; le déclin d’une civilisation. On se sert aussi du mot « déclin » comme synonyme de diminuer. Le « déclin de la fièvre » pour la diminution de la fièvre. Tout ce qui monte est appelé à redescendre, et le capitalisme qui s’est élevé avec rapidité est arrivé aujourd’hui à son point culminant. Chaque heure, chaque minute qui s’écoule, précipite sa chute ; il est à son déclin et déclinera jusqu’au moment où, complètement affaibli, il s’écroulera sous la poussée et le choc des parias qu’il a asservis durant des siècles.
DECOMPOSITION
n. f.
Action de séparer les parties d’un corps composé ; dissocier un tout formé de plusieurs éléments. En chimie, la décomposition a pour but de séparer les principes d’un composé ; elle diffère de l’analyse en ce sens que celle-ci détermine les proportions de ces principes. Le mot « décomposition » est parfois synonyme de « altération » ou « putréfaction ». On dit un corps en décomposition ce qui, dans son esprit, signifie la même chose qu’un corps en putréfaction.
De même qu’en chimie la décomposition morale d’un corps social est souvent indispensable pour déterminer sa valeur. Lorsqu’il est difficile à l’esprit humain de saisir toute l’étendue d’un sujet, il le décompose et arrive avec moins de difficultés aux résultats attendus et espérés. Au point de vue social, la décomposition morale et intellectuelle est donc un facteur de clarté. Tel sujet, tel objet qui nous apparaissaient sous un certain angle, change de physionomie à la décomposition. En décomposant la société moderne, et en s’attaquant à certaines institutions qui en forment les bases, on a plus de chance d’en ébranler les assises, car si elle offre une certaine résistance dans son tout, elle présente une certaine faiblesse dans ses parties.
DECORATION
n. f.
Ce qui sert à embellir, à orner. La décoration d’un salon, la décoration d’un jardin. En peinture comme en sculpture, ou en tout autre partie, la décoration est un art utile et agréable. Au théâtre, la décoration offre de véritables services. Dans le sens théâtral, on emploi plutôt le mot « décors » que « décoration » ; sa signification est la même. Pour décorer en certaines occasions des salles ou des appartements, on a recours à la fleur et à la tapisserie. Le décorateur doit avoir du goût, de l’intelligence, l’esprit de perspective, en un mot des connaissances multiples pour être un véritable artiste. On donne aussi le nom de « décoration » aux médailles et rubans que distribue journellement le Gouvernement ou ses ministres aux individus qu’ils veulent honorer. Avoir une décoration est une marque de dignité pour les ignorants et les ambitieux. La décoration a été instituée pour récompenser le mérite, mais outre qu’elle est souvent donnée sans aucune raison, il en est fait un tel abus qu’il y aura bientôt plus d’individus décorés que d’autres. Il y a des gens qui sont avides de décorations et qui accomplissent des bassesses pour en obtenir. C’est la vanité qui guide ces malheureux imbéciles qui veulent avoir quelque chose qui les signale à leurs semblables. En France, il y a environ soixante-dix ordres différents de décorations. La plus recherchée et la plus honorifique est celle de la Légion d’honneur qui fut instituée par la loi consulaire du 19 mai 1802, pour récompenser les services civils et militaires.
Quelle que soit la décoration dont on est gratifié par un gouvernement ou un homme d’Etat quelconque, cela n’implique pas la valeur d’un individu et n’ajoute rien à son mérite. L’homme intelligent trouve de suffisantes satisfactions dans l’utilité de son travail ou do son œuvre, sans rechercher un plaisir ridicule à porter à sa boutonnière un morceau de ruban d’une certaine couleur, et il est de vrais savants qui, pleins de modestie, refusent catégoriquement d’accepter aucun signe « honorifique », se distinguent ainsi des ambitieux vulgaires.
DÉCOUVERTE
n. f.
Action de découvrir ; de trouver une chose qui était ignorée, inconnue. Parvenir à percer l’obscurité de certains sujets. La découverte d’un pays, d’une mine. Une découverte scientifique. L’Amérique fut découverte en 1492 par le Gênois Christophe Colomb. Lorsqu’il décida de traverser l’Atlantique dans la direction de l’Ouest pour aborder aux rivages inconnus, de l’Inde, Christophe Colomb fut accueilli par la moquerie générale ; avec une pauvre flottille composée seulement de trois grandes barques, il partit pourtant le 3 août 1492 et, quelques mois plus tard, l’Amérique était découverte.
C’est aux découvertes successives de la science que nous devons le progrès. La nature indifférente possède en son sein des richesses incalculables, mais il faut que le génie humain les découvre ; ce n’est qu’à force de travail et de recherche que l’on arrive à percer ses secrets. La conquête de l’air, la T.S.F., autant de découvertes qui devraient être utiles à l’évolution de l’humanité, mais qui, hélas, sont bien souvent mises au service de la mort, et non de la vie. Les nombreuses découvertes qui ont illustré 1a fin du dix-neuvième et le vingtième siècle devraient permettre aux hommes de vivre libres et heureux. Mais les hommes se déchirent entre eux et passent leur temps à s’entre-tuer au lieu de s’unir et de s’aimer. Malgré l’ambition d’une fraction de l’humanité, qui profite en ce moment de la presque totalité des découvertes, le temps travaille à la régénération du monde, et l’heure est proche où les découvertes ne seront pas exploitées au bénéfice d’une portion, mais de l’humanité tout entière.
DÉCRASSER
verbe
Enlever la crasse ; nettoyer l’ordure qui se pose sur le corps ou sur les vêtements. Se décrasser au savon ; prendre un bain pour se décrasser. Au sens figuré : libérer un individu de ses préjugés ; lui donner une instruction, une éducation ; le sortir de l’ignorance dans laquelle il est plongé, lui donner du relief, le former, le façonner. D’un être rude et grossier, faire un homme bien élevé et sociable.
« Nous étions de grands ignorants et de misérables barbares quand les Arabes se décrassaient. » (Voltaire)
En France, lorsque la noblesse était encore puissante et qu’une famille bourgeoise achetait un titre ou une charge, qui donnait la noblesse, on disait qu’elle se « décrassait ».
Ils sont nombreux les individus à décrasser en ce monde. Voltaire écrivait déjà à son époque que « ce monde est une fort mauvaise machine qui a besoin d’être décrassée » et le travail n’a pas encore été accompli. La grande Révolution a passé, suivie de celles de 1830, de 1848, de 1871, et chacun de ces soulèvements ont enlevé un peu de la crasse qui s’accumulait depuis des années. Ce ne fut pas suffisant, et il faut continuer. Il ne faudrait pas s’imaginer que, seule, la bourgeoisie est responsable de l’état de choses que nous subissons. Le peuple a aussi une grande part de responsabilité dans le régime social qui nous est imposé. Le peuple se lave physiquement, mais intellectuellement et moralement il commence seulement à se décrasser. Son cerveau est encore encrassé de mille et mille préjugés qui le tiennent lié au passé et aux vieilles traditions, et ce sont tous ces facteurs rétrogrades qui entravent l’évolution.
Les croyances spirituelles s’effacent peu à peu. La crasse religieuse disparaît petit à petit, mais la crasse politique prend sa place et il faudra que le peuple prenne un bon bain pour retirer cette couche épaisse qui obstrue son intelligence. C’est en se décrassant que le peuple pourra acquérir le bonheur et là liberté. Qu’il se hâte, car personne ne se chargera de le décrasser s’il ne se livre pas lui-même à cette besogne.
DÉCRÉPITUDE
n. f.
Affaiblissement général de toutes les fonctions organiques d’un individu ou d’une société. La décrépitude est le dernier état, l’extrémité de la vieillesse pour un individu, et du déclin pour une société. Tous les vieillards ne sont pas atteints de décrépitude ; on peut vivre très vieux sans passer par cet état. Les causes de décrépitude sont ordinairement la faiblesse, la maladie, les mauvais soins, les privations, etc..., et son caractère est l’affaiblissement des fonctions de l’économie. Sans pour cela jeter le discrédit sur les vieillards, nous pensons cependant que, parvenu à un certain âge, le corps a besoin de repos et que le travail ne doit être exécuté que par la jeunesse. La vieillesse peut nous prodiguer les conseils utiles acquis au cours de l’existence par l’expérience de la vie, mais c’est à la jeunesse, source de force et d’avenir, qu’il appartient de forger l’outil social qui assure à chacun une somme de bonheur et de bien-être. S’il en était ainsi, la décrépitude serait un accident excessivement rare, car les hommes ne se tueraient pas au travail et nous n’assisterions pas au terrible spectacle de vieillards malades et infirmes incapables de répondre aux nécessités organiques de leur individu. D’autre part, si l’humanité était rénovée, — et elle le sera un jour — sans en exclure le plaisir et la joie, l’orgie et le vice disparaîtront d’eux-mêmes et nous ne serons plus dirigés comme nous le sommes aujourd’hui par des vieillards séniles, ignorants des besoins du peuple et attachés aux traditions du siècle passé.
Si on considère les hommes qui nous gouvernent en cette fin du vingtième siècle, nous pouvons avoir de sincères espérances. Représentants directs de la bourgeoisie et du capital, ils tombent eux-mêmes en décrépitude comme tomberont en décrépitude le capital et la bourgeoisie.
DÉCRET
n. m.
Le décret est un acte, un arrêt, une décision du Pouvoir exécutif ayant pour but d’assurer le fonctionnement des services publics et l’exécution des lois. Le décret est donc un complément de la loi, et se différencie de cette dernière de ce fait que les lois sont votées par les Assemblées législatives, tandis que les décrets sont rendus par les chefs d’Etat ou de Gouvernement.
Il y a en France plusieurs catégories de décrets. La Constitution de 1875 accorde au Président, de la République le pouvoir de rendre des décrets dits « décrets gouvernementaux ». De même que les décrets spéciaux ou individuels, qui ne sont en réalité que des ordonnances et règlements d’ordre administratif, les décrets gouvernementaux sont contre-signés par un ministre. En général, dans la promulgation d’un décret, bien qu’il le signale, le chef d’Etat ne fait office que de paravent et le décret est toujours rendu à la demande du ministre qui en est l’auteur responsable. Il arrive parfois, lorsqu’un Gouvernement se trouve en difficultés, qu’il réclame du Parlement l’abandon de ses pouvoirs et l’autorisation de rendre des décrets ayant force de loi. C’est ce que l’on appelle les décrets-lois. Lorsque le Parlement répond favorablement à cette demande, le chef du Gouvernement est alors pourvu d’une puissance qui en fait un véritable autocrate, ses actes n’étant même plus soumis au contrôle des Assemblées législatives. Nous savons fort bien que la loi est une chose néfaste en elle même et qu’il n’y a rien de bon à attendre d’un Parlement ; il n’est cependant pas inutile de souligner que lorsqu’un Parlement abandonne les prérogatives qui lui ont été transmises par le peuple naïf et confiant, il abuse du pouvoir qu’il détient, et s’il agit ainsi c’est qu’aux époques de difficultés et de trouble, il n’a pas le courage de prendre ses responsabilités et préfère se livrer entièrement à un homme d’Etat qui exerce alors librement sa dictature.
Comme tout ce qui émane du Gouvernement, un décret ne peut jamais être bienfaisant pour le peuple. Les Gouvernants sont placés à la tête d’un Etat par une poignée de gros industriels et de gros financiers dont ils sont les jouets et les complices, pour défendre la bourgeoisie et le capital, et leurs fonctions consistent à prendre les mesures les plus propres à maintenir les privilèges des classes possédantes. En conséquence les classes opprimées n’ont rien à attendre des gouvernants et de leurs décrets. Il arrive également qu’un Gouvernement prenne sous son entière responsabilité la publication d’un décret sans en avoir obtenu l’autorisation préalable du Parlement. Nous avons vu, en France par exemple, que le Gouvernement n’hésita pas, en 1914, à décréter la mobilisation générale et que, devant le fait accompli le Parlement ne protesta même pas contre cet abus qui, cependant, jetait dans la mêlée et dans la mort des millions d’individus. Quelle confiance peut-on alors accorder à ces Assemblées législatives qui prétendent représenter la majorité du peuple, agir en son nom, veiller au respect des volontés populaires et qui laissent à quelques hommes la puissance de disposer à leur gré de la vie de toute une génération. De même que le peuple abandonne sa force entre les mains du député qui lui ment et qui le gruge, le député abandonne la sienne entre les mains des gouvernants. Il n’y a pas à chercher de vice de forme dans cette manière de procéder, c’est la forme elle-même qui est viciée ; le décret est une conséquence, une résultante du régime d’autorité et quelle que soit son étiquette monarchiste, ou républicaine, il faudra détruire le régime pour s’en libérer.
DEDUCTION
n. f. (du latin deducere, extraire)
Conséquence d’un raisonnement. Action qui consiste à inférer par le raisonnement ou par l’esprit une chose d’une autre ou de tirer une conclusion d’un fait général pour l’appliquer à un fait particulier. Exemple :
Examinant les sociétés à travers les âges et considérant qu’elles se sont toutes écroulées sous le poids de l’autorité, nous pouvons conclure, c’est-à-dire : tirer cette « déduction » que l’autorité est néfaste à la vie des sociétés. La déduction très employée dans les sciences mathématiques n’est pas moins utile dans les autres sciences, en sociologie et en histoire. C’est de la déduction que l’on peut tirer les motifs et griefs qui nous permettent d’échafauder les critiques contre les régimes qui sont imposés aux collectivités ; c’est par la déduction que les historiens sont arrivés à plonger dans l’obscurité du passé, et d’effacer tous les mensonges des diverses religions, et c’est par la déduction que nous pouvons raisonnablement envisager l’avenir.
DÉFAILLANCE
n. f.
Affaiblissement. Perte partielle des sens et du mouvement. Tomber en défaillance, c’est-à-dire tomber en syncope. La défaillance a pour cause un affaiblissement physique et est le signe précurseur de maladies graves à moins qu’elle ne soit due qu’à la vieillesse, à la fatigue ou à l’excès de travail. Dans ce cas, un repos assez complet remet de l’ordre dans l’organisme et les troubles disparaissent.
Le mot défaillance est employé assez fréquemment comme synonyme de découragement. Exemple : « Tout homme est sujet à la défaillance », pour « tout homme est sujet au découragement ».
Dans le mouvement social il est peu de militants dévoués et sincères qui ne soient pas passés par ces heures de trouble, de doute, de découragement, de défaillance, et cela se comprend. La route à parcourir est couverte de ronces, et la côte est rude à gravir. Lorsque l’on jette un regard en avant et que l’on constate tout le chemin qu’il y a encore à parcourir, on est pris parfois par la lassitude et l’on désespère de ne jamais arriver au but.
En ces heures de défaillance, il faut se détourner et contempler non pas le chemin à parcourir, mais celui parcouru ; il faut se souvenir que, depuis des années et des années, des hommes comme nous ont eu le courage de lutter pour défricher le terrain que nous foulons ; il faut se rappeler que des savants sont restés penchés sur leurs cornues, analysant la matière pour arracher ses secrets à la nature et rendre notre vie un peu moins rude et un peu plus belle ; il ne faut pas oublier que des philosophes ont blanchi sur leurs livres pour dépouiller l’existence de ses mensonges et de ses erreurs et rendre possible l’évolution de l’humanité. En ces heures de défaillance, qui sont inhérentes a la lutte terrible que nous menons, il faut se dire que si le chemin est encore bien long, la plus grande partie en a été couverte par le passé et qu’il est .de notre devoir de continuer à avancer toujours sans nous arrêter jamais. La vie est éternelle dans le temps et dans l’espace, et si l’individu ne peut comprendre l’infini, la vie cependant ne se poursuit qu’en se donnant, et 1es générations futures bénéficieront de l’héritage que nous leur léguerons. La vie, c’est la lutte, c’est la bataille, pour le bien-être, pour la liberté, pour l’amélioration toujours accentuée du bonheur, pour la libération des hommes. La défaillance, c’est un peu de mort qui nous envahit. Il faut se dresser contre elle. Il faut, s’imprégner de la puissance et de la force de ceux qui, jusqu’à leur dernier souffle, ont tout donné dans le combat grandiose qui divise l’humanité, et comme eux, sans défaillance, travailler à préparer des jours meilleurs.
DÉFAITISME
n. m.
Le « défaitisme » est né durant la grande guerre « du Droit et de la Civilisation » et il est tout un symbole. Qu’on en juge par la définition qu’en donne le Larousse : « Pendant la grande guerre, opinion et politique de ceux qui manquaient de confiance dans la victoire, ou qui estimaient la défaite moins onéreuse que la continuation de la guerre ». En conséquence, nous pouvons déduire de cette définition que le mot défaitisme est purement national, car s’il est vrai que ceux qui doutaient de la victoire française avaient tort, puisque la France fut victorieuse, les défaitistes allemands avaient raison. Ce qui n’empêchait du reste pas les autorités germaniques d’emprisonner et d’exécuter ceux qui se permettaient de douter de la victoire allemande. En second lieu nous dit le Larousse « ou ceux qui estimaient la défaite moins onéreuse que la continuation de la guerre ». La guerre est terminée depuis bien des années déjà et nous pouvons constater que ceux qui étaient, durant le carnage, accusés de « défaitisme » n’étaient pas dans l’erreur. La défaite eut été moins onéreuse que la continuation de la guerre.
Un simple regard impartial sur la situation de la France victorieuse et nous serons fixés.
Avant la guerre, et avant la victoire, la richesse sociale de la France, s’il faut en croire les économistes bourgeois, était d’environ trois cents milliards de francs et sa dette qui datait encore de la guerre de 1870–1871, de trente-cinq milliards de francs. Or, la France victorieuse a vu sa richesse sociale baisser du tiers, de ce fait que pendant quatre ans et demie toute la production s’est évaporée en fumée sur les champs de bataille, et sa dette a augmenté dans de telles proportions qu’elle atteint un chiffre supérieur à sept cents milliards de francs.
A cette perte sèche, il faut naturellement ajouter un million 500.000 morts, plus le grand nombre de blessés arrachés à la production ; il est vrai que « l’homme » ne compte pas pour le capital et qu’il n’est considéré que comme chair à canon.
Eh bien ! Ce sont ceux qui prévoyaient cette débâcle économique et financière qui étaient accusés de défaitisme. Or, le fait est là, dans sa tragique brutalité : aucune guerre ne peut être avantageuse pour une nation victorieuse ou vaincue.
On pouvait penser que les hommes sur qui pèsent la lourde responsabilité de la guerre, seraient éclairés à la lumière de la réalité et que, devant l’étendue du désastre qu’ils avaient causé, ils conserveraient le silence ; on pouvait espérer qu’ils reconnaîtraient l’erreur profonde qu’ils avaient commise en accusant de « défaitisme » les esprits assez clairvoyants pour prévoir ce qui allait arriver et que le « défaitisme » allait mourir à l’aube de la paix.
Il n’en fut rien ; il n’en est rien. Le défaitisme existe toujours ; il est devenu un spectre que brandit le Gouvernement lorsqu’il se trouve en difficulté, et les mêmes hommes qui ont accumulé les crimes monstrueux de la boucherie, poursuivent leur œuvre en accusant de « défaitisme » ceux qui ont « l’audace » de les critiquer et de les combattre.
Cependant, si les populations se sont laissées griser pendant la guerre par des mots vides de sens, il n’en sera pas toujours de même ; et le défaitisme pourrait bien triompher. Défaitistes ; les anarchistes le sont, si le défaitisme consiste à lutter contre toute guerre, défensive ou offensive, ce qui est la même chose ; défaitistes, ils 1e sont pour abolir un régime d’abjection qui provoque le massacre de toute une génération ; ils le sont également pour affirmer qu’il ne peut rien sortir de bon, de juste et de beau du capitalisme qui engendre la guerre et la mort.
Les défaitistes seront de plus en plus nombreux et le capitalisme en a étendu le nombre, par sa guerre et par son après-guerre. Il a pensé consolider ses assises dans le sang de l’humanité ; il s’est trompé et n’est arrivé qu’à ébranler plus fortement ses bases ; il chancelle aujourd’hui et recherche un équilibre qu’il ne trouvera plus. La situation est désaxée. Le capitalisme a recours à des moyens extrêmes pour allonger sa vie ; peine perdue et inutile, il est condamné. Il a créé le défaitisme, le défaitisme l’écrasera.
DÉFAUT
n. m.
Absence, manquement, vice, imperfection physique ou morale. Ce qui est contraire à la vertu, à la perfection. « Avoir de grands défauts. » Le mot « défaut » s’applique aux personnes et aux choses ; on dit d’une œuvre imparfaite, défectueuse, qu’elle est pleine de défauts. Ce drap est tissé sur un métier usagé et est rempli de « défauts ». C’est en vain que l’on chercherait des qualités à cet homme, il n’a que des défauts.
« Ils rachètent ces défauts, par de grandes connaissances et par de grandes vertus. » (Voltaire.)
En jurisprudence, le mot défaut signifie, manquement. Faire défaut à un jugement, c’est-à-dire ne pas se présenter après avoir reçu l’assignation judiciaire. Etre condamné par défaut, ; être condamné sans avoir plaidé, sans être présent au jugement. On a toujours la faculté de faire opposition à un jugement, rendu par défaut, lorsque celui-ci vous est signifié. Etre en défaut ou être pris en défaut s’emploie couramment pour signaler le manquement à ce que l’on devait faire.
DÉFECTION
n. f.
Action de faire défaut, d’abandonner une lutte, un parti, une action, à un moment imprévu. La défection est une lâcheté, car elle met en difficulté celui qui comptait sur un concours extérieur et qui se trouve seul pour accomplir l’acte projeté. La défection est le propre des individus qui n’ont pas le courage de s’affirmer, qui promettent tout ce qu’on leur demande et qui sont absents à l’heure où leur présence escomptée serait indispensable. Il faut toujours se garder de prendre des engagements lorsque l’on ne se sent pas la force et l’énergie de les tenir. La défection dans le mouvement révolutionnaire peut avoir des effets funestes. En période de calme, chacun peut se réclamer de révolutionnarisme et ce n’est que dans les époques troublées et lorsque l’ardeur de la lutte exige que chacun fasse abandon d’un peu de lui-même que l’on peut juger de la sincérité du révolutionnaire. Hélas ! Quantité de ceux que l’on pouvait considérer comme des amis ne répondent pas à l’appel lorsque l’heure est venue de se dépenser, et la défection de ces révolutionnaires de pacotille, peut déchaîner des désastres. Et c’est pourquoi les Anarchistes n’ont pas confiance en ces partis politiques qui ne réclament de leurs adhérents qu’un bulletin de vote, car ils savent que l’on ne peut compter sur tous les électeurs naïfs qui pensent accomplir une œuvre révolutionnaire en déposant dans l’urne démocratique un morceau de papier plus ou moins rouge. Leur défection est certaine ; aussi, est-il plus sage d’être peu nombreux, mais résolus, que d’être nombreux et écrasés parce qu’abandonnés au dernier moment par une majorité de moutons.
DÉFENSE LÉGITIME
Bien que le mot légitime veuille dire : « Ce qui a les qualités requises par la loi », dans le langage courant, il est employé comme synonyme de « juste » et de « équitable ». et il ne faut pas confondre, par conséquent, ce que l’on appelle « la légitime défense » avec la défense légitime. Le droit de légitime défense est consacré par l’article 328 du Code pénal qui dit :
« Il n’y a ni crime ni délit lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de légitime défense de soi-même ou d’autrui. »
Tout en reconnaissant à chaque individu le droit de se défendre lorsqu’il est attaqué, il ne peut être ignoré cependant, que ce droit de légitime défense qu’accorde la loi, est surtout une arme entre les mains des forces répressives. Il est tout naturel, et cela n’a pas besoin d’être consacré par un article du code, que l’individu qui se trouve en danger, use de tous les moyens a sa portée pour sauver sa vie, mais ce que nous savons, c’est que le droit de légitime défense est exploité avantageusement, par le policier qui a, de ce fait, droit de vie et de mort sur la personne qu’il est chargé d’arrêter, par le mari « trompé » qui n’hésite pas à se prétendre en droit de .légitime défense lorsqu’il abat le « complice » de sa femme, enfin par tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, attentent à 1a vie ou à la liberté de leurs semblables, il est remarquable que ce soit toujours la même catégorie d’individus qui légalement bénéficie du droit légal de légitime défense. Lorsque, arrêté au cours d’une manifestation, le manifestant est brutalement frappé par le policier, chargé, dit-on, de maintenir l’ordre, le policier est considéré comme étant en état de légitime défense ; il n’est donc pas excessif de prétendre que lorsque le manifestant se défend contre les violences policières, il est en état de défense légitime.
Naturellement, le droit de défense légitime n’est pas reconnu par la loi, au contraire. La magistrature sévit, sans aucune indulgence contre ceux qui ont le courage de résister à l’oppression de l’ordre établi, et c’est ce qui explique le nombre incalculable de malheureux qui gémissent dans les prisons et les bagnes capitalistes.
On peut considérer comme étant en état de défense légitime, tout ce qui s’oppose à l’arbitraire et à l’injustice. La société moderne n’est ni juste ni équitable, et tous les gestes, tous les actes qui ont pour but d’amoindrir les effets néfastes de l’injustice, engendrée par l’organisation sociale actuelle, sont des gestes et des actes de défense légitime. Le travailleur qui pour améliorer son sort, abandonne l’atelier et se met en grève afin d’obtenir une augmentation de salaire, ou une diminution d’heures de travail, est en état de défense légitime, contre son patron qui se refuse à répondre favorablement à ses revendications légitimes ; et lorsque le Gouvernement afin de soutenir le capitaliste contre le prolétaire, met son armée au service de la richesse, le travailleur n’est-il pas en état de défense légitime, lorsqu’il oppose la révolte et la violence à l’intervention gouvernementale ?
La défense légitime se manifeste selon les périodes et les événements de différentes façons ; elle est parfois collective, et parfois individuelle. Lorsqu’elle est individuelle, c’est que la collectivité reste passive devant l’attaque de ses oppresseurs, et il se produit alors qu’à la suite d’un crime social ou encore pour éviter une injustice, un homme se dresse hors du troupeau pour supprimer les responsables de mesures qu’il juge arbitraires et dangereuses pour ses semblables. Il ne nous appartient pas de démontrer l’efficacité ou l’inefficacité de ces gestes, mais ce que l’on peut affirmer c’est qu’ils .sont déterminés par l’attaque continue d’une partie la plus puissante de la collectivité humaine et qu’en conséquence, il doit être considéré comme un acte de défense légitime.
Nous disons plus haut que la défense légitime est tout ce qui s’oppose à l’arbitraire et à. l’injustice, et l’on peut donc classer, comme étant en état de défense légitime tous ceux qui se refusent à servir de matière à champ de bataille durant les guerres, celles-ci étant un véritable crime envers l’humanité. Il faut se défendre. La vie est une lutte constante et celui qui ne se défend pas est écrasé. Ce qui fait la faiblesse du peuple, c’est sa naïveté à croire qu’il est garanti durant toute sa vie par la législation qui, en vérité, loin de le défendre, l’opprime. Il lui faut donc s’il veut triompher lutter contre la loi, lutter contre ceux qui la font et ceux qui l’appliquent, lutter contre tous les rouages d’une société mal faite, en un mot, se défendre contre tout l’organisme capitaliste qui nous dirige et nous étreint.
Ce n’est ni la vengeance ni la haine qui nous guident, nous, anarchistes, dans notre conception de la défense légitime. « Ce qui est grand et beau se suffit à soi-même, et porte en soi sa lumière et sa flamme », a dit J.-M. Guyau ; c’est parce que nous savons que l’humanité ne sera régénérée que par la défense, que nous opposons aux forces coalisées du capital, que nous nous révoltons contre les crimes monstrueux d’un régime périmé et que nous trouvons une force suffisante pour résister à tous les assauts de nos adversaires. Nous sommes en état de défense légitime et nous y resterons jusqu’au jour où le capitalisme et ses rouages, fatigués de la lutte, nous permettront de prendre l’offensive pour élaborer sur leurs ruines une société de douceur et de fraternité.
DÉFENSE NATIONALE
n. f.
La Nation nous dit le Larousse, est une « réunion d’hommes ayant une origine et une langue communes, ou des intérêts longtemps communs ». Notre conception de la nation n’est pas la même (Voir Nation), il nous semble ridicule de prétendre que les intérêts des différents éléments qui composent la nation française sont identiques. Pour nous la nation ne se présente que sous la forme d’une minorité d’oligarques, issue de la famille capitaliste, tenant courbé sous le joug économique et politique la grande majorité de la population d’un territoire déterminé. S’il arrive que les intérêts de cette minorité soient en opposition avec ceux d’une minorité appartenant à un territoire étranger, on déclare alors que la nation est en danger. Il faut la défendre et l’on organise ce que l’on appelle la « défense nationale ». Nous avons tenté de démontrer par ailleurs (voir capitalisme) que la grande majorité des populations étaient exploitées sous toutes les formes par un capitalisme qui de jour en jour centralisait sa puissance, et que les intérêts de cette population étaient diamétralement opposés a ceux de ce capitalisme. Par quelle aberration ces peuples consentent-ils à donner leur vie, à se livrer à 1a défense nationale, alors qu’ils ne peuvent espérer en tirer que la misère et la mort ? Cela dépasse l’imagination d’un homme qui pense sagement et sainement. C’est cependant un fait indéniable que les hommes se précipitent dans la guerre meurtrière pour défendre une nation au sein de laquelle ils ne sont que des esclaves.
La défense nationale est habilement et adroitement organisée par les hommes qui ont la charge de diriger les nations au plus grand profit des intérêts capitalistes. Jamais on ne verra des chefs du Gouvernement avouer que la guerre entreprise est une guerre offensive ; elle . est toujours défensive, quelles que soient les causes qui l’ont déterminée et les ignorants se laissent prendre naïvement au stratagème puéril qu’emploient les représentants du capitalisme pour entraîner le peuple dans le carnage.
Lorsqu’une nation entre en guerre, voici de quelle façon on pose au peuple la question qui est résolue d’avance : « Notre pays vient d’être attaqué par des barbares ; nous vivions en paix dans la sérénité de notre labeur. Nous n’avions aucune ambition. Chacun était heureux. Allons-nous laisser envahir nos hameaux, nos villages, nos villes ? Allons-nous laisser détruire toutes les richesses accumulées par nos ancêtres ? Allons-nous laisser les tyrans nous arracher notre liberté ? Allez-vous laisser vos femmes et vos enfants être les innocentes victimes de nos ennemis qui veulent conquérir votre pays ? Et la population naïve, répond par le sacrifice. Elle ne veut pas qu’on lui dérobe les richesses accumulées, elle ne veut pas qu’on lui arrache sa liberté et elle va défendre la nation, et elle se prête, elle se livre, elle se donne a la défense nationale. Et il en est ainsi dans tous les pays où défendre son pays, défendre sa nation est un devoir.
Mais demandons au pauvre garçon de ferme de la Beauce ; au pauvre pâtre qui, pour quelques sous par jour, un bout de pain noir et du fromage mène une vie solitaire et perdue, dans ses montagnes ; demandons à l’ouvrier d’usine qui durant 8 ou 10 heures par jour et cela pendant des années et des années, jusqu’à la mort, trime et végète devant les hauts-fourneaux qui le brûlent ; demandons à toute cette agglomération de parias, à toute cette armée de plébéiens des champs et des villes, ce qu’ils ont, eux, des richesses accumulées par les ancêtres ; demandons-leur où elle est leur liberté, où elle est la nation qu’ils défendent, ce qu’elle leur a donné, le bénéfice, l’avantage qu’ils ont à se battre de tel ou tel côté de la barricade ; demandons-leur pourquoi ils défendent la nation, ce qu’elle représente à leurs yeux. car enfin, pour tout abandonner, pour tout quitter : femme, enfants, père, mère, amante, pour préférer la mort à la vie, pour se donner ainsi entièrement, sans protester, pour répondre par le mot : présent à l’appel de la patrie, pour consentir à se livrer corps et âme à la défense de la nation, il faut se faire une idée grandiose de la nation, il faut qu’elle soit une source de joie, de bonheur, d’allégresse et d’amour ; il faut qu’elle soit le temple de la bonté, de la justice, de l’égalité, de la fraternité ; il faut que seule, cette nation puisse nous donner tout ce à quoi nous rêvons, nous aspirons, et que nulle autre au monde ne puisse réaliser notre rêve et notre idéal. En est-il ainsi, et est-ce pour cela que la « défense nationale » arrive à recruter ses armées ? Hélas, non ; et le patriotisme ou 1e nationalisme du peuple ne repose jamais sur des réalités, mais sur des illusions. Qui n’a, pas lu l’œuvre magistrale d’Octave Mirbeau ? Dans ses Vingt et un jours d’un neurasthénique, le célèbre écrivain nous présente Joseph Tarabustin qui, à, la frontière espagnole va chaque soir faire son pèlerinage au dernier bec de gaz de France. Et en extase devant cet appareil d’éclairage, il cherche à faire partager à sa femme les sentiments de patriotisme qui se lèvent en lui, qui montent du plus profond de son être, et qui le remplissent de grandeur et de fierté. Voilà en vérité ce que c’est que la nation ; c’est le dernier bec de gaz de France, c’est le dernier bec de gaz d’Allemagne, c’est le dernier bec de gaz d’Italie. C’est moralement pour ce symbole que les peuples se déchirent entre eux ; c’est à cause de ces préjugés que l’on arrive à enrôler dans les rangs de la défense nationale des millions de travailleurs qui se massacrent entre eux pour défendre, non pas la nation, mais les intérêt-particuliers des capitalistes nationaux. Il y a parmi cette foule d’inconscients qui se laisse mener passivement à l’abattoir, convaincue qu’elle remplit un devoir sacré, une minorité qui se refuse ou tente tout au moins de se refuser au sacrifice qu’exige la « défense nationale ». Elle est impitoyablement écrasée par les forces d’autorité, de répression, de violences, mises au service des institutions de la bourgeoisie. La défense nationale engloutit tout ce qui peut être un facteur de victoire et tous les hommes en vertu de ce principe : « La nation est en danger » doivent se donner entièrement aux exigences de la défense nationale.
La grande guerre de 1914–1918 éclaire d’une lueur brutale, aveuglante même, le mensonge -sur lequel repose cette formule. Même en se plaçant sur le terrain du nationalisme le plus large, il est impossible de légitimer cet acte monstrueux qui oblige un homme ou une population à aller se faire tuer pour défendre sa nation. Au sens bourgeois du mot, la nation n’existe pas et en conséquence la défense nationale est un leurre.
Prenons les uns après les autres les pays qui ont été entraînés dans la catastrophe de 1914. Où est-elle l’unité nationale de la France ? Est-ce que les Algériens, les Sénégalais, envoyés sur le front pour y défendre la « mère patrie » avaient une raison plausible pour se battre et se trouver plutôt d’un côté de la barricade que de l’autre ? Où est-il le patriote ou le nationaliste assez subtil pour soutenir cette thèse : que les Sénégalais devaient concourir à la défense nationale parce que leurs intérêts sont intimement liés à ceux des grands industriels et des grands financiers français. En vertu de quels principes et au nom de quel devoir national l’Autriche-Hongrie obligea-t-elle ses minorités. nationales à prendre part au conflit ? Si l’on excepte la contrainte, quelles raisons poussèrent les Tchèques, les Croates, les Slovènes, à défendre cette nation dont ils refusaient la nationalité et dont ils se séparèrent aussitôt que l’Empire écrasé fut incapable de les maintenir sous sa domination ? Sur quoi reposait le nationalisme polonais, alors que les habitants de la Pologne étaient répartis entre l’Allemagne, la Russie et l’Autriche et ne se libérèrent, politiquement qu’à la fin de la guerre ? Et les Irlandais qui, depuis le XIIè siècle, mènent une lutte opiniâtre contre l’impérialisme britannique ; et les 300 millions d’Indiens qui sont asservis à la perfide Albion ; sous quelle forme se présentait à eux la « défense nationale », et n’est-ce pas simplement contraints et forcés que ces hommes prirent part à la lutte, animés par un sentiment de peur, mais non pas par un sentiment de nationalisme ?
La « défense nationale » est un bluff formidable, elle ne se soutient pas et ne résiste pas à l’analyse. Il n’y a, disons-nous plus haut, qu’une infime minorité qui a intérêt à défendre la nation, parce que pour elle, la nation représente la richesse, le bonheur, tous les privilèges, tous les droits, toutes les libertés ; cette minorité, c’est le capitalisme. Mais le capitalisme serait impuissant à se défendre lui-même et c’est pourquoi il a recours à toute la population du pays. Il a inventé la « nation en danger » et est arrivé à faire croire que chacun devait fournir son cerveau et son corps pour défendre la nation ; sur cette croyance des crimes monstrueux ont été accomplis. Peut-être est-il temps que cela cesse. L’horrible cauchemar que nous laisse la dernière guerre n’est-il pas suffisant pour nous rappeler que le peuple n’a rien à défendre sinon sa peau, et qu’il n’a rien à donner à la nation, qui, elle, lui prend tout ? Il n’a pas à s’occuper de « défense nationale » ; sa nation, elle est à bâtir, elle sera universelle ; mais auparavant, il faut détruire les barrières qui divisent les hommes ; il faut que les individus comprennent que la vie ne peut être belle qu’à l’abri de toutes tentatives belliqueuses, que les guerres, toutes les guerres sont engendrées par le capitalisme, et que la « défense nationale » est un préjugé atroce et terrible qui coûte chaque siècle à l’Humanité des millions d’êtres jeunes et vigoureux.
DÉFENSE RÉVOLUTIONNAIRE
S’il est une question qui a une importance pour ainsi dire primordiale, dans le problème de la révolution, s’il est une chose qui a fait couler beaucoup d’encre, échafauder de multiples systèmes, et dire le plus de bêtises, c’est bien cette question de la Défense Révolutionnaire. Certes, pour d’aucuns, elle peut sembler puérile et comme subséquente à la révolte, car beaucoup d’esprits simplistes pensent que l’on perd son temps à vouloir solutionner ou tenter de solutionner certains problèmes avant que l’heure des réalisations n’ait sonné. Ils disent :
« On aura bien le temps de penser à tout cela au moment où la Révolution éclatera. Occupons-nous pour l’instant de choses plus sérieuses. Quand nous serons en pleine révolution, des solutions surgiront qui s’imposeront d’elles-mêmes. N’y a-t-il pas une sorte de fatuité et d’illogisme à vouloir prévoir ce que pourrait être l’avenir ? Donnons notre temps au présent, cela seul importe. »
Eh bien ! nous pensons que, s’il faut laisser aux événements le soin de résoudre certains problèmes, nous pouvons, nous devons à la fois prévenir et même, prévenir certains maux qui pourraient advenir si nous nous laissions aller au gré de l’improvisation circonstancielle. Et nous pensons que « la défense révolutionnaire » est une chose trop grave pour que nous laissions au seul hasard le soin d’y pourvoir. Aussi, nous basant sur les leçons de l’histoire, en même temps que de la raison, voulons-nous étudier à fond ce problème, encore que nous regrettions d’être obligés de nous restreindre ; car ce n’est pas un article encyclopédique, mais un gros volume qu’il faudrait pour examiner minutieusement tous les côtés de la question. Pour la clarté de notre exposé, divisons en trois parties la défense révolutionnaire. C’est-à-dire :
-
Avant ;
-
pendant ;
-
après la révolution.
Avant la Révolution.
Partout existent des groupements qui ont pour but (soit par la propagande éducative, soit par l’agitation, soit par des actes appropriés aux circonstances), de fomenter dans la masse la colère, l’indignation, en un mot l’esprit de révolte qui doit se muer tôt ou tard en insurrection. Ces groupements révolutionnaires sont donc partie intégrante de la révolution, puisqu’ils, en assument pour ainsi dire la préparation.
Or, il est de fait que les classes dirigeantes ne sont plus, comme au siècle dernier, endormies par l’optimisme que pourrait leur conférer la détention du Pouvoir. Elles savent très bien, et les événements du passé suffiraient à le leur apprendre, que le sort des dirigeants est précaire ; que telle caste qui fut jadis toute puissante est aujourd’hui obligée de s’allier, pour ne pas la subir, à une classe qu’elle opprimait naguère. D’autre part, elles connaissent l’état lamentable du peuple et son mécontentement de jour en jour grandissant. Elles sont à même de constater que l’idée révolutionnaire fait journellement de grands progrès. Aussi, sont-elles prêtes à tout pour écraser au moindre mouvement les militants qui pourraient entraîner la masse à des actes décisifs. Elles savent qu’en écrasant les groupements révolutionnaires avant ou dès le début, d’un mouvement, elles écraseront en même temps la plus grande force dont la révolution pourrait disposer, puisque ce serait la force morale et populaire. Aussi emploient-elles des moyens divers pour décimer les groupements.
La provocation, le mouchardage (voir provocateur, mouchard), constituent des moyens préventifs.
Dans l’étude de ces deux mots, nous dirons comment on peut se prémunir.
Mais il y a les moyens de lutte contre-révolutionnaire. Ligues civiques, faisceaux, chefs de section, syndicats jaunes, etc., etc., composent toute une échelle d’organismes destinés à entraver la propagande ou à se débarrasser des militants révolutionnaires. Ce sont tous des groupements recrutés, organisés, armés, protégés et subventionnés — soudoyés serait plus juste — par les classes dirigeantes. Tout cela constitue un fascisme (voir fascisme ) prêt à réprimer d’abord, à s’imposer ensuite et à opprimer enfin.
Les capitalistes, pour conserver leurs prérogatives matérielles, seraient prêts, malgré qu’ils préfèrent le régime hypocritement libéral que nous subissons, à instaurer une dictature militaire ou civile, plutôt que de voir leur prépondérance s’atténuer.
On sait, par les exemples d’Italie et d’Espagne comment, avant la prise du pouvoir, le fascio et les Somaten agirent à l’égard des organisations ouvrières de ces deux pays : assassinats, expéditions armées, assommades, etc.
Pareil mouvement s’organise en France : chemises bleues, jeunesses catholiques ou patriotes s’arment dans l’ombre, au su des gouvernants qui les tolèrent, et, si nous n’y prenons pas garde, la même aventure pourrait nous advenir.
Que faut-il faire pour défendre le mouvement révolutionnaire ?
Les uns nous disent :
« Il faut organiser un parti de classe puissant et discipliné dont les cadres, sévèrement composés d’hommes intégres et éprouvés, imposeront leur décision et leurs mots d’ordre aux adhérents. Il faut que ces adhérents soient prêts à répondre immédiatement à tout appel et à obéir aveuglément aux ordres de ce Comité-Directeur. En un mot, il faut organiser une armée pré-révolutionnaire. »
D’autres avancent :
« Il faut que toutes les organisations d’extrême-gauche envoient des délègués à une réunion commune qui constituera le front unique révolutionnaire, qui lancera partout ses mots d’ordre et qui organisera la riposte, voire même l’offensive et fera ainsi, de par l’unité révolutionnaire, de cette riposte ou offensive, un mouvement de grande envergure qui s’amplifiera vite en révolution. »
En ce qui concerne le « parti de classe », il a été dit et il sera dit dans les mots : armée, communiste (parti),militarisme et militarisation tout ce qui doit être objecté à cette thèse. Quant au « Comité d’action et d’unité révolutionnaire », nous savons par expérience qu’il ne rendrait rien du tout, sinon qu’il retarderait, entraverait et peut-être empêcherait toute défense utile. Trop de divergences théoriques, idéologiques et tactiques se feraient jour, trop d’incompatibilités se révéleraient ; les délégués passeraient leur temps à disserter, à ergoter, à discutailler... pendant que l’ennemi agirait autrement qu’en paroles. Un tel comité deviendrait, comme tous ses devanciers, un « Comité d’Inaction ».
Nous pensons que la défense révolutionnaire immédiate doit être organisée plus sérieusement, plus méthodiquement que des deux manières sus-indiquées. Il faut en revenir, qu’on le veuille ou non, aux groupes secrets. Groupements constitués par affinité des composants. Par maison, par rue, par quartier, par localité, par atelier, chantier ou entreprise, les révolutionnaires se connaissant bien, soit qu’ils aient vécu, travaillé ou milité ensemble d’une- façon intime, formeraient de petits comités qui auraient pour but de défendre le mouvement. S’armer n’est pas la besogne la plus essentielle de la défense pré-révolutionnaire. Il faudrait se livrer à tout un travail pour ainsi dire technique : connaître la topographie des lieux dans lesquels ils vivent, des points de résistance possibles, connaître les armuriers locaux, et puis les adresses de tous ceux qui, à un titre quelconque, pourraient être dans l’action fasciste : flics, gendarmes, membres d’organisations réactionnaires, personnages influents, etc., etc. De façon qu’au premier acte fasciste on puisse ainsi riposter du tac au tac.
On peut être bien certain que les fascistes connaissent les adresses des principaux militants révolutionnaires et, qu’à la première occasion ils s’en serviront. Eh bien ! pour un des nôtres, un des leurs ; nous pourrons même pratiquer à leur détriment la politique des otages qu’ils prônent si. fort. Dans la lutte, il faut savoir employer toutes les armes disponibles. « Ou combattre par tous les moyens, ou périr » tel est le dilemne Ces organismes secrets pourraient s’unir à d’autres du même genre pour assurer une unité d’action dans la localité, la région, etc. Ils auraient le mérite d’être composés de copains sûrs, sérieux et décidés à tout pour éviter qu’une dictature quelconque s’instaure, et même pour essayer de faire prendre tournure révolutionnaire à tout mouvement de riposte .
Il y aurait là une organisation sérieuse qui ne serait composée ni de bavards impénitents, ni de politiciens avides de pouvoir politique. Bien entendu, ici, nous exposons cela en bref, car il nous faudrait occuper un nombre de pages trop considérable si nous voulions définir dans tous ses détails une telle préparation de défense révolutionnaire. La fédération de ces groupes (qui pourrait prendre divers aspects) assurerait toute la puissance d’une action efficace, le caractère secret et affinitaire, en laissant ignorer à tous autres leur existence, lui donnerait la force de la spontanéité et de l’imprévu.
Pendant la Révolution.
Ici, nous touchons en plein au problème de la dictature. En effet, c’est au nom de la seule défense de la révolution qu’on prétend, dans certaine école révolutionnaire, instaurer une dictature provisoire,
On nous dit :
« Si nous nous révoltons, les classes possédantes se défendront par tous les moyens. L’armée est à leur solde ; mais même si l’armée leur faisait défection, ils auraient un concours largement assuré de la part des gouvernants capitalistes voisins. Il nous faudra donc, dès le premier jour de la révolution, sitôt le gouvernement actuel dépossédé, accomplir notre coup d’état en nommant un gouvernement prolétarien qui aura à charge d’organiser une armée rouge disciplinée. Ce gouvernement aura des pouvoirs dictatoriaux et tous devront, sous peine des plus graves sanctions, y compris la peine de mort, obéir aveuglément aux commissaires du Peuple »
Nous voudrions bien, auparavant, qu’on nous dise ce qu’on entend par Révolution. Ce mot, s’il n’est accompagné d’un qualificatif n’a, pour nous, qu’une bien vague signification. Si cette révolution n’a pour but que de changer de place les gouvernants, si c’est uniquement l’accession au pouvoir d’un parti politique, quel qu’il soit, que vise cette révolution ; pour nous c’est une révolution politique, en un mot un coup d’état. Alors, mieux vaut dire tout de suite que nous n’en sommes pas ; que cette révolution n’est pas la nôtre.
La Révolution que nous voulons et pour laquelle nous militons aujourd’hui et nous combattrons demain de toutes nos forces, c’est la Révolution sociale. Qu’est-ce que cette révolution sociale ? — Celle qui aura aboli toute exploitation de l’homme par l’homme : patronat, militarisme, État. Celle qui substituera au gouvernement des hommes par les hommes, l’administration des choses par le producteur. Celle qui, à la place de la société autoritaire et centraliste instaurera la société fédéraliste libertaire.
C’est à la défense de cette révolution-là, et, de celle-là seulement, que nous voulons nous employer. Nous aurons donc à la défendre contre trois genres d’offensives :
-
celle des capitalistes et gouvernants actuels à l’intérieur ;
-
celle que ces gouvernants et possédants chassés pourraient tenter avec le concours de l’extérieur ;
-
celle de tous les politiciens arrivistes au faux-nez révolutionnaire qui tenteront à tout prix d’escamoter la révolution à leur profit.
La première offensive fait partie de la révolution ; c’est la révolution elle-même. Nous savons très bien que les capitalistes ne se laisseront pas déposséder sans résister, mais c’est l’action du peuple en révolte qui les chassera petit à petit. A l’offensive que pourraient tenter les capitalistes concentrés dans une région non touchée par la révolution, nous répondrons par une énergique défensive, et ceci touche à la deuxième manière puisque les provinces non révoltées ne feraient pas partie de la Fédération révolutionnaire, et qu’elles seraient, par conséquent, à l’extérieur de la révolution.
Supposons donc que, chassés du pouvoir, les possédants actuels se retirent dans quelque région réactionnaire ; que de là, ils demandent aide aux gouvernants étrangers, et que ceux-ci envoient des troupes pour mettre le peuple « à la raison ». Nous pourrions faire cette remarque, que rien ne prouve que nous serons les premiers en Europe à nous révolter, qu’il se pourrait qu’avant nous l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne aient accompli leur libération, qu’en ce cas nous n’aurions pas grand’chose à craindre. Nous pourrions aussi objecter qu’il se pourrait qu’une révolution déclenchée en France amenât les peuples voisins à imiter le geste. Mais nous voulons envisager la question comme si nous étions les premiers à nous insurger. Y a-t-il nécessité d’un gouvernement, de défense, d’une armée rouge obéissant à ce gouvernement et faisant partout respecter ses édits ? On nous dit :
« Oui, il faudra une armée docile, disciplinée, organisée, entraînée encadrée, avec des états-majors solides, choisis par le Gouvernement prolétarien. Il faudra une préparation de plus en plus forte ; que tous les ouvriers soient astreints à cette obligation militaire. En un mot, il faudra décréter la mobilisation générale. »
Pourquoi tant de mesures dictatoriales ? Pourquoi une « mobilisation générale » du prolétariat ?
— « Parce que, sans cela, beaucoup se refuseront à marcher contre les réactionnaires ; chacun voudra laisser cette besogne a son voisin. Il faudra donc obliger tous les ouvriers et paysans à marcher. »
Croit-on, par hasard, que c’est avec des soldats qui marchent, à contre-cœur que l’on assure une bonne défense ? Croit-on que « tout le monde » rechignera ? Si la révolution est faite par le peuple et pour le peuple ; si dès le début de ce mouvement, le prolétariat sent que c’est véritablement sa libération que la révolution lui apporte ; s’il est convaincu que ce n’est pas simplement un changement de maîtres qu’il subit, le peuple se dressera unanimement pour défendre sa liberté et sa vie.
Prenons les exemples de l’Histoire : En 1792 quand Brunswick eut adressé à la Convention son insolent ultimatum, y avait-il une armée permanente ?
Que fit la Convention ? Elle décréta « la Patrie en danger » et fit un appel pressant à tous les citoyens pour défendre la Liberté contre les armées des tyrans coalisés. L’appel resta t-il vain ? Que non pas ! De toutes parts, sur les places publiques, des estrades avaient été dressées où l’on inscrivait les volontaires. Il y eut un élan d’enthousiasme indescriptible. En quelques jours, une formidable armée fut sur pied, cette armée de « sans-culotte », ainsi dénommée justement parce qu’elle n’était pas une armée de métier. Les chefs de cette armée de volontaires étaient-ils gens du métier ? Ceux qui en furent : Dumouriez, Moreau, Pichegru, Bonaparte, Bernadotte, finirent tous par trahir la révolution. Mais les Marceau, les Hoche, les Kléber, les Kellermann, les Desaix et autres, étaient-ils des gens rompus à la théorie ? — Non : le plus gradé de tous était sergent d’écurie ! Cette phalange de volontaires pourtant tint tête à toutes les armées étrangères ; mieux : elle les repoussa.
Pourquoi cette armée ne sauva-t-elle pas la révolution d’une façon définitive ? Pour plusieurs raisons.
La première, c’est que la mystique des individus existait encore. Il n’y avait pas bien longtemps que ces « sans-culotte » croyaient en la légende du « bon père, notre Roi ». Ensuite ce furent, leurs députés au corps législatif en qui ils placèrent. leur confiance, puis, enrôlés volontaires, ce fut en leurs généraux. C’est pourquoi nous voulons, dès aujourd’hui, dire hautement que le prolétariat ne se sauvera, que lorsqu’il ne comptera que sur lui-même pour ce faire ; qu’il ne doit pas attendre d’hommes ou de partis son salut, que c’est lui, et lui seul, qui le tient entre ses mains.
La seconde raison, c’est qu’il y avait à la tête de la révolution des hommes politiques ne se préoccupant que de faire prévaloir leurs théories politiques : lutte entre Girondins et Montagnards, d’abord ; lutte entre Montagnards ensuite ; lutte entre Robespierre et Barras après ; et que ces « politiciens » passaient leur temps à s’excommunier, à se lancer des injures, à s’envoyer à la guillotine au lieu de donner tout leur temps à l’unique défense de la République. Pendant qu’ils se livraient à ce travail « d’épuration », les armées de volontaires repoussaient les armées réactionnaires, mieux même : pénétraient à leur tour dans les pays voisins où elles instauraient ce qu’elles croyaient être la Liberté, mais qui n’était que le proconsulat de leurs généraux. Ceux-ci n’eurent pas de peine à devenir bientôt plus populaires que les pourvoyeurs de guillotine. Et quand Bonaparte tenta son coup d’État, il fut approuvé par tout un peuple 1as de l’incapacité de ceux qu’il avait mis à. sa tête. C’est pourquoi nous disons au peuple que lorsqu’il aura chassé ses maîtres actuels, il lui faudra empêcher que d’autres se mettent à leur place qui ne feraient, comme ceux-ci, que de la besogne de parti et non de classe.
La troisième raison que je veux indiquer, c’est que l’armée, en étant organisée par Carnot, prit figure d’armée permanente avec tous ses cadres, ses états-majors. Et que ces états-majors, ces généraux, avec leurs pouvoirs sur 1a troupe, entraînèrent celle-ci dans l’aventure napoléonienne qui leur assurait le maintien de leurs grades. C’est pourquoi nous sommes contre tout système militariste qui corrompt les chefs et avachit les subordonnés.
Si cette armée de volontaires avait été organisée sur le plan d’une armée provisoire ; si les sans-culotte étaient, restés, même à l’armée, des hommes ayant tous leurs droits ; si cette armée n’avait été considérée que comme un outil de défense, et si les soldats eux-mêmes avaient été chargés d’élire leurs chefs avec pouvoir de les révoquer ; si ces chefs n’avaient pas été autre chose que des délégués techniques, l’armée des sans-culotte serait restée libertaire, et elle se serait opposée aux factieux, elle se serait licenciée une fois l’ennemi repoussé du territoire, et les soldats seraient redevenus des producteurs ; ils auraient ainsi évité de gagner l’esprit militaire qui les portait à admirer leurs généraux d’abord et leur empereur plus tard.
Autre exemple : En 1871, le peuple de Paris tint deux mois devant les armées de Versailles. Et pourtant, il ne formait pas une armée de métier, il venait, de subir un siège long et déprimant. Pourquoi la Commune sombra-t-elle dans la dernière semaine de mai ?
Parce qu’il y avait un Gouvernement. Les fédérés nommaient eux-mêmes leurs chefs et leurs délégués au Comité Central de la Garde Nationale. Mais, d’autre part, les révolutionnaires qui composaient le Comité Central de la Commune contrecarraient toujours leurs desseins. S’agissait-il de faire une sortie ? La, Commune s’y opposait. Voulait-on détruire la Banque de France ? La Commune mettait son veto. Pendant deux mois ce fut une rivalité navrante entre les deux pouvoirs : civil et militaire. Le pouvoir civil, qui était gouvernement, destituait des généraux, en accusait d’autres de trahison et changeait tous les quinze jours son délégué à la guerre. Et c’est grâce à cette rivalité, qui amena une absence totale de décision dans la lutte, que les Versaillais purent rentrer dans Paris. C’est pourquoi encore nous disons au Peuple qu’il ne doit pas tolérer qu’un Gouvernement s’installe dans la révolution.
Nous aurons, enfin, à défendre la Révolution contre tous les politiciens au faux-nez révolutionnaire qui tenteront, par tous les moyens, d’escamoter la révolution à leur profit ou au profit de leur parti. Dès que la révolution éclatera, il nous faudra lui donner une impulsion libertaire. L’expropriation devra être immédiate. I1 nous faudra détruire par le feu toutes les archives, actes notariés, cadastres, titres, valeurs, billets de banque. Tout cela qui constitue la force de l’État et de la propriété devra être anéanti immédiatement. Chaque prolétaire devra être armé. Les combattants seront uniquement des volontaires qui nommeront, eux-mêmes leurs chefs, étant bien entendu que chacun rentrera chez soi dès que le danger aura disparu. Les formations de combattants nommeront leurs délégués au comité de défense révolutionnaire qui n’aura d’autre attribution que cette défense.
Les comités de production et de consommation, sous quelque forme qu’ils soient organisés, sous quelque nom qu’ils soient désignés, auront seuls pouvoir de gérer la production et la consommation. Toute tentative d’instaurer un pouvoir politique ou central quelconque devra être combattue avec acharnement et par tous les moyens comme étant un acte contre-révolutionnaire. Car la révolution ne sera triomphante que du jour où tout danger d’autorité quelconque aura disparu.
Ces formations de combattants volontaires, administrées techniquement, par des chefs nommés uniquement par les combattants et révocables au gré de leurs mandants, auront à charge de défendre la Révolution contre les ennemis du dedans et du dehors. Nous avons confiance dans l’énergie du peuple, une fois que celui-ci se sera révolté et débarrassé de ses maîtres. Nous sommes persuadés que, à la première alerte, au premier appel qui lui sera lancé pour défendre ses conquêtes, il répondra par une levée en masse et que les volontaires seront nombreux, plus que suffisants pour repousser toute attaque des réacteurs de tout poil et de toute étiquette.
Après la Révolution
Et maintenant, faisons une deuxième supposition. Après un nombre de jours, de mois, ou même d’années, de bouleversements, de combats et de tâtonnements, la révolution sociale est enfin triomphante. Ayant repoussé toutes les attaques des réactionnaires du dedans et de l’étranger, déjoué toutes les tentatives d’instauration de pouvoir politique, même dictatorial, même sous l’étiquette prolétarienne, le peuple a enfin instauré une société à base fédéraliste libertaire. La vie s’organise petit à petit, les perfectionnements améliorent de plus en plus les conditions d’existence. Mais les capitalistes vaincus n’ont pas abandonné la partie. Dans l’ombre, avec la complicité des gouvernants voisins (il faut bien admettre qu’il y en aura encore pour pouvoir pousser à fond la démonstration) les capitalistes méditent une agression qui doit leur permettre de reconquérir leurs prérogatives. Au bout d’un certain laps de temps des armées étrangères envahissent une région conquise à la révolution. Alors c’est l’appel au peuple, la levée en masse, la réformation des corps de combattants volontaires. Les batailles sont dures, les volontaires qui ont déjà goûté au mieux-être se battent avec acharnement pour conserver ce mieux-être, pour ne pas retomber en esclavage, et aussi parce qu’ils savent quelle féroce réaction, quelle terreur blanche s’étendrait sur le pays au cas où ils seraient vaincus.
Le même processus d’organisation de défense que pendant la révolution se reproduirait. Y aurait-il besoin de dictature ? Non pas, puisque la première fois on s’en serait passé. Eh bien ! poussons plus loin encore l’hypothèse. Malgré la fougue, la vaillance, l’ardeur du désespoir ; après des combats obstinés, les révolutionnaires sont vaincus par les armes. Les capitalistes rentrent en maîtres dans la France. La révolution a-t-elle dit son dernier mot ? Le prolétariat est-il définitivement écrasé ? Non. Immédiatement les comités de production lancent un ordre de grève générale. Les capitalistes occupent les usines, les mines, les têtes de lignes de chemins de fer, les postes et le télégraphe. Seulement, dès la première bataille, les comités de production, qui avaient prévu la possibilité d’une défaite, avaient donné le conseil à, tous les ouvriers de rester tranquillement chez eux quand les vainqueurs entreraient, de ne plus se rendre au travail et de se tenir prêts à résister à toute invite ou réquisition des capitalistes.
Que pourront donc faire ces derniers devant cette inertie générale ? Prendre eux-mêmes les outils de travail ? Faire venir de la main-d’œuvre étrangère ? Ils seront d’abord obligés, pour conserver le fruit de leur victoire, d’avoir une armée, une police, une gendarmerie considérable. Ils s’occuperont ensuite de se disputer pour le rétablissement des propriétés, tout acte de propriété, toute archive, toute valeur ayant disparu dans les flammes révolutionnaires. La main-d’œuvre étrangère ne sera pas suffisante pour subvenir aux besoins de la production, des services publics, etc. Enverront-ils chercher par la police ou l’armée les ouvriers à. leur domicile ? Chaque ouvrier étant résolu à résister par les armes, au bout d’un certain temps ils devront y renoncer.
Que leur restera-t-il alors à faire ? Tout simplement à repartir d’où ils étaient venus, parce que devant la force d’inertie consciente du prolétariat, ils ne pourront pas profiter de leur victoire. La grève générale, avec résistance armée, aura vaincu les velléitaires d’autorité. Car la grève générale, appliquée consciemment, méthodiquement, est encore le moyen de combat le plus efficace du prolétariat si elle n’est pas lancée pour des fins politiques. Comme on le voit, par cette rapide ébauche, à quelque période qu’on se place de la révolution, on n’a que faire des politiciens, de leurs partis et de leur dictature. Le prolétariat se défendra, se sauvera tout seul et ira vers sa libération totale sans le secours de ceux qui ont pour métier d’être des profiteurs de révolution.
C’est pourquoi il faut affirmer que, seul, est véritablement révolutionnaire celui qui lutte pour l’instauration d’une société fédéraliste-libertaire. Ce n’est pas à coups de décrets qu’on se défend, c’est les armes à la main ! Ce n’est pas avec un Gouvernement qu’on accomplit une révolution ; c’est en les supprimant tous !
Louis Loréal
DÉFI
n. m.
Le mot défi, signifie « provoquer quelqu’un ». « Porter un défi » ; « lancer un défi » ; « mettre au défi ». Dans le domaine sportif on se lance de nombreux défis. Lorsqu’un professionnel ou un amateur d’un sport quelconque veut se mesurer avec le détenteur d’un titre dans l’espoir de le lui ravir, il lui lance un défi et le match s’organise. Il y a des défis ridicules et d’autres qui sont intéressés. Les défis que se lancent périodiquement les champions professionnels de la boxe par exemple ne sont inspirés que par l’appât du gain et les résultats ou les conséquences de ces défis ne démontrent que la brutalité et la sauvagerie des adversaires et la bestialité du public.
« Mettre quelqu’un au défi de prouver ce qu’il avance », c’est-à-dire que l’on suspecte la possibilité dans laquelle il se trouve de démontrer le bien-fondé de ses affirmations. « Je vous mets au défi de trouver quelque utilité dans l’action gouvernementale ». Il ne faut jamais mettre quelqu’un au défi si l’on n’est pas certain de ce que l’on croit être la vérité sans quoi on se met soi-même dans l’embarras.
DÉFIANCE
n. f.
Si la crédulité est un mal, la défiance en est un autre. Il n’est pas bon d’être trop confiant et de se livrer aveuglément à qui que ce soit, mais ce n’est pas non plus une solution de douter de tous ceux qui nous approchent. « L’esprit de défiance nous fait croire que tout le monde est capable de nous tromper », a dit La Bruyère, et la défiance est d’autant plus mauvaise conseillère qu’à force de douter des autres l’homme défiant arrive à douter de lui-même et est de ce fait victime d’un continuel malaise. L’être défiant se figure que tout le monde veut le tromper et soupçonne quiconque vient à lui d’être guidé par un calcul ou par un intérêt quelconque ; il est toujours dans l’inquiétude et ne peut trouver d’amis craignant éternellement d’avoir en face de lui un individu masqué qui cache ses véritables intentions.
Il est un proverbe qui dit que la « défiance est mère de sûreté » et un autre que « dans la société actuelle, il faut être défiant si l’on ne veut pas être trompé ». Il est de toute évidence que la société regorge d’individus desquels il faut se. méfier et s’écarter ; mais ce serait exagérer de penser que le monde n’est qu’un composé de filous et de coquins et que tous les individus sont corrompus. Il ne faut pas se donner et se livrer sans examen et sans réflexion, mais il faut aussi reconnaître qu’il existe des hommes sincères et désintéressés auxquels on peut se confier et qui n’abusent jamais de la confiance qu’on leur a accordée.
Ne soyons donc pas trop méfiants et ne nous laissons pas absorber par la méfiance ; tâchons de trouver en nous assez de force et de courage pour ne pas avoir recours à d’autres afin de réaliser notre bonheur et nous serons alors garantis contre les manœuvres intéressées de tous ceux qui cherchent à nous exploiter physiquement, moralement et intellectuellement.
DÉFINITION
n. f.
Les logiciens distinguent la définition de nom et la définition de chose. La définition de chose est-elle possible à l’individualiste ou, dès qu’on lui en propose une, se méfie-t-il, averti qu’il se trouve en présence d’un dogmatisme conscient ou inconscient ?
L’individualiste a le sentiment de la réalité de l’individu, de l’irréalité de tout ce qui n’est pas individuel et singulier. Or, d’après tous les logiciens, l’individu reste indéfinissable ; sa richesse complexe ne saurait être enfermée en aucune formule ; et on ne peut définir que les termes généraux. Pour qui croit à la réalité du seul individu, définir c’est peut-être, au lieu d’essayer de dire ce qui est, consentir à dire ce qui n’est pas.
Puisque l’individu, seul réel, n’est définissable aux yeux de personne, qu’est-ce, donc qu’on définit ? Qu’exprime le terme général ? Lorsque je dis « homme », ou « individualiste » ou « anarchiste », qu’est-ce que je dis ?
Je résume une certaine série d’expériences. Je résume les rencontres « de personnes ou de tendances » qui m’ont fait penser « anarchiste » ou « individualiste » ; les rencontres d’êtres qui m’ont fait penser « homme »... Mais plus le terme est général et moins ma série d’expériences coïncidera avec celle d’aucun autre : personne n’a rencontré exactement et exclusivement les mêmes hommes que moi, dans les mêmes circonstances, dans le même ordre, dans les mêmes. états d’esprit. Quand j’écris « homme », j’exprime une de mes séries d’expériences et chaque lecteur lit autre chose : une série d’expériences qui lui est propre.
Mon idée de l’homme, qui ne peut correspondre complètement avec celle d’aucun de mes lecteurs, n’est pas la même aujourd’hui qu’hier, sera différente demain. Ma série d’expériences va nécessairement s’enrichissant et se modifiant.
Je ne puis donc définir le mot « homme » même pour moi seul. La définition — exigent les logiciens — doit être adéquate, c’est-à-dire s’appliquer exactement au défini et uniquement au défini. Je ne puis trouver une définition adéquate à ma série d’expériences, une définition qui dise exactement et uniquement tout ce que je pense et rien que ce que je pense quand je prononce un terme général. Ayant pris le sentiment de cette impossibilité, je trouverais fou de chercher une définition adéquate non seulement pour moi mais pour tous. Quiconque le tente est, à mes yeux, ou fou, ou un homme qui n’a pas étudié cette impossibilité, ou un charlatan et un menteur.
En termes moins modernes et moins précis, Antisthène faisait déjà cette critique. Il adressait encore à la définition d’autres reproches. Je les lui fais résumer ainsi au commencement des Véritables Entretiens de Socrate :
« Toute définition est une menteuse. Dès qu’au lieu de désigner la chose par son nom, tu t’appliques à la définir, voici que tu la désignes par d’autres noms que le sien, voici que tu remplaces le signe exact par des signes inexacts, voici que tu rapproches et confonds des choses que la réalité sépare et distingue... La définition multiplie les difficultés qu’elle prétend résoudre. Pour définir un mot, il te faut plusieurs mots. Nous étions en désaccord sur deux au moins. Il te faut encore deux mots au moins pour définir chacun des termes de ta première définition. Te voici, dira quelqu’un, de l’occupation pour toute ta vie. Antisthène ne dit pas comme ce quelqu’un. Antisthène sait-que tu ne pourras pousser très loin ta ridicule tentative. Car les mots d’une langue ne sont pas en nombre infini : Bientôt tu définiras par des mots déjà employés, tu définiras par ce qui est à définir, tu éclaireras par ce que tu viens de confesser avoir besoin d’éclaircissement. Ainsi tu tourneras dans un cercle... Ou bien tu t’arrêteras au bord d’un abîme. Tu seras arrivé à quelque mot trop général pour que tu le puisses faire entrer en un genre plus vaste. Tu t’arrêteras alors par nécessité et tu auras marché longtemps pour rien. A mieux dire, tu te seras fatigué pour le contraire de ce que tu voulais. Car, plus le mot est général, plus il est vide et obscur, moins il répond à des choses que tu aies éprouvées. Par exemple, tu as voulu définir l’homme. Après un long chemin de plus en plus ténébreux, tu arrives à la notion d’être. Or, tu sais moins ce que c’est que l’être que ce que c’est que l’homme. »
Antisthène faisait encore à Platon une objection qui doit se traduire en langage moderne :
« Je connais des hommes, je ne connais ni ne puis connaître l’homme. »
Et, en effet, l’homme en soi, l’homme en dehors des hommes, l’homme définissable est une chimère.
C’est pourtant sur de telles chimères que s’appuient tous les dogmatismes. C’est sur des définitions que s’appuient toutes les démonstrations. Quiconque sait de quelle brume est faite la fondation rit de toute l’architecture. Mais beaucoup de ces folies sont intéressées et les conclusions, au domaine éthique ou social, ne sont-elles jamais présentées comme créatrices de devoirs et d’obligations ?
Quand l’erreur est sincère, voici d’où elle vient. La première science qui se soit constituée, la science mathématique, appuie ces démonstrations sur des définitions. Et les démonstrations mathématiques — mais elles seules — sont exactes parce que les définitions mathématiques — mais elles seules — sont adéquates.
Quelle est la cause d’un tel privilège ? C’est que la définition mathématique est créatrice. Quand j’essaie de définir l’homme, l’individualiste, l’anarchiste ou quoi que ce soit de concret, je tente — chose impossible — d’enfermer en une formule d’innombrables séries d’expériences. En mathématiques, je reste indifférent aux expériences. Je définis la ligne par l’absence de largeur et d’épaisseur ; je définis la surface par .l’absence d’épaisseur. Or je n’ignore pas que, dans l’expérience, supprimer complètement une des trois dimensions, c’est supprimer aussi les deux autres et anéantir l’objet. Lorsque je définis la circonférence une courbe fermée dont tous les points sont à égale distance d’un point intérieur nommé centre, comme j’ai défini auparavant le point par l’absence d’étendue et que je ne connais rien qui soit exempt d’étendue, je sais (et pour quelques autres raisons) que ma définition crée un concept au lieu de calquer une réalité. Je ne me préoccupe pas de chercher dans la nature ou de réaliser par art une circonférence parfaite. Je sais que c’est impossible. Et je sais aussi qu’une circonférence imparfaite n’est pas une circonférence.
En mathématiques, la définition n’essaie jamais de dire ce qui est. Elle a la hardiesse consciente de créer son objet. Pas de cercle avant la définition du cercle, pas de surface avant la définition de la surface. La définition crée un concept qui contient exactement ce qu’elle y met. Ainsi les définitions mathématiques sont adéquates et permettent des démonstrations probantes. C’est parce qu’il y a dans le cercle uniquement ce que la définition y met que je puis, dans la définition du cercle, découvrir toutes les propriétés du cercle et de la définition du cercle tirer tous les théorèmes concernant le cercle.
Quand on démontre en s’appuyant sur une ou plusieurs définitions, la démonstration, si elle est correcte, vaut pour les concepts qu’on a définis, non pour les réalités qu’on a prétendu définir.
C’est pourquoi l’anti-dogmatique ne définit pas au commencement d’un exposé et se méfie de tout exposé non mathématique qui débute par des définitions. S’il définit, l’anti-dogmatique avertit que sa définition, est simple imposition de nom ou résumé provisoire de son expérience. De vraies définitions de choses ne pourraient venir qu’à la fin d’une science, si jamais une science pouvait être achevée. Elles seraient le fruit de toute une branche de la connaissance ; elles ne peuvent être un moyen de connaître et de prouver.
Han Ryner
DÉFORMATION
n. f.
Action de déformer, de changer la forme normale. Déformation du corps ; déformation de l’esprit. La déformation physique est déterminée par la maladie ou par la vieillesse. Avec l’âge et la fatigue ou encore par la souffrance, les organes dépérissent ou deviennent difformes, les traits s’altèrent et le corps subit une déformation. Si la déformation corporelle a des causes naturelles, il est cependant des cas où elle est la résultante des mauvaises conditions dans lesquelles s’effectuent certains travaux. On a donné à ces déformations le nom de déformations professionnelles et il est malheureusement quantité de travailleurs qui sont victimes de la dégénérescence de certains organes, sous l’influence des matières nocives qu’ils sont obligés de manier journellement, ou encore par la position dans laquelle ils sont contraints de travailler.
Il n’y a pas que la déformation du corps sur laquelle il faut porter son attention ; il y a aussi la déformation du cœur et de l’esprit qui, si elle est moins visible, moins apparente, n’en est pas moins réelle. Par la déformation spirituelle et morale des hommes, on est arrivé à leur faire croire que le mensonge est la vérité, que l’obscurité est la lumière et que l’esclavage est la liberté. Le capitalisme commence d’abord à déformer le cerveau des enfants afin d’être plus puissant pour en déformer le corps une fois qu’ils seront devenus hommes. N’est-ce pas une véritable déformation à laquelle se livre dans les écoles modernes l’instituteur qui inculque à des petits êtres incapables de discernement, l’amour de la patrie, de la religion et de la propriété ? Comment s’étonner des difficultés que rencontre la transformation des sociétés, si l’on considère que, dès sa naissance, l’individu est pris dans l’engrenage d’une organisation sociale dont tous les rouages sont entre les mains d’une classe privilégiée ayant intérêt à masquer la vérité afin de conserver ses privilèges ? Quand, à quatorze ou quinze ans, l’enfant sort de l’école pour entrer à l’atelier ou au bureau, l’instruction et l’éducation qu’il a reçues ont altéré son état naturel, et il est aussi déformé moralement et intellectuellement qu’il l’eût été physiquement entre les mains de tortionnaires. On en a fait un futur « bon citoyen », c’est-à-dire un être prêt à se courber devant une discipline arbitraire et despotique, capable d’accepter l’autorité des maîtres et des chefs, et pour compléter sa déformation, à l’âge de vingt ans, il part pour l’armée qui est le complément de l’école. Il est impossible d’expliquer autrement ce non-sens qui préside aux destinées des peuples. Sans déformation cérébrale, on ne peut concevoir que l’individu ne soit pas frappé de l’illogisme de tout ce qui l’entoure, du rôle effacé qu’il joue dans l’économie politique et sociale de la nation à laquelle il appartient par force, et du peu de liberté et de bien-être dont il jouit. Arriver à faire croire à un homme qui est dépourvu, non pas seulement du nécessaire, mais de l’indispensable, que c’est lui le maître, alors qu’il n’est que l’esclave ; arriver a capter sa force, sa confiance, sa liberté, et le convaincre qu’il est heureux ; arriver à lui faire abandonner tous les biens terrestres en lui affirmant que le royaume des cieux sera pour lui, n’est-ce pas, en vérité, un superbe travail de déformation devant lequel il faudrait s’incliner s’il n’était pas la cause de tragédies sanglantes ? C’est donc à cette déformation qu’a recours le capitalisme pour perpétuer son règne, et i1 faut reconnaître que ses méthodes ont été efficaces et que, dans une certaine mesure, elles le sont encore, puisque les peuples ne sont pas arrivés à se libérer de l’étreinte qui les oppresse. Pourtant, petit à petit, l’intelligence des opprimés s’éveille, elle devient collective, elle s’organise pour lutter contre la déformation qu’on veut lui faire subir, et elle arrive à triompher souvent des erreurs qu’on cherche à, lui imposer. Et l’Humanité va de l’avant. Chaque génération hérite du savoir de celle qui l’a précédé ; elle se débarrasse des préjugés qui ont entravé la marche de la civilisation, elle se libère des tares, des vices, qui marquèrent les époques du passé ; elle s’éduque au grand livre de l’Histoire ; elle cherche à acquérir des connaissances multiples, et l’empreinte de la déformation s’estompe, et le cerveau retrouve son équilibre : une révolution se produit, ayant des résultats relatifs à l’évolution collective, et la lutte reprend et l’humanité poursuit sa route, toujours sans s’arrêter.
« Nulle main ne nous dirige, nul œil ne voit pour nous ; le gouvernail est brisé depuis longtemps ou plutôt il n’y en a jamais eu, il est a faire : c’est une grande tâche, et c’est notre tâche. » (Guyau. Esquisse d’une morale sans obligations ni sanctions, p.252.)
Le gouvernail pour nous, anarchistes, c’est la liberté. Il ne peut y avoir de bonheur que dans la liberté, a dit Reclus. Mais il ne peut y avoir de liberté sans conscience et c’est le devoir des anarchistes de s’élever toujours plus haut, d’effacer en eux toutes les traces des déformations sociales, et de donner à ceux qui les entourent l’exemple de la liberté, de la tolérance et de la fraternité.
DÉGÉNÉRESCENCE
n. f.
Rétrograder, perdre de sa valeur, de sa force physique ou morale, se modifier en mal... S’applique aux individus et aux sociétés. Une race en dégénérescence, c’est-à-dire une race qui est prête à disparaître. Il y a en effet des corps organisés qui disparaissent sous l’influence du climat, de la nourriture, des maladies héréditaires, etc... La race indienne est en pleine dégénérescence ; il ne reste plus de nos jours que quelques tribus de race rouge au Nord des Etats-Unis d’Amérique, mais avant peu elles auront disparu. Si les optimistes ont tort de se déclarer satisfaits en affirmant que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, les pessimistes n’ont peut-être pas raison de voir tout en noir, et d’affirmer que nous sommes en pleine période de dégénérescence. En vérité, une portion de l’humanité, peut « dégénérer » et même disparaître, l’humanité toute entière ne le peut pas. Une nation à la suite d’un cataclysme, d’une catastrophe, tombe en dégénérescence, mais l’ensemble des habitants de la terre continue sa vie, sélectionnant les éléments favorables à son existence et rejetant ce qui semble nuire à son évolution. Les Sociétés comme les individus, naissent, vivent et meurent ; tout corps organisé arrive à se désagréger, à se désorganiser, à dégénérer, si on le considère dans le temps et dans l’espace ; mais la vie, elle, est éternelle dans le temps et dans l’espace, et « même en se donnant, la vie se retrouve, même en mourant elle a conscience de sa plénitude, qui reparaîtra ailleurs, indestructible, sous d’autres formes, puisque dans le inonde rien ne se perd » (Guyau).
Il serait donc erroné de penser que le monde est en complète dégénérescence. S’il est vrai que les sociétés occidentales, que la vieille Europe, se débattent dans un chaos indescriptible, déterminé par les erreurs accumulées du passé, il est vrai également que tous les progrès réalisés durant ces derniers siècles nous permettent d’espérer pour le futur une période de régénération. Que les principes qui dirigent les formes de sociétés modernes soient périmées, que ces sociétés se meurent de vieillesse, et qu’elles disparaîtront demain ; cela ne fait aucun doute ; c’est la loi intangible de l’évolution historique, scientifique et sociale. Mais des forces neuves se signalent, à l’horizon troublé, les nuages se dissipent fatalement devant la puissance créatrice de la jeunesse qui bâtira un monde nouveau sur les ruines fumantes des anciennes organisations. Le monde ancien dégénère et le monde nouveau apparaît. Nous traverserons encore bien des phases progressives avant, d’arriver au but que poursuit l’humanité — si toutefois l’humanité a un but — ne nous laissons pas accaparer par un pessimisme aveugle, ni par un optimisme absolu ; nous portons en nous le germe des sociétés futures ; avançons toujours sans espérer l’intervention de forces surnaturelles pour régénérer le monde, et agissons pour que la dégénérescence d’une portion ou d’une fraction de l’humanité, profite à l’autre fraction qui a le devoir de réaliser demain la fraternité entre les humains.
DÉGRÈVEMENT
n. m.
Action de dégrever ; de décharger du poids de l’impôt un individu ou une portion de la population. La guerre de 1914–1918 a lourdement grevé le peuple qui fut obligé d’en faire tous Ies frais, et il ne semble pas qu’il puisse espérer un dégrèvement de ses charges dans le proche futur, s’il s’en tient aux méthodes d’action employées présentement. Il est de toute évidence que les classes productrices supportent la totalité des charges fiscales de la nation et que les classes privilégiées, par le jeu du commerce, se déchargent de leurs impôts directs en augmentant progressivement le prix de vente des produits de première nécessité et de consommation courante ; en conséquence les dégrèvements d’impôts que les gouvernements accordent aux classes pauvres ne sont qu’apparents, en réalité, ils n’existent pas.
Certains éléments politiques d’extrême-gauche et en particulier les socialistes espèrent obtenir par le jeu du parlementarisme un dégrèvement des charges qui pèsent sur les épaules des travailleurs. C’est une illusion dangereuse dont se laisse malheureusement bercer le prolétariat. Il y aurait, certes, un moyen de dégrever le peuple ; mais ce moyen n’appartient pas à la politique. Il faudrait pour cela supprimer toutes les dépenses inutiles qui sont nombreuses, et qui comme nous le disons plus haut viennent toujours, en fin de compte, arracher au budget familial du petit la somme indispensable à sa vie normale.
D’après les documents officiels présentés par le sénateur Bérenger au cours des pourparlers qui eurent comme conclusion les accords de Washington du 29 avril 1926, nous pensons qu’il est possible de dégrever le peuple de bien des charges, mais les mesures à employer ne sont pas d’ordre gouvernemental ou parlementaire, mais d’ordre révolutionnaire. Il est facile de se rendre compte de la situation qui est faite aux classes laborieuses en étudiant simplement les charges inutiles qui pèsent sur la population. Prenons en exemple le budget français de 1925 et soulignons les dépenses militaires du gouvernement.
MINISTERE DE LA GUERRE
-
Dépenses ordinaires :
-
— Troupes métropolitaines : 2.352.000.000 francs
-
— Troupes coloniales : 264.000.000 francs
-
— Construction nouvelles et matériel : 183.000.000 francs
-
— Maroc : 340.000.000 francs
-
— Alsace-Lorraine : 1.000.000 francs
-
Dépenses extraordinaires :
-
— Dépenses provisoires de la Grande Guerre. : 105.000.000 francs
-
— Troupes du bassin de la Sarre : 21.000.000 francs
-
— Troupes d’Asie Mineure :173.000.000 francs
-
— Alsace-Lorraine : 1.000.000 francs
-
— Dépenses provisoires pour les dépenses de guerre : 27.000.000 francs
MINISTERE DE LA MARINE
-
Dépenses ordinaires : 1.264.000.000 francs
-
Dépenses extraordinaires : 6.000.000 francs
MINISTERE DES COLONIES
-
Dépenses militaires : 208.000.000 francs
-
Dépenses extraordinaires : 3.000.000 francs
Total -------------------- 4.930.000.000 francs
-
Compte spécial pour les troupes d’occupation : 591.000.000 francs
Total ---------------------- 5.521.000.000 francs
Nous voyons par le tableau ci-dessus que le peuple français pourrait déjà être dégrevé d’une somme importante de ses charges puisque rien que pour l’année 1925 le militarisme a englouti la somme fabuleuse de cinq milliards cinq cent vingt millions. Et il en est de même dans tous les pays civilisés. En six ans, c’est-à-dire de 1920 à 1926 les divers gouvernements français qui se sont succédés ont dépensé la somme énorme de 276 milliards de francs et l’on peut se rendre compte par le tableau ci-dessous que les 9/10 de cette somme servirent à des dépenses inutiles.
-
Service de la dette (inutile) : 70.953.000.000 francs
-
Pensions : 20.865.000.000 francs
-
Dépenses militaires (inutile) : 48.332.000.000 francs
-
Dépenses civiles : 34.656.000.000 francs
-
Divers : 9.958.000.000 francs
-
Avances à des gouvernements étrangers (inutile) : 7.022.000.000 francs
-
Reconstruction (inutile) : 84.036.000.000 francs
-
Total ----------------------------- 276.036.000.000 francs
Si nous comptons comme dépenses inutiles les sommes employées à la reconstruction des régions dévastées c’est qu’en réalité ces dépenses sont la conséquence du carnage et que, d’autre part, si l’on tient compte de certaines exceptions, ce sont les gros financiers et les gros industriels qui ont bénéficié de cette somme versée par les contribuables français. Comment, alors, espérer un dégrèvement des charges, si l’on considère que les charges futures seront encore plus élevées que celles du passé, car à toutes ces dépenses viennent encore s’ajouter celles déterminées par le remboursement des dettes extérieures : à l’Amérique, qui s’élèvent à quatre milliards de francs or et dont le remboursement est échelonné entre les années 1926 et 1987 et celles à l’Angleterre qui sont à peu près équivalentes à celles de l’Amérique.
Il n’est donc aucune puissance politico-sociale qui puisse, en vertu des lois qui régissent les sociétés bourgeoises, résoudre le problème du dégrèvement et il faut donc conclure que les peuples payeront au capitalisme les erreurs et les crimes de la guerre s’ils ne veulent pas se résoudre à briser les cadres de la légalité pour équilibrer une situation qui ne peut qu’empirer.
Le peuple est aveugle et, confiant. Il prête encore un certain crédit aux formes démocratiques et pourtant il devrait être éclairé à 1a lumière des réalités. Il n’y a qu’une solution, pour améliorer le sort des travailleurs : c’est la Révolution. La Révolution, c’est la destruction de tout un organisme périmé qui sacrifie la grande majorité d’une population au bénéfice d’une minorité ; la Révolution, c’est l’élaboration d’une société où chacun participera équitablement à la production et dans laquelle chacun trouvera le maximum de bien-être et de liberté ; la Révolution, c’est l’action qui déchargera le peuple de tout le poids que fait peser sur lui une classe de profiteurs et de ploutocrates, c’est le dégrèvement de l’humanité d’une erreur qui a duré des siècles et qui sera remplacée par une vérité assurant à tous la nourriture du corps et celle de l’esprit.
DÉIFIER
verbe
Mettre au rang des dieux. Prêter à un animal ou à un objet, une puissance surnaturelle. La déification est un signe d’ignorance et il est compréhensible qu’aux âges reculés de l’humanité, lorsque l’homme n’avait pas encore percé les mystères de la nature, il fût enclin à déifier ce qu’il ne comprenait pas. C’est ainsi que, par ignorance et par terreur, les premiers hommes adorèrent le tonnerre et que pour manifester leur joie ou leur reconnaissance, ils glorifièrent le soleil et les astres qui leur apportaient la lumière.
Par la suite, lorsque l’humanité sortit de l’obscurité dans laquelle elle était plongée et que l’homme, par la recherche, arriva à déterminer les causes de certains phénomènes, il s’éleva de la déification des objets, des choses, à la déification de ses semblables. Il considéra comme des Dieux les grands hommes de sa génération, les rois, les inventeurs et ceux qui se signalaient par leurs découvertes. En un mot, l’homme, durant des siècles, crut infailliblement en la puissance de forces extérieures et divinisa ceux qu’il considérait comme des bienfaiteurs ou capables d’exercer une influence favorable sur la vie de la collectivité humaine.
Bien que les progrès de la science et de la philosophie aient, dans une large mesure, aboli les pratiques auxquelles se livraient les populations des vieilles sociétés, la déification subsiste encore et nous assistons fréquemment à l’adoration d’un peuple pour une personnalité marquante de son époque. De même que les anciens mettaient au-dessus de tout, et adoraient après leur mort et même parfois de leur vivant, certains de leurs grands hommes, les populations modernes exaltent, à l’égal des dieux, des êtres dont la valeur peut ne pas être à dédaigner, mais qui ne furent que des hommes, rien que des hommes. N’a-t-on pas, en France, fait de Jaurès un véritable Dieu et n’agit-on pas de même en Russie à l’égard de Lénine ? Certes, on ne pousse pas le ridicule jusqu’à adresser des prières à ces hommes déifiés, mais cependant la croyance du peuple est telle, que durant les périodes de difficulté il s’imagine que seule la présence de ces individus serait capable de résoudre une crise matérielle ou morale. De pieux pèlerinages sont organisés sur la tombe de ces nouveaux dieux et le culte qu’on leur porte est tel, qu’il n’est permis à personne de douter de leur puissance passée, présente et future.
« Les choses les plus ignorées sont les plus propres à être déifiées », a dit Montaigne, et c’est parce que les humains n’ont pas confiance en leur propre force qu’ils se réfugient toujours dans une croyance quelconque et qu’ils espèrent que d’autres feront ce qui leur semble impossible à eux-mêmes. Il n’y a aucune Providence et rien ne peut être modifié par des moyens ou des forces surnaturelles. N’ayons confiance qu’en nous-mêmes ; unissons nos efforts, rien n’est supérieur à l’être vivant ! supprimons les dieux, tous les dieux ; conservons le souvenir des hommes qui, par leur volonté, leur clair voyance ou leur courage, ont apporté leur tribut à l’humanité, mais gardons-nous de les déifier si nous ne voulons pas retomber dans les erreurs qui furent si néfastes à l’évolution de l’humanité.
DÉISME
n. m. du lat. Deus (Dieu)
Les vocables déisme et théisme indiquent la croyance dans l’existence d’une Divinité personnelle et intelligente, distincte du monde. Déisme, cependant est employé spécialement pour indiquer une croyance religieuse, qui ne s’appuie pas sur la révélation et ne reconnaît aucun lien dogmatique. Déistes furent et sont presque tous les philosophes croyant à un Dieu. Mais la signification de théisme et de déisme varie de philosophe à philosophe. Kant, par exemple, appelle théisme la croyance en une divinité libre, créatrice du monde sur lequel cette divinité exerce sa propre Providence ; et déisme la simple croyance en une force infinie et aveugle, inhérente à la matière et cause de tous les phénomènes qui se produisent en elle.
— Le terme déisme est employé à indiquer la religiosité de ceux qui admettent l’existence d’une divinité, en lui niant toute action sur la nature et sur l’homme ; ou de ceux qui admettent la Providence divine, mais qui affirment l’indépendance de la moralité de la religion ; ou de ceux qui admettent l’idée du devoir et de la Providence divine, mais qui nient toute sanction de l’au-delà. (paradis et enfer) ; ou de ceux qui admettent toutes les vérités de la religion naturelle, mais qui repoussent le principe d’autorité et la révélation. Cette dernière est la signification la plus répandue.
DÉLATION
n. f.
La délation est l’acte le plus ignoble auquel peut se livrer un individu et il n’est pas de termes assez violents pour flétrir celui qui se prête à cette basse besogne. Elle consiste à dénoncer secrètement et à accuser de certains crimes ou délits des hommes auxquels on est, ou plutôt on semble attaché par des intérêts moraux ou matériels. Le délateur est un être sans scrupule, guidé simplement dans ses entreprises par le gain qu’il espère tirer de ses méfaits, et il est d’autant plus coupable que, pour arriver à ses fins, il est obligé de se couvrir du masque de l’amitié et de la camaraderie afin de pénétrer les secrets qu’il s’empresse de dévoiler à ceux qui l’emploient. La délation est un acte tellement odieux que même ceux qui s’en servent, ou à qui elle est utile n’osent pas en revendiquer la responsabilité et si la dénonciation secrète des « crimes contre la sûreté de l’Etat était autrefois une obligation », la loi de 1832 a abrogé les peines frappant les personnes qui se refusaient à servir d’auxiliaires à la police. Le délateur est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus lâche que le policier. Avec ce dernier, on est fixé ; on sait que son « devoir » est de rechercher, et de dénoncer tout ce qui peut troubler l’ordre bourgeois. On ne se trompe pas sur sa valeur et l’on se méfie lorsqu’il est signalé. Le délateur, lui, pénètre le milieu qu’il veut espionner, il se fait passer pour un partisan de ce milieu, il capte la confiance de ceux qui l’entourent et avec lesquels il semble travailler en toute sincérité, et finalement trahit ses « camarades » au profit de leurs adversaires. Il n’hésite pas, pour obtenir la récompense promise, à se montrer le plus acharné et le plus sectaire dans ses relations sociales et lorsque, parfois, le besoin s’en fait sentir pour ses maîtres, il dénonce des crimes ou des complots imaginaires quand il ne peut en découvrir de réels. On s’étonne de ce que les organisations d’avant-garde soient des foyers de délateurs. C’est cependant bien simple. Ce que la bourgeoisie craint le plus : c’est le réveil des classes opprimées et leur révolte. Elle a donc intérêt à savoir quelles sont les formes d’action que l’on prépare au sein de ces milieux, afin de tâcher de les étouffer ou d’en retarder la réalisation. Il est des besognes auxquelles la bourgeoisie n’aime pas à se livrer elle-même et, pour la délation, elle a recours à des individus vils et corrompus qui consentent à accomplir cet infâme ouvrage. Il n’y a donc pas lieu d’être surpris de ce que les associations révolutionnaires soient pénétrées par les délateurs, mais ce qu’il faut : c’est prendre ses précautions, ne pas introduire n’importe qui dans les secrets d’une organisation et, avant d’entreprendre ou même de décider une action, savoir avec qui on la décide et avec qui on l’entreprend. On ne prend jamais trop de précautions dans la lutte sociale et, s’il ne faut pas être arrêté par la crainte des délateurs, il faut cependant regarder qui nous entoure et savoir choisir ses amis.
La délation est un crime tellement odieux qu’il faut bien se garder d’en accuser un individu avant d’être certain de ce que l’on avance. Il arrive que l’on porte une accusation sur des apparences et non sur des certitudes, et les conséquences de cette accusation peuvent être graves. Méfions-nous. Lorsque certains gestes ou certains actes éveillent les soupçons, renseignons-nous d’abord et n’agissons qu’ensuite ; ce n’est qu’une fois convaincu de la réalité, qu’il faut dénoncer le délateur et lui réserver le sort qu’il mérite.
DÉLÉGATION
n. f.
Acte par lequel on donne à un ou plusieurs individus l’autorité nécessaire pour représenter un autre individu ou groupe d’individus. Délégation. cantonale ; délégation judiciaire ; délégation syndicale ; délégation de pouvoirs. En matière judiciaire, un juge, peut dans l’instruction d’une affaire criminelle ou correctionnelle, se faire remplacer en donnant une délégation à un commissaire aux « délégations judiciaires » ; le maire d’une commune peut se décharger de certaines de ces fonctions et, par une délégation, transmettre une partie ou la totalité de son autorité à l’un de ses adjoints ; un parlement peut se démettre de ses pouvoirs et, par délégation, en charger le gouvernement ; une organisation syndicale donne une délégation à son secrétaire pour qu’il puisse agir au nom du syndicat. On emploie couramment le mot délégation pour désigner un groupe d’individus servant d’intermédiaires entre deux parties et qui est chargé par l’une d’elles de présenter et de défendre ses intérêts auprès de la seconde. Le terme est impropre. La délégation n’est pas le groupe d’individus, mais le mandat qu’il a reçu ; celui ou ceux qui sont nantis d’une délégation s’appellent des délégués.
DÉLÉGUÉ
adj. et nom
Qui a reçu une délégation ; un délégué syndical ; un délégué mineur ; « Les délégués furent reçus par le ministre auquel ils présentèrent la délégation dont les ouvriers les avaient investis ». Le délégué est donc une personne à laquelle on a transmis ses pouvoirs et qui agit ou qui devrait agir, non pas en son nom propre, mais en celui de ses mandants. Les intérêts des délégués doivent s’effacer devant ceux des groupes qui les ont nommés pour remplir une mission ou un travail quelconque et ils se doivent d’oublier leur propre personnalité pour ne songer qu’à l’organisation ou aux individus qui ont placé en eux leur confiance. Il n’en est malheureusement pas ainsi et il arrive fréquemment que les délégués trahissent la cause qu’ils étaient chargés de défendre. Il n’est pas utile d’insister sur le rôle joué par les délégués populaires qui siègent dans les assemblées législatives et qui oublient leurs promesses sitôt qu’ils ont franchi le seuil du Forum ; nous savons l’impuissance du parlementarisme (voir ce mot) et la sincérité des hommes qui acceptent d’être délégués dans les parlements. Mais dans la bataille quotidienne entre la bourgeoisie et la classe ouvrière, dans les conflits d’ordre économique, il est presque indispensable que le prolétariat entre en contact avec les représentants du capitalisme et il le fait par l’intermédiaire de ses délégués. Il ne faut pas cacher le danger que présente une telle méthode d’action car le capital et la bourgeoisie dans leurs rapports avec les représentants de la classe ouvrière tentent l’impossible pour détacher la tête du corps et dissocier les intérêts des délégués de ceux qu’ils représentent. La corruption est une des armes les plus terribles de la bourgeoisie et il arrive souvent que les délégués ouvriers se laissent acheter et livrent le travailleur à son adversaire. Les exemples sont hélas nombreux de chefs d’organisations prolétariennes qui, tout en affirmant soutenir les intérêts des ouvriers, manœuvrent de telle façon que ces derniers sont toujours vaincus et restent les éternelles victimes dans la lutte sociale.
Il serait sage que la classe ouvrière avant de nommer des délégués à une mission quelconque, s’assurât de leur capacité et de leur sincérité et se gardât de leur donner des pouvoirs trop étendus. En n’accordant aux délégués qu’une autorité limitée, en déterminant strictement leur rôle et leur travail dans une action quelconque, le prolétariat s’éviterait bien des désillusions et bien des trahisons.
DÉLIBERATIF
adj.
Ce qui a qualité pour délibérer, pour décider, pour voter à la suite d’une délibération. Avoir voix délibérative dans une assemblée, c’est-à-dire avoir l’autorité de participer par son vote aux décisions de cette assemblée, alors que ceux qui ont voix consultative peuvent donner leur avis au cours de la discussion, mais n’ont aucun pouvoir pour participer à la résolution finale. Exemple : Dans les assemblées départementales, les conseillers généraux qui sont chargés d’administrer leur région ont voix délibérative, alors que le préfet n’a que voix consultative ; dans les congrès ouvriers, les représentants des syndicats ont voix délibérative et ceux des fédérations n’ont que voix consultative. Politiquement, c’est-à-dire dans la gérance de tout ce qui intéresse la nation, il peut sembler que le peuple ait une voix délibérative et que rien ne se fait sans sa volonté. En vérité, le peuple n’est même pas consulté et son pouvoir délibératif est capté par les intrigants qui prétendent la représenter dans les parlements et qui délibèrent et décident en ne tenant aucun compte des aspirations et des volontés populaires.
DÉLIBERATION
n. f.
Action de discuter sur une résolution à prendre. La délibération comprend : l’examen de la question présentée ; la discussion des arguments favorables ou défavorables à une résolution, et enfin le vote. La délibération est utile en ce sens qu’en provoquant la discussion elle permet à chacun des membres délibérant de raisonner sur les conseils qui leur sont soumis, et de prendre des décisions en pleine connaissance de cause. Comme tout objet intéressant une collectivité, une délibération ne peut avoir de résultats heureux qui si ceux qui y prennent part sont au courant de la question qui en fait l’objet et s’ils sont animés par un sincère désir d’arriver à un but. Nous savons le peu de sérieux qu’offrent les délibérations publiques des assemblées législatives et nous n’ignorons pas leur inopérance, tout au moins en ce qui concerne les sujets intéressant les classes productrices de la nation.
Toutes les organisations officielles, toutes les administrations publiques sont dirigées par des individus appartenant à la bourgeoisie et les délibérations des divers comités qui règlent les rouages de la société ne peuvent apporter aucun avantage à la classe ouvrière. Il est donc indispensable, si le prolétariat veut se libérer et voir disparaître un jour l’exploitation de l’ homme par l’homme, qu’il sache de quelle façon il doit agir, et ce n’est qu’en délibérant qu’il peut se fixer sur le parti qu’il convient de prendre, il est essentiel qu’une délibération ouvrière, pour porter ses fruits, soit empreinte de la plus grande cordialité et n’offre pas le spectacle des déchirements et des divisions. Le travailleur doit être uni sur le terrain du travail. Les intérêts de tous les travailleurs sont les mêmes et, lorsqu’ils comprendront que la puissance du capitalisme ne repose que sur l’ignorance des exploités, lorsqu’ils sauront que « c’est une chose déplorable de voir tous les hommes ne délibérer que des moyens et point de la fin » (Pascal) qu’ils auront appris à envisager les faits dans leur ensemble et à en déterminer les causes, de leurs délibérations sortira la lumière, et les résultats et les décisions de ces délibérations auront une portée formidable sur la destinée des sociétés.
DÉLIQUESCENCE
n. f.
En chimie on donne le nom de « déliquescent » à certains corps qui ont la propriété d’absorber l’humidité de l’air et de se résoudre en liquide. Au sens figuré, ce mot est employé comme synonyme de désagrégation, de décadence. On dit qu’un organisme est en pleine déliquescence lorsqu’il est complètement en décadence et que rien ne peut être tenté pour le sauver.
DÉLIT
n. m.
On appelle « délit » toute infraction à la loi, tout acte punissable de peines correctionnelles, Les infractions soumises à la délibération de la Cour d’assises s’appellent des « crimes ». Il y a plusieurs sortes de délits : 1° les délits publics qui provoquent une action judiciaire sans qu’aucune plainte particulière ait été portée ; 2° les délits réservés où l’appareil judiciaire ne se déclenche qu’à la demande de la partie lésée ; 3° les délits politiques. Quel que soit l’ordre du délit, les peines prononcées contre le délinquant sont ou la prison, les dommages et intérêts, ou l’amende. Si l’on considère qu’il y a en France 3006 justices de paix qui statuent sur les délits-de simple police et qui ont le pouvoir d’infliger des peines n’excédant pas 15 francs d’amende et 5 jours de prison, on peut se rendre compte du nombre incalculable d’infractions à la loi qui se commettent chaque jour. Et, à côté de tous ces tribunaux, il y a encore les tribunaux commerciaux, les cours d’appel, les cours d’assises et la cour de cassation.
Dire que toute cette organisation judiciaire, que tout cet appareil de répression n’est constitué que pour brimer les classes pauvres peut paraître enfantin et les partisans de « l’ordre » prétendent qu’il est indispensable de réprimer les délits, sans quoi la vie en société serait impossible. Il faudrait démontrer d’abord, pour prêter un certain crédit à cette assertion, qu’une société qui a besoin pour se défendre d’un tel appareil est basée sur l’ordre. Pour nous, Anarchistes, nous ne pouvons y croire et sommes convaincus que c’est le désordre qui nécessite une telle institution judiciaire.
Examinons le problème plus profondément et supposons que chacune des justices de paix n’ait à juger que cinq affaires par jour, — et nous sommes modestes, car c’est quinze ou vingt que nous devrions dire — cela fait 15.000 délits. Chacun des quatre cents tribunaux correctionnels une moyenne de dix affaires, ce qui fait 4.000, et nous arrivons à ce chiffre fantastique que pour une population de quarante millions d’habitants, il y a par année plus de six millions de délinquants, c’est-à-dire un sur sept. Cela peut sembler paradoxal, et c’est pourtant, ainsi, et nous sommes au-dessous de la vérité. Peut-on, en. toute loyauté, appeler cela « l’ordre » ?
Comment s’étonner alors que les prisons regorgent de monde ? Qui est responsable de ce nombre de délits et quelles en sont les victimes ? Nous disions plus haut que l’appareil judiciaire ne fonctionnait que contre les classes pauvres ; il est évident que les classes possédantes sont moins sujettes à, se livrer à des infractions à la loi .puisque la loi fut faite au bénéfice des privilégiés. Jamais un homme fortuné ne sera poursuivi pour délit de vagabondage par exemple ; être sans domicile, ne pas avoir les possibilités financières d’avoir un logis est, dans notre douce république française, considéré comme un délit. En vertu de la logique la plus élémentaire, il nous semble que le malheureux qui n’a ni feu ni lieu, qui est contraint, par les froides nuits d’hiver, de se contenter d’un coin de porte pour dormir, souffre assez de sa situation sans que vienne encore s’appesantir sur ses épaules la main de la justice ; il paraît que nous avons tort et que c’est un délit d’être pauvre. C’est un délit de s’attaquer à la propriété privée. Nous avons dit, d’autre part, ce que nous pensions de l’action que l’on a dénommée reprise individuelle (Voir cambriolage ), mais cependant nous sommes obligés de reconnaître que M. de Rothschild ne peut être réduit à une telle extrémité, car sa fortune lui permet d’user de procédés plus légaux pour s’approprier le bien d’autrui, et que, par conséquent, le vol et le cambriolage sont encore des délits dont n’auront jamais à répondre les individus appartenant à la bourgeoisie.
C’est donc sans hésitation que nous disons que ce sont toujours les classes pauvres qui, en vertu de la loi, commettent des délits. C’est un délit de chasser dans des terres qui ne vous appartiennent pas et le miséreux, le travailleur, n’a pas de terre ; c’est un délit de pécher dans des eaux qui sont la propriété d’un particulier ; c’est un délit de dormir dehors lorsque l’on a pas de foyer, mais on a le droit de le faire si l’on possède des châteaux et c’est encore un délit de crier qu’une société qui se livre à un tel arbitraire est une société mal organisée. Il est vrai que ce dernier délit est considéré comme un délit politique.
Il fut un temps ou ce que l’on appelle une infraction politique était considérée comme un crime et par conséquent jugé par la cour d’assises. I1 en est autrement de nos jours si l’on excepte toutefois les infractions commises par les éléments appartenant à la bourgeoisie. Même quelques années avant la guerre de 1914–1918, les délits de presse, les discours considérés comme tendancieux par les représentants de l’ordre étaient soumis à la délibération du jury ; un ministre plus zélé que ses prédécesseurs se souvint des lois de 1893–1894 votées par un Parlement dominé par la peur et en décida l’application, violant incontestablement l’esprit qui, vingt ans auparavant, avait animé le législateur. Ces lois dites « scélérates » permettent aux juges correctionnels, dont on connaît l’indépendance, de condamner le délinquant à des peines variant entre un mois et cinq ans de prison, en considérant comme « menées anarchistes » l’objet du délit. Ce qu’il y a de curieux et de ridicule dans l’application de ces lois, c’est que quantité de délinquants, poursuivis pour avoir commis des délits politiques, sont condamnés alors qu’ils sont les irréductibles adversaires de l’anarchisme. Il coule de source que les délits politiques d’ordre bourgeois, c’est-à-dire réactionnaires, tels les délits commis par les royalistes ne sont pas soumis à cette même juridiction et que l’on ne les accuse pas de menées anarchistes. Seuls les éléments d’avant-garde bénéficient de cette attention gouvernementale.
Bref, quels que soient la forme ou le fond du délit, qu’il soit politique, réservé ou public, ce qui est incontestable, c’est que depuis qu’il y a des juges, le nombre des délits n’a point diminué et qu’au contraire il augmente chaque jour. Il faut donc en conclure que le délit a des causes qui échappent à la loi et que la loi est impropre à résoudre le problème de la vie commune. Tout homme dont le cerveau s’est débarrassé de toute, ou d’une partie de l’erreur qui lui fut inculquée depuis son plus jeune âge, sera obligé de reconnaître avec nous, anarchistes, que l’imperfection de l’organisation sociale est la source de toutes les infractions, et que le délit n’est qu’une conséquence du malaise manifeste de la collectivité humaine.
Détruisons les causes et les effets disparaîtront ; c’est l’unique ressource. Réformer l’appareil judiciaire est impossible ; et ce serait perdre son temps que de s’atteler à une telle besogne. La corruption a pénétré tous les rouages des sociétés modernes et il ne pouvait pas en être autrement ; l’argent, le capital, l’autorité qui sont à, la base de l’organisation sociale actuelle sont les causes fondamentales et déterminantes du délit, et rien ne sera terminé tant que ces causes ne seront pas détruites. Qu’importent les critiques acerbes et malveillantes de nos adversaires lorsque nous présentons la question des délits sous son jour véritable. L’exemple du passé, l’expérience que nous avons acquise dans la lutte sociale donne plus de fermeté a notre certitude que ce n’est pas l’administration de la chose publique qui est à réformer, mais l’ordre économique et social en son entier.
L’homme ne commettra plus de « délits » lorsqu’il cessera d’être emprisonné dans le cadre des lois humaines et que son bonheur et sa liberté ne seront plus subordonnés à la volonté et à la puissance de certains de ses semblables. Il faut que l’individu sache cependant que la liberté et le bonheur ne se donnent pas :qu’ils se prennent. Que les hommes le veuillent, et demain ils seront heureux. Le délit, qui n’est en vérité que la manifestation du conflit entre deux catégories, entre deux classes d’individus, ne peut disparaître qu’avec ces classes c’est-à-dire lorsque la contrainte et l’autorité auront fait place à la fraternité.
J. Chazoff
DÉMAGOGIE
n. f.
L’origine du mot démagogie servait à signaler l’influence exercée par un homme politique sur le peuple, mais n’avait aucun sens péjoratif ; ; il était également usité comme synonyme de « démocratie ». De nos jours, il n’est plus employé dans le même sens et le mot « Démagogie » est toujours pris en mauvaise part. Il serait utile de définir exactement ce terme, car il prête à confusion. Proudhon, par exemple, ne lui donne pas un sens péjoratif :
« La réaction est la négation du progrès ; le juste milieu est l’hypocrisie, et la démagogie en est la fièvre. La réaction cherche à faire reculer le char révolutionnaire, le juste milieu s’efforce de l’enrayer, la démagogie veut accélérer le mouvement. » (Proudhon)
Le Larousse nous donne cette brève définition de la démagogie : « Politique qui flatte la multitude », et pour des raisons différentes nous pensons cependant que cette définition est assez courte quant au présent. Si, avec Proudhon, nous pensons qu’il est indispensable d’accélérer le mouvement révolutionnaire et de tenir les populations en éveil, il nous semble cependant que la démagogie remplit ce devoir de façon imparfaite et qu’elle n’envisage qu’un côté de la question. S’il est utile de chercher à exploiter les passions populaires en vue de la libération politique et économique du peuple ; s’il est parfois indispensable de déchaîner ces passions ; il serait bon cependant de ne pas oublier que la passion, comme unique moteur de révolte, peut être une cause de désastre si l’on n’y joint pas la raison. Or, la démagogie s’adresse uniquement à la passion et non pas à la raison ; c’est là son erreur sinon son vice, et c’est ce qui rend le démagogue si dangereux.
Dans une société où les causes de mécontentement sont si multiples, il est relativement facile de soulever une population en lui dénonçant les injustices et les iniquités dont elle est victime ; en s’adressant à son cœur, il est aisé de capter sa confiance, en la grisant de promesses et en lui faisant miroiter un avenir meilleur ; mais ce qui est plus épineux, c’est de lui faire comprendre que ce bonheur entrevu sous l’action persuasive de la parole ou de l’écrit, cette population doit le conquérir elle-même et qu’aucune force ou puissance extérieure ne peut le lui donner. C’est cela qu’oublie toujours de dire le démagogue et c’est pourquoi nous disons que le travail de la « démagogie » est négatif. Non seulement il est négatif, mais il est pernicieux, car ordinairement 1e démagogue imprime une direction au peuple et se présente à lui comme un messie qui va le sortir de la situation précaire dans laquelle il se trouve. N’est-ce pas faire de la démagogie que d’affirmer aux classes malheureuses que leur bien-être futur dépend du morceau de papier que l’électeur va périodiquement déposer dans les urnes officielles ; n’est-ce pas faire de la démagogie que de faire espérer au travailleur sa libération sans lui enseigner que cette libération est relative à la somme de sacrifices qu’il est capable de consentir ? Lutter contre le despotisme, contre l’injustice, contre l’iniquité dont souffrent 1es populations ; soulever la fureur populaire, entraîner le peuple dans la violence lorsque celle-ci est nécessaire à sa défense, c’est bien, et nous savons que l’énergie a parfois besoin d’être stimulée. Mais exploiter la crédulité et la naïveté du peuple, se livrer à des excès oratoires pour capter sa confiance et acquérir une popularité, se présenter à lui comme son ami alors que l’on est uniquement animé par l’ambition, user de l’influence que l’on exerce pour lui cacher la vérité et l’arrêter dans son élan émancipateur tout en faisant figure de révolutionnaire, c’est faire de la démagogie, et c’est tromper consciemment le peuple.
Le démagogue est un homme rusé et c’est une tâche ardue que de le démasquer. Les individus vouent un culte passionné à certains de leurs semblables, et malgré les trahisons et les désillusions, ils continuent à se laisser endormir par les belles paroles du tribun. D’autre part, l’homme aime à être flatté, et la flatterie n’est pas l’arme la moins usitée par le démagogue qui connaît ses foules et s’entend à merveille pour les mener.
Que faire contre la démagogie et les démagogues ? Opposer la raison et la logique à la passion. Petit à petit, le peuple se détache de tous les dieux de la politique qui s’attribuent un empire sur les cerveaux, et qui usurpent la puissance populaire ; le peuple commence à comprendre ; demain il aura compris, et alors il se débarrassera de tous les démagogues qui se hissent au pouvoir sur l’échine courbée du travailleur et la démagogie sera écrasée sous le poids de la franchise et de la loyauté.
DEMASQUER
verbe
Au sens propre : enlever le masque qui couvre le visage d’une personne déguisée. Au sens figuré : dévoiler la véritable personnalité d’un individu. Il est quantité de gens qui se présentent sous un jour bienveillant et qui n’ont d’autre intention que de tromper. L’imposteur cherche à en imposer par de fausses apparences ; le perfide se cache sous le masque de la loyauté, et le vicieux sous celui de la vertu. Il est utile de les démasquer, c’est-à-dire de mettre en évidence leurs intentions, afin de leur enlever toute possibilité de nuire. Lorsque l’on aura retiré tous les masques dont se couvrent ceux qui veulent profiter du peuple, le mensonge ne sera plus à craindre, l’erreur fera place à la vérité et l’humanité pourra poursuivre sa route à pas de géants.
DÉMEMBREMENT
n. m.
Action de démembrer, de séparer, de diviser. Ce terme est peu usité au sens propre et est surtout employé au sens figuré. « Le démembrement d’un pays, d’une province, d’une commune ». « Avant la guerre de 1914–1918, la Pologne était démembrée, et les trois parties de son corps étaient partagées entre l’Allemagne, la Russie et l’Autriche-Hongrie ». Depuis la guerre, c’est l’Empire autrichien qui est victime du « démembrement ». Il n’y a pas que les nations, les États qui se démembrent ; il y a aussi les organisations sociales et depuis quelques années, nous assistons à travers le monde au triste spectacle du démembrement des associations ouvrières. La politique perfide et menteuse a pénétré au sein des organisations prolétariennes et il en est résulté la division.
Espérons que ce démembrement n’est que provisoire et que la classe ouvrière retrouvera la force de faire de tous ses membres dispersés un corps unique lui permettant de résister à l’assaut de ses adversaires.
DÉMENCE
n. f. du latin dementia
Altération de l’intelligence ; cessation complète ou partielle des fonctions du cerveau. Une des principales manifestations de la démence est la perte de la mémoire et l’affaiblissement progressif des facultés intellectuelles et physiques. La démence est souvent due à la vieillesse, mais elle a aussi d’autres causes, et les êtres jeunes et chargée d’une hérédité alcoolique ou syphilitique en sont également victimes. La démence est une terrible maladie, car la pensée et l’intelligence sont les deux fonctions qui distinguent et séparent l’homme de la bête, et celui qui en est dépourvu n’est plus qu’un déchet d’humanité. Le travailleur qui peine et fatigue pour arriver modestement à boucler le budget familial et se laisse entraîner au cabaret ferait bien de réfléchir aux conséquences désastreuses de son acte. Combien d’êtres jeunes sont innocemment victimes d’une hérédité morbide et traînent toute une vie de misère, parce que leurs ascendants n’ont pas su maîtriser leur passions et résister à un verre de poison ?
Divers auteurs nous ont, par des ouvrages d’une haute portée philosophique ou sociale, éclairé sur les effets de la boisson. Zola, dans l’Assommoir, nous montre « Coupeau » finissant ses jours dans le cabanon des fous, et Ibsen, dans ses « Revenants » nous présente un homme jeune et talentueux qui sombre dans la démence, victime de la funeste passion de ses ancêtres.
Certains savants et philosophes, au spectacle qu’offre l’humanité, versent dans le pessimisme le plus profond et déclarent que le monde est en son entier atteint de démence.
Dans ses « Paradoxes Psychologiques », Max Nordeau, le célèbre docteur et écrivain autrichien, accuse l’individu de « dégénérescence névropathique », et il semble parfois que l’ensemble des humains donne raison à cette thèse. N’est-ce pas un vent de démence qui souffle sur le monde lorsque l’humanité sacrifie des millions d’hommes jeunes et vigoureux dans une guerre immonde et terrible ? Ne faut-il pas que l’homme soit atteint de folie pour se laisser conduire comme un mouton et se livrer sans protester au couteau du boucher ? La lassitude s’empare souvent de celui qui rêve de régénérer l’humanité lorsqu’il constate l’énorme besogne à accomplir ; et pourtant nous ne croyons pas que l’homme soit atteint de démence ; nous pensons simplement qu’il est encore un enfant qui a besoin de s’instruire et de s’éduquer, que, malgré les milliers de siècles qui nous précèdent, nous ne sommes encore qu’à l’aube de la civilisation, et qu’un long chemin reste à parcourir.
S’il arrive à l’individu de commettre des erreurs, de se livrer à des actes extravagants, de déraisonner, s’il lui arrive de se laisser entraîner dans des aventures criminelles, dans des entreprises stupides, c’est qu’il ne sait pas, qu’il ignore, et qu’il faut lui apprendre à se conduire ; c’est à cette tâche que l’Anarchiste doit s’attacher ; et ce qui apparaît comme de la démence disparaîtra lorsque l’oeuvre poursuivie sera accomplie et que l’homme devenu majeur restera maître de ses destinées.
DÉMOCRATIE
n. f. grec demos, peuple, et kratos, pouvoir
La démocratie est le « gouvernement du peuple » ou plutôt un régime politique qui prétend favoriser les intérêts de la masse. Si le socialisme est, ainsi que le prétend le Dr Gustave Le Bon, « La religion de l’avenir » on peut dire que la démocratie est la religion moderne et que toutes les puissances dites civilisées s’inspirent aujourd’hui de l’idée démocratique, sinon de son esprit. Même les gouvernements d’essence réactionnaire qui exercent sur les populations leur absolu pouvoir et politiquement entravent ou cherchent a entraver tout progrès, ne manquent jamais de se réclamer dans la direction de la, chose publique des intérêts et de la souveraineté populaires. Cela s’explique, car si, dans le passé, il fut possible aux autocrates d’éloigner le populaire de tout ce qui intéresse la vie d’une nation, c’est qu’ils étaient considérés comme des demi-dieux, nantis d’un pouvoir supérieur, et que la croyance et l’ignorance des hommes favorisaient une telle conception de la vie sociale ; mais Dieu est mort et n’exerce plus sur le monde qu’un pouvoir spirituel. Malgré les empreintes profondes laissées par les religions, malgré leur emprise sur une partie de l’humanité, il n’est cependant plus un individu — à moins qu’il ne soit un fanatique — qui, en notre siècle de modernisme, se laisserait gouverner économiquement au nom d’un Dieu qui apparaît lointain et qui s’éloigne chaque jour davantage. Il faut quelque chose de positif, maintenant, à la collectivité humaine ; l’homme veut être libre et la démocratie, si elle ne lui donne pas la liberté, lui offre tout au moins l’illusoire et l’éphémère satisfaction de se croire libre politiquement, alors qu’il est enchaîné dans les lois économiques dont il forge lui-même les mailles.
Si nous jetons un regard en arrière et si nous faisons une comparaison entre les formes politiques passées et présentes, nous pouvons constater que la démocratie n’est que l’adaptation dés classes possédantes aux nécessités intangibles de l’évolution sociale.
Il fut un temps où le fait de posséder la terre donnait au possédant le droit absolu et incontesté de gouverner et il ne serait jamais venu au serf l’idée de réclamer une parcelle d’autorité à son maître. L’autorité se transmettait de génération en génération avec les domaines, et le pouvoir était en conséquence exercé par un aristocratie héréditaire qui se réservait tous les privilèges économiques et politiques.
Les relations d’homme à homme, de pays à pays, de contrée à contrée ; les découvertes de territoires nouveaux et l’intensification du négoce international devaient, en donnant à l’argent une puissance inconnue, transformer cet état de chose et cependant que « les rois se ruinent dans les grandes entreprises et que les nobles s’épuisent dans les guerres privées, les roturiers s’enrichissent dans le commerce. L’influence de l’argent se fait sentir sur les affaires de l’Etat » (Tocqueville). Ces divers progrès ne pouvaient se manifester sans imprimer au peuple une orientation nouvelle et les gouvernements se trouvaient forcément influencés par les nouvelles lois économiques qui avaient leur répercussion sur tout l’ensemble de l’activité sociale. C’est la démocratie qui prenait naissance ; elle se développa graduellement ; elle détruisit la féodalité ; elle sortit victorieuse de sa lutte contre les régimes autocratiques et s’imposa enfin au monde par l’idée de liberté dont elle semblait inspirée.
Si la « république était belle sous l’Empire » la démocratie n’a rien à lui envier en ce qui concerne les désillusions qu’elle a fait naître. En vérité, ce ne fut pas sans crainte que la bourgeoisie, qui n’est en réalité qu’une nouvelle aristocratie, constatait les progrès de la démocratie ; mais, ne pouvant en arrêter l’évolution, elle allait l’adapter à ses besoins et s’en faire une arme contre ceux-là mêmes qui en étaient les plus chauds partisans et les plus fidèles défenseurs. Pour donner au peuple l’illusion de la liberté absolue, pour le convaincre de sa puissance en matière politique, on le laissa se gouverner lui-même ou plutôt on lui en laissa l’apparence et lorsqu’on 1848, après bien des hésitations, la bourgeoisie française accorda au peuple le suffrage universel, elle fut bien vite rassurée sur les dangers de la démocratie, car, en raison de son ignorance, le peuple envoya aussitôt à l’Assemblée Constituante une majorité de réactionnaires.
La bourgeoisie comprit alors tous les avantages que présentait .pour elle la démocratie et elle s’efforça d’en consolider les bases tout en en conservant la direction et « On comprend alors pourquoi les hautes classes ont définitivement abandonné toute idée de restauration monarchique ou césarienne, et pourquoi elles soutiennent de toute leur influence et de leur argent, les journaux et les candidats démocrates de tout poil et de toute nuance ». (F. Delaisi, La Démocratie et les Financiers, p. 69.)
Il n’y a donc pas grand chose de changé ; 1a démocratie actuelle ne se différencie que faiblement des anciens régimes et si le peuple est souverain, reconnaissons que c’est un souverain plein d’abnégation qui sacrifie tout son bien-être au profit d’une oligarchie occulte qui ne se présente que sous la forme d’un gouvernement qu’il a lui-même nommé.
Qu’a fait la démocratie ? Rien, nous dit Tocqueville ; elle a été abandonnée à ses instincts et il en est résulté que la révolution démocratique s’est opérée dans le matériel de la société, sans qu’il se fit dans les lois, dans les habitudes et les mœurs, le changement nécessaire pour rendre cette révolution utile. En quittant l’état social de nos aïeux, on jetait pêle-mêle derrière nous leurs institutions, leurs idées et leurs moeurs ; qu’avons-nous pris à la place ? Le prestige du pouvoir royal s’est évanoui, sans être remplacé par la majesté des lois ». Pouvait-il en être autrement ? Anarchistes, nous ne le pensons pas et les démocrates sincères, les démocrates d’hier qui n’ont pas vécu l’expérience de la démocratie, ont commis une profonde erreur en s’imaginant qu’un gouvernement peut être d’émanation populaire alors qu’en réalité le capital est le maître absolu et que c’est lui qui dirige toute l’activité politique, économique et sociale du monde moderne.
Cela peut sembler un paradoxe, surtout lorsque l’on sait que le peuple a la faculté de nommer ses délégués dans les assemblées législatives et que, par conséquent, c’est lui qui exerce le pouvoir par l’intermédiaire des hommes qu’il désigne à certaines fonctions. Nous avons dit plus haut que cela n’était qu’une illusion et il suffit pour s’en convaincre de lire l’oeuvre de vulgarisation dû à la plume de Francis Delaisi : « La Démocratie et les Financiers ». Dans ce petit ouvrage, écrit en 1911, Delaisi nous éclaire sur la façon dont se font les élections en régime démocratique ; il dévoile à nos yeux tous les dessous de l’action parlementaire et aucun doute ne peut subsister sur l’indépendance des Parlements et sur le rôle qu’ils jouent dans les organisations démocratiques. Les gouvernements sont étroitement liés avec les grosses entreprises financières et industrielles et les gouvernants ne sont que des hommes de paille, des pantins que manœuvrent les véritables maîtres qui se cachent derrière le paravent de la démocratie. Les exemples abondent de cette corruption parlementaire et gouvernementale et il n’est pas besoin de fouiller dans le passé pour trouver des preuves du mensonge démocratique. Le capital soutient la démocratie et cela se conçoit, car aucun régime ne lui semble aussi favorable et c’est la raison pour laquelle tous les pays du monde s’orientent de plus en plus vers la démocratie.
Le peuple est souverain ; c’est lui qui est le maître et qui contrôle l’activité économique et politique du pays ; c’est en son nom que se font les lois et c’est en son nom qu’elles sont appliquées ; c’est lui qui veille à ce que les intérêts de la collectivité ne soient pas sacrifiés aux intérêts de quelques particuliers ; en un mot, c’est lui qui gouverne. Voilà l’esprit de la démocratie. Mais étudions-la brièvement dans son activité, dans l’application de son programme. Quelques faits, par leur brutalité, suffiront, nous pensons, à initier les plus crédules.
Nous disons plus. haut que les gouvernements démocratiques — comme tous les gouvernements du reste — agissent au nom du peuple, mais en vue d’intérêts particuliers ; qu’on en juge. Les réseaux de chemins de fer français accusent, pour l’année 1925, un déficit de 750 millions de francs et laissent entrevoir pour l’exercice de 1926 une perte de 900 millions de francs. Or, en vertu des lois édictées au nom du peuple français, ce déficit doit être couvert par le Gouvernement qui sortira de ses caisses les sommes indispensables à l’équilibre du budget des compagnies ferroviaires. Quelle ne sera pas la stupeur du démocrate assez aveugle pour croire en la vertu du démocratisme, en apprenant que les compagnies de chemins de fer ont, en fin d’année 1925, distribué à leur personnel certaines petites gratifications en guise d’étrennes ; en voici le tableau :
-
Directeur ou assimilé ............ 100.000 francs
-
Sous-Directeur général ............ 60.000 francs
-
Ingénieur en chef ................ 50.000 francs
-
Ingénieur en chef adjoint ........ 40.000 francs
-
Ingénieur .......................... 30.000 francs
-
Inspecteur principal ............... 20.000 francs
-
Inspecteur principal adjoint ....... 15.000 francs
-
Chef de gare ..................... 800 francs
-
Sous-chef de gare ................. 600 francs
-
Commis facteur ................... 400 francs
-
Hommes d’équipe ................. 60 francs
II n’est pas besoin de signaler la gratification dérisoire accordée au personnel inférieur et l’allocation princière touchée par l’Etat-major ; mais ce qui mérite d’être souligné, c’est que c’est le peuple qui est obligé, en vertu de son « pouvoir démocratique » de payer aux parasites sociaux des sommes fabuleuses et que si la somme d’impôts augmente chaque année, c’est que la démocratie est un foyer autour duquel viennent se grouper tous les profiteurs ignorés des classes laborieuses.
Le fait que nous signalons ci-dessus n’est pas un accident, un cas isolé, un crime pourrait-on dire, mais une chose normale, inhérente à la démocratie ; c’est la démocratie toute entière. Le monde moderne a été transformé en une vaste société anonyme à la tête de laquelle se trouve un Conseil d’Administration tout puissant, et ce Conseil est asservi aux grandes entreprises financières et industrielles qui détiennent en leur pouvoir toute richesse économique. Que l’on prenne les banques, les grandes entreprises de transport, l’industrie métallurgique et minière, les grandes administrations d’intérêt public, tout ce qui touche enfin à la vie active d’une nation, et l’on s’aperçoit que tous les rouages de l’économie sociale ont été abandonnés à quelques barons, véritables monarques qui, sur des monceaux d’or, président aux destinées de l’humanité.
La démocratie a accompli ce tour de force : d’emprisonner le peuple dans la liberté. Elle lui a donné la liberté, mais elle lui a retiré les moyens de s’en servir. Elle lui permet d’accéder aux plus hautes fonctions, mais elle a élevé des barrières pour qu’il ne puisse pas y parvenir ; elle a déclaré que tous les individus étaient égaux, mais elle a maintenu les privilèges qui sont une source d’inégalité ; elle a affirmé que rien ne pouvait se faire sans son assentiment et sans sa volonté, mais elle a livré au marché de la concurrence le domaine politique des nations et, même dans les tragédies périodiques engendrées par les appétits particuliers, la démocratie ne peut rien contre les forces mauvaises qui la dirigent.
« Les nations se déchirent aujourd’hui comme alors, et peut être avec plus de furie ; mais alors les peuples n’étaient pas consultés, tout dépendait de la volonté de princes que leur intérêt privé, guidait essentiellement, et qui avaient plus ou moins le sentiment des intérêts des nations. Aujourd’hui les peuples sont consultés ou paraissent l’être ; ils apportent à l’exécution des plans qu’on leur propose une adhésion plus formelle et mieux constatée ; ils semblent agir par eux-mêmes, et cependant, ils ne réussissent qu’à être des instruments ou des victimes. » (Léon Ferr, Revue des Deux Mondes, Mars 1871)
Et c’est en effet bien ainsi que cela se passe. On semble consulter le peuple alors qu’en réalité on lui en impose et qu’on lui fait accepter, sous le fallacieux prétexte de sa souveraineté, les pires ignominies. Peut-on expliquer autrement les guerres qui ravagent l’humanité et plus particulièrement l’horrible boucherie de 1914 ?
Ce qui fait la puissance de la démocratie, c’est que le peuple n’arrive pas à comprendre que l’on puisse le berner à ce point, et que, dans sa confiance naïve, il s’imagine que la puissance politique peut avoir raison des forces économiques qui subordonnent en réalité toute l’activité politique. Dans son ignorance, le peuple détache le politique de l’économique ; il ne voit pas l’étroite corrélation qui existe entre ces deux organes essentiels de la vie collective et se figure que la politique à laquelle il accorde toute sa confiance, est un facteur d’évolution et de libération sociale alors qu’elle n’est, prise telle qu’elle se présente à nous dans les sociétés démocratiques, qu’un facteur d’asservissement.
Dans son dernier ouvrage « Les Contradictions du Monde Moderne », Francis Delaisi, après une étude approfondie de la situation créée par la grande guerre, est obligé de reconnaître non seulement l’erreur de la démocratie mais aussi ses dangers. » La souveraineté nationale, qui est apparue pendant un siècle comme la suprême garantie de sécurité pour les personnes et les entreprises, est maintenant, pour les unes et pour les autres, le suprême danger ». (Les Contradictions du Monde Moderne, p. 533). Nous pensons cependant que Francis Delaisi se trompe lorsqu’il pense conjurer le péril en séparant le politique de l’économique et qu’il déclare que « la séparation du politique et de l’économique amènera la fin des guerres d’affaires ». Il se trompe encore lorsqu’il pense que la Constitution des Etats-Unis d’Europe mettra fin aux grands conflits qui ensanglantent l’humanité. Normann Angell, dans « Sa grande Illusion » soutient également cette thèse et, pourtant, elle nous semble erronée. L’exemple de l’Amérique et de ses grandes républiques fédérées n’est pas suffisant pour ébranler les doutes qui nous animent, car s’il est possible de concilier les intérêts particuliers d’une fraction, il est impossible de concilier, dans un régime basé sur le Capital, les intérêts particuliers de toute l’humanité.
La constitution des Etats-Unis d’Europe et par extension des Etats-Unis d’Amérique est une nouvelle illusion dont on cherche à griser les peuples, illusion dangereuse et meurtrière, car les peuples souffriront de cette expérience. Elle est fondée sur une conception fausse puisque ce ne sont pas les divisions d’ordre politique qui déchaînent les grands conflits, mais les divisions d’ordre économique. Or l’unité économique ne peut être réalisé dans un monde dont le capitalisme est le moteur. Le capital n’est pas un facteur d’union, mais de désunion, et tant qu’il sera la source de toute l’activité humaine, la misère régnera en maîtresse sur le monde.
Séparer le politique de l’économique est inconcevable ; c’est peut-être une idée généreuse, mais elle ne peut se matérialiser, se réaliser dans l’ordre social actuel. La politique est le paravent derrière lequel se cachent les grands magnats de la finance et de l’industrie, c’est elle qui permet au capital d’évoluer librement à travers un monde d’ignorants et d’asservis, c’est elle qui sert de trait d’union entre la liberté factice du peuple et la liberté réelle des gouvernants ; c’est le cerveau de la démocratie.
La démocratie nationale a déjà conçu cette erreur que la souveraineté du peuple éloignera tous les fléaux inhérents à la féodalité ; la démocratie internationale qui repose sur la même erreur engendrera les mêmes fléaux.
Il n’y a de bonheur que dans la liberté et il n’y a de liberté que par la révolution. Il faut choisir. La guerre ou la Révolution. II n’y a pas de milieu. Les mystiques de la démocratie devront s’incliner. La guerre nationale ou internationale ne peut être effacée par la réforme incomplète des institutions modernes ; elle continuera ses ravages et ses crimes, tant que la population mondiale sera divisée en deux classes : l’une opprimée, l’autre oppressive. La démocratie ne peut concilier les intérêts de ces deux classes. Le voudrait-elle, les moyens lui manquent, elle n’en aurait pas la possibilité.
Il faut choisir. Il est des hommes qui se refusent à prendre la position qu’il convient. Passifs dans leur lâcheté, ils ne veulent être ni pour la guerre, ni pour la révolution. Ce sont des neutres ballotés au gré des événements, qui ne savent pas où ils sont, qui ne savent pas où ils vont. Nourris au lait démocratique, ils espèrent encore en la puissance des dieux politiques pour amener au port le frêle bateau perdu dans l’océan. Ils ne veulent ni la guerre ni la révolution. Ces hommes me font l’effet d’un moribond qui, sur son lit de souffrance, se débat contre la camarde en criant qu’il ne veut pas mourir. Il mourra cependant. Il n’est aucune puissance qui puisse arrêter la mort ; il n’est aucune puissance qui puisse arrêter la guerre ou la Révolution.
La démocratie c’est la guerre ; la Révolution, c’est la paix. La Révolution écrasera la guerre ; la démocratie, héritière des régimes autocratiques, dernier repaire de la finance et de l’industrie, ultime sauvegarde du Capital et de l’autorité, doit disparaître ; ou alors l’humanité doit s’attendre à vivre des journées sombres et sanglantes avant de s’écrouler dans une tragédie qui n’a pas de précédent dans l’histoire des peuples.
J. Chazoff
DÉMOCRATIE
La démocratie est une des formes de la société capitaliste et bourgeoise. La base de la démocratie est le maintien des deux classes opposées de la société moderne : celle du travail et celle du capital, et leur collaboration sur le fondement de la propriété capitaliste privée. L’expression de cette collaboration est le Parlement et le Gouvernement national représentatif.
Formellement, la Démocratie proclame la liberté de la parole, de la presse, des associations, ainsi que l’égalité de tous devant la Loi. En réalité, toutes ces libertés ont un caractère très relatif : elles sont tolérées tant qu’elles ne contredisent pas les intérêts de la classe dominante : la bourgeoisie.
La Démocratie maintient intact le principe de la propriété capitaliste privée. Par là même, elle laisse à la bourgeoisie le droit de tenir entre ses mains toute la presse, l’enseignement, la science, l’art, ce qui, en fait, rend la bourgeoisie maîtresse absolue du pays.
Ayant le monopole dans la vie économique, la bourgeoisie peut établir son pouvoir illimité aussi dans le domaine politique. En effet, le Parlement et le Gouvernement représentatif ne sont, dans les démocraties, que les organes exécutifs de la bourgeoisie.
Par conséquent, la démocratie n’est que l’un des aspects de la dictature bourgeoise, mêlée sous des formules trompeuses de libertés politiques et de garanties démocratiques fictives.
Archinoff
DÉMON
n. m. du grec daimôn (génie).
Dans le langage philosophique le mot démon indique le génie familier duquel Socrate se disait inspiré. Sur sa nature exacte persiste la controverse. Selon certains, Xénophon, le disciple le plus direct de Socrate, donnait à ce mot la même signification que le mot Dieu ; selon d’autres, Socrate croyait à l’existence de génies familiers ; selon d’autres encore, Socrate se servait de ce terme pour indiquer l’analogie entre ses pressentiments que la divinité lui inspirait, et les démons de la mythologie grecque. Les psychiatres retiennent que Socrate fut en butte à des hallucinations visuelles et auditives et qu’il imagina de parler avec un esprit. D’après de plus récents et modernes psychologues, Socrate entendait par le mot démon l’inspiration avertie dans les suggestions subconscientes qui, chez tous les mystiques, assument une notable vivacité et se présentent à l’introspection sous la forme d’une individualité extrinsèque, de laquelle ils sentent la présence dans le profond de leur esprit. Dans le sens courant, démon se réfère à l’anti-Dieu, en qui la croyance perpétue le dualisme religieux.
DÉMON
Dans les pays qui ont été touchés par le progrès et où la science et la philosophie exercent une bienfaisante influence, le démon n’est plus qu’une figure servant à caractériser une personne animée de sentiments bons ou mauvais, mais dont les inspirations et les impulsions sont plus particulièrement orientées vers le mal. Etre possédé par le démon du jeu, de la jalousie, de la guerre, signifie : avoir la passion du jeu, souffrir ou faire souffrir de la jalousie, aimer la guerre. « Le démon de la discorde et de la calomnie souffle terriblement sur la littérature. » (Voltaire.) « Quel démon vous irrite et vous porte à médire ? » (Boileau.)
Chez les chrétiens, le démon est un esprit malin, l’esprit du diable, de Satan qui cherche à s’introduire dans le corps des humains afin de les corrompre et de les conduire en enfer à leur mort. On leur oppose l’esprit des anges qui incarne le bien alors que le démon incarne le mal.
La démonolâtrie, c’est-à-dire le culte et l’adoration des démons était pratiquée chez les anciens et, même de nos jours, de grandes contrées de l’Asie et de l’Afrique prêtent encore aux démons une puissance colossale. Socrate disait : « Tout homme est conduit après sa mort, par le démon auquel il a appartenu pendant sa vie, vers un endroit où les morts rassemblés subissent le jugement, et d’où ils partent pour les enfers sous un guide chargé d’y conduire ceux d’ici-bas. » Platon, le célèbre philosophe de l’Antiquité, développait cette théorie : que les démons étaient des intermédiaires entre les mortels et Dieu car « Dieu ne se mêle pas aux hommes et c’est par cet intermédiaire qu’a lieu tout commerce et tout colloque entre les dieux et Ies hommes ».
La croyance aux démons remonte donc à la plus haute antiquité et, si l’on peut concevoir le démonisme des anciens, il est difficile de comprendre les démoniaques modernes, êtres stupides et ridicules qui se laissent troubler par des absurdités d’un autre âge. Car il se trouve encore des sectaires assez incohérents qui se croient ou croient les autres possédés par des démons, et qui se livrent alors sur eux-mêmes, ou sur leurs semblables, à des brutalités odieuses pour le chasser de leur corps. Ces malheureux doivent être considérés comme des demi-fous, tristes victimes de l’éducation religieuse, et il serait plus sensé. de les livrer au psychiatre qu’au geôlier, lorsqu’ils se livrent à des excès qui troublent la vie de leurs semblables.
DEMONIAQUE
adj. et nom
Communément, ce mot indique tout ce qui est propre au démon ; mais chez quelques auteurs il a une signification différente. Ainsi, Gœthe, appelle démoniaque la révélation du divin dans le monde, l’inaccessible qui nous entoure et duquel nous sentons partout le mystère. Démoniaques étaient appelés ceux qui appartenaient à cette secte d’hérétiques chrétiens qui enseignaient que, à la fin du monde, aussi les démons, c’est-à-dire les anges rebelles à Dieu, seraient sauvés.
DEMONISME
n. m.
Avec ce mot on indique cette phase de l’évolution religieuse au cours de laquelle les phénomènes naturels sont expliqués comme étant l’effet de la lutte continuelle des esprits : les uns bons, les autres mauvais, dont on imagine que le monde est peuplé. Le démonisme est antérieur au polythéisme, puisqu’en lui les esprits n’ont pas de nom, pas de forme humaine pas d’histoire personnelle, et sont simplement adorés dans les arbres, dans les nuages, dans le vent, etc. Quand ils acquièrent un nom, une forme humaine, et une histoire personnelle, le démonisme se transforme en polythéisme et en mythologie. Le démonisme est, donc, un aspect de l’animisme. Le concept du démon est propre du dualisme religieux. Dualiste est la religion de Zoroastre (religion de la Perse antique) qui attribue tous les événements du monde à la lutte de deux puissances contraires, primitives, éternelles, indépendantes l’une de l’autre. D’après cette religion, à Ormuzd, auteur du bien, s’opposait Ahriman, auteur du mal. Le Satan de la Bible est l’Ahriman juif. Dans le christianisme persiste la conception du démon, commune à toutes les religions orientales. Ainsi nous voyons Saint-Michel, la lance à la main, terrassant le dragon, correspondre au très ancien Indra des Indiens qui a à ses pieds le démon Vritra.
Dans le monothéisme, c’est-à-dire dans la croyance en un Dieu unique, la conception de la divine puissance infinie, ne réussissant pas à se concilier avec les contradictions de l’univers, s’est unie, illogiquement, avec ce dualisme, qu’elle aurait dû éliminer, d’où il résulte que le monothéisme est, dans ce cas, une forme du polythéisme ; Dieu et l’anti-Dieu, c’est-à-dire Satan.
DENATURER
verbe
Changer la nature d’une chose, d’une plante, d’un animal. L’usage de la greffe dénature les plantes ; le produit de l’union de deux espèces différentes d’animaux dénature l’une et l’autre de ces espèces, c’est-à-dire leur fait perdre leur caractère naturel ou primitif. Dénaturer un fait : présenter un fait d’une manière inexacte, fausse ; dénaturer une idée, une pensée, etc., etc…
On a souvent tendance à dénaturer ce qui nous gêne ; il faut s’en garder, car ce n’est pas honnête, et laisser ces pratiques jésuitiques à la gent politique. L’Anarchisme a souffert et souffre encore de ce que tous ses adversaires — et ils sont nombreux — cherchent à en dénaturer l’esprit auprès des éléments qui seraient susceptibles de s’intéresser à ce mouvement de libération sociale. On a non seulement dénaturé l’Anarchisme, mais on a présenté et l’on présente encore les anarchistes comme des criminels, des meurtriers, qui ne rêvent que de destruction. Le travail et le devoir de l’Anarchiste sont de remonter ce courant et, en se faisant connaître, d’inspirer la confiance qu’il mérite, afin de pouvoir exercer son influence et jouer un rôle dans les mouvements sociaux et historiques.
DENI (de justice)
n. m.
Juridiquement, on appelle un déni de justice l’acte par lequel un juge refuse de juger une affaire ou un individu en raison de l’insuffisance de la loi. Un juge n’a pas le droit de refuser de juger, même si aucun texte de loi ne prévoit le cas qui lui est soumis, et le magistrat qui se livre à cet attentat s’expose à une peine de 200 à 500 francs d’amende et à l’interdiction de l’exercice de ses fonctions, pendant une période de cinq ans à vingt ans.
Mais il ne se rencontre pas de juges qui refusent de juger ; ou le cas est tellement rare, qu’il ne mérite pas qu’on y porte attention ; c’est ce qui explique probablement que, dans le langage courant, le déni de justice exprime non pas le refus de juger, mais le refus d’accorder à quelqu’un ce qui lui est dû en vertu même de la loi. Ex. : en vertu des lois sur la presse, les crimes d’ordre politique doivent être soumis à la compétence de la cour d’assises ; cependant, les anarchistes, les communistes, tous les révolutionnaires se voient traînés devant les tribunaux correctionnels et, lorsque les juges de ces tribunaux refusent de se déclarer incompétents, c’est un déni de justice. Les révolutionnaires ne peuvent pas être choqués d’une telle attitude de la « justice » et de ses représentants : la loi est faite pour les riches et appliquée par les représentants de la bourgeoisie ; il n’y a donc rien à en espérer. Transformer le milieu, tel est le but vers lequel doivent s’orienter tous les révolutionnaires et 1e déni de justice disparaîtra avec la « justice » elle-même.
DENONCIATION
n. f.
Action de dénoncer, de faire connaître. Une dénonciation scandaleuse : une dénonciation calomnieuse. Celui qui accuse secrètement ou publiquement quelqu’un à la justice est un dénonciateur. L’être infâme qui trahit et dénonce ses complices dans un crime est généreusement récompensé de son acte par la « Justice » et bénéficie de l’indulgence des tribunaux. « Cet infâme jouit tranquillement du fruit de ses dénonciations » (Lachâtre). De même que la délation, la dénonciation a trouvé dans les milieux d’avant-garde un terrain fertile à exploiter et il y a fatalement des dénonciateurs parmi les révolutionnaires ; ils ne sont cependant que d’un danger relatif dans les pays où l’action se passe au grand jour ; mais, dans les pays où la réaction sévit avec force, ils accomplissent leur sinistre besogne au détriment des organisations qui se placent hors la loi et veulent réformer un régime arbitraire de brutalité et de violence.
DENTS, HYGIENE DENTAIRE
Avant de passer au développement que comporte un tel sujet, il est utile de donner quelques détails sur le passé, ceci dans un but strictement instructif. Cette description permettra de mieux apprécier les progrès réalisés dans cette branche, tant au point de vue thérapeutique que prothétique. Nous verrons, par quelques exemples, les choses les plus burlesques, les plus incroyables ; la crédulité publique, le peu de connaissance en la matière ou la peur de l’extraction faisaient que beaucoup de personnes prenaient le mal de dents comme un mal inévitable et qu’il n’y avait qu’à supporter patiemment ce mal « d’amour » pour qu’il disparût. On souffrait autrefois autant sinon plus que de nos jours, car les connaissances médicales étaient précaires. On essayait surtout d’ôter la dent malade avec des instruments qui étaient de véritables instruments de torture. Nous constatons que Rois, Seigneurs, Puissants du jour souffrirent atrocement des dents. François 1er, Charles VII, Henri IV, etc., souffrirent ou eurent à subir des interventions chirurgicales. Mais arrêtons-nous un peu à Louis XIV. Louis XIV souffrait énormément des dents. Périodiquement, sa joue enflait et un abcès malencontreux venait déformer la figure de cette royale majesté, qui, dans sa toute puissance, ne pouvait que se mettre des cataplasmes de mie de pain et de lait sur sa noble joue. Il en souffrit tellement que les archiatres du temps inscrivaient dans le journal de sa Majesté :
« Il n’y aurait rien à souhaiter, si la mauvaise disposition de sa mâchoire supérieure côté gauche, dont toutes les dents avaient été arrachées, ne l’eût obligé de remédier à un trou de cette mâchoire qui ; toutes les fois qu’il buvait ou se gargarisait, portait l’eau de sa bouche dans le nez d’où elle s’écoulait comme d’une fontaine. Ce trou s’était fait par l’éclatement de la mâchoire arrachée avec les dents qui s’étaient enfin cariées et causaient quelques fois des écoulements de sanie et de mauvaise odeur. »
S’il en était ainsi de cet auguste personnage, soigné par les représentants les plus distingués de la médecine, vous pensez ce qu’il en devait être des malheureux dont, par le marteau, la tenaille ou le ciseau, le forgeron, le maréchal ou le barbier soignaient la dentition !
On peut dire que pendant plusieurs années Louis XIV souffrit atrocement, à telle enseigne que le pus coulait continuellement de ses blessures et qu’il sentait mauvais à deux pas. Louis XVI, au cours de son séjour forcé à la prison du Temple, eut une fluxion. Il demanda un dentiste. La Chambre du Conseil se réunit et dut statuer si Louis Capet aurait satisfaction. La Chambre refusa, sous prétexte que Louis XVI pouvait parler au dentiste et le corrompre. Napoléon se servait de cure-dents en quantité considérable. Lui-même attribuait à ses soins sa belle denture. Au cours de sa captivité, il eut besoin du dentiste, pour l’extraction d’une dent de sagesse et Napoléon le Grand, Napoléon qui fit trembler le monde cria, tempêta comme un perdu, pour faire extraire cette dent, à tel point que Betsy, sa petite amie, lui dit en avoir honte pour lui :
« L’homme est un apprenti, la douleur est son maitre. »
Pendant ce temps le peuple se fiait aux rebouteux, aux barbiers et autres arracheurs de dents. La peur de l’extraction lui faisait employer des remèdes extravagants. Le plus populaire, le plus estimé, était l’urine humaine. Ce remède était très recommandé par 1es doctes savants de l’époque. Fauchard, le père de la « dentisterie », n’hésitait pas à en recommander l’emploi. « Il consiste, disait-il, à se rincer la bouche avec quelques cuillerées de son urine toute nouvellement rendue. Ce remède est bon. On a un peu de peine au commencement à s’y accoutumer, mais que ne fait-on pas pour son repos et sa santé ? » Et l’auteur nous avertit que ce remède est très approuvé par messieurs les professeurs de la Faculté de Médecine. Un autre remède fameux :
« Prenez la patte gauche de derrière d’un crapaud séché au soleil ; mettez-la entre deux linges fins et appliquez-la sur la joue à l’endroit de la dent qui vous fait mal, et la douleur cessera aussitôt. »
Pour faire tomber les dents, voici un moyen infaillible :
« Ayez un lézard vert, mettez-le dans un pot et faites-le sécher au four, puis réduisez-le en poudre, frottez de cette poudre la gencive et la dent que vous voulez faire tomber, et vous la tirerez sans peine avec les doigts. »
Ensuite, des charlatans allèrent de ville en ville, en de riches apparats avec de brillants équipages. Trompes et tambours annonçaient au loin l’arrivée du célèbre Untel qui arrache les dents avec un sabre et sans douleur. Mais ceci est presque de nos jours, puisque nos grands-pères qui vivent encore ont vu ces arracheurs et ont eu besoin de leurs services.
A côté de ces extravagances, il y avait des médications raisonnées : girofle, pyrèthre, guimauve, etc… Il y avait aussi des dentistes qui travaillaient sérieusement à améliorer l’art dentaire. Les appareils de prothèse dentaire étaient sculptés dans de l’os ou dans des défenses d’hippopotame ; c’étaient encore des appareils en or ou en platine sur lesquels étaient fixés des dents humaines.
La dent est un organe dur « ostéoïde », calcaire, d’apparence osseuse, implantée dans l’épaisseur des arcades maxillaires. Les dents sont destinées spécialement à la mastication et à la phonation. Il y a trois sortes de dents : les incisives qui servent à couper, à inciser, qui se divisent en centrales et latérales ; il y en a 4 par mâchoire. Les canines qui servent à tenir, à déchirer ; il y en a 3 par mâchoire ; enfin les molaires, qui se divisent en petites molaires au nombre de 4 qui aident les canines et les grosse molaires, au nombre de 6, qui servent à triturer, à broyer.
La partie de la dent que l’on voit dans la bouche est la couronne ; les racines sont implantées dans les maxillaires. La couronne est constituée par une couche dure appelée émail qui enveloppe complètement l’ivoire qui est la partie constitutive la plus grosse de la dent ; au milieu se trouve tout un paquet vasculo-nerveux ; c’est le centre vital de la dent. Au centre de chaque racine passe un filet nerveux.
Il y a deux dentitions : la première temporaire ou dents de lait ; la deuxième permanente ou définitive. La première dentition évolue du 7ème mois de la vie au 33ème mois. Ces dents sont au nombre de vingt. Les dents permanentes ou de 2ème dentition comportent un total de 32 dents. L’éruption de chaque dent permanente est précédée de la chute de la dent temporaire correspondante, sauf pour les grosses molaires. L’éruption commence vers 6 ans et se termine en général vers 25 ans par la dent de sagesse.
Il importe de savoir que vers le 40ème jour de la vie intra utérine apparaît, sur le bord de l’embryon, une saillie ou bourrelet épithélial. Ce bourrelet se transformera suivant un processus embryologique qu’il est superflu de développer ici et donnera naissance aux dents. Il faut savoir aussi que la calcification commence vers le quatrième mois de la vie intra utérine, que par conséquent à partir de ce moment, toute maladie chez la mère ou toute mauvaise nutrition se représentera sur l’embryon en général et sur ses dents en particulier. En un tel état, la maman devra suivre un régime alimentaire prescrit par le médecin, régime qui compensera la déperdition de ses forces et donnera à l’embryon les moyens de constituer normalement ses dents.
Au cours de la grossesse et de l’allaitement, la mère devra tenir sa bouche dans un état de rigoureuse propreté, si elle ne veut pas voir la carie se développer avec une rapidité désespérante. Dans cet état spécial, la mère se trouve en déficience ; ses dents se déminéralisent légèrement, le milieu buccal s’étant transformé permet les fermentations acides, qui détruiront l’émail de la dent d’autant plus rapidement qu’à ce moment la maman se délaisse personnellement pour ne penser qu’à l’être attendu ou à dorloter le mignon bébé. Toutes les mamans vous diront : « j’ai commencé à perdre mes dents à mon premier enfant ». De plus, il ne faut garder, sous aucun prétexte, des chicots des dents cariées ou abcédées, car non seulement la mère s’intoxique ; mais, ce qui est plus grave, elle intoxique lentement son enfant.
Que ceux qui ont à charge d’élever un enfant veuillent bien y apporter le plus grand soin, car l’enfant, est pour son développement physique et intellectuel, sous la dépendance de son intestin, par conséquent l’enfant doit pouvoir bien triturer ses aliments pour bien les digérer et pouvoir les assimiler le plus complètement possible, afin d’acquérir le plus d’éléments pour le développement de son individu. D’autre part, un enfant ayant de mauvaises dents, souffre, mange mal, dort mal, s’intoxique par absorption de bactéries et microbes. Sa santé générale est ébranlée, son système nerveux se fatigue. L’enfant est alors en état de moindre résistance, il est prédisposé à toutes sortes de maladies, particulièrement à la tuberculose.
Qu’est-ce donc que la carie dentaire ? La carie est l’altération des tissus durs de la dent. Cette altération est surtout caractérisée par sa nature infectieuse. Diverses causes ont altéré ces tissus : traumatiques, chimiques, maladies, etc..Aussitôt les microorganismes s’introduisent dans les canalicules de l’ivoire désorganisant, par leur action nécrogène, plus ou moins complètement la dent. Si on n’intervient pas, si la nature ne peut réagir, la dent se désintègre complètement et peut amener des complications graves.
On s’aperçoit de jour en jour de l’importance du milieu buccal sur l’état général et inversement. Aussi, en pathologie générale, on ne peut pas ne pas se préoccuper de la bouche, véritable carrefour des voies digestives et respiratoires. En effet, on peut dire que les neuf dixièmes des maladies infectieuses ont leur porte d’entrée par la bouche. Irritation de l’estomac recevant des aliments mal triturés et infectés, provoquant des gastrites septiques. L’absorption continuelle de pus peut provoquer des affections du foie, des reins, du cœur, du cerveau. Je puis citer le cas de la sœur d’un camarade que l’on traitait dans une clinique pour son système nerveux détraqué. Bromure, douche, tel était le traitement. La simple extraction de ses dents mauvaises, au nombre de 17, remit, en quelques semaines, cette personne dans son état normal. Chez les fumeurs par exemple le cancer a plus de chance de se développer dans une bouche malpropre. On peut dire que le cancer guette le fumeur aux dents sales. Au cours d’épidémies, les personnes ayant une bouche en mauvais état sont les plus touchées. Presque tous les microbes peuvent se trouver dans la bouche à l’état normal sans provoquer aucune manifestation pathologique ; mais il suffit d’un état de moindre résistance pour que l’équilibre biologique soit rompu.
Il faut donc, à l’état normal, avoir une hygiène buccodentaire rigoureuse et à plus forte raison au cours de maladie ou d’accidents graves. Une brosse dure et du savon de Marseille sont des armes indispensables pour voir dans un gracieux sourire une belle rangée de perles se détachant d’une gencive rose et ferme.
Nos cabinets dentaires modernes disposent de moyens scientifiques pour soigner et guérir sans aucune douleur. La thérapeutique dentaire a acquis les mêmes progrès que la thérapeutique médicale. L’art dentaire bénéficie des moyens chimiques et électriques soit pour la désinfection, la stérilisation électrique, Rayons X, haute-fréquence, les anesthésiques, etc…La prothèse dentaire s’est surtout manifestée par les travaux d’or et de porcelaine qui permettent de remplacer et de remplir parfaitement la fonction naturelle disparue. L’orthodontie a permis de régulariser une denture en position vicieuse et le professeur P. Robin, des Enfants malades, a transporté sur les mâchoires et sur la face cette théorie, obtenant ainsi des résultats surprenants. Il existe, dans beaucoup d’hôpitaux de Paris, des services dentaires gratuits, où le dévouement des professeurs et des élèves est sans égal, mais où l’administration de notre régime routinier et arbitraire empêche d’étendre plus largement ces services qui ne sont pas outillés comme ils devraient l’être. Quoi qu’il en soit, il n’est plus permis, de nos jours, d’avoir peur de souffrir chez le dentiste. A mesure que le progrès rentrait par la porte, la douleur se sauvait pas la fenêtre.
- M. PARANT.
N. B. — Les exemples cités dans la première partie de cette étude, sont empruntés à Dagey.
DENUEMENT
n. m.
Etat de l’être dépourvu de tout ce qui est indispensable à la vie. S’applique à l’individu et à la collectivité. Cet homme est dans le plus complet dénuement. Cette famille se trouvait dans le plus terrible dénuement. Le dénuement est une des manifestations de l’ordre bourgeois. N’est-il pas affreux de songer que de nombreuses familles souffrent de la faim, que des petits enfants n’ont pas de quoi se nourrir, alors que les magasins regorgent de vivres et que la richesse s’étale honteusement aux yeux de tous ? La philanthropie cherche à amoindrir les effets du dénuement et les philanthropes s’imaginent que l’aumône est capable de résoudre le problème de la misère ; la presse bien pensante verse de temps en temps un pleur sur le dénuement qui a poussé une famille au suicide ; tout cela est une sinistre comédie qui ne fait que perpétuer un état de chose criminel, et les résultats obtenus par ce genre d’action sont plus malfaisants qu’on ne le pense.
C’est surtout dans la grande ville que l’on assiste au pénible spectacle de la misère et Paris, la « capitale du monde » regorge de malheureux dénués de tout moyen d’existence. Il suffit, pour s’en rendre compte, de s’arrêter un instant, par les froids matins d’hiver, devant les « soupes populaires » qui distribuent gratuitement un bol d’eau chaude qualifié bouillon. Ils sont là des centaines et des centaines de pauvres hères, sans foyer, sans famille, sans une main amie qui vienne se tendre pour soulager leur détresse, et qui attendent, par la pluie, par le vent, que la porte s’ouvre pour s’engouffrer dans une salle étroite et puante où, pendant quelques minutes, ils auront l’illusion de la chaleur. Qui sont-ils, d’où viennent-ils, tous ces miséreux ? Ce sont des travailleurs qui se sont, un jour, trouvés sans ouvrage et qui, petit à petit, ont tout perdu de ce qu’ ils avaient, eux qui n’avaient pas grand-chose ; ce sont des bacheliers qui traînent leurs diplômes avec leur pauvreté et qui ne trouvent pas à vendre leur savoir ; ce sont des inconscients perdus dans la vie et qui ont été élevés dans les larmes ; c’est le rebut de l’humanité, c’est le déchet de la société, c’est la conséquence du désordre social, c’est la souffrance née de la richesse des uns, c’est le capitalisme qui livre à la charité publique le trop plein de la chair à travail. Et ils sont, de par le monde, des millions comme cela. Qui n’a entendu parler de Londres et de ses mendiants, qui cherchent la nuit un refuge sous les ponts de la Tamise ? Et dans toutes les capitales, et dans toutes les grandes cités où le luxe s’étale avec impudence, il en est de même, car le luxe et la fortune des uns ne reposent que sur la misère des autres.
Ce n’est pas un sentiment de pitié qui doit nous envahir devant un tel spectacle, c’est un sentiment de révolte. La pitié n’a jamais rien fait et ne fera jamais rien. A quoi bon larmoyer et se lamenter sur l’inégalité et l’injustice sociales ? Il faut réagir et lutter contre les forces mauvaises qui déterminent un tel état de choses et le dénuement fera place au bien-être lorsque les hommes voudront comprendre que leur force est en eux-mêmes et qu’il leur est possible, s’ils le veulent, de transformer cette société où le bonheur des uns n’est fait que de la misère des autres.
DEPENDANCE
n. f.
Etre sous la dépendance de..., c’est-à-dire dépendre, être subordonné, être placé sons l’autorité de quelqu’un ou de quelque chose. Ne pas être indépendant. L’esclave était dans la dépendance de son maître, l’ouvrier est dans la dépendance de son exploiteur. « Dépendre, c’est, selon la plus claire notion et la plus évidente, être tenu d’obéir » (Bourdaloue). Or, dans la société actuelle, de gré ou de force, l’homme est contraint d’obéir, de se courber devant les exigences ridicules des institutions et est, par conséquent, dans la dépendance de cette société. Il est impossible d’échapper à la loi féroce de l’autorité, et les « en dehors » ou ceux qui supposent l’être, ne le sont que superficiellement .Nous sommes pris en un étau et l’individu seul ne peut conquérir son indépendance. Quelle que soit la forme de la société, si celle-ci est basée sur l’autorité, l’indépendance individuelle sera toujours subordonnée à celle d’une majorité et, par conséquent, dépendante de cette majorité. L’indépendance ne peut être que collective et ne peut se concevoir que dans une société libérée de toute contrainte et de toute entrave, et dans laquelle une fraction de la collectivité ne sera pas dans la dépendance d’une autre fraction. Seul, le communisme libertaire, qui vise à abolir l’exploitation de l’homme par l’homme, à étouffer toute autorité, et considère qu’il n’y a de bonheur et de bien-être que dans la liberté la plus large, peut, par la Révolution, atteindre ce but ; et, tant qu’il ne sera pas atteint, la lutte devra se poursuivre.
DEPEUPLEMENT
n.m.
Action de dépeupler. Bien que naturellement les populations aient tendance à augmenter en nombre, certaines contrées du monde traversent une crise de dépopulation. Cela ne veut pas dire que le nombre d’habitants de ces contrées diminue, mais qu’il s’accroît avec moins de rapidité que celui des contrées avoisinantes.
Il est évident que la guerre, les épidémies et la famine qui sévissent encore en certaines régions, sont des facteurs de dépopulation (voir ce mot) ; mais ceci n’explique pas que, dans un pays, une partie du territoire se dépeuple, alors que d’autres parties sont surpeuplées. En France, par exemple, nous assistons au dépeuplement de la campagne ; cependant que les villes deviennent trop étroites pour contenir le flot grandissant de la population.
Les économistes bourgeois ont trouvé une explication simpliste à ce phénomène et prétendent que si la campagne se dépeuple c’est que le campagnard est attiré par les lumières de la cité et se laisse griser par des perspectives de vie facile. Pourtant, ce sont d’autres facteurs qui déterminent l’émigration campagnarde. D’abord, afin de maintenir ses privilèges, la bourgeoisie met journellement en application ce principe : « Diviser pour régner » et, par sa propagande intéressée, a créé un antagonisme entre les populations campagnardes et citadines. A la ville, on affirme que si le coût de la vie augmente chaque jour, il faut en rejeter la responsabilité sur le paysan qui ne livre ses produits qu’à des prix prohibitifs ; alors qu’à la campagne, on déclare que les charges fiscales s’élèvent quotidiennement en raison des exigences exagérées du citadin qui ne veut produire que faiblement pour des salaires dépassant la norme permise.
On conçoit qu’une telle propagande n’est pas sans porter ses fruits et qu’il en résulte une haine sourde entre le paysan et le citadin.
Le travailleur des champs s’imagine que celui de la ville est un oisif produisant peu et vivant bien, et qu’il est plus avantageux d’abandonner la terre et de fouler le pavé de la grande cité que de continuer à végéter dans des conditions précaires. Si on ajoute à cette cause la soif de distraction de la jeunesse et l’attrait des plaisirs factices, on comprendra peut-être une des raisons qui déterminent le dépeuplement des campagnes. Mais ce n’est qu’un des facteurs du dépeuplement de la campagne ; il en est d’autres beaucoup plus sérieux sur lesquels les économistes bourgeois conservent un silence tout politique.
Le paysan est, et reste attaché à la terre et s’il l’abandonne, c’est qu’en réalité elle ne lui donne pas les avantages qu’il était en droit d’espérer. Il est excessif de déclarer que le paysan possède aujourd’hui la fortune et le bien-être. S’il est vrai qu’une certaine portion de la paysannerie bénéficie de certains privilèges, ce serait une erreur de croire que tous les paysans sont heureux.
En réalité l’évolution économique et industrielle a été moins rapide à la campagne qu’à la ville et si le propriétaire a bénéficié du désaxage créé par la guerre de 1914, la situation du travailleur des champs, de celui qui, ne possédant rien, est obligé de louer ses bras pour assurer sa pitance, ne s’est guère améliorée, au contraire.
L’ouvrier de la terre est encore courbé sous un régime qui rappelle la féodalité et les difficultés qu’il rencontre pour s’organiser rendent plus ardue la lutte pour son émancipation. En vertu de la centralisation qui s’opère à la campagne comme à la ville, le petit paysan devient la proie du gros propriétaire, et grossit les rangs des ouvriers ne possédant rien. Convaincus qu’ils n’arriveront jamais à conquérir leur indépendance et qu’ils ne peuvent, en travaillant, arriver à se libérer, ils préfèrent abandonner un travail fatigant et peu rémunérateur, et c’est ce qui explique la surpopulation des cités et le dépeuplement des campagnes.
Cette situation présente un réel danger, car en venant s’ajouter à la population des cités, la population immigrante se jette sur le marché du travail et les maîtres de l’industrie profitent de cette concurrence que se font deux catégories de travailleurs également exploités par le même capitalisme. Pour lutter contre cet état de chose, il est indispensable que les relations plus étroites soient nouées entre 1es travailleurs des champs et ceux des villes. Il est d’une nécessité urgente que l’ouvrier de l’industrie fasse comprendre à son frère de la campagne, que les mensonges colportés par les agents de la bourgeoisie ont pour unique but de diviser la classe ouvrière dans son ensemble et d’arrêter son mouvement d’émancipation. Et c’est d’autant plus urgent que la révolution, unique moyen de libération sociale ne peut être efficace que par l’étroite collaboration du travailleur des villes et de celui de la campagne, et que, au lendemain d’un mouvement catastrophique, le ravitaillement des cités est subordonné au degré d’évolution du prolétariat de la terre.
Nous pensons que sur cette question les organisations syndicales et d’avant-garde ont un rôle tout tracé et qu’une intense propagande doit être, faite afin d’arrêter le dépeuplement de la campagne qui détermine de grosses difficultés pour le présent et une réelle menace pour l’avenir.
DEPOPULATION
n. f
La bourgeoisie de certains pays se désole en constatant que si le chiffre de la population ne diminue pas, il n’augmente pas cependant dans des proportions normales et naturelles et elle craint que, cet état de choses se généralisant, elle ne soit pas en mesure de trouver demain sur le marché le matériel humain indispensable à ses désirs d’impérialisme et de domination mondiale.
On a dit que la dépopulation était déterminée par la guerre, la famine et les épidémies. Cela est incontestable mais pourtant ces fléaux ne sont eux-mêmes que des effets dont il faut rechercher les causes et c’est ce que nous allons faire sans aucun esprit démagogique et en nous appuyant sur des chiffres d’une netteté qui, nous l’espérons, feront réfléchir les plus fidèles défenseurs de l’ordre bourgeois.
La cause première qui engendre la dépopulation est le capitalisme, qui, par ses accaparements, par son exploitation et la mauvaise répartition des richesses sociales, détermine la misère et par extension toutes les maladies, toutes les épidémies qui, à leur tour, provoquent dans les populations ayant atteint un certain degré de civilisation, un arrêt de la procréation. Nous savons qu’en France par exemple il meurt chaque année environ cent mille individus de la tuberculose, et nous savons également que la tuberculose n’étend ses ravages que dans les classes productrices qui sont contraintes de vivre dans des conditions d’hygiène détestable et qui n’ont pas leur suffisance de nourriture. Or, comment s’étonner que les classes pauvres se refusent à faire des enfants alors qu’elles savent que ces malheureux seront condamnés à mort par le capitalisme, et que s’ils échappent à la maladie, la guerre se chargera de les arracher à la vie.
Certains économistes prétendent que le bien-être économique du peuple n’est pas arrêté par l’ordre capitaliste et que bien au contraire les formes économiques et politiques modernes sont les plus susceptibles d’assurer à chacun le maximum de ce qui lui revient en raison de la production mondiale. Nous disons, nous, que si le peuple refuse de produire, de faire des enfants — et le « mal » n’ira qu’en s’accentuant, car aucune loi ne peut obliger des humains à procréer — c’est que le capitalisme, pour satisfaire ses ambitions et ses besoins, ne livre à la consommation qu’une partie de la production mondiale et que, si la répartition des vivres se faisait de façon normale et logique, nous n’assisterions pas au spectacle dégradant, pour une société, de la misère affreuse s’étalant à côté de la richesse et du superflu.
Nous allons essayer de démontrer par des chiffres que la population du monde aurait la possibilité de satisfaire tous ses besoins naturels si l’accaparement du capitalisme ne s’exerçait pas dans toutes les branches de l’activité économique.
La population de la terre, c’est-à-dire des cinq parties du monde, se chiffre par environ 1.750.000.000 (un milliard sept cent cinquante millions d’habitants) ; or, parmi cette population il en est une partie qui meurt littéralement de faim et qui est périodiquement victime des famines qui sévissent en certaines contrées. Cependant la production totale de ce qui est indispensable à la vie des hommes est supérieure à ce qu’ils pourraient consommer.
Durant la dernière décade, c’est-à-dire d’après les statistiques élaborées pour les années comprises entre 1915 et 1925, la production annuelle mondiale de céréales fut la suivante par tête d’habitant :
-
Blé …………… 720 kilogrammes
-
Avoine ………… 360
-
Orge …………… 250
-
Seigle ………… 250
-
Maïs …………… 700
-
Riz …………… 1.100
-
Pommes de terre … 800
En conséquence, si nous faisons le total, nous constaterons que chaque habitant de la terre pourrait se permettre de consommer 4.180 kilogrammes (quatre mille cent quatre-vingt kilogrammes) de céréales par année, c’est-à-dire une moyenne de 11 kilos par jour.
Il est évident que sur cette production de la terre, il faut nourrir le bétail qui se répartit comme suit :
-
Chevaux … 100 millions
-
Bœufs …… 550
-
Moutons …… 500
-
Chèvres …… 120
-
Porcs ……… 210
-
Total ……… 1.480 millions
Mais si l’on considère que ce cheptel, exception faite du cheval, est, à son tour, livré à la consommation, nous ne croyons pas nous tromper en affirmant comme nous le faisons plus haut que céréales ou viande, la population mondiale a la possibilité de consommer une somme de 11 kilos de nourriture par jour et par tête. Nous ferons remarquer en passant qu’à part la pomme de terre, nous ne faisons pas état de tous les légumes et fruits qui sont récoltés de par le monde et alors se pose cette question : comment se fait-il que le peuple n’arrive pas à satisfaire ses besoins les plus élémentaires ? Aussi criminel que cela puisse sembler, le capitalisme préfère laisser des populations crever littéralement de faim que de livrer la production de la terre à la consommation. Pour maintenir des prix élevés, chaque année, des millions et des millions de quintaux de matières comestibles sont jetés, brûlés, cependant que des populations entières vivent dans la pauvreté la plus médiocre et dans l’insuffisance la plus tragique. C’est terrible et incroyable, mais c’est pourtant ainsi. Les voilà les raisons de la dépopulation, que semblent ignorer les repopulateurs qui crient au scandale parce que le peuple ne veut plus faire d’enfants. Considérant les chiffres incontestables que nous énonçons plus haut, la bourgeoisie n’est-elle pas la première responsable de la dépopulation ?
Le Docteur Georges Drysdale dans son étude sur « La Pauvreté », reprenant l’affirmation de Malthus que « la population, quand elle n’est pas entravée, s’accroît dans une progression géométrique telle qu’elle se double tous les vingt-cinq ans », et que les moyens de subsistance ne peuvent pas s’accroître dans les mêmes proportions, cherche à démontrer dans son ouvrage que « la population est nécessairement limitée par les moyens de subsistance » et que « c’est donc une immense erreur de supposer, comme on le fait d’habitude, que les guerres, les famines, les pestes, etc., que l’histoire nous énumère, ont surtout été provoquées par les mauvaises passions des hommes ou par l’absence d’habileté industrielle. Elles résultaient principalement des instincts sexuels, et étaient absolument inévitables, puisque ces instincts n’étaient pas contenus par la prévoyance. Il naissait plus d’enfants que le lent accroissement des moyens de subsistance ne pouvait en maintenir ; ainsi il fallait qu’ils disparussent d’une manière quelconque » (Georges Drysdale, La Pauvreté, p. 33).
Nous n’avons pas ici l’intention d’étudier le malthusianisme et le néo-malthusianisme qui seront traités plus loin (voir ces mots), mais les affirmations du Dr Drysdale nous semblent basées sur une erreur fondamentale. Les guerres ne sont nullement provoquées par la surpopulation du globe ou d’une de ses parties mais simplement par le désordre social consécutif à la mauvaise gérance d’une classe qui méconnaît ou continue sciemment à méconnaître les besoins collectifs et à les sacrifier à ses intérêts particuliers. Même en acceptant aveuglément ce principe malthusien que « la population quand elle n’est pas entravée, s’accroit dans une proportion géométrique telle qu’elle se double en vingt-cinq ans », le danger de la surpopulation n’est pas une menace immédiate, car les 140 millions de kilomètres carrés des continents peuvent être habités par une population dix fois supérieure à celle d’aujourd’hui ; ce qui ne ferait en réalité que 120 habitants par kilomètre carré et parce que la production actuelle de la terre, si elle était bien répartie, suffirait presque à nourrir cette population. Notons en passant que, par kilomètre carré, la population de la France est de 71 ; celle de l’Allemagne de 128 ; celle de la Belgique de 245 ; celle du Royaume-Uni de 188 ; celle de l’Italie de 124 ; celle du Japon de 187. Le capitalisme qui a entre les mains les rênes de l’économie mondiale, s’inquiète peu de l’avenir et ne cherche pas à savoir, lorsqu’il agit, si son action sera favorable ou désavantageuse aux générations futures. Il travaille en raison de ses aspirations immédiates et cela est tellement vrai que loin d’être inquiété par le problème de la surpopulation dans l’avenir, il s’inquiète de la dépopulation dans le présent.
La question de la population ne peut donc être pour le travailleur qui y est le plus particulièrement intéressé, un problème d’avenir, mais un problème d’une réalité brutale qu’il a le devoir d’étudier et de résoudre.
Pour les classes opprimées, ce n’est pas la surpopulation qui détermine l’arrêt dans la procréation, car, obligées de se livrer chaque jour aux difficultés de la vie, elles restent ignorantes des grands problèmes sociaux de l’avenir. Mais ce que les travailleurs n’ignorent pas, ce sont les charges terribles qu’occasionne 1a naissance d’un petit être, c’est l’esclavage qui en résulte, et la crainte de ne pouvoir satisfaire aux besoins les plus élémentaires d’une nouvelle bouche. Un enfant dans le foyer plébéien, mais c’est le salaire de la semaine qui se divise en trois ; c’est l’abandon de l’atelier ou du bureau par la maman ; en un mot c’est l’augmentation des charges et la diminution des possibilités de vie. Or, le peuple demande à vivre maintenant. Lui aussi s’éduque chaque jour un peu plus au grand livre de l’Histoire et il en a assez de l’esclavage qu’il subit depuis des siècles et des siècles ; il aspire à un peu de joie, de bonheur et de liberté. Les joies familiales lui sont refusées puisque, pour le travailleur, la famille n’est qu’une source de larmes ; alors, il cherche ailleurs et il constate que la science lui a donné le moyen d’amoindrir sa détresse ; qui donc ira le lui reprocher ? Aucune loi au monde, nous le répétons, ne peut contraindre à procréer ; il est donc inutile à la bourgeoisie de se lamenter sur un état de choses qu’elle a créé, qu’elle a voulu, qu’elle a cherché, en refusant à chacun la possibilité de se nourrir et de vivre humainement.
Pour son expansion, le capitalisme a besoin présentement d’une augmentation de la population dans certaines parties du globe ; mais l’humanité qui souffre aujourd’hui des ravages occasionnés par l’intérêt du capitalisme, refuse de se livrer à une prolification désordonnée. En agissant ainsi, le peuple travaille non seulement pour le présent mais il travaille aussi inconsciemment pour l’avenir, puisque, de cette façon, il écarte le danger de la surpopulation qui pourrait être fatale à l’humanité. Il remplit donc son rôle historique et c’est bien. Demain, lorsque les nuages se seront effacés, et que le peuple libéré des entraves qui le maintiennent dans un demi-esclavage pourra en pleine quiétude envisager l’avenir, il se penchera alors sur le brûlant problème de la « population », et la science aidant il triomphera de tous les obstacles.
DEPUTE
Celui qui est chargé d’une députation ; qui remplit une mission au nom d’une nation ou d’un souverain.
Dans le langage courant, on désigne sous le nom de député le personnage chargé de représenter le peuple aux Assemblées législatives. En France il y a deux Chambres législatives : la Chambre des députés et le Sénat. On appelle députés ceux des membres qui siègent à la première et sénateurs ceux qui siègent à la seconde.
La Chambre des députés se renouvelle tous les quatre ans ; pour être éligible, il faut être Français et avoir 25 ans d’âge. Chaque département nomme autant de députés qu’il a de fois 75.000 habitants, il y a donc en France 626 députés dont 24 pour l’Alsace et la Lorraine. Les députés touchent un traitement de 45.000 francs par an, mais nous verrons plus loin que ce salaire n’est pas le plus clair de leurs ressources et que la place ne manque pas d’être avantageuse. La personne d’un député est inviolable. Aucun membre de l’une ou l’autre Chambre législative, c’est-à-dire député ou sénateur, ne peut être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle pendant la durée de la session parlementaire. Seule, l’Assemblée peut permettre les poursuites par la levée de l’immunité parlementaire, mais elle ne le fait que pour des raisons exceptionnelles et très rarement.
En vertu des lois démocratiques, chacun a le droit d’être député, il suffit, pour cela, ainsi que nous le disons plus haut, d’être Français et d’avoir 25 ans d’âge ; il semblerait donc que le député est le fidèle représentant du peuple et qu’il défende, ainsi qu’il en est chargé, les intérêts de ses électeurs. Le peuple a cette croyance naïve ; et les batailles électorales sont chaudes et parfois violentes, lorsqu’il s’agit de réélire ou d’élire les candidats qui se présentent. La place est recherchée, cela se conçoit, et l’électeur naïf qui ne connaît de la politique que son côté superficiel se dispute, espérant que son candidat — qui ne peut être que le meilleur- triomphera des adversaires et qu’ainsi sortira victorieuse la politique qui lui paraît susceptible d’améliorer son sort. Pas une minute l’électeur ne suppose que le candidat puisse être un charlatan qui se moque de lui et se fiche de son bien-être et de sa liberté ; pas une minute il ne doute de sa sincérité et de son dévouement. A ses yeux, son candidat est un être sublime qui se dévoue à une cause et qui sacrifie ses propres intérêts pour soutenir et défendre ceux de ses semblables, et l’électeur se prosterne devant tant d’abnégation.
Car en effet si l’on considère la façon dont le député se présente à l’électeur, il faut reconnaître que cette fonction est pour celui qui en est chargé une source d’ennuis et de tracas. Le député, avons-nous dit, est élu pour quatre ans et touche annuellement un salaire de 45.000 Fr., ce qui fait pour une législature 180.000 francs. Cela peut paraître excessif, mais l’électeur s’est-il jamais posé cette question : à savoir combien coûte une élection ? Probablement non ; car l’électeur ne pénètre pas dans le fonds de la politique et ne s’arrête qu’à la surface. Or, une élection est une bataille, et une bataille qui ne se livre pas à coup de fusils mais à coup de publicité, de propagande ; et cette bataille coûte cher. Pour réussir dans sa tentative, le candidat doit s’attacher la presse, inonder les murs d’affiches, payer des propagandistes qui travaillent le collège électoral, et cela ne se fait pas sans argent. Au bas mot, on peut dire que, de nos jours, une élection coûte au moins 100.000 Fr. Faut-il encore les posséder, car celui qui ne peut répondre à toutes les exigences publicitaires peut être certain d’être submergé par ses adversaires et en conséquence arriver bon dernier. Il ne suffit donc pas, ainsi que cela semble, pour décrocher un mandat, d’être Français et d’avoir 25 ans d’âge, mais pour être juste il faut ajouter, qu’il est indispensable de posséder 100.000 francs. Nous voyons donc que sur les 190.000 francs que touche un député, il ne lui en reste plus que 90.000, et encore nous supposons que le candidat fut élu, sinon il a purement et simplement perdu 100.000 francs. Et voilà pourquoi le peuple s’imagine que son député est un homme sincère et dévoué, car, aussi désintéressé soit-on, il est peu d’individus qui soient prêts à risquer 100.000 francs pour en gagner 90.000. Mais ce que le peuple ignore, c’est que la plupart dés candidats sont patronnés par de grosses firmes industrielles et de grosses entreprises financières qui ont la faculté de jeter tout l’argent nécessaire dans la bataille, et que, une élection étant une bataille d’argent, lesdits candidats sortent toujours victorieux. Et de cette façon la finance et l’industrie ont à la Chambre des députés leur représentant direct. Ce que le peuple ne veut pas comprendre, c’est que le député n’est pas un agent politique chargé de défendre ses intérêts mais un agent commercial qui a une mission à remplir auprès des gouvernants et que cette mission consiste à arracher à l’Etat le plus possible en faveur des établissements qui l’ont placé là.
L’Etat est un gros acheteur ; il dépense chaque année plusieurs milliards et chacun est avide de recevoir du Gouvernement une commande. Qui, mieux qu’un député, est capable d’arracher un ordre ou de provoquer un achat ? Qui, mieux qu’un député, surtout s’il est représentant d’une grande firme d’aviation, peut pousser le Gouvernement à l’armement aérien ? Il a l’air de remplir une œuvre patriotique et nationale, alors qu’en réalité il ne cherche qu’à remplir ses poches, Dans toutes les branches de la grosse industrie et de la haute finance il y a, à la Chambre, des députés qu’on a surnommés les députés d’affaires et qui forment la majorité de l’Assemblée. S’il se trouve, par hasard, parmi ces hommes, une brebis qui ne soit pas galeuse, et qui ne veuille pas se laisser contaminer, elle est bien vite écrasée par l’entourage.
Faut-il voter une loi sociale, quelque chose qui puisse être avantageux à la classe opprimée ? Immédiatement se dresse toute la clique de ces hommes de paille, qui, en chiens de garde de la bourgeoisie et du capital, s’élèvent contre les mesures envisagées, et la loi retourne dans les cartons poussiéreux des ministères, d’où elle ne sort plus jamais.
Voilà le rôle du député, qu’il remplit du reste à merveille. Nous avons dit d’autre part que la démocratie était le dernier rempart de la bourgeoisie, le député en est le fidèle soldat, et c’est un soldat qui ne livre pas bataille franchement, loyalement, mais qui use de fourberie, de mensonges et de trahison.
Quel plus bel exemple peut-il être donné des qualités morales d’un député que les élections législatives de 1924 qui feront époque dans les annales de la démocratie ? Deux ans à peine après les dites élections, les élus trahissaient leurs électeurs et fléchissaient le genou devant l’homme sur lequel pèse une grande part de responsabilité de la guerre de 1914. Combien d’exemples semblables pourrait-on citer à l’actif des députés ! Et cela ne suffit pas au peuple.
Il y avait, dit J.-M. Guyau, « une femme dont l’innocente folie était de se croire fiancée et à la veille de ses noces, le matin en s’éveillant, elle demandait une robe blanche, une couronne de mariée, et souriante, se parait. « C’est aujourd’hui qu’il va venir », disait-elle. Le soir la tristesse la prenait, après l’attente vaine ; elle ôtait alors sa robe blanche. Mais le lendemain, avec l’aube, sa confiance revenait : « C’est pour aujourd’hui disait-elle ». Et elle passait sa vie dans cette certitude toujours déçue, et toujours vivace, n’ôtant que pour la remettre sa robe d’espérance ».
Le peuple n’est-il pas atteint de cette même folie, plus dangereuse, hélas!, car ses espérances toujours déçues, perpétuent son esclavage et engendrent souvent des catastrophes ? Il continue, malgré l’expérience du passé, à se laisser griser de mensonge, et après avoir été trompé par les blancs il se laisse tromper par les rouges, espérant encore et toujours trouver l’homme ou plutôt le Dieu qui l’arrachera à son sort misérable. Il ne veut pas comprendre que cet homme n’existe pas que personne ne peut le sortir de son esclavage et que « l’émancipation des travailleurs ne sera l’œuvre que du travailleur lui-même ».
Il vote, espérant trouver là le salut. Tout ce que l’on peut dire a été dit sur le député et sur l’électeur, et nous ne pourrions mieux faire que de citer la conclusion du vigoureux pamphlet de Octave Mirbeau à ce sujet.
« A quel sentiment baroque, à quelle mystérieuse suggestion peut bien obéir ce bipède pensant, doué d’une volonté à ce qu’on prétend, et qui s’en va, fier de son droit, assuré qu’il accomplit un devoir, déposer dans une boîte électorale quelconque un quelconque bulletin, peu importe le nom qu’il ait écrit dessus ? ... Qu’est-ce qu’il doit bien se dire, en dedans de soi qui justifie ou seulement qui explique cet acte extravagant ? Qu’est-ce qu’il espère ? Car enfin, pour consentir à se donner des maitres avides qui le jugent et qui l’assomment, il faut qu’il se dise qu’il espère quelque chose d’extraordinaire que nous ne soupçonnons pas. Il faut que par de puissantes déviations cérébrales, les idées de député correspondent en lui à des idées de science, de justice, de dévouement, de travail et de probité.
« Rien ne lui sert de leçon, ni les comédies les plus burlesques, ni les plus sinistres tragédies.
« Voilà pourtant de longs siècles que le monde dure, que les sociétés se déroulent et se succèdent, pareilles les unes aux autres, qu’un fait unique domine toutes les histoires : la protection aux grands, l’écrasement aux petits. Il ne peut arriver à comprendre, qu’il n’a qu’une raison d’être historique, c’est de payer pour un tas de choses dont il ne jouira jamais et de mourir pour des combinaisons politiques qui ne le regardent point.
« Que lui importe que ce soit Pierre ou Jean qui lui demande son argent et qui lui prenne sa vie, puisqu’il est obligé de se dépouiller de l’un et de donner l’autre ? Eh bien non ! Entre ses voleurs et ses bourreaux, il a des préférences, et il vote pour les plus rapaces et les plus féroces. Il a voté hier, il votera demain, il votera toujours. Les moutons vont à l’abattoir. Ils ne disent rien, eux, et ils n’espèrent rien. Mais du moins ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera et pour le bourgeois qui les mangera. Plus bête que les bêles, plus moutonnier que les moutons, l’électeur nomme son boucher et choisit son bourgeois. Il a fait des révolutions pour acquérir ce droit » (Octave MIRBEAU. La Grève des Electeurs).
Et il n’y a rien à ajouter.
DESARMEMENT
n. m.
« Action de désarmer, de réduire ou de supprimer ses forces militaires », telle est la définition la plus courante du mot désarmement.
Pour nous, qui n’envisageons pas les choses et les faits de la même façon, et qui les considérons sous un angle différent, le désarmement ne peut être à nos yeux, partiel et consister en une réduction quelconque des forces militaires, mais doit, pour être effectif, entraîner la suppression totale de ces forces. Durant les années qui suivirent la signature des divers traités de « paix », mettant fin à la guerre de 1914–1918, de nombreuses conférences officielles furent organisées, et autour du tapis vert de la diplomatie, les représentants de toutes les grandes nations du monde, étudièrent ou firent semblant d’étudier le problème du désarmement. Un accord fut conclu déterminant la limite d’armements dans laquelle devaient se maintenir les nations contractantes, et on alla même jusqu’à détruire de vieilles unités maritimes, donnant ainsi au peuple l’illusion que quelque chose était fait pour le maintien de la paix mondiale. Or, il est erroné de penser, qu’une limitation, qu’une réduction des armements soit un facteur de paix et il serait faux de croire que dans les hautes sphères gouvernementales, on soit animé par le désir d’amoindrir les forces militaires des différentes nations du monde. La vérité brutale est que chaque nation est entraînée dans un formidable tourbillon créé par la guerre de 1914 et que la paix est menacée par l’intensification perpétuelle des armements. Du reste, mieux que toutes paroles, les chiffres nous fixeront nettement sur la situation respective de certaines nations et des dépenses qu’elles effectuent pour maintenir et augmenter leur puissance militaire.
Dépenses pour la « Défense Nationale » en milliers de dollars
| ANGLETERRE | 1913–14 | 1924–25 |
| Armée | 203.233 |
| Armée et Aviation | 171.468 |
| Aviation | 64.967 |
| Marine | 247.489 | 252.537 |
| Colonies | 22.019 |
| Dépenses militaires incorporées au budget civil | 11.124 |
| Total | 418.957 | 553.880 |
| INDES | **1913–14 | 1924–25 |
| Armée et Aviation | 96.769 | 191.007 |
| Marine | 2.508 | 3.025 |
| Ouvrages militaires | 4.713 | 13.873 |
| Total | 103.990 | 207.905 |
| ETATS-UNIS | 1913–14 | 1924–25 |
| Département de la Guerre | 112.485 | 340.554 |
| Département de la Marine | 114.869 | 277.208 |
| Total | 257.354 | 617.762 |
| JAPON | 1913–14 | 1924–25 |
| Armée | 46.276 | 80.727 |
| Marine | 47.258 | 96.087 |
| Total | 98.534 | 176.814 |
| ITALIE | 1913–14 | 1924–25 |
| Marine Militaire et Aviation | 116.947 | 11.837 |
| Marine Marchande | 49.344 | 38.832 |
| Colonies, dépenses militaires | 1.881 | 8.459 |
| Total | 178.173 | 159.149 |
| BELGIQUE | 1913–14 | 1924–25 |
| Budget ordinaire | 14.345 | 25.522 |
| Budget extraordinaire | 2.354 | 3.538 |
| Total | 16.699 | 29.060 |
Quant à la France, son budget de la guerre qui’ était en 1914 de 1.720 millions de francs, s’est élevé, en 1925, à 5.521 millions, auxquels il faut ajouter : 1.252 millions pour les dépenses du Ministère de la Marine.
Voilà donc ce qu’entendent par « désarmement » les hommes qui président aux destinées du monde. Une fois de plus les peuples se laissent berner par leurs dirigeants et reposent tranquilles sans s’apercevoir que le réveil sera brutal et que les mots de désarmement ne sont prononcés que pour cacher l’armature d’acier dont s’entourent les différents capitalismes internationaux.
Nous avons tracé un tableau comparatif des dépenses militaires, de différentes nations en 1914 et en 1925, et l’on pourrait nous objecter que, la valeur de l’argent ayant diminué et que celle des matériaux n’étant pas la même en 1914 qu’en 1925, il ne s’en suit pas que ce surplus de dépenses ait déterminé une intensification des armements.
S’il est vrai en effet que la dépréciation de la monnaie joue un rôle dans les dépenses formidables occasionnée par la course aux armements, il est utile de faire remarquer que l’armement s’est modernisé et que si l’on étudiait le problème superficiellement on serait également tenté de croire qu’un progrès immense s’est réalisé et que le désarmement s’opère lentement, mais progressivement. En effet, pour la France par exemple, le nombre d’officiers qui était de 32.392 en 1913, n’était plus en 1926 que de 31.622 et celui des soldats était descendu de 870.000 en 1924 à 640.000 en 1926.
Mais nous savons que les hommes, de même que les fusils et les canons, ne joueront qu’un rôle effacé, secondaire, dans les guerres futures, et qu’en conséquence, les dirigeants peuvent sans crainte sacrifier quelques cent mille hommes inutiles, et faire refondre quelques centaines de canons, sans pour cela désarmer. Ils donnent au peuple, en accomplissant ces actes, l’illusion du désarmement, et celui-ci se contente de cet artifice pendant que, dans l’ombre, on organise l’aviation et l’on fabrique des gaz qui sont les véritables armements modernes.
Voici, du reste, un document officiel, émanant de la Société des Nations, qui nous initie pleinement sur le désarmement des grandes nations et sur 1es procédés susceptibles d’être pratiqués au cours d’une guerre :
« Mais on peut concevoir dans l’avenir d’autres procédés tels que le lancement par avions de bombes ou autres récipients, chargés en produits nocifs, qui atteindraient les populations civiles aussi sûrement que les combattants. « Il est douteux, écrit le professeur André Mayer, que les peuples se rendent compte de la puissance de cette arme et du danger auquel elle les expose » ; et le professeur W. B. Canon, va plus loin encore, lorsqu’il déclare que : « Nous n’avons rien vu au cours de la dernière guerre, qui soit comparable aux perspectives probables de destruction des centres industriels et de massacres de populations civiles, au cas où un nouveau conflit important viendrait à se produire », « L’arme chimique, employée pendant la dernière guerre avec une intensité croissante ct une efficacité indiscutable produit des effets physiologiques les plus divers. « Il n’y a pas plus de limites concevables à sa puissance, à son efficacité, à sa diversité, qu’il n’y en a à la pharmacologie ou à n’importe quelle branche de la chimie ».
« Les substances nocives employées étant d’un usage courant en temps de paix, l’arme chimique est à la disposition de toute grande puissance industrielle possédant des usines chimiques, et cette constatation suggère aux professeurs Zanetti et Mayer, les conclusions suivantes extraites de leurs rapports :
« L’extrême facilité avec laquelle, nous dit le professeur Zanetti, ces usines peuvent être transformées, presque en une nuit, en fabriques de matériel destiné à la guerre chimique, fait naître un sentiment de crainte et de défiance vis-à-vis d’un voisin disposant d’une organisation chimique puissante. »
« Elle assure, en effet, à une puissance animée de mauvais desseins, une supériorité immense, observe à son tour le professeur Mayer. Un corps nocif, étudié en secret « et cette étude peut se faire n’importe où » fabriqué en grande quantité (et cette fabrication peut être faite dans n’importe qu’elle usine chimique), jeté par surprise sur une population non préparée, peut briser toute velléité de résistance. »
Du point de vue technique, il ne semble pas qu’il y ait une impossibilité à ce que les grandes cités soient attaquées au moyen de gaz toxiques par la voie des airs ou par les armes à portée de plus en plus longue existant dans l’armement des forces militaires et navales modernes. Il y a, au contraire, des raisons de croire que, dans une guerre future, l’armée aérienne sera beaucoup plus développée que dans la dernière guerre, tant au point de vue du nombre des avions que de leur capacité de transport.
« Quelque condamnable que soit une telle action, il n’y aurait pas de difficultés techniques à ce que les bombes de grande dimension, remplies de gaz toxique, soient jetées sur des centres indispensables à la vie politique ou économique du pays ennemi.
« Le gaz utilisé ne serait pas nécessairement à effet temporaire, puisque le but consisterait à gêner ou détruire le centre d’activité qui serait l’objectif de l’attaque. Le gaz moutarde, par exemple déversé en forte quantité sur de grandes villes, resterait probablement pendant longtemps sur le sol et pénètrerait graduellement dans les maisons.
« Il faut espérer qu’on trouvera un moyen efficace de protéger les populations civiles contre de tels dangers, mais Il faut admettre que le problème est difficile. La fourniture de masques à une population entière semble être presque impraticable et il reste encore à prouver que les méthodes de protection collective soient efficaces.
« En l’absence de ces moyens et sans indications préalables sur le point d’attaque, toute protection complète est impossible. De plus, les gaz toxiques lourds demeurent près du sol, même en pleine campagne pendant un temps très long. Dans une ville, il est difficile de dire le temps pendant lequel ils resteraient et persisteraient à constituer un danger.
« On pourrait dire sans doute qu’un tel développement de la guerre serait trop odieux et que la conscience humaine se révolterait contre de pareilles pratiques.
« Cela est possible, mais étant donné que, dans les guerres modernes telles que la dernière, toute la population d’un pays se trouve plus ou moins directement engagée, il est à craindre que des belligérants peu scrupuleux ne fassent pas de différence entre l’usage de gaz toxiques contre les troupes sur le champ de bataille et l’usage de ces gaz contre les centres qui fournissent à ces troupes les moyens de se battre.
« En conclusion : constatant, d’une part, les applications de plus en plus nombreuses et variées de la science à la guerre, observant d’autre part, que le véritable danger,- danger de mort — pour une nation serait de s’endormir confiante en des conventions internationales, pour se réveiller sans protection contre une arme nouvelle, il paraît à la Commission essentiel que les peuples sachent quelle terrible menace est ainsi suspendue sur eux ».
Nous avons tenu à reproduire ce texte en son entier, car il est, dans son ensemble, non seulement un avertissement pour les peuples, mais aussi une preuve de l’impuissance dans laquelle se trouve, en 1927, cette fameuse Société des Nations, à écarter les conflits entre nations. Et de plus cet exposé nous éclaire lumineusement sur le désarmement. On comprend pourquoi certaines grandes nations ne se refusent pas à réduire leurs effectifs militaires, à détruire certaines vieilles unités navales, ne se trouvant plus en rapport avec 1es besoins de la guerre moderne, tout en s’organisant puissamment dans l’attente de nouvelles hécatombes.
« L’extrême facilité », dit le rapport que nous reproduisons « avec laquelle les usines peuvent être transformées, presque en une nuit, en fabrique de matériel destiné à la guerre chimique fait naitre un sentiment de crainte ». Il est évident que cela complique sensiblement le problème du désarmement, que telle puissance peut paraître très faible si l’on considère le nombre de ses troupes, de ses canons, de ses navires, et être très forte au point de vue chimique.
Et, bien que, dans les cercles officiels, on parle, pour le peuple, de désarmement, il est notoire que chaque puissance du monde envisage dès à présent l’utilisation des gaz nocifs dans la guerre qui vient et cela est tellement vrai que, le 26 juillet 1926, le journal Paris-Soir publiait ce petit entrefilet suggestif malgré sa brièveté :
« Londres, 26 juillet. — Demain M. C. G. Ammon parlera à la Chambre des Communes de la guerre aérienne.
« Il demandera au gouvernement de voter une loi rendant obligatoire la possession d’un masque à gaz. »
Cette mesure est indispensable, a déclaré dans son rapport l’auteur de cette interpellation, car en cas de guerre, d’un moment à l’autre, une ville peut être anéantie par des gaz lancés par avions.
« En créant cette obligation du masque, les municipalités, à des périodes fixes, — trois ou quatre fois par an — feront passer les populations dans des chambres à gaz afin de leur bien apprendre à s’en servir. » (Paris-Soir)
Ce n’est donc pas sans raison qu’au début du mois d’août 1926, Han Ryner lançait ce manifeste à la population, afin de l’éclairer sur les dangers qui la menacent.
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » écrit Rabelais. Mais la science a progressé depuis et si la conscience ne se réveille pas en l’homme la science ne ruinera pas seulement l’âme.
« Si l’homme reste assez vil pour laisser faire les gouvernements, et pour obéir à ceux qui ont assez peu de conscience pour se prétendre des chefs ; s’il reste l’être discipliné qui se laisse mener en troupeaux et en armées, c’est l’humanité même qui, grâce à la science, fera hara-kiri.
« Et voici, d’après le National Zeitung de Bâle, comment le grand suicide du genre humain risque de commencer :
La guerre vient brusquement d’être déclarée. Aucune difficulté urgente, insoluble, ne semblait la rendre imminente. Au contraire, les dernières nouvelles étaient plutôt rassurantes.
La condamnation à mort de l’Europe n’est connue du Gouvernement que depuis cinq minutes. La presse n’en sait encore rien, le public non plus.
Les rues sont remplies d’une foule anxieuse excitée mais qui ne se doute rien.
Tout à coup, une odeur de violette, d’abord légère, puis insupportable, envahit les rues et les places. Déjà l’air n’est plus respirable.
Qui ne réussit pas à s’enfuir à temps — et bien peu y réussissent — devient rapidement aveugle, perd connaissance, s’effondre sur le sol et étouffe.
Le ciel est parfaitement serein, bleu, sans nuages
Aucun avion en vue.
Cependant, à quatre ou cinq mille mètres au-dessus du sol, hors de la portée de la vue et de l’ouïe, une escadrille évolue, sans pilote, sous l’action d’ondes hertziennes, et laisse couler sur le sol sa charge de gaz lacrymogène (le gaz le plus « humain ») ou de lewisite, moins agréable déjà, ou même de bichlorure d’éthyle sulfuré, le gaz moutarde, roi des poisons,
La guerre des gaz a commencé. L’action du gaz moutarde, dernier cri de la technique moderne, ne saurait être décrite en termes trop atroces. Des dix-sept espèces de gaz utilisés jusqu’ici avec succès, c’est de beaucoup la plus parfaite. C’est la mort même.
Aucun masque ne protège contre lui. Il ronge les chairs. Lorsqu’une région a été saturée par le gaz, chaque pas, chaque poignée de porte, chaque couteau à faire reste pendant des mois mortels.
Les aliments ne peuvent plus être consommés. L’eau est empoisonnée. Toute vie se trouve anéantie.
Encore deux ou trois guerres utilisant de tels progrès et il ne restera plus personne pour dire : « Je n’ai pas voulu cela ». (HAN RYNER)
Est-il besoin d’ajouter quoi que ce soit ? Il est évident, indéniable, que l’armement moderne, plus terrible que celui qui l’a précédé est une menace pour l’humanité et que le monde va à la ruine si les peuples ne se réveillent pas de leur torpeur. Certains prétendent que la guerre serait trop monstrueuse et qu’aucun homme d’Etat ne prendrait sur lui la lourde responsabilité de la déclencher ; Raisonner ainsi, c’est se prêter volontairement comme « agneau pascal » et se faire indirectement un agent de destruction. Déjà en 1914, cet argument courait de bouche en bouche, et pourtant la guerre éclata et durant quatre ans et demi, ce ne furent que massacres et que ruines. Il en sera de même demain, et rien ne peut empêcher que cela soit, sinon la volonté des hommes, de ne pas se faire tuer dans un conflit d’intérêts divisant le capitalisme.
Le problème du désarmement reste entier. Il ne peut être résolu par les parlottes diplomatiques. C’est au peuple de le résoudre.
Le désarmement est intimement lié à d’autres questions et vouloir le traiter séparément est inutile. Le capital a besoin d’armements pour se défendre et l’utopie n’est pas d’espérer une société sans capital, mais justement de songer à réaliser une société capitaliste sans armements.
Nous avons, par ailleurs, tenté de démontrer quelles sont les origines des guerres (voir capitaliste et capitalisme), et nous restons convaincus qu’il n’est pas de remèdes dans l’ordre social actuel, susceptibles d’enrayer les conflits internationaux.
Et ce n’est pas une question d’hommes. Les hommes peuvent disparaître. Un conservateur peut, à la tête du gouvernement, être remplacé par un radical, un démocrate, voire un socialiste. Rien ne sera changé. Les dangers de guerre subsisteront tant que ne sera pas effondré le régime basé sur le capital. Ce qui est plus terrible, c’est que tout retard dans l’accomplissement d’une telle œuvre rend la tâche plus difficile. A mesure que nous avançons dans le temps, le capitalisme s’organise plus puissamment, et la faiblesse des classes opprimées s’agrandit également en raison directe de la force du capital. Demain il sera trop tard, les peuples seront réduits à l’esclavage et toute tentative de révolte deviendra inutile.
La révolution n’est pas seulement une question d’individus, elle est aussi et surtout une question d’événements, mais faut-il encore que les hommes sachent profiter de ces événements et ne pas les laisser passer en restant inactifs.
Au lendemain de la boucherie, lorsqu’en 1918 les hommes d’Etat des nations belligérantes furent obligés, faute d’hommes et d’argent, d’arrêter le massacre, le peuple avait entre les mains tous les outils nécessaires pour se libérer une fois pour toutes de tous ses maîtres, de tous ses parasites. Pendant quatre ans, il avait su se sacrifier pour une cause qui n’était pas la sienne, mais il n’eut pas le courage d’user de ses armes contre ses véritables ennemis. Il avait la possibilité d’organiser sur les ruines sanglantes de la guerre une société de bonheur et d’harmonie, il ne l’a pas voulu et i1 rendit ses armes avec la même inconscience qu’il les avait reçues.
Le capitalisme eut peur un moment. Mais aujourd’hui, tout danger immédiat étant écarté, il organise sa défense en usant d’armes d’élite, mises entre les mains d’individus lui appartenant et en qui il peut avoir toute confiance.
Il n’est pourtant pas possible que l’humanité se détruise ainsi. Si le capitalisme sent sa fin prochaine, il n’hésitera pas à tenter l’impossible pour entraîner avec lui toute l’humanité. « Périsse le monde entier » s’il ne doit pas vivre, lui. Voilà où nous en sommes, et notre conclusion est et reste toujours la même. Y en a-t-il une autre ? Nous ne le pensons pas.
Le capitalisme est un facteur de désagrégation, de destruction, et l’humanité a besoin d’être construite sur de nouvelles bases. L’autorité a fait ses preuves, et il a été démontré suffisamment, qu’elle n’engendre que la misère et la ruine. Que reste-t-il alors ? « La liberté. »
Remontons à la source, plongeons le scalpel dans l’origine du mal, et le désarmement s’opérera, dans le domaine physique et moral pour le plus grand bonheur de l’humanité régénérée.
- J. CHAZOFF.
DESARROI
n. m.
Désordre, confusion. Etre dans un grand désarroi, c’est-à-dire être troublé, ne pas savoir comment sortir d’une situation difficile. Depuis la guerre de 1914, les Etats du monde sont dans le désarroi et ne peuvent retrouver leur équilibre. Cela se conçoit facilement lorsque l’on n’est pas nourri au lait démocratique et que l’on considère les choses dont on est entouré avec un peu de logique et de raison. Ce sont les formes des sociétés modernes qui engendrent le désarroi social et malgré qu’au sens bourgeois on ait fait du mot anarchisme le synonyme de désordre, il semble bien que la réalité soit là pour démontrer que l’ordre n’est pas une des qualités des Sociétés bourgeoises. Le désarroi social est dû à la mauvaise gérance de la sociétédans laquelle, on ne le répétera jamais assez, les intérêts collectifs sont sacrifiés aux intérêts particuliers. Les sociétés modernes ne vivent que par la force de l’habitude, par la vitesse acquise, par la routine, et sitôt qu’un accident vient arrêter le cours normal de leur vie, elles sont désemparées et perdues. C’est que les fondations des sociétés capitalistes ne sont pas aussi solides qu’on se plait à l’affirmer. Les apparences sont trompeuses et on s’en rend compte parfois, lorsque l’on constate les tâtonnements des hommes qui ont la charge de diriger la vie publique et l’incertitude dans laquelle ils se trouvent.
Cependant la société capitaliste trouve de nombreux architectes qui cherchent à consolider les bases de la société bourgeoise afin d’en retarder l’écroulement. Il appartient aux hommes sensés et courageux d’avoir la vision nette et précise des nécessités sociales, et de profiter de ces périodes de désarroi intense pour empêcher que l’on rafistole la vieille bâtisse qui nous abrite si mal depuis des siècles. C’est dans le désarroi du capitalisme qu’il faut jeter les bases de la maison neuve que nous bâtirons demain.
DESASTRE
n. m.
Le désastre est un grand malheur, une calamité qui s’abat sur une population. Il y a des désastres devant lesquels l’homme est impuissant ; il ne peut que les enregistrer et chercher à en amoindrir les effets ; ce sont ceux d’ordre naturel tels les tremblements de terre, les éruptions volcaniques etc.... qui sont provoqués par des causes indépendantes de la volonté humaine. Il semblerait que ces calamités qui sont la source de tant de deuils ne sont pas suffisantes à l’humanité, et que celle-ci déchaîne des désastres comme par plaisir. Les guerres, les famines, sont des désastres que l’homme pourrait éviter et qui ne sont dus qu’à l’ambition, la lâcheté, l’ignorance et la bêtise des individus. Contre ces derniers nous pouvons beaucoup ; si, en notre vingtième siècle, nous assistons encore à de terribles catastrophes et si le monde est déchiré, c’est que l’esprit de fraternité n’a pas encore suffisamment pénétré l’individu, et que celui-ci n’est pas assez éduqué pour mettre fin aux désastres dont il est la victime mais dont il porte toute la responsabilité.
Il faut espérer que les progrès de la science permettront bientôt à l’homme de dompter la nature et d’enrayer ses méfaits et que l’éducation lui fera comprendre que l’entraide et la solidarité peuvent et doivent mettre un frein à la férocité de certains qui provoquent des désastres sociaux, pour en tirer des honneurs et des bénéfices.
DESAVEU
n. m.
Action de désavouer ; faire un désaveu de ses doctrines, c’est-à-dire, rétracter ce que l’on avait avancé précédemment, En matière politique, les cas de désaveu sont assez fréquents et sont le plus souvent déterminés par l’intérêt, mais parfois le désaveu est déterminé par la tyrannie exercée par les puissants du monde sur leurs sujets. Il y a des cas de désaveu qui sont devenus célèbres. Tel est celui de Galilée, le célèbre astronome du XVIème siècle qui déclara que la terre tournait alors qu’en vertu de la doctrine chrétienne toute puissante à cette époque, il fallait soutenir qu’elle était immobile. Galilée fut cité à Rome devant le tribunal de l’Inquisition et sous la menace d’être exécuté, il se rétracta. Il fut contraint de faire abjuration de ses « erreurs » agenouillé, et les mains sur l’évangile.
On raconte qu’en se relevant, il ne put cependant se contenir et prononça tout bas ces mots : E pur si muove (Et pourtant c’est la terre qui se meut). Plus tard, le grand Voltaire, pour échapper aux tracasseries et aux persécutions des autorités, fut également obligé de désavouer plusieurs de ses ouvrages, et même de nos jours, malgré la science et la philosophie qui ont fait de si puissants progrès, on est encore attaché profondément aux préjugés d’hier et des hommes se désavouent pour éviter la souffrance ou l’impopularité.
Certes, quelles que soient les raisons qui déterminent le « désaveu », celui-ci est regrettable, sinon blâmable : mais il faut parfois être indulgent et comprendre que l’homme n’est qu’un homme, et qu’il ne peut pas toujours résister à la tyrannie. C’est en soi-même qu’il faut puiser la force indispensable pour défendre toujours ce que l’on croit être la vérité et en unissant nos efforts lutter contre les erreurs que les puissants du monde ont toujours intérêt à propager.
DESERT
n. m.
Ce qui est très peu fréquenté, peu peuplé. Une contrée déserte ; une maison déserte.
On a donné le nom de désert aux régions déprimées et soumises à une sécheresse à peu près continue. Il en résulte naturellement pour ces régions une absence presque totale de végétation. Les principaux déserts du monde sont le Sahara, le Kalahari, l’Arabie Pétrée, le Gobi et le Colorado. Le Sahara est fait de dunes de sables et de plateaux pierreux et est parsemé de rares oasis ; il est habité par des Maures, des Touaregs et des Tibous qui sont en grande partie des populations nomades. Il a une longueur de 5.000 kilomètres et une largeur de 1.400 kilomètres environ. C’est le désert par excellence. Les Egyptiens étaient arrivés à en fertiliser certaines parties par irrigation ; mais, depuis l’écroulement de la civilisation égyptienne, la culture y est absolument abandonnée. Le Kalahari, de beaucoup moins important que le Sahara, est un désert de l’Afrique méridionale. Il est couvert d’une végétation buissonneuse et est habité par les Betchouanas, appartenant aux tribus cafres du Sud de l’Afrique. L’Arabie Pétrée est la partie centrale de l’Arabie, et forme un immense plateau pierreux et désert où règnent une chaleur effrayante et une sécheresse absolue. Heureusement pour ce pays que ses côtes sont particulièrement fertiles, et que l’on y récolte en abondance le café, le coton, la canne à sucre, etc., etc.…. Le Gobi est un grand désert de la Mongolie qui s’étend entre la Sibérie et la Mandchourie, et son climat est inégal. Quant au Colorado, c’est une contrée de l’Amérique du Nord qui contient d’importantes richesses minérales, mais qui est presque totalement inhabitée.
DESERTER
verbe
Action qui consiste à abandonner un parti, une lutte, une bataille. Le mot est employé surtout dans le langage courant, pour qualifier l’acte du militaire qui abandonne sans en avoir obtenu l’autorisation, le poste qui lui a été confié. En période de guerre et dans tous les pays, la désertion devant l’ennemi est punie de la peine de mort ; en temps de paix les peines sont un peu plus légères, mais la désertion est toujours réprimée avec férocité par les tribunaux militaires. Toute répression est arbitraire et inopérante mais on ne peut concevoir une condamnation plus illogique que celle qui frappe le déserteur. Il y a en effet peu de jeunes gens qui soient attirés par la carrière des armes, en conséquence, c’est par la contrainte qu’on les oblige, dès qu’ils ont atteint un certain âge, d’accomplir une période de service militaire. Comment s’étonner que, parmi eux, il s’en trouve qui, au bout d’un certain temps, abandonnent la caserne pour recouvrer leur liberté ? C’est sans leur volonté qu’on les a embrigadés dans les régiments ; c’est sans tenir compte de leurs opinions, de leurs désirs, de leurs aspirations qu’on les a emprisonnés à la caserne ; ils n’ont rien promis, on ne leur a rien demandé. Est-ce vraiment « déserter » que de se refuser à accomplir un acte, un geste qui nous répugne, que de ne pas se prêter à un travail que l’on juge inutile, à une fonction que l’on estime criminelle ?
Celui qui de sa propre volonté, en pleine possession de ses facultés, conscient de ce qu’il fait, embrasse une carrière et abandonne celle-ci au moment du danger, est méprisable, et, en vertu de la morale et des lois bourgeoises, on comprendrait encore la répression qui s’exercerait contre lui. Mais le malheureux que l’on numérote comme du bétail sans tenir compte de sa personnalité ne peut être blâmable lorsqu’il quitte un poste qu’il n’a pas demandé. Même dans les pays où le service militaire n’est pas obligatoire et où le recrutement est volontaire, le soldat est excusable lorsqu’il déserte. Il est excessivement rare qu’un homme s’engage par amour de l’armée ; très souvent il y est poussé par la misère et la famine ; on fait miroiter à ses yeux le bien-être dont il sera entouré lorsqu’il aura revêtu l’uniforme et ce n’est qu’à l’expérience qu’il se rend compte de son erreur.
Déserter est un crime, lorsque librement on a décidé de participer à une lutte que l’on juge noble et belle, ce n’en est plus un lorsque l’on est entraîné dans une organisation qui est une plaie sociale et qui concourt à la ruine de l’humanité. Il n’appartient cependant à personne de conseiller à un jeune homme de déserter. La désertion n’est du reste qu’un pis-aller et le déserteur un accident ; ce n’est pas cela qui peut transformer la société. La désertion est un geste de révolte individuelle et la société ne peut être transformée que par la révolte collective. Refuser collectivement de se prêter à la sinistre comédie du militarisme peut seul produire des effets. Mais cela suppose un certain degré d’éducation sociale à laquelle les hommes ne sont pas encore arrivés. L’action de déserter, lorsqu’ elle est déterminée par des raisons d’ordre social, suppose une énergie et un courage incontestable car le déserteur s’expose à une vie de souffrance et de misère. L’exil est loin d’être une source de joies et l’homme qui accepte cette extrémité se prépare bien des ennuis. De nos jours, les diverses nations du monde s’entendent à merveille sur la question des déserteurs et à la moindre incartade ils sont reconduits à la frontière et livrés à la police de leur propre pays. Il est cependant des jeunes gens qui aiment mieux affronter les risques et les difficultés de la désertion plutôt que de se courber durant un temps déterminé devant les volontés ridicules du militarisme. Il n’y a qu’un remède, un seul, pour se libérer de toutes ces contraintes qui empoisonnent l’existence humaine. Il y aura des déserteurs, tant qu’il y aura des armées et des armées tant que le capitalisme ne sera pas aboli. C’est 1a cause du mal qu’il faut attaquer si nous voulons en détruire les effets.
DESHERITES (les)
« Personnes dépourvues de certains biens que les autres possèdent ». C’est la définition qu’on peut dire « classique ». Les autres ? Qui sont-ils ces autres ? Dans une société où le bien-être est le produit de la rapine et du vol, « les autres » ne peuvent être que la minorité possédante, vivant sur le travail d’autrui et accaparant la plus grosse partie de la richesse sociale. Les déshérités sont donc ceux qui ne possèdent rien, ne posséderont jamais rien et, durant toute leur existence, mèneront une vie d’esclaves.
Ils n’ont rien ; et comment auraient-ils quelque chose, les déshérités, puisqu’ils viennent au monde dans la misère, et que leur unique héritage est la pauvreté ? Personne ne peut leur léguer un peu de bonheur et de bien-être, qui sont le privilège des riches et qui se transmettent avec la fortune, de père en fils. Acquérir ce bien-être est chose impossible aux déshérités, car la fortune et la richesse ne sont pas les fruits du travail et de l’économie, mais de la roublardise et de l’exploitation.
Le déshérité, c’est le prolétaire qui du matin au soir est obligé de se soumettre à la pénible loi du travail capitaliste et n’a aucune espérance de voir son sort s’améliorer dans les cadres de la société bourgeoise. Et, après une vie de labeur, lorsque, vieux et fatigué, il est incapable de fournir sa part de travail au capitalisme, son unique ressource est le bureau de bienfaisance ou l’hospice, ce qui est la même chose : la misère.
Et encore, parmi cette grande majorité d’exploités, de déshérités, sacrifiés à la soif de jouissance d’une minorité oisive, il y a à faire des classifications. Il est des individus plus malheureux les uns que les autres et qui traînent péniblement une vie de paria. Le travailleur a encore cette satisfaction de retrouver le soir autour de la table familiale, la femme et les bambins qui lui font oublier un instant les soucis de la lutte quotidienne et lui donnent le courage nécessaire pour reprendre le lendemain le collier de misère ; il jouit parfois des mille petits riens qui rendent supportable la vie de l’exploité ; il participe à l’action qui doit lui apporter sa libération sociale ; la vie est rude mais il se nourrit de cette espérance, qu’un jour son sort, qui est intimement lié à celui de ses semblables, s’améliorera. Hélas ! Il est des individus, descendus au dernier degré de l’échelle sociale, qui n’ont ni travail, ni famille, ni foyer, ni amis et qui traînent leur misère derrière eux, ayant à jamais perdu l’espoir d’un changement dans leur vie. Ce sont des morts-vivants habitant des taudis ou couchant sous les ponts et qui n’ont même plus la force de se révolter contre une société qui les soumet à un tel état de chose. Ils vivent de la charité publique, si toutefois on peut appeler vivre, cette végétation toute physique ; ils n’ont aucun but ; ils vivent par instinct de conservation, sans savoir pourquoi, ni comment.
Ce sont des exceptions, diront les défenseurs du régime bourgeois. Hélas non ! Ce ne sont pas des exceptions et si, dans les pays occidentaux, la misère brutale et atroce est cachée par la bourgeoisie, il existe des contrées entières ou les déshérités meurent littéralement de faim, sous l’œil indifférent du capitalisme.
M. René Maran qui milite activement en faveur de ses frères noirs, nous initie à la misère de ces déshérités, soumis à un régime abject en Afrique Equatoriale française. Au sujet de la construction de la voie ferrée Congo-Océan, voici ce qu’il écrivait :
« Pendant tout 1925, on a assisté au drame suivant : du Tchad, de l’Oubangui, du Bas-Oubangui et du Moyen Congo, des Saras, des Yakomas, des Bandas, des Bakongos, tous gens solides, avaient été, par voie fluviale, acheminés sur Brazzaville, et de Brazzaville sur les chantiers où l’on travaillait à la voie ferrée.
« Il est hors de doute que l’on aurait dû descendre en même temps, et par le même vapeur, les travailleurs et leurs vivres. Il n’en a rien été. Saras, Bandas, Bakongos et Yakomas, étaient d’abord expédiés sur Brazzaville. Suivaient leurs vivres à deux ou trois semaines d’intervalle.
« Aussi, par manière de protestation, ces malheureux crevaient-ils affamés. Entre février et septembre 1925, la mortalité par dénutrition a été effroyable ... Sur certains chantiers, à différentes reprises, les manœuvres noirs sont restés quatre jours sans manger, sur d’autres leur ration était infime. On ne distribuait par exemple, aux Saras, gros mangeurs de mil, que de ridicules portions de manioc.
« Cette pénurie de vivres, ce rationnement inintelligent, cette criminelle imprévoyance de la haute administration, ont produit tous les résultats qu’ils devaient produire. Les contingents envoyés fondaient à vue d’œil. L’un de ceux-ci qui s’élevait à trois cent cinquante individus à son arrivée à Brazzaville, n’en comprenait plus, au bout de trois mois, que soixante-neuf. TOUS les autres étaient morts. » (René MARAN)
Le fait signalé par René Maran est assez fréquent et se reproduira encore, car il n’est qu’un effet du régime qui considère comme normal que des hommes crèvent de faim, cependant que des milliers de tonnes de vivres sont inutilisés ; il n’y a donc pas à s’en étonner outre mesure. C’est l’indignation qui devrait s’emparer de l’individu animé d’un peu de sentiment à la lecture d’une telle barbarie. Ce qu’il y a de terrible, c’est que les populations ouvrières se rendent complices bien souvent des actes de la bourgeoisie et de ses représentants.
Qui donc ignore les souffrances du peuple irlandais, assujetti à l’impérialisme britannique et qui, depuis le XIIème siècle, lutte pour son indépendance ? C’est toute la population de l’Irlande qui est déshéritée et qui se bat pour conquérir sa liberté ; il en de même des nombreuses populations des Indes qui sont honteusement exploitées par la perfide Albion. Or, le peuple anglais, qui bénéficie dans une certaine mesure de cette indigne exploitation, n’élève pas la voix en faveur de son frère indigène.
En Amérique c’est toute la population noire des Etats-Unis qui est victime des préjugés de race et de couleur, qui est martyrisée et soumise à des vexations quotidiennes de la part de la population blanche, et le travailleur américain ne dit rien, et se prête à ces manœuvres déshonorantes pour un homme qui se prétend libre.
En Bulgarie, en Roumanie, ce sont les juifs qui souffrent des pogroms organisés par le gouvernement pour éloigner le peuple de la lutte de classes qui est la véritable lutte pour l’émancipation des hommes. Et il en est ainsi partout. Le monde regorge de déshérités, alors que l’humanité pourrait être heureuse, si les hommes voulaient comprendre enfin la cause de leur souffrance.
Nous avons dit par ailleurs que la philanthropie ne pouvait rien contre la misère humaine ; mais qu’elle entretenait plutôt un état de chose qui n’est que 1a conséquence d’une mauvaise organisation sociale. Il n’y a que l’union de tous les déshérités qui peut changer la face des choses. La misère ne disparaîtra qu’avec la richesse, mais ceux qui détiennent la richesse entendent la défendre avec la dernière énergie. C’est pourquoi la révolution est l’unique moyen dont disposent les déshérités, pour détruire une organisation sociale élaborée sur des erreurs séculaires, et la remplacer par une société ou la solidarité sera le lien de fraternité universelle.
DESHONORER
verbe
Oter l’honneur, avilir quelqu’un. « Se déshonorer : perdre son honneur ». Le déshonneur est toujours relatif à la conception que l’on se fait de l’honneur ; or, il y a des gens qui ont une conception particulière ou erronée de ce qu’est l’honneur et qui se trouvent déshonorés pour des causes et des raisons différentes. Une jeune fille se trouvera déshonorée parce que, sans être liée par les liens du mariage légal, elle aura cédé aux désirs de son amant, alors que telle autre plus consciente et plus logique ne se considérera pas amoindrie par l’accomplissement d’un acte naturel. Le souteneur, déchet social, qui vit de la prostitution de la femme, et qui accepte que sa compagne se livre contre argent au passant inconnu, se juge offensé si cette dernière se permet d’entretenir gratuitement des relations sexuelles pour satisfaire ses désirs, et se considèrerait déshonoré s’il ne lavait pas dans le sang cette incartade aux lois de prostitution ; il en est de même pour le mari « trompé » qui va laver son déshonneur en tuant l’amant de sa femme. Il y a donc autant de conceptions du déshonneur que de l’honneur, et nous savons qu’en bien des cas l’honneur est un préjugé qui puise sa source dans l’ignorance. Que de parents se croient déshonorés parce qu’à l’âge de vingt ans, leur fils s’est refusé de répondre à « l’appel du pays » pour accomplir son service militaire, et que de gens se croient déshonorés par le jugement des hommes, et pourtant ! En notre siècle d’exploitation ce sont les plus coupables qui sont à l’honneur.
La bourgeoisie pense déshonorer le travailleur en le jetant en prison ; cependant « la puissance souveraine peut maltraiter un brave homme, mais non pas, le déshonorer » (Voltaire).
Pour nous, Anarchistes, qui devons avoir de l’honneur une conception différente de celle du commun, nous pensons que le déshonneur n’est pas subordonné aux jugements des moralistes ou des magistrats, mais qu’il est inhérent à une mauvaise action commise.
Tout acte qui a pour but le bien-être de l’humanité, tout ce qui ne nuit pas à son prochain sous quelque forme que ce soit ne peut être déshonorant. Au contraire tout ce qui nuit à la marche en avant de la civilisation, tout ce qui s’oppose au progrès et à l’évolution du genre humain peut être considéré comme déshonorant. Le policier qui arrête le militant ou l’ouvrier au cours d’une grève ou d’une manifestation est déshonoré à nos yeux et non sa victime, et c’est lui pourtant qui est couvert par la loi et qui sort légalement glorifié de l’aventure. La répression en ce cas est déshonorante pour celui qui l’exerce et non pas pour celui qui la subit. La loi bourgeoise qui entend ; veiller à l’honneur de la société est un tissu de contradictions. Tel homme, pour une raison quelconque, parce qu’il y trouve un certain intérêt physique ou moral, supprime un de ses semblables ; l’acte est mauvais en soi, et cet homme est déshonoré. Supposons que ce même homme, en période de guerre et sans aucune raison, simplement parce qu’il y est contraint et forcé, supprime plusieurs de ses semblables ; il est l’objet de l’admiration publique et recevra les honneurs et les félicitations de ses supérieurs.
Notre conception de l’honneur n’est pas si complexe. Pour nous, chacun est libre de faire ce qui lui plaît, à condition de ne pas entraver la liberté de son prochain. C’est la base de tout l’honneur anarchiste. Il en découle nécessairement certaines obligations sociales que nous devons avoir à cœur de respecter. Luttant contre toutes les tares, tous les vices, toutes les erreurs inhérentes à la Société bourgeoise, nous ne nous considérons pas comme déshonorés par les assertions mensongères et les crimes que l’on nous impute. Nous avons conscience d’être dans la vérité et l’honneur pour nous est de poursuivre notre travail et notre lutte jusqu’à la complète libération du monde.
Les Anarchistes n’ont que faire de cet honneur militaire qui est une source de larmes et de crimes ; et, loin de se considérer comme déshonorés lorsqu’ils refusent de participer à un massacre quelconque, ils pensent au contraire accomplir une belle et noble action que tous les hommes auraient intérêt à prendre en exemple. Ils ne se jugent pas déshonorés lorsqu’ils refusent de se prêter aux comédies du mariage légal, ils savent leurs droits et ils connaissent leurs devoirs, et n’ont pas besoin de l’autorisation d’un officier d’état civil pour accomplir un acte qui ne regarde que les intéressés ; ils se moquent de l’honneur civique, tel que le conçoivent les fidèles défenseurs des régimes d’autorité et leur honneur consiste à travailler au bonheur de l’humanité qu’ils espèrent un jour réaliser.
DESIDERATUM
Mot emprunté au latin et dont la signification littérale est : « désiré » ; au pluriel : « desiderata ».
Dans le domaine scientifique ce mot s’emploie pour signaler toutes les parties d’une science qui n’ont pas été traitées et dans laquelle on désire voir s’exercer des recherches, mais il est entré dans le langage courant et au sens populaire sa valeur s’est étendue.
Dans le domaine social ce mot s’emploie fréquemment pour signaler les désirs d’une collectivité. « Le député présente à l’Assemblée les « desiderata » de ses électeurs » ; la délégation syndicale présente à un patron les « desiderata » des travailleurs. Ce mot est donc synonyme de désirs, et dans le domaine social il marque la volonté du mandant d’aboutir à un résultat et de mener la lutte pour obtenir satisfaction.
Le desideratum de la classe ouvrière est la disparition de l’exploitation de l’homme par l’homme, source de toutes les misères et de tous les abus sociaux.
DESILLUSION
n. f.
Etat de celui qui a perdu ses illusions. Il existe des gens, et ils sont des plus nombreux, qui passent leur existence loin de la terre sur laquelle ils reposent et vivent dans un songe sans cesse renouvelé. Leur conception de la vie étant étayée sur une erreur, ils attendent toujours des réalisations qui ne se matérialisent jamais et leurs illusions s’envolent avec la même rapidité qu’elles ont été conçues. Ce sont les éternels désillusionnés. A peine se sont-ils rendu compte de la fragilité et de l’irréel de leurs espérances, qu’ils élaborent de nouveaux châteaux de cartes emportés à leur tour par le vent de la vie, et ce perpétuel jeu d’illusions et de désillusions en fait des êtres incomplets et incapables de s’armer pour la lutte sociale. Sébastien Faure, je crois, nous conte dans une de ses œuvres l’histoire de cet amant de l’absolu qui se maria un jour, croyant avoir rencontré la femme idéale, la femme telle qu’il l’avait imaginée dans ses rêves. Ce fut pour lui une désillusion lorsqu’il s’aperçut que sa compagne était semblable à toutes les compagnes, et l’abandonnant, il en prit une seconde qui lui apporta les mêmes désillusions, puis une troisième et toujours ses espérances déçues donnaient naissance à d’autres espérances, mais jamais il ne trouva le bonheur matrimonial.
C’est dans toutes les branches de l’activité humaine que cet homme se rencontre, car l’humanité est incomprise de la grande majorité des individus. L’homme attend encore des forces occultes des bienfaits et des améliorations ; il s’imagine qu’en dehors de lui il existe quelque chose qui peut concourir à son bien-être et à son bonheur et il se forge des illusions que la brutalité de l’existence et de la réalité s’empresse de détruire. L’inconstance qui en résulte rend plus pénible le travail de ceux qui, éclairés à la lumière des faits, restent dans le droit chemin, ont une conception exacte de ce qu’est la lutte pour la vie et, loin de se nourrir de chimères, veulent trouver en eux la force et la puissance indispensables à la transformation sociale du monde.
L’humanité est ce que la font les individus. Les hommes ne sont pas mauvais mais sont rendus méchants par l’organisation d’une société gérée en dépit du bon sens par une poignée d’individus auxquels la grande majorité a légué ses pouvoirs. Pendant des siècles le monde a été dirigé par les autocraties, sans que le peuple comprenne que la forme autocratique était contraire à ses aspirations, à ses désirs et à ses besoins, et lorsque convaincu de son erreur, il s’est attaqué aux institutions qui en découlaient, il s’est laissé illusionner par une nouvelle erreur : le parlementarisme démocratique. Si à une illusion a succédé une autre illusion, la désillusion ne devait pas tarder à en être la conséquence logique, et l’on se rend compte à présent que la démocratie est impuissante à résoudre un problème qui est cependant bien simple, mais dont on se refuse à accepter comme exacte la solution présentée par le communisme libertaire.
Il coule de source que toute illusion étant le fruit de l’erreur et de l’ignorance, il arrive fatalement qu’elle s’écroule, et c’est ce qui fait dire à Pascal que « la vie humaine n’est qu’une illusion perpétuelle ». Pas pour tout le monde cependant. Devant les misères de l’humanité, il est des philosophes et des moralistes qui prétendent qu’il est criminel de dessiller les yeux de l’ignorant et qu’il est préférable de le maintenir dans son erreur : ils affirment que l’illusion est un facteur de joie et qu’elle est une compensation à la souffrance et à la douleur. Cela nous amènerait à conclure que le mensonge est préférable à la vérité, ce qui est ridicule en soi, et qui est la négation de tout progrès et de toute évolution. Nous pensons au contraire, que plus l’illusion est grande, plus le réveil est brutal, pénible et douloureux et qu’en conséquence il est un devoir auquel l’homme social doit s’attacher : c’est d’effacer les fantômes qui peuplent le cerveau de ses semblables.
Lorsque l’on aura détruit toutes les illusions du peuple, il n’y aura plus de source de désillusions et l’humanité avancera à pas de géants.
Il arrive parfois que les hommes d’action, devant l’étendue du chemin à parcourir, devant les préjugés qui gouvernent encore le genre humain, s’imaginent également que c’était un beau rêve qu’ils avaient fait lorsqu’ils pensaient rénover l’humanité. Ils se laissent, eux aussi, envahir par la désillusion. Il ne le faut pas. Il faut prendre l’humanité telle qu’elle est en notre siècle, rechercher les causes déterminantes de son activité, en analyser les effets et l’on se rend bien vite compte que ce n’est pas une illusion d’apercevoir dans le lointain la réalisation de nos espérances. Chaque jour amène une transformation, aussi minime soit-elle, à 1’organisation sociale des individus. De l’homme sociable dépend tout l’avenir. Il est donc nécessaire que le plus grand nombre d’individus soient rendus sociables, c’est-à-dire débarrassés de toutes les illusions qui peuplent leur esprit. C’est à cette tâche que doivent se livrer les révolutionnaires sincères. La raison et la logique prendront alors la grande place occupée encore de nos jours par le rêve, et les désillusions disparaîtront, effacées par une réalité harmonieuse et positive.
DESINTERESSEMENT
n. m.
Oubli, sacrifice, abnégation.
« On trouve l’intérêt presque partout, le désintéressement presque nulle part. » (Boiste)
Le désintéressement est la qualité de l’homme probe et sincère qui n’accomplit pas une action pour en tirer un bénéfice particulier et qui n’envisage que le but de cette action. Malheureusement le désintéressement est de plus en plus rare et les hommes sont tiraillés par de basses questions d’intérêts ; ils se déchirent et se tuent pour de l’argent et ce qu’il y a de plus terrible, c’est que certains d’entre eux, les plus forts et les plus puissants, entraînent dans leurs disputes sanglantes des populations innocentes et étrangères à leurs intérêts. Il n’y pas seulement le désintéressement d’argent, qui doit être considéré comme une qualité ; il y a aussi le désintéressement politique et social qui peut être considéré comme une faute. Il existe un nombre incalculable de gens qui ignorent totalement ce qui se passe à travers le monde et qui sont tout étonnés le jour où ils sont entraînés dans une catastrophe. Ils se désintéressent totalement de toute question qui semble ne pas exercer d’influence immédiate sur leur vie quotidienne sans comprendre qu’ils ne peuvent pas être étrangers à l’action politique, économique et sociale de la collectivité. Ce désintéressement-là est de l’égoïsme, car celui qui s’en réclame n’aspire qu’à ne pas être troublé dans son existence monotone, et, par sa passivité, il permet aux aventuriers de toutes catégories d’exercer leur pouvoir au détriment de la grande masse des asservis.
S’il est bon et beau d’être désintéressé au point de vue financier, il n’est pas moins utile et nécessaire d’être intéressé au point de vue social et de rechercher les causes de toutes choses. L’anarchiste doit apprendre pour savoir et connaître et pour associer à l’abnégation de soi l’intérêt pour tout ce qui touche ses semblables.
DESINVOLTURE
n. f.
Tournure pleine de grâce, d’aisance ; allure dégagée. Avoir de la désinvolture dans ses gestes, dans ses mouvements. Un individu désinvolte est un personnage dont la « liberté » frise parfois l’inconvenance et dont les actions sont souvent choquantes. Sous le masque de la franchise, la désinvolture cache généralement de la sécheresse de cœur et de l’égoïsme. C’est avec désinvolture, c’est-à-dire avec un laisser-aller complice et coupable que les hommes d’Etat livrent les pays qu’ils dirigent aux gros potentats de la finance et de l’industrie, et qu’ils mettent toutes les forces actives des nations au service d’une classe de privilégiés. C’est à la désinvolture des politiciens, qu’il ne faut pas prendre pour de la franchise, qu’est due la guerre maudite qui dura quatre ans et demi et fit périr plusieurs millions d’hommes, et c’est encore cependant avec désinvolture que ces mêmes politiciens responsables de la tragédie de 1914 se présentent devant le peuple. N’est-ce pas là une inconvenance n’ayant d’égales que la bêtise et la lâcheté des masses populaires qui ne trouvent pas en elles la force de se révolter devant un tel sans gêne, et de chasser les mauvais bergers qui, depuis des années et des années, les trompent et les grugent ?
On constate avec peine que les opprimés acceptent leur sort comme une fatalité et ne sont pas moins désinvoltes que ceux qui les dirigent ; il semblerait qu’ils ne peuvent rien contre tous les fléaux qui se sont abattus sur eux et contre ceux qui les menacent encore, Pourtant ce sont eux les premières victimes de toutes les catastrophes sociales inhérentes au régime capitaliste.Peut-être serait-il temps, si le monde ne veut pas se laisser engloutir dans le sang et dans la ruine, que les peuples se décidassent à envisager l’avenir avec un peu moins de désinvolture.
DESISTEMENT
n. m.
Action de se désister, de se départir, de renoncer à quelque chose que l’on désirait et pour laquelle on a formulé une demande ou commencé une action. Juridiquement le désistement est l’acte par lequel une partie, engagée dans un procès, retire la demande qu’elle avait formée ; elle est dans ce cas, soumise au payement de tous les frais occasionnés par la procédure. On appelle aussi désistement en langage électoral, l’action qui consiste à retirer sa candidature au bénéfice d’un autre candidat. Le désistement électoral donne lieu à une série de marchandages queue peut supposer l’électeur naïf qui compte sur son favori pour défendre, dans une Assemblée quelconque, ses intérêts.
Nous savons que, lors des élections, il faut pour être élu, obtenir une certaine majorité ; or, il est des candidats qui, après le premier tour de scrutin et d’après le nombre de voix recueillies perdent tout espoir de décrocher un mandat ; cependant en maintenant leur candidature pour le deuxième tour de scrutin (scrutin de ballotage), ils peuvent gêner profondément un ou plusieurs de leurs adversaires. C’est là que commence l’ignoble manœuvre du désistement où les intérêts économiques, politiques ou sociaux des mandants n’entrent même pas en jeu, mais où s’échafaudent les combinaisons qui permettront au « candidat malheureux « de ne rien perdre dans l’affaire.
Il faut agir avec mesure et doigté, mais les politiciens sont maîtres en la matière, et l’électeur est si docile et si confiant qu’il accepte le désistement de son candidat sans même se rendre compte de l’ignominie et de la bassesse de l’action.
Il est, pensons-nous, inutile de signaler l’insolence qui caractérise la prose électorale : les affiches qui colorent les murs sont couvertes d’insultes ; on étale aux yeux du public, les vices, les tares, les travers de l’adversaire que l’on combat, et c’est un échange entre candidats de diverses couleurs, d’un lot d’injures, d’offenses et d’outrages. Tout cela avant le premier tour du scrutin naturellement. Le socialiste a combattu avec véhémence son adversaire radical, il l’a traîné dans la boue, il l’a accusé de tous les crimes, de tous les malheurs qui pèsent sur l’humanité, il a fouillé au plus profond de sa vie privée et publique, il a découvert toutes ses trahisons et a affirmé que son élection serait un désastre pour le pays. Le radical n’a pas été moins farouche, moins violent, et a usé à l’égard du socialiste des mêmes termes, puisés dans le même vocabulaire électoral. Et le vote a lieu. Il y a ballotage.
Le socialiste a perdu toutes ses chances. Il ne sera pas élu ; même s’il maintient sa candidature, il sera battu. Va-t-il purement et simplement abandonner la lutte et assister, en simple spectateur, à la bataille qui se continue supposons, entre le radical et le conservateur ? Ce serait mal connaître la cuisine électorale et prêter une certaine sincérité au politicien. Non. Le socialiste va se désister en faveur de ce fêlé, de ce vendu, de ce traître, de ce radical, qu’il a traîné dans la boue et qu’il a déshabillé de façon si désobligeante. Oh!, mystère des coulisses électorales ! Après ce premier tour de scrutin, quelle transformation dans le langage, dans le style de notre socialiste ! Certes le radical, est toujours un radical, ce n’est pas un socialiste, oh non ! « Mais pourtant, il faut barrer la route à la réaction, il ne faut pas permettre au conservateur de gravir les marches du pouvoir, et comme, entre deux maux il faut choisir le moindre, vous voterez, mes chers électeurs, pour ce radical, qui, après tout, n’est pas si noir qu’on le présentait et qui a un programme de réformes sociales quelque peu semblable au nôtre ». Et le peuple applaudit, et il s’empresse, le dimanche suivant, autour des urnes pour y jeter le morceau de papier « radical », qui lui est remis par son candidat socialiste, et la pièce est jouée, populo n’a rien vu.
Derrière le rideau, toutes les tractations se sont opérées. L’électeur a été vendu, comme il l’a été cent fois, comme il le sera encore mille fois. Son candidat ne s’est pas désisté par conviction, en vertu d’une idée, d’un principe, mais pour rentrer dans les frais que lui avait, à lui ou à son parti, occasionnés sa candidature. Il a vendu ses électeurs mais c’est lui qui a touché la forte somme, et le peuple souverain est heureux, content et fier d’avoir rempli son devoir, c’est-à-dire d’avoir servi de tremplin ou de marchandise à des fantoches et à des crapules.
Que de fois a-t-on cherché à initier le peuple aux dessous de la politique ; que de fois lui a-t-on dit qu’il était un moyen, un outil entre les mains d’ambitieux habiles et sans scrupules, que de fois l’écho de scandales électoraux est arrivé jusqu’à ses oreilles ! Mais il ne veut rien voir, il ne veut rien entendre et il continue, malgré tout, à servir de jouet aux aventuriers politiques qui ne se cachent même plus pour accomplir leur basse besogne.
En réalité s’il est quelqu’un qui se désiste, qui abandonne toute sa force et toute sa puissance, qui renonce à tout ce qu’il aurait le droit d’exiger et d’avoir, qui se livre pieds et poings liés aux puissants de la terre : c’est le peuple ignorant et inconscient, livré à l’esclavage politique et économique et dont la bêtise et la lâcheté est telle, qu’il se désiste parfois de sa vie au profit de ses bourreaux. Et combien de temps cela durera-t-il encore ?
DESOBEISSANCE
n. f.
Refus d’obéir, enfreindre un commandement. « Désobéir à ses chefs ; désobéir à ses parents ». « La désobéissance est chez les enfants un grave défaut » déclare la morale bourgeoise, et en effet il paraîtrait surprenant qu’il en fût autrement, si l’on considère que toute la morale bourgeoise est basée sur les droits de l’Autorité et la nécessité de l’obéissance. C’est sans doute en vertu du vieux principe religieux : « Honore ton père et ta mère » que, de nos jours encore, on persiste à déclarer que la désobéissance des enfants aux parents est un acte répréhensible qui doit être châtié, et pourtant la désobéissance des enfants est le plus souvent déterminée par l’incompréhension et provoquée par 1es parents eux-mêmes.
Donner un ordre à un petit enfant est utile, car ce dernier est parfois incapable de se conduire lui-même et a besoin, pour s’orienter, d’être appuyé et soutenu par les conseils de ses parents ; mais faut-il encore que les parents soient des êtres raisonnables et logiques et que leur autorité ne se manifeste pas fréquemment d’une manière arbitraire et ridicule.
L’enfant est un petit être neuf, qui veut savoir, connaître, s’intéresse à toute chose, remarque les moindres détails, et qui, à chaque instant, cherche à pénétrer le mystère de ce qui l’entoure : c’est un petit animal instinctif qui fonce tête baissée à la découverte de la vie et qui agit avec toute la fougue et l’impétuosité que lui communique la jeunesse. Il n’est donc pas absolument inutile de réfréner en lui l’instinct qui peut lui faire commettre des gestes, des mouvements, des actes dangereux pour lui-même ; mais il faut le faire intelligemment, avec perspicacité et mesure, si l’on veut en être compris et, en conséquence, écouté.
Malheureusement, ce n’est que rarement que l’on agit ainsi avec un enfant. On a le grand tort de le croira inaccessible à la raison et l’on se refuse à discuter avec lui. On a trop peu souvent l’habitude de répondre à ses questions et on juge inutile de l’initier aux causes de l’ordre qu’on lui donne et c’est pourquoi tant d’enfants désobéissent.
Tu ne dois pas faire ceci ; tu ne dois pas faire cela ; tu ne dois pas aller ici, etc., etc. C’est dix fois par jour, à chaque instant que l’enfant entend ces mots sans que l’on daigne « s’abaisser » à lui donner la moindre explication. Il doit exécuter l’ordre qu’on lui intime, et c’est tout ce qu’on lui demande : « l’enfant doit être obéissant et ne pas chercher à approfondir ». Raisonnement ridicule qui caractérise particulièrement la médiocrité de la morale bourgeoise, car l’enfant veut savoir quand même, et pour atteindre son but, il désobéit. On le corrige, mais cela ne change rien du tout, un enfant ne reculant pas devant une correction où une punition quelconque, lorsqu’il veut satisfaire une fantaisie ou un caprice. Il semble donc que le cerveau vierge de l’enfant n’étant pas encore corrompu, le raisonnement est le moyen le plus propice à obtenir de lui l’obéissance. Et puis jusqu’à quel point — toujours en vertu de la morale bourgeoise — la désobéissance de l’enfant est-elle un défaut ? Quel est le moraliste qui soutiendra que l’enfant commet un acte répréhensible, lorsqu’il refuse à son père, ivrogne, d’aller lui chercher de l’alcool ? L’enfant a-t-il raison ou tort lorsqu’on lui demande de s’humilier pour satisfaire à l’autoritarisme de ses parents ? En vérité, il serait bien difficile au moraliste d’établir des bornes pour marquer le point où la désobéissance cesse d’être immorale. Pour nous, anarchistes, toute obéissance passive, aveugle, irraisonnée est néfaste, nuisible, et si on inculque aux enfants les beautés et les bienfaits provoqués par l’obéissance et les méfaits et les crimes occasionnés par la désobéissance, ce n’est que pour les préparer à une vie de mensonge, de veulerie et d’esclavage.
Et, en effet, lorsqu’il sera libéré du joug du maître d’école qui aura troublé ses plus jeunes années, et aura déjà, par son autorité, fait des ravages dans son jeune cerveau, c’est le patron, le contremaître, l’ouvrier, auxquels il ne lui faudra pas désobéir, car l’apprenti est l’inférieur qui doit tout admettre sans protester, sans donner son avis, et accepter comme parole d’évangile tout ce qu’on lui dit. Ensuite ce sera l’armée, où désobéir est un véritable crime, même si l’ordre donné est de tuer ses semblables. L’obéissance aux chefs est un devoir sacré pour le militaire, et la désobéissance est punie avec une sévérité atroce.
En regard de ses supérieurs, civils ou militaires, l’homme durant toute sa vie reste un enfant auquel le père donne un ordre logique ou ridicule.
Obéir : c’est se courber, c’est reconnaître durant toute son existence son infériorité notoire ; obéir c’est consentir à n’être qu’une chose, un jouet, une plante, sans aspirations, sans désirs, sans besoins. Désobéir, c’est se refuser à n’être qu’une machine, c’est affirmer sa personnalité, c’est manifester sa volonté, sa force ; désobéir, c’est se refuser à voir se perpétuer indéfiniment un organisme corrompu dans tous ses rouages, c’est vouloir changer un ordre social qui engendre des monstruosités et qui, depuis des siècles, transmet aux générations son bagage d’erreurs.
DESOLIDARISER (SE)
C’est une conséquence logique de la notion anarchiste de la vie, que l’anarchiste n’accepte que la solidarité qu’il a choisie, voulue, examinée, consentie enfin. La solidarité obligatoire ou imposée est contraire à l’esprit anarchiste lui-même. L’histoire est là d’ailleurs pour nous montrer que la solidarité imposée s’est montré un instrument merveilleux de dogmatisme et de domination. Pour rendre concrète et effective la solidarité entre les êtres que n’unissaient ni des affinités de tempérament ni la conformité des intérêts, la religion et la loi ont été nécessaires ; pour que les rapports de solidarité obligatoire que la religion et la loi déterminent entre les hommes ne restent pas lettre morte, il a fallu des exécutifs religieux ou légaux, c’est-à-dire des prêtres et des juges.
Là où il n’y a pas de contrat imposé — ni dans l’ordre économique, ni clans l’ordre éthique, ni dans l’ordre intellectuel — et c’est cela l’anarchie, il ne peut y avoir non plus de solidarité imposée. Par exemple, l’anarchiste se solidarise tacitement avec tous les gestes que son camarade accomplit aux fins de miner, saper, ruiner, détruire l’autoritarisme. Mais il entend se désolidariser et il se désolidarise des gestes du soi-disant camarade qui, par raison d’opportunisme ou de tactique, défend une forme quelconque de gouvernement (la République vaut mieux que la Monarchie, etc.), préconise le vote, approuve la guerre. L’anarchiste n’a rien à faire avec lui, pas plus qu’avec le juge, le policier, le geôlier, le bourreau, l’élu, l’électeur socialiste ou communiste. Ni les uns ni les autres ne sont de son « monde ».
On objectera que les anarchistes font des concessions au milieu. Examinons la question de très près. Il y a des concessions évitables et volontaires, d’autres qui ne le sont pas. Il y a un ordre de concessions inévitables comme celles d’aller travailler à l’atelier, en usine, au chantier, au bureau, parce que si l’on n’y consentait pas, on courrait le risque de mourir de faim. Le faire cependant, contribue non seulement à maintenir le régime capitaliste, mais encore le principe de l’exploitation de l’homme par l’homme. Travailler « pour son compte » ne change d’ailleurs rien au problème ; marchand ambulant, forain, artisan, petit boutiquier, on est toujours exploiteur ou exploité ; il n’est pas un article qu’on vende qui n’ait été obtenu grâce au système capitaliste de la production ; le grossiste gagne sur le petit revendeur, le petit revendeur gagne sur le chaland. Rien ne change et tel petit revendeur est plus soumis aux caprices de ses clients que l’ouvrier aux fantaisies de son patron. Dans la majorité des cas, le compagnon « illégaliste » n’échappe pas aux difficultés qui l’entourent et dont il voudrait bien cependant s’évader ; les objets qu’il consomme sont des produits qui ont passé par la filière capitaliste et les risques qu’il court ne sont pas comparables à l’ennui engendré par les heures de présence à l’atelier ou passées « à faire la place », par exemple.
Il y a des concessions évitables que certains anarchistes concèdent cependant à l’ambiance. Pourquoi ? Parce que telles concessions qui, à autrui, à vous, à moi, semblent parfaitement évitables, leur paraissent à eux, inévitables ; il y a des camarades qui consentent à accomplir telle ou telle formalité légale pour éviter de mettre autrui — une compagne, par exemple — dans une position économique défavorable ; pour ne pas mettre des enfants qui n’avaient pas demandé à naître dans une situation inférieure ou qui leur soit préjudiciable, et cela pour le reste de leur vie, etc. Il ne faut donc pas porter de jugements trop sommaires (à condition d’admettre qu’un « anarchiste » puisse « juger » son camarade) sur des « concessions » dont nous ignorons les motifs intimes et profonds.
Dans un autre ordre d’idées, j’ai connu un compagnon qui s’était marié avec une étrangère, pour lui éviter d’être expulsée, parce que, de son séjour en France, dépendaient peut-être son avenir et celui de ses enfants. J’en ai connu un autre qui ignorait ce qu’était devenue sa famille, qui l’avait renié à cause de ses idées anarchistes ; il allait souvent en prison ; seul, le mariage légal pouvait lui permettre des relations avec le monde extérieur durant ses villégiatures pénitentiaires. J’en ai connu un troisième qui n’a pu pratiquer la pluralité amoureuse qu’en acceptant l’union légale avec sa compagne habituelle ; s’il avait agi autrement, celle-ci aurait immanquablement perdu sa situation et le camarade dont il s’agit n’était pas en état de lui en procurer une autre. De nombreux camarades se prévalent des dispositions législatives en vigueur lorsqu’ils sont victimes d’accidents de travail, etc. Qui reprocherait à l’anarchiste renversé et blessé par une automobile de recourir au tribunal pour obtenir la légitime satisfaction qui lui est due ? On pourrait multiplier les exemples à l’infini. En France, un journal anarchiste ne peut paraître sans gérant et sans effectuer un dépôt légal ; des compagnons travaillant en commun sont contraints d’adopter la forme coopérative ou une forme d’association possédant des statuts, rédigés conformément aux lois en vigueur en pareille matière, etc.
Il est évident que les concessions sont des expédients dont il ne convient pas de se réjouir et qu’il faut individuellement s’efforcer de réduire toujours plus. Toutefois, sans ces concessions ou d’autres similaires, nous ne pourrions ni exister ni survivre. Il appartient à chacun de déterminer jusqu’à quel point il est possible de descendre en fait de « concessions » pour ne pas perdre sa puissance de réaction individuelle contre les usurpations de l’autorité, contre l’influence de 1a façon de penser et d’agir des composants du milieu. C’est un problème difficile à résoudre et il faut beaucoup de perspicacité et de tact pour ne pas glisser sur la pente. Dans ce domaine, comme dans les autres, c’est à chacun qu’il appartient de faire ses expériences. Mais je ne comprends pas qu’on se serve de ce qu’on a pu apprendre à propos des concessions qu’un camarade a pu consentir au milieu, pour lui nuire auprès de ses compagnons de lutte antiautoritaire.
Bien entendu, ces concessions qu’ils font au milieu bourgeois, à la société capitaliste, à la légalité trop souvent, les anarchistes ne les présentent pas comme des actes de « réalisation anarchiste » ; ils les donnent pour ce qu’ils sont : des expédients individuels, des pis-aller. Ils ne les prennent pas au sérieux. Peu importe que le compagnon anarchiste ait consenti à travailler pour un patron, à contracter un mariage légal, à écrire dans un journal qui effectue un dépôt légal, l’essentiel est qu’il lutte sans trêve contre le régime capitaliste, pratique ostensiblement l’amour libre, écrive tout ce qu’il pense.
Une concession faite au milieu social n’engage pas plus l’anarchiste qui la consent que signer un engagement l’engage vis-à-vis de l’accaparement foncier et propriétariste, laisser visiter ses bagages à la douane vis-à-vis de l’idée de frontières.
Donc, je ne me désolidariserai pas de celui qui a dû consentir à l’ambiance sociale quelques concessions et en a retiré un bien-être économique appréciable. Je ne me désolidariserai pas de l’instituteur ou du cheminot, que leur travail n’empêche pas de nourrir une haine profonde pour l’autorité. L’expédient économique auquel ils ont eu recours ne les porte pas à priver de la liberté qui que ce soit, à maintenir en prison qui que ce soit. Je ne me désolidariserai du camarade employé de l’Etat ou marié que s’ils faisaient de la propagande en faveur de l’excellence ou de l’utilité de l’institution Etat ou des formalités légales.
Mais je ne me désolidariserai pas non plus de celui qui ne veut pas faire de concessions directes au régime de contrat social imposé ou obligatoire, tel que celui qui régit la société actuelle. Dans un tel régime,- et il implique la soumission aveugle au contrat social, qu’il est impossible de rejeter ou de résilier- je conçois fort bien les déterminismes individuels qui ne veulent pas se courber, qui se refusent à servir d’instruments ou d’agents directs de domination ou d’exploitation, à fortifier les privilèges ou les monopoles de qui domine ou de qui exploite. Son tempérament peut, certes, l’amener, dans son combat quotidien pour sa vie, à employer la ruse ou la violence, et sur ces actes, je ne porterai pas de jugement. Dès lors que ce réfractaire s’est intéressé, au moins tout autant que celui qui se soumet, à la propagande des idées anarchistes, qu’il s’est montré un « camarade » vis-à-vis des camarades anarchistes, qu’il a apporté tout l’effort dont il a été capable aux réalisations anarchistes pratiques tentées par des camarades avec lesquels il se sentait des affinités de caractère ou de pensée, je n’ai aucune raison de me désolidariser de lui.
— E. ARMAND.
DESOLIDARISER (SE)
Rompre un lien moral qui unissait plusieurs individus ou groupes d’individus.
II arrive fréquemment que des hommes — et plus particulièrement dans le mouvement social — cherchent à unir leurs efforts pour atteindre un but qui semble commun et que les pratiques de certains d’entre eux apparaissent au bout d’un certain temps, nuisibles à la collectivité. Il est donc nécessaire de se détacher d’eux afin que ne se corrompe pas tout l’organisme constitué. On le fait ordinairement de façon assez retentissante pour que nul ne l’ignore et afin de n’être pas confondu avec ceux dont on se désolidarise. Dans ce cas, « se désolidariser » est un acte de courage, de franchise et de loyauté ; mais, parfois, la rupture du lien moral qui unissait des individus est provoquée par la crainte que l’action entreprise ne compromette la quiétude et la liberté de ceux qui s’y donnent et, dans ce cas, se désolidariser au moment du danger est une lâcheté.
Durant la grande guerre de 1914–1918, une certaine fraction d’anarchistes intellectuels crurent devoir engager les anarchistes du monde à prendre position dans ce conflit qui mettait aux prises deux capitalismes et à se ranger du côté de la France, qui, à leurs yeux, symbolisait le droit et la « liberté ». Dans un manifeste reproduit par toute la presse alliée, ces anarchistes patriotes, parmi lesquels il faut, hélas, compter les Kropotkine, Jean Grave, Malato, etc., etc., faisaient appel au libéralisme et à la clairvoyance des anarchistes, en leur demandant de combattre les empires centraux « responsables de la tuerie ».
La grand majorité des Anarchistes, adversaires de la guerre, ne pouvaient, quelle que soit l’influence des signataires de ce manifeste, dit manifeste des 16, laisser passer sans protester une telle inconscience ; c’était tout l’avenir de l’Anarchisme qui était en jeu et ils se désolidarisèrent publiquement des 16 dévoyés qui s’étaient laissés absorber par la folie guerrière. Un contre-manifeste que toute la presse se refusa, naturellement, à insérer, fut publié à Londres pour marquer la position prise par les Anarchistes dans 1e carnage mondial.
Dans tous les faits et gestes qui illustrent la lutte sociale, les anarchistes se solidarisent toujours avec ceux qui vont franchement et loyalement à la bataille et dont la propagande est susceptible d’améliorer le sort du genre humain ; mais ils sont toujours prêts il se désolidariser de ceux qui, par leur activité, cherchent à plonger le peuple dans une nouvelle erreur.
On a prétendu que les Anarchistes se désolidarisèrent de la Révolution russe et travaillèrent à la chute du Pouvoir Communiste. Ces affirmations sont purement intéressées et dénotent une évidente mauvaise foi. Dans son étude sur la Russie, Chazoff écrit :
« Lorsque Kerensky, incapable et impuissant, fut obligé de céder le Pouvoir sous la poussée de l’Ouvrier de Petrograd et de Moscou, tous les révolutionnaires, et les libertaires au premier rang, firent, de leurs poitrines, un rempart pour défendre les hommes nouveaux qui avaient promis au prolétariat : la liberté et la paix. »
« Les libertaires soutinrent les bolchevistes, car ils considéraient que, devant l’âpreté de la lutte, rien ne devait diviser la classe ouvrière et amoindrir les chances de succès, et que tous les efforts devaient être unis pour écraser définitivement les forces du passé. »
« Même au lendemain de la prise du pouvoir par le Gouvernement des Soviets, les libertaires n’établirent pas une barrière entre le pouvoir central et la Révolution. Avec tous les miséreux, avec tous les parias, avec tous les déshérités qui, sur le front, sans armes et sans pain, menaient une lutte de géants ; ils applaudirent au programme bolcheviste : « La Paix de suite et tout le Pouvoir aux Soviets. »
« Hélas!, sitôt à la tête du Gouvernement, les maîtres du bolchevisme oublièrent vite leurs promesses et se jetèrent à corps perdu dans la politique. Pourtant, durant près de deux années, les Libertaires de l’extérieur se refusèrent à croire à toute l’étendue du désastre. Malgré les fautes et les erreurs des gouvernants russes, ils conservèrent leur confiance en l’avenir et usèrent de tous leurs moyens pour soutenir le Gouvernement et la Révolution. »
« Ce n’est qu’en juin 1920, à la suite de l’attitude équivoque de Krassine, à Londres, et des premières tractations officielles du Gouvernement russe avec la basse finance internationale que les révolutionnaires sincères se rendirent compte du danger et que dans un article trop bien inspiré, hélas!, Rilbon concluait : « Le Bolchevisme en mourra. »
« Se solidariser plus longtemps avec les hommes qui, quels que soient leur nom et leur passé, se mettaient au banc de l’humanité, eût été un crime ; Nous ne voulûmes pas nous y associer. Nous ne voulûmes pas nous rendre complices du meurtre de milliers de travailleurs russes. Nous élevâmes notre voix, pour que retentisse le grand cri de douleur et de détresse de tous ceux qui, sans arrière-pensée, loyalement, avaient tout donné pour la Révolution et voyaient celle-ci sombrer, à la grande satisfaction de la bourgeoisie, un instant apeurée. » (J. Chazoff, Le Mensonge bolcheviste).
Par les lignes qui précèdent, on comprendra que les Anarchistes ne se sont jamais désolidarisés de l’action révolutionnaire de leurs frères slaves, qu’au contraire ils ont fait tout ce qu’il leur était possible de faire pour les soutenir et pour les défendre, mais qu’ils se refusèrent à s’associer à l’action politique qui réduisit à sa plus simple expression le superbe mouvement d’octobre 1917.
On a également coutume de prétendre que les anarchistes se désolidarisent de la classe ouvrière parce qu’ils se refusent à se joindre à eux lors des foires électorales. C’est bien au contraire parce qu’ils ont souci des intérêts des classes opprimées et asservies que les libertaires ne veulent pas participer à ces comédies périodiques qui n’ont d’autres raisons que de donner aux travailleurs l’illusion de sa souveraineté. Malgré les affinités qui l’attachent, qui le lient au prolétaire, l’anarchiste ne peut se solidariser avec les erreurs du prolétariat, et le parlementarisme est une des erreurs les plus nuisibles dont ne se sont pas encore libérées les classes travailleuses. Se solidariser avec tous les politiciens menteurs et véreux qui spéculent sur l’ignorance populaire, ce serait là se désolidariser, d’avec la classe ouvrière ; et si parfois le verbe de l’Anarchiste est cinglant et brutal, c’est parce qu’il souffre de voir que, malgré tous les exemples, tous les enseignements du passé, le producteur se laisse toujours prendre au piège que lui tendent les candidats de différentes couleurs.
« Notre monde civilisé n’est, en réalité, qu’une grande mascarade. On y trouve des chevaliers, des soldats, des docteurs, des avocats, des prêtres, des philosophes, et tout le reste ; ils ne sont que des masques sous lesquels, en règle générale, se cachent des spéculateurs. » (Schopenhauer)
Eh bien!, c’est de tous ces hommes masqués que les Anarchistes se désolidarisent. Ils pensent que le mensonge a assez duré et que l’homme est assez grand pour comprendre la vérité.
Se désolidariser est un devoir pour tout être sincère, loyal et clairvoyant, lorsque sa solidarité est dangereuse au bien-être de l’humanité. Il faut avoir le courage, l’énergie, la volonté, de briser des sympathies, de s’aliéner des amitiés, de détruire des liaisons lorsque l’idée que l’on croit juste en dépend. Il en coûte parfois. Qu’importe ! Ce sont les nécessités de la lutte, les sacrifices indispensables au triomphe de la cause que l’on défend et rien ne doit arrêter l’anarchiste même si son attitude doit soulever l’indignation des ignorants et des imbéciles.
Conscients du rôle qu’ils ont à jouer dans la lutte des classes, malgré les clameurs intéressées des profiteurs et des parasites sociaux, les anarchistes poursuivront leur route, se désolidarisant de tous les corrupteurs et soutenant toujours avec une inébranlable abnégation, les véritables lutteurs qui, en détruisant le présent, préparent l’avenir.
DESORDRE
n. m.
Défaut d’ordre, dérèglement dans le fonctionnement d’un corps constitué ; manque d’organisation. Confusion, dérangement. Mettre tout en désordre. Des cheveux en désordre. Le désordre du bureau. « Mes papiers et mes livres sont restés dans un désordre épouvantable » (J.-J. Rousseau). Le désordre des finances ; le désordre politique ; le désordre administratif ; le désordre parlementaire.
Avec un cynisme déconcertant, la bourgeoisie, inspirée sans doute de ce même esprit qui fait que le coquin crie « au voleur » pour se débarrasser des poursuivants qui le menacent, a fait du mot « Anarchie » le synonyme de désordre et pourtant il ne peut exister un organisme qui symbolise plus parfaitement le désordre que l’Etat social bourgeois. On se demande comment les peuples peuvent être assez aveugles pour ne pas apercevoir le dérèglement de la chose publique, dérèglement qui s’accentue de jour en jour et se terminera par la déchéance et la ruine, s’ils ne se décident pas à mettre un frein à l’incohérence les dirigeants.
C’est dans tous les domaines de l’activité : politique, économique et sociale que se manifeste le désordre inhérent à la Société capitaliste, et il faut toute la naïveté, toute l’inconscience des masses populaires pour considérer comme ordonnée une société qui évolue dans un fouillis et une confusion perpétuels. Les anarchistes qui ne se nourrissent pas d’illusion ont une conception plus nette des réalités, et pensent que te mot désordre est plus conforme à la vérité et s’applique admirablement pour qualifier ce que l’on appelle « l’ordre bourgeois ».
La démonstration de ce que nous avançons nous paraît facile. Le Larousse nous enseigne que l’ordre est « La disposition des choses d’une manière utile et harmonieuse, le fonctionnement régulier ; la qualité de ceux qui aiment l’arrangement, la méthode : la règle établie par la nature, etc., etc…. »
Acceptant cette définition de l’ordre il est alors bien simple de démontrer que l’organisation bourgeoise s’oppose dans ses moindres rouages à l’harmonie, à l’arrangement et à la méthode. En effet, peut-on sincèrement qualifier d’ordonnée, une Société, qui, si nous prenons la France en exemple, est obligée de se dépenser presque uniquement à chercher des remèdes aux troubles continuels qui agitent sa population ? En France, sur une population de 40 millions d’habitants, près de deux millions d’hommes : soldats, policiers, magistrats, gendarmes, gardiens de prison, douaniers, etc., etc., sont arrachés, d’un bout de l’année à l’autre, à tout travail utile et productif, afin que « l’ordre » soit maintenu au sein de la nation. Une telle conception de l’ordre est inimaginable et il faut pour s’y soumettre avoir eu le cerveau atrophié dès l’enfance par l’éducation bourgeoise. Si l’ordre existait réellement, il ne serait pas nécessaire qu’une telle armée soit mise à son service. La réalité c’est que face au désordre qu’elle engendre, la bourgeoisie est obligée de prendre des mesures si elle ne veut pas être engloutie dans le chaos.
Chaque jour un nouveau conflit divise les diverses classes de la population et la cause initiale de ces conflits est : l’erreur dans laquelle évolue la société basée sur le capitalisme. Un tel désordre règne en maître dans tous les rouages de l’Etat social, que les hommes les plus avertis, les politiciens les plus retors, les financiers les plus roués se perdent dans la confusion et sont incapables de remettre un peu d’ordre et de méthode dans les affaires publiques. Au désordre national, vient s’ajouter le désordre international, et nous en connaissons les conséquences tragiques. La guerre n’est que la résultante de ce que les défenseurs des sociétés modernes osent qualifier de « l’ordre ».
Examinons donc brièvement ce que cet ordre a coûté au monde. D’après les statistiques officielles, depuis la déclaration de la guerre jusqu’au 11 novembre 1918, sur une population de 39.600.000 habitants, la France a mobilisé 8.340.000 hommes. C’est-à-dire que pendant plus de quatre ans elle a arraché à la terre, à l’usine, toute la population mâle valide du pays.
Le total de ses pertes a été de 1.350.000 tués pour l’armée de terre ; 10.735 pour la marine et 30.000 morts dans la population civile.
Sur ces derniers chiffres, 669.000 hommes étaient employés dans l’agriculture, 235.000 dans l’industrie et 159.000 dans le commerce.
Ce n’est pas qu’en France que se manifestèrent les ravages du désordre bourgeois. Durant cette période tragique, les pertes des différentes nations se chiffrèrent comme suit :
-
1 mort sur 28 habitants en France
-
1 mort sur 35 habitants en Allemagne
-
1 mort sur 50 habitants en Autriche-Hongrie
-
1 mort sur 66 habitants en Grande Bretagne
-
1 mort sur 79 habitants en Italie
-
1 mort sur 107 habitants en Russie
N’est-ce pas terrible, et comment peut-on prétendre qu’un tel état de choses est normal, conforme aux nécessités des peuples et être assez fermé à toute raison pour ne pas comprendre que la cause de tout ce mal est l’autorité abusive des gouvernants qui, loin d’assurer l’ordre, perpétuent un désordre qui détermine des cataclysmes ?
Si l’on considère une nation comme une vaste entreprise commerciale ou industrielle, on peut, sans crainte de se tromper, affirmer que cette entreprise est gérée de façon incohérente et que ses administrateurs seraient bien vite remerciés s’ils dirigeaient une affaire privée. Les commanditaires forcés de l’Etat sont les habitants, contraints de subvenir à tous les besoins de la nation, et qui, en échange de leurs subsides, sont en droit de réclamer que leurs intérêts soient défendus et leur quiétude assurée ; en un mot ils sont en droit d’exiger « le fonctionnement régulier et productif des affaires ». Est-ce que l’Etat répond à ce besoin de la population ? Nous ne le croyons pas. Au contraire, si l’on envisage les bilans, on constate que le désordre des chefs d’Etat est nuisible aux intérêts de la collectivité, et que cette dernière souffre perpétuellement du chaos déterminé par la mauvaise gérance de la chose publique. Nous avons donné plus haut les pertes humaines occasionnées par la guerre qui est elle-même une conséquence du désordre social, voyons maintenant quelles furent les pertes matérielles qui vinrent s’ajouter à ce criminel sacrifice.
Pour la France seulement, on comptait 893.000 maisons détruites, 3 millions d’hectares du territoire complètement dévastés, 2 millions d’hectares de sol cultivé complètement ravagés, 120.000 kilomètres de routes rendus impraticables, 1.100 kilomètres de ponts et de barrages inutilisables, 119 millions de mètres cubes de mines à dénoyer et près de 10.000 entreprises industrielles employant au moins 16 ouvriers, complètement détruites.
Si on se place au point de vue financier, l’étendue de la catastrophe consécutive au désordre bourgeois n’est pas moindre, et personne n’ignore les difficultés rencontrées par les gouvernements pour boucler annuellement des budgets qui engloutissent la plus grosse partie de l’épargne nationale. En conséquence, il semble que les anarchistes sont dans la vérité lorsqu’ils déclarent que l’ordre ne peut être établi dans une organisation sociale qui est à source d’un nombre incalculable de conflits et que le désordre n’ira qu’en s’amplifiant jusqu’au jour où les individus sauront se décider à combattre le désordre en employant des mesures radicales.
De toutes les écoles sociologiques qui se sont attachées et qui s’attachent encore à combattre la forme capitaliste des sociétés modernes, et qui entendent assurer l’harmonie entre tous les hommes, seul, l’Anarchisme n’a pas eu l’occasion de se livrer à des expériences matérielles. Ce que nous savons cependant, c’est que toutes les organisations politiques ou sociales qui ont tenté de mettre un frein au désordre économique du monde ont échoué.
La démocratie s’est montrée incapable de résoudre le problème de l’ordre, et plus récemment encore nous avons assisté à la tentative communiste, qui, elle non plus, n’a pas été couronnée de succès.
La raison en est bien simple. Tous les révolutionnaires politiques veulent « s’emparer de l’autorité et la fortifier pour la faire servir à leurs projets de rénovation sociale » alors que l’autorité est la cause initiale de tout désordre. C’est ce que les Anarchistes ont compris et c’est pourquoi ils sont les adversaires irréductibles de l’autorité. Les accuser d’être des agents de désordre est une diffamation intéressée, propagée par une minorité d’oisifs et de profiteurs, car si le désordre est nuisible à la collectivité, il permet à certains de « pêcher » en eau trouble et de vivre grassement au détriment de la grande masse des travailleurs,
Est-il même besoin d’insister sur les méfaits de l’autorité ? Est-ce que tout ce qui nous entoure n’est pas là pour démontrer que ses effets sont déplorables et que, depuis des siècles qu’elle dirige les destinées de l’humanité, elle n’est pas arrivée à écarter les conflits entre lez humains ?
Les Anarchistes sont des partisans de l’ordre, et l’ordre ne peut prendre naissance que dans la liberté. La liberté et l’autorité sont des contraires, et s’il est vrai que l’autorité n’a su engendrer que le désordre, la liberté engendrera l’harmonie. Abolissons donc l’autorité et nous aurons du même coup supprimé le désordre ct toutes les misères qui en découlent.
DESORGANISATION
n. f. (du latin : desorganisatio)
Altération profonde dans la structure d’un organisme, à la suite de laquelle toutes les fonctions initiales de cet organisme sont abolies. Dissociation des éléments constituant une chose physique ou morale. La désorganisation d’un corps, la désorganisation administrative, la désorganisation politique.
Physiologiquement, la désorganisation d’un corps a des causes multiples : elle est une conséquence de la maladie, de la vieillesse, du climat, etc., etc. Dans de nombreux pays, sous l’influence de l’air et de la chaleur, le foie se désorganise et tout le corps humain en est affaibli ; par l’action du temps, le corps de tous les individus se désorganise, mais ces désorganisations doivent être attribuées à des causes naturelles.
Il en est différemment lorsque l’on considère l’histoire à travers les âges et que l’on constate la lenteur avec laquelle l’humanité évolue ; c’est dans la désorganisation politique et morale des Etats, des Sociétés, qu’il faut chercher la source de cette nonchalance sociale entravant la marche de la civilisation et éloignant toujours l’être de la fraternité humaine. C’est souvent au moment où une civilisation, ou lorsqu’un Etat semblait être arrivé à son apogée, que la désorganisation apparaissait et ruinait tout un passé de travail et de lutte. Et depuis les temps les plus reculés, l’histoire se répète invariablement ; car de tout temps le monde fut organisé sur une erreur, et cette erreur se perpétue encore de nos jours. La cause qui préside à la désorganisation économique et sociale des sociétés, est le manque de liberté et il ne peut exister d’organisation stable sans liberté. Durant une période plus ou moins longue, l’autorité peut paraître un facteur d’organisation, mais ce n’est qu’une illusion qui disparaît avec le temps.
La Rome antique qui semblait assise sur des bases inébranlables, après une période de prospérité, où les arts et les lettres se mêlaient à l’éloquence, sombra dans le plus pitoyable des désordres sous l’autorité de ses Césars, et sa décadence date précisément de cette époque de magnificence où la folie criminelle d’un Néron faisait brûler une ville ayant une population considérable, pour satisfaire sa soif sadique de jouissances et de plaisirs. Rendre les empereurs romains uniquement responsables de la déchéance romaine serait une faute grave. La désorganisation du Grand Empire doit être attribuée également à la veulerie du peuple, se contentant du pain et du cirque, se laissant mener à la ruine par ses dirigeants et ne trouvant pas en lui la force de se révolter contre les abus de ses maîtres.
A la désorganisation politique d’un Etat il n’y a qu’un remède : la Révolution, et les exemples abondent de peuples qui se soulevèrent devant la carence d’un monarque à assurer la vitalité d’une nation.
Bien avant 1e peuple français, le peuple anglais se révolta contre ses tyrans qui désorganisaient le pays et plus de cent ans avant Louis XVI, Charles 1er d’Angleterre, monta sur l’échafaud. La désorganisation politique d’un Etat peut être attribuée généralement à des causes financières. C’est parce que le Parlement anglais refusa de voter les subsides réclamés par la Couronne, que Charles Ier le déclara dissous, se mettant par cet acte en guerre ouverte avec son peuple. Le mécontentement provoqué par l’arbitraire et le despotisme de Buckingham, favori du roi, engloutissant des fortunes pour son luxe, ses plaisirs et ses aventures guerrières, devait ouvrir la route à Cromwell et à la République.
On peut ne pas aimer Cromwell ; nous plaçant purement et simplement au point de vue Anarchiste, que de faits ne peut-on pas lui reprocher ! Mais il faut cependant reconnaître qu’il sut mettre un frein à la désorganisation de l’Angleterre et qu’il fit la grandeur de son pays. De son temps l’idée Anarchiste n’avait pas encore vu le jour, et lutter contre l’autorité royale, prendre position en faveur du Parlement, c’était porter un coup terrible au despotisme monarchiste, et préparer les luttes futures pour une liberté plus large.
Nous disons plus haut, que, historiquement, le règne de l’autorité est un facteur de désorganisation et que politiquement ce sont presque uniquement les questions financières qui désagrègent les’ Etats. On s’en rend compte assez facilement en étudiant le grand siècle de Louis XIV précédé par la dictature de Richelieu et de Mazarin.
Le grand Cardinal crut faire œuvre utile en détruisant la puissance politique du protestantisme, en abaissant l’orgueil de la noblesse et en préparant la royauté absolue de Louis XIV. En réalité, socialement, son activité fut inutile, et la rapacité d’un Mazarin qui réalisa une fortune de 200 millions de francs en pressurant le peuple, les dépenses fantastiques du roi Soleil, furent des facteurs de désorganisation aussi néfastes que les abus de la noblesse. On prétend que Richelieu fut un grand organisateur parce qu’il sut agrandir la France en lui adjoignant l’Alsace, la Lorraine et le Roussillon, alors que l’Alsace et la Lorraine sont des foyers d’incendie, de guerre, de désorganisation pour les pays qui se les disputent. Déjà à la fin du règne de Louis XIII et durant la régence d’Anne d’Autriche et de son amant Mazarin, on sentait bien que l’organisation de la France de Richelieu, reposait sur des sables mouvants. Si la Fronde fut une émeute d’ambitieux, il n’en est pas moins vrai que, au plus profond des couches populaires, elle fut une manifestation de liberté et le signe avant-coureur de la grande Révolution.
Le long règne de Louis XIV ne fit que précipiter la désorganisation de l’Etat ; les finances du pays, jetées en pâture à ses maîtresses et à ses bâtards, l’argent du peuple dilapidé, la révocation de l’Edit de Nantes et les dragonnades, qui eurent pour conséquence la ruine du commerce et de l’industrie, voilà l’œuvre de la monarchie absolue, préparée par Richelieu, et mise en action par le roi Soleil.
Le règne de Louis XV ne fut pas moins répugnant que celui de son aïeul, et le Gouvernement occulte de Mme de Pompadour marque l’apogée de la monarchie.
Louis XV souriait aux trésors de l’Etat engloutis par les largesses du « Parc aux Cerfs ». Elles montèrent à des sommes fabuleuses, disent les écrivains modérés. Trop connus, ces désordres répandirent la corruption et l’encouragèrent. Telle se montrait au dedans la royauté de Louis XV, et son rôle, au dehors, fut au niveau de tant d’opprobre.
« Notre diplomatie devint la risée de l’Europe. La défaite de Rossbach, 80 millions de subsides payés bénévolement à l’Autriche, des armées entières englouties dans des expéditions folles, 37 vaisseaux de ligne et 50 frégates pris ou détruits par les Anglais, le Canada par nous sacrifié définitivement à leur dictature avide, ainsi que la Martinique, la Guadeloupe, Tobago, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, nos comptoirs de l’Afrique et de l’Inde... Voilà, ce que produisit la guerre de Sept Ans, voilà ce que valut à la France le titre de ma bonne amie, donné par Marie-Thérèse à la maîtresse d’un roi absolu. » (Louis Blanc)
Ce spectacle de désorganisation n’est pas particulier à la France ; le principe d’autorité produisit partout les mêmes effets et nous ne croyons donc pas nous tromper en affirmant que l’autorité peut temporairement donner aux masses ignorantes l’illusion de l’ordre et de l’organisation, mais qu’en fin de compte il n’engendre que le désordre et la désorganisation.
Bismarck passa pour un grand organisateur parce qu’il sut habilement et avec diplomatie reconstituer l’Empire d’Allemagne en groupant autour de la Prusse tous les petits Etats d’ordre secondaire. Son œuvre fut couronnée à Versailles à la fin de la guerre de 1870–1871, mais ouvrait la voie à d’autres conflagrations et la reprise de l’Alsace et de la Lorraine conquises par Richelieu allait être le prétexte à de nouvelles tragédies, à des tueries grandioses, à la désorganisation économique et sociale du monde. Il peut sembler à certains que les sociétés modernes sont le symbole de l’ordre, mais pour nous, Anarchistes, qui étudions les faits, en recherchons les causes, nous ne pouvons qualifier d’organisée, une Société qui ne se maintient qu’en sacrifiant dans des guerres fratricides des populations entières, et qui périodiquement est obligée de se reconstituer géographiquement, sans que soit respectés les intérêts les plus élémentaires de la grande masse des individus.
La bourgeoisie et le capital n’ont rien à reprocher à la seigneurie et à la féodalité. La désorganisation préside de nos jours aux destinées humaines, comme elle y présidait dans le passé. Ni l’expérience, ni l’exemple de siècles et de siècles d’erreurs, de mensonges, de crimes n’ont assagi les hommes. Ils ont encore confiance et espèrent encore trouver la quiétude et le bonheur dans un ordre périmé, qui est le désordre, et dans une organisation absurde et dangereuse qui désagrège l’humanité.
Déjà avant la guerre de 1914–1918 qui sema tant de deuils, fertilisa la terre de larmes et de sang, et détruisit toute une génération on pouvait prévoir le chaos déterminé par la folie et l’ambition d’une minorité incapable de refréner ses bas instincts de jouissance, et d’une majorité impuissante à manifester son désir de paix et à imposer une forme d’organisation plus conforme aux nécessités d’un siècle de science et de progrès.
La chute se précipite. Sur la pente glissante de la désorganisation, la Société mourante qui marque la fin de ce vingtième siècle, si riche en découvertes de toute sorte, attend des événements, ou sa rénovation ou sa mort. Les finances de tous les grands Etats européens ont été dilapidées dans des aventures ridicules et meurtrières ; la diplomatie, dans un dernier spasme, cherche à sauver les apparences et à donner une certaine vitalité au capitalisme moribond qu’elle représente, mais cela ne peut durer. A mesure que nous avançons dans le temps, la désorganisation se poursuit sans qu’il soit possible aux hommes d’Etat d’en arrêter les effets qui mènent fatalement au désastre.
La grande guerre a passé par là. L’Allemagne de Bismarck — de Bismarck qui avait, comme Napoléon, rêvé de suprématie universelle — amoindrie par le traité de Versailles imposé par Clémenceau, se relève péniblement de la douloureuse équipée de son César déchu. La rançon que réclame d’elle les nations victorieuses accule à la misère toute la population travailleuse de ce grand Empire, qui est contrainte de peiner et de souffrir pour payer les crimes de ses maîtres.
L’Autriche, démembrée, divisée, traîne lamentablement derrière elle le boulet qui lui fut légué par François-Joseph, vieillard arriéré, perdu dans la tradition et dont le règne de 68 ans fut un long calvaire pour son peuple qui eut à subir tout le poids des guerres malheureuses déclenchées par ce prince impuissant.
L’Angleterre, dont la puissance reposait sur son vaste empire colonial, voit ce dernier lui échapper. Déjà elle a été obligée de faire des concessions et d’accorder une liberté relative à certaines de ses possessions. Le Canada, l’Australie, se sont dans une certaine mesure, libérés du joug britannique ; mais les Indes, l’Egypte, l’Irlande, sont agités par la soif de liberté, qui est un ferment de révolte. La puissante « organisation » de la perfide Albion apparaît menacée, et ne pourra résister bien longtemps à l’assaut coordonné des populations qu’elle opprime. L’Angleterre se désorganise, et même intérieurement elle souffre du malaise engendré par son impérialisme séculaire, qui lui valut une fortune temporaire, mais s’écroulera fatalement, comme tout ce qui est bâti sur l’autorité et son soutien : la violence.
L’Espagne, qui n’a pas comme la France, l’Angleterre et l’Allemagne, payé son tribut au Moloch durant les années pénibles de 1914 à 1918, ne se trouve pas dans une position plus heureuse. Le peuple maintenu dans l’ignorance et l’obscurantisme clérical, ouvre les yeux à la vérité et réclame son droit à l’existence. Le despotisme d’un dictateur ne peut rien pour équilibrer une situation qui a ses origines dans un passé noirci par les méfaits de la religion, et le général Primo de Rivera qui, de complicité avec le roi Alphonse XIII, cherche à rafistoler une monarchie branlante, apparaîtra dans l’histoire comme un fantoche malfaisant n’ayant d’autres soucis que celui de sauver de la ruine, non pas son pays et son peuple, mais la classe de parasites qui perpétue la misère collective de la nation.
Et il en est de même en Italie, où un Mussolini semble triompher, alors que son autorité criminelle ne peut engendrer que la chute un peu plus rapide du régime d’arbitraire qu’il dirige. Partout où sévit l’autorité règne la désorganisation. La France qui sortit victorieuse de la grande guerre n’est pas dans une situation plus brillante que les autres puissances européennes et sa débâcle financière l’entraîne au fond d’un gouffre duquel elle ne pourra s’évader. Des milliards de dettes contractées entre 1914 et 1925 auxquelles viennent s’ajouter celles antérieures à la guerre « du droit et de la liberté » lui interdisent l’espérance de réajuster la vie sociale, d’améliorer les conditions de vie du populaire et cet état déplorable ne peut aller qu’en empirant à moins que, dans un sursaut d’énergie, le peuple ne se réveille de sa torpeur et ne brise les liens qui le tiennent attachés à un passé de boue et de sang.
Seule, dans toute la vieille Europe désemparée, la Russie, sortant d’un sommeil de plusieurs années, sembla un moment éclairer l’avenir de son flambeau révolutionnaire. Mais, hélas!, les hommes nouveaux ne furent pas à la hauteur de leur lourde tâche, et leurs erreurs accumulées, jointes à la coalition extérieure des forces de réaction, devaient avoir raison de l’insurrection libératrice.
Dans ces conditions, est-ce trop dire, que la désorganisation politique de l’Europe de 1925 menace de déclencher de terribles cataclysmes et que l’avenir se dessine sombre et misérable pour les générations futures ?
Il y a pourtant un remède efficace à cet état de chose, mais il est curieux de considérer que le peuple s’éloigne de toute solution simple et se complait dans la difficulté.
Un fait est indéniable : c’est que le capitalisme est une forme d’économie sociale et politique qui ne répond plus aux exigences de l’humanité. Le capitalisme se décompose, tout son organisme embrouillé, rongé par le parasitisme administratif de ses institutions se désagrège et toute la compétence des économistes bourgeois est inopérante à rétablir de l’ordre dans un monde qui s’écroule sous le poids de son passé.
On peut opposer aux contempteurs de l’ordre capitaliste, l’exemple de l’Amérique, forte et puissante, sortie agrandie de la guerre de 1914. La force de l’Amérique n’est qu’une illusion. Son tour viendra. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l’Amérique aura son jour, son heure, et elle subira les mêmes tourments que la vieille Europe. Le fait même qu’elle ne peut satisfaire à ses besoins d’expansion commerciale et industrielle qu’en asservissant économiquement les nations européennes, marque bien que l’avenir n’épargnera pas les jeunes républiques américaines. Elles se suicideront dans leur course aux dollars ; c’est fatal, c’est inévitable.
Comment faire face alors à cette corruption politique qui détermine tant de conflits et qui a inscrit à son actif tant de ruines ? Détruire l’ordre bourgeois, abolir la puissance capitaliste n’est pas suffisant. C’est un travail utile, certainement, mais qui serait négatif en soi, si le peuple n’était pas capable de remplacer immédiatement l’ancien organisme par un organisme nouveau présentant un caractère de stabilité inébranlable.
Il faut opposer à ce que nous appelons le désordre et la désorganisation capitaliste, l’ordre et l’organisation sociale du peuple, mais encore faut-il ne pas commettre à notre tour les erreurs inhérentes à tout être humain et ne pas compromettre le futur par une politique pleine d’inconséquence.
Les Anarchistes ont critiqué et critiqueront encore toutes les formes d’organisation sociale qui reposent sur l’autorité et qui sont impuissantes à réaliser le bonheur de l’humanité. Le terrain que nous ensemençons a admirablement été défriché par nos aînés, et la période d’après-guerre, dans laquelle se débattent les gouvernants du monde entier, démontre que ceux qui nous ont précédés dans la lutte ne s’étaient pas trompés.
Tous les partis politiques ont fait faillite et le bolchevisme qui fut un moment l’espérance du monde du travail s’est définitivement discrédité. L’Anarchisme est donc la seule conception sociale susceptible de réussir là où échouèrent toutes les autres économies politiques, puisqu’il est incontestable que le socialisme qui a usé ses moyens en Angleterre et en Allemagne -voire même en France — n’a remédié à rien et que le communisme autoritaire n’a pas été -si nous considérons la fin — plus heureux en Russie.
Il faut, hélas!, reconnaître que l’influence exercée par l’Anarchisme sur les masses populaires est relativement faible et que la classe ouvrière sur laquelle reposent toutes les espérances d’avenir est elle-même désorganisée. Nous disons plus haut que détruire n’est pas suffisant, et pour reconstruire il est indispensable d’obtenir le concours du travailleur uni dans la bataille contre ses exploiteurs, et prêt à concourir à l’élaboration d’un monde meilleur. Or, le spectacle qu’offre la division du prolétariat mondial est pitoyable. Déchiré par les luttes politiques, le travailleur se livre sur lui-même à une opération désorganisatrice qui lui enlève toute sa force et, en se laissant diriger par des politiciens incapables, il abandonne toute sa puissance et en même temps toutes ses chances de libération économique et sociale.
La désorganisation ouvrière permit au capitalisme de retomber sur ses pieds au lendemain de la guerre de 1914 et, depuis 1920, par la trahison des chefs, par l’ambition de certains meneurs, la division n’a fait que s’accentuer. En France, le prolétariat est sectionné en trois tronçons qui se combattent sans s’apercevoir que ce manque d’unité permet aux classes dirigeantes de replâtrer le vieil édifice qui n’attend pour s’écrouler que la poussée du travailleur réconcilié.
Le travailleur, toujours confiant en la politique, se laisse aveuglément diriger vers des destinées inconnues et, malgré les déboires, continue à se laisser leurrer par cette politique qui est le principal facteur de désorganisation. Les Anarchistes ne sont pas sans avoir également une part de responsabilité dans la désorganisation du mouvement ouvrier et l’erreur de certains d’entre eux fut de vouloir prêter au syndicalisme une philosophie qu’il n’a pas et un but révolutionnaire qui n’est pas le sien. S’il est vrai que l’unique puissance capable d’être opposée au capitalisme est le prolétariat, ce dernier ne peut produire un effort qu’à l’unique condition de n’être pas divisé, et l’unité ne peut être obtenue que si ce syndicalisme, considéré comme un moyen, groupe en son sein les travailleurs de toutes tendances ; et si nous disons plus haut que les Anarchistes ont également une part de responsabilité dans la désorganisation ouvrière, c’est qu’à une époque donnée, eux aussi, animés par un sentiment sincère, confondirent le Syndicalisme et l’Anarchie.
Nous ne pouvons faire mieux, pour situer, à notre point de vue, la position de l’Anarchiste que de reproduire les paroles pleines de sagesse et de clairvoyance prononcées par Malatesta, au Congrès Anarchiste d’Amsterdam, en 1907.
« Je veux, aujourd’hui comme hier, que les Anarchistes entrent dans le mouvement ouvrier. Je suis, aujourd’hui comme hier, un syndicaliste, en ce sens que je suis partisan des syndicats. Je ne demande pas de syndicats anarchistes qui légitimeraient, tout aussitôt des syndicats socialistes, démocratiques, républicains, royalistes ou autres, et seraient, tout au plus, bons à diviser plus que jamais la classe ouvrière contre elle-même. Je ne veux pas même de syndicats dits rouges, parce que je ne veux pas de syndicats dits jaunes. Je veux au contraire des syndicats largement ouverts à tous les travailleurs sans distinction d’opinions, des syndicats absolument neutres ».
Malatesta voyait clair, et vingt ans après son discours d’Amsterdam, sa prophétie se réalisait. La classe ouvrière est désorganisée parce que les communistes ayant voulu donner au syndicalisme un but politique, « la dictature du prolétariat », une large fraction de travailleurs se sépara de l’organisation pour en fonder une autre. Et il n’y a pas de raison pour que s’arrête sur cette pente la division ouvrière.
« Donc je suis pour la participation la plus active au mouvement ouvrier. Mais je le suis avant tout dans l’intérêt de notre propagande dont le champ se trouverait ainsi sensiblement élargi. Seulement cette participation ne peut équivaloir en rien à une renonciation à nos plus chères idées. Au syndicat nous devons rester des Anarchistes dans toute la force et toute l’ampleur de ce terme. Le mouvement ouvrier n’est pour moi qu’un moyen — le meilleur évidemment de tous les moyens qui nous sont offerts. Ce moyen, je me refuse à le prendre pour un but, et même je n’en voudrais plus, s’il devait nous faire perdre de vue l’ensemble de nos conceptions anarchistes, ou plus simplement nos autres moyens de propagande et d’agitation.
« Les syndicalistes, au rebours, tendent à faire du moyen une fin, à prendre la partie pour le tout. Et c’est ainsi que, dans l’esprit de quelques-uns de nos camarades, le syndicalisme est en train de devenir une doctrine nouvelle et de menacer l’anarchisme dans son existence même.
« Je déplorais jadis que les compagnons s’isolassent du mouvement ouvrier. Aujourd’hui, je déplore que beaucoup d’entre nous, tombant dans l’excès contraire, se laissent absorber par ce même mouvement. Encore une fois, l’organisation ouvrière, la grève, la grève générale, l’action directe, le boycottage, le sabotage et l’insurrection armée elle-même, ce ne sont là que des moyens. L’Anarchie est le but. La révolution anarchique que nous voulons dépasse de beaucoup les intérêts d’une classe ; elle se propose la libération complète de l’humanité actuellement asservie, au triple point de vue économique, politique et moral. Gardons-nous de tout moyen d’action unilatéral et simpliste. Le syndicalisme, moyen d’action excellent à raison des forces ouvrières qu’il met à notre disposition, ne peut pas être notre unique moyen. Encore moins doit-il nous faire perdre de vue le seul but qui vaille un effort : l’Anarchie. » (Errico Malatesta)
Si nous avons cru devoir introduire dans cette brève étude sur la désorganisation, ce passage du discours du vieux camarade Malatesta, c’est que, si le syndicalisme de secte, de parti, n’a pas entièrement détruit le mouvement Anarchiste, s’il ne l’a pas désorganisé -l’organisation des Anarchistes étant toute récente — il est une menace constante contre notre mouvement, et la jeune organisation anarchiste périra ou restera embryonnaire, si elle subordonne son activité à celle d’un mouvement corporatif, syndical, sujet à changement, à modifications, à transformations, en vertu même des lois de la majorité qui déterminent l’action syndicaliste.
L’Anarchie doit rester elle-même. Elle ne peut être subordonnée, ni à la remorque d’un mouvement quelconque aussi important, aussi imposant soit-il. Les Anarchistes doivent s’unir, ils doivent s’organiser et envisager tous les problèmes d’avenir, afin de ne pas être surpris par les événements qui, souvent, n’attendent pas les décisions humaines, et précipitent les individus désemparés dans le chaos.
La société bourgeoise se meurt, sa désorganisation est totale, elle ne peut remonter le courant qui l’entraîne à la dérive. C’est une question de temps, de jours peut-être, et il faut être prêts.
Les Anarchistes seront-ils capables de mettre fin à la gabegie capitaliste et de résister à tous leurs adversaires politiques qui entendent élaborer le monde nouveau sur une autorité qu’ils qualifient de socialiste ? Qui sait ? Quoi qu’il en soit, le désordre et la désorganisation ne disparaîtront qu’avec l’autorité, et l’organisation sociale n’assurera le bonheur de l’humanité que lorsque les hommes pourront jouir pleinement de leur liberté économique et morale.
- J. CHAZOFF.
DESPOTISME
n. m. (du grec : despotès, maître)
Pouvoir d’un despote. Exercice absolu et arbitraire du pouvoir. Forme de gouvernement où tous les pouvoirs sont abandonnés entre les mains d’un seul individu. Le despotisme de Louis XIV. Le despotisme de Napoléon 1er.
Ayant rappelé que de Jules César à Vespasien « aucun empereur ne mourut que de mort violente », que depuis la ruine de la liberté romaine jusqu’à Charlemagne, trente empereurs furent massacrés, Mirabeau ajoute :
« Il faudrait bien du courage aux despotes s’ils réfléchissaient sur les suites du despotisme. »
Il serait, certes, préférable que les despotes réfléchissent. Ce serait un bienfait pour le peuple et avantage pour eux. Mais malheureusement, l’exemple du passé, la fin tragique de certains de leurs prédécesseurs n’arrêtent pas le despotisme des tyrans qui gouvernent le monde par la violence et la brutalité. Ce n’est pas le courage qui anime le despote, mais la lâcheté.
Quelle piètre figure que celle de ce Néron qui, après une vie de débordements, de cruautés et de débauches hésita à se donner la mort, lorsqu’il apprit que le Sénat l’avait déclaré « ennemi de la patrie » et qu’il allait expier les crimes commis durant son règne ! Et Louis XI, monarque méchant et vicieux, qui, après avoir terrorisé son royaume par sa barbarie, trembla devant la mort, et se livra durant des années à ses dévotions superstitieuses dans son château de Plessis-Lès-Tours ! Et la fin du roi Soleil, du grand roi, qui pendant 60 ans, appauvrit la France, affama ses sujets, martyrisa le peuple, et fut effrayé lorsqu’à 77 ans, il dut quitter cette vie qu’il combla de son luxe et de ses crimes !
Comme tous les maux qui ravagent l’humanité, le despotisme découle du principe d’autorité et nous avons constamment dénoncé les méfaits déterminés par l’application de ce principe. Tout être auquel on abandonne une parcelle d’autorité est enclin à abuser des pouvoirs qui lui sont conférés ; il n’y a donc pas lieu de s’étonner qu’un homme auquel on donne toute licence pour diriger une Nation, un Etat, qui n’est soumis à aucun contrôle, qui n’a à répondre devant personne de ses gestes, de ses actions, abuse de ce pouvoir. L’histoire nous a suffisamment édifiés sur les désastres causés par le despotisme et il semble cependant que les peuples n’ont pas appris grand chose à son étude. Ils se laissent encore, de nos jours, mener par les despotes qui poursuivent l’œuvre de destruction sociale.
On peut comprendre que dans le passé — l’ignorance étant un facteur de despotisme — les hommes se soient laissé gouverner aveuglément par des tyrans ; mais comment admettre, qu’en notre siècle de progrès et de science, où le peuple a, malgré tout, la possibilité de se livrer à certaines recherches, où la lecture lui fournit un bagage de connaissances que ne possédaient pas ses aînés, il consente encore à être conduit comme un vil bétail, et s’agenouille devant ses bergers qui l’exploitent et le tuent. C’est inconcevable, et cette passivité ne peut être mise que sur le compte de sa lâcheté et de sa paresse politique.
Comme tout ce qui est abusif, le despotisme n’a qu’un temps, et détermine une réaction, toujours violente. C’est ce qui explique que, dans les pays où il s’exerce on assiste fréquemment à des attentats ou à des complots. Nous savons que ni le complot, ni l’attentat, ne peuvent être considérés comme un but, et que seule la révolution sociale peut libérer l’humanité et permettre l’éclosion d’une société meilleure. Nous avons signalé que le despotisme ne s’exerce que favorisé par la lâcheté de la grande majorité du peuple et nous avons déjà dit que dans les pays où la liberté la plus élémentaire est férocement brimée, où il est impossible aux travailleurs de s’exprimer librement par l’organe de la presse, où le droit de réunion est interdit, où la dictature règne en maîtresse ; partout où tous les autres moyens se sont manifestés inopérants, et où il est indispensable que la Révolution vienne, de son souffle énergique et puissant, balayer l’air, pour en chasser les miasmes du despotisme, on ne voit pas quels autres procédés que le complot, signe avant-coureur des révoltes fécondes, peuvent être employées. (Voir Complot, page 380).
On trouvera en outre à la page 178, la liste de certains attentats qui ont été déterminés par le despotisme.
Pourtant le despotisme a évolué, il évolue chaque jour et n’emprunte pas à présent les mêmes formes que dans le passé. Le peuple qui s’est nourri depuis quelques années du lait démocratique, accepte d’être gouverné, mais se refuse à admettre qu’il est un esclave à la merci de ses maîtres. Il subit la main de fer à condition cependant qu’elle soit recouverte du gant de velours. Et les maîtres font cette concession au peuple, Ils portent le gant. Le résultat reste le même, si les formes ont changé.
Le despotisme d’un Bonaparte apparaît mesquin et petit à côté de celui des gouvernants modernes. Les ruines accumulées durant le premier empire ne sont rien à côté de celles engendrées par la folie furieuse des chefs d’Etat, républicains ou royalistes, qui déclenchèrent la grande tuerie de 1914. Il est évident que si l’on avait dit au peuple qu’il devait se battre, pour Guillaume II ou pour Poincaré, il eût sans doute refusé. Il eût hésité à abandonner sa terre, son foyer, sa famille, pour défendre l’honneur d’un quelconque tyran ; mais le despotisme s’est modernisé, avons-nous dit, et les hommes du monde entier sont partis au massacre, parfois en chantant, avec la douce illusion de se sacrifier pour une cause juste, alors qu’en réalité ils allaient se faire tuer pour un despote occulte, resté dans l’ombre, caché dans les plis du drapeau démocratique, pour un despote plus cruel, plus meurtrier, plus barbare, que tous ceux du passé : le capital. Pendant quatre années, les maîtres invisibles du monde exerçant leur despotisme, jetèrent en pâture au Dieu de la guerre, des millions et des millions de jeunes êtres virils, ils livrèrent à la dévastation des millions d’hectares de terre cultivable, ils arrêtèrent toute la production utile du monde, et cependant l’exemple n’est pas encore suffisant, et l’expérience tragique n’a pas su inspirer à la collectivité une haine farouche contre l’autorité qui, fatalement, devient abusive et se transforme petit à petit en despotisme.
Nous pouvons dire aujourd’hui que le despotisme, n’est pas la manifestation du pouvoir absolu abandonné entre les mains d’un seul individu, mais d’une minorité qui exerce son pouvoir, par l’intermédiaire d’un homme de paille, placé à la tête d’un Gouvernement.
Mussolini est un despote, mais il n’est pas le despotisme, il est un agent du despotisme ; son autorité est subordonnée à celle d’une catégorie de dirigeants obscurs : banquiers, financiers, industriels, qui tirent les ficelles et dirigent toute la politique intérieure et extérieure de la Nation. Est-ce à dire qu’il est irresponsable ? Non pas. Il porte, au contraire, une grosse part de responsabilité dans les actes criminels du despotisme, mais sa disparition ne marquerait pas la fin du despotisme et, derrière lui, apparaîtrait immédiatement un autre pantin qui se livrerait aux mêmes inconséquences et aux mêmes abus. Il en est de même, pour le fantoche espagnol, qui mène son pays à la ruine. Primo de Rivera peut s’effacer, les ravages du despotisme ne s’arrêteront, que lorsque le despotisme sera écrasé sous le talon populaire..
Ne confondons donc pas les effets et les causes. C’est à la source qu’il faut remonter pour trouver une solution logique et raisonnable, et c’est parce que toutes les écoles politiques ct sociales s’y refusent, qu’elles sont incapables de résoudre le problème posé depuis si longtemps devant l’humanité.
A quoi bon s’élever contre la tyrannie d’un despote, contre l’exercice arbitraire d’un pouvoir si les remèdes que l’on apporte ne sont pas susceptibles d’arrêter le mal ? A quoi bon protester contre les abus, contre les crimes du despotisme, si toutes les formes de gouvernement qu’on lui oppose, renferment également le virus malfaisant oui inévitablement, engendrera, en évoluant, les mêmes méfaits ? La politique du moindre mal est à nos yeux ridicule et dangereuse, car elle donne au peuple une espérance stérile, qui ne se traduit en fin de compte que par la désillusion et le découragement.
« A quoi bon changer, dit le peuple, c’est toujours la même chose ! » C’est toujours la même chose, parce qu’il le veut ainsi ; c’est toujours la même chose parce qu’il se refuse à écouter la voix de la raison ; c’est toujours la même chose, parce que après avoir été trompé par Pierre, il consent à être trompé par Paul et ne veut pas trouver en lui la force et l’énergie de détruire les causes déterminantes de sa souffrance et de sa misère. C’est toujours la même chose parce qu’il ne veut pas que ça change.
Le despotisme peut disparaître, doit disparaître. Il peut céder la place à une forme d’organisation répondant au désir de liberté de la collectivité, mais il ne suffit pas pour cela du courage et de l’héroïsme de quelques individus qui, se sacrifiant, débarrassent de temps à autre l’humanité d’un despote, car le despotisme survit au despote. Il faut la force coalisée de tous les opprimés, de tous les parias, la révolte consciente de tous les hommes nouveaux et d’avenir, pour monter à l’assaut du Capital et de l’Autorité qui en sont les causes déterminantes. Alors, le despotisme aura vécu.
DESSEIN
n. m.
Le mot dessein signifie : projet, intention résolution. Avoir de grands desseins, de beaux desseins, de nobles desseins, des desseins hardis, de sombres desseins.
Ne fut jamais, seigneur, conçu dans votre sein.
RACINE.
Mettre ses desseins à exécution, c’est-à-dire exécuter ce que l’on avait conçu, prémédité, arrêté, envisagé. Nourrir de sinistres desseins à l’égard de quelqu’un, c’est-à-dire chercher des moyens de lui nuire, de lui faire du mal.
Les desseins de Dieu sont impénétrables, disent les croyants. Mais ceux des hommes qui font commerce de la religion ne le sont pas et il est triste de constater qu’ils viennent souvent à bout de ces desseins, qui consistent à abêtir le peuple pour le mieux maintenir dans l’esclavage. Et les prêtres qui nourrissent d’inavouables desseins sont nombreux. Ils ne se rencontrent pas seulement dans les églises où les fidèles idolâtrent des dieux spirituels mais aussi dans les églises civiles, plus dangereuses peut-être que les autres. Les desseins du politicienqui siège au Palais-Bourbon, à l’extrême-gauche ou à l’extrême-droite, ne sont pas moins intéressés que ceux d’un quelconque curé ou pasteur, et les plans qu’il élabore sont tous destinés à lui assurer une vie large et facile, au détriment de la masse d’aveugles qui l’adorent.
Et le peuple, lui, n’a pas de desseins bien définis et c’est la cause pour laquelle il est facile de l’exploiter. Lorsqu’il aura formé le dessein de se libérer, et travaillera courageusement à sa réalisation, alors seront voués à un échec certain tous les sombres desseins de ses oppresseurs.
DESSIN
n. m.
Le dessin est l’art d’imiter, en se servant de lignes, la forme des choses, des objets, des individus. Avec la musique, le dessin a dû être le premier des arts, car s’il fut de tous temps naturel à l’homme de manifester sa joie ou sa peine, sa gaîté ou sa tristesse, par des cris, des sons, des intonations, aux époques reculées de l’humanité, alors que les progrès de la civilisation n’avaient pas encore apporté à l’individu un bagage suffisant de connaissances, le dessin a été pour lui l’unique moyen de conserver la forme d’êtres ou d’objets qui lui étaient chers, ou encore de manifester ses désirs et ses besoins lorsque la parole n’arrivait pas à refléter sa pensée.
Certains historiens prétendent que le dessin fut inventé par une jeune fille grecque qui, voulant conserver les traits de son amant, traça sur le mur le contour le son ombre. Cette explication est sans fondement et il nous semble que l’on ne peut attribuer à personne l’invention du dessin qui se perd dans la nuit des temps ; le plus raisonnable est de supposer que, aux âges les plus lointains de l’histoire, l’homme a cherché à imiter, sur le sable ou sur la pierre, l’image qui se présentait à lui sous une forme quelconque.
Ce qui est certain, c’est que le dessin a précédé la sculpture et la peinture, dont il est le principe fondamental et, bien que peu expressif et plutôt grave, il présentait déjà un certain esprit artistique chez les Egyptiens. Il acquit par la suite de la souplesse, de la beauté et de l’élégance pour arriver à atteindre de nos jours au plus haut degré de perfection.
Il y a plusieurs sortes de dessins. Le dessin au crayon, à la plume, à l’estompe, etc., etc., mais, quelle que soit sa qualité, il nécessite de la part de celui qui l’exerce une connaissance assez étendue de l’anatomie, de la perspective et de l’expression, pour rendre et reproduire les caractères, les mouvements et les gestes d’une façon naturelle et artistique.
Le dessin n’offre pas seulement des satisfactions à la vue et à l’esprit, il trouve aussi son utilité dans l’industrie. Les progrès de la science, et plus particulièrement du machinisme dans toutes ses manifestations, nécessite l’emploi d’une armée de dessinateurs, qui ne doivent pas être seulement des artistes, mais aussi des techniciens. La connaissance du dessin géométrique facilite la tâche de l’ouvrier qui a à fabriquer une pièce quelconque et son étude ne saurait trop lui être recommandée, car i1 tient lieu de parole et d’écrit dans tous les arts mécaniques.
Le dessin est donc un art utile et agréable, qui nous offre de multiples jouissances à tous les moments de notre existence. Si la maison que nous habitons a été, avant d’être bâtie, dessinée sur le papier par les soins de l’architecte, le papier peint qui couvre les murs de nos appartements et qui égaie un peu le modeste logis du travailleur, est également dû au dessin de l’artiste ignoré et inconnu qui a su combiner les quelques couleurs mises à sa disposition. Et il en est de même pour les étoffes que nous portons, pour les broderies et les dentelles qui ornent le linge, pour les tapis, enfin pour tout ce qui nous entoure et flatte notre vue. Le dessin est donc utile, nécessaire, indispensable au peuple, puisqu’il lui procure certaines satisfactions et si tous les dessinateurs ne sont pas de très grands artistes et si les Michel Ange, les Léonard de Vinci et les Raphaël, sont rares, il n’en est pas moins vrai, que nous bénéficions à chaque instant, du travail des modestes artisans, qui, à la plume ou au crayon, exécutent pour nous, pour frapper notre sensibilité, une figure ou une fleur, un animal ou un paysage, ou tout autre objet imaginaire.
Pourquoi faut-il que comme celui de l’écrivain et du journaliste, le crayon du dessinateur se prostitue et se prête à l’accomplissement d’œuvres inhumaines ? L’avion qui viendra demain bombarder les villes et les campagnes, le canon qui crachera sa mitraille, furent, eux aussi, exécutés sur le papier, avant d’avoir été façonnés par la main de l’ouvrier. Chacun, hélas!, a sa part de responsabilité dans les actions nuisibles qui engendrent les désastres et les catastrophes, et ce n’est que par l’accord du travailleur manuel et intellectuel, qui ont chacun, leur place et leur utilité dans la société, que l’on arrivera, un jour, à vivre harmonieusement. Alors, le dessin célèbre de Villette représentant des anges bourrant la gueule du canon avec des gerbes de blé, ne sera plus un rêve mais une réalité.
DESSOUS
n. m.
Partie inférieure d’un objet. Le dessous de la chaise, le dessous de la table. Au figuré être au-dessous, signifie, être plus bas dans l’ordre hiérarchique de l’échelle sociale. Un ouvrier est au-dessous d’un contremaître ; un contremaître est au-dessous d’un directeur. A l’armée un soldat est au-dessous d’un caporal, un caporal est au-dessous d’un sergent et ainsi de suite. Il n’y a qu’au-dessous du simple soldat et de l’ouvrier qu’il n’y a plus rien, ni personne.
Il est un proverbe qui dit « qu’il ne faut jamais regarder au-dessus de soi, mais toujours au-dessous, si l’on veut être heureux ». Cette conception du bonheur n’a pu germer que dans l’esprit maladif d’un conservateur quelconque considérant sans doute que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Car, en vérité, si le peuple souffre et s’il est malheureux, c’est uniquement parce qu’il ne veut pas regarder au-dessus de lui et qu’il reste aveuglément étranger à tout ce qui l’entoure.
Il m’est arrivé parfois, durant de belles et chaudes après-midi de printemps ou d’été, et lorsque mes loisirs me le permettaient, de me promener dans les quartiers aristocratiques de la capitale. Il m’est arrivé de me perdre dans le Parc Monceau, ce coin superbe du cruel Paris et d’y rêver à l’ombre des grands arbres fleuris. Tout autour de moi, je contemplai les mines saines et joyeuses, resplendissantes de santé de toute cette jeunesse riche, à laquelle rien ne manque et qui évolue et qui grandit gâtée, choyée, sans que jamais l’ombre d’un désir inassouvi vienne troubler le bonheur et la quiétude. Et immédiatement, par la pensée, je me revoyais dans les autres quartiers de la ville lumière, dans les quartiers ouvriers, populeux, où les enfants manquent souvent du nécessaire et de l’indispensable. Et je me disais que si le peuple savait regarder au-dessus de lui, il ne serait pas possible que persistât une telle inégalité sociale.
Il faut regarder au-dessus de soi. Regarder en bas c’est s’abaisser, regarder en haut c’est se grandir. Nous sommes des révolutionnaires, non pas parce que nous voulons que la bourgeoisie partage le sort du peuple, mais pour que le peuple participe à toutes les joies, à tous les bonheurs, et qu’il partage le sort matériel de la bourgeoisie. Le travail pourrait procurer à chacun une somme de bienfaits incalculables, si les privilèges ne venaient pas diviser en classes une humanité où les individus perdent leur temps à se déchirer comme des bêtes féroces.
Mais le peuple ne sait pas et ce qu’il y a de plus terrible, c’est qu’il ne veut pas savoir. Si, en ce qui concerne son bien-être, il doit regarder au-dessus de lui en ce qui regarde la politique il lui serait profitable d’en étudier les dessous. Mais, à quoi bon ? On désespère parfois, en constatant la passivité avec laquelle le peuple se laisse berner, sans vouloir écouter les conseils désintéressés qui lui sont offerts. Déjà. en 1883, il y a donc près de cinquante ans, le célèbre pamphlétaire, Octave Mirbeau, écrivait :
« Ô bon électeur, inexprimable imbécile, pauvre hère, si au lieu de te laisser prendre aux rengaines absurdes que te débitent, chaque matin, pour un sou, les journaux, grands ou petits, bleus ou noirs, blancs ou rouges, et qui sont payés pour avoir ta peau ; si au lieu de croire aux chimériques flatteries dont on caresse ta vanité, dont on entoure ta lamentable souveraineté en guenilles, si, au lieu de t’arrêter, éternel badaud, devant les lourdes duperies des programmes ; si tu lisais parfois, au coin de ton feu, Schopenhauer et Max Nordeau, deux philosophes qui en savent long sur tes maîtres et sur toi, peut-être apprendrais-tu des choses étonnantes et utiles. Peut-être aussi, après les avoir lus, serais-tu moins empressé à revêtir ton air grave et ta belle redingote, à courir ensuite vers les urnes homicides où, quelque nom que tu mettes, tu mets d’avance le nom de ton plus cruel ennemi. Ils te diraient en connaisseurs d’humanité, que la politique est un abominable mensonge, que tout y est à l’envers du bon sens, de la justice et du droit, et que tu n’as rien à y voir, toi dont le compte est réglé au grand livre des destinées humaines. » (Octave MIRBEAU)
Et le peuple n’a pas suivi les bons conseils de Mirbeau ; il n’a pas lu Schopenhauer, il n’a pas lu Nordeau et il est resté dans son ignorance. Il ne connaît rien des dessous de la politique et de la finance et pourtant il a eu sous les yeux des exemples symboliques de la corruption politique.
Puisons dans un vieil ouvrage de Francis Delaisi, aujourd’hui introuvable : La démocratie et les Financiers, un cas typique des dessous parlementaires. Le cas cité par Francis Delaisi fut étalé à la suite d’un procès retentissant entre M. Charles Humbert, alors sénateur de la Meuse et le journal qui dit tout, qui sait tout : le Matin.
« M. le sénateur Humbert est comme il le dit lui même, un « enfant du peuple ». Engagé dans l’armée comme simple soldat, puis élève à l’école Saint-Maixent, puis officier d’ordonnance du général André, enfin secrétaire général du Matin, député puis sénateur, il n’a, il l’avoue, aucune fortune personnelle. Pour entrer au Parlement, il a dû renoncer au métier militaire, qui était son seul gagne-pain.
Il n’a donc comme ressources normales que :
-
Son indemnité parlementaire, soit 15.000 Fr.
-
Le revenu de la dot de Mme Humbert qu’il évalue lui-même à 2.500 Fr.
TOTAL : 17.500 Fr.
Or, il dépense pour son train de maison :
-
Pension de Madame … 18.500
-
Appartement personnel … 5.000
-
Habillement, logement, chaussures … 1.500
-
Nourriture … 3.000
-
Villégiature … 1.200
-
Assurance sur la vie … 1.600
-
« Membres pauvres de ma famille » … 1.500
-
Divers (demi-londrès, etc.) … 2.000
TOTAL : 33.800
On le voit pour un homme sans fortune, notre sénateur a un joli train de maison.
En outre, il lui faut :
-
Un bureau rue de Madrid … 1.800
-
Secrétaire, garçon de courses, sténographe, frais de bureau, chauffage, timbres … 15.000
-
Automobile … 5.000
-
Voitures … 750
TOTAL … 22.500
Enfin, il ne faut pas oublier qu’on a un département à visiter, des électeurs à satisfaire :
-
Logement à Verdun … 1.800
-
Habillement des pauvres de l’arrondissement … 1.500
-
Secours aux miséreux de l’arrondissement … 750
-
Sociétés patriotiques, concours, etc. … 750
-
Prix aux élèves des écoles primaires … 500
-
Fournitures scolaires … 250
-
Bienfaisance … 500
-
Voyages à Verdun … 1.800
TOTAL : 7.850
En somme, notre sénateur dépense :
-
Train de maison … 33.800
-
Frais de bureaux … 22.550
-
Frais électoraux …7.850
TOTAL : 64.200
Réduit à son indemnité parlementaire et à la dot de sa femme (en tout 17.500 Fr.), M. le Sénateur Humbert serait donc en déficit chaque année de 46.700 francs.
Or, il accuse un bénéfice net de 2.300 francs. Comment s’opère ce miracle ? D’où viennent donc ces 49.000 francs de boni ?
Remarquons d’abord que l’indemnité parlementaire n’y est pour rien.
<verbatim>M.<verbatim> Humbert avoue 7.850 Fr. de frais électoraux annuels. C’est déjà plus que la moitié de son traitement de sénateur. Mais il oublie quelque chose : son élection lui a coûté quelques billets bleus. Ses adversaires disent 100.000 à 300.000 francs…
Heureusement, nos « honorables » sont débrouillards ; ils savent se retourner. M. Charles Humbert ne gagnant rien comme sénateur, et ayant donné sa démission d’officier, s’est fait journaliste et publiciste.
A ce titre :
-
La Lanterne lui donne … Fr. 1.800
-
La Correspondance Républicaine … 1.800
-
La Grande Revue … 3.000
-
Journaux étrangers … 1.400
-
Son livre : Sommes-nous défendus ? … 3.000
-
Les Vœux de l’Armée … 1.500
TOTAL : 12.500
D’autre part, MM. Darracq et Serpollet, gros fabricants d’automobiles, viennent d’inventer un type de camions dits : « poids lourds » destinés au transport de grosses charges, et ils désirent en faire acheter un lot par le ministère de la Guerre. Mais pour cela, il faut que le Parlement vote les crédits nécessaires : on nommera une Commission ; la Commission désignera un rapporteur ; il faut s’entendre avec ce rapporteur. Or, il se trouve précisément que M. le Sénateur Humbert est rapporteur du budget de la guerre. C’est donc à lui qu’il faut s’adresser.
C’est ainsi que fut signé le traité que toute la Presse a publié :
MM. Darracq et Serpollet, donnent à M. Charles Humbert, le titre d’agent général de leur maison, avec 12.000 francs d’appointement fixe, plus tant pour cent sur les camions vendus… D’autre part, le Journal n’hésite pas à offrir 18.000 francs par an au rapporteur Charles Humbert, comme rédacteur spécialiste des questions militaires.
Résultat :
-
Quelques camions vendus … Fr. 7.500
-
Des mitrailleuses et autres valeurs industrielles qui rapportent … 1.500
-
Appointements fixes comme agent général … 12.000
-
Comme rédacteur au Journal … 18.000
-
Journalisme politique … 12.500
TOTAL : 51.500
(Puisé dans la Démocratie et les Financiers de Francis Delaisi, Edition de la Guerre Sociale, 1911)
Est-ce clair, est-ce net, est-ce précis ? Ces chiffres sont d’avant-guerre, mais ils sont suggestifs et démontrent lumineusement ce que sont les dessous de la politique. Et M. Charles Humbert n’est pas une exception. Il n’est ni plus mauvais ni meilleur que les autres politiciens. Tous se valent, tous tripotent, tous participent à de louches affaires que le naïf électeur ne soupçonne même pas.
Dans toute affaire politique il y a la combine ; dans toute élection un abject marchandage pour arriver le plus près possible de l’assiette au beurre, et il n’est pas de députés ou de sénateurs qui ne se soient laissés peu ou prou, corrompre, au cours de leur carrière. Les dessous de la politique sont ignobles et cependant les scandales qui éclatent de temps à autre ne semblent pas soulever dans la population l’indignation que l’on serait tenté de supposer. Le peuple assiste, indifférent, à toute cette bassesse, à toute cette corruption.
Il est parti, en 1914, à la guerre, sans en connaître les causes déterminantes, sans savoir pourquoi il allait se battre ; il est revenu, affaibli, fatigué, sans rien dire, sans protester, sans demander des comptes à ses bourreaux, et la tragédie continue comme par le passé.
A la grande guerre du droit et de la liberté, ont succédé d’autres petites guerres, dites civilisatrices : la guerre du Maroc, la guerre de Syrie, la guerre de Chine, qui se poursuivent encore, et si le peuple n’a pas eu connaissance des dessous qui ont déterminé la boucherie de 1914 ; il ne connaît pas plus pour quels intérêts inavoués il va se faire tuer en Syrie ou en Chine. Qu’attend-il ? Que toute l’humanité soit noyée dans le sang ? Qu’il soit réduit à l’état de l’esclave préhistorique ? Cela ne pourrait tarder. Encore quelques années d’un tel régime, et il ne pourra plus se relever. Il sera la bête de somme qui traîne son lourd fardeau, et sa chaîne sera si fortement imprimée dans sa chair qu’il ne pourra plus en effacer la, trace.
Qu’il brise le paravent, qu’il jette un regard dans les coulisses, qu’il retourne les cartes, pour qu’au grand jour il puisse travailler au bonheur social ; c’est le rôle historique du peuple, c’est le devoir et la tâche qu’il a à remplir, s’il ne veut pas sombrer dans la plus profonde des misères et s’il ne veut pas assister à la décadence de l’humanité.
DESTIN
n. m. (du latin destinare qui signifie : destiner, arrêter, fixer, décider)
Aux yeux de quantité de gens, le destin est une suite d’événements, de phénomènes, heureux ou malheureux, tracés à l’avance sur le grand livre de la vie, par une puissance obscure, et contre lesquels il est inutile de lutter, ou d’opposer la moindre résistance, ceux-ci devant se manifester et se produire en vertu d’une fatalité inéluctable.
Ce qu’il y a de plus curieux, c’est que des êtres qui s’imaginent être libérés dé toute croyance religieuse, de tous préjugés, se refusent à admettre que le destin n’est que l’enchaînement des effets et des causes, et si pour eux l’idée du destin ne personnifie pas la providence, ils n’en sont pas moins convaincus que tout dans l’existence est réglé, et que les arrêts du destin sont invariables, irrévocables.
« Il faut se soumettre à son destin. »
« La plainte ni la peur ne changent le destin. » (La Fontaine)
Tel est l’esprit qui a dominé le monde pendant des siècles et qui exerce encore une influence considérable. Pour nous, une telle conception du destin est rétrograde et celui qui la partage, ne peut être qu’imprégné, à son insu, des vieilles idées religieuses.
D’autre part, cette croyance aveugle en son destin, ou en la destinée des êtres et des choses, est un facteur, de faiblesse, de lâcheté et d’asservissement. Que de fois n’avons-nous pas entendu, et plus particulièrement lorsque l’on s’adresse au travailleur pour lui faire entrevoir sa condition inférieure et misérable, que le destin le voulait ainsi, et que, quoi qu’on dise ou quoi qu’on fasse, cela ne changera jamais ?
C’est cette idée, imprimée dans le cerveau des opprimés par des siècles et des siècles d’esclavage, qu’il faut énergiquement combattre. Il faut lutter contre cette ignorance, qui arrête toute velléité de révolte chez le travailleur et lui fait accepter son sort avec passivité.
Aucune force occulte ne nous dirige, aucune puissance extérieure ne nous guide. Tout est déterminé dans la vie, et le bonheur des hommes, ne peut être, n’est et ne sera que le produit, le fruit, de leur travail.
Si les serfs du moyen âge, si nos aînés du XVIIIème siècle s’étaient endormis dans leur souffrance, s’ils avaient attendu les « arrêts du destin », nous n’en serions pas aujourd’hui à bénéficier des quelques bienfaits dus à leurs révoltes, et au progrès de la science et de la civilisation. « Ce sont les hommes eux-mêmes qui s’attirent leurs maux », ce sont eux aussi qui forgent leur bonheur.
« Nulle main ne nous dirige, nul œil ne voit pour nous ». Sachons nous diriger, et sachons écarter le voile qui fut placé devant nos yeux pour nous cacher la vérité. La force du destin est une croyance indigne d’un siècle de science et de philosophie, c’est un vestige du temps passé, qui fut utilisé pour maintenir les esclaves sous le joug de leurs maîtres, pour dominer les parias, et pour refréner leurs légitimes élans de révolte ; mais aujourd’hui, les opprimés doivent étancher leur soif de libération ; ils doivent savoir et, s’ils ne savent pas, apprendre que la vie est une suite de phénomènes déterminés, qui s’enchaînent les uns aux autres et que l’homme possède en lui la force et la puissance de déterminer certains de ces phénomènes.
« L’homme a besoin de se sentir grand, d’avoir, par instant, conscience de sa sublimité et de sa volonté. Cette conscience, il l’acquiert dans la lutte : lutte contre soi et contre ses passions, ou contre des obstacles matériels et intellectuels. Or, cette lutte, pour satisfaire la raison, doit avoir un but. L’homme est un être trop rationnel pour approuver pleinement les singes du Cambodge jouant par plaisir avec la gueule des crocodiles. » (J.-M. Guyau)
Et Guyau a raison, la conscience ne s’acquiert que dans la lutte, et la lutte doit avoir un but. Ce but pour nous, c’est la libération totale du genre humain, et il n’est pas possible que nous ne l’atteignions pas.
L’homme a lutté contre des forces naturelles ; il a triomphé et est arrivé à les asservir. Ayant triomphé de forces, de causes et d’effets indépendants de sa volonté, il arrivera à vaincre les effets et les causes qu’il engendre lui-même et dont il est la victime. Il porte son destin avec lui et, selon son vouloir sa volonté, son pouvoir grandira, il arrivera à se libérer de toutes les contraintes exercées sur lui par ses semblables, et sa destinée lui apparaîtra douce et harmonieuse.
DESTITUTION
n. f. (du latin destitutio)
Dépourvoir, priver quelqu’un de son emploi, de sa charge ou de sa fonction. Prononcer la destitution d’un monarque, d’un préfet, d’un maire, d’un fonctionnaire, etc...
Dans notre belle république, se réclamant pourtant de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, il n’est pas rare de voir des fonctionnaires être destitués en raison de leurs opinions politiques. Il est fréquent que, dans des mouvements de grève, par exemple, lorsque le maire d’une cité se refuse à user de son autorité et de son influence au profit des employeurs, on voie le préfet, représentant direct du Gouvernement, le destituer de sa charge.
Mais toute puissance gouvernementale est éphémère.
Nous avons vu, dans le passé, que des despotes, des autocrates, des dictateurs ont été destitués ; des monarchies se sont écroulées par la volonté du peuple, et il y a peu de temps encore, Guillaume II, empereur d’Allemagne fut obligé d’abandonner le pouvoir et, quelques mois avant lui, l’empereur de toutes les Russies cédait la place à la révolution triomphante. Le travail n’est pourtant pas terminé. La destitution de tous les petits monarques de la démocratie s’impose pour que les peuples soient heureux et libres. Les capitalistes doivent être destitués de leurs privilèges, et alors seulement, lorsqu’auront disparu toutes les formes de l’autorité, la Révolution aura accompli son œuvre.
DESTRUCTION
n. f. (du latin destructio)
Action de détruire, d’abattre, de démolir, de ruiner, d’anéantir, de faire disparaître une chose quelconque. La destruction d’une maison, d’un édifice, d’un palais, d’un empire, d’animaux nuisibles, d’un régime, etc., etc....
La nature impitoyable, indifférente et indomptée, accomplit parfois un tragique travail de destruction. Les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les raz de marée, les typhons détruisent souvent des villes entières et provoquent des ravages que les forces et le génie humains sont impuissants à surmonter.
S’il est impossible à l’homme d’arrêter les désastres et les fléaux naturels, du moins devrait-il s’attacher à ne pas se joindre aux éléments déchaînés, pour ajouter encore à la misère humaine ; mais il semble, au contraire, que l’homme se plaît également à détruire et aussi loin que nous plongions dans son histoire, nous le voyons poursuivre une œuvre de destruction.
L’ambition des puissants, la soif de domination engendre les guerres, et à travers les âges, le grand livre de la civilisation est taché par le sang versé inutilement, au profit des despotes et des tyrans. Depuis des siècles et des siècles que l’humanité marche aveuglément, rien de stable ne fut établi et aussi solides que paraissaient les bases sur lesquelles s’élaborèrent les grandes organisations du passé, elles n’étaient cependant construites que sur des sables mouvants, et furent détruits comme châteaux de cartes balayés par le vent. Et cela n’étonne nullement lorsque l’on a compris que l’autorité ne peut rien construire de puissant et que, loin d’être une source de force, elle est une manifestation de la faiblesse. Une autorité, quelle qu’elle soit, peut être détruite par une autorité plus grande, et la force brutale peut imposer temporairement la volonté d’un individu ou d’un groupe. Tout cela n’est cependant que du provisoire. Inhérente à l’autorité, la force ne peut-être que relative, et est contrainte à s’incliner lorsqu’on lui oppose une force supérieure.
Et c’est là l’erreur séculaire des hommes. Depuis toujours, et de nos jours encore, les grandes agglomérations humaines ne se sont pas organisées en ayant soin de se reposer sur la raison et de s’appuyer sur des principes sociaux susceptibles d’assurer la paix et la stabilité des sociétés, mais en cherchant et en puisant leur puissance en la force de leurs guerriers et de leurs armes, sans s’apercevoir que la force, élevée au niveau d’un principe, d’un symbole, ne pouvait produire de la vie, mais qu’engendrer de la mort et de la ruine.
Nous disons que l’autorité et la force sont des facteurs de destruction. Quel plus bel exemple peut-on citer que celui de Carthage, la grande cité : africaine, restaurée au IXème siècle avant J. C. et qui, en 600 ans de succès ininterrompus, fonda le grand empire maritime de la Méditerranée.
Que reste-t-il aujourd’hui de toute cette richesse, de toute cette splendeur ? Rien.
« L’Esclavage divisait la patrie en castes ennemies ; une constitution aristocratique fermait les carrières de la politique aux ambitions légitimes du peuple ; l’argent, non le patriotisme recrutait les armées. La production agricole et industrielle ne faisait pas équilibre au négoce, Carthage était réduite à poursuivre toujours de nouveaux débouchés, de nouveaux tributs et, quand l’adhésion spontanée manquait, de les imposer par la guerre. Elle était ainsi amenée à s’appuyer sur la force, non sur le droit ; sur l’intérêt, non sur la justice ; sur la ruse et la fraude, non sur la loyauté des échanges. Devenant puissance guerrière et oppressive, elle devait chanceler et succomber quand elle se heurterait contre plus fort qu’elle. Cet écueil, elle le trouva en Sicile et en Espagne ; alliée des Romains pendant plusieurs siècles, elle dut, un jour, devant des résistances imprévues, engager la lutte et vaincre ou périr. Elle périt après des efforts gigantesques, par les ordres implacables de Rome jalouse, l’an 146 avant J. C. Le pillage, l’incendie, les massacres, châtièrent six siècles d’une domination insolente, éternel avertissement donné au peuple, qui, abusant de l’art nautique, fondent une tyrannie sur le monopole maritime : tôt ou tard ils sont balayés de la scène pour n’avoir pas reconnu à chaque peuple son rôle et son droit. » (Jules Duval)
Carthage se débattit longtemps. Les luttes qu’elle entreprit contre Rome, connues sous le nom de guerres puniques, sont légendaires. A la première de ces guerres, de 264 à 242 avant J. C., elle perdit la Sicile ; à la seconde, de 219 à 202, elle abandonna l’Espagne, et à la dernière, de 149 à 146, elle fut anéantie.
Relevée par César, elle redevint un centre d’activité mais fut prise d’assaut en 698 par les Arabes et, cette fois, totalement détruite. Il ne reste plus, actuellement, à quelques kilomètres de Tunis, que quelques ruines pour aviver le souvenir de l’excursionniste et lui rappeler les grandeurs de la ville lumière qui rayonna sur le monde durant six siècles.
Et pourtant, l’avertissement de Carthage fut inutile et l’histoire se répète sans imprimer aux hommes un enseignement profitable. En notre siècle de progrès et de science, où toute l’activité humaine devrait se dépenser à l’élaboration d’une société rayonnante de joie et de bonheur, il apparaît que l’œuvre de destruction continue et, en regardant dans le passé, on tremble d’entrevoir un avenir où s’amoncellent les ruines d’une civilisation féroce et barbare.
Vingt et un siècles ont passé depuis la décadence de Carthage, et la ruine de cet empire ne se comprendrait pas « si l’on ignorait que, par une loi fatale, toute civilisation parvenue à son apogée, est destinée à périr, comme un fruit mûr, si elle ne revêt pas, par sa propre énergie, une forme sociale supérieure ». Vingt et un siècles ont passé, et l’Europe a grandi, au milieu des sciences et des arts, donnant naissance à des puissances qui se disputent à leur tour l’hégémonie du monde.
L’Angleterre, inspirée peut-être par la puissance commerciale et industrielle de Carthage, aspire à la souveraineté absolue et étend son domaine en se reposant sur sa force maritime. La France et l’Allemagne, moins puissantes sur mer, cherchent à consolider leurs entreprises industrielles et commerciales en s’appuyant sur leur force année. La colonisation est devenue une nécessité, impérieuse pour les grandes nations qui n’arrivent plus à écouler leurs produits et, comme par le passé, la guerre est là, menaçante, pour ouvrir par la force de nouveaux débouchés, la production et la consommation n’étant pas équilibrées au sein de ces nations. De l’autre côté des mers, des puissances neuves s’éveillent. Economiquement, les Etats-Unis de l’Amérique du Nord ont déjà presque asservi la vieille Europe. Le Japon cherche sa place. Industriellement et commercialement, il concurrence sur le marché colonial les grandes puissances européennes et Nord américaines qui veulent s’imposer dans le grand empire chinois et y écouler leurs produits aux 500 millions d’habitants. Et toute cette soif de domination économique, source d’esclavage et de misère, donnent naissance à des conflits qui ne peuvent se régler que dans le sang des peuples.
La grande guerre de 1914 n’est peut-être que le prélude, de nouvelles tueries, plus terribles, plus monstrueuses, plus barbares que la précédente, et la destruction d’une partie de la France, sera sans doute suivie de la destruction d’une partie de l’Europe.
N’oublions pas, cependant, que ce qui précipita la ruine de Carthage, ce fut une terrible guerre qu’elle eut à soutenir, entre les deux dernières guerres puniques, contre les mercenaires qui s’étaient révoltés. Les mercenaires modernes en auront peut-être bientôt assez, à leur tour, de verser leur sang, pour des causes qu’ils ignorent, qui n’offrent pour eux aucun intérêt, et de se sacrifier pour défendre les privilèges et les biens de leurs adversaires et de leurs ennemis.
Ils détruiront alors, tout ce qui gêne la libre évolution des individus ; mais leur œuvre de destruction sera saine, puisqu’elle aura pour but le bonheur de l’humanité. Ayant bénéficié des expériences du passé, les mercenaires ne détruiront plus pour détruire, ils ne s’attaqueront plus aux palais, aux châteaux, aux richesses, à tout ce qui ‘est une source de bien-être et de joie, mais aux vieux taudis infects et misérables dans lesquels ils sont entassés, aux prisons derrière lesquelles gémissent des parias, victimes de l’inégalité sociale, aux institutions qui déterminent tant de calamités ; ils détruiront tout ce qui engendre la misère et les larmes, et ayant su détruire, ils sauront reconstruire. C’est à cette seule condition que 1e XXème siècle peut sortir de l’abîme dans lequel il est tombé. Si les hommes sont incapables de briser avec le passé, d’élever ‘une barrière entre hier et demain, alors, une fois encore, la civilisation arrivée à son apogée s’écroulera et ce sera l’éternel recommencement. La liberté, pleine et entière peut offrir une chance de salut, mais la liberté ne se donne pas, elle ne se demande pas ; elle se prend ; il faut la conquérir avec vaillance et courage. La Révolution n’est pas destructive, elle est constructive, à condition, toujours, d’être animé par un désir de liberté et non par une soif d’autorité. Sachons donc faire la Révolution si nous voulons que prennent fin la destruction de l’humanité et le triomphe du despotisme.
DESUETUDE
n. f. (du latin desuetudo)
Se dit, d’un mot, d’une chose, d’un objet, d’une coutume, d’un règlement, d’une loi, qui vieillissent et dont on ne fait plus usage,
Par exemple, la loi française condamne l’adultère et punit la femme qui s’en rend « coupable » à une peine variant entre trois mois et deux ans de prison ; le complice est passible de la même peine. On peut dire cependant qu’il ne se trouve pas en France un magistrat pour se conformer aux textes de cette loi, et qu’elle ne pourrait plus être appliquée sans soulever immédiatement la réprobation et la protestation générales, Cette loi ne se trouvant plus en rapport avec les mœurs de la vie moderne, est, sans avoir été abrogée, tombée en désuétude. Il en est de même de la loi sur les retraites ouvrières, pourtant récente, mais qui souleva l’indignation des travailleurs ; devant la volonté du peuple, énergiquement manifestée, de ne pas se conformer aux exigences de ladite loi, celle-ci fut enterrée sans avoir, en réalité, jamais été appliquée.
DETAILLER
verbe actif
Diviser en pièces, couper en morceaux. Détailler un bœuf, un mouton, une pièce de drap. Action qui consiste à répartir en divisions ; détailler un discours, un conte, un récit. Faire le détail de quelque chose.
« Ne vous chargez jamais d’un détail inutile » a dit Boileau ; il ne faut jamais, en effet, sacrifier le tout pour le détail, mais bien souvent on est obligé d’appuyer sur le détail, pour comprendre ou faire comprendre le tout. Le bagage des connaissances s’augmentant chaque jour, il est presque impossible au cerveau humain de considérer en entier l’ensemble de ces connaissances ; l’individu se trouve donc obligé de les détailler et d’e les étudier séparément, indépendamment les unes des autres.
C’est en étudiant les divers détails de .n vie sociale que l’on arrive à se faire une idée de ce qu’est la Société, de ce qu’elle devrait et pourrait être ; c’est en détaillant ses rouages que l’on est frappé par le vice et l’erreur de toutes les administrations qui président à l’activité d’une nation ; et c’est en critiquant, attaquant, et frappant la Société dans ses détails que l’on arrivera à en ébranler les bases.
Attachons-nous donc à ne rien laisser échapper de ce qui peut être pour nous une source de connaissances nouvelles. Sans nous arrêter particulièrement aux détails de second ordre, sachons détailler notre besogne et que l’activité de chacun se dépense dans la branche qu’il a étudiée, qu’il connaît et dont aucun détail ne lui échappe. Les circonstances ct les événements aidant, nous arriverons ainsi, petit à petit, à étendre notre force et à transformer le monde en améliorant de sort de l’humanité.
DETECTIVE
Mot anglais signifiant policier. Ce mot est devenu international et sert à désigner cette catégorie de policiers spécialement attachés à la poursuite des enquêtes judiciaires et à la recherche des inculpés qui réussissent à échapper aux griffes de la magistrature.
Il y a le détective privé et le détective officiel ; ce dernier est un fonctionnaire au service de l‘Etat et appartient au ministère de l’Intérieur. Il ne porte pas d’uniforme afin de n’être pas reconnu et pénètre partout où se manifeste une certaine activité civile, sociale ou politique. On le rencontre aussi bien dans les cercles aristocratiques de Monaco, d’Aix ou de Vichy, que dans les milieux politiques ; dans les cercles il veille à la sécurité du bourgeois qui s’amuse et se charge d’éloigner tout ce qui peut être un trouble-fête pour ces Messieurs en ribote ; dans les milieux politiques, il cherche à découvrir les buts de l’association afin de dénoncer à ses chefs l’activité des éléments composant ces milieux et d’en arrêter les effets ; en outre, ainsi que nous le disons plus haut, il poursuit, pour le service de la magistrature, les enquêtes judiciaires et recherche le criminel.
Bien que placé tout en bas de l’échelle judiciaire, le détective est peut-être le plus dangereux des individus. Sa fonction lui permet d’ouvrir toutes les portes et de troubler quiconque a le malheur de se trouver sur sa route. Dénué de tout scrupule, de tout sentiment, et, en surplus, de toute éducation, il n’hésite pas, lorsqu’il désire pénétrer un secret, à vous noircir auprès de votre entourage, pour en obtenir les renseignements qu’il juge utiles à son enquête. C’est donc un être bas et abject, qui, du reste, a admirablement été dépeint par Victor Hugo, en la personne de Javert, dans son célèbre roman Les Misérables.
Hélas ! Cette calamité officielle, qu’est le détective d’Etat, ne semblait pas suffisante, puisque le détective privé, à son tour, intervient pour troubler la quiétude de l’individu. Le détective privé travaille pour lé compte du particulier et se charge, dit-il, de vous fournir tous renseignements que vous pourriez désirer sur une tierce personne. En réalité, son principal client est le mari jaloux, avide de rencontrer sa femme entre les bras de son amant, et qui demande le service du détective pour se livrer à cette basse besogne.
A la base de tout scandale, on rencontre le détective et les drames qu’il détermine sont innombrables ; il s’est cependant trouvé des écrivains tels Conan Doyle pour présenter le détective sous un jour sympathique. Malheureusement, Sherlock Holmes est un policier romantique qui a vu le jour dans le cerveau de littérateurs avides de succès populaires, et le détective, le vrai, est un personnage antipathique, dont il faut se méfier et qui est incapable de faire quelque chose de bien. C’est un être malfaisant au sens complet du mot et, qu’il agisse pour le compte de l’Etat ou du particulier, son action néfaste en tous points n’en est pas moins blâmable. Mais cessons d’en parler. Nous lui avons déjà consacré plus de place qu’il n’en mérite.
DETENTEUR
(du latin detentor)
Celui qui possède un bien, une richesse, un pouvoir, une autorité, etc...
Le mot détenteur ne peut s’appliquer qu’à une catégorie d’individus et cette catégorie d’individus compose la bourgeoisie. C’est en vain, en effet que l’on se creuserait l’esprit pour chercher de quoi le peuple est « détenteur », à moins que ce ne soit de la misère et de la servitude.
La richesse sociale est détenue par une minorité qui en dispose à sa guise, la fait fructifier et en conserve tous les profits et bénéfices. Le pouvoir est détenu et exercé par des hommes appartenant également à la bourgeoisie, et l’autorité dont disposent ces hommes leur permet d’asservir la grande majorité des individus qui se courbent devant leurs ordres. Il ne reste donc rien au peuple, sinon l’illusion que lui a versée la démocratie, en lui laissant croire qu’il est le détenteur de toute la vie économique et politique, et que rien ne peut se faire sans sa volonté.
L’exemple du chaos social est le meilleur exemple que nous pourrions citer, si nous voulions démontrer que le peuple se dépossède chaque jour un peu plus et se livre pieds et poings liés aux aventuriers de la politique.
Il est incontestable que le peuple est détenteur de la force et de la puissance et que, s’il le voulait, il se libérerait de l’étreinte de ses oppresseurs. Mais, de même que l’intelligence est inutile si elle ne s’extériorise pas, la force et la puissance sont également inutiles si elles ne se manifestent pas au profit de celui ou de ceux qui la détiennent ; mieux, elles sont alors néfastes et nuisibles. Que le peuple donc, dont c’est la seule fortune, use de sa force, et nous verrons alors les détenteurs de toute la richesse sociale lâcher leur prise et la collectivité, goûter enfin à la joie et au bonheur auxquels elle a droit.
DETENTION
n. f. (du latin detentio)
Le mot détention est synonyme d’emprisonnement, mais s’applique plus particulièrement pour désigner la peine qui consiste à être enfermé dans une forteresse ou une maison d’arrêt située dans un endroit offrant toutes les garanties possibles contre les tentatives d’évasion.
La détention ne se prononce d’ordinaire que contre les délinquants politiques, les traîtres, les espions, ou tous ceux qui sont considérés comme nuisibles ou dangereux à la sécurité de l’Etat. Naturellement, seules les autorités constituées ont le droit d’ordonner la saisie d’un prévenu ou d’un inculpé, et la détention est illégale lorsqu’elle s’est effectuée sans l’avis de juges compétents,
La détention revêt parfois un caractère d’arbitraire particulièrement scandaleux, et il est à peine besoin de rappeler la monstrueuse affaire, dénommée affaire Dreyfus, et qui, de 1894 à 1905 agita et divisa la France en deux camps. Cette affaire devait pourtant se terminer par le triomphe de la justice.
Un officier français, le capitaine Dreyfus, né à Mulhouse en 1859, fut accusé d’avoir cédé à l’Allemagne certain document militaire intéressant la défense nationale. Traîné devant le conseil de guerre, malgré ses protestations d’innocence, l’absence totale de preuves, et l’évidence de la cabale montée contre lui, il n’en fut pas moins condamné à la déportation.
C’était aux anarchistes qu’allait revenir l’honneur de défendre, une fois de plus, la justice. Le capitaine Dreyfus n’était pas des leurs ; mieux, il était leur adversaire, leur ennemi, une fois comme bourgeois, et une fois comme officier. Cependant, il était innocent ; Juif, il servait de tremplin à la meute cléricale, qui, consciente de sa faiblesse, voulait, par un coup d’éclat, relever son prestige. Ecartant toute considération d’ordre politique, n’écoutant que la saine raison, les Anarchistes, les premiers, entrèrent dans la bataille. Le capitaine Dreyfus s’effaçait, il n’était plus, aux yeux des compagnons, qu’un innocent injustement condamné, grâce à une odieuse machination, et il fallait que la cause de l’humanité, de la justice, sortit victorieuse de la lutte qui s’engageait.
Sébastien Faure fit, à Paris, le premier meeting, qui souleva l’indignation populaire contre les tyrans militaires, et le peuple commença à gronder. Sa voix fut entendue, et le célèbre romancier Emile Zola, intéressé par cette sensationnelle affaire, après avoir étudié les rapports qui lui furent soumis par les fidèles défenseurs du capitaine, publia sa fameuse lettre « J’accuse », qui dénonçait la trame du sinistre complot.
Un nouveau procès eut lieu ; Dreyfus fut renvoyé devant un nouveau conseil de guerre, à Rennes, en 1899. Mais les loups ne se mangent pas entre eux, et la soldatesque ne voulut pas désarmer ; le conseil de guerre de Rennes réduisit la peine infligée la première fois, mais ne voulut pas reconnaître l’accusé Innocent. Il fut condamné à 10 ans de détention, et ce ne fut qu’en 1906 que la Cour de Cassation, après une nouvelle instruction, annula le jugement et prononça l’innocence du capitaine Dreyfus.
L’homme est doué d’une faculté d’oubli remarquable.
Les misères, les souffrances, les douleurs s’estompèrent bien vite, dans l’esprit du capitaine réhabilité, et, lorsque quelques années plus tard, on vint près de lui, pour solliciter son concours afin d’arracher Rousset, une autre mais modeste victime de la galonaille, aux griffes des bourreaux, il refusa de se joindre au peuple, pour l’aider, dans son œuvre humanitaire. C’est une honte dans la vie de Dreyfus.
Dreyfus, disons-nous, était un bourgeois, cela n’empêcha cependant pas le gouvernement au pouvoir de se rendre complice de sa détention, pour satisfaire à l’ambition d’une caste qui gouvernait dans l’ombre. C’est suffisant, pensons-nous, pour souligner que, lorsqu’il s’agit d’individus appartenant à la classe asservie, les hommes de gouvernement n’éprouvent aucun scrupule à agir et à ordonner leur détention, s’ils la jugent utile à l’accomplissement de leurs desseins.
Les cas abondent de militants ouvriers, syndicalistes, révolutionnaires, détenus arbitrairement dans les prisons et les forteresses, parce qu’il plaît aux despotes qui dirigent et président aux destinées humaines qu’il en soit ainsi. Leurs crimes ? Ils veulent régénérer le monde ; ils veulent mettre fin à l’inégalité sociale ; ils veulent voir se terminer la lutte fratricide que, depuis des siècles, se livrent les hommes ; ils veulent, enfin, qu’un rayon de soleil vienne illuminer ce pauvre globe, arraché, déchiré, partagé, par l’ambition et l’intérêt. Et c’est pour cela que, de par le monde, des hommes, beaux, nobles et grands, gémissent dans des cachots.
L’emprisonnement est cruel ; mais encore, au nom de la morale bourgeoise, il se légitime. Le moraliste nous dira que la « Société » se défend contre les criminels et qu’il faut les éloigner, les enfermer pour les empêcher de nuire ; mais la détention de prisonniers politiques est odieuse, car, généralement, pour provoquer la saisie des êtres considérés comme dangereux, ne pouvant rien légalement leur reprocher, on a recours aux faux, à l’intrigue, aux mensonges, pour s’en emparer.
« La justice » asservie aux maîtres et aux puissants, joue la sinistre comédie, indispensable à l’accomplissement du forfait, et les prisons s’ouvrent et se referment sur des hommes innocents, alors que les coupables de toutes les catastrophes, de tous les cataclysmes, de toutes les tueries, jouissent, de la liberté et de la considération de la grande masse des moutons et des aveugles.
Et il en sera ainsi, jusqu’au jour où, éveillé de son sommeil léthargique, la populace, se dressant à nouveau, sera traversée par une lueur de conscience et montera à l’assaut des bastilles, derrière lesquelles se meurent des milliers de malheureux.
- J. C.
DETENU
Etre détenu, être prisonnier, être enfermé dans une prison, être privé de sa liberté.
Il y a plusieurs catégories de détenus. On peut être détenu pour dettes, pour un crime ou délit de droit commun, pour un crime ou délit politique. La détention pour dettes ou contrainte par corps, ne se pratique plus en France, sauf en ce qui concerne les dettes contractées envers l’Etat ou pour les amendes et frais de justice consécutifs à certains procès. Par contre, la détention pour délit politique ou de droit commun se poursuit sans interruption et sans qu’il soit possible d’entrevoir, pour le plus proche futur, un changement quelconque à un tel état de choses.
En vertu de quels principes se permet-on de priver de sa liberté un individu ayant accompli un acte aussi blâmable soit-il ? On nous dira que la Société est obligée de se défendre contre les malfaiteurs et qu’elle les enferme pour mettre les gens honnêtes à l’abri de leurs méfaits ; c’est une mesure de précaution. Cet argument ne résiste pas à l’analyse ; car, à part quelques cas excessivement rares, le crime est un incident ou un accident dans la vie d’un individu. On n’est pas criminel de profession. Il y a des récidivistes, nous objectera-t-on ? Les récidivistes sont des êtres tarés ; mais, en général, ils ne se rendent coupables que de petits faits presque insignifiants.
Il suffit d’avoir étudié tant soit peu et avec impartialité ce qu’est une prison, pour savoir qu’elle n’est peuplée ordinairement que par des vagabonds, toujours les mêmes, et que les grands criminels qui pourraient légitimer uns mesure de sécurité de la part de la « Société » y sont relativement peu nombreux..
En vérité, ce n’est pas par mesure de précaution que l’on détient des prisonniers mais en vertu de l’idée de sanction qui est à la base de la morale bourgeoise.
« Le vice appelle rationnellement à sa suite la souffrance ; la vertu constitue une sorte de droit au bonheur ».
« Est-il vrai » nous dit J.-M. Guyau « qu’il existe un lien naturel ou rationnel entre la moralité du vouloir et une récompense ou une peine appliquée à la sensibilité ? En d’autres termes, le mérite intrinsèque a-t-il le droit de se voir associé à une jouissance, le démérite à une douleur ? Tel est le problème qu’on peut encore poser sous forme d’exemple en demandant : — Existe-t-il aucune espèce de raison (en dehors des considérations sociales) pour que le plus grand criminel reçoive, à cause de son crime, une simple piqûre d’épingle, et l’homme vertueux un prix de sa vertu ? L’agent moral lui-même, en dehors des questions d’utilité ou d’hygiène morale, a-t-il à l’égard de soi le devoir de punir pour punir ou de récompenser pour récompenser ? »
« Nous voudrions montrer combien est moralement condamnable l’idée que la morale et la religion vulgaires se font de la sanction. Au point de vue social la sanction vraiment rationnelle d’une loi ne pourrait être qu’une défense de cette loi, et cette défense, inutile à l’égard de tout acte passé, nous la verrons porter seulement sur l’avenir. Au point de vue moral, sanction semble signifier simplement, d’après l’étymologie même, consécration, sanctification ; or, si, pour ceux qui admettent une loi morale, c’est vraiment le caractère saint et sacré de la loi qui lui donne force de loi, il doit impliquer, selon l’idée que nous nous faisons aujourd’hui, de la sainteté et de la divinité idéale, une sorte de renoncement, de désintéressement suprême ; plus une loi est sacrée, plus elle doit être désarmée, de telle sorte que, dans l’absolu et en dehors des convenances sociales, la véritable sanction semble devoir être la complète impunité de la chose accomplie. Aussi verrons-nous que toute justice distributive a un caractère exclusivement social et ne peut se justifier qu’au point de vue de la société : d’une manière générale ce que nous appelons justice, est une notion tout humaine et relative. » (Guyau, Esquisse d’une Morale sans obligation ni sanction)
Or, si nous pensons avec Guyau que toute « justice distributive a un caractère exclusivement social et qu’en dehors des considérations sociales » il n’v a aucune raison, aucun devoir, de punir pour punir, nous sommes obligés de reconnaître que la détention en soi est arbitraire, et qu’elle ne trouve sa consécration que dans une forme de société que nous jugeons injuste et inhumaine.
Malheureusement, la philosophie, la raison, la logique, n’ont rien à voir avec la justice distributive, et les années de prison pleuvent dru sur les pauvres délinquants qui se mettent en marge de la loi.
Quelle est la « vie » du détenu ? Examinons tout d’abord la situation du prévenu, c’est-à-dire de l’individu emprisonné, bien que la loi ne l’ait pas encore reconnu coupable, et qui attend que le magistrat veuille bien décider de son sort. Il est, d’ordinaire, enfermé dans une cellule dont les dimensions varient selon les prisons et n’a le droit d’avoir de relations avec le dehors que par l’intermédiaire des représentants de l’administration pénitentiaire. Toute sa correspondance passe à la censure, de même que toute celle qu’il reçoit, exception faite en ce qui concerne celle de son défenseur. Obligé de se lever matin de très bonne heure, il a toute la journée pour se livrer à la méditation, toute distraction lui étant interdite. Dix minutes par jour, on le sort de sa cellule, pour le conduire à ce que l’on appelle la promenade et qui n’est en réalité qu’un long couloir d’une quinzaine de mètres, situé dans la cour de la prison, et entouré de murs assez hauts et assez larges pour n’être pas franchissables. Les journaux lui sont interdits et les livres qu’il a le droit d’acheter, sont comme sa correspondance, passés à la censure et interdits s’ils sont considérés comme subversifs par l’administration. La nourriture du prévenu est identique a celle du condamné, elle se compose d’une « soupe » à neuf heures du matin, soupe qui n’est en vérité qu’un bol d’eau chaude recouvert par une couche de graisse ou d’huile et d’une autre à quatre heures du soir, d’une boule de pain noir et sale d’un poids approximatif de 600 grammes et, deux fois par semaine, le jeudi et le ‘dimanche d’un morceau de viande. Cependant, le prévenu a le droit, s’il a de l’argent, de se nourrir à ses frais, et, dans ce cas, il est honteusement exploité par les mercantis qui spéculent sur la misère humaine.
Voilà, brièvement tracée, la vie de l’homme non encore reconnu coupable par la société et qui, en vertu de la loi même, devrait être considéré comme innocent.
Aussi terrible que puisse être cette existence, elle est cependant supportable à côté de celle du condamné. Selon la peine qu’il a à subir, le détenu est envoyé dans une prison cellulaire, ou dans une centrale. Nous allons voir quel est le régime de la prison cellulaire de Fresnes-les-Rangis, qui est une des plus modernes de notre France républicaine. Le prisonnier doit être levé à sept heures du matin, au coup de cloche, et a environ une demi- heure pour se livrer aux soins de sa toilette et à ceux de sa cellule ; à 7 h. 1/2 son lit doit être plié, sa chambre nettoyée, et il doit être prêt à travailler. Le travail est obligatoire pour le détenu condamné. Il travaille seul dans sa cellule et doit accomplir la tâche qui lui est assignée s’il ne veut pas être puni. On sait en quoi consiste le travail des prisons, On y fabrique généralement des articles bon marché que d’immondes exploiteurs ne trouveraient pas à manufacturer s’ils ne spéculaient pas sur l’incapacité de se défendre dans laquelle se trouve le prisonnier. Si ce dernier n’accomplit pas sa tâche, Il est mis au pain sec et, si cette punition ne produit pas les effets attendus ou espérés, c’est le prétoire ou le cachot.
La nourriture du détenu, nous l’avons dit plus haut, consiste en deux soupes par jour, une boule de pain et deux morceaux de viande par semaine. Il a cependant la faculté d’améliorer son ordinaire, en prélevant une partie du salaire qui lui est alloué. Supposons un prisonnier gagnant 4 francs par jour, ce qui est énorme. L’administration pénitentiaire, si le détenu subit sa première condamnation, en prélève environ la moitié pour couvrir ses frais ; suit les deux francs qui restent, 1 franc est conservé au greffe pour que le détenu ne soit pas démuni d’argent au sortir de prison, et il a droit à dépenser par conséquent un franc pour sa nourriture. Le tabac n’est pas autorisé, et l’unique distraction du prisonnier est la messe le dimanche et un livre par semaine, qu’il ne choisit pas, mais qui est cueilli au hasard dans la bibliothèque pénitentiaire.
Ce que ce livre hebdomadaire représente pour le détenu, est-il besoin de le dire ? Et pourtant la méchanceté humaine ne connait pas de bornes et il se trouve des gardiens assez dénués de tous sentiments pour s’amuser encore de la détresse du détenu. Il nous fut conté que certains gardiens se faisaient un malin plaisir de choisir pour certains de leurs détenus, des livres ne présentant d’intérêt que pour des techniciens, etc…, et de leur rapporter ces volumes trois semaines de suite, malgré les faibles protestations du pauvre bougre sans défense.
Se rend-on bien compte de ce qu’est la vie misérable du détenu, enfermé dans sa cage, sans pouvoir jamais prononcer une parole, ne pouvant recevoir de visites qu’une fois par semaine et encore n’apercevant ses familiers qu’à travers un grillage, et éloigné de ses proches par un couloir d’un mètre de large ? Nous n’avons pas besoin de dramatiser. Qu’il nous suffise de dire que, pour faire diversion à cette vie monotone et mourante, les détenus se mutilent afin de voir s’opérer un changement d’une minute, d’une seconde, dans leur existence. Nous savons des détenus qui n’hésitèrent pas à se faire porter malades et à subir certaines opérations douloureuses, alors que parfaitement sains, simplement pour sortir de cette maudite cellule, où jamais ne pénètre un éclair de joie, une lueur de gaîté.
Si le détenu des prisons centrales, ne souffre pas de l’isolement, car il travaille, mange, et dort en commun, son sort n’est pas plus enviable que celui du détenu cellulaire. C’est la promiscuité de tous les instants avec ce qu’elle a de bas, de bestial et de dégoûtant ; c’est la corruption la plus répugnante, à laquelle il faut opposer une volonté puissante si l’on ne veut pas s’écrouler dans l’abjection, qui se manifeste dans la prison centrale. Dans la cellule on devient fou, de la centrale on sort à jamais taré. Est-ce cela que désirent nos moralistes ? Est-ce de cette façon que l’on espère régénérer l’humanité ? Et encore nous ne disons rien de la brutalité des monstres qui consentent à garder les prisonniers. On a tant dit déjà sur les prisons qu’il n’est pas utile de nous étendre.
Du reste le fait est là. Le criminel ne sort pas guéri de la prison, et la détention n’a jamais empêché le crime. Alors, nous dira-t-on, que faut-il faire ? Lâcher les prisonniers, les laisser se livrer à leurs méfaits, ne rien faire pour empêcher des individus de nuire à leurs semblables ? Posée de cette façon, la question nous semble ridicule. Ce qu’il faut faire : c’est changer .a forme de la société ; c’est ne pas permettre le crime, en détruisant les causes du crime. Nous savons que tant qu’il y aura des lois, il y aura des juges, et tant qu’il y aura des juges : une justice distributive, des prisons et des détenus. La loi est un mal engendré par le principe d’autorité sur lequel reposent les sociétés modernes. Elle est une conséquence du capitalisme et il faut lutter contre elle, comme contre tout ce qui fut institué par la puissance de l’argent. Là est le remède, c’est le seul.
Et c’est parce que c’est l’unique remède, et que des hommes clairvoyants cherchent à l’appliquer, qu’ils sont victimes de la loi et détenus dans les prisons du monde entier.
Dans le monde entier les révolutionnaires peuplent les prisons, mais rien cependant ne les arrêtera dans leur désir de vaincre ; car, à leurs yeux, la société moderne n’est qu’une vaste prison derrière les grilles de laquelle sont détenus tous les asservis et tous les opprimés, et c’est en les libérant que les révolutionnaires se libèreront eux-mêmes.
DETERMINER
verbe (du latin déterminare, même signification)
Fixer, décider, prendre ou faire prendre une détermination. « C’est après nous avoir consultés et avoir reçu notre avis favorable qu’il s’est déterminé à faire ce voyage ». Déterminer quelque chose, les limites, l’étendue, etc., etc.... « Nous avons aux événements, puise dans sa volonté propre une certaine détermination. Dans tous les actes et gestes de la vie qui ne sont pas purement instinctifs, il faut regarder, comparer, chercher à comprendre et se déterminer, après réflexion, à suivre un chemin ou un autre déterminé que la distance de la Terre à la Lune était de 96.000 lieues ou 384.000 kilomètres. Occasionner, produire, pousser à : « c’est l’égoïsme des potentats, l’insatiabilité des ploutocrates et la lâcheté du peuple, qui déterminèrent les hommes à s’entre-tuer pendant plus de quatre ans dans la plus furieuse des guerres. C’est également l’appétit toujours grandissant des oppresseurs qui détermine la révolte des opprimés ».
Se déterminer, prendre un parti, s’arrêter à une résolution. Il faut toujours bien réfléchir avant de se déterminer à une action quelconque, mais ne pas attendre indéfiniment la détermination d’autrui, L’homme faible se laisse fréquemment déterminer, c’est-à-dire conduire, mener, guider ; alors que l’homme fort, tout en n’échappant pas à l’ambiance et
C’est parce que trop d’hommes manquent d’énergie et sont incapables de prendre une détermination que la société semble être un asile d’aliénés, où les individus se meurtrissent mutuellement, sans jamais arriver à s’entendre et à s’aimer.
DETERMINISME
n. m.
Pris dans le sens le plus général du mot, déterminisme signifie le conditionnement d’une chose par une autre. Tout fait, tout phénomène, tout événement n’est, au fond, qu’un anneau dans une chaîne de faits dont chacun est prédéterminé par les faits précédents (les causes ou les motifs) et engendre fatalement les faits ultérieurs (les conséquences). Il n’y a pas de fait sans raison déterminante. Tout ce qui est dans le monde a sa raison déterminée. Tout se produit infailliblement quand certaines conditions sont données et ne se produit pas dans le cas contraire. Il existe donc une liaison étroite, inviolable, entre tous les phénomènes de la nature, de la vie, de tout ce qui est dans le monde. Telle est la formule générale de l’idée du déterminisme.
Exprimée de cette façon très générale, cette idée ne contient encore que dans le germe la fameuse controverse, le grand problème philosophique, psychologique, éthique et social, qui est connu plutôt comme celui du libre arbitre et dont la solution définitive se fait toujours attendre.
Formulée généralement, l’idée du déterminisme ne spécifie pas encore la nature de la raison déterminante. Cependant, cette dernière peut varier : par exemple, elle peut être externe et transitive ou interne et immanente ; elle peut être soit logique ou rationnelle, soit efficiente ou causale, etc. Or, il suffit de réfléchir d’une façon plus approfondie sur la nature de cette raison et surtout de tâcher d’en déduire certaines conclusions pratiques, pour se rendre compte de la grande complexité du problème.
Traitant le sujet plus à fond au libre arbitre (voir ce mot), je me bornerai ici à exposer dans ses grandes lignes le sort historique de la doctrine du déterminisme.
Ce furent les anciens, les Grecs notamment, qui, les premiers, posèrent le problème. Ils le firent sous le jour éthique et psychologique. Socrate, Platon, Aristote, les stoïciens, et nombre de philosophes grecs et romains (Cicéron) postérieurs, s’occupèrent à formuler certaines objections à l’idée — à cette époque assez vague encore – du déterminisme universel. Leur but fut toujours d’établir une certaine liberté psychologique et éthique de l’homme : liberté intérieure de son raisonnement, de son jugement, de sa volonté, de son action. L’argumentation de ces divers philosophes et de différentes écoles philosophiques de l’antiquité variait beaucoup, mais tous ils s’efforçaient de limiter, d’une façon ou d’une autre, le principe du déterminisme, par rapport à l’homme. Ils penchaient vers la reconnaissance du libre choix chez l’homme, donc vers le libre arbitre. Autrement, ils n’auraient pu établir leurs célèbres conceptions éthiques.
Ainsi, sur le terrain étique tout d’abord, le problème fut posé, la controverse naquit.
Philosophiquement, matériellement, moralement, socialement, etc., l’homme est-il libre et indépendant d’une prédétermination fatale ou, au contraire, toute son activité n’est-elle qu’un résultat inévitable de causes et de motifs se trouvant en dehors de sa volonté personnelle qui, dans ce cas, ne serait qu’une illusion ? Tel fut le problème légué à la postérité par la pensée antique.
Au Moyen-âge, du Vème au XVème siècle, la controverse acquit un caractère religieux et scolastique. La préoccupation principale des penseurs de cette époque fut celle de concilier le dogme chrétien de la prédestination divine — sorte de déterminisme absolu — avec le principe de libre choix humain nécessité par la même religion chrétienne. Saint Augustin, Thomas d’Aquin et d’autres encore, versèrent beaucoup d’encre pour y aboutir. Le résultat de leurs efforts fut plutôt maigre, car, malgré qu’au XIème siècle le déterminisme intégral eût été condamné comme hérésie, le XIVème siècle fournit la théorie du déterminisme absolu (toujours à hase religieuse de Wiclef), et le XVIème siècle, celle, déterministe aussi, de Luther.
Les siècles XVI et XVII furent remplis de luttes religieuses et philosophiques entre les déterministes extrêmes, déterministes modérés et les partisans du libre arbitre. Pascal, Fénelon et Bossuet furent les penseurs religieux les plus puissants de cette époque parmi ceux qui s’occupaient du problème. Pascal et surtout Fénelon, défendirent des théories déterministes, tandis que Bossuet penchait plutôt vers l’idée du libre arbitre, tout en cherchant à concilier les deux extrémités.
D’autre part, cette époque est remarquable par des tentatives consécutives de construire des systèmes métaphysiques grandioses. C’est à la métaphysique spéculative que la religion cède le pas. Les systèmes les plus importants sont ceux de Spinoza, de Leibniz et de Kant, ce dernier (mort en 1804) jetant son ombre gigantesque sur tout le XIXème siècle. Spinoza fut un déterministe accompli, intégral. Il n’admettait à la volonté humaine aucune liberté de choix réelle. La raison déterminante universelle et absolue de Spinoza est la nécessité rationnelle, logique. Leibnitz, tout en étant partisan d’un déterminisme général de caractère moral, admet, néanmoins, une certaine liberté intérieure de volonté et d’action. Quant à Kant, il fut le premier qui établit définitivement le principe de la causalité générale déterminante. Il admettait, cependant, une liberté relative dans le domaine psychique.
Au XIXe siècle, nous avons, tout d’abord, quelques tentatives, spéculatives aussi, de compléter et de préciser la philosophie de Kant. Tels sont les systèmes métaphysiques de Schelling et de Schopenhauer qui, tout en étant déterministes par rapport à la causalité universelle, admettent une certaine liberté intérieure conditionnelle. Nous trouvons plus intéressante la conception de Fichte qui, le premier, fixa l’attention sur la force créatrice de l’homme et prépara ainsi le terrain à l’idée d’une causalité psychique spécifique. C’est pour cette raison qu’il penchait vers la possibilité du libre arbitre. Des idées analogues furent développées par le philosophe français Maine de Biran.
Vers la fin du XIXème siècle, la philosophie spéculative, la métaphysique, se trouvent définitivement engagées dans une impasse sans issue. C’est le positivisme d’Auguste Comte, c’est la philosophie évolutionniste, fermement établie par Herbert Spencer, qui guide la pensée humaine. D’autre part, c’est l’essor des sciences précises et expérimentales, qui commence à marquer le pas de l’activité et de l’exploration des savants, des penseurs et des chercheurs de la vérité. Le problème général du déterminisme cesse précisément d’être un problème « général ». Dorénavant, ce seront les érudits des diverses branches séparées des sciences — psychologues, moralistes, économistes, juristes, sociologues — qui analyseront et tâcheront de résoudre la controverse, tant qu’ils seront poussés à le faire par les nécessités de leurs recherches scientifiques et, aussi, par les besoins pratiques.
C’est ainsi que le problème général métaphysique du déterminisme se divise, à notre époque, en plusieurs problèmes de déterminisme moral, économique, social, etc. Chaque branche des sciences résout la question plus ou moins à son gré. Et s’il reste encore un domaine qui s’en occupe toujours de façon générale, c’est la psychologie contemporaine, qui n’a plus rien de métaphysique, étant entièrement basée sur l’expérience et l’analyse précise.
Les résultats de ce nouvel état de choses ne sont pas encore très concluants. La controverse entre la conception déterministe et celle du libre arbitre est encore loin d’être définitivement résolue. Mais ce qui importe, c’est que la véritable essence du problème est aujourd’hui clairement et définitivement établie. Le fond de la question peut être formulé comme suit : tout en reconnaissant la présence d’une causalité universelle, générale, fatale ; à laquelle l’homme ne pourrait pas se soustraire entièrement, sa volonté et son action peuvent-elles jouir d’une certaine liberté de choix ? Si oui, en quel sens et dans quelle mesure cette liberté pourrait-elle être admise ?
Les éléments principaux pour la solution éventuel1e de ce problème sont fournis par la psychologie qui s’occupe à établir le principe d’une causalité psychique spécifique introduisant dans la chaîne des causes générales un anneau sui generis, un facteur indépendant, dans une certaine mesure. Sur cette voie, le problème en touche de près un autre, celui de la capacité créatrice chez l’homme. (Voir : Création, Libre arbitre, Evolution, Progrès).
N’ayant pas encore abouti à un résultat décisif, l’analyse psychologique du problème laisse toujours le champ libre à d’autres sciences de résoudre la question à leur gré.
Ainsi, par exemple, dans les sciences économiques et sociales, nous avons aujourd’hui la conception marxiste qui est celle d’un déterminisme économique et social presque absolu, basé sur le monisme et le matérialisme philosophiques et historiques. Et nous avons, en même temps d’autres théories socialistes et, surtout, la conception anarchiste, qui, étant beaucoup plus d’accord avec les données de la psychologie et de la sociologie modernes, se basent sur le principe pluraliste et synthétique, permettant de s’approcher de la conciliation définitive du déterminisme extrême avec le libre arbitre illimité. C’est, précisément, le problème de la force créatrice de l’homme, — de son essence, de son rôle, de ses effets, — qui doit intéresser surtout les anarchistes.
Notons pour conclure que le problème du déterminisme a des accointances avec celui du hasard. Mais c’est un sujet à part qui doit trouver sa place au mot correspondant : Hasard
NOTE BIBLIOGRAPHIQUE : Voir Libre arbitre.
- VOLINE.
DETERMINISME
n. m.
Ce terme désigne la théorie selon laquelle tout phénomène, y compris celui de la volonté, est déterminé par les circonstances dans lesquelles il se produit, d’où nécessairement résultent les conséquences. Le déterminisme est basé sur le principe de causalité : « les mêmes causes, dans les mêmes circonstances, engendrent les mêmes effets ».
On distingue, en général, le déterminisme cosmique ou physique du déterminisme psychologique ou de la volonté. Le premier a trait aux phénomènes physiques, le second aux phénomènes psychiques. Le premier est le postulat de toutes les sciences, puisqu’elles ont pour objet la recherche des lois. Et la loi (rapport invariable entre deux phénomènes) peut être recherchée à la condition seulement que l’on croie que tout phénomène est invariablement précédé, et invariablement suivi par d’autres phénomènes.
Admise cette impérieuse nécessité causale qui lie les phénomènes du monde dans chaque instant de son existence, se trouvent potentiellement contenues toutes ses phases successives, de sorte que, une intelligence infinie pourrait aisément prévoir le plus lointain futur. Huxley dit qu’une intelligence suffisante « connaissant les propriétés des molécules dont était composée la nébuleuse primitive, aurait pu prédire l’état de la faune de l’Angleterre en 1868 ».
E. Du Bois-Reymond dit qu’ « on pourrait savoir dès maintenant à quelle époque l’Angleterre brûlera son dernier morceau de charbon ».
Le déterminisme psychique considère toutes les actions de l’homme déterminées par ses états antérieurs, et il n’admet pas que sa volonté puisse changer cette détermination. Les actes volontaires sont déterminés ab œterno, de manière nécessaire. Il n’y a pas de choix, mais prépondérance de la pression qui a la plus grande puissance d’impulsion.
Kant dit que, si l’on pouvait connaître toutes les impulsions qui meuvent la volonté d’un homme et prévoir toutes les occasions extérieures qui agiront sur lui, on pourrait calculer la conduite future de cet homme avec la même exactitude que celle avec laquelle on calcule une éclipse solaire ou lunaire,
On distingue plusieurs formes de déterminisme volontaire. La forme théologique considère nos actions comme un produit de l’action divine, de la grâce, de la providence. La théorie typique de ce déterminisme est celle de la prédestination. Le déterminisme intellectuel place l’action déterminative dans l’intelligence, faisant de chaque action la pure et nécessaire conséquence d’un jugement. Le déterminisme sensitif fait des sensations la cause unique des actions. Pour le déterminisme idéaliste, l’idée, en soi, absolue (acte pur) agit librement et détermine les actes humains sans aucun lien avec la matière.
Il ne faut pas confondre le déterminisme avec le fatalisme ; puisque, ici, les événements sont prédéterminés ab œterno, de manière nécessaire, par un agent extérieur, tandis que, là, le pouvoir est placé dans l’agent même. Dans le fatalisme, la nature est soumise à une nécessité transcendante ; dans le déterminisme cette nécessité est immanente. Naguère, encore, le déterminisme scientifique était seulement mécanique (le conséquent est déterminé par ses antécédents et l’ensemble par ses parties) ; maintenant, le déterminisme finaliste (instauré par Claude-Bernard) dont la formule est : « l’ensemble détermine ses parties et le conséquent ses antécédents », commence à avoir des partisans. Ce dernier déterminisme est appliqué, que je sache, seulement ou spécialement, au domaine biologique. - C. BERNERI.
BIBLIOGRAPHIE :
Cl. Bernard, Introduction à l’étude de physiologie, 1865. Fouillée, La liberté et le déterminisme, 1873. A. Hamon, Déterminisme et responsabilité, 1898. A. Lalande, Note sur l’indétermination, « Revue de métaphysique » 1900, page 94. J. Pétrone, I limiti del determinismo scientifico, 1900. R. Ardigo, La morale dei positivisti, 1892, pages 118 et suiv. Fonsegrive, Essai sur le libre arbitre, sa théorie et son histoire, 1889.
DETERMINISME ECONOMIQUE
(Voir : Matérialisme historique).
DETONNER
(verbe)
N’être pas maître de sa voix.
Chanter faux, manquer de justesse. « Cette femme ne sait pas chanter, elle détonne à tout instant ».
Rien n’est plus désagréable à l’oreille que l’audition d’un « artiste » instrumentiste ou chanteur qui ne respecte pas la musique et qui détonne. L’instruction musicale n’est pas toujours suffisante pour éviter la détonation et il arrive que certaines personnes ayant appris la musique sont absolument incapables de jouer ou de chanter juste. Certains instruments exigent une très grande maîtrise et une profonde habileté pour être harmonieux. Le violon et le violoncelle par exemple, dont les notes ne sont pas séparées les unes des autres sur la touche, comme sur le clavier d’un piano, nécessitent une longue pratique de celui qui veut en jouer ; sinon, en tenant compte des autres difficultés que rencontre l’étude de ces instruments, ils ne sortent que des intonations détestables. Quant au chanteur, il ne suffit pas d’avoir une voix puissante pour qu’il se permette de se produire ; faut-il encore qu’il ait « l’oreille », et qu’il rende avec justesse le morceau qu’il désire interpréter.
Au sens figuré, le verbe détonner s’emploie péjorativement comme synonyme de déraisonner. On dit de quelqu’un qu’il détonne lorsqu’il parle sans savoir, et aborde une question qu’il ignore. Au sens propre comme au sens figuré, il faut s’abstenir de détonner. Désagréable, lorsque l’on détonne en chantant, on paraît ridicule lorsque l’on parle en donnant l’impression que l’on ne sait pas ce qu’on dit.
DETOUR
n. m.
Endroit qui va en tournant. Les détours d’une rue, d’un fleuve, d’une montagne. Faire un détour signifie prendre un chemin qui éloigne du but auquel on doit arriver.
Ce mot qui s’emploie au propre et au figuré, a, dans l’un et l’autre sens, la même signification. On dit d’un orateur qui, en prononçant un discours, use de ménagements, s’exprime indirectement, qu’il emprunte des détours pour arriver à sa conclusion. Parfois les intentions de celui qui use de ces procédés, sont bonnes ; mais en général le détour, en matière politique et sociale, cache la ruse et n’est qu’un subterfuge employé pour masquer des desseins inavouables et arriver à bout de quelque chose.
« La ligne droite est toujours la plus courte d’un point à un autre » ; c’est donc celle-là qu’en toute logique il convient d’adopter si l’on veut avec rapidité atteindre le but que l’on poursuit. La politique semble combattre cet élémentaire principe de géométrie, et les politiciens en sont adversaires ; il n’y a donc pas lieu de s’étonner de ce qu’ils usent de détours afin de détourner l’attention de leurs victimes de l’objectif réel pour lequel ils se dépensent.
Nous avons dit par ailleurs, et nous répétons sans cesse, car cela nous apparaît comme une vérité lumineuse, que la politique n’a d’autres raisons d’être, que de détourner le peuple de ses obligations, de le tromper sur la route qu’il doit suivre, de le conduire sur des voies sinueuses, difficiles à suivre, et de le perdre dans les détours d’un labyrinthe duquel il ne peut plus s’échapper.
S’il est vrai, et nous le croyons, que le bonheur de l’humanité, que l’égalité et la fraternité ne peuvent exister que lorsqu’aura disparu sur toute la surface du globe l’exploitation de l’homme par l’homme, et par extension tout ce qui concourt au maintien de l’arbitraire, de l’inégalité, et de l’autorité, il n’est pas besoin de faire des détours pour réaliser cet idéal,
L’on nous objecte qu’une période transitoire est nécessaire, que l’homme, corrompu par des siècles et des siècles d’hérédité, est incapable de vivre une existence saine, physiquement et moralement, on prétend que maintenu depuis toujours dans l’obscurité, l’Individu ne saurait s’acclimater brutalement à la lumière trop vive de la vérité et du bonheur et qu’il se livrerait à des excès déplorables, néfastes à l’avenir de l’humanité. Qui dit cela ? Sinon ceux qui ont intérêt à emprunter des détours ou des aveugles et des inconscients qui ont eux-mêmes peur de la lumière ?
Le temps perdu ne se rattrape jamais, hélas ! Et trop de temps a déjà été perdu par le peuple. Lorsque l’on a compris les causes d’un mal, il n’est pas bon d’hésiter à le combattre. Loyalement, courageusement, sans détour il faut aller droit au but. S’il est des obstacles, on les franchit ; s’il est des difficultés on les surmonte. L’union fait la force, et la force de tous les opprimés serait colossale, s’ils le voulaient. Qu’ils le veuillent : au terme de la route droite, est la liberté.
DETOURNER
(verbe)
Tourner en sens contraire, écarter, éloigner, faire prendre une autre direction.
Détourner la tête, détourner les oreilles. « Il n’est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, ni plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » dit le proverbe, et ils sont en effet nombreux ceux qui détournent la tête et les oreilles lorsqu’on veut leur parler de questions qui les intéressent cependant au plus haut point. C’est avec facilité que les maîtres arrivent à détourner l’attention de leurs esclaves ; il faut si peu de choses pour les distraire et les préoccuper, que ces derniers ne s’aperçoivent même pas qu’un fait divers banal et grossier, autour duquel la grande presse fait un impressionnant tam-tam, n’a d’autre but que de détourner les regards du peuple d’un événement social dont dépend tout son avenir.
Chacun peut avoir une conception particulière du « devoir », mais pour nous, anarchistes, nous pensons qu’abandonner la direction de la chose publique entre les mains de politicaillons rapaces et intéressés, se laisser accaparer par des incidents d’ordre secondaire, et ne pas s’intéresser à tout ce qui est la vie, présente et future de la société, c’est se détourner du droit chemin, c’est manquer à tous ses devoirs.
Et c’est justement parce que le peuple se détourne volontairement de tout ce qui pourrait lui être utile que, par paresse, il accorde sa confiance à ses pires ennemis, qu’on lui soustrait frauduleusement, sous formes d’impôts directs et indirects, des sommes formidables, qui, détournées de l’objet auquel elles étaient destinées, vont enrichir une armée de parasites spéculant sur la naïveté et la bêtise humaines et vivant grassement du produit de leurs forfaits.
« Les grands sujets lui sont défendus ; il se détourne sur de petites choses. » (La Bruyère)
Telle est la figure du peuple, il portera toute son attention sur un Landru quelconque, criminel de bas étage, inventé peut-être de toutes pièces pour les besoins de la cause et accusé à tort ou à raison d’avoir tué une demi-douzaine de femmes, mais ne remarquera pas qu’après avoir sacrifié sur le champ de bataille plusieurs millions d’êtres humains, les potentats et les ploutocrates, autour du tapis vert diplomatique, discutent des meilleurs moyens à employer pour asservir ce qui reste de sain et de productif dans la population du monde.
Il serait temps que le peuple se détournât de toutes ces distractions mesquines qui lui font perdre sa dignité et, qu’il se tournât enfin vers la vérité, source de lumière et de bienfaits. Le peuple peut faire de grandes choses ; sa force, sa puissance, son intelligence, son activité, son travail le lui permettent. Il lui manque une chose : la volonté. Qu’il sache l’acquérir, et alors il pourra détourner l’humanité de la route boueuse et sanglante qu’elle a suivie jusqu’à ce jour et la diriger sur le chemin de la liberté.
DETRACTION
n. f. (du latin detractio, même sens)
Action de détracter, de prélever une portion d’une chose. Il fut un temps ou le souverain avait le droit de prélever sur les successions que les étrangers venaient recueillir en France, une certaine somme. Ce droit s’appelait droit de détraction. En réalité cela n’a pas changé et de nos jours ce ne sont pas seulement les étrangers qui subissent ce « droit » mais les français également. Seulement il s’appelle « droit de succession » et c’est l’Etat qui le prélève.
Dans le langage courant, le mot distraction est plus couramment employé comme synonyme de médisance, De même qu’en jurisprudence, il signifie prélever ou retrancher une portion, en langage courant la « détraction » est l’action que commet celui qui s’efforce de rabaisser le mérite ou les qualités de son semblable.
« Ne t’abaisse pas pour entendre ces bourdonnements détracteurs » a dit Lamartine, et en effet il faut fuir ceux qui se livrent à la détraction : ce sont d’ordinaire des gens sans qualités, sans mérites et sans avantages personnels qui espèrent briller en abaissant et en amoindrissant ceux qui les touchent.
Eloignons-nous donc des détracteurs et disons avec Montaigne :
« La peine qu’on prend pour détracter les hommes vertueux, je la prendrais volontiers pour leur donner un coup d’épaule pour les hausser. »
DETROUSSEUR
n. et adj.
Celui qui détrousse, qui vole les passants sur la voie publique en usant de violence.
Il convient d’expliquer l’origine de ce mot. Il fut un temps où les anciens afin que leur robe ne trainât pas la tenait troussée à l’aide d’une ceinture, dans laquelle ils portaient également leur argent. Or, pour les voler on emportait cette ceinture et la robe se trouvait détroussée, c’est-à-dire pendante, traînante. On a donc donné le nom de détrousseur à celui qui se livrait à ce genre d’opérations.
De nos jours, la ceinture a disparu mais hélas, le détrousseur lui a survécu ; toutefois il n’opère pas de la même façon. Ce n’est pas qu’il manque de chenapans, d’êtres vils et mauvais, qui n’hésitent pas à vous attaquer au coin d’une rue pour vous dépouiller de votre maigre avoir ; mais ces détrousseurs-là, aussi nuisibles soient-ils, sont de bien faible envergure si on les compare aux détrousseurs de grande école qui, par l’escroquerie autorisée légalement, vous affament et vous réduisent à la misère. Ces détrousseurs, que l’on peut qualifier de bourgeois, mettent une certaine forme pour vous voler ; ils emploient des formules alléchantes, savent intéresser leurs futures victimes, et ils seraient vraiment bien mal inspirés en coupant la ceinture, puisque les portefeuilles s’ouvrent d’eux-mêmes, et que les poches se vident pour aller remplir leurs coffres-forts.
Laissons à la bourgeoisie ce qui lui appartient. C’est son rôle de détrousser le peuple puisque ce dernier veut bien se laisser faire. Lorsqu’il aura suffisamment été détroussé, peut-être refusera-t-il de se prêter aux entreprises du capital, mais ce qui est hélas regrettable c’est qu’il arrive souvent que le peuple se rende complice des méfaits de ses maîtres et fasse aussi œuvre de détrousseur.
Lorsque toute licence lui est accordée, et plus particulièrement lorsqu’il a revêtu l’uniforme militaire, l’homme s’avilit, se dégrade et il semblerait que l’empreinte du costume le pousse à se livrer à des excès blâmables.
C’est surtout dans les expéditions coloniales, lorsqu’il opère contre des indigènes sans défense, que se manifestent la brutalité et la bestialité de certains soldats. « On détrousse les passants, on fait le contraire aux filles ; on vole, on viole, on massacre » (P.-L. Courier). Est-ce que ces lignes de Paul-Louis Courier ne s’appliqueraient pas admirablement aux pauvres inconscients, qui, en pays conquis, disposent non seulement du bien, mais aussi de la vie de leurs victimes ? Que de travail ne reste-t-il pas à accomplir pour éduquer tous ces malheureux qui n’ont pas encore compris que tous les hommes opprimés, qu’ils soient noirs ou blancs, sont leurs frères de misère, et qu’eux-mêmes ne sont que des jouets entre les mains de détrousseurs qui ne leur donnent jamais que l’os que l’on jette aux chiens.
Espérons qu’un jour tout cela changera, et que l’humanité rénovée ne sera plus divisée en détrousseurs et en détroussés, et que tous les hommes libres et égaux travailleront à perpétuer le bien-être et la fraternité.
DETTE PUBLIQUE
n. f. (du latin debitum, chose due ; ce mot s’écrivait autrefois debte)
La dette est le contraire de la créance et l’on donne le nom de dette publique à celle contractée par les gouvernements afin de subvenir aux besoins de l’Etat.
Lorsque les impôts directs et indirects qui forment l’ensemble des ressources de la nation, ne sont pas suffisants pour couvrir les frais et les dépenses d’un gouvernement, celui-ci lance un emprunt, remboursable en un nombre d’années déterminées à l’avance, et paye à ses créanciers un intérêt fixe dont le taux varie en raison directe de la confiance inspirée par la situation des finances gouvernementales.
Mathématiquement, à mesure qu’augmentent les besoins de l’Etat et que grossit son déficit, la confiance baisse et ses emprunts se couvrent plus difficilement ; c’est alors que les gouvernements élèvent le taux de l’intérêt. Avant la guerre de 1914, la France trouvait de l’argent en payant à ses créanciers un intérêt de 3 à 3,5 % ; mais, de nos jours, vu la situation déficitaire, il est obligé pour trouver des créanciers d’offrir un intérêt variant entre 6 et 7 %. On peut prétendre que le taux élevé de l’intérêt exigé par les prêteurs, a pour cause unique, la concurrence des entreprises privées qui offrent à leurs créanciers de précieux avantages et qu’en conséquence ceux qui possèdent quelques capitaux aiment mieux les placer dans le commerce et l’industrie que dans les fonds d’Etat. Il n’y a là qu’une part de vérité et plus particulièrement en ce qui concerne la France, pays « du bas de laine » où, d’ordinaire, le petit propriétaire, le paysan, l’employé ou l’ouvrier ayant réalisé quelques économies, préfèrent faire un placement de « père de famille », c’est-à-dire de toute sécurité, que de se lancer dans des aventures spéculatives, et être soumis aux aléas, aux incertitudes, aux fluctuations des affaires industrielles et commerciales.
Déjà avant la guerre, l’entreprise privée offrait à ses créanciers des avantages supérieurs à l’emprunt d’Etat, ce qui n’empêchait pas la population d’offrir son argent aux gouvernements, en se contentant d’un intérêt modique ; il faut donc en conclure que si, à présent, l’argent déserte les caisses de l’Etat, c’est qu’ aux yeux des créanciers, l’Etat n’offre plus les garanties du passé. Nous verrons plus loin en étudiant la situation du Trésor français, que le créancier n’a pas tout à fait tort.
En France, la dette publique se compose : de la rente perpétuelle, désignée ordinairement sous le nom de dette consolidée ; des rentes viagères et des pensions. En ce qui concerne la rente perpétuelle, l’Etat ne rembourse jamais le capital mais verse éternellement l’intérêt de la somme qui lui a été remise. Exemple : l’Etat vend de la rente à raison de 5 %, c’est-à-dire, qu’en échange de 100 francs, il remet à son acheteur un titre de rente qui permettra à ce dernier de toucher chaque année une somme de cinq francs. Naturellement, ce titre de rente est remis par son détenteur à ses héritiers qui, à leur tour, touchent l’intérêt de la somme donnée et transmettent également le titre à leurs héritiers. Et cela peut durer indéfiniment. Nous avons dit que l’Etat ne rachetait pas sa rente, et lorsqu’ un « rentier » veut se débarrasser de son titre il est obligé de trouver un acquéreur et de le vendre en Bourse par l’intermédiaire d’un agent de change. Il se produit alors ce fait : le titre est soumis aux variations de l’offre et de la demande : s’il y a peu de vendeurs et quantité d’acheteurs, la valeur du titre monte ; si c’est le contraire qui se produit, sa valeur baisse. Dans le premier cas le vendeur revend, 110, 120, etc., ce qu’il a payé 100 francs ; dans le second, il subit une perte sèche.
A côté de cette rente perpétuelle que l’Etat est obligé de payer à ses créanciers et qui grève, et grèvera indéfiniment son budget, il y a la rente viagère et les pensions qui s’éteignent par le décès des titulaires. Si, considérée dans le temps, cette dette est moins lourde à l’Etat, par contre le taux de l’intérêt est généralement plus élevé, car le titulaire de cette rente sacrifie à l’intérêt tout son capital et son titre n’est, naturellement, pas transmissible à ses héritiers. Cela revient à dire, que la dette de l’Etat envers son créancier s’éteint à la mort de ce dernier.
A cette rente viagère et perpétuelle il faut ajouter la rente amortissable. Pour inspirer confiance à ses prêteurs éventuels, l’Etat émet parfois de la rente, qu’elle s’engage à racheter dans un laps de temps déterminé. A la date fixée le créancier de l’Etat est en droit de réclamer le remboursement de sa créance, mais il n’a d’autre ressource, s’il veut s’en débarrasser avant la date fixée, que de la vendre en Bourse, en se livrant à la même opération que s’il s’agissait de rente perpétuelle ou consolidée. Ces dettes que nous énonçons ci-dessus, qu’il est convenu d’appeler « dettes à long terme », et dont nous donnons le montant plus loin, ne sont pas les seules. Il y a également la dette flottante, qui s’accroît, méthodiquement, mathématiquement et dont le remboursement peut être exigé presque immédiatement par les créanciers de l’Etat.
Lorsque pour faire face à ses dépenses un gouvernement a compté sur les recettes normales et autorisées et que ses espérances ne se sont pas réalisées, il émet des bons du Trésor qu’il s’engage à rembourser dans un temps relativement bref. Cette masse flottante se renouvelle donc sans discontinuer, car l’Etat emprunte continuellement pour faire face à ses échéances, et a recours à « Pierre lorsqu’il lui faut rembourser Paul ». En temps normal le renouvellement indispensable de la « masse flottante » s’effectue assez facilement, mais il arrive fatalement un moment où ce petit jeu doit s’interrompre et où la difficulté apparaît insurmontable. C’est ce qui se produisit en Allemagne en 1923 et en France en 1926. L’Etat est alors acculé à la faillite.
En étudiant la situation financière de la France, nous nous rendrons compte facilement des « bienfaits » engendrés par le désordre capitaliste.
La dette publique de la France se divise en dette intérieure et dette extérieure. Nous allons étudier, d’abord qu’elle était au 30 avril 1925 la dette intérieure, nous verrons ensuite qu’elle est sa dette extérieure.
Les Fonds d’Etat en circulation à la date ci-dessus indiquée se répartissaient ainsi :
-
Rentes, 3, 4, 5 et 6% (perpétuelles) … 96.202.116.000 Fr.
-
Rentes 3 ; 3,5 et 5 % (amortissables) … 14.458.715.000
-
Bons du Trésor 3 et 5 ans … 8.190.963.000
-
Bons du Trésor 3, 6 et 20 ans … 9.981.756.000
-
Obligations de la Défense Nationale … 1.910.877.000
-
Bons de la Défense Nationale … 53.229.285.000
-
Bons du Trésor … 2.364.732.000
TOTAL : 186.338.444.000 Fr.
Sur cette somme formidable de 187 milliards de francs, 96 milliards, transformés en rente perpétuelle n’auront pas à être remboursés par l’Etat, mais par contre l’Etat sera tenu de verser indéfiniment aux porteurs de titres l’intérêt fixé à l’émission ; et une somme de 90 milliards est amortissable, c’est-à-dire qu’en sus de l’intérêt l’Etat a pris l’engagement de rembourser dans un temps déterminé le capital qui lui fut avancé ; et, s’il n’a pas d’argent, il ne peut rendre ce qu’il doit qu’à la condition d’emprunter à nouveau et c’est ce qui explique que la dette publique augmente de jour en jour, de semaine en semaine, d’année en année.
D’autre part, si l’Etat peut gagner du temps et ne rembourser que dans un temps très lointain l’argent qui lui a été prêté, il est cependant obligé de payer périodiquement, et régulièrement s’il ne veut pas perdre son crédit, les coupons représentant l’intérêt des sommes dont il est débiteur.
Pour l’année 1924, l’Etat français a payé, aux détenteurs des fonds d’Etat, à titre d’intérêt, une somme de 10 milliards de francs, prélevée sur son budget et dont nous donnons ci-dessous le décompte :
-
Rente 3, 4, 5 et 6 % (perpétuelle) … 4 .882.667.810 Fr.
-
Rente 3 ; 3,5 et 5 % (amortissable) … 664.920.141
-
Bons du Trésor 3 et 5 ans … 493.927.780
-
Bons du Trésor, 3, 6 et 20 ans … 604.951.000
-
Obligations de la Défense Nationale … 96.045.056
-
Bons de la Défense Nationale … 2.507.099.323
-
Bons du Trésor … 106.412.940
TOTAL : 9.356.024.050 Fr.
En conséquence, si nous supposons- ce qui est peu probable — que cette partie de la dette intérieure, contractée vis-à-vis des créanciers habitant la France, n’augmente pas, il est cependant indispensable que l’Etat français sorte chaque année de ses caisses une somme de 10 milliards pour payer les intérêts des sommes investies dans les fonds d’Etat.
La France a une population de 40 millions d’habitants. Si nous tenons compte des enfants, des vieillards et des infirmes, on peut dire qu’il n’y a en réalité que 30 millions d’habitants qui soient susceptibles de venir en aide à l’Etat et de subvenir à ses besoins.
Il faut donc, uniquement pour payer l’intérêt des fonds d’Etat, que chacun de ces trente millions d’habitants, verse annuellement, sous forme d’impôts directs ou indirects, une somme de 300 francs. Le capital restera toujours dû, naturellement.
Et cela n’est qu’une partie de la dette intérieure, qui dans son ensemble se répartissait comme suit à la date du 30 avril 1925.
-
Dette à long terme (ministère des Finances) … 144.152.494.500 Fr.
-
Dette à long terme (autres ministères) … 11.099.774.500
-
Dette à court terme … 44.274.769.000
-
Dette flottante portant intérêt … 81.966.759.000
-
Dette à long terme sans intérêts … 4.679.897.000
TOTAL : 286.173.694.000 Fr.
La dette intérieure de la France s’élevait donc au 30 avril 1925 à DEUX CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLIARDS DE FRANCS, et ce n’est pas seulement 300 Fr., par conséquent, que chaque adulte devrait payer pour satisfaire aux exigences des créanciers, mais bel et bien 450 francs par an.
Mais, à la dette intérieure il convient d’ajouter maintenant la dette extérieure, ce qui nous donnera le chiffre total de la dette française ou dette dite publique.
Avant de nous livrer à cette opération il convient de signaler qu’au mois de décembre 1913, la dette totale de la France n’était, en chiffres ronds, que de 33 milliards de francs, et que si elle s’est élevée à des sommes aussi fabuleuses, en un laps de temps relativement restreint, c’est que la guerre est venue engloutir non seulement des millions d’hommes, mais aussi des fortunes. Pendant quatre ans et demi des millions ont été évaporés, et si le peuple a consenti à faire une guerre qui coûta si cher, il est appelé aujourd’hui à en payer les frais.
Etudions maintenant la dette extérieure de la France.
Si nous calculons le dollar à trente francs et la livre sterling à 150 (ils étaient respectivement à 36 et 170 au mois de septembre 1926), nous obtenons les chiffres suivants.
La dette de la France envers les Etats-Unis se décompose ainsi :
-
Fonds avancés par le Trésor (capital seul) … 87.995.145.480 Fr.
-
Matériel de guerre … 12.220.234.410
-
Prêts directs au Gouvernement français :
-
— 1920 … 2.422.416.000
-
— 1921 … 2.107.617.000
-
— 1924 … 2.953.485.000
-
Reste dû sur :
-
— Emprunts anglo-français … 415.500
-
— Emprunts 5,5 % … 63.300.000
TOTAL : 107.762.613.390 Fr.
Nous disons donc que la dette de la France à l’Amérique s’élève, intérêts arriérés et à venir non compris, à 108 milliards de francs.
Examinons maintenant la dette de la France à l’Angleterre, toujours à la date du 30 avril 1925 :
-
Bons du Trésor remis au Trésor britannique joints aux intérêts composés … 105.674.200.000 Fr.
-
Matériel de guerre … 1.008.910.350
-
Bons du Trésor émis en Grande-Bretagne … 660.000.000
-
Bons du Trésor émis à la Banque d’Angleterre … 7.050.000.000
TOTAL : 114.393.110.350 Fr.
La dette de la France à l’Angleterre est donc en chiffres ronds, de cent quinze milliards de francs.
Et ce n’est pas tout. En outre de cet argent emprunté de tous côtés pour couvrir les frais de la guerre, les divers gouvernements français qui se succédèrent de 1924 à 1926, prirent divers engagements envers une certaine partie de la population, et ces engagements viennent à leur tour grossir le montant de la dette publique.
« A la fin du 1er semestre 1923 on avait versé : 63.200 millions de francs comme indemnités aux régions libérées…Les réclamations s’élevaient à 123 milliards de francs. Sur les réclamations examinées, s’élevant à 106 milliards de francs, les Commissions ont accordé environ 72 milliards d’indemnité représentant seulement 68 % du montant réclamé. »
Il reste encore à examiner des réclamations s’élevant à 17 milliards ; si nous appliquons à cette somme le pourcentage de 68 %, les indemnités accordées s’élèveraient à 11,5 milliards. La somme totale des dommages alloués (ou restant à allouer) serait de 72 milliards, plus 11,5 milliards, soit 83,5 milliards de francs. Puisque les dommages payés s’élèvent à 63,2 milliards, il reste encore à payer 20,3 milliards, sans compter l’Alsace et la Lorraine à laquelle on attribue 550 millions de francs ». (D’après le mémoire présenté à Washington, le 29 avril 1926 aux membres de la « War Debt Funding Commission », par M. Henry Bérenger, ambassadeur de France à Washington).
Nous pouvons maintenant récapituler :
-
Dette intérieure … 286.173.694.000 Fr.
-
Dette aux Etats-Unis … 107.762.613.390
-
Dette à la Grande-Bretagne … 114.393.110.350
-
Régions libérées … 20.000.000.000
-
Dus à divers Etats … 10.000.000.000
*TOTAL : 538.329.417.740 Fr.
La dette publique de la France, d’après les chiffras officiels, s’élevait donc, à la date du 30 avril 1925, à la somme de CINQ CENT QUARANTE MILLIARDS DE FRANCS.
Il faut encore ajouter à cette somme les intérêts dus aux Etats-Unis, pour le principal de notre dette et qui se chiffraient au 15 juin 1925 par 26.430.000.000 de francs, ce qui remonte le total de la dette à 570 milliards, et à 600 milliards si l’on ajoute également les intérêts dus à l’Angleterre.
A mesure que les capacités de payement d’une puissance s’affaiblissent, ses créanciers deviennent plus pressants, et réclament leurs créances, et l’Etat débiteur est mis en demeure de régler ses dettes ou tout au moins de prendre des arrangements avec ses créanciers. Nous avons dit que l’Etat n’avait d’autre alternative pour se libérer de sa dette que de faire pression sur la population pour en obtenir les ressources nécessaires. Pourtant il arrive un moment où le poids des impôts directs ou indirects est si élevé, qu’il devient impossible à un Gouvernement de les percevoir. La population mise à sec ne peut plus rien donner et le problème devient alors insoluble.
C’est le cas dans lequel se trouve la France en cette année 1926. Les difficultés qu’elle éprouve pour faire face à ses engagements sont insurmontables et l’on peut dire sans crainte de se tromper que, même si par un palliatif quelconque, un Gouvernement arrivait à gagner du temps, ce ne serait que partie remise, aucune mesure, propre au régime capitaliste ne pouvant sauver l’Etat de la ruine financière, de la faillite. On en jugera par les chiffres des sommes nécessaires à l’Etat pour payer ses dettes ou simplement l’intérêt de celles-ci. Le budget de l’Etat français était en 1924, de 41.214.000.000 de francs, or, cette somme ne fut pas suffisante pour couvrir les dépenses et l’Etat fut obligé d’emprunter :
-
En France … 5.444.000.000 Fr
-
A l’Etranger … 2.122.000.000
-
Avances de la Banque de France … 500.000.000
-
Emprunts émis par les soins du Crédit National … 6.860.000.000
Soit un total de près de quinze milliards de francs, et pourtant en 1924, les charges de la France n’étaient pas aussi lourdes qu’elles le sont en 1926 et qu’elles le seront dans les années qui suivront.
Tiraillé par ses créanciers extérieurs, l’Etat français prend des engagements qu’il ne sera en mesure de tenir que s’il affame sa population et encore ! Cependant, cela n’a pas empêché les représentants officiels du capitalisme français de traiter avec leurs confrères américains et, par l’intermédiaire de M. Bérenger, ambassadeur de France à Washington, de conclure le fameux accord du 29 avril 1926 qui reconnaissait à l’Amérique une créance de (nous calculons le dollar à 30 francs) CENT VINGT ET UN MILLIARDS DE FRANCS remboursables en soixante ans, la première échéance étant prévue pour le 15 juin 1926 et s’élevant à 900 millions de francs et la dernière pour le 15 juin 1987 et s’élevant à trois milliards et demi. Ce qui revient à dire que, durant soixante ans le travailleur français devra suer 2 milliards de francs supplémentaires pour remplir les coffres-forts des banquiers américains et de leurs complices les banquiers français.
La classe ouvrière a en général une sainte horreur des chiffres et elle se désintéresse des questions financières qui agitent les cercles et les milieux politiques. C’est un grand tort ; car, à l’étude des chiffres, on s’aperçoit de la fragilité du régime capitaliste et du peu qu’il faudrait pour en ébranler les bases.
Nous avons donné plus haut l’état de la dette publique française, et nous avons fait remarquer qu’il était matériellement impossible à un gouvernement de se libérer de cette dette. Nous avons dit également que si l’Etat français ne pouvait rembourser le principal de sa dette, il était tenu à en payer les intérêts à ses créanciers. Or, il semble qu’il lui est aussi impossible de payer les intérêts que la dette elle-même et que les uniques ressources provenant des impôts directs ou indirects ne sont pas assez élevés pour faire face aux dépenses utiles et inutiles de la nation.
Pour donner à cette affirmation la force qu’il convient, nous allons rechercher quelle somme l’Etat est obligé de prélever sur le budget annuel qui lui est alloué, pour solder l’intérêt de la dette contractée :
INTÉRÊTS
-
À l’Intérieur :
-
Dette perpétuelle … 4.362.000.000
-
Dette à long terme … 4.449.000.000
-
Dette flottante … 3.477.000.000
-
Dette à court terme … 1.926.000.000
-
Pensions civiles et militaires … 5.444.000.000
-
-
À l’Extérieur :
-
Etats-Unis … 540.000.000
-
Angleterre … 1.200.000.000
TOTAL : 21.368.000.000
-
Soit près de 22 milliards de francs par an que n’importe quel gouvernement français sera obligé de trouver s’il veut conserver son crédit. Il faut faire remarquer que cette somme n’éteindra pas la dette publique et que si le Gouvernement tient à liquider ou à consolider sa dette extérieure, en soixante annuités, ainsi qu’il en est question, il lui faudra en outre verser en moyenne, et pendant soixante ans, toujours en calculant le dollar à 30 francs et la livre sterling à 150, environ deux milliards à l’Amérique et autant à l’Angleterre, ce qui nous donne :
-
Intérêts annuels à payer tant à l’Intérieur qu’à l’Extérieur … 21.368.000.000
-
Consolidation de la dette aux Etats-Unis … 2.000.000.000
-
Consolidation de la dette à la Grande-Bretagne … 2.000.000.000
TOTAL : 25.368.000.000
Soit un total de 25 milliards de francs par an.
Est-ce tout ? Non pas. Nous avons dit en nous reportant aux chiffres officiels présentés par M. Bérenger à Washington, que l’Etat français avait encore à payer une somme de 20 milliards pour ses régions libérées. Si nous supposons qu’il échelonne ses payements en une période de dix années c’est deux milliards de plus par an que les caisses du Gouvernement devront sortir.
Nous nous arrêterons ici en signalant que, dans tous les chiffres que nous donnons, nous sommes au-dessous de la vérité, et que nous n’avons pas tenu compte des dettes secondaires : des 54 millions de florins dus aux Pays-Bas, du million de livres dû à l’Egypte, des 20 millions de pesos-or dus à l’Argentine, etc., etc., et nous dirons que la France a une dette publique de 570 MILLIARDS DE FRANCS et que, dans les années qui suivront celles de 1926, le peuple français devra trouver 25 milliards de francs par an pour payer l’intérêt de cette dette publique.
Un Etat a cependant d’autres dépenses que celles occasionnées par sa dette, et il a pour devoir d’y subvenir.
En 1913, toujours en nous servant de données officielles qui ne peuvent être démenties, 70 % du budget « demeuraient disponibles pour satisfaire aux besoins de la nation », ce qui revient à dire que ces 25 milliards que l’Etat demande par an ne représentent que 30 % de la somme qui lui est nécessaire, pour que son budget soit dans une situation identique à celle de 1913, ou :
( 25.000.000.000 * 100 ) / 30 = 83.333.333.333.33
Soit en chiffres ronds : 83 milliards de francs par an que le travailleur français doit verser sous forme d’impôt, s’il veut que sa situation redevienne ce qu’elle était à la veille de la guerre.
Ce n’est pas à la légère que nous prétendons que la dette publique de la France ne peut aller qu’en s’augmentant et que rien ne peut permettre à un gouvernement d’échapper à de nouveaux emprunts.
Tous les objets, toutes les matières imposables l’ont été à leur extrême limite, les denrées de première nécessité ont été taxés par les divers gouvernements qui se sont succédés depuis 1919, au point de rendre la vie presque impossible aux travailleurs, obligés de se restreindre même dans leur nourriture ; et cependant les impôts directs et indirects du pays n’ont pas fourni aux gouvernements une somme supérieure à 45 milliards de francs. Or, les gouvernements, nous l’avons démontré plus haut, ont besoin pour stabiliser l’état financier de la Nation, de 85 milliards, près du double ; où iront-ils les chercher ?
Empruntant une formule chère aux politiciens socialistes, nous pourrions dire : « Il faut prendre l’argent où il se trouve », mais nous savons trop que ceux qui détiennent la richesse, entendent ne pas s’en démunir, et persistent à vouloir faire peser sur le peuple tout le poids des charges fiscales.
85 milliards d’impôts par an sont introuvables en France si l’on considère la situation des classes moyennes et des classes travailleuses. Le peuple a tout donné : son sang et son argent, et l’Etat l’a si bien compris, que durant les années antérieures à 1926, comprenant qu’il serait inutile d’essayer d’en tirer quelque chose de plus, il n’eût d’autre recours que l’emprunt pour faire face à ses dépenses.
Pour l’édification et la documentation de nos lecteurs, nous allons leur soumettre un tableau comparatif et des budgets et des emprunts de l’Etat français, entre les années 1913 et 1926 :
| Années | Budgets | Emprunts |
|---|
| 1913 | 5.067.000.000 |
| 1914 | 10.371.000.000 | 6.299.000.000 |
| 1915 | 22.120.000.000 | 20.708.000.000 |
| 1916 | 36.848.000.000 | 29.583.000.000 |
| 1917 | 44.661.000.000 | 35.633.000.000 |
| 1918 | 56.649.000.000 | 37.668.000.000 |
| 1919 | 54.956.000.000 | 51.331.000.000 |
| 1920 | 57.501.000.000 | 42.822.000.000 |
| 1921 | 46.492.000.000 | 31.120.000.000 |
| 1922 | 37.929.000.000 | 20.064.000.000 |
| 1923 | 37.929.000.000 | 27.761.000.000 |
| 1924 | 41.214.000.000 | 14.926.000.000 |
On remarquera que les emprunts de l’Etat français diminuent à dater de 1921. La raison n’est pas, comme on pourrait le croire, que les gouvernements n’ont plus besoin d’argent, mais bien au contraire qu’ils ne trouvent plus de créanciers, leur solvabilité étant douteuse : c’est à dater de ce moment que les difficultés grandissent et deviennent insurmontables.
* * *
Maintenant que nous avons établi avec un réel souci d’impartialité qu’elle est la dette publique de la France, il faut, pour que la vérité dans toute sa clarté soit respectée, avouer que la France est à son tour, créditeur de certaines sommes.
La dette publique de la France s’élève à près de 600 milliards, mais on lui doit :
-
La Russie … 6.023.300.000
-
La Yougoslavie … 1.738.566.000
-
La Roumanie … 1.132.000.000
-
Là Grèce … 537.514.000
-
La Pologne … 895.400.000
-
La Tchécoslovaquie … 542.200.000
-
L’Italie … 350.273.000
-
Le Portugal … 9.000.000
-
L’Esthonie … 3.500.000
-
La Latvie … 9.000.000
-
La Lithuanie … 2.300.000
-
La Hongrie … 800.000
-
L’Autriche … 331.926.000
TOTAL : 11.375.799.000
Soit un peu plus de onze milliards de francs. Est-ce être partial que de dire, que ce ne sont pas ces onze milliards de créances qui peuvent sauver le pays de la débâcle ? Ajoutons également qu’à titre de dommages de guerre, la France, dans les années qui suivront 1926, escompte récupérer de l’Allemagne quelques milliards. II ne semble cependant pas que ce soit de ce côté que puisse venir le salut.
* * *
Quelle conclusion est-il possible de donner à cet exposé ? On reproche fréquemment aux éléments révolutionnaires et plus particulièrement aux communistes libertaires, de critiquer, de s’attaquer à des institutions, de détruire idéologiquement toute l’économie sociale moderne, mais de ne pas apporter de remèdes aux maux dont souffre la société.
Nous avons dit et nous ne pouvons que répéter qu’il n’y a aucun remède à puiser dans les formes d’organisations élaborées sur le capital. Le capital est la source même des maux, et c’est à lui qu’il faut s’attaquer si nous voulons tous guérir.
L’on conçoit que des hommes qui bénéficient du régime capitaliste cherchent à lui sauver la vie ; mais que des êtres qui en souffrent, qui en ont reconnu les vices, les tares, les erreurs, se refusent à se joindre à ceux qui le combattent, cela est incompréhensible.
Nous avons brossé rapidement la situation de la France, qui sera demain celle de l’Angleterre, de l’Italie, de l’Espagne, etc.… Même l’Amérique qui semble si bien assise sur ses monceaux d’or, n’échappera pas un jour à la débâcle et à la ruine. Les causes indirectes de cette débâcle peuvent ou pourront être différentes de celles qui affaiblissent la nation française, mais les causes directes seront les mêmes ; c’est le capital qui se désagrègera.
Le capitalisme a à son service des économistes compétents en matière financière ; ils se sont attelés à 1a besogne, ils ont cherché tous les moyens possibles et imaginables, pour sortir le capitalisme français de l’ornière. Ils n’ont rien trouvé ; ils ne trouveront rien, car il ‘n’y a rien, En désespoir de cause, ils ont accouché cette monstruosité que la cause initiale des difficultés financières de l’Etat français, était la journée de huit heures, et que si le travailleur consentait à augmenter sa production, la situation de la nation s’améliorerait.
Le travailleur français, comme celui du monde entier du reste, a été entraîné contre son gré dans le cataclysme qui ensanglanta le monde de 1914 à 1918. C’est lui qui a le plus souffert, c’est lui qui a le plus donné ; et affaibli, saigné, il a réintégré son foyer, convaincu qu’il s’était battu en vain, et que le « droit et 1a liberté » n’était qu’une formule propre à le tromper et à le sacrifier à la soif des grands potentats du commerce et de l’industrie.
Il ne travaille que huit heures, et pas toujours encore ; mais loin d’améliorer le sort de la nation et son sort propre, les plus longues journées de travail auraient pour conséquence le chômage et par extension la misère. Nous avons tout près de nous l’exemple de l’Angleterre et de son million et demi de chômeurs, qui, depuis des années, sont à la recherche d’une situation. Et puis est-ce au peuple de fournir les moyens de relever le crédit de l’Etat ? Avant 1914, tant bien que mal, le budget familial était bouclé avec le salaire modeste du père de famille. Tant bien que mal également le budget de l’Etat suffisait aux dépenses de la Nation.
Ce n’est pas le travailleur qui a voulu la guerre. Le prolétariat, qu’il soit allemand, français ou anglais, avait un profond désir de quiétude et de paix. Ce n’est pas le travailleur qui a contracté les milliards de dettes que le capitalisme mondial entend maintenant lui faire payer. Il ne payera pas, il ne peut pas payer. Que ceux sur qui pèse la lourde responsabilité de la boucherie, que ceux qui ont avec désinvolture emprunté des milliards pour fournir de la nourriture aux canons et aux fusils, que ceux qui ont à leur actif le crime affreux qui coûta la vie à des millions d’êtres humains, s’arrangent ; qu’ils cherchent et qu’ils trouvent ; ou alors qu’ils tremblent, car la dette publique, leur dette, s’éteindra dans la Révolution.
- J. CHAZOFF.
DEVELOPPEMENT
n. m.
Action de développer, d’ôter l’enveloppe ; de retirer ce qui entoure, de déployer ce qui enveloppe. Le développement d’une pièce d’étoffe, d’un objet d’art, etc.…Accroissement des facultés intellectuelles ou morales. Le développement de 1’intelligence, du cœur, du caractère. Travail organique par lequel un être se constitue dans ses formes. Le développement d’une fleur, d’un corps, d’un arbre. Exposition détaillée d’un sujet ; le développement d’une thèse, d’un discours d’un article, d’une idée. En ce qui concerne une idée, l’action de la développer est indispensable lorsque l’on veut se faire comprendre. Quand nous disons : « les Anarchistes veulent instaurer un milieu social qui assure le maximum de bien-être et de liberté adéquate à chaque époque » ; cette proposition peut paraître abstraite à celui qui n’est pas initié au mouvement philosophique et social, et ignore tout de l’Anarchie. Il est donc utile d’étendre, de donner de l’ampleur à cette proposition et de tirer de ce simple énoncé toutes les conclusions qui s’imposent. Par le développement du sujet, on démontrera que les Anarchistes ont raison de vouloir « instaurer un nouveau milieu » mais qu’il est nécessaire pour cela de détruire le milieu actuel, dont tous les rouages sont viciés et corrompus. Par le développement, on arrivera également à démontrer que cette transformation ne peut être que consécutive à une Révolution qui dépossèdera ceux qui ont accaparé toute la richesse économique du monde et jouissent de tous les privilèges. En un mot le développement d’un simple énoncé anarchiste nous conduit à la critique des sociétés modernes et à la recherche des moyens propres à employer pour sortir les individus de la situation précaire dans laquelle ils se trouvent.
A l’étude des hommes et des choses, on constate que si les individus ne jouissent pas de plus de bien-être et de liberté, c’est que leur développement intellectuel et moral est encore à l’état d’embryon et qu’ils ont encore à se perfectionner s’ils veulent conquérir leur liberté. Il est du devoir de chacun d’étendre ses connaissances, de chercher à voir et à comprendre tout ce qui l’entoure, afin de percer le mystère de ce qui lui est inconnu. Le peuple est asservi, opprimé, et aspire à sa libération ; il faut cependant qu’il sache qu’une révolution brutale serait imparfaite, et inopérante si, auparavant, une autre révolution ne s’était faite en son cerveau. Une révolte d’ignorants peut déplacer des privilèges, elle ne peut pas les supprimer. La plus grande révolution de l’homme doit se faire en lui. S’instruire, s’éduquer, approfondir toutes choses, puiser dans les sciences, dans les arts, dans le passé et dans le présent un bagage de connaissances susceptibles d’assurer la vie harmonieuse de demain, se développer physiquement et intellectuellement, c’est la tâche à laquelle doit s’attacher le Révolutionnaire. Le développement de l’humanité sera toujours relatif au développement des individus qui la composent, et c’est parce qu’ils le savent que tous les partisans de l’autorité entravent le développement intellectuel du peuple, et c’est pourquoi aussi ils oppriment avec tant de férocité les Anarchistes qui savent et veulent faire comprendre aux hommes qu’une société libre doit être peuplée d’individus développés.
DEVENIR
n. m. et verbe
Il s’oppose à Etre dans le sens de ce qui reste inchangé, et désigne le changement, la série de passages d’un état à l’autre. Le problème de la stabilité : « être » ou du changement : « devenir », fut posé et étudié par les premiers philosophes grecs. Selon Héraclite, la permanence d’Etre est une pure illusion ; la réalité est comme un fleuve qui coule toujours. Selon Parménide et l’école éléatique, seulement Etre est réel ; il est le substratum du changement, la substance qui reste, alors que les qualités changent. La controverse qui opposa les disciples de Parménide à ceux d’Héraclite persiste et plus près de nous, le représentant des premiers fut Herbart, et Hegel celui des seconds.
La célèbre formule d’Héraclite : « panta rêi » (tout passe) a été reprise par le mobilisme, terme proposé par Chide et accepté par la Société Française de Philosophie, pour indiquer la doctrine selon laquelle le fond des choses n’est pas seulement individuel et multiple (pluralisme), mais en mouvement continuel : en continuelle transformation et sans lois fixes ainsi que toute tentative d’organisation rationnelle reste inefficace. La doctrine Hégélienne, la Darwinienne et la Bergsonienne ont porté au mobilisme. (Chide, Le mobilisme moderne, 1908).
DEVERGONDAGE
n. m.
Libertinage, excès, dérèglement dans les mœurs. Etre dévergondé : mener une vie licencieuse. Un jeune homme dévergondé ; une jeune fille dévergondée. Le dévergondage fait des ravages dans toutes les classes de la société et n’est malheureusement pas seulement le privilège des riches. Le peuple a, lui aussi, ses abcès et il en souffre. Ils sont hélas trop nombreux, les jeunes gens qui se perdent dans les bouges des grandes villes et quittent l’atelier pour vivre des produits de la prostitution ! L’oisiveté dans laquelle ils se vautrent les corrompt et ils sont bien vite entraînés à se livrer à la débauche et au dévergondage le plus scandaleux et le plus bas. Une fois sur la pente glissante, il est presque impossible de s’arrêter et les malheureux traînent leur misérable existence partagée entre la « noce » et la prison. Encore, eux, ont-ils cette ultime excuse, qu’ils ne voulaient pas se plier sous le joug d’une exploitation stupide et féroce, qu’ils n’étaient pas détenteurs d’une instruction ou d’une éducation solides ; mais que dire de cette bourgeoisie qui se dévergonde dans les boîtes de nuit, et s’en va chercher dans les bouges aristocratiques des sensations nouvelles pour leurs sens désabusés ! Que penser de cette jeunesse nourrie au lait de la morale bourgeoise, qui en une nuit dépense dans les cabarets louches de Montmartre ou d’ailleurs, le produit du travail de dizaines, de centaines d’ouvriers ! Est-ce que Paris, avec tous ses music-halls, ses établissements de nuit, ses bordels, n’offre pas le spectacle d’un dévergondage outrageant, et la vie licencieuse qui s’y mène n’est-elle pas le symbole d’une dégénérescence et d’une décadence désespérante ?
Mais si le peuple, un jour, ou plutôt un soir, le peuple qui travaille, qui peine et qui souffre, le peuple aux mains calleuses, le peuple en cotte et en bourgeron, le peuple que l’on exploite et auquel on accorde tout juste une pitance qui lui permet de ne pas crever de faim, descendait dans vos repaires, Messieurs les bourgeois, et venait vous demander des comptes ? S’il venait vous demander s’il est juste, logique, équitable, moral, que vous puissiez sabler le champagne à flots, cependant que lui n’a pas de lait à donner à ses petits, s’il venait vous montrer sa compagne flétrie par le travail, vieille de trente ans, cependant que vos maîtresses sont entretenues richement par le fruit de son travail, s’il venait là où vous vous amusez briser votre dévergondage, et vous crier que vous n’avez pas le droit de rire et de vous distraire, alors que lui a faim, croyez-vous qu’il se trouverait de par le monde, un homme ayant conservé un peu de sens moral, et au cœur un peu d’amour pour l’humanité, pour l’en blâmer ?
Réfléchissez ! Quelqu’un doit payer, quelqu’un payera.
Louis XVI a payé de sa tête le dévergondage de ses aïeux. L’aristocratie française sait ce que lui a coûté son dévergondage. La bourgeoisie le saura bientôt. Le vieil adage « l’excès en tout est un défaut » n’est pas vain. Livrez-vous à vos excès de débauches ; lorsque le peuple en aura assez, d’un seul bloc il fera votre bilan, et vous réclamera le prix de ses souffrances et de ses misères.
DEVIATION
n. f.
Action de dévier. Changement dans la direction naturelle. La déviation d’un corps, la déviation d’un boulet. Ecart moral. Une déviation de principes. Les déviations socialistes, communistes, anarchistes.
Y a-t-il des déviations anarchistes et l’Anarchisme peut-il dévier ? Il faudrait, pour établir un critérium, établir auparavant ce qu’est l’anarchisme et nous poser cette question : qui est anarchiste ? Dans « The Road of Freedom », revue américaine, Théo Mill commençait ainsi un article :
« Si vous rencontrez dans la rue un passant qui vous déclare être Shakespeare ou Napoléon, sans aucune hésitation vous affirmerez que cet homme est un fou ; mais s’il vous déclare qu’il est socialiste ou anarchiste, vous enregistrerez simplement sa déclaration et lui ouvrirez votre cœur, car il n’y a aucune possibilité de juger de sa sincérité. »
En effet si nous laissons de côté les petits actes secondaires de la vie, nous sommes obligés de reconnaître qu’il est difficile à un anarchiste de donner une preuve absolue de sa loyauté et que sa sincérité et son abnégation ne peuvent se manifester que lorsque, à l’évolution lente et méthodique fait suite, à la faveur des événements, l’action révolutionnaire.
Il en est ainsi dans tous les domaines de l’action politique et sociale, et ce qui est vrai pour les anarchistes l’est également pour les socialistes ou les communistes. Chez les uns et chez les autres l’héroïsme est subordonné aux événements.
Nous avons dit par ailleurs, que tous les partis politiques avaient fait faillite et que le communisme qui fut un moment l’espérance du monde du travail s’était à son tour discrédité. L’Anarchisme est donc à nos yeux la seule conception philosophique et sociale qui puisse assurer le bonheur de l’humanité puisqu’il est de toute évidence que le socialisme qui a tenté une expérience en Angleterre, en Allemagne et même en France, n’a apporté que des résultats négatifs et que le communisme autoritaire n’a pas été plus heureux en Russie.
D’où viennent alors la faiblesse numérique des Anarchistes et le peu de crédit qu’ils rencontrent auprès des profanes ? D’où viennent les difficultés qu’ils ont à attirer l’attention du peuple et à s’attacher ses sympathies ? Les campagnes de calomnies menées contre eux ne sont pas suffisantes à expliquer ce phénomène ; il y a d’autres causes, d’autres facteurs qu’il nous faut rechercher, si nous voulons sincèrement étudier le problème et le résoudre.
La guerre de 1914 ne semble pas avoir été un enseignement pour les individus et les anarchistes peu nombreux déjà avant la tuerie se sont disséminés durant le massacre. Rien d’étonnant par conséquent à ce qu’ils traversent, après la guerre, une période de crise. Du reste, cette crise n’est pas particulière à l’Anarchisme. Tous les partis politiques la subissent et se trouvent dans un état d’amoralité regrettable. Mais ce qui est concevable pour toute organisation politique ne l’est pas pour l’Anarchisme. Il est évident que l’Anarchiste subit les mêmes influences, est soumis aux mêmes variations, aux mêmes courants que les autres individus, et qu’étant Anarchiste on n’en est pas moins homme ; pourtant il nous semble que ces influences devraient produire sur l’Anarchiste des effets contraires et qu’ils devraient, dans une large mesure, bénéficier du chaos dans lequel se débattent les puissances d’autorité. Il faut donc, puisque la réalité est tout autre, découvrir le diagnostic et, ce qui est plus complexe, lui trouver un remède.
S’il nous fallait faire l’historique du mouvement anarchiste, nous nous apercevrions bien vite que « l’individualisme » fut une des causes primordiales de toutes les déviations anarchistes. Certes, au point de vue philosophique, nous sommes, anarchistes communistes, aussi individualistes que quiconque, et nous le sommes, non pas parce que nous le voulons, mais parce que l’égoïsme est à la base de toute vie individuelle et sociale et qu’il est impossible de concevoir un être qui ne serait pas animé par un sentiment d’égoïsme. Il apparaît cependant à l’analyse que tout cela n’est qu’une spéculation intellectuelle, non pas utile en soi, mais qui embrouille et compromet tout 1’avenir social.
C’est précisément parce que certains ont abandonné le domaine social, le terrain populaire, pour se cantonner sur le terrain philosophique, que l’Anarchisme a dévié, qu’il s’est divisé en sectes, en clans, en écoles et que, si cette pratique se poursuivait, il y aurait bientôt autant d’Anarchismes que d’Anarchistes. Toute idée philosophique mal interprétée est néfaste, et celles du déterminisme et de l’égoïsme ont été incomprises par quantité d’individus pénétrant notre milieu, et cette incompréhension a concouru à faire dévier l’Anarchisme de sa ligne.
Nous voyons tel bandit, tel criminel, ignorant absolument tout de nos idées, de nos conceptions, de nos aspirations et condamné pour un meurtre odieux à la peine de mort monter à l’échafaud au cri de « Vive l’Anarchie ! », et tel autre bourgeois à la Follin prétendre également être Anarchiste ; et les adversaires de l’anarchisme en profitent pour affirmer que « Anarchie » est synonyme de désordre.
Nous savons qu’étymologiquement « Anarchie » signifie « sans autorité » et qu’en conséquence nous n’avons aucun droit de contester à quiconque le droit de se réclamer de l’Anarchie ; du reste, le voudrions-nous, nous ne pouvons imposer aucune sanction à l’Anarchiste « d’opéra-comique », et pourtant la liberté n’est qu’une chose relative dans une société où tout repose sur l’autorité. Où commence-t-elle et où s’arrête-t-elle ? M. Victor Serge, ex-individualiste notoire, et à présent agent du Gouvernement bolcheviste, se prétend toujours Anarchiste, et Ernest Girault également. Si à nouveau nous nous placions sur le terrain de la philosophie pure, ils ont raison, ils ont le droit et la liberté de se dire Anarchistes, mais alors, peuvent également se déclarer Anarchistes : le policier qui nous arrête, le magistrat qui nous juge, et le bourreau qui nous exécute.
C’est, à nos yeux, sur le terrain social, et sur le terrain social seul, que nous devons considérer les possibilités Anarchistes. Les mots n’ont que la valeur qu’on veut bien leur prêter, et il n’est de critérium possible, qu’en recherchant les origines de l’Anarchisme pour en arrêter les déviations.
C’est en 1865, à la suite de certains voyages de Français à Londres, que se fonda l’Association Internationale des Travailleurs. A ses débuts, cette organisation ne poursuivait aucun but politique et s’était assigné comme travail, d’étudier toutes les questions économiques intéressant la classe ouvrière. A cette même époque, le Marxisme commençait déjà à avoir ses adeptes, principalement en Allemagne, et Karl Marx, fin politicien, envisagea les moyens propres à accaparer la nouvelle puissance ouvrière.
Avec un doigté remarquable, Karl Marx évita de se mettre en évidence dans la jeune association, et n’assista même pas aux premiers Congrès ; mais, suivant une coutume qui s’est maintenue dans les milieux socialistes et qui fut adoptée plus tard par les communistes, il usa de pratiques sournoises en faisant travailler ses lieutenants. Lui restait dans l’ombre. La première internationale fut ainsi « noyautée » par les éléments politiques du marxisme, mais une opposition sérieuse ne tarda pas à se manifester, et deux ans plus tard, en 1867, lorsque Marx eut découvert ses batteries, Bakounine opposait à l’idéal marxiste « d’une société autoritaire » un système qu’il appela le fédéralisme antiautoritaire.
Ce ne fut pourtant que bien plus tard, exactement en 1871, qu’une majorité antimarxiste s’affirma au sein de l’Internationale et ce n’est véritablement qu’en 1873, au sixième Congrès Internationa1 de Genève, que, à la suite des manœuvres de Marx, qui ne pouvait accepter de se trouver dans la minorité, la scission, devenue inévitable, divisa les forces ouvrières.
Bakounine et ses amis n’hésitèrent pas après avoir fédéré les éléments antiautoritaires de l’Association Internationale des Travailleurs, à fonder la Fédération Jurassienne, qui fut en vérité, la première organisation anarchiste.
C’est donc à cette époque que l’on doit placer la naissance du mouvement Anarchiste, en tant que mouvement autonome, détaché de toute autre organisation politique ou sociale ; car si, antérieurement, les partisans d’une société antiautoritaire, avaient travaillé en collaboration avec les autres éléments révolutionnaires, ils entendaient en quittant l’Association Internationale des Travailleurs, créer un mouvement bien défini et, en évitant toute confusion possible, se désolidariser entièrement des défenseurs du principe d’autorité.
La résolution qui fut présentée au Congrès de Berne en 1876 et qui fut acceptée par l’unanimité des délégués situe nettement les adversaires de l’autorité et signalent les buts que poursuivent les Anarchistes.
Voici cette résolution :
-
Plus de propriété, guerre au capital, aux Privilèges de toutes sortes et à l’exploitation de l’homme par l’homme ;
-
Plus de Patrie, plus de frontières ni de lutte de peuple à peuple ;
-
Plus d’Etat, guerre à toute autorité dynastique ou temporaire et au parlementarisme ;
-
La révolution sociale doit avoir pour but de créer un milieu dans lequel, désormais, l’individu ne relèvera que de lui-même, sa volonté régnant sans limite et n’étant pas entravée par celle du voisin.
C’était bien là un programme social, non pas individuel, mais collectif et, pour préciser l’esprit qui animait les Anarchistes, et rechercher sincèrement ce que fut l’Anarchisme à ses débuts, il n’y a qu’à reprendre la résolution d’Elisée Reclus, présentée au 3ème Congrès Anarchiste de Fribourg et adoptée à l’unanimité des délégués présents :
« Nous sommes révolutionnaires parce que nous voulons la justice ... Jamais un progrès ne s’est accompli par simple évolution pacifiste et il s’est toujours fait par une évolution soudaine. Si le travail de préparation se fait avec lenteur dans les esprits, la réalisation des idées se fait brusquement. Nous sommes des Anarchistes qui n’ont personne pour maîtres et ne sont les maîtres de personne ... Il n’y a de morale que dans la liberté. Mais nous sommes aussi collectivistes internationaux, car nous comprenons que la vie est impossible sans groupement social. »
Enfin, en 1880, un Congrès, tenu également en Suisse, décide d’abandonner le terme « Collectivisme » et d’adopter celui de « Communisme ».
Si l’on veut polémiquer en toute sincérité, on reconnaîtra aisément que les thèses soutenues par les « Anarchistes individualistes » sont loin, bien loin, de ces résolutions et si l’on accepte comme étant le but de l’Anarchisme et des Anarchistes de réaliser une société sans autorité, au moyen de la Révolution sociale, on constatera que bon nombre de nos amis se sont sensiblement éloignés des bases fondamentales sur lesquelles reposait l’organisation primitive des Anarchistes.
La question que nous voudrions ici éclaircir, n’est pas de savoir qui est dans la logique et dans la raison ; si ce sont nos camarades qui se réclament de l’individualisme ou ceux qui se réclament du communisme libertaire. Ces questions sont l’objet d’un examen spécial et d’une étude à part. Nous voulons rechercher, s’il y eut des déviations anarchistes et qui, idéologiquement à l’heure actuelle, peut se réclamer de l’Anarchie.
Un mouvement se crée, il établit une ligne de conduite, il se trace un chemin, il détermine son but ; ce mouvement, pour se caractériser des autres mouvements, pour se signaler de ceux qui prennent une route qui, à première vue, semble parallèle, choisit un terme, une appellation inusitée antérieurement. Au bout d’un certain temps, débordant des cadres de ce mouvement, un certain nombre d’individus, à tort ou à raison, le considérant comme n’étant pas conforme à leurs aspirations, s’en séparent et forment à côté un autre groupement, une autre association. Ils sont peut-être dans le vrai, la raison et la logique peuvent être de leur côté, mais s’ils emploient, pour signifier leur mouvement, la même terminologie que celui qu’ils viennent d’abandonner, immédiatement se manifeste une confusion, et leur mouvement n’est qu’une variation, qu’une déviation du mouvement d’origine.
C’est ce qui s’est produit pour l’Anarchisme, et sincèrement ne devraient se réclamer de l’Anarchisme que ceux qui sont restés dans les grandes lignes de la tradition.
Nous n’avons pas l’intention, nous l’avons dit, de faire l’historique de tout le mouvement anarchiste. Nous ne nous arrêterons donc pas à tous les actes d’héroïsme qui illustrèrent le mouvement Anarchiste de 1877 à 1896. En Italie, c’est Cafiero et Malatesta qui, à la tête d’une poignées d’hommes brûlent les archives de Letina et de San Gallo, prennent armes et argent et les distribuent au peuple ; en Allemagne ce sont les attentats contre Guillaume Ier ; en Espagne, en Russie, c’est l’action révolutionnaire qui reprend avec vigueur ; en France c’est la période tragique qui fait trembler la bourgeoisie ; mais c’est aussi la chasse à l’homme, la répression brutale et terrible du capital qui a peur et qui se défend. Oui, certes, on blâme « l’anarchisme » qui éveille chez l’individu une telle vigueur, on blâme l’idée qui fait jaillir une telle source d’énergie désintéressée, mais les adversaires les plus irréductibles, sont obligés de reconnaître néanmoins la sincérité des hommes qui se sacrifient pour une cause qui est juste, et si l’on qualifie de rêveurs ceux en qui a germé l’idée de rénover le monde, on se courbe tout de même devant la beauté du but, devant la grandeur de l’idéal poursuivi.
Mais hélas, toute médaille a son envers, et à côté de cette noblesse, évoluent les spéculateurs de l’idée anarchiste, qui vont se charger de la discréditer. Tous ceux dont l’égoïsme particulier n’est pas satisfait, tous ceux qui, traînant comme un boulet leurs tares physiques et morales, cherchent dans ce monde imparfait à assouvir leur soif de jouissance, vont se couvrir du manteau de l’Anarchisme pour légitimer leur méfaits.
Et l’Anarchie crédule et confiante ouvre ses portes ; elle accueille, loyalement et sans arrière-pensée, ces aventuriers qui, petit à petit, s’implantent, s’imposent, envahissent le mouvement, à la grande joie de la bourgeoisie qui les présente à la masse ignorante comme les anarchistes, les vrais.
Et cependant que, fatiguée par une intense période de lutte et de coercition, l’Anarchie se repose, cependant qu’à la violence des premières heures a succédé la période d’instruction de la classe ouvrière, qui, émotionnée par les événements, cherche à savoir, pénètrent chez nous les faux savants, les faux philosophes, colporteurs ignares de lectures qu’ils n’ont pas digérées, et dont tout l’anarchisme se réduit à considérer leur petite personne, planant au-dessus « des humains trop humains ».
Alors, c’est la discussion lassante et stérile, c’est l’œuvre ébauchée par les aînés qui se désagrège, c’est l’anarchie sectionnée, amputée qui se défend contre les attaques de l’extérieur et de l’intérieur. Toutes les tentatives d’unifier le mouvement sont vouées à un échec. On ne marie pas de l’huile et de l’eau, et les divergences qui séparent les différentes écoles creusent un fossé entre les différents éléments qui se réclament de l’anarchie. En 1900, les étudiants socialistes internationalistes de Paris lancent le cri d’alarme et, dans un manifeste, demandent aux anarchistes de s’entendre. Peine perdue, leur appel reste sans écho, et l’anarchisme continue à se perdre en discussions stériles.
En 1907, a lieu le Congrès Anarchiste d’Amsterdam où notre cher camarade Malatesta fait l’impossible pour jeter les bases d’une organisation internationale. On souscrit à sa proposition, il sort victorieux de la discussion mais hélas, les engagements pris de part et d’autre ne sont pas suivis d’effets et les espérances sont déçues. Le mouvement reste ce qu’il était : chaotique, personnel, toujours.
Et c’est la grande guerre, qui vient à son tour jeter le trouble dans le mouvement Anarchiste. Des hommes, et non des moindres, prennent parti pour la France « du droit et de la liberté ». Les Kropotkine, les Jean Grave, les Malato, les Pierrot, découvrent un Anarchisme patriotique et publient le trop fameux manifeste des seize, dont s’empare toute la bourgeoisie « alliée » comme tremplin, pour entraîner à la boucherie des millions de travailleurs. La guerre se termine et à la déviation patriotique succède la déviation syndicale. On confond anarchisme et syndicalisme et comme si cela n’était pas encore suffisant pour tuer l’Anarchisme, le Communisme autoritaire, profitant de la désorientation des Anarchistes absorbe une partie de ses éléments.
Le plus brièvement possible nous avons exposé ce que nous entendons par déviations Anarchistes. L’Anarchie souffre de ces déviations, et il faudrait, pour la relever, revenir à une plus saine compréhension de la doctrine.
Les camarades, les compagnons anarchistes, reliraient utilement et avec profit le bref discours que fit sur l’organisation, en 1907, notre ami Malatesta.
« On s’écrie avec Ibsen, que l’homme le plus puissant du monde, est celui qui est le plus seul et cela est un non-sens énorme », dit notre camarade. « L’homme « seul » est dans l’impossibilité d’accomplir la plus petite tâche utile, productive ; et si quelqu’un a besoin d’un maître au-dessus de lui, c’est bien l’homme qui vit isolé. Ce qui libère l’individu, ce qui lui permet de développer toutes ses facultés, ce n’est pas la solitude, c’est l’association. » (E. Malatesta)
Mais pour s’associer faut-il encore avoir, dans ses grandes lignes un programme commun. « Les mots divisent et l’action unit », il serait donc utile pour mettre fin au flottement dont souffre l’anarchisme depuis tant d’années de mettre fin à la discussion stérile.
Un certain nombre de camarades anarchistes communistes ont compris le danger et, en 1926, au Congrès d’Orléans, ils ont tenté de remettre sur pied un programme, susceptible, non seulement de rencontrer la sympathie de presque tous les anarchistes révolutionnaires, mais aussi d’intéresser le peuple. Espérons que leurs travaux ne seront pas vains et que l’avenir leur apportera une récolte abondante.
Jetons un coup d’œil dans le passé, et profitons des erreurs de ceux qui nous ont précédé pour ne pas commettre les mêmes. Nous avons accompli un formidable travail de destruction. Rien n’a résisté à la critique et à la logique des Anarchistes ; toutes les branches, tous les rouages des sociétés autoritaires ont été idéologiquement détruits ; le militarisme, le nationalisme, le patriotisme, le capital et la bourgeoisie, toute l’autorité en un mot, a vu ses principes s’écrouler sur les coups répétés de l’Anarchie. Il nous faut construire à présent. Evitons donc de nouvelles déviations. Regardons autour de nous, et constatons la faiblesse des autres organisations malgré la force numérique de leurs membres. Le syndicalisme s’est piteusement écroulé, parce qu’il n’a pas su rester dans la ligne droite qu’il s’était tracée ; il est déchiré maintenant par les divers partis politiques qui se disputent sa direction, comprenant que le syndicalisme représente un intérêt tout particulier sur 1e terrain électoral.
Le socialisme, qui n’a pas su rester dans la tradition, qui s’est corrompu dans un parlementarisme étroit, qui s’est discrédité en abandonnant toute idée révolutionnaire, est menacé de ruine, et ne conservera pas longtemps l’autorité dont il dispose encore auprès des masses populaires ; quant au communisme, il se perdra bientôt dans le démocratisme bourgeois.
Il y a une place à prendre dans le mouvement social et cette place revient à l’Anarchisme. Remontons le courant, revenons à l’origine et, en évitant toutes déviations dans le futur, l’anarchie, comprise et aimée, en sortira régénérée et grandie.
- J. C.
DEVISE
n. f.
La devise est une courte sentence qui exprime d’une façon vive et saillante une pensée ou un sentiment. Pour celui qui l’adopte ou qui la compose, elle signale un but ou une résolution.
La devise est souvent précédée d’une figure emblématique. Cette figure est le corps de la devise ; la sentence en est l’âme.
La devise est une invention de la chevalerie ; et à une certaine époque, tracée sur les armures, elle servait de marque distinctive aux chevaliers. C’est ce qui explique que chaque membre de la haute noblesse avait une devise particulière.
Il est des devises qui sont historiques et qui resteront comme une image reflétant l’esprit, le caractère, d’une époque ou d’un individu.
La devise de Louis XI représentait un fagot d’épines, et était suivie de cette sentence :
« Qui s’y frotte s’y pique. »
Dans ces quelques mots apparaît tout le caractère de ce roi cruel et méchant. La devise de Louis XIV est pleine de prétentions ; elle est représentée par un soleil :
Nec pluribus impar (« Je suffirais à plusieurs mondes »)
Et les Rohan, qui se font une gloire, de nos jours encore, d’être la plus vieille famille de noblesse française :
« Roi ne puis ; prince ne daigne ; Rohan suis. »
Aujourd’hui, l’individu ne compose plus de devises, mais les institutions ont chacune la leur. Personne n’ignore quelle valeur on peut leur accorder. La devise de la République française est :
« Liberté-Egalité-Fraternité »
À laquelle on peut ajouter celle du drapeau :
« Honneur et Patrie. »
Les hommes se sont fait tuer et peut-être se feront-ils tuer encore pour des mots. Ce qui ne peut faire l’ombre d’un doute, c’est que la République a manqué à sa devise. De liberté, nous n’en avons pas plus que sous les régimes qui ont précédé le nôtre ; la fraternité se manifeste par une lutte constante où les plus faibles sont écrasés sous la botte du plus fort, et l’égalité n’existe que sur le papier.
Personne ne peut être adversaire de la devise républicaine : chacun aspire à la liberté, à la fraternité et à l’égalité entre tous les hommes ; mais il ne suffit pas d’adopter une devise, il faut la respecter, il faut travail1er pour qu’elle ne reste pas une idée abstraite, pour qu’elle se réalise, se matérialise.
Les Anarchistes ont compris que la devise républicaine était incomplète et ne reflétait pas suffisamment leur soif de libération universelle, et que la liberté, l’égalité et la fraternité ne pouvaient voir le jour que lorsque les bases économiques des sociétés auront été transformées. C’est pourquoi leur devise est :
« A chacun selon ses forces, et à chacun selon ses besoins. »
DEVOIR
verbe (du latin debere ; autrefois on écrivait debvoir)
Avoir des dettes ; il me doit cent francs et je me dois de les lui réclamer ! Etre obligé à quelque chose ; je dois rendre visite à cette personne ; nous devons des égards à toute personne sincère et respectable ; les jeunes gens doivent s’instruire et s’éduquer s’ils veulent se rendre utiles dans la vie ! Proverbe :
« Fais ce que tu dois, advienne que pourras. Va où tu peux, meurs où tu dois. »
Accompagné d’un autre verbe, devoir présente différents sens. Intention, projet : je dois aller demain faire ce travail. Probabilité : Le capitalisme doit disparaître, si les hommes veulent vivre fraternellement. Certitude : Quoi que l’on puise faire, chaque être humain doit mourir !
S’emploie substantivement à la troisième personne de l’indicatif en comptabilité : tenir ses comptes par doit et avoir!! !
Etre obligé envers soi-même :
« Si je dois tant d’égards à tout ce qui m’environne, ne m’en dois-je point aussi quelques-uns à moi-même ? » (J.-J. Rousseau)
DEVOIR
n. m.
« Ce à quoi l’on est obligé »
Telle est la définition que le Larousse nous donne du devoir. En termes clairs, cela veut dire que le devoir est une contrainte.
S’il est vrai que le devoir est la limite du droit, que c’est le respect du droit d’autrui, il faudrait donc pour bien définir le devoir, déterminer ce qu’est le droit. Or, à nos yeux il n’y a qu’un droit, un droit inné : c’est celui de vivre ; et il en découle que tous ceux qui s’opposent à la vie de l’individu, que tous ceux qui empiètent sur le patrimoine moral, intellectuel, économique et social de son semblable, nuisent ou s’opposent à son évolution et à son épanouissement manquent à leurs devoirs.
Le « devoir », au sens bourgeois du mot, ne se présente pas sous cet aspect, et c’est pourquoi, nous le considérons comme une abstraction qui divise l’humanité en deux parties, la première étant composée des dupes courbés sous le joug des fripons qui composent la seconde. Il est de fait que les fripons, par la naïveté et la bêtise humaines, sont les plus forts, et ce sont eux qui, depuis les temps les plus reculés, perpétuent la servitude des esclaves, des pauvres et des opprimés. Ce sont eux qui créent, qui inventent des devoirs auxquels sont astreints des millions d’individus. Obéir à la loi est un devoir. Mourir pour la patrie est un autre devoir, et ce qu’il y a de terrifiant, c’est qu’à travers les âges il s’est toujours trouvé des savants et des poètes pour chanter le devoir.
En un mot, devoir est synonyme d’obéir ; et, comme obéir suppose un maître, le devoir tel que le conçoivent les moralistes n’est pas un facteur d’évolution et de liberté, mais bel et bien un facteur d’asservissement et de recul.
Le devoir de l’écolier est d’écouter son maître, son professeur, qui sait tout, qui dit tout et qui ne se trompe jamais. Je connais un enfant à qui l’on donna un jour, dans une école supérieure, comme sujet de composition :
« Vous vous arrêtez devant un magasin et en voyant la diversité des marchandises, vous pensez à l’utilité du commerce et au bien-être qu’il procure à l’humanité. Exprimez vos sensations et vos pensées. »
L’enfant vint me trouver pour l’aider dans son travail, et je restai embarrassé. Que pouvais-je lui dire, sinon une chose qui lui eût valu une sévère réprimande de son professeur ? J’évoquai en moi-même tous les méfaits du commerce, tout le mal qu’il fait, toutes les bassesses de ceux qui s’y livrent, tous les crimes monstrueux dont il fut la cause, et toutes les guerres qu’il engendre encore en notre siècle de soi-disant civilisation. Je pensai que si, selon Raynal, le devoir « peut être défini, l’obligation rigoureuse de faire ce qui convient à la Société », alors 1e commerce était contraire à tous les devoirs puisqu’il était une source de richesse et d’opulence pour les uns et de souffrances et de misères pour les autres.
Le petit écolier n’a pas fait, en ce sens, sa composition. Moi aussi j’ai manqué à mon « devoir ». Je n’ai pas eu le courage de l’exposer aux foudres de son maître et aux risées de ses petits camarades qui ont du devoir une conception commune, générale et qui n’en n’auraient pas comprise une autre. Il est bon de se souvenir et de se répéter cette pensée profonde de Guyau :
« Si un tigre croyait, en sauvant la vie d’un de ses semblables, travailler à l’avènement du bien universel, il se tromperait peut-être. »
Comme le tigre du philosophe, le maître d’école s’imagine peut-être travailler pour le bien-être de l’humanité en enseignant aux enfants une erreur qui est la base de tout le vice social et qui entrave la marche en avant de la civilisation. Il croit remplir son « devoir », et il le remplit en vérité, mais, hélas ! Ce n’est qu’un lent travail de corruption intellectuelle, qui consiste à préparer la jeunesse à l’accomplissement d’un nombre incalculable de « devoirs » qui leur feront oublier leur droit le plus élémentaire : le droit à la vie.
« L’amour n’est qu’un plaisir, l’honneur est un devoir », a dit Corneille, et l’honneur militaire est l’un des plus sacrés. Mourir sur un champ de bataille c’est mourir sur un champ d’honneur, et le devoir de l’homme est de se faire tuer lorsque la « Patrie » est en danger. La Patrie ? Le Devoir ? Deux abstractions qui se confondent, qui se soutiennent, qui sont les piliers sur lesquels repose tout l’organisme social et qui sont aussi malfaisantes l’une que l’autre.
Comment peut-il se trouver des êtres assez naïfs, assez aveugles, pour croire au « devoir » militaire ? Car, enfin, que les riches, que les puissants, que les heureux de ce monde défendent, fût-ce au prix de leur vie, les privilèges malhonnêtement acquis par eux ou par leurs ancêtres, rien de plus normal ; mais que de pauvres bougres soient assez inconscients assez déraisonnables, assez dépourvus de la plus petite parcelle de logique pour considérer comme un « devoir » de servir pour soutenir une Patrie où ils n’ont aucun droit, au sein de laquelle ils sont les éternels volés, cela dépasse toute compréhension. Et cependant on peut dire que la grande majorité des hommes sont imprégnés de ce préjugé du devoir militaire. Le peuple ne comprend pas que le devoir militaire, n’est en réalité que le « droit de mort sur les peuples » ; droit que détiennent les oppresseurs et dont ils usent chaque fois que leurs intérêts sont menacés.
Si le militarisme est une plaie sociale, s’il n’est pas indispensable à la vie des sociétés, si au contraire il est nuisible à l’existence harmonique des hommes, comment peut-on être assez stupide pour considérer comme moral le devoir militaire.
Le devoir militaire « c’est la guerre!... se battre !... égorger!... massacrer des hommes… ».
Les hommes de guerre sont les fléaux du monde. Nous luttons contre la nature, l’ignorance, contre les obstacles de toute sorte, pour rendre moins dure notre misérable vie. Des hommes, des bienfaiteurs, des savants, usent leur existence à travailler à ce qui peut aider, à ce qui peut secourir, à ce qui peut soulager leurs frères. Ils vont, acharnés à leur besogne utile, entassant les découvertes, agrandissant l’esprit humain, élargissant la science, donnant chaque jour à l’intelligence une somme de savoir nouveau, donnant chaque jour à la patrie du bien-être, de l’aisance, de la force.
La guerre arrive. En six mois, les généraux ont détruit vingt ans d’efforts, de patience et de génie ...
Qu’ont-ils fait pour prouver même un peu d’intelligence, les hommes de guerre ? Rien. Qu’ont-ils inventé ? Des canons et des fusils. Voilà tout.
L’inventeur de la brouette n’a-t-il pas plus fait pour l’homme par cette simple et pratique idée d’ajuster une roue à deux bâtons que l’inventeur des fortifications modernes ?
Que nous reste-t-il de la Grèce ? Des livres, des marbres. Est-elle grande parce qu’elle a vaincu ou parce qu’elle a produit ?
Est-ce l’invasion des Perses qui l’a empêchée de tomber dans le plus hideux matérialisme ?
Sont-ce les invasions des barbares qui ont sauvé Rome et l’ont régénérée ?
Est-ce que Napoléon 1er a continué le grand mouvement intellectuel commencé par les philosophes à la fin du siècle dernier ?
Eh bien, oui, puisque les gouvernants prennent ainsi le droit de mort sur les peuples, il n’y a rien d’étonnant à ce que les peuples prennent parfois le droit de mort sur les gouvernants.
« Ils se défendent, ils ont raison. » (Guy de Maupassant)
« Ils se défendent, ils ont raison. » Ne serait-ce pas là le vrai devoir des peuples, si toutefois les peuples ont des devoirs, au lieu de se déchirer entre eux pour des causes qu’ils ignorent et qu’ils ignoreront toujours ? Hélas ! Les sages paroles de Maupassant et de tant d’autres ne sont pas entendues et l’on écoute plutôt d’une oreille attentive cette stupidité :
C’est le plus beau, le plus digne d’envie. »
Tout devoir légal est une absurdité, une contrainte, qui abaisse, avilit l’individu, et Stirner a raison lorsque, s’adressant aux hommes, il leur dit :
« Vous répétez mécaniquement la question qu’on vous a soufflée : « A quoi suis-je appelé ? Quel est mon devoir ? » et il suffit que vous vous posiez la question, pour qu’aussitôt la réponse s’impose à vous : vous vous ordonnez ce que vous devez faire, vous vous tracez une vocation où vous vous donnez les ordres et vous vous imposez la vocation que l’Esprit a d’avance prescrit. Par rapport à la volonté, cela peut s’énoncer ainsi : « Je veux ce que je dois ». » (Max Stirner, « L’Unique et sa Propriété »)
L’homme s’est tracé des devoirs ou plutôt on les lui a tracés et il les accomplit, le plus souvent sans protester, par crainte, par paresse ou par lâcheté. Il est imprégné d’une conception incohérente du bien et du mal et il ne s’est jamais étonné que, ce qu’il appelle le bien est justement ce qui est favorable aux riches et aux puissants, et que ce qu’il appelle le mal est ce qui peut leur être nuisible. Le devoir, pour l’homme du peuple, c’est le respect des lois, aussi instables soient-elles, c’est l’attachement à un régime qu’on lui impose, aussi arbitraire soit-il ; le devoir c’est la justice, c’est la propriété, c’est le respect de la hiérarchie, enfin c’est tout ce qui l’empêche d’être libre, et qu’il croit cependant être obligé de subir. Le fait même que le devoir est sanctionné par la justice, cette justice qui depuis des siècles s’est livrée à tous les abus imaginables, devrait ouvrir les yeux aux plus aveugles ; mais non : le peuple ne veut pas voir.
Voici des siècles et des siècles qu’il peine et qu’il souffre, voici des années et des années qu’on lui répète « qu’un homme n’est appelé » à rien ; qu’il n’a pas plus de « devoir » et de « vocation » que n’en ont une plante et un animal.
« La fleur qui s’épanouit n’obéit pas à une « vocation » mais elle s’efforce de jouir du monde et de le consommer tant qu’elle peut, c’est-à-dire qu’elle puise autant de sucs de la terre, autant d’air de l’éther, et autant de lumière du soleil qu’elle en peut absorber et contenir. » (M. Stirner)
Malgré tout cela, le peuple reste dans son ignorance, et se maintient comme à plaisir dans la passivité et dans l’erreur.
Pour le conduire dans la vie, l’animal a l’instinct ; l’homme a l’intelligence. On prétend que la supériorité de l’homme sur la bête est la conséquence de cette intelligence qui lui permet de s’élever, de quitter le terrain purement matériel pour atteindre le sommet des joies et des plaisirs intellectuels. Si l’existence de l’homme du peuple ne doit être faite que du manger, du boire et du dormir, alors celle de l’animal lui est préférable. Autant que nous pouvons en juger, la bête n’a pas la conception du grand et du beau ; ses goûts sont primitifs, purement matériels, et elle ne souffre pas des mille choses qui frappent chaque jour notre sensibilité. Pourtant l’animal ne s’embarrasse pas de « devoirs ».
L’instinct de conservation porte tout individu à vivre, et si l’on met en face d’un chien affamé un appétissant rôti, méconnaissant les « droits » de la propriété, il s’élancera sur l’objet de sa convoitise. En cette circonstance, l’instinct du chien, l’aura poussé à un acte beaucoup plus raisonnable et plus logique que ne l’eût fait l’intelligence humaine. Une multitude d’humains croupissent dans des taudis, alors qu’il existe des palais ; une multitude de pauvres bougres crèvent littéralement de faim, alors que la terre regorge de vivres, parce que le « devoir » interdit à l’individu « intelligent » de se nourrir, de se vêtir et de se loger, sans en avoir auparavant obtenu l’autorisation de ceux qui se sont déclarés les maîtres du monde.
Ce sont tous les « devoirs » accumulés depuis des siècles d’asservissement et d’esclavage qui entravent l’évolution de l’humanité ; ce sont eux qui maintiennent les peuples dans un état d’infériorité économique et morale ; ce sont eux qui perpétuent un état de choses néfaste, à tous les points de vue, au bien-être des collectivités.
« Remplir ses devoirs » ; « manquer à ses devoirs » sont des formules que l’on prononce à tout bout de champ et en toute occasion, mais jamais ces devoirs ne sont compensés par des droits. Or, où il n’y a pas de « droits » il ne peut y avoir de « devoirs ». Nous l’avons dit plus haut, l’homme, quelle que soit la condition dans laquelle il se trouve, a un droit inné : le droit à la vie, il n’a donc qu’un « devoir » c’est celui de faire cette vie pleine de jouissance, de beauté et d’harmonie.
Il n’est pas de devoir social proprement dit. Le devoir social, collectif, disparaît devant la liberté individuelle, et la liberté n’est pas ainsi que l’affirment les adversaires de l’évolutionnisme un facteur de désordre. L’autorité, la contrainte, le « devoir », là sont les sources de tous les maux et il suffit de regarder un peu le chaos dans lequel nous nous débattons pour être fixés sur les bienfaits de la morale moderne.
Vivre et se respecter soi-même, c’est respecter autrui. Aimer la liberté pour soi, c’est l’aimer pour les autres. Refuser d’obéir et refuser de commander, c’est tout le secret du bonheur ; c’est l’unique route qui peut conduire l’homme à un peu plus de bien-être ; c’est l’unique moyen qui peut mettre fin à la tyrannie et au despotisme.
Que les opprimés se lèvent, qu’ils brisent les tables de la loi, qu’ils effacent tous les devoirs qui, depuis toujours, les maintiennent dans une sinistre infériorité et ils auront conquis ce « droit à la vie » pour lequel ils luttent depuis si longtemps.
DEVOTION
n. f. (du latin devotio)
Dévouement à Dieu ; attachement aux pratiques religieuses.
La dévotion a pour objet l’observation des lois prescrites par les théologiens des diverses religions, qui au cours des âges, exposèrent, expliquèrent et vulgarisèrent les dogmes définis par une autorité soi-disant infaillible.
Si la dévotion n’était que ridicule et inutile, il n’y aurait qu’à laisser les fanatiques se livrer à leurs pratiques et à leurs simagrées sans plus s’inquiéter d’eux : mais elle est un danger social et est nuisible à l’individu, comme du reste tout ce qui se rattache à l’idée de Dieu. Elle est non seulement néfaste à l’individu en soi, mais elle déteint sur tout ce qui l’entoure, et exerce une détestable influence sur toute la collectivité, qui souffre en conséquence des agissements déraisonnables des croyants.
Il est possible qu’en des temps reculés, certains actes de dévotion aient été édictés par des conducteurs d’hommes ou des savants de l’époque, en raison de la brutalité, de l’ignorance et de la bestialité des peuples ou des tribus, et on s’explique aisément aujourd’hui, pourquoi la loi judaïque par exemple exigeait des fidèles qu’ils se lavassent les mains deux fois par jour, c’est-à-dire avant de faire les prières précédant les repas, ou que, une fois l’an, à la veille de Pâques, ils nettoyassent leurs maisons du fond aux combles afin qu’il ne puisse y rester une miette de pain égarée.
La loi judaïque prescrivait de même que la femme devait au moins une fois par mois, après ses menstrues se rendre au bain, et que tous les fidèles âgés d’au moins treize ans devaient, une fois par an, jeûner durant 24 heures, et il nous apparaît que ces dévotions avaient un caractère d’hygiène et étaient inspirées dans un but pratique. Mais il semble que, de nos jours, et plus particulièrement dans nos pays occidentaux, il ne soit pas nécessaire d’obliger par une loi, les individus à se laver et à nettoyer leur maison, ou de leur apprendre qu’ils doivent de temps à autre reposer, par une certaine abstinence, les organes intérieurs de leurs corps, de même qu’ils délassent leurs bras ou leurs jambes fatigués par un travail trop rude.
Il est donc évident que si, à l’origine, les dévotions ont présenté certaine utilité, depuis longtemps elles ont été dénaturées par la religion et ne présentent plus aujourd’hui aucun sens pratique. Le dévot n’a à présent d’autre but que celui de plaire à Dieu, et d’attirer sur lui les bienfaits du Très-Haut.
Nous disons plus haut que la dévotion est néfaste à la collectivité, et il n’est pas besoin de remonter très loin dans l’histoire pour y retrouver les crimes commis par les dévots. Les autodafés, c’est-à-dire l’exécution des jugements prononcés contre les savants et les philosophes, considérés comme hérétiques par l’Inquisition, étaient considérés comme des actes de dévotion. Le massacre de la Saint-Barthélemy qui eut lieu à Paris et dans toute la France dans la nuit du 24 au 25 août 1572, d’après les ordres du roi Charles IX, fut un acte de dévotion. Plus de 200.000 personnes périrent, au nom de la religion et de Dieu, en cette nuit tragique, et le Pape Grégoire XIII eut le cynisme, en apprenant le massacre, de faire tirer le canon du château Saint-Ange en signe de réjouissance, et d’envoyer au roi meurtrier un message de reconnaissance, le félicitant pour l’acte de dévotion qu’il venait d’accomplir.
Et plus près de nous, il y a quelques années à peine, lorsque la Russie était courbée sous le joug du tsarisme, et chaque fois que, pour des raisons politiques, il fallait occuper l’esprit populaire, l’église ne se prêtait-elle pas bénévolement à l’organisation des pogroms et, sous l’obscure conduite de la prêtraille, de malheureux inconscients ne croyaient-ils pas accomplir un acte de piété et s’attirer la reconnaissance du Ciel, en persécutant de pauvres juifs qu’on leur jetait en pâture ?
Et en France, pays de l’irréligion, nous assistons encore, de temps à autre, au triste spectacle de malades, se livrant sur leurs semblables à des actes de cruauté, croyant ceux-ci possédés par le diable ? N’est-ce pas en 1926 qu’une poignée de déments s’emparèrent d’un prêtre et exercèrent sur lui des violences, pour faire sortir de son corps le démon dont il était possédé ?
Les dévotions, sont donc manifestement pratiquées par des êtres corrompus intellectuellement, et maintiennent l’individu dans un perpétuel état d’asservissement. C’est du reste bien le rôle dévolu à la dévotion par la religion.
Dans Orpheüs, le beau livre de Salomon Reinach, sur l’histoire des religions, on fera une ample moisson des erreurs accumulées par des siècles de dévotion, et on est étonné à la lecture de cet ouvrage, si simple, si clair et si profond, à la portée de toutes les intelligences et qui devrait se trouver dans toutes les familles, qu’il y ait encore des gens assez dépourvus de bon sens, pour se livrer aux hommes d’églises, à quelque religion qu’ils appartiennent.
Ce qui est particulièrement regrettable, c’est que l’homme du peuple, le paria, l’opprimé, ne soit pas, non plus, débarrassé du préjugé religieux, et qu’il se livre également à des actes de dévotion. Il est peu d’individus, même dans la classe ouvrière, qui se « marient » sans passer devant Monsieur le Curé ; ils sont peu nombreux ceux qui ne font pas baptiser leurs enfants, ou qui n’envoient pas ceux-ci au catéchisme afin de faire leur première communion. « C’est sans importance » dit-on ; et c’est une profonde erreur.
Ce sont toutes ces pratiques qui donnent encore à l’église une certaine puissance et c’est du reste la raison pour laquelle les prêtres s’attachent à attirer vers eux les petits et à leur imprimer le caractère de la dévotion.
En apprenant à servir Dieu, on se prépare à servir ses maîtres sans protester, et on forge les chaînes qui maintiennent l’humanité en un demi-esclavage. Il est faux, que la dévotion soit une innocente folie ; c’est une folie dangereuse, contre laquelle il faut lutter, pour débarrasser la civilisation d’une plaie, d’une maladie qui a fait déjà de trop nombreuses victimes.
La dévotion est tellement imprégnée en l’individu, qu’elle se manifeste même en dehors des églises spirituelles, et l’on rencontre des dévots, qui croient être libérés de tous préjugés religieux et qui cependant remplissent certains devoirs ridicules, qui leur sont conseillés par les théologiens des nouveaux dogmes et des cultes modernes. Ce sont les patriotes, les nationalistes, et aussi les travailleurs qui ont découvert un nouveau Dieu et qui ne manquent jamais de lui faire leurs dévotions. Ignorance et hypocrisie, c’est la seule définition que l’on puisse donner de la dévotion ; d’une façon comme d’une autre il faut la combattre. « Un dévot est celui, qui, sous un roi athée, serait athée ». (La Bruyère). Et, en effet, le dévot est d’ordinaire un être plat, bas, mesquin, petit, qui cache ses passions, ses vices et ses tares, sous un voile de piété.
« Ne vous fiez pas, nous dit Balzac, à la sainte humilité ni au mauvais habillement de ce prêtre directeur de conscience, qui semble se préparer toujours à la mort ; car au dedans il est tout vêtu de pourpre, il a l’ambition de quatre rois ; il a des desseins pour un autre siècle. Mais surtout défiez-vous de ces ouvriers d’iniquité, de ces hommes puissants en malice, qui lèvent au ciel des mains impures, et s’approchent des mystères, étant tout sanglants de leurs parricides. Ils sont cruels ; ils sont monstrueux ; ils sont sacrilèges et ne laissent pas d’être dévots. Leur dévotion corrige leurs gestes et reforme leurs cheveux, mais elle ne touche point à leurs passions ni à leurs vices. Ils ne gagnent rien à la fréquentation des choses saintes, que le mépris qui naît de la familiarité et de la coutume de les violer. Ils en deviennent plus hardis, méchants, et non pas plus gens de bien ; ils perdent le scrupule et ne perdent pas le mal. Tellement qu’il est à croire qu’ils ne vont pas tant à l’église pour obtenir le pardon de leurs fautes, que pour demander permission de les faire et avoir autorité de pêcher. » (Balzac, le Prince.)
Elle serait longue à décrire la liste des dévots notoires qui se signalèrent à l’histoire, par leur méchanceté, leur tyrannie et leur despotisme. Louis XI fut un dévot cruel, Charles IX a à son actif la Saint-Barthélemy, Richelieu, le cardinal rouge, ensanglanta la France et son nom est taché de tous les assassinats qu’il organisa ; Louis XIV, le roi Soleil, fut un dévot ambitieux et hautain, et ses maîtresses, ne furent pas moins abjectes qu’il ne le fut lui-même. Madame de Montespan, après avoir supplanté la La Vallière, et eu du grand roi huit enfants, après avoir trempé dans l’affaire des poisons qui défraya la chronique parisienne de 1670 à 1680, fut à son tour sacrifiée à la Maintenon, et versa dans la dévotion la plus basse, comme si la piété pouvait laver toutes les ignominies dont-elle s’était rendue coupable.
La Maintenon ne fut pas une dévote moins ambitieuse que celle à qui elle succéda. Tour à tour protestante et catholique, elle abandonna, définitivement le protestantisme, son intérêt étant intimement lié à sa ferveur. Après avoir épousé le poète Scarron, elle devint bientôt veuve, mais l’esprit de son mari lui avait été de quelque utilité, et cette femme dévote n’hésita pas à accepter d’élever les enfants adultérins de Louis XIV. C’est probablement toujours en vertu de la morale, qu’elle se livra à Louis XIV et supplanta Mme de Montespan, qui avait été sa bienfaitrice. On peut dire que Mme de Maintenon a une grande part de responsabilité dans les désastres et les infamies qui signalèrent la fin du règne de Louis XIV.
La liste pourrait s’allonger indéfiniment, mais à quoi bon ; qu’il nous suffise de conclure par ces sages paroles de La Bruyère : « Faire servir la piété à son ambition, aller à son salut par le chemin de la fortune et des dignités, c’est, du moins jusqu’à ce jour, le plus bel effort de la dévotion du temps ».
Cela n’a pas changé, et cela ne changera pas ; car c’est en cela que consiste la dévotion, et si elle n’est pas la conséquence de l’intérêt, elle est celle de la bêtise.
DEVOUEMENT
n. m.
Action de se dévouer, de se donner à une chose, à une idée, à une personne qui nous est chère et pour laquelle on abandonne ses intérêts particuliers, et parfois sa vie.
On cite assez fréquemment comme un exemple de courage et de dévouement, Léonidas, roi de Sparte, qui, avec 300 de ses compagnons, se firent massacrer aux Thermopyles, plutôt que de se rendre à la puissante armée des Perses, conduite par Xerxès.
Le dévouement des premiers Chrétiens est également légendaire, et l’on connaît tous les supplices qu’ils subirent, sans jamais vouloir renoncer à la croyance à laquelle ils étaient attachés. Il est pénible de constater que tous ces sacrifices, tous ces dévouements n’ont servi qu’à faire du Christianisme une agence politique au service des puissants, et que cette abnégation de soi fut à peu près inutile.
Il n’y a pas que l’enthousiasme, la raison, ou la logique qui soient des facteurs de dévouement : la sentimentalité et le fanatisme engendrent également le dévouement, et s’il est des êtres qui se dévouent pour une idée ou pour une cause qui est juste, il en est d’autres qui se dévouent pour une erreur. Il en résulte que des actes d’héroïsme sont accomplis par des individus et que ces actes ont des répercussions désastreuses sur l’ensemble de la collectivité.
La guerre, par exemple, est un champ d’action propice au dévouement, et il est certainement — car le courage n’est pas un privilège révolutionnaire — des patriotes qui sont prêts à donner leur vie pour « la défense de leur patrie ». Il est bien entendu qu’il ne peut être question ici des patriotes intéressés, des politiciens et des commerçants du patriotisme ; mais des patriotes sincères — il y en a hélas ! — qui n’hésitent pas à se dévouer à leur mauvaise cause. Il en est de même du reste de toutes les causes. La vérité est « une » et l’erreur est nombreuse. Or, chacun défend une conception différente et particulière, et par conséquent il est de toute évidence qu’il est des dévouements inutiles, voire nuisibles.
Quoi qu’il en soit, raisonnable ou aveugle, une cause ne grandit que par le dévouement de ceux qui y sont attachés. C’est le dévouement des premiers chrétiens qui a permis au Christianisme de s’étendre, de pénétrer partout et de gagner le monde. Si le Christianisme n’est plus aujourd’hui qu’un odieux commerce, qu’un ignoble négoce, cela tient justement à ce que le dévouement de ses adeptes ne reposait pas sur la raison mais sur le fanatisme.
Nous avons de nos jours, un autre exemple frappant du dévouement fanatique. Le Bolchevisme, qui est une religion, offrant de nombreux points de communauté avec le jésuitisme catholique, a de nombreux adeptes, et fait naître en eux un esprit de dévouement. Il n’est pas suffisant, pour combattre le bolchevisme, de déclarer que les hommes qui président à ses destinées sont corrompus par l’exercice du pouvoir, et qu’ils ne sont plus des révolutionnaires sincères. De même que le Christianisme, le bolchevisme pénètre partout parce qu’il inspire une certaine séduction et fait naître un certain esprit de sacrifice. Or, les êtres simples sont facilement influençables et se laissent subjuguer par les actes de courage d’autrui. Le commun ne comprend pas que l’on puisse mourir en se trompant, et leur sympathie est toujours orientée, par sentimentalisme, vers ceux qui souffrent pour une cause, cette cause fût-elle la plus arbitraire, la plus illogique et la plus tyrannique. Il est évident que l’homme qui se sacrifie à ses idées, quelles qu’elles soient, est un homme sincère, et par conséquent respectable et, si l’on ne peut qu’admirer son courage et son abnégation, il faut cependant se garder de s’arrêter à l’acte sans en étudier les causes déterminantes, et les idées qui ont inspiré cet acte.
C’est justement la profonde erreur du peuple de n’étudier les problèmes que superficiellement, et de s’attacher aux individus et non aux principes qui les guident et c’est pourquoi le dévouement fanatique est un facteur de propagande et de recrutement pour les partis en faveur desquels il s’exerce.
Chaque parti, chaque organisation sociale eut à son service des hommes dévoués ; chaque cause a donné naissance à des martyrs. On trouvera dans cette encyclopédie au mot « Attentat », page 184, une liste éloquente des hommes qui se sacrifièrent pour leurs idées, mais tous les hommes dévoués ne sont pas des martyrs ou des héros, et l’on peut servir une cause sans toutefois avoir le tempérament, le courage, la volonté, l’énergie de se livrer à des actes de violence, individuels, contre les institutions ou les individus que l’on combat.
Pourtant il faut s’imprégner de cette idée que si l’on est sincèrement révolutionnaire il faut s’attendre à ce que le dévouement à la cause que l’on défend soit appelé à nous conduire au sacrifice de la vie, car il est impossible de concevoir qu’une révolution puisse être un mouvement pacifiste et qu’une transformation sociale puisse s’effectuer sans effusion de sang.
Il faut donc espérer que lorsque les événements nous conduiront à la lutte et que l’heure sonnera pour tous ceux qui aspirent à un monde meilleur, les dévouements seront nombreux, et que grâce à leur volonté de vaincre et de se libérer à tout jamais de l’oppression et de l’esclavage, les opprimés sortiront victorieux de la bataille qu’ils se doivent de livrer aux exploiteurs et aux tyrans.
DEXTERITE
n. f.
Adresse, habileté à se servir de ses mains. Le jongleur et le prestidigitateur travaillent avec dextérité. Dans les travaux manuels, la dextérité est un appoint précieux, car l’ouvrier qui se sert habilement de ses mains produit parfois de véritables chefs-d’œuvre.
On peut citer comme exemple de dextérité, les travaux exécutés par les dentellières de Valenciennes, du Puy, de Tulle, de Bruges, d’Irlande, etc…, admirables œuvres d’art qui, la plupart du temps ne sont accomplies que par des paysannes maniant l’aiguille ou le crochet, tout en gardant leurs troupeaux. Ce sont de réelles artistes, les dentellières, et pourtant leurs travaux qui se payent des prix exorbitants dans les magasins luxueux des grandes villes, et qui viennent agrémenter les costumes féminins des aristocrates ou les appartements des gens fortunés ne permettent pas à ces malheureuses de vivre. Elles sont honteusement exploitées et leur sort n’est pas plus enviable que celui de tous les travailleurs. Lorsque vieilles et tremblantes, presque aveugles, elles ont usé leurs yeux pour le plaisir des riches, elles sont acculées à la misère, et les chefs-d’œuvre qu’elles exécutèrent durant leur jeunesse ne leur assurent pas le pain pour les vieux jours.
Un jour, peut-être, la dextérité du travailleur lui sera-t-elle utile et comprendra-t-il que si ses mains produisent de belles choses, la justice la plus élémentaire serait qu’il en profitât aussi.
Au figuré, la dextérité signifie habileté de l’esprit, la faculté de manier des affaires délicates ; elle est utile dans toutes les conditions autant que la dextérité des mains.
« Il avait autant d’audace pour exécuter un projet, que de dextérité pour le conduire. » (Voltaire)
DIABOLIQUE
adj.
Qui vient du diable. Des pensées diaboliques, des sensations diaboliques. Se dit pour ce qui est méchant, pernicieux, nuisible, dangereux et qui peut causer du mal. Un caractère diabolique. Un être diabolique est un individu qui cache ses véritables sentiments et qui se présente sous le masque de l’hypocrisie.
Le mot diabolique s’emploie également comme synonyme de pénible, difficile. Un travail diabolique, est un ouvrage qu’il est pénible d’exécuter. Les travaux diaboliques sont nombreux et au premier plan il faut placer celui du mineur qui est obligé d’arracher à la terre la houille qui nous chauffe l’hiver. Le progrès de la science fera disparaître petit à petit les travaux diaboliques, et déjà de nos jours, si les sociétés étaient mieux organisées, et si des intérêts particuliers n’étaient pas en jeu, la houille blanche remplacerait avantageusement la houille noire, sans exposer le travailleur aux coups du grisou ou aux menaces d’éboulements et d’inondations souterraines.
Le capitalisme a vendu son âme au diable, mais la richesse qu’il a reçue en échange n’est que provisoire. Le chemin diabolique tire à sa fin, le capitalisme est en haut de la côte, et bientôt sa chute va se précipiter. Avec lui disparaîtront tous les méfaits, toutes les méchancetés, tout le mal qu’il a causé depuis des siècles, et à la vie diabolique succèdera une vie pleine de joie, de bonheur et d’harmonie.
DIACONESSE
n. f.
Veuve ou fille qui, dans l’église primitive, remplissait certaines fonctions ecclésiastiques. On leur confiait plus particulièrement le soin de la nef dont l’espace était réservé aux femmes, et elles étaient les épouses des diacres à l’époque où les papes et les conciles n’avaient pas encore proclamé l’obligation du célibat pour les prêtres.
Lorsque le baptême se donnait par immersion, aux femmes comme aux hommes, ce sont les diaconesses qui baptisaient les femmes et les jeunes filles, les diacres ne pouvant s’acquitter de ces fonctions, sans blesser la pudeur des fidèles. En outre, elles s’occupaient des malades et des prisonniers.
La consécration des diaconesses fut interdite par différents conciles en raison de l’intimité trop étroite qui existait dans certaines églises entre le prêtre et les prêtresses, et aux environs du XIIème et du XIIIème siècle, elles furent totalement supprimées.
Les anabaptistes, sectes de protestants, qui prit naissance au XVIème siècle et qui soutenait la thèse qu’il ne faut pas baptiser les enfants avant l’âge de raison, chargeaient les femmes de certaines fonctions et eurent des diaconesses ; mais ils furent combattus par les catholiques et les protestants orthodoxes ; leur secte est de nos jours à peu près éteinte et les diaconesses ont disparu. Les femmes n’occupent plus, à présent, de fonctions officielles dans l’église, et celles qui se « dévouent » à la religion n’y jouent qu’un rôle subalterne. Pourtant chez les protestants, et surtout dans l’Armée du Salut, elles se livrent à un travail de propagande formidable et l’influence qu’elles exercent est considérable. Si elles n’ont plus le pouvoir, et ont été obligées d’abandonner les charges qu’elles occupaient, le travail qu’elles accomplissent n’en est pas moins nuisible, et leur action est aussi néfaste que celle des diaconesses du passé.
DIACRE
n. m.
Ministre ecclésiastique qui a reçu l’ordre immédiatement inférieur à la prêtrise. Le diacre a pour fonction de servir, à l’autel, le prêtre ou l’évêque durant la célébration des mystères et, en cas de nécessité, ils ont le droit de donner la communion. Ils ont également le droit de prêcher et de conférer le baptême, mais seulement après avoir reçu l’autorisation spéciale de l’évêque. Comme tous les prêtres, le diacre est astreint à la récitation quotidienne du bréviaire, au célibat, et au port du costume ecclésiastique.
C’est aux apôtres que l’on doit l’institution des diacres. Au VIème siècle il fallait avoir 25 ans d’âge pour être promu à cette fonction, mais à présent 23 ans suffisent. A l’origine, les diacres pouvaient se marier, ensuite ils ne le pouvaient qu’avec l’autorisation spéciale du pape, et maintenant, ainsi que nous le disons plus haut, ils sont astreints au célibat. Curieuse façon d’interpréter les paroles de l’Evangile : « Croissez et multipliez ».
Si de nos jours le diacre seconde le prêtre durant les cérémonies, ce ne fut pas toujours le rôle qu’il a rempli. Il fut, dans le passé, chargé de garder les portes de l’église ; il fut, par la suite, remplacé dans ces fonctions par le sous-diacre et à présent c’est un simple portier qui occupe cette charge. Tout évolue.
Les insignes liturgiques du diacre sont : l’amict, l’aube, le cordon, l’étole (portée en écharpe sur l’épaule gauche) et la dalmatique.
DIAGNOSTIC
n. m. (du grec diagnosis, connaissance)
Le diagnostic est la partie de la médecine qui consiste à déterminer le mal dont souffre le patient et à distinguer les maladies les unes des autres. Si chaque maladie a des symptômes qui lui sont particuliers, par contre elle en a certains qui sont communs avec d’autres affections et l’on conçoit alors que le diagnostic soit d’importance lorsqu’un docteur a la charge de soigner un malade, car tout le traitement dépend de l’habileté de l’homme de science à déterminer le diagnostic.
Le diagnostic est, à nos yeux, la base même de la médecine, et l’erreur du praticien est parfois fatale au malade. Il coule de source que, si le docteur est incapable de trouver la cause d’un malaise, il est de ce fait même incapable de le soigner. Il est évident que le diagnostic est une opération qui présente de grandes difficultés, car, d’ordinaire, le médecin ne connaît pas le tempérament, les antécédents de l’individu qui se présente à lui, et bien souvent, par une certaine pudeur ridicule, le patient se refuse à dévoiler ses tares et ses vices. Le diagnostic nécessite en conséquence une parfaite connaissance non seulement de la physiologie, mais aussi de la psychologie humaine.
Il est pénible de constater que la médecine est devenue un véritable négoce et que quantité de médecins ne sont que de vulgaires commerçants ; et cela est d’autant plus regrettable que le malade est un profane, qui, lorsqu’il souffre, n’a d’autres ressources que de se confier à celui que ses diplômes mettent à l’abri de toute critique, et qui est supposé posséder la capacité de guérir. S’il est des médecins dévoués, attachés à leur art et qui accomplissent leur métier avec conscience, il est un grand nombre de charlatans qui spéculent sur l’ignorance des malades et qui, sans même approfondir les causes du mal, diagnostiquent une maladie et vous soignent en dépit du bon sens. Sans vouloir hurler avec les loups et tout en comprenant les difficultés qui se présentent dans de nombreux cas, il faut cependant reconnaître que, en notre siècle de mercantilisme, on joue trop facilement avec la vie des individus.
Le célèbre écrivain irlandais Bernard Shaw, a écrit sur la question un ouvrage The doctor’s dilemma, qui, sous un jour humoristique, présente un véritable intérêt et critique vigoureusement les médecins peu consciencieux auxquels est livrée toute la population du globe.
Ignorant de la science médicale, gardons-nous d’être trop sévères pour les médecins et conservons l’espérance en un avenir où la science n’étant plus assujettie à toutes les spéculations, l’intérêt pécuniaire ne viendra plus corrompre ceux en qui nous plaçons notre confiance et notre vie ; lorsque nous souffrons.
Et puis peut-on vraiment blâmer le médecin qui se trompe dans son diagnostic, et qui n’arrive pas avec une scrupuleuse exactitude à découvrir les causes da nos douleurs, puisqu’il est des souffrances que nous subissons, des souffrances collectives, des souffrances sociales, dont le diagnostic a été déterminé, dont les remèdes sont trouvés et dont nous refusons de nous libérer,par lâcheté, par manque d’énergie et de volonté ? Il ne suffit donc pas au médecin, des corps ou des âmes, de dénoncer le mal caché, encore faut-il que 1e malade veuille se soigner, qu’il consente à absorber les médicaments indispensables pour obtenir sa guérison. Le peuple souffre, il sait de quoi ; il sait qu’il est opprimé, qu’il est exploité, qu’il est dirigé par une catégorie de parasites qui vivent de son sang et de sa chair. Il a consulté des docteurs, qui ont diagnostiqué, qui lui ont dit ce qu’il devait faire s’il avait à cœur de recouvrer la santé sociale qu’est la liberté. Mais il ne veut pas, il refuse et, au lieu d’écouter les sages conseils, il préfère se livrer à des charlatans qui l’exploitent et qui perpétuent ses souffrances.
Que faire contre cela ? Pas grand chose. Il faut que le peuple consente à se soigner, et au plus vite, car la maladie fait de rapides progrès et il arrive un moment où même l’opération chirurgicale est incapable de sauver le malade. Que le peuple se dépêche, son mal est aigu, demain il sera trop tard et rien ne pourra le libérer de ses maux, sauf la mort qui est la fin de toutes les misères et de toutes les souffrances. Mais s’il veut vivre, s’il veut jouir, s’il veut bénéficier enfin de toutes les joies que peuvent offrir le travail rationnel et la fierté, qu’il trouve en lui la force et l’énergie de lutter contre tous les microbes sociaux qui se sont emparé de lui, et avec la santé du corps et de l’esprit il trouvera le honneur et l’amour dans une humanité régénérée.
DIALECTIQUE
n. f.
Méthode de discussion ; art de raisonner avec justesse. On en attribue l’invention à Zénon, philosophe grec, né à Élée vers l’an 504 avant J.-C. ; ce que l’on sait, c’est qu’il enseigna à Athènes la doctrine de son maître Parménide, ainsi que la dialectique.
La logique est chez nous, ce qu’était la dialectique chez les grecs, c’est-à-dire l’art de démontrer ce que l’on considère comme une vérité.
« La dialectique est le nerf de l’éloquence » déclare Marmontel, et en effet, la conduite d’un raisonnement qui aboutit à une démonstration simple, claire et précise est le meilleur des talents oratoires. Platon la considérait comme une science susceptible d’élever l’individu et de lui faire atteindre les sommets de la vérité et de l’absolu.
Il est donc utile de s’exercer à l’art de la dialectique mais il faut se garder d’en abuser et de tomber dans le travers des sophistes qui s’en servirent pour tout contester et discuter sur toute chose. La discussion est bienfaisante à condition d’être raisonnable, et que le sujet qui la provoque présente un certain intérêt. Discuter pour discuter est non seulement inutile, mais encore ridicule et absurde, et d’une discussion oiseuse il ne peut sortir aucune vérité.
DIALECTIQUE
n. f.
Les anciens entendaient par le terme dialectique, l’art d’atteindre la vérité au moyen de la discussion des opinions. La méthode dialectique consistait donc à bien savoir interroger et à bien répondre, en cherchant à faire jaillir la vérité de la confusion et des contrastes de la discussion. Dialectique est la fusion de deux mots grecs : attraverso et raccolgo. Un dialecticien merveilleux fut Socrate, dont l’activité philosophique fut exclusivement dialogique. Il ne faut pas confondre l’ergotage avec la dialectique. L’ergotage c’est l’art de disputer pour disputer, de contredire l’adversaire à chaque affirmation, sans avoir l’intention positive de prouver quoi que ce soit.
De l’ergotage dérivent les sophistes célèbres à cause de leurs subtilités qui tendaient à embouteiller l’adversaire. Quelques-uns, pourtant, employaient ce terme pour indiquer l’art de contester avec des arguments et le raisonnement, sans lui attribuer une mauvaise signification. La dialectique est un art polémique qui ouvre le chemin à la science. Elle part des opinions communes autour d’un objet donné, elle prouve leur résistance à la critique, en faisant ressortir les lacunes, les difficultés, les erreurs. Elle prépare donc le terrain à l’investigation scientifique. De Socrate aux positivistes contemporains, la dialectique a été entendue et appliquée en ce sens.
Avec Hegel, la dialectique devient « l’application scientifique de la logique inhérente à la nature humaine ». Comme, pour lui, les formes de la pensée sont les formes du réel, ainsi la dialectique est « la vraie et propre nature des déterminations de l’intellect, des choses et, de manière générale, de tout ce qui est « fini » ». Elle consiste essentiellement à reconnaître l’inséparabilité des contradictions et à découvrir le principe de cette cohésion en une catégorie supérieure.
Par exemple : être et ne pas être, mots contradictoires, se fondent, pour ainsi dire dans devenir dans lequel se confondent : naître et périr, ainsi que : périr et naître : parce que ce qui devient, naît comme être mais périt comme non être ; et ce qui périt comme être, naît comme non être. Hegel appelle moment dialectique la contradiction même et le passage d’un terme à l’autre de cette contradiction.
La dialectique, dans le sens hégélien, acquiert une signification distincte de celle donnée précédemment.
La méthode dialectique est anti-scientifique en tant qu’elle se résout en un acrobatisme qui frise la logique et qu’elle barre la route à l’analyse.
Dans le champ de la logique, la dialectique hégélienne se base sur le principe d’identité qui considère les concepts comme quelque chose de permanent et d’immuable au lieu de les considérer comme des résultats de rapport, de relation. La méthode dialectique, au sens hégélien, se résout en « raison raisonnante », c’est-à-dire dans la combinaison de concepts dont la validité n’est pas en eux-mêmes mais qui résulte de la logique des développements systématiques. La dialectique hégélienne est un système plus qu’une méthode. Elle n’est pas, comme la dialectique socratique, analyse d’éléments logiques avec la conscience de la nécessité de faire précéder la justification des éléments de base à la construction systématique, construction dont le plan doit résulter de la connexion analysée, des rapports logiques, mais développement de lignes systématiques a priori, audace fantastique sans freins analytiques. La méthode dialectique de Socrate est à la dialectique d’Hegel comme l’investigation du savant est aux fantaisies du poète.
DICTATEUR
n. m. (du latin dictator, provenant de dictare, dicter, imposer, commander)
Les premiers hommes qui portèrent ce titre furent des magistrats romains qu’on investissait d’un pouvoir absolu dans les périodes troublées. Ils étaient nommés pour une période assez courte, six mois généralement, et leur dictature expirait avec les circonstances qui l’avaient déterminée. Le dictateur était une sorte de monarque temporel, jouissant de l’autorité absolue, toutes les autres autorités s’inclinant devant la sienne.
Au début, les dictateurs étaient proposés par le Sénat et nommés par le peuple, mais peu à peu le rôle du peuple fut diminué, puis supprimé, et les dictateurs ne représentèrent plus guère que l’aristocratie patricienne. Ils devaient, au bout d’un certain temps, faire place aux empereurs romains.
C’est d’ailleurs l’histoire de tous les dictateurs, dans tous les pays et à toutes les époques. Nommés pour résoudre des situations difficiles, pour écraser les ennemis de l’extérieur et de l’intérieur, ils reconstituent à leur profit l’autorité. Maîtres des diverses institutions autoritaires : armée, police, justice, administration, ils finissent par s’en servir pour exterminer leurs ennemis personnels, tous ceux qui pourraient menacer leur position élevée.
Les adversaires de l’idée anarchiste nous disent souvent que l’homme n’est pas parfait, qu’il a des défauts et des vices, et qu’il ne peut par conséquent vivre sans une autorité. C’est un reproche que nous pourrions retourner à ceux qui rêvent de dictature. Précisément parce que l’homme n’est pas parfait, si l’on a le malheur de lui confier l’autorité absolue, on peut être certain à l’avance qu’il l’utilisera pour des fins personnelles, dans son intérêt particulier, pour supprimer toute opposition, fût-elle la plus justifiée, à son autorité.
Il faut lire les belles pages d’Anatole France, dans « Les Dieux ont soif », pour saisir toute la nocivité de cette autorité sans aucun contrôle : des hommes profitant de leur situation pour s’enrichir, se venger, contraindre les femmes à les subir, etc., etc…
Chaque fois qu’un pays embarrassé s’est laissé imposer une dictature, il s’en est repenti amèrement.
La révolution française de 89–93 a fait aussi cette expérience. Un Robespierre, rêvant d’instaurer sa dictature personnelle, a fait couper sans pitié les têtes de tous ses adversaires. Il ne guillotinait pas que les hommes, mais aussi la révolution. Les meilleurs éléments révolutionnaires abattus, le peuple dégoûté et terrorisé, la réaction n’eut plus grande besogne à accomplir pour revenir au pouvoir : le dictateur lui avait préparé la voie.
Qu’on jette un coup d’œil dans l’histoire, et l’on s’apercevra de cette vérité indiscutable : quand un pays en révolution tourne ses yeux du côté d’un ou de quelques dictateurs, la révolution peut être considérée comme ayant vécu et la réaction revient vite.
Le titre de dictateur n’est qu’un euphémisme pour tromper les peuples. En fait, un dictateur est un monarque absolu, tyrannique, régnant par la terreur, irresponsable, échappant à tout contrôle, écrasant toute critique.
Un peuple dont la servilité peut lui faire accepter le gouvernement des dictateurs, est mûr pour un régime d’autorité absolue, et ne tarde pas à retomber dans l’esclavage.
Le langage populaire, qui est souvent l’expression du bon sens, ne s’y est point trompé. Dictateur est un mot presque toujours jeté comme une insulte. Il est l’équivalent d’individu autoritaire, brutal, tyrannique, tracassier, se mettant au-dessus de tout et de tout le monde.
Comme les Etats, les groupements ont souvent leur personnage voulant jouer le rôle de dictateur, désireux de gouverner sans rendre de compte à personne, finissant par confondre leur individu et l’organisation, et par faire passer pour des attaques à l’organisation toute critique de leurs faits, gestes ou paroles. Généralement, lorsqu’un groupement quelconque tombe dans cette mentalité, les adhérents finissent par se désintéresser de tout ; le groupement n’est plus qu’une chose personnelle et finit fatalement par disparaître.
- Georges BASTIEN
DICTATURE
n. f.
Mot indiquant les fonctions des dictateurs. Par extension, on l’applique à un régime gouvernemental dans lequel le pouvoir est despotiquement exercé par un homme ou un groupe d’hommes.
D’après son origine, le mot dictature ne devrait s’appliquer qu’à une autorité absolue exercée seulement pendant une période limitée et à l’occasion de circonstances exceptionnelles.
En fait, la dictature ressemble à toutes les autres formes d’autorité absolue. Ce qui la distingue le plus essentiellement, c’est qu’elle surgit dans une période d’agitation et qu’elle emploie, pour s’imposer, des procédés de terreur.
Dans une période révolutionnaire, au milieu d’un peuple insurgé, il serait difficile à une autorité normale de fonctionner. Protée sachant s’adapter merveilleusement aux conditions du moment, l’autorité prend alors figure révolutionnaire. Sous le couvert de la dictature, établie soi-disant pour vaincre l’ennemi de l’extérieur et celui de l’intérieur, les institutions autoritaires, policières, militaires, judiciaires, administratives, se réorganisent.
C’est au nom de la révolution qu’elles prétendent agir. Mais au fond, c’est la même organisation de domination que sous l’ancien régime qui se reconstitue.
Un peuple a renversé ses tyrans. Mais par la terreur dictatoriale, les exécutions sommaires, le hideux mouchardage, la peur semée partout, par le fer et par le sang, l’autorité reconquiert son domaine et s’affermit à nouveau. Une fois que le terrorisme dictatorial a supprimé toute action et toute idée vraiment révolutionnaires, les institutions de domination et d’exploitation redevenues maîtresses de la situation, s’épanouissent à nouveau au grand jour.
C’est l’histoire de toutes les dictatures se renouvelant éternellement et ne variant que dans les détails.
Lorsque les maîtres de la société sentent que leur situation devient mauvaise, que le mécontentement grandit, que la révolte est près d’éclater, ils n’hésitent généralement pas. Ils font fi alors de leur propre légalité et établissent un régime dictatorial, c’est-à-dire un système de terreur.
Dictature et terreur sont deux mots exprimant le même régime.
Il est hors de toute discussion sérieuse que le régime dictatorial, quel qu’il soit, ne peut que river davantage les chaînes de l’esclavage. Interdire toute liberté de réunion, de presse, d’association, de propagande on d’organisation, ne peut avoir qu’un but et un résultat : livrer le peuple aux appétits des maîtres du moment.
Les bourgeoisies capitalistes du monde entier ont aujourd’hui, à peu près toutes, les yeux tournés vers la dictature. Quoique encore bien ignorants, les peuples aujourd’hui, surtout dans les pays capitalistes, ont le sentiment très net de l’injustice sociale dont ils sont les victimes, et de la non-légitimité des privilèges des gouvernants et possédants. Le mouvement d’avant-garde a grandi dans tous les pays. D’autre part, la grande guerre mondiale a perturbé toute l’économie sociale. Des mouvements populaires ont eu lieu : en Russie, Allemagne, Hongrie, Italie. Ailleurs des grèves. Le monde bourgeois, sentant que la base normale du régime : l’acceptation de la société par les déshérités, est minée, tend partout à organiser la terreur pour maintenir les prolétariats dans l’obéissance.
C’est, en Italie, le féroce régime du bandit Mussolini, en Espagne celui de Primo de Rivera. En Roumanie, Pologne, Bulgarie, Grèce, dictatures aussi sanglantes. Dans les autres nations réputées démocratiques, le pouvoir glisse peu à peu vers un régime dictatorial. Naturellement, partout, la situation politique, économique ou financière est prise comme prétexte. Les dictateurs se présentent toujours comme des sauveurs.
En Russie, la dictature a pris une autre figure, celle dite du prolétariat. Mais c’est absolument la même chose, la question de terminologie mise à part. Par une duperie jésuitique, on l’a dénommée dictature du prolétariat. Comme s’il était possible à des millions d’humains d’exercer le pouvoir. La dictature du prolétariat est un mensonge au même titre que la souveraineté du peuple, dans le régime parlementaire. Le prolétaire de Russie y joue le même rôle que l’électeur en France, Angleterre, ou ailleurs. On exerce le pouvoir en son nom, contre lui, en lui supprimant toute liberté, en le terrorisant systématiquement. Mensonge des formules politiques !
En réalité, cette dictature du prolétariat consiste dans un état politique où le pouvoir est despotiquement exercé par un petit groupe d’hommes, de dictateurs, qui se sont arrogé le droit, par la ruse et la violence, de diriger toute une nation, et n’hésitent pas à faire supprimer tous ceux qui sont ou pourraient devenir une menace pour leur pouvoir.
On a dit, pour la justifier, presque pour l’excuse, que la dictature était une nécessité, mais qu’elle n’était que provisoire. Or, ce « provisoire » dure toujours. Ceux qui détiennent le pouvoir et s’en servent pour leur profit et ambition personnels, n’ont garde de le lâcher. Au contraire, ils s’y cramponnent, et comme toute latitude leur est laissée d’exterminer leurs concurrents ou adversaires, ils n’ont garde de les laisser se développer.
Comme tout organisme, la dictature tend à se perpétuer et à se fortifier. Elle ne disparaît jamais d’elle-même. Un retour plus ou moins long à l’ancien régime ou une autre révolution peuvent seuls terminer l’ère des dictatures.
En réalité, comme l’expérience nous le démontre, la dictature, régime de transition, est surtout une transition entre l’époque révolutionnaire qui a culbuté les institutions autoritaires et la réinstauration de ces mêmes institutions, plus ou moins camouflées.
Dès lors qu’une dictature peut s’implanter et grandir, c’est que l’esprit révolutionnaire est en décadence, c’est que la révolution est finie.
Il suffit de comparer ces deux régimes dictatoriaux : celui de Russie et celui d’Italie pour être frappé de leur ressemblance, de leur similitude.
De part et d’autre, un pouvoir usurpé par la violence, un pouvoir ne se soutenant que par la terreur. Mêmes procédés gouvernementaux, même mépris des masses populaires. Les élections, dans les deux pays, ne sont qu’une farce destinée à donner le change aux aspirations démocratiques. En réalité, les élus, les représentants du peuple sont désignés par la dictature.
En Italie comme en Russie, interdiction complète de la liberté d’opinion : la presse muselée, le droit de réunion supprimé, la liberté d’association anéantie. Dans les deux pays, répression féroce contre les adversaires du régime.
Grâce à la dictature mussolinienne, le capitalisme pille impunément la classe ouvrière italienne. Grâce à la dictature bolcheviste, le capitalisme reprend pied en Russie, et peu à peu la domine.
La révolution russe ayant été plus profonde et vigoureuse que l’occupation des usines en Italie, on met un peu plus de temps à refouler l’esprit révolutionnaire et rétablir le règne de la ploutocratie. C’est la seule différence. Et puis, en Russie, le retour pur et simple au capitalisme se complique de questions épineuses : création d’une nouvelle bourgeoisie au détriment de l’ancienne, légitimation des nouveaux maîtres, anciennes dettes tsaristes, etc…. A peu près ce qui s’est passé eu France, après 1789. Les expropriés ne pardonnent pas aux usurpateurs, et il faut un certain temps à ces deux catégories pour s’entendre… sur le dos du public.
Bref, en tous pays et à toute époque, la dictature n’a été qu’un régime d’autorité comme les autres, se distinguant seulement par plus de brutalité et de violence. Elle est le procédé utilisé par les classes régnantes pour refouler les peuples dans la soumission, lorsque les peuples veulent s’émanciper.
Tant qu’une dictature sera possible, c’est que le peuple ne sera pas mûr pour la liberté ; c’est que la lâcheté et la peur seront encore les déterminantes de l’esprit social.
C’est pourquoi les anarchistes combattent toutes les dictatures, quelles qu’elles soient, et font tous leurs efforts pour détruire l’idée d’autorité dans les cerveaux.
- Georges BASTIEN.
DIEU
n. m.
La nature de Dieu et ses rapports avec le monde furent et sont conçus de diverses manières par les différents systèmes philosophiques et religieux. Le concept de Dieu comme Etre suprême est commun à presque toutes les religions et à presque tous ces systèmes ; mais cet Etre peut être conçu comme créateur du monde (créationnisme) ou comme l’ordonnateur de la matière, existante ab œterno comme lui, et qui, pour ordonner, se sert d’un intermédiaire (demiurgo). Il peut être conçu comme inhérent au monde avec la substance duquel il est indissolublement identifié (panthéisme) ou comme en dehors de l’univers, duquel il est substantiellement distinct ; on peut lui nier toute action sur le monde et sur l’homme (déisme épicurien) et on peut en faire une entité personnelle, intelligente, qui intervient incessamment dans les événements naturels et humains (providence) ; on peut croire en une divinité seule et unique (monothéisme) ou bien en une unique divinité en trois personnes, comme dans le mystère catholique de la Trinité, ou en deux divinités, l’une représentant le principe du bien, l’autre le principe du mal (dualisme, manichéisme) ou en plusieurs divinités pourvues d’attributs divers et disposées hiérarchiquement (polythéisme) ; on peut croire que son existence n’a pas besoin d’être prouvée en tant que le dessein de Dieu est créé avec la nature intelligente, de sorte qu’elle est le fondement de toute autre connaissance (ontologisme), ou on peut estimer le cerveau humain incapable de démontrer cette vérité, qu’il doit recevoir de la révélation (révélationnisme) et de la tradition qui la transmet (traditionalisme) ; ou on peut, au contraire, en démontrer l’existence avec des arguments a priori (ontologiques, idéologiques, moraux) ou avec des arguments a posteriori (métapsychiques, théologiques, cosmologiques).
Il est intéressant d’examiner comment Dieu fut conçu par les principaux philosophes. Pour Platon, c’est l’idée du Bien, l’idée la plus élevée, à laquelle toutes les autres sont subordonnées comme moyen et, partant, la cause finale de tout ce gui peut arriver. Pour Aristote, c’est le premier moteur immobile, qui met en mouvement chaque chose non par impulsion mécanique mais par l’irrésistible attraction de sa beauté ; c’est une activité qui réside purement en elle-même, ou bien la pensée pure, qui ne demande rien d’autre comme objet, mais qui possède un contenu toujours égal : donc la pensée de la pensée. Aristote jette les bases du monothéisme spiritualiste ; puisque Dieu est mis comme Etre auto conscient, distinct du monde et comme l’élément immatériel. Pour les stoïques, il est la force originelle universelle, dans laquelle sont contenues et la causalité et la finalité de tout ce qui existe et de tout ce qui peut advenir ; comme force productive et formatrice, Dieu c’est la raison séminale, le principe de la vie, qui déroule dans la multiplicité des phénomènes et, dans cette fonction organique, Dieu est aussi la raison qui crée et guide vers un but déterminé. De là, face à tous les processus particuliers, il est la providence souveraine. Dans le néo-platonisme il est l’Etre primitif absolument transcendant, l’unité parfaite, supérieure aussi à l’esprit, infini, incompréhensible, inexprimable. Pour saint Augustin, il est l’unité absolue, la vérité qui embrasse tout, l’Etre suprême, la suprême beauté, le bien suprême. Pour Scoto Trigena, c’est l’essence substantielle de toutes les choses en tant qu’il possède en lui-même les vraies conditions de l’Etre. Pour Nicola Cusano, c’est l’unité de tous les opposés, l’absolue réalité, en qui les possibilités sont réalisées comme telles, pendant que chacun des nombreux finis est seulement possible en soi, et réel seulement pour lui. Dans chacune de ses manifestations, le Deus implicitus unique est aussi le Deus explicitus diffusé dans la multiplicité, le fini et l’infini, le maximum et le minimum. Pour Böhme, c’est le premier principe et la cause du monde lequel n’est que l’essence de Dieu même faite créature ; pareillement pour Giordano Bruno, Dieu est la cause formelle, efficiente et finale de l’univers, l’artiste qui agit sans intervention et qui transforme son intérieur en vie vigoureuse. Pour Descartes c’est « l’ens perfectissimum », l’être infini que l’esprit humain comprend avec une certitude intuitive dans son propre être imparfait et fini. Pour Spinoza, c’est l’essence universelle des choses finies, « l’ens realissimum » possédant une infinité d’attributs, mais qui n’existe que dans les choses comme leur essence générale, et dans lequel toutes les choses existent, comme manières de sa réalité. Pour Malebranche, Dieu c’est le lien des esprits, comme l’espace est le lien des corps ; toute connaissance humaine est une participation à la raison infinie, toutes les idées des choses finies ne sont que déterminations de l’idée de Dieu, tous les désirs tournés à l’individuel ne sont que participations à l’amour de Dieu comme principe de l’être et de la vie. Pour Leibnitz c’est la monade centrale, la monade suprême dans la série ininterrompue qui va des plus simples jusqu’aux esprits et qui, pour cela, représente l’univers en toute la clarté et la distinction. Pour Fichte c’est le Moi universel, absolument libre, l’ordre moral du monde. Pour Schleiermacher, c’est l’identité de la pensée avec l’être ; et qui, comme tel, ne peut être objet ni de la raison théorique, ni de la raison pratique, mais qui, cependant, constitue le but absolu de la pensée. Pour Schelling, c’est la raison absolue ou l’indifférence de nature ou d’esprit, d’objet et de sujet, parce que le principe plus haut ne peut être déterminé ni réellement ni idéalement, et en lui doivent disparaître tous les contrastes. Pour Hegel, c’est l’esprit absolu, l’idée dont les déterminations constituent le développement du monde.
- C. BERNERI.
BIBLIOGRAPHIE.
S. Reinach, Der Ursprung des Gottesidee, 1912. Allen, Grant, The evolution of the idea of God, 1897. J. Alleux, Les preuves de l’existence de Dieu, « Revue néo-scolastique », mai-août 1907. E. Le Roy, Comment se pose le problème de Dieu, « Revue de métaphysique et de morale », juillet 1907. Schiffacher E., L’Idée de Dieu et l’idée du Cosmos, « Revue de philosophie », juin 1907.
DIFFAMATION
n. f.
Action de diffamer, de porter atteinte à la réputation de quelqu’un ; décrier, attaquer une personne, par l’écrit, par la parole ; user d’invectives outrageantes, d’expressions méprisantes, d’injures, ne reposant sur aucune raison, sur aucun fait précis, pour nuire à un individu, à un corps, à une organisation quelconque.
La diffamation est un procédé ignoble, abject, qui est employé par tous ceux qui, défendant une mauvaise cause, et n’ayant rien à reprocher à leurs adversaires, usent du mensonge et de la calomnie pour les discréditer.
La diffamation est une arme terrible, contre laquelle il est parfois difficile à se défendre, car elle est maniée avec dextérité par toute une armée de jésuites malfaisants. Michel Bakounine, le grand révolutionnaire, qui sacrifia toute sa vie à la cause des opprimés, eut toute son existence empoisonnée par les diffamateurs à la remorque de Karl Marx, dont il était le plus énergique adversaire. Rien ne lui fut épargné, et malgré l’action perpétuelle qu’il menait au sein des divers mouvements révolutionnaires de l’Europe entière, Karl Marx, espérant se débarrasser de lui, n’hésita pas à faire courir le bruit que Bakounine était un agent provocateur au service de la police tsariste.
Dans les milieux anarchistes, on ne prend pas de mesures assez vives contre les diffamateurs. Si le mouvement libertaire a périclité, la diffamation n’est pas sans avoir joué un grand rôle dans cette décadence. En effet, de quelque côté que l’on se tourne, le communiste libertaire ne rencontre que des adversaires qui s’acharnent sur lui et cherchent à le détruire.
La bourgeoisie d’abord, qui craint l’action désintéressée des révolutionnaires sincères et logiques, s’est emparée de la diffamation et est arrivée à un résultat appréciable en faisant courir le bruit que les Anarchistes étaient des bandits et des voleurs, qui, pour leur bien-être particulier, et pour satisfaire leur soif de jouissance, se jetaient dans le crime et dans le meurtre. D’autre part, les partis « d’avant-garde », qui se réclament du prolétariat et ont la crainte de l’influence que les Anarchistes peuvent exercer sur les masses, poursuivent leur œuvre de diffamation en déclarant que les Libertaires sont payés par la réaction, alors qu’ils démasquent les politiciens de la sociale qui spéculent sur l’ignorance et la bêtise populaires.
Méfions-nous des diffamateurs, ils sont nombreux et dangereux ; ils pénètrent partout, on les rencontre sur tous les chemins ; accomplissant leur travail de désagrégation, salissant de leur bave l’être indépendant, sincère et dévoué, ils ne méritent que le mépris de l’homme probe, honnête et généreux, et il faut les dénoncer et les combattre avec la dernière énergie.
DIFFUSION
n. f. (du latin diffusio)
Action de se répandre, de s’étendre. La diffusion du son ; la diffusion de la lumière.
Au figuré, diffusion est synonyme de propagation. On dit : la diffusion d’une idée, d’un principe, des livres, des richesses, etc., etc...
« De la diffusion des idées anarchistes dépend l’avenir de l’humanité ». De même que l’air, la lumière, les idées sont indispensables à l’homme, car elles sont un facteur d’évolution et lui permettent d’améliorer son sort ; c’est grâce à elles qu’il a su s’élever au-dessus de l’animal et, en certaines occasions, triompher de la brutalité indifférente de la nature.
Pourtant, toutes les idées ne sont pas bonnes, et nous savons que ce sont des idées fausses qui régissent de nos jours les collectivités. Le monde est gouverné en vertu de principes archaïques, desquels il doit se libérer. Or, ce n’est que par la diffusion des idées saines, logiques, raisonnables, que l’humanité et la civilisation arriveront au but qu’elles poursuivent, et les idées anarchistes, véhiculant des principes de libération sociale, doivent être diffusés aux quatre coins du monde, pour permettre aux hommes, d’atteindre au plus haut degré de perfection possible.
La diffusion des idées anarchistes est rude et pénible ; car, pour les semer, il faut s’attaquer à tous les préjugés emmagasinés depuis toujours dans le cerveau d’individus, qui, conservateurs par essence, ont la crainte de toute innovation, même si celle-ci doit leur apporter la quiétude et le bonheur.
Néanmoins, petit à petit, l’œuvre s’accomplit. Ce n’est jamais en vain que l’on ensemence un terrain. La terre est parfois dure à labourer, et longue à produire ; mais un jour vient où l’on est généreusement payé de son labeur. Les idées anarchistes font leur chemin ; elles pénètrent partout et déjà leur influence s’exerce dans toutes les classes de la société. Que chacun se mette à la tâche. C’est aux jeunes de s’atteler à la besogne et de diffuser, à l’usine, à l’atelier, au bureau, au champ, les idées nobles et belles qui nous animent et qui nous sont inspirées par le désir de vivre en paix et heureux, au milieu d’une collectivité fraternelle et libre.
DIGNITE
n. f. (du latin dignitas)
La dignité est le respect de la personnalité d’autrui et de soi-même ; elle se manifeste par la réserve, la mesure que l’on observe en toute occasion, et surtout dans les rapports que l’on entretient avec ses semblables.
On se demande pourquoi le mot « dignité » sert aussi à désigner les fonctions honorifiques de certains individus, car un homme qui a de la dignité, est un homme valeureux, posé, utile, sociable, alors que ceux qui sont élevés en dignité, sont le plus souvent des êtres nuisibles. Ne jugeons jamais un homme d’après les apparences, car trop fréquemment, « nous jugeons d’un homme élevé en dignité, non selon sa valeur, mais à la mode des jetons, selon la prérogative de son rang » (Montaigne).
Il faut, pour conserver sa dignité, être pondéré en toute chose. Un ivrogne perd sa dignité, et ne peut exercer aucune autorité ou influence morale sur son entourage. L’homme violent, querelleur, batailleur, est également incapable de conserver sa dignité, en un mot, on peut dire que l’habitude de certains vices est incompatible avec la dignité.
Dans la lutte sociale et dans les conflits qui éclatent périodiquement entre employeurs et employés, exploiteurs et exploités, ces derniers ne doivent jamais manquer de dignité et, sans faire montre d’arrogance, ils doivent se considérer comme les égaux de ceux qui vivent de leur travail en les exploitant et se refusent à leur accorder le salaire indispensable à la vie. Le travail est une source de dignité et, par conséquent, il n’y a pas lieu de se croire inférieur parce qu’on travaille : bien au contraire. C’est l’oisiveté qui est indigne, et l’homme qui s’y livre ne mérite pas le respect de ses semblables.
DIGRESSION
n. f. (du latin digressio)
La digression est la partie d’un discours ou d’un ouvrage qui s’écarte du sujet et occupe l’auditeur ou le lecteur par une question ou un objet étrangers au sujet traité. Faire une digression. Tomber dans de perpétuelles digressions.
Lorsqu’elle est traitée de façon convenable, la digression est agréable et utile car elle repose l’auditeur ou le lecteur d’une attention soutenue ; mais il faut rester dans la juste mesure, sans quoi un discours ou un écrit deviendraient diffus et la digression exagérée semble de la divagation.
Ne nous égarons donc jamais dans des digressions, et si nous en usons dans nos discours, dans nos articles, dans nos ouvrages, faisons-le avec méthode, avec art et ne nous servons pas de digressions déplacées, qui, loin d’agrémenter le sujet que l’on traite, fatigue celui qui nous écoute ou qui nous lit, et lui fait perdre le fil de l’exposé qui lui est soumis.
DILEMME
n. m. (du latin dilemma, formé du grec ; dis, deux fois et lambano, je prends)
Le dilemme est un argument qui présente une alternative de deux propositions, de façon à ce que l’on soit nécessairement confondu, quelle que soit la supposition que l’on choisisse.
Empruntons au Larousse un exemple de dilemme.
On dit à un soldat qui a laissé passer l’ennemi :
« Il faut que tu aies quitté ton poste ou que tu aies volontairement livré le passage. Si tu as quitté ton poste, tu mérites la mort. Si tu as livré le passage, tu mérites encore la mort. Donc, dans tous les cas, tu mérites la mort. »
Protagoras, le sophiste d’Abdère, a laissé un modèle de dilemme dans le procès qu’il intenta à l’un de ses élèves. Le maître avait convenu d’apprendre l’éloquence à son disciple moyennant une certaine somme, payable moitié à l’avance et l’autre moitié à la première cause que l’élève défendrait avec succès. Comme, selon Protagoras, l’élève tardait à plaider, ne trouvant sans doute pas de cause, le maître le cita en justice et se tint ce raisonnement : « Ou la sentence me sera favorable, ou elle me sera tout à fait contraire. Dans le premier cas, mon élève doit me payer ; dans le second, il gagne son procès et, aux termes de notre convention, il est mon débiteur ». Mais le disciple avait profité des enseignements et des leçons de son professeur, et il répondit :
« Si les juges me donnent raison, je ne vous dois plus rien ; s’ils la donnent à vous, je perds ma première cause et notre première clause m’absout. »
On prétend que les juges, embarrassés, remirent le prononcé du jugement à cent ans.
Nous voyons, par les deux exemples qui précèdent, que le dilemme nous entraîne dans un cercle vicieux duquel il est impossible de s’échapper. Si le dilemme est une adresse de l’esprit, un argument employé pour réduire une proposition à l’absurde, il n’en est pas moins usé très fréquemment et les individus s’y laissent prendre comme des oiseaux à la glu.
Prenons en exemple les pacifistes guerriers qui spéculent sur les morts et jouent sur la guerre défensive et la guerre offensive. « Vous êtes Anarchistes et, par conséquent, vous défendez des principes de liberté absolue, nous disent-ils. Or, si la France est attaquée, et si les « ennemis » sont victorieux, vous serez, ainsi que toute la population, asservis et courbés sous le joug du vainqueur ; et, si vous prenez les armes, vous serez en contradiction avec vous-mêmes. D’une manière comme d’une autre, vous ne pouvez agir en Anarchistes, et, par conséquent, l’Anarchisme est une doctrine ridicule ». Politiquement, et surtout dans les périodes de bataille électorale, on se plaît à nous enfermer dans un dilemme, et ce sont surtout nos adversaires de gauche qui agissent ainsi. Ils nous disent :
« Si vous ne votez pas, vous permettez à la réaction de triompher, car vos voix viendraient grossir le nombre d’élus socialistes et communistes ; mais si vous votez, en vertu même de vos principes, vous vous nommez un « maître », et vous n’êtes pas Anarchistes ; alors ? »
Alors, et particulièrement dans les réunions contradictoires, il faut faire attention de ne pas se laisser enfermer dans un dilemme, et avoir soin de bien établir le sujet que l’on traite, car, malheureusement, les raisonnements par l’absurde abondent, et le peuple, dans sa naïveté et sa simplicité, ne s’aperçoit pas qu’on se joue de lui, et se laisse prendre par ces arguments illogiques et captieux.
DILETTANTISME
Dilettante est un mot italien qui signifie « amateur » et il fut, à l’origine, appliqué spécialement aux amateurs de musique, et surtout de musique italienne. Le dilettantisme était donc l’amour passionné de la musique italienne, et n’était pas pris en mauvaise part.
De nos jours, le mot dilettantisme a une signification beaucoup plus étendue et sert à marquer le caractère de celui qui s’occupe d’une chose superficiellement, en amateur, sans être profondément attaché à cette chose.
Les dilettantes sont nombreux et pénètrent partout ; il y en a en peinture, en littérature, en musique et aussi en politique ; ces derniers sont les plus dangereux, car on peut les considérer comme les parasites d’un mouvement.
En politique, le dilettante est dangereux ; non pas qu’il soit un mauvais garçon cherchant à nuire à ses compagnons ou à les trahir, mais parce que ses opinions sont à fleur de peau et que, d’ordinaire, il ne veut, en aucun cas, sacrifier sa quiétude et sa tranquillité pour les soutenir et les défendre. En politique — et nous n’employons pas le mot politique au sens péjoratif — il ne faut pas agir en amateur, mais aller jusqu’au bout de ses idées. Quand on participe à un mouvement et plus particulièrement lorsque celui-ci est un mouvement d’avant-garde, il ne s’agit pas de le faire en guise de divertissement et de se dérober quand le moment est venu de prêter son action, de la joindre à celle de ses camarades. Agir ainsi, c’est commettre une indélicatesse vis-à-vis des compagnons qui comptaient sur une force et qui voient celle-ci leur échapper. C’est pour cette raison que le dilettante est dangereux.
Il y a, malheureusement, quantité de gens qui, par inconscience ou indifférence, ne se rendent pas compte de la portée de leurs gestes et de leurs actions, et de la répercussion qu’ils peuvent avoir, et c’est pourquoi on rencontre tant d’individus qui se réclament d’une idée ou d’une autre, par dilettantisme, parce que cela pose ou sonne bien à l’oreille.
Il fut un temps où l’on se disait anarchiste par snobisme, où il était bien porté de faire montre d’une certaine indépendance, et les cercles bourgeois accouchaient d’un nombre incalculable de jeunes Anarchistes : des dilettantes, qui s’évanouirent avec une rapidité vertigineuse lorsqu’il devint dangereux de se réclamer de l’Anarchisme.
Méfions-nous donc des dilettantes, on ne peut compter sur eux. S’il est permis de faire du dilettantisme, en sport, en littérature, etc…, le mouvement social n’est pas un amusement mais une chose sérieuse, qui a besoin d’hommes d’action, réfléchis et sincères, et non pas de dilettantes avides de discussion et à la recherche de gymnastique cérébrale ou de spéculation intellectuelle.
DILETTANTISME
n. m. (du mot italien : dilettante)
Le dilettantisme est le goût prononcé pour un art ou un genre d’activité auquel on s’intéresse avec passion, sans toutefois le pratiquer. Le dilettante, par son caractère, s’apparente à l’amateur, mais avec quelque chose de plus intellectuel, élégant et raffiné.
Le mot dilettante ne servait guère à désigner, à l’origine, que les amateurs de musique, mondains et désœuvrés. A présent, par extension, ce qualificatif s’applique à tous les gens qui, dans le domaine de la philosophie, des beaux-arts, de la littérature, ou même de l’action sociale, se comportent de façon analogue.
Il est des dilettantes de la religion, de la charité, de la politique ; voire de la révolution prolétarienne.
L’écrivain Joris Karl Huysmans, qui a laissé une œuvre unique, et fut un des plus remarquables et des plus consciencieux littérateurs de la fin du XIXème siècle, fut un dilettante du mysticisme catholique. Plus artiste que philosophe, ayant en horreur la plupart des milieux où se complaisaient ses contemporains, il fut séduit par l’art admirable des cathédrales et des chants liturgiques, la sérénité des cloîtres, jusqu’à se croire touché de la grâce divine et se réfugier, pour un temps, chez les Trappistes. Mais, tout en faisant l’éloge de ces derniers, et déclarant envier la sainteté de leur existence, il ne tarda pas à retourner à ses habitudes. Son héros Durtal — que l’on devine n’être que lui-même — avoue honnêtement que l’agitation de Paris ne lui paraît point, en fin de compte, sans saveur, et qu’il est trop attaché à l’ indépendance de sa plume et à la fumée des cigarettes, pour se contraindre définitivement à la vie monastique. Il passe sous silence l’attrait des jolies filles, mais on croit comprendre que cette omission n’est pas le fait du dédain.
Lors de la période héroïque de l’anarchisme, de 1890 à 1894, la série des attentats perpétrés par des hommes d’une audace extraordinaire, agissant seuls, et revendiquant hautement devant les juges leurs responsabilités, eut le don d’enthousiasmer nombre de poètes, plus épris de la noble attitude des terroristes que de leurs objectifs de transformation sociale, et qui exaltèrent l’insurrection, moins par amour de la classe ouvrière que par haine des laideurs bourgeoises.
Leur état d’esprit se retrouve et se résume en cette phrase de Laurent Tailhade — qui, pourtant, paya parfois de sa personne — « Qu’importe la mort des vagues humanités, si le geste est beau ! ».
Mais la Révolution grandiose sur laquelle on comptait ne se produisit point. Et quand les esthètes se trouvèrent en présence de l’œuvre patiente des Bourses du Travail, et des magasins d’épicerie de la Coopération, parmi la triste foule des exploités, ils s’en allèrent un à un, ils reprirent goût aux forêts ombreuses et aux belles étoffes.
Il en est de même pour beaucoup d’admirateurs du métier des armes, qui se sentent très sincèrement l’âme valeureuse, et seraient prêts à donner leur vie, lorsqu’ils contemplent des régiments à la parade, marchant musique en tête et tous étendards déployés, mais ne tiendraient pas quinze jours dans une caserne, sans être découragés par l’ennui morne que l’on y respire, par les relents de pieds douteux, de rogatons et de vieux cuir que l’on y flaire en permanence.
Le dilettante n’est pas à confondre avec le snob. Ce dernier n’a d’autre aspiration que de suivre la mode et de paraître ainsi à la page, même lorsqu’en secret il l’apprécie peu. Le dilettante, au contraire, ne dédaigne point le paradoxe, et ce à quoi il s’attache il l’aime vraiment, quoique d’une façon un peu trop légère et superficielle.
On dit souvent que des gens ont les défauts de leurs qualités. La réciproque est vraie. On peut dire que le dilettantisme a les qualités de ses défauts. S’il ne compte à son actif ni la puissance de travail, ni la vocation du sacrifice, ni même l’énergie qui permet un effort régulier, il a pour lui fréquemment trois mérites non négligeables : la franchise poussée jusqu’au cynisme ; la modestie portée jusqu’au dénigrement de soi ; et le désintéressement tout court. Un nombre impressionnant d’hommes d’action ne seraient même pas, en effet, des dilettantes du but qu’ils poursuivent, s’ils n’étaient poussés dans la voie qu’ils ont adoptée par ces deux grands facteurs d’énergie : l’orgueil et l’intérêt.
Ce n’est ni dans l’hypocrisie, ni dans la vénalité, qu’il faut chercher l’origine du dilettantisme, mais bien plutôt dans l’indolence contemplative, résultat fréquent de l’aisance assurée, et dans cette indécision, ce scepticisme briseur de vaillance qui, avec un tempérament d’artiste, prompt à l’emballement, mais rebelle aux tâches prolongées et rebutantes, est souvent l’apanage des intellectuels.
Pour faire œuvre sociale, au mépris de sa vie et de sa liberté, il faut une foi ardente. Il n’est pas très surprenant que puissent se trouver, jusque dans les milieux révolutionnaires, de simples sympathisants qui, tout en approuvant la révolte des miséreux et la philosophie dont elle se réclame, conservent néanmoins trop de doutes sur les résultats immédiats que l’on en peut attendre pour être capables d’autre chose que d’une contribution d’amitié à la tâche commune.
Les dilettantes non douteux n’aiment guère que l’on use de ce terme à leur adresse, parce qu’il comporte toujours quelque dédain. Ceux qui se font gloire d’être des dilettantes ne le sont le plus souvent qu’en apparence. La philanthropie bourgeoise et le cabotinage politique ont si fréquemment pincé de la guitare humanitaire pour des entreprises qui n’avaient rien le généreux ; tant de pédants insupportables se sont ridiculisés avec d’excessives prétentions, que des méticuleux, impatientés, en arrivent à éprouver quelque pudeur à emprunter leur langage.
Zo d’Axa, qui fut l’animateur du premier journal « L’Endehors », en 1892, et l’un des plus verveux pamphlétaires de l’époque héroïque, se définissait lui-même :
« Celui que rien n’enrôle et qu’une impulsive nature guide seule... »
Il déclarait mépriser toute étiquette, même celle d’anarchiste, et se préoccuper assez peu du plan qu’adopterait la société future. Il prétendait ne batailler que pour la joie d’exprimer librement ses aspirations et ses rancœurs. Au cours d’un article, il évoqua ce que pourraient être ses derniers instants si, condamné à mort, il était conduit à l’aube devant la guillotine. Et il concluait, en annonçant qu’il s’abstiendrait de crier : Vive... quoi que ce fût. Il se contenterait de savourer la dernière bouffée de sa cigarette !
Mais Zo d’Axa subit avec bonne humeur et courage l’emprisonnement et les persécutions. Et lorsque, ayant écrit tout ce qu’il avait à faire connaître, il se retira, prématurément peut-être, de la lutte sociale, c’est qu’il préférait briser sa plume plutôt que de la faire servir à une médiocre prose, ou de la vendre pour trente deniers.
- Jean MARESTAN
DÎME
n. f. (du latin decima, dixième partie d’une chose)
La dîme était, avant 89, la partie des récoltes que les paysans étaient obligés de céder à l’église ou aux seigneurs, et cette redevance s’élevait approximativement à la dixième partie de la terre imposée. Elle fut abolie par la grande révolution française, ou tout au moins elle changea de nom et de forme, car, si, de nos jours, l’impôt se perçoit sous une apparence moins brutale, ce dernier est une dîme qui est prélevée directement ou indirectement par le capital sur le producteur.
La dîme se divisait en plusieurs catégories ; il y avait d’abord la dîme ecclésiastique, qui fut, à son origine, volontaire, mais fut rendue obligatoire par l’empereur Charlemagne, en 794, pour n’être supprimée qu’en 1789. La dîme seigneuriale était celle prélevée au profit de la noblesse, et la dîme royale, allait remplir les coffres du monarque. Ces diverses sortes de dîmes se subdivisaient à leur tour en dîmes réelles, personnelles et mixtes.
Les dîmes réelles, les plus importantes, étaient celles perçues sur les produits comme le blé, le vin, le bois, les légumes, etc... , les dîmes personnelles étaient prélevées sur le travail, l’industrie, le négoce, la chasse, la pêche, et les dîmes mixtes étaient celles qui provenaient en partie de l’industrie et en partie de la terre.
En un mot, la dîme était la contribution obligatoire du peuple à qui l’on imposait toutes les charges de l’État, et l’entretien de toute l’armée de parasites composée par les gens d’église ou de « noblesse ».
On conçoit que la perception de la dîme ne s’effectuait pas sans soulever la protestation du peuple, dont les champs étaient fréquemment ravagés par les guerres, et qui, la plupart du temps, n’arrivait pas à produire suffisamment pour ses propres besoins. Mais, l’église qui, à travers l’histoire, n’a jamais eu d’autre but que d’assurer aux puissants et aux riches le bien-être et les jouissances, usait de son autorité et de son influence pour soumettre le pauvre paysan pressuré ; c’est ainsi, par exemple, que le concile de Chalons ordonna que « tous ceux qui, après de fréquentes admonitions et prières, auraient négligé de donner la dîme au prêtre, seraient excommuniés ». En une époque, où l’ignorance était profonde dans le peuple, on comprend de suite ce que représentait cette menace. L’église n’alla-t-elle pas jusqu’à stipuler que la dîme était un droit divin ; et y a-t-il vraiment lieu de s’étonner lorsque l’on sait qu’aussi loin que nous puissions plonger dans le passé, Dieu ne fut qu’un moyen employé par les maîtres pour asservir les esclaves.
Voltaire, dans une de ses études sur la dîme, nous conte cette aventure, puisée dans le Talmud de Babylone :
« Une veuve n’avait qu’une brebis ; elle voulut la tondre ; Aaron vient, qui prend la laine pour lui ; elle m’appartient, dit-il, selon la loi : Tu donneras les prémices de ta laine à Dieu. La veuve implore la protection de Coré. Coré va trouver Aaron. Ses prières sont inutiles ; Aaron répond que par la loi, la laine est à lui. Coré donne quelque argent à la femme, et s’en retourne plein d’indignation. Quelque temps après, la brebis fait un agneau ; Aaron vient et s’empare de l’agneau. La veuve vient encore pleurer auprès de Coré, qui veut en vain fléchir Aaron. Le grand prêtre lui répond : « Il est écrit dans la loi : Tout mâle premier né de ton troupeau appartiendra à ton Dieu. » Il mangea l’agneau et Coré s’en alla en fureur. La veuve, au désespoir, tue sa brebis. Aaron arrive encore ; il en prend l’épaule et le ventre ; Coré veut encore se plaindre. Aaron lui répond : « Il est écrit : Tu donneras l’épaule et le ventre aux prêtres. » La veuve, ne pouvant plus contenir sa douleur, dit anathème à sa brebis. Aaron, alors, dit à la veuve : « Il est écrit : Tout ce qui sera anathème dans Israël sera à toi. » Et il emporta la brebis tout entière. Et Voltaire de conclure : « Ce qui n’est pas si plaisant, mais fort singulier, c’est que, dans un procès entre le clergé de Reims et les bourgeois, cet exemple, tiré du Talmud, fut cité par l’avocat des citoyens. Gaulmin assure qu’il en fut témoin. Cependant, on peut leur répondre que les décimateurs ne prennent pas tout au peuple ; Les commis des fermes ne le souffriraient pas. Chacun partage, rois et prêtres, le bien du pauvre peuple, auquel il ne reste rien. » (Voltaire)
Cependant, malgré sa puissance, I’Église ne fut pas toujours capable d’arrêter l’élan de colère du peuple, tyrannisé, torturé, volé, brutalisé, par la noblesse de robe ou d’épée, soutenue dans toutes ses actions par le clergé, qui bénéficiait du brigandage et de la terreur qui s’exerçaient sur la population.
« La faim fait sortir le loup du bois » dit un vieux proverbe, et les habitants de la campagne, à certaines époques, acculés à la misère la plus noire, n’eurent d’autres ressources que de sortir de leur passivité et de se révolter contre ceux qui étaient la cause de leurs souffrances.
La Jacquerie, qui eut lieu au xve siècle, fut un de ces formidables mouvements qui éclatèrent en France, en raison des ravages exercés par les seigneurs. Non seulement le peuple était obligé de payer les frais des combats que se livrait la noblesse, mais le plus souvent le campagnard n’avait même pas la possibilité de semer et de récolter. Les hommes d’armes détruisaient tout sur leur passage, et le paysan, que, par dérision, on appelait Jacques Bonhomme, se réfugiait sous la terre avec sa famille, d’où la faim le dénichait, cependant que la noblesse faisait ripaille, après avoir raflé toutes les maigres ressources de la paysannerie.
« Cependant », dit Michelet, la souffrance exalta enfin ces vilains qui se laissaient frapper ; le jour de la vengeance arriva, et les paysans payèrent à leurs seigneurs un arriéré de plusieurs siècles. En 1358, le 28 mai, les habitants de quelques villages des environs de Clermont, en Beauvoisis, s’assemblèrent et firent le serment de détruire tous les nobles de France. Ils prirent pour chef un paysan nommé Guillaume Caillet ou Jacques Bonhomme. Armés seulement de bâtons ferrés, ils forcèrent un château voisin, et massacrèrent le châtelain, sa femme et ses enfants. Ce fût le signal de l’insurrection et des massacres. Tous les paysans prirent leurs couteaux, leurs cognées, leurs socs de charrues, coupèrent des bâtons dans les bois pour en faire des piques, et coururent sus aux nobles, assaillant ces châteaux devant lesquels ils avaient si longtemps tremblé, les emportant d’assaut, tuant tout ce qu’ils y trouvaient, et y mettant le feu. En peu de jours, l’insurrection se répandit dans tous les sens comme l’incendie qui court sur une campagne couverte d’herbes sèches. Nulle part, les nobles n’essayaient de se défendre. » (Michelet)
Il serait inexact de prétendre que la dîme, l’impôt, le prélèvement effectué par le riche sur le pauvre, fut la cause unique de la Jacquerie ; l’arrogance, le mépris du noble pour le manant joua également un rôle dans la révolte paysanne du xve siècle, mais il est certain que c’est surtout la misère qui détermina le paysan à s’insurger, et que cette misère était consécutive à la grosse part que le prêtre et le seigneur exigeaient du paysan.
Même la « Fronde » qui, de 1643 à 1653, divisa la France en deux camps, et qui ne fut, à l’origine, qu’un complot organisé par une certaine partie de la noblesse contre le cardinal Mazarin, ne rencontra la sympathie populaire que grâce au mécontentement soulevé par les nouveaux impôts rendus nécessaires par les nombreuses guerres présentes et passées.
Lorsque l’on analyse les divers mouvements de révolte populaire, on remarque qu’à la base de tous ces mouvements, il y a la misère, et que peu d’insurrections ou de révolutions ont été provoquées par des causes purement morales. Il est vrai que tout s’enchaîne et que la misère du peuple entraîne les gouvernements à user d’autorité, par crainte de soulèvement, et qu’en conséquence, lorsqu’elle n’est pas un facteur de révolte, elle est une source de bassesse et d’esclavage.
On peut donc dire, sans craindre de se tromper, que toute révolution, quelles qu’en soient les apparences, ont pour cause directe l’état misérable de la population, et que cet état est déterminé par la dîme, ou si nous aimons mieux, l’impôt direct ou indirect, que prélevait hier le seigneur, et que prélève aujourd’hui le gouvernement, ce qui est sensiblement pareil.
Nous avons vu que, si la grande révolution française a rencontré l’accueil pressant de la paysannerie et du peuple, c’est qu’ils étaient courbés sous le poids des, impôts et que leur dénuement était terrible. Plus près de nous, la Révolution russe, est un autre exemple, celles d’Italie et d’Allemagne peuvent également nous servir d’enseignement.
Nous disons plus haut que la dîme et l’impôt sont deux choses identiques ; et, en effet, si la dîme était une redevance qui se payait en nature, sa suppression tient surtout à ce que les formes actuelles de société ne permettent pas de tels procédés, et que l’Impôt payé en monnaie facilite le travail administratif de l’État. Mais, en réalité, le résultat est le même, et c’est en vain, si nous prenons la France en exemple, que nous chercherions un produit sur lequel l’État, le Gouvernement ne prélèvent pas une certaine partie de sa valeur. Toutes les marchandises, quelles que soient leur nécessité ou leur utilité, sont imposées. Il fut un temps, où la Gabelle, ce fameux impôt sur le sel, souleva la protestation et l’indignation du populaire. Aujourd’hui, le blé, le sucre, le sel, la viande, le café, tous les produits enfin, sont soumis à une certaine taxe qui varie selon les besoins de l’État, et il coule de source que si ces taxes sont payées directement par le commerçant, ce dernier ne manque jamais, en augmentant le prix de sa marchandise, de se faire rembourser par le consommateur. C’est donc le consommateur qui paye la dîme.
On trouvera plus loin, au mot « Impôt », les diverses formes de contributions auxquelles sont soumises les populations modernes, et nous verrons que nous n’avons rien à envier à nos ancêtres ; que nous sommes, comme eux, écorchés par de nouveaux seigneurs, qui, s’ils ont changé de noms, n’en sont pas moins rapaces, et entendent continuer à vivre sur le dos du commun.
Le peuple a payé la dîme, il s’en est libéré par la Révolution ; il paye l’impôt, il ne s’en libérera que par la Révolution. Encore faut-il que cette révolution soit complète ; car, inachevée, elle donnera naissance à de nouvelles erreurs, et changera le nom des choses sans en changer le fond. Or, c’est au fond qu’il faut s’attaquer, c’est lui qu’il faut détruire si nous voulons voir disparaître ce qui fit et fait encore le malheur de l’humanité.
DIPLOMATIE
n. f.
Anciennement, la diplomatie était l’art de déchiffrer les chartes et les diplômes ; mais, depuis le XVème siècle, elle est devenue une science qui consiste à négocier les « intérêts » respectifs des Etats et des Gouvernements entre eux, et les qualités les plus indispensables à l’exercice et à la pratique de cette science sont : le mensonge, la fourberie, l’adresse et la ruse ; qualités, comme on le voit, toutes bourgeoises et dont se glorifient les diplomates, honorés de posséder de telles vertus.
Pour le peuple, la diplomatie puise sa source dans le « droit » international et a pour but ou pour objet la tranquillité, la sûreté, la quiétude des nations, et le rôle du diplomate est de rechercher les moyens susceptibles de régler pacifiquement les conflits qui pourraient menacer la paix existante entre diverses nations dont les intérêts sont opposés.
La réalité est toute autre, et M. Georges Louis, ancien ambassadeur de France à Petrograd, dans son étude sur les responsabilités de la guerre, éditée chez Rieder sous le titre : « Les Carnets de Georges Louis » nous éclaire lumineusement sur ce qu’est la diplomatie.
Nous initiant sur les relations diplomatiques de Poincaré et de Sazonoff, il écrit : « Après avoir lu le Livre bleu d’Avril sur la crise européenne, on sent que Poincaré et Sazonoff se sont dit : « Ce qui importe ce n’est pas d’éviter la guerre, c’est de nous donner l’air d’avoir tout fait pour l’éviter » ».
Ces mots, cette formule, sous la plume d’un diplomate éminent, sont symboliques. Et, en effet, le rôle de la diplomatie n’est pas d’éviter les conflits, mais d’en cacher les causes déterminantes au peuple, et de couvrir de son manteau les véritables responsables.
Il est des individus qui ne combattent pas, qui ne critiquent pas la diplomatie en soi, la considérant comme utile, nécessaire, indispensable même à la vie des nations, et qui estiment que, si elle n’était pas secrète, si ses travaux s’effectuaient en plein jour, sous le contrôle du peuple, son rôle ne pourrait être que bienfaisant. Pauvres fous ! La diplomatie peut-elle ne pas être secrète, et le contrôle populaire peut-il être une garantie ? La démocratie, qui est le gouvernement du peuple, est une manifestation suffisante de la souveraineté populaire, et il n’y a plus que les naïfs ou les coquins pour croire que sa volonté est respectée.
Nous avons dit que les qualités essentielles du diplomate sont la ruse, le mensonge et la fourberie ; par conséquent, la partie n’est pas égale car, sur ce terrain-là, le peuple est toujours et sera toujours roulé.
La diplomatie est l’action de dissimuler, et on ne peut donc, en vérité, demander qu’elle ne soit pas secrète ; si elle ne l’était pas, ce ne serait pas de la diplomatie.
Est-il besoin de rechercher bien loin dans le passé pour trouver des exemples frappants de ruse diplomatique ? Qui donc, de nos jours, ignore la finesse avec laquelle le célèbre Bismarck procéda à la veille de la guerre de 1870 ?
La France, comme l’Allemagne, voulaient la guerre et, lorsque nous disons la France et l’Allemagne, nous entendons, non pas le peuple qui n’aspirait qu’à la paix, mais les gouvernements respectifs de ces deux pays ; et pour laisser au gouvernement français toute la responsabilité de la déclaration de l’état de guerre, Bismarck n’hésita pas à falsifier des télégrammes diplomatiques, ce qui mit le comble à sa puissance, la fourberie étant un facteur de succès en diplomatie.
D’autre part, les événements, beaucoup plus récents qui précédèrent la grande guerre de 1914, et qui nous sont connus aujourd’hui, nous fixent définitivement sur le jeu de la diplomatie et des diplomates. Nous allons citer certains faits qui démontrent amplement la ruse déployée par les diplomates et l’ombre dans laquelle ils agissent.
Empruntons le témoignage suivant à M. Stéphane Lauzanne, qui ne peut être suspecté de sympathie pour les contempteurs de l’ordre bourgeois.
« Je me souviens, dit-il, le 31 juillet 1914, avoir déjeuné dans une maison amie, avec M. Aristide Briand que M. René Viviani avait accompagné jusqu’à la porte en auto ».
31 juillet 1914 ! Le jour où l’Allemagne lança son ordre de mobilisation, le jour où, en fait, elle décréta la guerre ! On pense si les convives interrogèrent M. Briand. Il savait, lui ! Il venait de causer avec le chef du gouvernement qui savait, qui devait savoir. Et j’entends encore M. Briand nous dire, de sa voix aux sonorités traînantes : « Ce que je sais bien, c’est que les Allemands ne nous déclareront pas la guerre. Ce ne sont pas des idiots ! Ils ont eu dix occasions meilleures que celle-ci pour nous attaquer, dix occasions où ils n’auraient pas trouvé les alliés aussi solidement unis. Ils raisonnent, les Allemands. Ils ne sont pas fous... Je vous dis qu’ils ne feront pas la guerre... »
Et Stéphane Lauzanne ajoute :
« 31 juillet 1914. Voilà ce que l’on savait dans les milieux où l’on sait ... »
M. Stephane Lauzanne, en bon journaliste bourgeois qui se respecte, prend ses lecteurs pour des imbéciles, car il ne fera admettre à aucun homme qui raisonne tant soit peu, que M. Briand ne savait pas ; mais si M. Briand savait, il y avait intérêt à ce que le peuple ignorât ce qui se tramait dans les coulisses diplomatiques. Le 31 au matin, le Gouvernement français savait que la guerre était inévitable puisque, dans la nuit du 30 au 31, l’ordre de mobilisation avait été affiché en Russie, et que M. Paléologue, l’ambassadeur de France, en avait averti son gouvernement. Cela est tellement certain, que le 10 septembre 1914, la revue française le « Correspondant » publiait le journal d’un officier français mobilisé à Saint-Pétersbourg, dont nous extrayons ce passage :
Vendredi 31 juillet, le matin.
« La mobilisation russe est un fait accompli. Le manifeste du tsar a été affiché cette nuit. Je vais à l’ambassade de France... Je trouve l’ambassadeur fort occupé. M. Paléologue paraît tout à fait certain de la guerre et s’en réjouit presque en songeant que la situation est la plus favorable que l’on ait jamais pu espérer. »
« Déjeuner, chez Cubat, je cause avec des officiers. Aucun ne cache sa joie de la guerre prochaine. »
En outre, M. Paléologue, le 31 juillet 1914, au matin, déclarait à l’ambassadeur de Belgique : « La mobilisation russe est générale. En ce qui concerne la France, elle ne m’a pas encore été notifiée, mais on ne peut pas en douter ». Et si l’on ajoute à cela ce passage ci-dessous, puisé dans les mémoires de l’Ambassadeur de France à Pétrograd, et portant la date du 31 mars 1915, on est totalement fixé sur le rôle de la diplomatie :
« Nous avons pris les armes, écrivait l’Ambassadeur, parce que la ruine de la Serbie aurait consacré l’hégémonie des puissances germaniques, mais nous ne nous battons pas pour réaliser les chimères du slavisme. Le sacrifice de Constantinople est déjà suffisant. »
On ne peut avouer avec plus de cynisme que la guerre de 1914 était voulue, recherchée, préméditée, que, seul, le prétexte manquait et qu’il appartenait à la diplomatie de le trouver.
Le meurtre de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche à Sarajevo, par l’étudiant serbe Garilo Prinzep, fut une occasion inespérée de déclencher le carnage et la diplomatie, en cette affaire, interpréta son rôle de façon admirable, c’est-à-dire qu’elle se dépassa en abjection. Tout eût pu s’arranger si les diplomates n’étaient pas les vils serviteurs du capitalisme et si la diplomatie était autre chose qu’une institution au service du Capital. Mais le Capital, représenté au Pouvoir par M. Poincaré et ses hommes, voulait la guerre, et il la prépara avec la complicité de la diplomatie.
Le 16 janvier 1914, le Baron Guillaume, ministre de Belgique à Paris, écrivait à son Gouvernement :
« Ce sont, en fait, MM. Poincaré, Delcassé, Millerand et leurs amis qui ont inventé et poursuivi la politique nationaliste, cocardière et chauvine dont nous avons constaté la renaissance. C’est un grand danger pour l’Europe et la Belgique. J’y vois le plus grand péril qui menace aujourd’hui la paix de l’Europe. »
Et le 10 mai 1914, à propos du voyage de Poincaré en Russie, il écrivait :
« Il y a envoyé récemment Delcassé, auquel il a confié la mission de chercher, par tous les moyens, à exalter les bienfaits de l’alliance franco-russe et à amener le grand empire à accentuer ses préparatifs militaires. »
Comme l’on comprend bien, alors, que, lorsque débarquant à Dunkerque, le 29 juillet 1914, à midi, le sénateur Trystram lui posa cette question :
« Pensez-vous, M. le Président, que la guerre pourra être évitée ? »
Poincaré répondit :
« Ce serait, grand dommage, jamais nous ne retrouverions conditions meilleures. »
Qui donc dénoncera les agissements de la diplomatie internationale ? Qui donc arrachera le bandeau qui couvre les yeux du peuple ? Personne. Capital, Diplomatie, Gouvernement, trois têtes sous le même bonnet, exercent leur puissance dans tous les domaines ; la presse est muselée, elle est achetée, et ce n’est qu’accidentellement que l’on arrive à savoir quelque chose. La vénalité, la corruption de la presse est aujourd’hui le secret de polichinelle, mais pourtant, nous croyons utile de publier, malgré sa longueur, le document qui va suivre et qui démontre, de manière indiscutable, la collusion de la presse et de la diplomatie.
C’est à la « Bonne Guerre » que nous devons la publication de ce pacte qui fut conclu en avril 1920, au nom de la grande presse française, par MM. Roëls, rédacteur en chef des services extérieurs du « Temps », Charles Rivet et Tavernier, courriers diplomatiques de ce même journal. Voici ce pacte :
-
L’accord qui intervient, valable de mai 1920 il juin 1921, comprend :
-
les journaux : Le Matin, Le Journal, L’Echo de Paris, Le Temps, Le Petit Parisien, L’Information, Le Gaulois, La Liberté, Le Petit Journal, la France Libre.
-
les agences : L’Information, Radio et Agence des Balkans, cette dernière comme minimum pour la cessation d’insertions de dépêches hostiles à la Bulgarie.
-
-
Le matériel devra être remis par Sofia ou ses représentants, soit directement aux rédactions, soit à M. Roëls, suivant les cas. Les questions d’organisation, c’est-à-dire de répartition de ce matériel et des formes diverses que peut affecter son insertion dans les organes précités (c’est-à-dire : dépêches, notes, articles, lettres de correspondants, interviews, réponses), sont à définir sur place à Paris, entre M. Roëls ou son représentant pour les questions balkaniques, M. Tavernier et l’agent désigné par le gouvernement bulgare pour le service de presse en France ;
-
Les organes précités s’engagent à insérer les télégrammes d’agence relatifs à la Bulgarie, qui leur parviendront par le canal de Radio ou de l’Information ;
-
L’agence L’Information sera représentée à Sofia par un correspondant français désigné par elle, qui fera le service de dépêches pour l’agence et un service de lettres pour le journal, L’agence Radio aura un représentant, préférablement bulgare, choisi par le Gouvernement qui se bornera à transmettre à son agence les notes ou dépêches d’informations à lui, remises par le bureau de presse du ministère des Affaires étrangères de Sofia ;
-
Le Temps enverra en Bulgarie un correspondant français qui sera chargé :
-
D’un service télégraphique,
-
d’un service de lettres ;
-
-
Le Petit Parisien sera représenté également, mais soit par un journaliste bulgare, soit par un français déjà établi. Ce sera au Gouvernement bulgare à 1e rechercher et à le désigner. De même pour le représentant de Radio ;
-
La gratuité télégraphique est accordée dès mise en vigueur de l’agrément par le Gouvernement bulgare aux agences L’Information et Radio et au journal Le Temps. De plus, les frais d’entretien à Sofia, des correspondants du Petit Parisien et des deux agences, seront assurés, pour la majeure partie du moins, par le Gouvernement bulgare ;
-
Il est entendu que, par ces divers moyens, un service continu d’informations bulgares, venues de la source même et non plus dénaturées par des adversaires, sera assuré dans les organes ci-dessus désignés et principalement dans Le Temps ;
-
Il est expressément compris également que les autorités gouvernementales bulgares ne demanderont jamais que ces informations prennent un ton agressif pour une puissance amie ou alliée de la France, et revêtent le caractère d’une polémique avec telle où telle de ces puissances. Il est entendu de même que ces informations, pour conserver tout leur crédit, ne prendront pas l’allure d’une campagne systématique sans mesure comme sans prudence. Par contre, les attaques constantes contre la Bulgarie cesseront dans les organes précités, c’est-à-dire dans la plus grande partie de la presse française. Au cas où, pour une cause impossible à prévoir, une attaque se produirait, le Gouvernement bulgare serait immédiatement mis en mesure d’y répondre ;
-
Il est entendu que le Gouvernement bulgare nt demandera pas aux organes précités de soutenir une politique d’expansion au détriment de tel ou tel de ses voisins. Mais, par contre :
-
La thèse de la récupération par la Bulgarie de territoires qui sont siens, thèse définie dans les trois lettres du Président du Conseil, M. Stamboulisky, à ses collègues grec, roumain et serbe, comme :
-
La question de son accès territorial à l’Égée ;
-
La question des minorités, auront une place faite sous forme appropriée dans les organes précités.
-
De même les organes précités, prenant en considération que l’intérêt de la France demande le relèvement économique de la Bulgarie, réserveront une place à ce problème pour éclairer, s’il y a lieu, à son sujet, et l’opinion et la commission interalliée qui siégera à Sofia.
Enfin, dans les rubriques bibliographiques des organes précités, il sera fait mention des ouvrages bulgares désignés par Sofia.
En présence de :
E. Roêls, Ch. était Rivet, V. Ganef, N. Stoiloff.
Ce pacte complété par une note dont voici la traduction :
LÉGATION DE BULGARIE
ARCHIVES SECRÈTES PROTOCOLE
Nous, soussignés, certifions que, conformément à la dépêche N° 645 du président du Conseil, M. Stamboulisky, en date du 17 avril, ce jour et en la présence de M..Charles Rivet, nous avons remis au rédacteur en chef du journal Le Temps, M. Roëls, représentant le groupe de journaux suivants : Le Matin, Le Journal, L’Echo de Paris, Le Temps, Le Petit Parisien, L’Information, le Gaulois, La Liberté, Le Petit Journal, La France Libre, et les agences : Information, Radio et Agence des Balkans, le chèque N° 23.111 pour la somme de sept cent cinquante mille francs français, émis par le Comptoir National d’Escompte de Paris, par compte du ministère des Affaires étrangères de Bulgarie à la Banque de France.
Paris, le 4 mai 1920. (Signé) : B. Ganef.
38, avenue Kléber. (Signé) : N. Stoiloff.
(Cachet de la Délégation bulgare à la Conférence de la Paix).
Nous pourrions multiplier la publication de documents démontrant le rôle néfaste de la diplomatie. La Russie dévoila, au lendemain de la Révolution, une certaine partie de la correspondance échangée entre les représentants des divers gouvernements d’Europe et la lecture de cette correspondance est édifiante. Mais la grande presse, en général, conserva le silence, et cela se comprend, en considérant le document que nous publions ci-dessus et qui lie les grands journaux de France au Gouvernement bulgare. Lorsque l’on sait que ce pacte, cet accord n’est pas particulier, mais, qu’en réalité, il en existe de semblables qui furent conclus avec d’autres nations, que la Presse se vend à n’importe qui, qu’elle se tait ou qu’elle parle selon que l’on paye ou que l’on ne paye pas, on est terrifié à la pensée que l’on est à la merci d’une poignée de coquins, dont l’intérêt peut déchaîner les plus terribles cataclysmes.
Nous disions, d’autre part, traitant de la concurrence (voir ce mot) : Chaque fraction du capitalisme en lutte se défend par l’intermédiaire de son Gouvernement et la concurrence de nation à nation est l’unique cause des négociations interminables qui se poursuivent depuis des années et des années. Le Capitalisme inter national cherche un terrain d’entente, et lorsque les intérêts particuliers n’ont pu se concilier autour du tapis vert de la diplomatie, alors on donne la parole au canon et c’est la guerre fratricide, criminelle, monstrueuse, qui est chargée de régler le différend.
Et, en effet, la Société est une vaste entreprise commerciale et le diplomate peut être comparé à un représentant qui cherche à vendre une marchandise le plus cher possible ou à en obtenir une autre dans les conditions les plus avantageuses. A quoi, sinon à des tractations commerciales, se livrerait toute cette armée d’agents diplomatiques, qui coûte si cher à entretenir, et dont les travaux ont, parfois, un résultat tragique ?
De quoi discutaient avant la guerre, tous ces ambassadeurs, tous ces ministres ? Etait-ce du Cochon serbe ; de Constantinople que réclamait la Russie afin d’étendre son commerce extérieur ; du Traité de Francfort qui accordait à l’Allemagne certains privilèges commerciaux lui permettant d’exporter en France une grande quantité de ses produits ; de la puissance maritime anglaise, de son empire colonial, nuisibles aux intérêts du capitalisme des empires centraux ? Quelles furent, et les difficultés devant lesquelles se brisa l’habileté des diplomates et les causes directes de la guerre ? Les divers ouvrages diplomatiques, relatifs à toutes ces questions, et publiés par les divers gouvernements, rejettent la responsabilité sur les uns et sur les autres, mais c’est en vain que l’on chercherait dans les nombreux livres diplomatiques de toutes couleurs, une parcelle de vérité. Ce qui est vrai, ce qui ne souffre aucune contradiction, c’est que le capitalisme voulait la guerre en 1914 comme il la désirait en 1870, et que la diplomatie s’efforça d’en masquer les raisons, et d’aveugler le peuple par ses subterfuges. Comment ne serait-elle pas secrète ? Comment pourrait-elle avouer, qu’elle ne se livre qu’à des tractations commerciales, industrielles, financières, au profit d’une poignée de parasites ? Comment pourrait-elle reconnaître qu’elle organisa la tuerie pour que l’Alsace et la Lorraine revinssent à la France et que la Compagnie des Chemins de fer de l’Est pût hériter de tout le régime ferroviaire de ces deux départements ; que, de son côté, l’Allemagne voulait se battre, parce que le traité de Francfort prenait fin, et qu’aussi elle avait l’espérance d’affaiblir la perfide Albion et de détruire son hégémonie mondiale ? Eh oui ! Elle est secrète et elle restera secrète la diplomatie. Elle ne peut se montrer toute nue. Maquillée, recouverte de brocard et de soie, elle semble jolie et appétissante ; mais lorsqu’on la découvre, lorsqu’on lui retire son manteau, elle apparaît sous son vrai jour : sale et répugnante, et soulève de dégout le cœur de celui qui la regarde.
Abjecte prostituée, elle s’est vendue hier, elle se vend aujourd’hui, elle se vendra demain, elle se vendra toujours.
Ses amants sont toujours les mêmes, et c’est toujours dans le même clan qu’elle les trouve. Pour satisfaire à l’appétit insatiable du Capitalisme, elle a livré à la mort des millions d’hommes et elle recommencera encore. Que nous prépare-t-elle ? Que nous réserve-t-elle ? Des carnages. Elle est en train d’organiser les tueries futures.
Elle a sacrifié hier aux maîtres de la métallurgie des milliers d’innocents, elle en sacrifiera d’autres demain aux caoutchoucs anglais ou aux pétroles américains.
Que l’on ne s’imagine pas que notre pessimisme repose sur des illusions ou sur des probabilités. C’est la brutale réalité du présent qui nous fait craindre pour l’avenir. Le monument diplomatique accouché à Versailles, loin de résoudre les divers problèmes inter-nationaux, n’a fait qu’envenimer les conflits qui divisent les différents capitalismes, et la Société des Nations, illustre mensonge, dont l’unique utilité est de tromper le peuple, n’est qu’un repaire où se réfugient les cuisiniers de la politique, pour préparer la sauce à laquelle nous devons être mangés.
Le 2 novembre 1921, Romain Rolland écrivait :
« L’humanité, déchirée par la guerre de cinq ans, est à la veille de guerres plus monstrueuses encore, où des millions de jeunes vies et toutes les espérances de l’avenir seraient immédiatement englouties. Si les femmes ne luttent pas avec la dernière énergie contre le fléau qui s’approche, que le sang de leurs fils retombent sur leurs têtes ; elles auront été complices du meurtre qu’elles n’auraient pas eu l’énergie d’empêcher. »
Eh bien ! L’heure de l’échéance approche. Les effets pernicieux de toutes les discussions intestines auxquelles se livrent les diplomates des diverses contrées du monde, ne peuvent tarder à se faire sentir.
Nous avons dit que la diplomatie n’a d’autre but que de masquer les causes de guerre, et que les guerres sont toujours déterminées par des conflits d’intérêts commerciaux, industriels ou financiers.
La récente guerre du Rif, qui nous fut présentée comme une guerre de libération des peuplades africaines asservies et courbées sous l’autorité d’Abd el-Krim, ne fait pas exception à la règle. Nous savons que le triomphe du chef Hiffain eût été une source de profits pour certains groupes ou particuliers qui le commanditaient et auxquels il avait accordé de larges concessions territoriales, et que la France ne s’engagea dans l’entreprise marocaine, à la suite de différentes négociations diplomatiques avec l’Espagne, que parce que la finance française entendait exploiter à son bénéfice les richesses souterraines de la grande contrée nord-africaine.
C’est donc bien pour la possession des mines marocaines que se firent tuer des milliers et des milliers de soldats français, espagnols ou marocains, possession dont devaient hériter non pas ceux qui se faisaient ridiculement massacrer, mais leurs chefs, leurs maîtres, leurs exploiteurs.
Et c’est pourquoi nous fûmes étonnés lorsque certain parti d’avant-garde, usant de diplomatie, c’est-à-dire de mensonge, engagea le peuple à soutenir Abd el-Krim.
Les chefs de ce parti ignoraient-ils que celui qu’ils présentaient comme un héros dévoué à la grande cause « des peuples libres de se diriger et de se déterminer eux-mêmes » avait déjà livré :
-
À M. W. Muller : 2.000 hectares de terrain.
-
À M. André Teulon : 300 hectares de terrain.
-
À la Compagnie Maroco MineraIs : 2.635 hectares.
-
À M. Muller : 1.995 hectares.
-
À la Compagnie Internationale du Minera : 6.400 hectares.
-
À une Compagnie italo-hollandaise : 1.600 hectares.
-
Etc. ?
Non, ils ne l’ignoraient pas, mais tout parti politique est entraîné dans diverses tractations, surtout lorsqu’il représente une puissance gouvernementale, et est, en conséquence, obligé d’user de ruses, de subterfuges de diplomatie.
La guerre du Maroc n’est que le prélude de conflagrations plus sanglantes et, dans les négociations diplomatiques qui se poursuivent à travers le monde, chaque ambassadeur, chaque ministre cherche, non pas à assurer la paix, mais à choisir pour la guerre l’heure qui lui paraît la plus propice au triomphe da la fraction du capitalisme qu’il représente. Ils n’ignorent pas, les diplomates, que la guerre est inévitable ; ils sont convaincus que, de plus en plus, la situation deviendra plus critique, et qu’il faudra régler les différends dans le sang du peuple. Que leur importe après tout !
L’Amérique a besoin de caoutchouc pour son industrie automobile, mais l’industrie du caoutchouc est contrôlée dans une proportion de 75 % par le capitalisme anglais ; la France convoite les richesses métallurgiques du bassin de la Sarre, mais ce bassin appartient à l’Allemagne, qui le céda temporairement en vertu du Traité de Versailles, mais qui espère, malgré tout, en reprendre possession ; l’Italie veut la Corse et la Tunisie, mais ces contrées sont à la France, qui ne veut pas s’en séparer ; l’Angleterre a besoin de pétrole, c’est l’Amérique qui le possède et l’insatiable Albion jette les yeux sur les mines de Bakou ; et chaque pays, chaque nation, s’étudie, s’observe, se surveille, s’espionne par l’intermédiaire de ses diplomates, et cherche à affaiblir son voisin pour se jeter sur les richesses convoitées.
Afin d’assurer le succès du capitalisme qu’elle représente, la diplomatie détermine des alliances, prend des engagements, suscite des révoltes, fomente des troubles ; en un mot, elle se livre à de louches entreprises, et l’on comprend la raison pour laquelle la correspondance échangée entre un gouvernement et ses ambassadeurs nécessite un code spécial, indéchiffrable pour celui qui n’y est pas initié.
Se débarrasser de la diplomatie ou espérer qu’elle s’améliorera est une chimère tant que subsistera la forme actuelle des sociétés. La diplomatie est une branche de l’arbre capitaliste ; il est inutile de chercher à l’arracher ; comme toutes les plantes parasitaires elle repousserait avec rapidité. Il faut détruire l’arbre, il faut anéantir ses racines, afin que jamais plus il ne repousse et vienne, de son ombre, cacher les rayons lumineux de la paix et de la liberté.
- J. CHAZOFF.
DIRECTION
n. f. (du latin directio)
Côté vers lequel une personne ou une chose se dirige. La direction du fleuve, la direction de la route ; suivre la même direction ; quelle direction allons-nous prendre ? Prendre la bonne direction.
Le mot « direction » s’emploie également au figuré.
Dans ce cas, il sert à signaler la façon, bonne ou mauvaise, de se conduire. « Ce garçon suit une mauvaise direction ». Il sert également à désigner l’organe dirigeant d’une entreprise, d’une affaire, d’une administration. La direction de l’usine ; la direction des postes ; la direction des contributions directes et indirectes. « Veuillez vous adresser à la direction ».
Au sens bourgeois du mot, « direction », suppose hiérarchie, chef, autorité, contrainte, etc., et cela se comprend, puisque, en vertu même de la morale et de la loi bourgeoises, celui qui dirige exerce sa volonté, devant laquelle doivent s’incliner tous ceux qui sont placés plus bas que lui dans l’échelle sociale.
On prétend, — bien à tort du reste, et cette insinuation est intéressée-, que les anarchistes, étant les adversaires de l’autorité, sont, de ce fait même, ennemis de « toute direction ». Présenter les choses sous un tel jour nous paraît plus que simpliste. Si les anarchistes sont, en effet, les adversaires acharnés de l’Autorité, parce qu’ils en ont compris les effets pernicieux, cela ne veut pas dire qu’ils ne comprennent pas l’utilité, la nécessité indispensable d’une « direction » dans toute affaire, dans toute entreprise groupant un certain nombre d’individus.
Seulement, à leurs yeux, « direction » ne peut en aucun cas être synonyme de supériorité personnelle et, s’ils admettent que toute chose doit être dirigée : c’est-à-dire conduite vers le but qui lui est assigné, d’une manière raisonnable, logique et intelligente, celui ou ceux à qui sont confiées cette fonction, cette charge, cette direction, ne leur apparaissent pas comme devant être des individus devant lesquels ils doivent s’ incliner, et qu’ils ont le devoir de considérer comme des demi-dieux infaillibles. Partisans de l’organisation, les anarchistes-communistes, les libertaires, ne peuvent donc, en vérité, être les ennemis de la « direction ». Pourtant, ils ne sauraient se ranger du côté des amis de l’autorité qui, même au sein de leurs organisations d’avant-garde, s’inclinent devant les décisions d’un « comité directeur », sans même analyser les actions et les gestes qu’ils sont appelés à exécuter.
Reconnaissant les bienfaits de l’intelligence, de la logique et de la raison, les anarchistes placent à la direction de leurs organes ou de leurs associations, les camarades qu’ils considèrent comme les plus capables et les plus susceptibles de propager les idées auxquelles ils sont attachés ; mais ils conservent toute leur liberté, se réservent le droit de critique, et ne suivent pas aveuglément, comme des esclaves, une « direction » qui pourrait se manifester stupide et ridicule.
DIRECTIVE
n. f.
Ensemble d’indications, ligne de conduite à suivre, application de décisions prises. Les directives à suivre pour l’affranchissement social sont suffisamment traitées dans cet ouvrage. Nous jetterons nos regards sur ce qui se passera après la destruction du système capitaliste : état, armée, capital, tribunaux, etc. Ce point est essentiellement ardu, car il a pour objet d’envisager la reconstruction, par des directives nouvelles, qui demanderont une entente fraternelle entre les divers points de vue de la réalisation du tout en commun. Les directives nouvelles auront l’efficacité et l’étendue de liberté que sauront leur impulser les individus qui auront eu la bonne fortune de démolir l’outillage de leur oppression, et aborderont la reconstruction sur les bases de notre Idéal, où la Liberté remplacera réellement l’Autorité. Les individus, pour se guider plus sûrement, auront à envisager l’entente des éléments capables d’instaurer la société nouvelle et l’accord à établir sur le rôle que joueront les syndicats, ce qui est un point essentiel. Les tâches particulières seront traitées au fur et à mesure des besoins de la reconstruction, et en application des directives adoptées.
Ce point de vue aura une importance décisive sur la réussite d’application de notre devise : « Bien-être et Liberté » ; c’est pourquoi il faut que cela soit envisagé dès à présent, afin de n’être pas pris au dépourvu au moment propice, et d’éviter, ainsi, les erreurs qui seraient impardonnables, une fois commises. (Nous avons l’étude des lendemains de la révolution russe pour nous guider).
Les syndicats joueront un rôle efficace, si les camarades syndicalistes, anarchistes et coopérateurs veulent bien apercevoir la nécessité, l’obligation, pourrait-on dire, d’avoir à s’entendre pour éviter toute dictature, même par un Etat prolétarien, où la servitude reste toujours à la base, par suite de la conservation de la structure centraliste, dont les directives ont pour résultat l’obéissance et la discipline, par conséquent l’asservissement. C’est cela qu’il faudra éviter à tout prix.
Le syndicat doit être, en cela, d’un fort appui et sera donc très bien à sa place en tant qu’organisme de raccordement, de ralliement, et facteur de répartition pour les transactions et directives prises par l’ensemble des adhérents à la Commune libre, fédérale, régionale, nationale, internationale même.
Ici se pose une explication nécessaire sur le point de savoir pourquoi le syndicalisme est désigné comme facteur, plutôt que l’Anarchie ou le coopératisme. Il n’y là aucune suspicion ni diminution pour l’un et l’autre ; il n’y a qu’une tactique d’opposition plus vigoureuse et plus efficiente contre l’oppression politique, sous quelque forme quelle se présente. Peu à peu, celle-ci perdra de sa force ; ce moment-là marquera son déclin ; mais, en attendant cette disparition, nous aurons à réagir contre les manœuvres des intrigants, des ambitieux, des aspirants à la Dictature.
Le syndicalisme n’étant pas un organisme essentiellement d’affinités, ses cadres permettront plus facilement l’entente entre les individus ; ensuite, il englobera plus facilement tous les travailleurs, tous les individus, par sa structure économique ; de cette façon, nous pourrons plus pratiquement éviter que les humains soient enclins à se plier aux convoitises et aux desseins politiques qui n’auront pas encore tout à fait disparu. Il lui sera aussi plus facile de recevoir les éléments des deux autres groupements : coopératisme et anarchisme ; par conséquent, tous ceux qui luttent pour l’affranchissement, ce qui sera moins praticable dans le seul cadre anarchiste où l’affinité jouera encore son rôle. Cela est à prévoir et ne diminue en rien le rôle définitif et la valeur de l’Anarchisme reconstructif.
La destruction des cadres syndicalistes serait préjudiciable à l’établissement du tout en commun. Ce serait une faute de l’envisager. La politique nous fera une obligation de les conserver pour faire face à la lutte à laquelle celle-ci ne renoncera qu’à l’établissement réel et au fonctionnement normal de la nouvelle société. Ce résultat ne sera pas obtenu du jour au lendemain. Il faudra du temps pour s’y reconnaître et s’orienter à travers le chaos des idées et le fatras des préjugés qu’il faudra vaincre par la raison et une justice qui n’aura rien de commun avec celle qui nous régit actuellement.
Il est à prévoir que les difficultés seraient beaucoup plus grandes pour lutter contre cela dans le seul cadre anarchiste. Poser la question, c’est la résoudre ; sans vouloir, j’y insiste, en quoi que ce soit diminuer la valeur de l’Anarchisme, qui jouera son rôle malgré tout. Mais il serait impardonnable de se leurrer ou, alors, ce serait créer un élément de trouble propice à tous les partis, pour jeter la discorde dans nos rangs, les individus n’étant pas suffisamment éduqués.
Le coopératisme se ralliera certainement, par la force des choses. S’étendre sur ce sujet nous paraît inutile.
Les résultats seront appréciables par le raccordement des trois organismes, avec le syndicat comme facteur de répartition, inspiré de l’idéal libertaire, puisque sans contrainte, il n’y aura nul inconvénient à cela. D’ailleurs, cette nécessité s’imposera suffisamment pour que la question soit envisagée dès aujourd’hui comme moyen de barrer la route à la politique nébuleuse, et toujours confuse. Il est bien entendu que, dans ce ralliement des trois organismes, la plus entière liberté sera laissée aux individus.
Les camarades anarchistes qui se rallient au syndicalisme ont raison d’exposer dès à présent leurs conceptions de reconstruction sociale après la Révolution, au moment de l’établissement d’une société nouvelle. Vous appellerez cela par le nom qu’il vous plaira, anarchie, communisme, fédéralisme, etc. Cela importe peu.
Il est aisé d’apercevoir la lourde faute qui serait commise, si cette entente libre ne pouvait se réaliser ; il en résulterait l’obligation de subir la tutelle des partis autoritaires ou dictatoriaux, conservant Etat, Armée, Tribunaux, Police, Prisons, etc. L’affranchissement serait à recommencer, et l’on envisage avec effroi le retard incalculable pour l’amélioration du sort des spoliés, des asservis ; et cela, pour n’avoir pas su s’entendre sur des points de vue mal étudiés ; cela serait impardonnable, ce ne doit pas être, la raison doit éclairer les individus. Ce qui découle de la vie elle-même doit attirer l’attention de tous pour l’éclosion d’une société où chaque individu sera libre.
Les parias ne peuvent être éternellement le jouet des politico-dirigeants, présents ou futurs, qui tirent profit de nos divisions, que souvent ils fomentent. A nous d’y voir enfin clair, en sachant nous entendre, pour démasquer les ambitieux et les profiteurs.
- AIGUEPERSE
DISCERNEMENT
n. m.
Le discernement est la faculté de distinguer les choses et les personnes, et d’en juger sainement : agir avec discernement ; agir sans discernement. « Chaque homme, a dit Condillac, a assez de lumières pour discerner ce qui est honnête ». Nous serions plutôt de l’avis de La Bruyère, qui pensait : « Qu’après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au monde de plus rare, ce sont les diamants et les perles ». C’est le manque de discernement des individus qui permet, en effet, aux mauvais bergers de conduire le troupeau de façon incohérente ; et c’est toujours faute de discernement que ce troupeau se laisse exploiter et égorger au profit de ses maîtres.
Le peuple, inéduqué, corrompu par des siècles d’esclavage, ne sait pas distinguer ses amis de ses ennemis, discerner le mensonge de la vérité ; il est toujours attiré par celui qui le comble de promesses et de flatteries ; et c’est pourquoi il est malheureux. Pourtant, le peuple est assez vieux pour comprendre, pour savoir, pour connaître. Il est en âge de discerner ce qui lui est utile et ce qui lui est nuisible, d’apprécier ce qui lui fait du bien ou du mal, et de se détacher de tout ce qui l’asservit et le fait souffrir. Il est indispensable que les asservis acquièrent le discernement qui leur manque, s’ils veulent briser leurs chaînes et goûter un peu de bonheur et de liberté.
DISCIPLE
n. m. (du latin discipulus, élève)
Celui qui apprend d’un maître, ou qui s’attache aux doctrines ou aux systèmes d’un autre. Dans l’Evangile, c’est le nom qui fut donné spécialement aux soixante-douze personnes choisies par Jésus-Christ, pour aller prêcher sa doctrine ! (Les disciples de Platon, de Descartes, de Newton, de Jaurès, de Lénine).
Si, en science, le disciple poursuit généralement les recherches du maître qui l’a précédé, en philosophie et plus particulièrement en sociologie, il dénature le plus souvent ses pensées en les interprétant de façon ambigüe. Il arrive aussi fréquemment que des individus se disent les disciples (de tel ou tel homme), sans même connaître ou comprendre la doctrine de celui-ci. En ce cas, les disciples ne sont que des suiveurs ou des croyants qui adorent un Dieu, aveuglément, par fanatisme, par bêtise, par ignorance. Combien sont-ils qui se réclament aujourd’hui de Jaurès, sans savoir seulement ce qu’il désirait, quelles étaient ses opinions, son but, ses vues, ses aspirations, ses espérances, sa doctrine. Ils se disent ses disciples sans même connaître le maître. N’en est-il pas de même pour Lénine ? Il y a, de par le monde, des centaines de milliers d’êtres obscurs qui se prétendent les disciples du dictateur russe, et qui n’ont même pas lu une simple ligne de ses écrits. Ce sont de pauvres religieux, agissant sans discernement, sans raison, et qui sont des proies faciles pour les politicaillons de tous grades et de toutes couleurs.
Les disciples de la vérité sont rares ; car pour la propager, il faut d’abord l’avoir comprise et l’avoir dépouillée de l’amas de mensonges dont elle est entourée.
Fouillons, étudions, cherchons pour grossir notre bagage de connaissances. En réalité, la vérité n’existe pas, ne peut pas exister ; il y a des vérités et il y a des mensonges. On ne peut être le disciple d’un homme, on ne doit pas l’être, si selon la forte expression de Stirner : « Rien n’est pour Moi, au-dessus de Moi ». Prenons, empruntons à d’autres les pensées, les idées qui nous paraissent justes et logiques ; mais gardons-nous, si nous voulons conserver notre personnalité, de nous dire les disciples de quelqu’un, si nous ne voulons être comparés avec raison aux moutons de Panurge.
DISCIPLINE
n. f. (du latin disciplina, enseignement ; de disco, j’enseigne)
La discipline est l’ensemble des règlements qui régissent certains corps et devant lesquels sont obligés de se soumettre, sous peine de sanction, tous les individus. Telle est la définition que l’on peut donner de la discipline, en ce qui concerne les sociétés organisées selon les principes de l’autoritarisme.
La discipline est donc une contrainte et, selon l’importance des institutions où elle s’exerce, elle est plus ou moins sévère. Naturellement, comme dans tout ce qui découle de l’autorité, il y a ceux qui en bénéficient et ceux qui en souffrent. Ceux qui en bénéficient sont ceux qui l’imposent, ceux qui en souffrent sont ceux qui la subissent. « La discipline scolaire, la discipline ecclésiastique, la discipline militaire, la discipline de la magistrature » etc., etc.
L’homme est une victime de la « discipline », il est pris entre ses griffes dès sa plus tendre enfance, dès son plus jeune âge. C’est à l’école qu’elle commence à peser sur ses frêles épaules, et son poids augmente avec les années. Il est évident que l’enfant a besoin d’être conduit, orienté, qu’il est un petit animal inéduqué et qu’il est bon de lui enseigner certaines règles et de réfréner parfois ses instincts naturels. Toutefois, il ne nous apparaît pas que la discipline scolaire puisse atteindre le but qu’elle poursuit, c’est-à-dire : donner à l’écolier, qui sera demain un homme, un enseignement lui permettant d’acquérir de l’ordre et de la méthode, qualités indispensables à la bonne harmonie des sociétés.
La discipline scolaire s’adresse moins à l’intelligence de l’enfant qu’à ses sentiments de crainte et de frayeur et, s’il se courbe devant elle, ce n’est pas qu’il en reconnaisse l’utilité, mais parce qu’il a peur des sanctions qui pourraient résulter de ses infractions.
Par conséquent, l’ordre, le calme qui existent dans une classe ne sont qu’apparents, superficiels et, si l’on pouvait plonger dans le jeune cerveau des élèves, on s’apercevrait bien vite du travail nocif de la discipline.
L’erreur particulièrement profonde de la discipline scolaire est de s’adresser à la collectivité, sans tenir compte du tempérament, de la personnalité des individus qui la composent. « Qu’importe, dira-t-on, puisque les résultats sont obtenus ». Et c’est justement là que l’erreur se corse. Le but — à nos yeux, tout au moins — de l’école, est de faire de l’enfant un homme ; de lui faire comprendre la différence qui existe entre une action utile à la collectivité, à la vie de laquelle il participera bientôt, et une action qui lui est néfaste ; de lui faire distinguer, en s’adressant à sa raison, à son intelligence, le « bien » du « mal », le beau du laid, et de frapper son imagination par des exemples susceptibles d’éveiller en lui l’amour de son prochain et le désir vivace de ne pas nuire à son semblable.
Or, l’école moderne ne remplit pas ce rôle et, loin d’être, pour leurs élèves, de grands frères expérimentés, les maîtres, les professeurs, sont plutôt des caporaux chargés de faire respecter une discipline qui se traduit par des punitions donnant naissance, non seulement à un sentiment de terreur, mais aussi de haine.
Dans certaines écoles anglaises, les infractions à la discipline sont sévèrement réprimées et l’on assiste parfois au pénible spectacle d’un jeune homme de 15 ou 18 ans fouetté pour n’avoir pas respecté les règlements auxquels il était soumis. Quelles influences bienveillantes peuvent avoir de tels procédés ? Aucune, bien au contraire. L’enfant est un terrain vierge qu’il faut savoir cultiver. Ce n’est pas par la brutalité, par la force, par la violence que l’on peut arriver à en faire un homme digne de ce nom, c’est-à-dire qui, dans l’avenir, aidera son prochain à gravir le rude chemin de la civilisation. Au lieu de répondre aux incartades de la jeunesse par des sanctions ridicules et arbitraires, enseignons-lui plutôt à se respecter, à s’instruire, et l’on détruira ainsi les germes mauvais dont elle a hérité et qui ne disparaîtront que si nous voulons sincèrement ne pas faire de nos enfants ce que nous sommes nous-mêmes : des esclaves. (Voir : Education.)
La discipline ecclésiastique repose sur les décisions et les Canons des conciles ainsi que sur les décrets des papes et des princes de l’église. Est-il besoin de souligner que tous les règlements, toutes les lois religieuses édictées pour déterminer la conduite commune des individus n’ont d’autres buts que de protéger le puissant et le riche des révoltes possibles du faible et du pauvre ?
Il est heureux que, de nos jours, l’Eglise ne puisse plus, dans certains pays, entre autres la France, exercer des sanctions contre ceux qui ne se soumettent pas à sa discipline, car elle se distingua, dans le passé, par sa barbarie et sa cruauté. A présent, son prestige a disparu et elle n’exerce plus qu’une puissance occulte de laquelle il faut pourtant se méfier.
On ne peut cependant oublier les crimes dont elle se rendit coupable et l’Inquisition qui régna en maîtresse sur le monde, et plus particulièrement sur l’Espagne, où les bûchers allumés par Torquemada — qui pour son compte personnel a un actif de 120.000 victimes — ne s’éteignirent qu’au XIXe siècle, illustre les bienfaits de la discipline ecclésiastique.
Les premiers inquisiteurs avaient le droit de citer tout hérétique, de l’excommunier, d’accorder des indulgences à tous princes qui extermineraient les condamnés, de réconcilier à l’église, de taxer les pénitents et de recevoir d’eux, en argent, une caution de leur repentir. Nul n’a le droit d’ignorer aujourd’hui les ravages causés par l’Eglise, tout l’odieux de cette discipline déployée pour consolider les privilèges des seigneurs et du clergé, et qui coûta tant de vies humaines sacrifiées pour forger les chaînes de l’esclavage. Et cette discipline terrible était telle qu’elle donna son nom à un fouet composé de cordelettes et de petites chaînes, et l’on vit au XIe siècle des bandes composées de plusieurs milliers d’imbéciles qui parcouraient les villes en se donnant la « discipline », croyant par ces actes ridicules racheter leurs péchés et ceux des autres.
Ces coutumes sont enfouies dans la nuit du passé, et il faut espérer que jamais plus, dans nos pays occidentaux, nous ne serons assujettis à la discipline de l’église.
Hélas ! La discipline militaire a survécu à la discipline ecclésiastique et, de gré ou de force, par la bêtise, par la lâcheté humaines, nous y sommes tous astreints.
« La discipline fait la force des armées » et, à l’armée, discipline est synonyme d’obéissance, de soumission, de respect aux ordres du chef, quels que soient ces ordres et quelles qu’en soient les conséquences.
On a dit sur l’armée tout ce qui pouvait en être dit et si ce n’était que l’on connaisse son rôle, sa discipline nous paraîtrait comique. Notre Molière moderne, Georges Courteline, l’a ridiculisée avec un rare talent, en a souligné les travers, les mesquineries, les petitesses, et l’a marquée au fer rouge de l’ironie. Mais l’ironie n’a tué ni l’armée ni la discipline. C’est que l’armée est la force sur laquelle se repose le capitalisme, et c’est pourquoi elle exige pour tous ceux qui forment ses cadres, qu’ils abandonnent toute personnalité pour devenir des automates animés par un cerveau extérieur, dont les ordres sont infaillibles et indiscutables.
Malheur à celui qui ayant franchi les murs de la caserne, se permet encore d’être un homme ! Avec le costume civil qu’il quitte, il doit se dépouiller de tout ce qu’il sait, de tout ce qu’il connaît, de tout ce qu’il a appris à l’expérience de la vie. Il doit faire le vide en son crâne comme en son cœur, il ne doit plus être lui-même, mais la millionième partie d’un tout, d’un corps immense, d’un corps sans âme, sans idée, sans pensée, qui tourne à droite ou à gauche, lorsqu’on le lui dit, qui mange et qui boit, non pas lorsqu’il a faim ou soif, mais lorsqu’on le lui permet, qui dort lorsqu’un autre le veut bien ; un corps qui n’est qu’un objet semblable au jouet mécanique que l’on donne à un enfant.
Ainsi le veut la discipline militaire, pour que le soldat exécute sans protester les actes criminels qu’il est appelé à accomplir.
Et si, malgré le costume militaire, le cœur continue à battre et le cerveau à penser, alors, la sanction est là, menaçante, et s’abat terriblement sur la victime.
Peut-on mieux faire pour donner une image de la discipline militaire, que de citer l’aventure récente survenue à trois officiers espagnols ?
C’était en 1924. L’Espagne était courbée sous le joug de l’aventurier Primo de Rivera, mais de l’autre côté des Pyrénées, des hommes jeunes, nobles et courageux avaient juré de délivrer le pays du tyran et de son roi. Ils partirent un soir, avec au cœur l’espérance de déclencher la révolution, et de donner à l’Espagne un régime plus conforme aux aspirations de la population. Ils traversèrent la montagne, et s’attaquèrent à des forces tellement supérieures, que tout leur courage ne put suffire, et que leur action fut inutile. Ils furent vaincus. Léonidas et ses 300 Spartiates pouvaient-ils arrêter et triompher de l’armée de Xerxès ? Leur petite armée à eux fut dispersée ; certains moururent dans la batai1le, les autres se perdirent dans la montagne.
Cependant, cette tentative ne fut pas sans soulever l’émotion et la terreur de la réaction espagnole qui demanda à son digne représentant de déférer à la justice les coupables de ce « coup de main ». De coupables on n’en avait pas, il fallait en trouver, et l’on arrêta trois jeunes gens, connus pour leurs idées syndicalistes ; mais qui niaient avoir participé à cette action révolutionnaire.
Ils furent pourtant renvoyés devant un Conseil de guerre, composé de trois officiers. On sait le peu d’indulgence des juges civils à l’égard des révolutionnaires, mais on peut dire que d’ordinaire les peines infligées par ces derniers sont relativement douces, si on les compare à celles que distribuent les juges militaires. Les magistrats siégeant à ce conseil de guerre étaient donc peu disposés en faveur des inculpés ; cependant, devant l’absence totale de preuve, il leur fut impossible de condamner ; ils acquittèrent.
Ces officiers ne connaissaient-ils pas les lois intangibles de la discipline qui ordonnent d’exécuter sans discuter, sans écouter le cœur et la conscience, les actes décidés par les autorités supérieures ? Pour n’avoir pas condamné des innocents, ils furent condamnés eux-mêmes à être enfermés dans une forteresse, et les malheureux acquittés furent renvoyés devant d’autres magistrats qui punirent de la peine de mort, et devant le bourreau qui garrotta. Telle est la discipline militaire. Et encore, dans le fait que nous citons ci-dessus, ce sont des officiers qui se trouvent être les victimes de cette institution cruelle qu’est l’armée, mais lorsqu’il s’agit de simples soldats, les peines encourues sont terribles.
Dans notre douce république, en cette année de grâce 1927, malgré toutes les campagnes entreprises contre les conseils de guerre et contre les bagnes militaires où croupissent et meurent des milliers de jeunes gens dont le seul crime est d’avoir eu un jour un légitime geste de révolte contre la discipline, ces lieux maudits subsistent encore, sans qu’il soit possible d’espérer pour un avenir prochain leur suppression.
Que de crimes sont commis au nom de cette discipline qui est un facteur de désordre, de gabegie, de corruption et de dégénérescence ! Les révolutionnaires sont partisans, eux, de la discipline : les anarchistes la considèrent comme indispensable à la vie en commun des individus. Ils savent qu’aucun groupement, qu’aucune organisation, qu’aucun travail, qu’aucune action ne sont possibles sans discipline.
Mais notre discipline n’est pas la vôtre. Elle ne repose pas sur l’autorité, sur la bêtise et sur l’arbitraire, mais sur la logique. Elle est librement consentie. Etant l’œuvre de l’intelligence, elle n’est pas une contrainte. Elle n’oblige personne à se courber devant elle, elle n’use pas de sanction, elle est libre en un mot et est constituée par l’engagement pris par chacun de respecter une décision prise en commun.
Voilà ce que doit être et ce que sera la discipline, lorsque les hommes, en ayant assez d’être des esclaves ou des serfs, briseront les chaînes qui les tiennent attachés aux institutions criminelles, derniers vestiges d’un passé d’horreur qui ne se perpétue que par la veulerie et l’ignorance des masses populaires.
- J. CHAZOFF.
DISCORDE
n. f. (du latin discordia, formée de dis, séparation et de corda, cœur)
En mythologie, « Discorde » est la divinité malfaisante, fille de la Nuit, et chassée du ciel par Jupiter parce qu’elle suscitait sans cesse des dissensions parmi les dieux. N’ayant pas été invitée aux noces de Pélée et de Thétis, la Discorde jeta une pomme parmi les dieux assemblés, pomme sur laquelle étaient écrits ces mots : « A la plus belle ». Cette pomme fut la cause de la guerre et de la ruine de Troie et des malheurs des Grecs.
La discorde est la division qui existe entre deux ou plusieurs personnes. Une grande discorde, discordes civiles. Elle est la source de toutes les discussions et de toutes les disputes, et c’est avec raison que La Fontaine a dit : « La discorde a toujours régné sur l’Univers. Notre monde en fournit mille exemples divers ».
Peut-il en être autrement en un ordre social où tout est discordant, où rien n’est harmonieux ? Il ne peut y avoir accord entre des éléments qui sont opposés les uns aux autres, et qui sont séparés par une barrière infranchissable. La liberté et l’autorité ne peuvent faire bon ménage ; la richesse et la pauvreté non plus ; la discorde ne prendra fin que lorsque la liberté aura complètement vaincu l’autorité, et que la richesse sociale n’appartiendra plus à quelques-uns, mais à tous.
Les causes et les raisons de discorde ayant disparu, ses effets disparaitront également, et les hommes pourront mener enfin une existence pleine de quiétude et d’harmonie.
DISCUSSION
n. f. (du latin discussio)
La discussion est l’examen, par débat, d’une idée, d’une proposition, d’un problème, et où chacun expose le point de vue particulier qu’il a du sujet soumis à son appréciation. Une discussion peut être calme, animée ou orageuse. Les plus profitables sont celles qui se déroulent dans le calme, car il est plus facile d’y examiner les sujets ou les objets en contestation avec soin. Les discussions orageuses sont d’ordinaire stériles, et on ne peut prendre de meilleurs exemples que ceux que nous offrent les discussions électorales, qui dégénèrent parfois en bagarre, mais d’où ne sort jamais rien de bon.
Les discussions parlementaires qui font l’effet de tant de hâte sont aussi inutiles que les discussions électorales, et il faut le croire, car depuis que se réunissent les corps législatifs, ils n’ont encore élaboré aucune loi qui soit susceptible d’assurer l’harmonie des pays et des nations qu’ils ont à charge de diriger. La discussion seule d’un sujet intéressant est utile, mais il ne faut pas cependant discuter pour discuter et avoir raison. Il coule de source que lorsque l’on discute, c’est que l’on considère son point de vue comme le meilleur, pourtant il faut écouter et examiner les arguments qui nous sont opposés, et ne jamais hésiter à reconnaître ses erreurs. Discuter à perte de vue, par dilettantisme et snobisme est ridicule, et prise dans ce sens, la discussion n’est pas une source d’enseignement et de lumière.
DISPUTE
n. f. (du latin dis, séparat. et de putare, penser)
La dispute est le débat suscité par des opinions contraires, par des intérêts opposés ou des prétentions rivales. Il ne faut pas confondre la dispute et la discussion. La discussion dégénère parfois en dispute ; mais si, lors de la discussion, on cherche à convaincre son adversaire, lorsque l’on arrive à la dispute, on ne cherche plus qu’à le froisser.
« C’est du choc des esprits que jaillit la lumière », dit un proverbe, et il est vrai que l’exposition des idées de chacun est un important auxiliaire du progrès ; mais ce n’est pas au cours d’une dispute que l’intelligence peut se livrer à ses opérations ; il lui faut le calme pour travailler, et non pas l’orage de la dispute.
Malgré ce distinguo que nous faisons entre les mots dispute et discussion, le mot dispute, en dehors du langage courant est souvent employé par les écrivains, et non des moindres, comme synonyme de discussion :
« Quand les hommes éclairés disputent longtemps, il y a grande apparence que la question n’est pas claire. » (Voltaire)
« Elle n’explique rien de ce qui pouvait être en dispute. » (Pascal)
« Nous avions le plus souvent disputé ensemble. » (Molière)
Quoi qu’il en soit, nous ne tergiverserons pas sur la valeur grammaticale du mot. Contentons-nous de dire que, dans l’usage courant, vulgaire que l’on fait du mot « dispute », celui-ci n’est pas synonyme de discussion, mais serait plutôt synonyme de querelle.
DISQUALIFIE
adj.
Ne plus être qualifié pour ; être déchu, déshonoré, être indigne de remplir certaines fonctions. Avoir manqué à ses promesses, à ses engagements ; ne plus posséder l’estime et la confiance de ses semblables. Manquer de qualités requises pour ...
L’homme disqualifié est un individu qui a généralement abusé de l’estime et de la confiance que l’on avait placées en lui, et qui en a profité pour en user à son avantage et à son profit. Hélas ! Avant d’être disqualifié pour être dans l’incapacité de nuire, l’individu fourbe et retors fait bien des victimes, et il est souvent difficile de le dénoncer et de retirer le manteau dont il se couvre, tant est profonde et tenace la crédulité de ceux qui, sincèrement, le défendent.
Ne sont-ils pas nombreux, et surtout dans les milieux politiques, les hommes qui sont moralement disqualifiés, qui se sont disqualifiés en faisant commerce de leurs mandats, en trompant leurs électeurs, en trempant dans toutes les affaires louches susceptibles de leur apporter un quelconque bénéfice, et qui cependant exercent, malgré tout, une influence prépondérante et dirigent encore les destinées d’une nation ?
Le sinistre Poincaré, qui peut à juste titre être considéré comme un des grands responsables de la guerre, ne s’était-il pas lui-même disqualifié aux yeux de tous ?
DIVAGATION
n. f.
Action de divaguer. Primitivement, ce mot était employé pour signaler l’action d’errer çà et là ; mais de nos jours, il signifie l’écart involontaire de la pensée, de la parole ou de l’écrit. Les divagations d’un aliéné ; les divagations d’un poète exalté.
S’il est des divagations inoffensives, il en est d’autres qui sont dangereuses, et les écarts de la pensée, de la parole ou de l’écrit ne sont pas toujours involontaires ; ils sont souvent intéressés.
On peut qualifier de divagations littéraires, les principes, les théories, les idées rétrogrades, développés par certains auteurs ; on ne nous trompe pas ; à nos yeux ces divagations ne sont qu’une marchandise frelatée destinée au peuple qui l’absorbe aveuglément et qui s’en empoisonne. Peut-on considérer comme des divagations, la prose maladive de M. Léon Daudet, le bouffon monarchiste, et les pamphlets haineux de ce politicaillon en mal de dictature, ne sont-ils pas un danger pour la liberté ? Son associé en divagation, Charles Maurras, n’est-il pas également un danger public, un danger social ? Anarchistes, nous ne réclamons pour personne, fussent-ils nos plus terribles adversaires, la répression brutale de la justice, mais dans les maisons de santé, dans les hospices d’aliénés, il est des fous qui sont enfermés, et qui sont certes moins nuisibles que le bouffon Daudet et que son compère Maurras, le « Trestaillon » Maurras, pour lui donner le nom si cher à Urbain Gohier.
Eh oui ! Les divagations de ces êtres nous conduisent tout droit à la guerre extérieure et à la guerre intérieure, et peut-être serait-ce leur rendre service tout en sauvant l’humanité, que de les soumettre à l’analyse du psychiatre. Notre intention n’est nullement de sauver une République qui s’est prostituée et qui asservit à quelques privilégiés, à une ploutocratie inepte, toutes les forces vives de la collectivité ; mais si, anarchistes, nous combattons un régime qui a fait ses preuves, qui a démontré l’incapacité de ses efforts et l’inopérance de ses principes, ce n’est pas pour écouter les divagations de ceux qui espèrent, par la violence, nous ramener à quelques centaines d’années en arrière et nous livrer, pieds et poings liés, à un tyran ou à un despote.
Malheureusement, on ne divague pas qu’à droite, on divague aussi à gauche, à l’extrême gauche, et ces dernières divagations sont peut-être plus dangereuses que les premières, car le peuple les écoute comme des choses sensées. Ils sont nombreux, les fous qui donnent l’impression d’avoir toute leur raison, et il faut du discernement et de la subtilité pour apercevoir la maladie.
N’est-ce pas une divagation que de vouloir supprimer une autorité, pour la remplacer par une autre autorité ? C’est pourtant l’opération à laquelle veulent se livrer certains docteurs en socialisme. Et ils sont écoutés, hélas ; et les malheureux qui les suivent me font l’effet de pauvres fous qui jetteraient de l’essence sur le feu pour éteindre un incendie.
Ce qu’il y a de plus curieux, c’est que les hommes sensés, logiques, raisonnables, n’arrivent pas à se faire entendre, et sont considérés par ceux qui les entourent comme des déséquilibrés.
Ce serait à croire que le monde est un composé de fous ou de demi-fous, et que l’homme sensé est une exception. Car enfin, il est remarquable que les idées les plus saugrenues, les plus erronées, les plus stupides ont toujours trouvé des défenseurs nombreux, et que ceux qui les véhiculent ont bénéficié de l’admiration universelle.
Dites à un individu que pour se libérer du fléau de la guerre, il faut que chaque nation intensifie ses armements, qu’elle construise des fusils, des canons, des monstres marins et sous-marins ; qu’elle se munisse de gaz terribles, capables d’exterminer en une seconde des populations entières, des femmes, des enfants et des vieillards, et immédiatement vous jouirez de la considération de vos semblables, qui vous élèveront une statue et vous proclameront champion de la paix. Mais dites à ce même individu que pour voir disparaître de la surface du globe les torrents de sang qui la rougissent ; pour que jamais plus la main meurtrière d’un homme ne tue un autre homme, pour que jamais plus nous n’assistions au terrifiant spectacle qui nous fut offert de 1914 à 1918, il faut se débarrasser de tous les engins de destruction, il faut jeter dans le creuset la fonte des canons pour en faire des socs de charrue ; alors, il vous dira que vous divaguez, et vous fera jeter en prison comme néfaste et dangereux à la société.
Combien de temps cela sera-t-il encore ainsi ? Qui sait ? La civilisation évoluera-t-elle ; l’humanité est-elle en pleine jeunesse ou retombe-t-elle déjà en enfance ? Dans ce dernier cas, tout est perdu.
DIVERGENCE
n. f.
La divergence est la différence dans les opinions, les sentiments, les idées qui animent les personnes appartenant à un même parti et en acceptent les principes fondamentaux.
On peut, dans une organisation, être d’accord sur une quantité de points et ne pas partager sur certains sujets l’opinion de la majorité ou même de la totalité de ses camarades. Cet écart s’appelle divergence, puisqu’il s’éloigne du point commun.
Les divergences sont inévitables dans toute organisation groupant un certain nombre d’individus, et à condition de n’être pas trop profondes, elles ne nuisent pas à la bonne entente qui doit régner dans toute association ; bien au contraire, les divergences d’idées et d’opinions permettent, au sein d’un parti, d’élever les discussions et d’envisager les solutions possibles à un problème posé.
Si les divergences sont trop nombreuses, alors l’unité est rompue, et toute action collective est impossible ; il est préférable, alors, de dissoudre l’association ou de libérer de leurs engagements celui ou ceux qui se trouvent en opposition avec la grande majorité de leurs camarades. Il faut reconnaître que bien souvent les divergences qui se manifestent au sein d’un parti politique ne sont déterminés que par une basse question d’intérêts, et que les idées ne jouent qu’un rôle secondaire dans les divisions qui éclatent périodiquement au sein de ces partis. Anarchistes, nous n’avons pas à nous plaindre de ces dissociations, puisqu’elles offrent au peuple l’image vivante de ce qu’est la politique et le caractère de ceux qui s’y livrent.
DIVORCE
n. m. du latin divortium, de divertere, se séparer
Le divorce est la rupture des liens du mariage, légalement effectuée du vivant des époux. On a dit que le divorce était aussi ancien que le mariage lui-même. Voltaire a fait spirituellement observer, qu’il avait dû le suivre de quelques semaines. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une affirmation excessive. Il n’y a pas lieu, en effet, de confondre le divorce avec la répudiation telle qu’elle a été pratiquée, dès la plus haute antiquité, chez tous les peuples de l’Orient, et qui consistait en la faculté, pour le mari, de renvoyer sa femme lorsqu’il la jugeait indigne de partager dorénavant son existence.
Il semble que c’est en Grèce qu’a pris naissance le divorce, avec faculté pour les époux de se séparer d’un commun accord, après qu’un magistrat eût apprécié les motifs de leur détermination.
A Rome, la législation distinguait entre le divorce et la répudiation. Le divorce consistait en la dissolution du mariage par le consentement mutuel de l’homme et de la femme. La répudiation consistait en la dissolution du mariage par l’effet de la volonté d’un seul des conjoints : l’homme ou la femme, indépendamment de la volonté de l’autre. La répudiation de la part de l’épouse était légitimée lorsque le mari était convaincu d’avoir voulu la livrer à la débauche, ou d’avoir fait peser sur elle des accusations d’immoralité non fondées, ou bien encore d’avoir entretenu une concubine. On admettait que l’époux répudiât sa femme au cas d’adultère, d’abandon du domicile conjugal, ou de désobéissance. De part et d’autre, la tentative de meurtre était appréciée comme une raison particulièrement grave.
Ces mœurs, d’origine grecque, et qui consacraient, en même temps qu’un respect marqué de la liberté individuelle, une égalité relative des sexes, furent transportées en Gaule avec l’invasion romaine. Mais elles disparurent devant les exigences de la religion chrétienne, qui, non seulement faisait de la monogamie une obligation, mais encore s’inspirait d’un passage des Evangiles pour fonder le dogme de l’indissolubilité du mariage. II est écrit, en effet, dans saint Matthieu, au chapitre XIX, que des Pharisiens, ayant demandé à Jésus s’il est permis à un homme de répudier sa femme pour quelque sujet que ce soit, celui-ci leur répondit qu’il était dans la volonté divine que les époux ne formassent qu’une seule chair, et que l’homme ne doit point séparer ce que Dieu a uni.
Fort de ce texte, le catholicisme condamna le divorce comme un crime, avec pour sanction l’excommunication. Mais, avec la casuistique spécieuse qui le caractérise, il devait l’admettre en fait, quoique d’une façon hypocrite et détournée, pour favoriser, à l’occasion, les desseins de puissants personnages. Henri IV, devenu roi de France, ne pouvait épouser Marie de Médicis, étant uni déjà à Marguerite de Valois. L’Église ne pouvant rompre ce premier mariage par le divorce, ce qui eût été un scandale, tourna la difficulté en le frappant de nullité, c’est-à-dire en déclarant qu’il n’existait pas ! Et tout le monde fut satisfait, sauf peut-être Marguerite de Valois. Grâce à ce grossier subterfuge, le bon roi Henri put reposer la conscience à l’aise, et profiter de la bénédiction du clergé, dans une circonstance qui aurait fait accuser d’adultère et vouer aux flammes éternelles le premier venu des paysans.
Pour les pauvres gens, rivés l’un à l’autre par les chaînes du mariage religieux, l’Église n’a jamais admis, en cas de mésentente, que la séparation de corps, qui est la faculté d’aller vivre chacun de son côté, mais sans que soit dissous le mariage, sans la possibilité, par conséquent, de rechercher le bonheur dans une autre union. Il en est encore ainsi, de nos jours, dans les pays soumis à l’autorité papale : l’Autriche, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la presque totalité de l’Amérique du Sud. Par contre, les nations protestantes : l’Allemagne, l’Angleterre, la Hollande, le Danemark, la Suisse, ont rejeté le rigorisme catholique et adopté le divorce, avec des facilités diverses, dès la Réforme, c’est-à-dire au début du XVI° siècle.
En France il fallut, pour obtenir ce résultat, l’effort libérateur de la Révolution. L’Assemblée législative reconnut le divorce par la loi du 20 septembre 1792, sur la proposition du député Aubert-Dubayet. Il fut autorisé sur la demande d’un seul des conjoints dans chacun des cas suivants :
-
Démence ou folie ;
-
Condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
-
Sévices ou injures graves ;
-
Dérèglement des mœurs ;
-
Abandon pendant deux ans au moins ;
-
Absence sans nouvelle pendant cinq ans au moins ;
-
Émigration.
Mais le divorce comptait beaucoup d’ennemis et, après nombre de débats, le Décret du 20 mars 1803 en réduisit considérablement la portée. Puis le retour des Bourbons annula cette conquête révolutionnaire. Il fut aboli par la loi du 8 mai 1816. Il ne devait renaître de ses cendres que soixante-huit ans après, sur l’initiative d’Alfred Naquet, après sept ans d’efforts parlementaires.
Les lois du 27 juillet 1884 et du 18 avril 1886 ont reconstitué le divorce de la Révolution, mais avec des restrictions regrettables, et tout en laissant subsister la séparation de corps, par égard pour le culte catholique. Avec ces nouvelles dispositions légales, les motifs de divorce reconnus valables sont réduits à trois :
-
Les excès, sévices et injures graves ;
-
La condamnation à une peine afflictive et infamante ;
-
L’adultère.
Le premier motif est laissé à l’estimation du juge. Seuls les deux derniers motifs sont considérés comme péremptoires, c’est-à-dire de nature à faire obtenir le divorce sans difficulté, — ce qui ne signifie point sans frais ni lenteurs — dès l’instant que les faits sont bien établis. Mais si la constatation est aisée qu’une pénalité judiciaire a été prononcée contre un des époux, il n’en va pas toujours de même pour l’adultère et ceci donne lieu à des recherches et expertises à la fois grotesques et répugnantes.
D’abord, il faut distinguer : le flirt, les mignardises, l’essai de prise de possession, certains attouchements risqués, ne sont pas considérés comme péché d’adultère, non plus que les relations homosexuelles ! Et pourtant... Mais passons ! Pour que, du point de vue de la loi, il y ait adultère, il faut qu’il y ait eu consommation de l’acte sexuel entre personnes de sexe différent. Et s’il n’existe pas de documents probants, tels des lettres édifiantes susceptibles d’être présentées comme pièces à conviction, il faut qu’un commissaire de police, muni d’un mandat de perquisition, se rende dans la chambre des amants pour y faire les constatations nécessaires, et dresser procès-verbal de toutes les circonstances utiles. C’est-à-dire qu’il retiendra soigneusement les propos enflammés des coupables, leurs soupirs significatifs, les craquements de leur sommier, s’il a pu entendre, à la dérobée, quelque chose de semblable. La porte ouverte, il notera l’état de désordre de leurs vêtements et de leur chevelure, vérifiera si le lit est défait, s’il est encore chaud et porte l’empreinte de deux corps allongés, si les draps portent des traces intimes, et cœtera...
Bien qu’il s’agisse d’enquête au service d’une loi condamnée par l’Église, cette casuistique malpropre est trop dans le caractère de sa littérature spéciale à l’usage des confesseurs, pour que l’on n’en soupçonne point l’inspiration.
Le divorce, tel qu’il a été rétabli par la République Française, est à part ceci, très imparfait, et conserve la marque de toutes les concessions que le législateur a dû faire aux gens « bien pensants », pour obtenir gain de cause. Il est hérissé d’obstacles. Les démarches en sont excessivement longues et coûteuses. Ici encore, il n’est aucune parité entre les possibilités pratiquement offertes aux riches, et celles mises à la portée des pauvres. La dissolution du mariage par consentement mutuel des époux n’ayant pas été retenue, le divorce français actuel n’est pas la liberté pour l’homme et la femme de se séparer de corps et de biens quand ils le veulent, avec faculté de convoler en d’autres noces. Ce n’est que la libération accordée à l’un d’eux, sur sa demande, en conséquence de certaines fautes graves commises par son conjoint, et sur lesquelles un tribunal doit se prononcer tout d’abord.
Que de complications inutiles et barbares ! Même dans les conditions de la vie sociale actuelle, le divorce pourrait être sans inconvénient, mais avec tout avantage, débarrassé des entraves que lui ont infligées à plaisir des pions paperassiers et de malfaisants « vertuistes ». Dès à présent, l’effort du législateur laïque pourrait et devrait porter exclusivement sur le souci de protéger contre la misère l’épouse et l’enfant abandonnés — car c’est surtout cela qui importe !- et délaisser le souci de préserver, soi-disant, la dignité du mariage par la sauvegarde des apparences et le sacrifice du bonheur d’autrui. Dès à présent, le législateur, pour la plus grande satisfaction de ses contemporains, pourrait renoncer à la poursuite de cette utopie : L’amour dans le mariage et le bonheur des enfants dans la maison, assurés par la contrainte judiciaire. Car l’amour, qui se ressent mais ne s’impose point, se révèle sans préoccupation des articles du Code. Et, pour ce qui est des enfants, si c’est pour eux un très grand bonheur, un incontestable avantage que d’être élevés par des parents unis, il .est cependant pour eux préférable d’être confiés à des éducateurs affectueux, que de rester dans l’atmosphère attristante et dangereuse d’un foyer où l’on se hait.
Jean Marestan
DIVORCE
Le divorce, on peut le définir la porte de sauvetage du mariage. Il est, en effet, un compromis entre l’union libre et le mariage légalement indissoluble. Le divorce est admis en presque tous les pays du monde. Aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Russie, en Suisse, en Norvège, au Danemark, en Belgique, en Hollande, en Grèce, en Bulgarie, au Japon, en France, etc... Dans les pays dominés par le clergé catholique, comme l’Espagne et l’Italie, le divorce n’existe pas encore, mais il ne tardera pas a s’universaliser. Son mécanisme sera toujours plus simple. En Russie, en vertu du décret du 18 décembre 1917, le divorce est devenu une pratique accessible à. toutes, les bourses, et réalisable en peu de jours.
Il semble impossible que le divorce rencontre encore beaucoup d’adversaires, étant donné que le lien matrimonial, quand il est troublé par le dissentiment, la mauvaise santé, etc., se résout en une infinité de malaises pires que la séparation elle-même, aussi bien pour les conjoints que pour les enfants. L’adultère, les scènes continuelles, les crimes passionnels, les drames de la jalousie, et tant d’autres désordres et scandales naissent du fait que beaucoup de femmes sont forcées de vivre avec le mari qu’elles n’aiment pas, à cause des difficultés qu’elles rencontrent pour la revendication de leurs propres droits. En certains pays, la femme séparée-reste légalement soumise au mari et exposée à ses représailles : de l’arrestation pour concubinage à l’interdiction de garder-les enfants auprès d’elle.
Il est ridicule de présenter le divorce comme étant la destruction du mariage, puisqu’il n’est que la fin légale de l’union qui, désormais, n’existe plus. A ce propos, le juriste italien Luigi Miraglia observait (Filosofia del diritto, Naples, 1903, p. 463) :
« Seule, l’union perpétuelle de fait répond à l’idéal ; le divorce, on doit le considérer comme la reconnaissance de la juste fin de l’union pleine ; il commence là où finit l’idéal de l’indissolubilité. »
Le plus curieux, c’est que dans les pays où n’existe pas le divorce, ce sont les femmes elles-mêmes qui, écoutant les prêtres, se dressent contre lui. Pourtant, le divorce serait une libération pour beaucoup d’entre elles. Une statistique sur les séparations de personnes en Italie, en 1897, donnait (abstraction faite des cas de séparations dont les conjoints étaient d’accord), les chiffres suivants : la séparation fut accordée en 206 cas, pour excès, sévices, injures imputables presque toujours au mari. En 18 cas, il s’agissait d’abandon volontaire et, sur ces 18 cas, les deux tiers étaient imputés au mari qui avait quitté la famille. En d’autres cas, la cause est une condamnation du mari. Seulement en une seule des causes de séparation, le tort se trouverait en majorité du côté des femmes, là où il s’agit de tromper la foi conjugale : la statistique officielle cite 47 séparations déterminées par ce genre de mésaventures domestiques, et ajoute que, en 35 .cas sur 47, la faute est du côté de la femme ; mais en tenant compte du fait que la tromperie de la femme, aux termes de la loi, se consomme avec un seul acte, pendant que celle du mari, pour être légalement efficace, doit se traduire en une forme de concubinat, cette dernière exception perdrait toute importance.
L’augmentation énorme des divorces est significative. Aux États-Unis, pays classique du divorce, il est dû à la précocité des mariages. En fait, le recensement de New-York enregistrait 1.600 jeunes hommes et 1.200 jeunes filles de quinze ans, mariés en la seule année 1920. Pendant la même année, 82 garçons et 1.500 filles d’âge non supérieur aux 15 ans, se trouvaient en état de veuvage ou divorcés. En Europe aussi, les cas de divorce sont de plus en plus fréquents, surtout dans les grands centres. Voici une statistique de Berlin :
| Années | Mariages | Divorces | Pourcentage |
|---|
| 1921 | 45.238 | 7.875 | 17,2 |
| 1922 | 47.688 | 7.364 | 15,5 |
| 1923 | 41.519 | 6.781 | 16,1 |
| 1924 | 30.650 | 7.372 | 24,1 |
On pourrait citer d’autres statistiques, pour démontrer que le mariage est en décadence et qu’on va vers l’union libre.
C. BERNERI
DOCTRINAIRE
n. m.
A l’origine, prêtre de la doctrine chrétienne. Depuis 1815, ce mot servit à désigner les politiciens, hommes d’Etat ou publicistes, pensant que l’on peut concilier la liberté et le pouvoir et qui travaillèrent en France à l’établissement d’un gouvernement monarchiste constitutionnel.
Le système des doctrinaires fut mis en pratique par divers ministres de la Restauration, et les adeptes de ce système reconnaissaient comme chef Royer-Collard, qui fut président de la Chambre des Députés.
Bien que peu nombreux, ils exercèrent une influence considérable depuis la chute du premier empire, jusqu’à 1848, et le libéralisme dont ils se couvraient n’était que superficiel et tout politique. En réalité, ils laissent le souvenir d’un autoritarisme étroit, mesquin et brutal, qui coûta la vie à la monarchie et déclencha la révolution de 1848.
Il ne faut pas confondre « doctrinaire » et « doctrinal ». Ce dernier s’emploie surtout pour désigner les conseils, les avis, les jugements des savants sur les questions de morale et de religion.
De nos jours, on se sert parfois du mot doctrinaire pour désigner un homme attaché à une doctrine, et qui la soutient de manière étroite et avec sectarisme.
Adjectivement : Les opinions doctrinaires ; le système doctrinaire.
DOCTRINE
n. f. (du latin doctrina)
La doctrine est l’ensemble des connaissances que l’on a acquises. Elle est ce que l’on croit être la théorie, le système, l’opinion philosophique ou social susceptibles de résoudre, au mieux des intérêts de l’humanité, les grands problèmes de la vie.
On distingue plusieurs sortes de doctrines ; mais, idéologiquement, toutes se réclament du même but : le bonheur spirituel, moral et matériel de l’individu. S’échafaudant sur des considérations particulières et sur des principes contraires, il est facile de comprendre que les diverses doctrines qui s’opposent, empruntent, pour atteindre le but poursuivi, des chemins différents, et qu’elles donnent naissance à des antagonismes qui ne s’éteindront que lorsque la sagesse des hommes aura triomphé de l’ignorance et de la bêtise.
Durant les siècles écoulés, les doctrines les plus remarquables furent celles qui traitaient du déisme et interprétaient Dieu de façon différente. Il y aurait peu de choses à en dire du point de vue social, si elles n’avaient jamais débordé des cadres de la philosophie et n’avaient pas servi de tremplin politique pour asservir le peuple. La doctrine chrétienne, qui depuis si longtemps a envahi l’Europe, traîne derrière elle le boulet des crimes monstrueux qu’elle a engendrés, et s’est définitivement disqualifiée aux yeux de tout homme raisonnable et sensé. Il en est de même de toutes les autres doctrines religieuses qui ont été ébranlées par les coups répétés de l’athéisme, et il est probable que, sous le choc des idées nouvelles, elles disparaîtront bientôt totalement de la surface du globe.
Les doctrines religieuses ont cédé la place aux doctrines politiques, qui, à leur tour, se sont emparées des questions relatives au bonheur de la collectivité humaine et cherchent à améliorer le sort et l’existence de l’individu. Nous connaissons les diverses doctrines politiques qui s’opposent, se combattent, et nous savons aussi que les prêtres des nouvelles religions ne sont ni mieux inspirés ni plus sincères que ceux qui les ont précédés. La doctrine démocratique, la doctrine socialiste, collectiviste, communiste autoritaire, nous semblent aussi incapables de résoudre le problème social, que le furent les doctrines religieuses du passé. Nous avons déjà traité, dans cet ouvrage, de la doctrine collectiviste, communiste, démocratique. Nous traitons plus loin des autres doctrines. Pour nous, anarchistes, nous croyons sincèrement et profondément que seul l’anarchisme « peut assurer à chaque individu le maximum de bien-être et de liberté », et c’est pour voir un jour se réaliser cette espérance que nous luttons avec énergie et que nous propageons notre doctrine qui repose sur l’analyse des nécessités et des besoins intellectuels et matériels de l’homme. Elle est pour nous le flambeau qui doit éclairer et éclairera demain une humanité régénérée.
DOCUMENTATION
n. f. (du latin documentatum, renseignement)
La documentation est l’action qui consiste à appuyer une affirmation, une déclaration, une assertion sur des documents, des preuves, qui en rendent la contestation impossible. Pour faire autorité, il faut que l’on ne puisse contester la valeur d’un document, et que celui-ci soit inattaquable ; ce n’est pas toujours le cas, et il arrive souvent que des faits de très haute importance reposent sur des documents dont l’authenticité est douteuse.
Une bonne documentation est une arme terrible contre les adversaires que l’on veut confondre, combattre et abattre, et en conséquence, elle est indispensable à l’anarchiste, au révolutionnaire qui veut transformer la société bourgeoise. Avec un peu de recherche, de travail et de méthode, elle est relativement facile à se procurer.
L’histoire du passé est un formidable monument où nous avons la possibilité de puiser pour nous documenter sur toutes les erreurs qui ont présidé jusqu’à nos jours aux destinées humaines, et si les individus étaient un peu plus courageux, les documents historiques qu’ils pourraient et qu’ils devraient compulser seraient pour eux une preuve indéniable du mensonge social.
Un bon militant doit donc avoir une documentation solide et irréfutable, afin d’avoir la force et la puissance de démontrer la vérité des opinions et des idées qu’il émet et qui reposent sur l’analyse et l’étude des documents qui sont une preuve accablante pour les maîtres, qui, depuis tant de siècles, asservissent la grande majorité des humains.
DOGMATISME
n. m.
On peut être dogmatique sans pour cela adhérer à une religion ou à une église. Le dogmatique est celui qui se raidit en une croyance, en une vérité déterminée ou en un groupe de vérités (pour lui naturellement) et qui n’admet pas que d’autres en doutent. Le dogmatisme, c’est le père de l’intolérance politique, religieuse et morale. Combien de personnes qui rient et qui sourient des dogmatiques religieux et qui, à leur tour, sont des religieux dogmatiques vis-à-vis du programme de leur parti ! Hier, les jacobins aujourd’hui les communistes autoritaires sont des dogmatiques. Mais aussi parmi les anarchistes, il y a des mentalités bornées, des esprits arides, des présomptueux sans culture, qui prennent à la lettre et en bloc la pensée des auteurs plus ou moins connus, et de valeur, et ne tolèrent aucune critique ; ils ne s’intéressent à aucune élaboration idéologique, à aucun ajournement des données sur lesquelles les théoriciens construisent leurs théories.
Anarchisme et dogmatisme sont inconciliables.
DOGME
n. m. (du grec doghma, formé de dokéo, je pense)
Dans son acception commune, ce mot signifie une opinion imposée par une autorité en dehors et au-dessus de toute critique et de tout examen. Dans la religion chrétienne, le dogme est une vérité révélée par Dieu, et directement imposée, par l’Eglise, à la croyance des fidèles. La révélation est la source du dogme, et son caractère fondamental est l’intangibilité. Le dogmatisme catholique est l’ensemble des dogmes préparés, définis et développés par les Pères de l’Eglise, par les Conciles et par les Papes. Les trois dogmes fondamentaux sont : Jésus, l’homme et Dieu ; Dieu, en une et en trois personnes ; l’homme, tombé à cause du péché, et racheté moyennant la grâce. Le dogme a été la base de l’intolérance religieuse, puisque toute vérité philosophique ou scientifique trouva dans le dogme intangible sa pierre d’achoppement. La vérité étant unique, aucune autre vérité n’est admise. Donc, l’Eglise dit :
« Je suis en possession de la vérité, qui n’est pas avec moi est dans l’erreur. »
Combien de bûchers allumés, combien de sang a fait verser la présomption de l’Eglise, qui, en définitive, n’était que la présomption des prêtres installés sur les dogmes pour guetter toute lumière de vérité nouvelle, afin de l’éteindre ! Au dogmatisme ecclésiastique s’unit le dogmatisme scientifique pendant des siècles. A tel point que saint Thomas, les Conciles, le Pape, infaillibles, eurent comme complice involontaire Aristote, dont les œuvres étaient considérées comme les colonnes d’Hercule du savoir et de la pensée. Avec la réforme de la méthode scientifique, avec l’hérésie religieuse et la critique philosophique, le dogmatisme se confina dans l’Eglise. Puis vint à s’affaiblir l’éclat de l’anathème, qui pendant des siècles avait été la foudre de Rome.
Le positivisme en philosophie, l’expérimentalisme en science ont affranchi la pensée des dogmes religieux et scientifiques. Aujourd’hui, l’homme cultivé ne veut plus croire en aveugle, il demande des explications et il cherche des preuves. Le modernisme est entré dans le corps de l’Eglise, cheval de Troie du rationalisme.
L’histoire de la pensée est l’histoire du dogme et du libre examen en lutte. Et l’histoire nous montre combien de fois le premier étouffa le second en retardant la civilisation.
A près Kant, le dogmatisme a perdu sa bataille.
Allons-nous vers le triomphe de la raison ? Certains courants philosophiques fatigués et les restaurations cléricales imposées par les gouvernements réactionnaires en certaines nations nous laisseraient redouter un nouveau Moyen-âge, s’il n’y avait pas des courants de pensée vifs et riches dans les pays libres, et s’il n’y avait pas beaucoup d’hommes qui ne cessent de lutter contre la tyrannie. Mais s’il est naturel d’espérer en demain, certains que le patrimoine de la pensée ne peut subir les catastrophes des systèmes politiques, nous ne devons pas ignorer combien il est nécessaire d’intensifier la lutte contre le dogmatisme. Le bolchevisme en Russie, la tyrannie jésuitique fasciste en Italie, la dictature clérico-militaire en Espagne sont la preuve que la civilisation ne va pas du même pas que le progrès. Le dogme est là, protéiforme et tenace. Il est là, mais il est en nous aussi.
- C. B.
BIBLIOGRAPHIE
Le Moy. — Dogme et critique, 1903. Ch. Guignebert. — L’évolution des dogmes, 1910. Laberthonnier. — Le dogmatisme moral et « Essais de philosophie religieuse, 1903.
DOGME
Le dogme, en théologie, en philosophie comme en sociologie, est le principe accepté par les individus ou à eux imposé par une église ou une école qui présente ledit principe comme une vérité incontestable et indiscutable. Le dogme est la base fondamentale de toute religion spirituelle, matérielle ou sociale et ce serait une faute grave de penser que seules doivent être considérées comme des dogmes les théories qui puisent leur source dans la révélation divine. Il existe un nombre incalculable d’individus qui se croient sincèrement débarrassés de tous préjugés et qui affirment ne se courber devant aucun dogme et qui, cependant, sont les esclaves d’idées rétrogrades qu’ils se refusent à soumettre à l’analyse et qu’ils soutiennent comme des vérités intangibles et immuables.
Le dogme est, à nos yeux, la barrière qui se dresse devant le regard de l’homme, l’arrête et l’empêche de plonger dans l’obscurité du passé. A l’époque où l’intelligence était encore primitive et où la science n’avait pas arraché à la nature ses nombreux secrets, l’homme fut naturellement entraîné à attribuer à une force et une puissance surhumaines les phénomènes heureux ou malheureux qui le frappaient. La vie elle-même était pour l’individu une énigme et l’esprit humain ne pouvant concevoir l’infini, l’homme se donna, à lui et à tous les objets qui l’entouraient, une cause initiale, déterminante, un commencement, un Dieu créateur duquel émane tout l’Univers et qui dirigea, dirige et dirigera éternellement, selon sa volonté, les destinées du monde.
C’est sur ce dogme, sur ce principe métaphysique, ténébreux, que se sont élaborées, jusqu’au XVIIIe siècle, presque toutes les philosophies.
Cela ne nous surprend aucunement car, même de nos jours, « si loin que portent, dit Sébastien Faure, les prodigieux appareils par lesquels l’optique prolonge le champ d’observation de l’homme de science, la puissance de ces appareils a une limite au-delà de laquelle la constatation fait nécessairement place à la supposition ou au calcul ».
Or, le passé peut être considéré comme un astre éloigné, le plus éloigné de la terre et, forcément, il arrive un moment où la .pensée est obligée de s’arrêter rencontrant devant elle un nuage épais et obscur. Est-ce à dire qu’il n’y a rien derrière ce nuage, que la passé s’arrête là et qu’il n’est pas éternel comme l’avenir ?
L’explication des déistes nous paraît simpliste et ne satisfait pas notre soif de savoir. Rien pour nous ne représente que « rien » et nous ne pouvons pas admettre que ce « rien » est l’ « Etre éternel, infini et puissant » qui a fait toutes choses de « rien », c’est-à-dire de Lui.
Si l’on accepte comme base, comme dogme, l’hypothèse « Dieu », alors rien de surprenant à ce que l’on accepte avec autant de facilité tous les autres dogmes qui en dérivent. Et c’est là que se manifeste le danger de la religion et de ses dogmes.
Le « Dieu » spéculatif des métaphysiciens vit — s’il existe — dans des régions séparées par d’incommensurables distances de celles où se meut la fourmilière humaine. Se suffisant à lui-même, il dédaigne de s’occuper de ce qui se passe sur notre globe terraqué ; il se désintéresse des microscopiques passions qui nous agitent ; il ne se mêle, ni directement, ni indirectement aux rapports établis entre nous ; il ne s’inquiète ni de nos bonnes, ni de nos mauvaises actions. Les abstracteurs de quintessence, les extracteurs de racines cubiques de la Pensée pure, veulent qu’Il soit ; ils se targuent de démontrer péremptoirement qu’Il doit être, qu’il est impossible qu’Il ne soit pas. « Il est, affirment-ils, Il existe, parce qu’Il n’est pas possible qu’Il n’existe pas ». Un point c’est tout.
Il est évident que, présenté de cette façon, le dogme « Dieu » ne nous gêne nullement et nous nous garderons bien de contester, à qui que ce soit, d’avoir une croyance semblable, aussi ridicule nous semble-t-elle.
Mais « Dieu » traîne à sa suite un tas d’autres dogmes et, en premier lieu, celui de l’immortalité de l’âme qui fut enseigné par la presque unanimité des métaphysiciens ; et ce dogme, adroitement exploité par les théologiens, fut peut-être le facteur le plus précieux d’asservissement et de domination sociale. Si, à tous les âges de l’humanité, l’Eglise s’est emparée de ce principe, c’est qu’elle a compris tout l’avantage qu’elle pouvait en tirer au profit du riche et du puissant. Il n’est pas une religion qui n’ait pas, à sa base, l’immortalité de l’âme, de cette âme qui, une fois séparée du corps, quittera la vallée de misères et de souffrances pour atteindre l’idéal, dans la profondeur éthérée des cieux. Les Juifs ont leur « terre promise » comme les chrétiens ont leur paradis et ces Edens ne sont accessibles qu’à ceux qui, durant leur vie terrestre, auront respecté les lois préalablement établies par la bonté, la justice et la sagesse de Dieu.
Quels profits, quels avantages énormes ont su tirer de ce dogme les princes de l’Eglise qui amenèrent habilement les peuples à renoncer aux joies terrestres en leur promettant un paradis céleste ! « Heureux les pauvres d’esprit, le royaume des cieux leur appartient ! », cependant que les grands ne se contentent pas des promesses, jouissent et vivent heureux sur notre boule ronde, spéculant sur la naïveté, la bêtise et l’ignorance des faibles.
Comme l’on comprend bien les raisons pour lesquelles les théologiens se refusent à discuter les dogmes et interdisent aux fidèles de les approfondir. C’est que, à l’analyse, tout s’ébranle, et l’on aperçoit, à la faveur de la critique, l’erreur et le mensonge sur lesquels ils reposent. Quelles que soient, pourtant, les murailles dont on les entoure, les dogmes spirituels, révélés, deviennent de moins en moins dangereux, tendent à disparaître et tout le formidable édifice qu’ils ont construit s’écroulera demain.
C’est que la vie moderne ne s’accorde plus avec le dogme du Dieu tout-puissant et infaillible. Un vent d’athéisme a passé sur les hommes et les exigences de la religion ont éloigné d’elle la plupart des individus. Certes, la croyance en une divinité n’est pas totalement éteinte ; on continue à se livrer, plus par coutume, par cupidité et par besoin, que par foi sincère, à certaines manifestations extérieures, à condition cependant que celles-ci n’entravent pas la marche courante de la vie quotidienne. Quel est celui qui sera assez fou, surtout dans nos contrées occidentales, pour sacrifier une parcelle, aussi minime soit-elle, de son bien-être terrestre, afin d’atteindre aux félicités célestes ? S’il y en a, ils sont peu et leur nombre est insignifiant. L’idée de Dieu n’est plus dangereuse ; le dogme n’est plus qu’une lumière vacillante qui disparaît derrière les flambeaux de la science, et qui va s’éteindre totalement, sous le souffle puissant du progrès. Mais l’Eglise, elle, subsiste, soutenue par toutes les puissances d’argent ; elle ne prétend même plus être un organisme de moralisation, mais avoue être une association politique ; c’est donc comme telle qu’il faut la considérer et la combattre. Il faut la placer parmi toutes les autres associations de conservateurs ; elle forme l’élément le plus puissant de réaction, de conservation et de domination sociale. Ne cherchons donc plus à détruire ce qui fut sa force, mais ce qui est sa force, actuellement, et qui lui permet d’exercer, malgré la faillite de son dogme, une influence colossale sur la collectivité humaine.
Les dogmes de l’Eglise moderne se confondent avec les dogmes des nouvelles religions matérielles, religions politiques, aussi néfastes et aussi nuisibles que les précédentes. Le nationalisme, le patriotisme, le démocratisme sont les dogmes auxquels se sont attachés les hommes d’aujourd’hui et il est aussi difficile de les arracher à leur croyance qu’il fut difficile de faire pénétrer dans le cerveau des anciens religieux une parcelle de raison. Si le christianisme fut, et est encore, l’allié de la classe capitaliste, le nationalisme, le patriotisme et le démocratisme en sont les précieux auxiliaires et les souffrances que ces dogmes ont déterminées, les crimes dont ils ont été la cause sont déjà terriblement nombreux.
La lenteur avec laquelle un individu abandonne un dogme et la rapidité avec laquelle il s’attache à un autre pourrait faire penser que le peuple a besoin d’une religion : c’est, du reste, ce qu’affirment certains philosophes. De là, sans doute, les différents dogmes qui se succèdent les uns aux autres.
A notre sens, c’est l’erreur de toutes les écoles que de croire à la nécessité de remplacer une religion par une autre, sous prétexte que l’homme doit avoir un idéal et un but. Il est vrai que l’individu a besoin d’un idéal, mais celui-ci ne doit pas être dogmatique ; sans quoi, il perpétue un état de chose qui, échappant à l’analyse, maintient l’individu dans l’ignorance et l’esclavage.
« Le dogmatisme est l’opposé de la méthode critique qui part de l’examen approfondi de la faculté de connaître pour aller à la connaissance des objets », a dit J. Aicard. Conservons donc et essayons de développer chez ceux qui nous entourent cette faculté de critique ; ne dogmatisons pas, détruisons les dogmes, tous les dogmes et, lorsqu’il en sera libéré, l’individu s’acheminera à grand pas vers le bonheur et la liberté.
DOMESTICATION
n. f.
Action de domestiquer. « Action d’accoutumer les animaux sauvages à la domesticité » dit le Larousse, qui nous cite le nom des animaux dont la vie est attachée à celle de l’homme. Et, si nous regardons au mot domesticité, nous voyons : « Etat de domestique. Ensemble des domestiques d’une maison ». Hommes et animaux, naturellement, car, pour le bourgeois, le « domestique » n’est ni plus moins qu’une bête de somme, attachée au service de son maître.
« Le premier d’entre les hommes qui jeta une bride sur le cou d’un âne, pour en faire sa bête de somme, et qui mit une livrée sur le dos d’un lâche, pour en faire son serviteur, inventa certainement ce qu’on appelle le principe d’autorité, en créant le domesticisme. » (Farenthuld)
L’homme serait-il inférieur à certains animaux ?
La domestication du tigre, du lion, de la panthère est impossible et la sauvagerie de ces fauves est combien supérieure à l’état de dépendance, de servitude dans lequel vit une catégorie — et la plus nombreuse -d’individus. Comment est-il possible de comprendre que la plus grande partie de l’humanité se soit laissé domestiquer au point d’abandonner sa vie et sa liberté entre les mains d’une poignée de parasites et de privilégiés ? Cela dépasse la compréhension, mais, cela est. L’énorme majorité des hommes se trouve, vis-à-vis d’une minorité, dans une situation inférieure, et consacre son existence à servir cette minorité qui, en échange, lui permet de ne pas crever de faim. Comme travail de domestication, c’est admirable. Le régime de la domesticité évolue ; le servage a succédé à l’esclavage ; le salariat au servage ; l’exploitation reste la même, la domestication domine ; le principe ne change pas.
Et l’on se demande parfois s’il y a lieu de plaindre et non de blâmer ceux qui se livrent ainsi volontairement à la domestication. Les deux peut-être. Certes, l’on peut trouver des circonstances atténuantes aux malheureux qui n’ont pas conscience de leur bassesse et de leur lâcheté. L’atavisme, l’ignorance, la crainte, la faiblesse morale, physique et intellectuelle sont des facteurs de domesticisme ; soit, mais tout de même, en notre siècle de lumière, il n’est pas permis d’être aussi sourd à toute raison et aussi aveugle à tout ce qui se voit. L’ignorance absolue est une preuve de paresse, car chacun, aujourd’hui, aussi faible, aussi dépourvu soit-il, a la possibilité d’acquérir un minimum de connaissances et de lutter contre l’emprise exercée par les maîtres !
Non, ils n’ont pas d’excuses, les domestiques volontaires, les heureux, les contents de leur sort et, si nous ne souffrions pas de leur domestication, il n’y aurait qu’à les laisser croupir dans leur crasse. Mais notre vie est intimement liée à la leur et c’est pourquoi il nous faut continuer la lutte, poursuivre notre œuvre, pour jouir de notre liberté pleine et entière, qui est subordonnée à la liberté de toute l’humanité.
DOMINATION
n. f. (du latin dominatio)
Puissance, autorité. Action de dominer, d’être au-dessus des autres. Pouvoir que l’on a sur les esprits ou sur les corps. Exercer sa domination. La domination de l’âme sur le corps. La domination du roi, du prince, du dictateur.
L’esprit de domination a présidé de tout temps et préside encore à la vie des sociétés. C’est ce qui explique leur instabilité et les luttes continuelles et fratricides que se livrent les hommes.
Etre quelque chose, commander, exercer sa puissance, sa domination sur quelqu’un semble être le moteur de toute l’activité des individus. « Un gueux a un chien pour avoir un être sur qui dominer » a dit Sainte-Foix et c’est, malheureusement, trop vrai.
Depuis le temps que nous souffrons des contraintes qu’ont subies nos pères et que nous subissons nous-mêmes, ne devrions-nous pas être guéris de cette soif de domination ? Quand donc étoufferons-nous au plus profond de nous-mêmes ce besoin de dominer ? L’anarchiste est adversaire de toute domination. Il veut être un homme libre, se refusant d’être esclave, il ne veut pas être maître et, refusant d’être dominé, il ne cherche pas à être dominateur. Ce n’est que lorsque les hommes auront compris qu’eux seuls sont responsables de la domination qui les abaisse et les place en bas de l’échelle sociale que s’effaceront les dominateurs qui étendent leur puissance sur tout l’Univers.
DOUANE
n. f. (de l’italien doana, droit vénitien établi par les doges sur les navires arrivant de l’étranger et sur les charges qu’ils portaient)
La douane est l’administration chargée par un Etat, une nation, de percevoir un droit sur les marchandises qui franchissent ses frontières. Cette institution semble avoir été réglementée en France par Colbert ; elle portait le nom de ferme générale et la douane lui succéda, à la suite du vote du 5 novembre 1790. En décrétant une taxe sur l’entrée des marchandises, Colbert entendait protéger les manufacturiers français contre la concurrence étrangère et leur permettre d’écouler leurs produits sans craindre d’avoir à lutter contre ceux venant du dehors. Les conséquences fâcheuses de cette réglementation ne tardèrent pas à se faire sentir. Si la taxe fut une source de revenus pour l’Etat, au point de vue social ce fut un désastre. Ne craignant plus la concurrence, le manufacturier ne chercha pas à améliorer et à perfectionner ses moyens de production, et le prix des marchandises livrées aux consommateurs augmenta dans des proportions fantastiques. Mais, cela importait peu ; le capitalisme, naissant avec l’industrie, se défendait déjà nationalement à cette époque, quelles que soient les souffrances qui en résultaient pour le peuple. La douane continua à fonctionner et, le 15 mars 1791, le premier tarif uniforme et unique fut établi, frappant toutes les marchandises entrant en France et en sortant.
Depuis, ces tarifs ont été modifiés à différentes reprises et, actuellement, en France, les droits de douane se divisent en droits ad valorem et en droits spécifiques. Les premiers sont calculés en proportion de la valeur des marchandises importées et à raison de tant pour cent ; les seconds, d’après la nature et la quantité des produits.
L’élaboration des tarifs douaniers nécessite d’interminables conversations diplomatiques et l’on peut dire que jamais les intérêts de la population n’entrent en jeu au cours de ces discussions. C’est toujours l’esprit de Colbert qui préside l’institution : défendre le capitalisme national contre le capitalisme étranger.
Dans un quelconque pays, le peuple peut littéralement crever de faim. Mais son gouvernement ne permettra pas l’importation du blé sans frapper ce produit d’une taxe, si le producteur national est incapable de livrer le blé au même prix que son concurrent étranger. La douane n’a qu’un unique but : permettre au commerçant, au paysan, à l’industriel de vendre cher une marchandise qui pourrait être livrée au consommateur à meilleur marché. Le commerce est un vol en soi mais le tarif douanier permet au commerçant d’être un affameur et de devenir un meurtrier.
Nous avons déjà dit, en traitant le mot « concurrence » que certaines nations ne vivaient que de l’exportation de certains de leurs produits et que, lorsque des frontières leur sont fermées, en raison des taxes prohibitives qui frappent les marchandises, elles sont obligées d’en chercher l’écoulement d’une manière ou d’une autre ; et nous ajoutions que, lorsque la diplomatie n’arrivait pas à régler les différents qui s’élevaient entre deux capitalismes nationaux, c’est la guerre, la boucherie, le sacrifice de millions d’hommes qui en décidait.
Tous les traités commerciaux de nation à nation sont basés sur les tarifs douaniers, et les gouvernants de chaque pays cherchent naturellement à acquérir, pour ceux qu’ils représentent, le plus de quiétude et d’avantages possibles.
A mesure que se développent l’industrie et le commerce, les régimes douaniers deviennent plus prospères et cela est une conséquence logique de l’évolution capitaliste. Nous voyons des pays qui, avant la guerre, pratiquaient le « libre échangisme » sur une large échelle, prendre, à leur tour, des mesures prohibitives contre les produits étrangers, afin de permettre à leurs nationaux d’écouler des produits qu’ils ne peuvent fabriquer à des prix avantageux. Les populations travailleuses sont les premières victimes de cet état de choses ; mais cela importe peu, le seul souci des gouvernants étant d’assurer, non pas le bien-être des masses ouvrières, mais les privilèges de la bourgeoisie.
Il arrive parfois que, lorsque la spéculation devient trop insolente, un gouvernement, effrayé de la rumeur populaire, lève les droits qui frappent certaines denrées et permettent l’importation libre. Mais, en général, ces mesures ne sont que provisoires et superficielles et ne sont prises que pour donner un semblant de satisfaction à la population. Le commerçant sort toujours victorieux et, lorsque l’apaisement et le calme sont revenus, les tarifs sont remis en vigueur et la comédie continue.
Il n’y a pas lieu d’espérer réformer cette institution qui pèse si lourd, sans même qu’il s’en rende compte, sur les épaules du travailleur. La douane n’est qu’un effet, c’est la cause qu’il faut détruire et cette cause, c’est le capitalisme.
N’en est-il pas, du reste, ainsi de toutes les institutions qui nous oppriment et nous oppressent ? Comme le militarisme, la justice, la magistrature, la douane est un moyen de défense, une arme au service de la bourgeoisie et elle ne disparaîtra qu’avec elle.
DRAGONNADES (Les)
On désigne sous ce nom les persécutions exercées contre les calvinistes, entre 1685 et 1715, et qui furent ordonnées par le Roi-Soleil : Louis XIV. Elles débutèrent sitôt la révocation de l’Edit de Nantes qui, rendu en 1598, par Henri IV, mit fin aux guerres de religions en accordant aux protestants la tolérance des places de sûreté et l’autorisation de se livrer à l’exercice de leur culte.
Les défenseurs du « grand siècle » ou plutôt du « grand roi » prétendent que celui-ci céda à l’influence pernicieuse de Mme de Maintenon et des Jésuites en organisant les Dragonnades. Il est possible que la veuve de Scarron, qui se prostitua au monarque pour échapper à la misère qui la menaçait et qui devint plus tard la reine « morganatique » de France, dévorée d’ambition, dénuée de scrupules, ait poussé son « auguste » maître au massacre des protestants pour faire oublier ses attaches passées avec les calvinistes ; mais cela n’excuse pas les crimes dont Louis XIV conserve toute la responsabilité.
En supprimant, un à un, tous les droits consentis aux protestants, en poursuivant une politique de rigueur et d’arbitraire, Louis XIV devait plonger fatalement ses mains dans le sang. Lorsque, après près de cent ans de paix intérieure, le 17 octobre 1685, l’Edit de Nantes fut définitivement révoqué, la guerre civile recommença. Les protestants fortunés quittèrent le pays, transportant leurs industries sur des terres plus hospitalières. Mais l’exil n’était pas permis à tous et ceux qui restèrent furent contraints de subir la violence dont ils furent écrasés.
Afin d’établir l’unité religieuse et convertir les protestants, sur le conseil de Louvois, on ne trouva rien de mieux que d’envoyer en garnison chez les adeptes de la religion réformée, des soldats de cavalerie, alors appelés dragons, qui se comportèrent, chez leurs hôtes forcés, de façon abominable. Tout leur était permis. Assassinant les hommes, frappant les enfants, violentant les femmes, ils répandirent la terreur et la crainte et, pour échapper à l’obligation de les loger, un certain nombre de protestants se convertirent. Cependant, dans les Cévennes, la cruauté et l’intransigeance de l’intendant Basville déchaînèrent la révolte. Les Camisards, ainsi appelés car ils portaient, pour se reconnaître, une blouse blanche, semblable à une chemise, prirent les armes pour défendre leur indépendance religieuse et leur liberté. La lutte fut rude. En 1702, on envoya contre eux le maréchal de Montrevel ; mais, celui-ci ne put les réduire. En 1704, ce fut le maréchal de Villars qui arriva à les soumettre en traitant avec un de leurs généraux, mais la plupart des chefs périrent dans les supplices plutôt que de se rendre.
A côté des dragons, faisant leur triste métier de soldats, en se livrant à des atrocités sans nom, on vit des hommes d’Eglise montrer, dans cette lutte religieuse, une férocité sans précédent. Des prêtres, des moines, s’organisèrent (en vertu d’une Bulle du Pape Clément) et participèrent au carnage, à côté des troupes royales. Tout était bon pour réduire le protestant. On enrôla des voleurs de grand chemin qui pillèrent et rançonnèrent leurs victimes et l’on peut dire que, dans l’histoire criminelle de Louis XIV, les dragonnades sont les pages les plus terribles et les plus sanglantes.
Après dix ans de lutte inégale et de sacrifices sans nombre, le courage des protestants dut céder devant la force et la puissance de l’adversaire ; ils furent vaincus. Mais, de nos jours encore, malgré le recul de l’histoire, dans certaines contrées du Midi, on conserve, vivace, la haine du catholique, qui se transmet de père en fils. Les cicatrices creusées dans le corps des protestants par les dragons du roi, ne se sont pas encore refermées et, dans les petites villes et villages des Cévennes, durant les longues soirées d’hiver, on raconte aux enfants les souffrances endurées par les ancêtres.
L’histoire a des revirements ; dans certains pays du monde, la nouvelle religion s’est imposée et elle dirige à présent les corps et les esprits. En Angleterre, par exemple, le pasteur est tout puissant ; le protestantisme a triomphé. Est-ce en souvenir de la barbarie exercée par les catholiques que le peuple anglais reste indifférent au supplice que subit le peuple irlandais ? Nous savons, certes, que derrière le manteau religieux duquel se couvrent certains politiciens, il y a autre chose ; mais en façade, la guerre entre l’Irlande et l’Angleterre est une guerre religieuse et le peuple anglais devrait, lui, si fier de sa « liberté », comprendre que d’autres ont droit à une « liberté » au moins égale.
Toutes les religions se valent et n’engendrent que la pauvreté et la misère. Les dragonnades de Louis XIV se manifestent sous un autre nom de nos jours encore. Il y a dix ans à peine, les pogroms organisés en Russie par le gouvernement et exécutés par les cosaques n’étaient pas autre chose que des dragonnades. Et même, dans des contrées qui se targuent d’avoir atteint le plus haut degré de civilisation, on assiste encore parfois au massacre de nègres, dont le seul crime est d’avoir une couleur de peau différente de celle des Yankees.
Quand donc les hommes comprendront-ils qu’assez de sang a coulé, que la terre en est inondée et qu’ils doivent pratiquer enfin un peu d’amour et de fraternité ?
DRAPEAU
n. m. (du latin drappellum, formé de drappus, drap)
Le mot drapeau servait primitivement à désigner la pièce de drap utilisée pour emmailloter les enfants en bas-âge et que l’on nomme aujourd’hui lange. Par la suite, il devint synonyme de chiffe, de vieux morceau d’étoffe ou de linge : « Un marchand de viels fers et drapeaux » et désigne enfin, de nos jours, la pièce d’étoffe que l’on place au bout d’une lance et qui sert à distinguer, par ses couleurs, les nations ou les partis.
Mais, qu’importe le mot ; l’usage du drapeau est très ancien puisque déjà les douze tribus d’Israël avaient chacune des enseignes de couleurs différentes, munies de signes particuliers.
S’il n’est pas considéré comme un Dieu, le drapeau peut être de quelque utilité. Il sert de marque de ralliement et peut être utilisé pour faire des signaux, etc. Mais, à nos yeux, c’est à peu près là toute son utilité. Notre point de vue n’est, malheureusement, pas partagé et le drapeau est autre chose que ce qu’il devrait être, que ce qu’il est : un vulgaire morceau de chiffon que l’on promène au bout d’un bâton.
La grande majorité des hommes voient dans le drapeau le symbole de leurs partis, de leurs nations, de leurs dogmes et en font une telle idole qu’ils lui rendent des honneurs particuliers et se font parfois tuer pour lui. Ce ne serait qu’un demi-mal s’il n’obligeaient pas tous leurs semblables à se livrer comme eux à leurs ridicules pratiques.
Le culte du drapeau s’exerce partout ; il est une divinité devant laquelle on se courbe et auquel on rend des hommages publics. Certains lui vouent une vénération et une adoration passionnées.
Le drapeau a ses églises et ses prêtres. Chaque nation a ses drapeaux et, en France, il y en a un par régiment qui porte, outre le numéro de son régiment, la devise Honneur et Patrie, le nom des quatre principales victoires inscrites dans les annales du corps. Le drapeau est déposé, généralement, dans la salle d’honneur du régiment et, lorsqu’on le sort ― pour lui faire prendre l’air, sans doute ― il est porté par un officier, lieutenant ou sous-lieutenant, et entouré de sa garde, qui est composée d’un sous-officier et de quatre soldats de première classe, choisis par le colonel.
Quand vous apercevez un régiment et son drapeau, prenez une autre route, si votre intention n’est pas de lui rendre les hommages qui lui sont dû ; car, sans aucun doute, il se trouvera, parmi la foule d’imbéciles et de goujats, un être assez stupide pour vous découvrir de force. Ne manquez pas de respect au drapeau si vous désirez conserver votre liberté, car toute insulte à cette loque vous conduirait devant les tribunaux. C’est un Dieu, comme tous les autres Dieux, et il faut y croire ; il représente tout le passé sanglant et sa gloire est d’avoir fait périr sous ses plis des millions de jeunes gens pleins de force et de vie.
Avant 1789, le drapeau français était blanc ; un décret du 30 juin 1790 interdit les étendards de cette couleur et on leur substitua le drapeau tricolore : bleu, blanc et rouge. Le drapeau blanc symbolise, en France, à l’heure actuelle, la monarchie ou sert, en temps de guerre, à indiquer que l’on demande une trêve et que l’on désire parlementer.
Chaque parti politique ou secte philosophique a également son drapeau, ses emblèmes, ses étendard. Le drapeau rouge qui, « en vertu d’un décret de l’Assemblée Constituante, devait être déployé chaque fois que l’on proclamait la loi martiale et qu’on se préparait à dissiper un rassemblement par la force des armes » est devenu, plus tard, le symbole de la « Révolution ». Les socialistes l’adoptèrent et les communistes autoritaires également. Les uns et les autres le prostituèrent dans la politique et s’il est arrivé dans le passé, que le peuple se battit autour de lui, actuellement, il n’est plus qu’un torchon comme les autres qu’on idolâtre et qui sert à tromper et à asservir le peuple.
Le drapeau rouge a ses fanatiques tout comme le drapeau tricolore et on se livre devant lui aux mêmes mouvements, aux mêmes simagrées et les profanes sont également menacés par le troupeau populaire lorsqu’ils refusent, en certaines occasions, de se livrer à l’adoration du nouveau Dieu.
Les anarchistes ont également un drapeau. Il est noir. Les anarchistes sont les seuls qui voient en lui, non pas un symbole, mais un morceau de chiffon qui sert à rallier tous les camarades au cours d’une promenade ou d’une manifestation. Ils remplaceraient tout aussi bien ce drapeau par une pancarte ou tout autre ustensile, mais un drapeau porté bien haut est plus pratique et se voit de plus loin. Il leur arrive de le défendre, non pas qu’ils pensent qu’un mètre de vieux tissu vaille la peine de se battre et de coûter la vie à des camarades, mais parce que ce n’est jamais à leur drapeau qu’on en veut, mais à leurs idées. Bien que n’ayant pas le culte du drapeau, les anarchistes sont néanmoins les plus courageux et les premiers à attaquer et à se défendre lorsqu’ils sont brutalisés physiquement et moralement par les forces de réaction ; c’est qu’ils donnent à chaque chose sa juste valeur, que ce ne sont pas des religieux qui dépensent leur « énergie » à adorer des images, des statues ou des drapeaux.
Au figuré : Être sous les drapeaux signifie : être au service militaire. Se ranger sous les drapeaux de quelqu’un : se mettre sous la direction politique de quelqu’un ; joindre son parti ; mettre son drapeau dans sa poche : cacher ses opinions politiques ou philosophiques ; planter un drapeau : partir de quelque part sans payer ce que l’on doit.
DROIT
n. m.
Dans la plupart des langues, et plus particulièrement dans toutes les langues aryennes, la notion de justice est liée à celle de la rectitude. La ligne droite est regardée comme le symbole du bien. C’est ainsi que du sanscrit argu (droit au physique et au moral), dérivent les mots arguta (droiture, honnêteté), et arguya (droit, honnête). La même application se retrouve dans les langues germaniques et celtiques. En Anglo-Saxon, les mots reht, riht, aujourd’hui right, expriment à la fois au propre l’idée de ligne droite, au figuré l’idée de droiture, d’honnêteté, de justice. En Allemand, il en est de même de la racine reht, aujourd’hui recht.
« Droit » vient du mot latin « directum », participe passé du verbe dirigo, dont le sens précis est « mettre en ligne droite », par exemple, dans l’expression dirigere aciem, ranger une armée en bataille (en ligne droite). Directum, dans le sens figuré, signifie ce qui est conforme aux lois. Ce mot, comme d’ailleurs le verbe rego dont il est issu, contiennent aussi l’idée d’ordre, de commandement. Du verbe rego est également issu le mot latin regula, qui a, au propre et au figuré, les mêmes acceptions que le mot règle, en Français.
L’idée de droit, dans l’origine grammaticale même du mot, se confond aussi avec l’idée d’une règle imposée par une force ou une autorité supérieure. Pour exprimer cette idée, les Latins employaient, de préférence au mot directum peu usité, le mot jus, qui provient du verbe jubeo, je commande, j’ordonne. Du mot jus sont venus les mots français : justice, jurisprudence, etc.
Le Droit, si l’on s’en tient à l’origine grammaticale du mot, est donc un ordre, un commandement, une règle, qui s’imposent aux individus. Nous verrons plus loin qu’il n’était pas sans intérêt d’insister sur cette origine.
Le mot « Droit », nous disent les jurisconsultes modernes, peut être pris dans deux grandes acceptions différentes.
« Si l’on se place au point de vue objectif, le Droit désigne l’ensemble des préceptes, règles ou lois qui gouvernent l’activité humaine dans la société, et dont l’observation est sanctionnée au besoin par la contrainte sociale, autrement dit par la force publique. »
Le Droit objectif, dans les sociétés modernes, est, en général, unique pour tous les individus appartenant à une même communauté politique. C’est ainsi, par exemple, que l’on dira : le Droit français, le Droit allemand, le Droit italien, etc.
« Dans le sens subjectif, le mot droit désigne les facultés ou prérogatives appartenant à un individu et dont il peut se prévaloir à l’égard de ses semblables dans l’exercice de son activité. »
Chaque genre de faculté ou prérogative constitue un droit déterminé, par exemple le droit de propriété, le droit de puissance paternelle. À chaque droit de l’individu, correspond un devoir légal, c’est-à-dire une obligation de respecter le droit, et qui s’impose à tous les autres individus. Le mot droit, dans ce sens subjectif, implique donc l’idée d’un pouvoir accordé à l’individu.
Le droit, dans les deux sens qui viennent d’être précisés, suppose l’existence de groupes d’hommes ou sociétés humaines, mettant au service des individus la force collective pour faire respecter les droits de ceux-ci (sens subjectif), et imposant à tous leurs membres, l’observation du Droit (sens objectif). Sur l’origine et l’évolution des sociétés, on trouvera dans d’autres mots de l’Encyclopédie, notamment au mot « Société », les développements qui n’ont pas leur place ici. Nous plaçant en présence du fait de la contrainte sociale, nous bornerons nos explications à analyser d’une manière plus complète, l’idée de Droit, à en rechercher l’origine, et à en retracer l’évolution générale, enfin à en déterminer les diverses divisions ou formes dans nos sociétés modernes.
L’idée de droit, avons-nous dit, implique la contrainte. Nous n’avons eu en vue que le Droit dit positif, celui qui est obligatoire en vertu d’une loi écrite ou non écrite. Mais on prend souvent le mot « droit » dans une acception beaucoup plus large.
Les jurisconsultes romains définissaient le droit « ars boni et œqui », la science du bien et du juste, définition qui, ainsi qu’on l’a fait remarquer, n’est guère qu’une tautologie ; il faudrait, en effet, définir ce qui est bon et juste, et c’est là où commencent les difficultés. Aristote disait « la décision du juste est ce qui constitue le droit ». Au XVIIIe siècle, Montesquieu, dans l’Esprit des lois, définit le droit « la raison humaine en tant qu’elle gouverne le monde », La Commission de l’an VIII, chargée de la rédaction du Code civil (voir ce mot), avait inséré dans son projet, un article premier, qui disparut dans la rédaction définitive comme constituant une simple déclaration de principes, et qui disait : « Il existe un Droit universel, immuable, source de toutes les lois positives : il n’est que la raison naturelle, en tant qu’elle gouverne tous les hommes ».
Ces diverses définitions s’appliquent à ce que les Juristes appellent le Droit naturel par opposition au Droit positif. Il y aurait une législation antérieure et supérieure à tout droit positif, et dont la loi écrite aurait pour tâche de se rapprocher aussi exactement que possible, étant d’autant plus parfaite qu’elle ressemblerait plus fidèlement à ce modèle. C’est à cette législation idéale que font allusion les philosophes et les jurisconsultes de Rome. L’idée du droit naturel s’harmonise d’ailleurs avec les doctrines de Rousseau, inspiratrice de la génération révolutionnaire, lesquelles représentent l’homme comme investi, par le seul fait de sa naissance, de droits inhérents à sa personnalité, identiques dans tous les temps, et sous tous les climats, et ne supportant d’autres limitations que celles qu’il a consenties lui-même dans le pacte social sous certaines conditions, et en vue de certains avantages déterminés. (Voyez ci-dessous : Droits de l’homme.)
La grande difficulté reste toujours de déterminer ce qui est ou non conforme au Droit naturel. En philosophie, en morale, en science sociale, les conceptions des hommes sont essentiellement variables suivant les époques ; elles dépendent des transformations de toute sorte que produit l’évolution des sociétés. Pour une même époque et dans un cadre social déterminé, ces conceptions s’éloignent les unes des autres, presque toujours sinon toujours pour de profondes raisons économiques. Dans cette confusion, dans ce chaos d’idées, dans cette multitude de projets de réforme, de conceptions morales ou sociales, où trouver le Droit naturel ?
Eût-on admis, au moment de la rédaction du Code civil, qu’un individu pût être condamné à payer des dommages-intérêts à un autre même en l’absence de toute faute ? Une semblable conception eût semblé à nos pères destructrice de tout ordre social. L’évolution économique et les découvertes modernes ont créé, en matière d’accidents du travail, par exemple, la théorie du risque professionnel, qui elle-même peut-être, sera remplacée un jour par une autre ; et la matière de la responsabilité civile est depuis quelques années l’objet d’une remarquable évolution de la jurisprudence.
Ainsi, ce qui, il y a un siècle à peine, eût paru contraire au bon sens, prend place aujourd’hui dans la législation ou dans la jurisprudence. Comment pourrait-on, dans ces conditions, émettre la prétention de rédiger un Code « des lois de la nature », modèle dont devraient s’inspirer les législateurs de tous les temps et de toutes les nations ?
Il est évident que, sous cette forme, le « Droit naturel » constitue une notion au premier chef antiscientifique ; les jurisconsultes contemporains ont eu raison de la soumettre à une sévère critique.
Il y a dans un groupe social parvenu à un stade d’évolution déterminé, des tendances ou des désirs de progrès ou de transformation qui, au travers de bien des obstacles, malgré des résistances souvent violentes et sanglantes, influent plus ou moins sur l’évolution même du Droit. Si l’on veut donner à ces tendances, à ces volontés de transformation, le nom de Droit naturel, il n’y a là qu’une question de terminologie, et l’on pourrait n’y voir aucun inconvénient grave. Mais le sens exact du mot « Droit naturel », est tout différent. Il tend bien à désigner un corps de préceptes « cautionnés par la raison humaine », et servant de modèle aux législations. Il n’y a pas à ce point de vue de Droit naturel. Nier le Droit naturel, ce n’est pas nier la raison humaine, mais c’est reconnaître son imperfection. C’est aussi nier les prétendus principes naturels (droit divin, droit monarchique, droits des peuples), au nom desquels dans le cours de l’histoire, on a poussé les hommes à s’entretuer, les peuples à se combattre et à s’exterminer ; c’est nier la légitimité des tyrannies, qu’elles reposent sur l’idée divine ou sur un prétendu consentement des individus d’un groupe familial ou social, quel qu’il soit.
Mais s’il n’y a pas de droit naturel, disent les juristes, il y a une science qui s’appelle la morale, et qui a des rapports très étroits avec le « Droit ». Nous ne nous hasarderons pas ici à définir la morale (voir ce mot), encore moins a rechercher si la morale est une science. Mais en considérant sous ce vocable l’ensemble des idées ou des préjugés qui ont cours à une époque déterminée en ce qui concerne la conduite que chaque homme doit tenir vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis de ses semblables, on peut se demander avec les commentateurs de nos Codes, si le Droit se rapproche de la morale, et dans quelle mesure il doit se confondre avec elle. On déclare en général, que le Droit, à mesure que les sociétés progressent, tend à se confondre avec la morale. Ce qui est à l’origine simple obligation morale, dans nombre de cas, se transforme peu à peu en obligation légale ; les devoirs moraux de l’individu envers lui-même n’échappent pas, dit-on, à cette évolution. Pour une raison ou pour une autre, par exemple dans un intérêt d hygiène publique, des obligations de plus en plus nombreuses sont imposées à l’individu en ce qui concerne sa manière d’être ou d’agir vis-à-vis de lui-même.
Cette doctrine pourrait paraître consolante si elle était toujours exacte. Mais, malheureusement, elle est trop souvent démentie par les faits historiques. Sans passion, sans phraséologie déplacée dans un Dictionnaire encyclopédique, citons quelques exemples. Le droit de propriété ― dont nous ne recherchons ici ni l’origine ni la légitimité ― ne sert-il pas à couvrir les plus formidables spéculations, les profits de guerre ou de paix les plus scandaleux, les renversements de fortune les plus extraordinaires ? On nous a appris, dans notre jeunesse, que la propriété avait sa base légitime dans le travail ― travail de l’individu ou travail de ses ancêtres. ― Et il se trouve que dans les secousses et dans les drames de l’histoire, ceux qui ont « travaillé » ou dont les ancêtres ont « travaillé » sont un jour ruinés ; d’autres, par le fait d’un hasard heureux, et sans aucun effort, sans aucun travail, souvent sans avoir même eu la peine de prendre une initiative quelconque, se trouvaient brusquement enrichis des dépouilles des premiers. La loi intervient pour légitimer, pour sanctionner, pour rendre obligatoire la situation nouvelle. Est-ce donc que la « propriété » des premiers était illégitime ? Mais, en l’admettant, comment prétendre légitimer le changement ?
Fortunes détruites, souvent de ceux qui, à tort ou à raison, ont cru faire acte de bons citoyens pendant les crises subies par leur pays ; fortunes énormes créées, au profit de ceux qui souvent se sont soustrait à toutes les obligations sociales, et que le hasard a servis ! Tous ces scandales, si nombreux au cours de l’histoire, et que les années que nous venons de vivre ont si tragiquement éclairés, heurtent violemment la « conscience publique ». Ils s’aggravent parfois, et plus particulièrement dans ces dernières années, du fait que le déséquilibre économique a permis aux spéculateurs et aux profiteurs d’augmenter encore leurs richesses par une véritable fraude organisée, par la violation de lois qui ont été, à tort ou à raison, considérées comme essentielles au salut public, telles que celle sur l’exportation des capitaux, par une campagne systématique et victorieuse contre tout essai de gouvernement dont les tendances pouvaient leur paraître suspectes, tandis qu’au contraire, ces manœuvres et ces campagnes pouvaient pousser au désespoir et à la révolte, en les acculant à la famine, non seulement les classes laborieuses, mais celles des anciens petits et moyens possédants, de ceux qui avaient apporté à l’État leur or en même temps que le sang de leurs enfants.
Situation émouvante et combien révolutionnaire ! Les partis qui prétendent défendre l’ordre, la morale, la foi due aux contrats et aux engagements de la nation, se croient obligés de protéger de toute leur puissance la horde des aventuriers et des financiers qui entendent sauvegarder les situations maintenant acquises, et tout cela au nom du Droit. Les notions les plus élémentaires de ce qu’on appelle la « morale » sont violemment heurtées, et l’esprit public, au spectacle de cet ignoble bouleversement, s’habitue à penser qu’il n’y a plus ni lois sociales ni lois morales contre l’audace servie par le hasard, et contre les plus cyniques spéculations ; chaque individu s’efforce d’arracher une part du butin et, sous des formes plus hypocrites sans doute qu’il y a quelques milliers d’années, mais avec un égoïsme et une brutalité encore accrus, la lutte pour la richesse et pour la jouissance remplace tout autre sentiment dans le cœur de l’immense majorité des hommes. Le Droit, qui couvre et qui protège cela, est bien le contraire et non l’auxiliaire de la morale.
Assurément, l’on peut répondre que la législation, à la suite des grandes crises comme celle de la guerre de 1914, aurait pu et dû suivre une évolution différente ; mais le fait historique reste : si de beaux discours ont été prononcés, aucun parti n’a eu le courage de définir et de proposer les mesures nécessaires : ces mesures étaient impossibles sans doute, à moins de renverser les notions les plus fondamentales du « Droit » actuel, à moins de créer un droit nouveau. Elles dépassaient les hommes de gouvernement qui, dans le déséquilibre économique, cherchent, par les vieux moyens et par les vieilles combinaisons à échapper à leurs redoutables responsabilités. Elles exigeaient non seulement de l’audace, non seulement de la clairvoyance, mais peut-être du génie. Rien de tout cela n’est venu, et l’édifice social, en même temps que la vieille morale populaire, restent fortement ébranlés, alors, que le droit règne et que les tribunaux continuent à juger...
Mais il n’est pas nécessaire de se placer dans les périodes de cataclysmes sociaux pour voir combien sont fragiles parfois les notions reçues sur les rapports du droit et de la morale. Les exemples abondent, de situations de droit qui s’éloignent de plus en plus de la « morale » reçue. Toujours en considérant le droit de propriété, que les jurisconsultes, en le définissant, proclament absolu et perpétuel (il comporte la faculté de détruire), il est facile de voir que les principes admis, tels que celui-ci : « Le propriétaire du sol est propriétaire du dessus et du dessous » peuvent aboutir et aboutissent souvent, à des conséquences contraires à la morale, nous allions dire au bon sens. Les progrès scientifiques et économiques conduisent l’humanité à utiliser de plus en plus les richesses du sous-sol ; or, la notion de propriété individuelle ou de propriété familiale à l’origine et pendant de longs siècles, repose sur la culture du sol par l’individu ou par le groupe familial ; nous sommes bien loin de la morale lorsque nous prétendons attribuer à ce propriétaire, la jouissance des richesses minières peut-être néfastes à I’ humanité, peut-être aussi nécessaires éventuellement à son existence et à son salut, enfouies dans les profondeurs du sol, jusqu’à la limite la plus lointaine que les outils de l’homme puissent atteindre !
J’entends bien que l’usage et l’exploitation des mines sont réglementés d’une manière spéciale par les diverses législations. Il n’en reste pas moins que le principe juridique aboutit dans les faits aux conséquences les plus inacceptables, les plus révoltantes. Si le hasard ou la chance peuvent enrichir, le jurisconsulte peut ne pas avoir à s’en préoccuper s’il borne son rôle à l’étude des règles imposées sous le nom de lois par le corps social ; mais il serait impuissant à mettre d’accord le « Droit » et la « morale » dans le sens vulgaire que nous avons laissé à ce mot.
Si le Droit s’écarte trop souvent de la « morale », peut-on, avec les philosophes anglais des deux derniers siècles, le fonder sur l’idée d’utilité sociale ? Ici, encore, et sans nous étendre, nous sommes obligés de faire les plus grandes réserves. Que le Droit doive se conformer à l’utilité sociale, qu’il y ait ou qu’il puisse y avoir un Droit naturel fondé sur l’utilité générale, et par conséquent variable suivant les temps et suivant les milieux, contrairement au « Droit naturel » tel que le définissait Montesquieu, certains peuvent l’admettre ; nous persistons à penser que, même sous cette forme nouvelle, la notion que nous avons critiquée plus haut ne peut être admise. Mais, nous voulons nous placer uniquement au point de vue du Droit positif et, à ce point de vue, il faut bien constater que Droit et utilité sociale, dans toutes les législations anciennes ou modernes, ne se confondent pas, et même s’opposent dans un grand nombre de cas. Les règles de droit ont été trop souvent créées pour l’intérêt d’une petit minorité, ou pour l’intérêt d’un seul, et non pour l’utilité générale. Elles ont trop souvent servi de moyen d’oppression aux prêtres de toutes les religions, et aux monarques. Ici encore, les exemples viennent en foule à l’esprit. Trop souvent aussi, et encore à l’heure actuelle, les règles de droit ont pour seul fondement et pour seule raison d’être, les plus grossiers préjugés de la foule, sans aucun profit pour l’ordre social et même contrairement à l’intérêt social, bien entendu. C’est ainsi que l’interdiction ou une réglementation mauvaise du divorce, bien loin de fortifier le lien familial, peuvent, à certains stades de l’évolution sociale, en introduisant dans les relations familiales non seulement entre époux, mais entre parents et enfants, des causes de haines et de violences, en empêchant de régulariser des situations que la société aurait intérêt à légitimer et à maintenir, constituer une sérieuse atteinte à « l’utilité générale ». Les préjugés religieux ou sociaux de toute nature traduits en lois vont la plupart du temps à l’encontre du bien général, ou même de l’ordre public. Chacun de nous peut en trouver d’innombrables exemples dans son expérience de tous les jours.
Dans la société, telle qu’elle est organisée de nos jours, l’utilité générale devrait donner pour premier devoir au législateur, la protection de l’hygiène ou de la santé publique. Il est interdit, par les ordonnances de police, de jeter des papiers dans les rues, ou de secouer les tapis après une certaine heure. Mais le plus grossier des préjugés permet à un individu physiquement taré, de procréer des êtres chargés d’hérédités morbides, voués à la maladie ou à la folie, incapables d’aspirer à ce qui peut être le bonheur de la vie. L’opinion se révolte ‘e0 l’idée d’une règlementation qui, dans l’état actuel de l’évolution sociale et de notre législation, ne pourrait guère constituer qu’une intolérable tyrannie. Et le préjugé triomphe de la notion la plus élémentaire de morale, et d’utilité générale.
On peut donc conclure, sans plus amples développements, qu’il n’y a, à l’origine ou à la base du droit, comme en constituant l’essence même, ni un principe dé morale, ni un principe d’utilité, ni même parfois un principe d’ordre social. S’il en est ainsi, les règles du droit ne peuvent trouver leur explication que dans leur origine historique, et nous sommes ainsi amenés, laissant de côté l’analyse de l’idée de droit, à en retracer l’évolution. Nous ne le ferons qu’à grands traits, et au moyen de quelques exemples. L’origine et l’histoire du Droit (sens objectif), c’est l’origine et l’histoire des collectivités humaines. L’histoire des droits (sens subjectif), c’est l’histoire des diverses institutions ayant existé au sein de ces collectivités : famille, propriété, mariage, obligations, responsabilité civile, etc., etc. On trouvera sous chacun de ces mots, les indications d’ordre historique concernant ces institutions.
On a lu, d’autre part, au mot « Code », un aperçu de l’évolution des diverses législations. Nous n’y reviendrons pas.
On peut affirmer que, d’une manière générale, les sociétés antiques n’ont pas eu la notion du droit individuel. Les groupes familiaux ou sociaux obéissaient à un certain nombre de règles transmises par la tradition et qui avaient un caractère religieux plus ou moins prononcé. Toute révolte contre ces préceptes était une révolte contre la divinité, punie de mort le plus souvent. Et ces préceptes avaient pour principal objet d’assurer la domination d’une caste, d’une famille, celle du chef de famille ou du chef de tribu. Cette domination est absolue : dans la famille antique, aussi bien à Rome et en Grèce qu’en Orient, le chef a sur tous les membres du groupe, le droit de vie et de mort : la femme, le fils même majeur, n’ont aucun droit. En Grèce, dans beaucoup de villes, la vente des enfants a été permise jusque sous l’empire romain, dans les premiers siècles de notre ère.
Partout, l’institution de l’esclavage a créé une classe d’hommes placée hors la loi. Le chef a droit de vie et de mort sur ses esclaves, comme sur les membres de sa famille. Ce n’est que très tard, que ce droit est soumis à des restrictions que l’usage avait peu à peu introduites dans les mœurs. II est plus intéressant de vendre sa propriété, que de la détruire. L’esclave est une richesse, et lorsque les relations contractuelles se multiplient entre les familles ou entre les individus, lorsque les échanges deviennent de plus en plus nombreux, l’idée de la valeur prépare les esprits à des mesures de protection que vient après coup colorer le prétexte humanitaire.
Le vieux cadre juridique s’est peu à peu modifié, avec le développement des relations économiques : le rôle de l’individu s’est accru, et il a été nécessaire, au moins dans les rapports nécessaires avec lés membres des autres groupes familiaux, de lui conférer des droits. D’autre part, la cité s’est constituée, elle a peu à peu englobé par la conquête les peuples plus faibles, et l’individu-citoyen s’est trouvé aux prises avec une puissance plus forte, plus tyrannique : celle de l’État, dont il a cherché à obtenir le maximum d’avantages. Ainsi s’est formée et a évolué la notion du droit individuel ; retracer cette évolution, les luttes qui ont opposé l’être humain à l’oppression collective, ce serait faire l’histoire de l’humanité. Il n’est pas discutable que les hommes ont aujourd’hui un sens très aigu de ce qu’ils pensent être leur « droit individuel », et qu’à ce point de vue, un immense changement s’est produit peu à peu. L’individu s’est libéré de plus en plus, grâce à la Réforme, de la puissance religieuse. Les révolutions politiques du XVIIe et du XVIIIe siècle, lui ont permis de se libérer pour une part de la puissance « laïque ». La conception des droits de l’homme se formule d’abord dans les écrits des philosophes, ensuite dans les « Déclarations » et les « Constitutions modernes ». Nous n’y insistons pas ici. (Voir le mot Droits de l’Homme.)
Le droit moderne, encore aujourd’hui, conserve la forte empreinte de la notion primitive. Ainsi, la règlementation de la famille, dans notre Code Civil, n’est que l’énumération des pouvoirs du chef : puissance paternelle, puissance maritale, ce sont les mots mêmes que nos législations continuent d’employer. Sans doute les jurisconsultes nous affirment que ces institutions existent surtout dans l’intérêt des incapables : il devrait y avoir alors dans la loi, une règlementation des devoirs en même temps que la règlementation des droits. Sans doute aussi les pouvoirs du père, du mari, du tuteur, se trouvent restreints par des dispositions législatives lorsqu’il s’agit de l’administration des biens. Mais précisément, l’on voit ainsi que, préoccupée avant tout de la protection et de la conservation de la propriété des « biens », la loi laisse dans l’ombre la personne même, le droit de l’individu. Par exemple, le chapitre de la tutelle, dans notre Code civil, règlemente en détail l’administration des biens du mineur dans une série d’articles ; rien n’est prévu en ce qui concerne les devoirs du tuteur, relatifs à l’éducation à l’instruction de son pupille. C’est d’une manière tout à fait arbitraire que les tribunaux interviennent dans certains cas, et font droit à des réclamations ou à des demandes qui ont pour objet de réprimer des abus : ils ne le font d’ailleurs qu’avec une prudence extrême. Les « droits du père de famille » doivent être respectés ; une grande ligue s’est même constituée avec ce titre. Sous une forme plus atténuée, avec l’hypocrisie d’une civilisation en apparence moins brutale, plus douce aux faibles, le cerveau des hommes conserve la notion barbare : celle de l’autorité du chef, du maître.
Nous n’avons parlé du droit familial qu’à titre d’exemple. Il serait facile de montrer, en prenant l’une après l’autre toutes les branches du droit, toutes les formes de l’activité sociale, que le droit aujourd’hui comme Il y a deux ou trois mille ans, n’est que la désignation des coutumes, des routines et des préjugés qui gouvernent l’intelligence des hommes, dans la mesure où ces coutumes et ces préjugés sont rendus obligatoires par la loi. Ces coutumes soumettent l’être humain à une contrainte que ni le sentiment de la justice, ni l’idée d’utilité générale très souvent ne peuvent expliquer ou justifier ; elles ont pour origine la volonté du plus fort, la crainte ou le mystère des forces naturelles qui ont engendré la superstition religieuse.
De ces coutumes, de ces préjugés, les uns constituent pour les hommes des habitudes auxquelles inconsciemment ils se soumettent ; d’autres sont sanctionnées par les lois, sans que l’on puisse parfois s’expliquer la raison pourquoi dans un cas l’obligation légale existe, et non dans un autre. Mais lorsque la loi prétend aller à leur encontre, elle reste la plupart du temps inefficace : les Romains disaient déjà « Quid sine moribus vanœ leges proficiunt ? » À quoi servent de vains textes de lois, s’ils ne sont pas imposés par les mœurs ? Et de fait, il serait facile de donner une longue énumération des textes, et même des réformes législatives considérées comme capitales, et qui ne sont restés qu’à l’état de formules théoriques, dans toutes les législations (ex. en France, certaines lois sur l’assistance).
Assurément, certains préjugés s’affaiblissent avec le temps. L’influence des superstitions religieuses diminue en apparence tout au moins. C’est ainsi que l’Église catholique, après avoir créé toute une législation qui avait pour objet d’assurer sa domination sur les familles (droit canon) s’est vue concurrencée par les progrès du pouvoir civil. En matière de successions, de mariage, d’organisation de la famille, après de longues luttes, la législation civile a fini par s’imposer tout au moins dans notre pays. Le mariage est devenu un acte civil, enregistré par l’autorité publique. Il a fallu, pour imposer aux prêtres le respect de la nouvelle législation, des dispositions pénales que l’Église considère encore aujourd’hui comme la violation de ses droits, et qu’elle présente audacieusement comme la violation des droits de la conscience. Le prêtre, sous peine de s’exposer à des poursuites correctionnelles, ne peut pas procéder à un mariage religieux sans que le mariage civil l’ait précédé. Mais, jusqu’à ces dernières années, des fanatiques, abusant de l’ignorance des « futurs époux » n’hésitaient pas à violer la loi ; il y en a encore des exemples. La sphère de la loi civile s’étend cependant peu à peu, tandis que sans rien abandonner de leurs principes, les représentants des superstitions défendent âprement ce qu’ils osent appeler la liberté, c’est-à-dire les moyens de domination que l’ignorance et la crainte leur avaient laissés pendant de longs siècles. Parfois arrivent-ils à trouver des appuis imprévus. Des associations qui se prétendent dégagées de l’esprit du passé mettent par exemple à l’ordre du jour de leurs réunions ou de leurs congrès, la question de savoir s’il est ou non légitime de priver les congréganistes du droit d’enseigner. On discute pour savoir si un mari peut imposer à sa femme, si la religion de cette dernière s’y oppose, un divorce. Et beaucoup de braves gens, qui se croient très libéraux dans le bon sens du mot, demandent, sous prétexte d’apaisement, que le curé puisse rentrer à l’école pour y donner son enseignement, ou bien que les subventions de l’État soient accordées aux œuvres catholiques d’assistance et d’enseignement, comme aux écoles publiques.
Mais l’Église a cependant perdu du terrain dans la lutte. Elle n’a peut-être réussi à conserver ce qui lui reste d’influence sur la législation, sur le droit (nous ne nous plaçons qu’à ce seul point de vue), qu’en favorisant ou même en provoquant, au cours des siècles, les luttes meurtrières entre les peuples. Avant et pendant l’abominable tuerie de 1914, elle est restée indifférente au malheur universel ; elle seule a retiré des avantages réels de cette immense catastrophe. Elle n’a même pas renouvelé le geste symbolique de l’archevêque de Paris, montant sur les barricades aux journées de juin 1848, pour demander la cessation de la lutte. Son autorité morale, même sur la masse des fidèles se trouve atteinte. Son domaine diminuera...
Mais si le préjugé religieux voit s’affaiblir son influence sur l’évolution du droit, il reste tous les autres, et le législateur est obligé de compter avec eux. Combien superficielle et vaine, cette grande distinction entre le Droit écrit et le Droit coutumier que les jurisconsultes placent à la base même de la science du droit. Non seulement le droit a été coutumier à l’origine, mais il reste aujourd’hui encore essentiellement coutumier, malgré l’arsenal législatif qui s’augmente chaque jour. Nous avons vu plus haut que beaucoup de lois restaient à l’état de lettre morte. Mais la loi reste impuissante à régler tous les rapports de droit. Elle édicte des principes généraux que la coutume (ou si l’on veut la jurisprudence), applique en suivant l’évolution même de la société ou les passions du temps. Le Code civil a été rédigé à une époque qui ne connaissait pour ainsi dire pas la machine, qui ignorait les chemins de fer et l’automobile. C’est cependant encore aujourd’hui, en matière de responsabilité civile, et sauf la législation du travail, les textes de 1914 que l’on applique il des situations inconnues au moment de leur rédaction. Mais, par exemple, les dangers qui résultent du développement sur nos routes et dans les grandes villes d’une circulation intense, amènent peu à peu la jurisprudence à une interprétation de ces textes qui admet la responsabilité de plein droit du conducteur d’une voiture automobile pour les accidents causés à un tiers, interprétation à l’heure actuelle en voie de formation, et qui était contraire à celle admise jusqu’ici. Le texte est cependant resté le même.
On dira que les lois peuvent avoir plus de précision, et avoir l’ambition de régler tous les cas auxquels elles entendent s’appliquer. Il est bien certain que nos lois contemporaines sont infiniment plus complexes, plus touffues qu’autrefois. Par le jeu des amendements et des sous amendements, les parlementaires cherchent à introduire dans les lois en préparation, toutes les dispositions qui peuvent donner satisfaction aux intérêts (ou aux préjugés), de telle ou telle catégorie de leurs électeurs.
A la différence de nos grands Codes, la loi contemporaine a pour caractéristique de chercher à prévoir et à régler dans le détail la matière qu’elle traite. Y a-t-il là un progrès ? Pour ma part, je ne le crois pas. Il n’en résulte qu’une énorme confusion et comme, malgré tous les efforts et toutes les prévisions, le législateur reste impuissant à deviner à l’avance toutes les hypothèses qui pourront se présenter dans la pratique, l’incertitude subsiste pour chacun, le plus souvent, sur l’étendue de ses droits et de ses devoirs. C’est donc encore ici la coutume qui règle la plupart des situations juridiques, car l’interprétation littérale des textes n’est guère qu’un prétexte à l’adoption des solutions que les préjugés ambiants font naître.
Si l’on envisage notre ancien droit français, notre manière de voir se justifie encore mieux. L’ancienne France était divisée en pays de droit écrit et pays de coutume. Cette division juridique, correspond assez exactement à une division géographique. Les provinces du Midi constituaient le pays de droit écrit, où l’influence romaine avait persisté au travers du Moyen Âge, où le droit romain était en principe en vigueur. Les provinces du Nord étaient, au contraire, régies par les coutumes, qui varient de province à province et souvent de localité à localité. (Il y avait plus de 360 coutumes.) Mais, même dans les pays de droit écrit, le droit romain avait reçu presque partout, des modifications plus ou moins profondes en vertu des usages locaux et de la jurisprudence des parlements. D’autre part, l’ordonnance royale de 1453, ordonna la rédaction par écrit des coutumes. En réalité, le Droit est resté jusqu’à la rédaction de nos Codes, constitué essentiellement par des traditions, soit d’origine germanique, soit d’origine romaine, adaptées plus ou moins aux nouvelles conditions sociales.
Depuis la promulgation de nos Codes, nous ne reviendrons plus sur ce point ; une évolution progressive en a quelque peu modifié l’esprit dans beaucoup de parties. Mais il faut tenir compte aussi de l’existence, au-dessus de la loi écrite, d’un certain nombre de principes, dits « adages de droit » pour la plupart venant des jurisconsultes de Rome, et dont la jurisprudence tient encore aujourd’hui le plus grand compte, soit pour interpréter les textes, soit pour les compléter. L’autorité de ces vieux principes juridiques est restée entière ; autant au moins que le texte de nos Codes, il constituent la base même de la culture juridique et de l’enseignement de nos Facultés de droit. Il semble que le droit dit écrit, du d’une manière plus exacte le droit « promulgué », ne puisse s’en écarter. C’est la coutume, c’est la tradition, qui gouverne le monde.
Nous venons, avec la distinction entre le Droit coutumier et le Droit écrit, d’entamer l’étude des diverses divisions du « Droit », toujours considéré dans le sens objectif du mot. Il nous reste à donner une très rapide énumération de ces divisions. Nous pourrons ainsi avoir une notion plus exacte de ce qui constitue aujourd’hui le « Droit ».
La première de ces divisions est celle du Droit national et du Droit international. Dans la civilisation antique, nous l’avons vu, la notion du droit individuel n’est pas encore née. Les règles du droit, coutume, tradition, préceptes religieux ne s’appliquent qu’aux membres du groupe social. Vis-à-vis de l’étranger, il n’y a pas d’autre règle que la loi du plus fort : c’est l’état de guerre. Dans la terminologie romaine, le même mot désigne, tout au moins au début, l’ennemi et l’étranger : hostis. Avec l’évolution économique, se forme peu à peu la notion de principes juridiques applicables à l’étranger, notion sans laquelle toutes relations commerciales et tous échanges eussent été impossibles. Ainsi naît ce que les historiens du droit romain appellent le jus qentium (droit applicable entre les gentes ou groupes familiaux), par opposition au jus civile, applicable aux seuls citoyens romains. Le contrat de vente, par exemple, fait partie du jus qentium. C’est l’origine du Droit international.
La loi, en principe, n’étend son autorité qu’aux limites du territoire de l’État. Mais elle oblige dans ces limites tous les individus qui se trouvent sur ce territoire. Quelles sont les dispositions dont les étrangers pourront réclamer le bénéfice ; quelles sont celles dont seuls les nationaux pourront se réclamer : c’est le problème de la condition civile des étrangers (voir ce mot), et c’est la première partie du Droit international.
Le Droit International règle aussi les rapports contractuels ou de famille, entre nationaux et étrangers ; quelle sera la loi applicable dans tel ou tel cas déterminé ? Les législations des divers pays le précisent ; souvent aussi, la solution est indiquée par des traités internationaux.
Le Droit international règle enfin les conditions de forme et de fonds des conventions passées à l’étranger par des nationaux, et l’exécution hors des limites d’un État des sentences rendues par les tribunaux.
Tout ce que nous venons d’indiquer fait partie de ce qu’on appelle le Droit international privé, qui concerne les intérêts privés des individus. Mais il y a aussi un Droit international dit public, qui règle ou qui est censé régler les rapports entre nations au point de vue de leurs intérêts généraux. C’est cette partie du Droit que l’on appelle souvent le Droit des gens, le Droit entre les nations (jus intergentes). Le Droit international public contient les traités ou conventions intervenus entre les États : traités de paix, traités de commerce, conventions d’arbitrage, etc. Le Droit n’est ici, sanctionné que par des organisations qui ont été jusqu’ici impuissantes à empêcher les nations de se jeter les unes sur les autres, et de se massacrer pour faire triompher leur « bon droit » à l’appel de leurs gouvernants civils ou militaires, monarques ou parlementaires. Nous ne voulons même pas effleurer ce sujet qui dépasse le cadre de cette étude. Le Droit international public contient aussi ce qu’on appelle le Code des lois de la guerre. Les « usages de la guerre » ont fait l’objet de conventions internationales (conventions de La Haye, etc.). Ils sont d’ailleurs outrageusement violés dans chaque conflit, par tous les belligérants, chacun d’eux accusant le voisin d’avoir pris l’initiative de cette violation. La barbarie change de forme ; elle s’entoure de prétextes ; la guerre d’autrefois opposait l’homme à l’homme, comme dans la forêt primitive où la bête cherchait sa nourriture. La guerre d’aujourd’hui organise et autorise le massacre en masse, par tous les moyens que la science peut avoir trouvés, pour faire respecter, ô ironie, le prétendu Droit des peuples. Les « usages et les règles de la guerre » pèsent bien peu dans la tourmente, et nous l’avons bien vu, pendant cinq ans, des deux côtés de la tranchée.
Le Droit national, celui qui ne régit qu’une nation déterminée, se divise aussi en Droit public et en Droit privé.
Le Droit public est celui qui règle la constitution de l’État, et ses rapports avec les individus. Il comprend notamment le Droit constitutionnel, qui se réfère à l’organisation générale de l’État, le Droit administratif, qui règle l’exercice des diverses fonctions de l’État et, en particulier, la gestion de ses intérêts dans ses rapports avec les particuliers, enfin le Droit pénal ou criminel, qui réprime par la peine infligée à l’individu certains actes que la loi considère comme constituant une atteinte plus ou moins grave à l’ordre public, une violation plus ou moins grave de ses dispositions.
Nous examinerons au mot « peine », tout ce qui concerne l’évolution historique de cette partie du droit. Nous voulons seulement noter ici que la sanction de l’obligation que crée le Droit est tantôt une sanction civile, par exemple la nullité de l’acte juridique intervenu entre deux individus contrairement au Droit, et tantôt une sanction pénale ; il y a aussi des lois qui sont dépourvues de toute sanction, par suite d’un oubli volontaire ou non du législateur.
Le Droit privé est celui qui règle les rapports de particulier à particulier. Il contient, par exemple, tout ce qui est relatif à l’organisation de la famille et de la propriété. Le Droit privé contient aussi les règles applicables aux conventions entre particuliers. Dans toutes les législations, la violation de ces conventions est sanctionnée par la loi ; c’est en ce sens que l’on dit que la convention, ou contrat, est l’une des sources des obligations. La convention tire donc sa force de l’appui que lui donne la société. Cet appui cesse parfois pour des raisons bonnes ou mauvaises d’opportunité ; c’est ainsi que les conventions peuvent être annulées dans certains cas. Des circonstances exceptionnelles, comme celles nées de la dernière guerre, ont amené le législateur à permettre aussi la révision de certains contrats (baux, marchés commerciaux, etc.). Mais, d’une manière générale, la loi, dès les débuts des premières civilisations, intervient pour obliger les particuliers à exécuter ce qu’ils ont promis ; l’inexécution entraîne même dans certains cas la sanction pénale (exemple : délit d’abus de confiance). À l’origine, d’ailleurs, la loi se contente d’autoriser le cocontractant à user de la force. Le débiteur peut être emmené en esclavage ; il peut même être mis à mort (Loi des Douze Tables). Notre législation a connu très tard encore, jusqu’au dernier siècle, la contrainte par corps, c’est à dire la prison pour dettes. La contrainte par corps n’existe plus dans la loi française, que pour les paiements des amendes ou des dommages intérêts prononcés par un tribunal répressif. L’exécution sur les biens à remplacé l’exécution sur la personne, mais la loi intervient ; avec l’appui de toute la force sociale, pour assurer le respect de la convention.
Il y a, dans le Droit privé, ce qu’en langage d’école, on appelle les dispositions impératives et les dispositions supplétives. Une partie importante du Droit privé consiste à régler l’élaboration des actes juridiques et des contrats. Certains actes juridiques, certains contrats même (ex. le mariage) sont réglementés par la loi d’une manière impérative. Les conventions qui règlent des intérêts privés sont, au contraire, en général libres. La loi, en ce qui les concerne, ne contient que des dispositions applicables dans le silence des contractants.
Le Droit privé comprend lui-même le Droit civil, applicable à tous les citoyens, ou des institutions applicables soit à certaines catégories de citoyens, soit a certaines situations particulières (droit commercial, droit industriel, droit rural, etc.). Mais ces divisions sont quelque peu arbitraires. L’évolution économique peut même les rendre incompréhensibles. Ainsi, l’on a voulu donner aux commerçants un Code spécial, et des tribunaux spéciaux. On a considéré que les contrats commerciaux, conclus plus fréquemment, plus rapidement que les contrats entre particuliers, devaient être assujettis notamment au point de vue de la preuve, à des règles moins strictes que les contrats civils. Mais il se trouve que le développement des affaires a rendu d’un usage constant, en matière commerciale plus encore qu’en matière civile, l’écrit, pour constater une convention de quelque importance. On a voulu faire juger les commerçants par des hommes connaissant mieux, dit-on, les usages du commerce. Et cependant, les tribunaux civils sont appelés à juger, eux aussi, les questions de droit commercial (par exemple dans les rapports entre un non-commerçant et un commerçant). Et il se trouve que ces juridictions spéciales sont plus routinières souvent, plus attachées aux formes minutieuses de la procédure, et à tous points de vue plus dangereuses pour les justiciables que les tribunaux composés de magistrats de carrière.
Nous voici au terme de notre étude. Nous avons jusqu’ici négligé une troisième acception du mot Droit. Dans cette acception, le Droit désigne la science, l’étude qui porte sur le Droit en général, et en particulier sur les Droits qu’il établit, C’est ainsi qu’on dit la Faculté de Droit, un livre de Droit, etc... Les manuels discutent gravement et savamment si le Droit ainsi compris, constitue un art ou une science. Nous ne nous attarderons pas à cette vaine recherche.
CONCLUSIONS. ― La complexité de plus en plus grande des rapports sociaux, a créé dans le monde moderne, un Droit lui-même de plus en plus complexe, moins formaliste peut-être à certains égards, et dans son principe, qu’aux époques anciennes, mais composé d’une multitude de dispositions législatives et d’usages. Dans un amas de dispositions confuses ou même souvent contradictoires, les citoyens n’arrivent pas à se reconnaître. Une immense corporation privilégiée, de plus en plus puissante dans l’État, composée des notaires, avocats, avoués, huissiers, hommes d’affaires, etc., tire sa richesse de l’exploitation de cette ignorance. La victoire est souvent au plus habile dans les luttes judiciaires : de là une source d’incertitudes ou même de démoralisation dans les relations sociales.
L’organisation même de l’État et des services publics devient de jour en jour infiniment plus complexe. Des innombrables prescriptions et formalités de toute sorte qui gouvernent l’activité des individus, ces derniers cherchent à éluder toutes celles qui peuvent gêner leur indépendance ou leurs combinaisons particulières. Les forts, les puissants y arrivent. Mais sur les humbles, sur les faibles, pèse lourdement le poids de la contrainte sociale, faite, malheureusement, et trop souvent, d’iniquité.
― G. BESSIÈRE.
DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN (Déclarations des)
On sait que l’Assemblée nationale de 1789 a intitulé Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen l’ensemble des principes qu’elle reconnaissait comme les bases nécessaires de toutes les institutions humaines. Ces droits primitifs, naturels, imprescriptibles, les philosophes les avaient dès longtemps définis : l’Assemblée se bornait à les déclarer.
Aussi bien, l’histoire avait-elle enregistré maintes « déclarations des droits ».
Au Moyen-Age, l’affranchissement des communes avait permis, sous le nom de « reconnaissances » ou de « concessions », de « franchises », d’ « usages », de « privilèges », la confirmation de certains droits acquis antérieurement (vestiges du droit romain ou coutumes locales), et la reconnaissance d’autres droits jusqu’alors réservés à une minorité privilégiée (royauté, noblesse, clergé, particuliers, corps constitués).
Au XVIème siècle, la Réforme avait eu, en Angleterre et en Hollande, ses pétitions et ses « déclarations de droits ».
Mais la République des « Insurgents » américains eut l’honneur d’évoquer, la première, les Droits de l’Homme en tête de la Constitution d’un État.
I. DÉCLARATION DE 1776 :
La Déclaration de l’Indépendance américaine, rédigée au nom des « Insurgents » par T. Jefferson, J. Adams, B. Franklin, R. Sherman et R.-P.-R. Livingston, fut adoptée à l’unanimité, le 4 juillet 1776, par les représentants des treize colonies unies de l’Amérique du Nord.
Elle rappelait les « droits inaliénables de l’homme » dans les termes que voici :
« Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes :
Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par leur créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent : la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu’une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l’abolir, et d’établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes et en l’organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. »
La Déclaration américaine fut ainsi la première à fonder la Constitution d’un État sur les bases essentielles de toute démocratie, qui sont la souveraineté nationale et le droit à l’insurrection.
II. DÉCLARATION DE 1789 :
La Révolution française — on vient de le voir — n’eut donc ni l’initiative de la Déclaration des Droits de l’Homme, ni la primeur de son utilisation politique.
La Déclaration américaine était connue en France et en Europe dès avant 1789. Certains Cahiers, en particulier les Cahiers de la Noblesse, avaient même exprimé le vœu qu’une déclaration analogue fût rédigée par les États-Généraux qu’on allait réunir. Une Déclaration des Droits à l’usage du peuple français était imposée à l’Assemblée nationale par l’attente de tous les esprits cultivés. Le peuple de Paris allait montrer bientôt qu’il était prêt, au besoin, à l’exiger par la violence.
Le Tiers-État — c’était la bourgeoisie de l’époque — montrait à l’égard des « Droits de l’Homme » beaucoup moins d’enthousiasme que tels nobles idéalistes ou que le populaire excédé par les abus. Sans doute, demandait-il l’abolition des privilèges dont jouissaient, parfois à ses dépens, le roi, les nobles, le clergé. On connaît la brochure célèbre publiée par l’abbé Siéyès, en janvier 1789, et dont le titre résumait les aspirations des bourgeois en trois brèves formules :
« Qu’est-ce que le Tiers-État ? — Tout. Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans l’ordre politique ? — Rien. Que demande-t-il ? — A y devenir quelque chose. »
Mais ce « quelque chose », sous la plume de Siéyès, n’était qu’une litote : le Tiers, qui croyait être tout dans la nation, voulait devenir tout dans l’État. Il entendait non seulement conserver, mais accroître indéfiniment les avantages matériels déjà considérables que lui avaient acquis des siècles d’une lutte obstinée. Quant aux droits de l’ouvrier, il n’en avait cure. Et lorsque, dix ans plus tard, sous le Directoire, il se trouverait suffisamment « nanti » par les dépouilles des nobles et du clergé, il adhérerait sans vergogne aux propos du cynique Fouché, déclarant qu’il n’y avait plus « qu’à arrêter la marche d’une Révolution désormais sans but, depuis qu’on avait obtenu tous les avantages personnels qu’on pouvait prétendre ». Le Tiers-État voulait faire la Révolution, mais à son bénéfice exclusif.
Ce fut donc malgré l’hostilité plus ou moins avouée du Tiers, que l’Assemblée nationale, entraînée par le comte de Montmorency et par le comte de Castellane, décida de placer en tête de la future Constitution du Royaume, un bref exposé des principes qui devaient en inspirer les dispositions.
La lutte, au sein de l’Assemblée, fut longue. Divers projets avaient été proposés. Le 12 août, la rédaction fut confiée à une Commission de cinq membres. L’un d’eux, le comte de Mirabeau, député du Tiers, quoique noble, présenta le travail commun dans la séance du 17. Mais ce premier projet fut rejeté.
Sur la proposition du marquis de la Paulette, l’Assemblée décida que de nouveaux projets seraient élaborés dans les bureaux. Enfin, après un second débat, la Déclaration, qui avait été repoussée tout d’abord en séance secrète par 28 bureaux sur 30, fut imposée par les tribunes en séance publique et votée à la majorité des voix.
Elle avait eu pour principaux rédacteurs le général marquis de La Fayette, le prince de Talleyrand-Périgord, évêque d’Autun, l’abbé Siéyès et l’avocat Mounier, député de Grenoble. Elle se compose d’un préambule, œuvre de Mounier, et de 17 articles. Placée en tête de la Constitution du 3–14 septembre 1791, elle resta en vigueur jusqu’à la révolution du 10 août 1792, qui abolit la royauté.
Voici le texte intégral de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :
« DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN :
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des Droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme : Afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; Afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soient plus respectés ; Afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les Droits suivants de l’Homme et du Citoyen :
-
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
-
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
-
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
-
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
-
La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
-
La loi est l’expression de la volonté générale : tous les citoyens ont le droit de concourir, personnellement ou par leurs représentants, à sa formation ; elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.
-
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis, mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.
-
La loi ne doit établir que les peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.
-
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
-
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
-
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
-
La garantie des Droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
-
Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
-
Tous les citoyens ont le droit, par eux-mêmes ou par leurs représentants, de constater la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
-
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
-
Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.
-
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »
Par cette Déclaration solennelle qui eut en France et en Europe un immense retentissement, l’Assemblée nationale entendait faire table rase de l’ancien régime ; elle voulait, en outre, instituer une société toute nouvelle dont les bases essentielles devaient être la souveraineté nationale, la séparation des pouvoirs, l’égalité et la liberté des citoyens.
La partie négative de cet audacieux programme, celle qui consistait simplement à détruire, l’Assemblée nationale l’exposa dans la Constitution de 1791, en rappelant brièvement les abus qu’elle supprimait :
« L’Assemblée nationale, voulant établir la Constitution française sur les principes qu’elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l’égalité des droits.
Il n’y a plus ni noblesse ni pairie, ni distinctions, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance ; ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions. Il n’y a plus ni vénalité ni hérédité d’aucun office public. Il n’y a plus, pour aucune partie de la nation ni pour aucun individu, aucun privilège ni exception au droit commun de tous les Français. Il n’y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers. La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la Constitution. »
L’œuvre positive définie par la Déclaration de 1789 embrassait tous les droits dont l’Assemblée nationale entendait garantir la jouissance aux citoyens français.
On en trouve le plan général au titre I de la Constitution de 1791, intitulé : « Dispositions fondamentales garanties par la Constitution » :
« La Constitution garantit, comme droits naturels et civils :
-
Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents ;
-
Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également, en proportion de leurs facultés ;
-
Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction de personne.
La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils :
-
La liberté à tout homme d’aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté ni détenu que selon les formes déterminées par la Constitution ;
-
La liberté à tout homme de parler, d’écrire, d’imprimer et publier ses pensées, sans que ses écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d’exercer le culte religieux auquel il est attaché ;
-
La liberté aux citoyens de s’assembler paisiblement et sans armes en satisfaisant aux lois de police ;
-
La liberté d’adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement.
Le pouvoir législatif ne pourra faire aucune loi qui porte atteinte et mette obstacle à l’exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre et garantis par la Constitution. Mais comme la liberté ne consiste qu’à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant, ou la sûreté publique, ou les droits d’autrui, seraient nuisibles à la société.
La Constitution garantit l’inviolabilité des propriétés ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.
Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d’utilité publique appartiennent à la nation, et sont dans tous les temps à sa disposition.
La Constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi.
Les citoyens ont le droit d’élire ou choisir les ministres de leurs cultes.
Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes et fournir du travail aux pauvres valides qui n’auraient pas pu s’en procurer.
Il sera créé et organisé une instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d’enseignement indispensable pour tous les hommes, et dont les établissements seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume.
Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à la patrie et aux lois.
Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume. »
Qu’est-il advenu de ces projets grandioses ? On peut, sans trop d’impertinence, poser aujourd’hui la question. On sait, en effet, qu’après un siècle et demi de luttes politiques, d’émeutes sanglantes et d’inutiles révolutions, les citoyens français attendent encore la réalisation de leurs droits. Le sublime idéal de 1789 a reçu de l’historien un cruel démenti. Mais son échec était fatal. Les grands révolutionnaires, ceux du moins qui gardaient la foi dans l’œuvre entreprise, avaient fait, selon le mot de l’un d’entre eux, « un pacte avec la mort ». Ils ne pouvaient, hélas ! contraindre la victoire. On ne transige pas avec la ruse, la peur, l’hypocrisie, la trahison !... Mais si le succès leur échappa, ils tinrent leur serment et surent mourir.
Il ne faut point leur imputer à crime d’avoir conçu une Cité de rêve, comme si les lois de l’État suffisaient à réformer les mœurs. Maîtres de leurs pensées, ils les voulurent idéalement belles. Mais le cœur des ambitieux leur échappait, où régnait l’égoïsme, le seul tyran qu’on ne pût « raccourcir ». Ils eurent l’honneur, et ce sera leur gloire, de tracer l’ébauche d’une société moins inique, laissant à l’avenir la tâche peut-être surhumaine de l’édifier, pierre après pierre, dans la douleur et dans l’effort.
La Déclaration de 1789 a inspiré à des degrés divers toutes les Constitutions françaises jusques et y compris la Constitution bonapartiste de 1852. Des rédactions différentes en furent parfois adoptées. Nous croyons intéressant de les mentionner ici.
III. DÉCLARATION DE L’AN I (OU DE 1793) :
Dès les premières séances de la Convention nationale, une Commission fut chargée de préparer un projet de Constitution de la République. L’élément girondin y dominait. Elle comprenait : Siéyès, Thomas Payne, Brissot, Pétion, Vergniaud, Gensonné, Barère, Danton et Condorcet, avec Barbaroux, Fauchet et quelques autres pour suppléants. Condorcet présenta son rapport les 15 et 16 février 1793. Mais la lutte engagée entre la Montagne et la Gironde ne permit pas à l’Assemblée de le discuter.
Après la chute des Girondins, le Comité de Salut public, auquel on adjoignit cinq membres, reçut la mission de rédiger un nouveau projet.
Hérault de Séchelles en fut le principal rédacteur. Élaboré en six jours, amendé et adopté par le Comité en une séance, le projet de Constitution fut présenté à la Convention le 10 juin et voté le 24. Ébauche improvisée pour les besoins d’une crise politique, la Constitution de 1793 fut appelée plaisamment par son auteur Hérault de Séchelles « un impromptu républicain ». Siéyès ne voulait y voir qu’ « une table des matières ».
Soumise avec la Déclaration qui lui servait de préambule à la ratification des Assemblées primaires, elle fut acceptée par le corps électoral. Mais elle ne put être appliquée. Le 10 octobre 1793, l’Assemblée décréta que « le Gouvernement provisoire de la France serait révolutionnaire jusqu’à la paix » et que « la Convention serait elle-même le centre unique du Gouvernement ».
La Déclaration de 1793 resta donc lettre morte, comme la Constitution dont elle n’était que la préface.
Voici le texte de cette Déclaration :
« Le peuple français, convaincu que l’oubli et le mépris des Droits naturels de l’Homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables ;
Afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du Gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie ;
Afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de la liberté et de son bonheur ; le magistrat, la règle de ses devoirs ; le législateur, l’objet de sa mission.
En conséquence, il proclame en présence de l’Être suprême la déclaration suivante des Droits de l’Homme et du Citoyen :
-
Le but de la société est le bonheur commun ! Le gouvernement est institué pour garantir à l’homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
-
Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.
-
Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
-
La loi est l’expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.
-
Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d’autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.
-
La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu’il te soit fait.
-
Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits. La nécessité d’énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.
-
La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.
-
La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent.
-
Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l’autorité de la loi, doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.
-
Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.
-
Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires sont coupables et doivent être punis.
-
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
-
Nul ne doit être jugé et puni qu’après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait des délits commis avant qu’elle existât, serait une tyrannie ; l’effet rétroactif donné à la loi serait un crime.
-
La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.
-
Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
-
Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l’industrie des citoyens.
-
Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît pas de domesticité ; il ne peut exister qu’un engagement de soins et de reconnaissance entre l’homme qui travaille et celui qui l’emploie.
-
Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété, sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
-
Nulle contribution ne peut être établie que pour l’utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l’établissement des contributions, d’en surveiller l’emploi et de s’en faire rendre compte.
-
Les secours publics sont une dette sacrée. La Société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.
-
L’instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens.
-
La garantie sociale consiste dans l’action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
-
Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n’est pas assurée.
-
La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.
-
Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblé doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté.
-
Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l’instant mis à mort par les hommes libres.
-
Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.
-
Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
-
Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.
-
Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n’a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
-
Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.
-
La résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l’homme.
-
Il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.
-
Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »
IV. DÉCLARATION DE L’AN III (OU DE 1795) :
Le 17 Floréal An III (6 mai 1795), la grande « Terreur » étant close, la Convention nomma une commission pour réviser les lois révolutionnaires. Cette commission comprenait onze membres : Lesage (d’ Eure-et-Loir) , Daunou, Boissy d’Anglas, Creuze, Latouche, Berlier, Louvet, La Réveillère-Lépeaux, Lanjuinais, Durand-Maillane, Baudin (des Ardennes) et Thibaudeau. Elle rejeta unanimement la Constitution de 1793 dont certaines dispositions paraissaient, aux réacteurs de l’époque, « contraires à l’ordre social ».
Le 5 Messidor An III (23 juin 1795), Boissy d’Anglas présenta un projet à la Convention qui, après une longue discussion, adopta le texte définitif le 5 Fructidor (22 août 1795).
Soumise à l’approbation du corps électoral, la Constitution de 1795 fut acceptée par 914.853 voix contre 41.892. Elle était précédée de la Déclaration que voici :
« Le peuple français proclame, en présence de l’Être Suprême, la déclaration suivante des Droits et des Devoirs de l’Homme et du Citoyen :
DROITS
Les Droits de l’Homme en société sont la liberté, l’égalité, la sûreté, la propriété.
La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui.
L’égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. L’égalité n’admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoir.
La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun.
La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
La loi est la volonté générale exprimée par la majorité ou des citoyens, ou de leurs représentants.
Ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formules qu’elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis.
Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de la personne d’un prévenu doit être sévèrement réprimée par la loi.
Nul ne peut être jugé qu’après avoir été entendu ou légalement appelé.
La loi ne doit prononcer que des peines strictement nécessaires et proportionnées au délit.
Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi est un crime.
Aucune loi, ni criminelle, ni civile, ne peut avoir d’effet rétroactif.
Tout homme peut engager son temps et ses services ; mais il ne peut ni se vendre ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable.
Toute contribution est établie pour l’utilité générale. Elle doit être répartie entre les contribuables en raison de leurs facultés.
La souveraineté réside essentiellement dans l’universalité des Citoyens.
Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s’attribuer la souveraineté.
Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique.
Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédiatement ou médiatement, à la formation de la loi, à la nomination des représentants du peuple et des fonctionnaires publics.
Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.
La garantie sociale ne peut exister, si la division des pouvoirs n’est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées et si la responsabilité des fonctionnaires publics n’est pas assurée.
DEVOIRS
La déclaration des Droits contient les obligations des législateurs ; le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs Devoirs.
Tous les Devoirs de l’Homme et du Citoyen dérivent de ces deux principes gravés par la nature dans tous les cœurs : ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fît ; faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir.
Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois et à respecter ceux qui en sont les organes.
Nul n’est bon citoyen s’il n’est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.
Nul n’est homme de bien s’il n’est franchement et religieusement observateur des lois.
Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre envers la société.
Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous ; il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.
C’est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout l’ordre social.
Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l’égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre. »
V. DÉCLARATION DE 1848 :
La Constitution républicaine de 1848 avait été rédigée par une commission qui comprenait MM. de Cormenin, Marrast, rapporteur ; Lamennais, Vivien, de Tocqueville, Dufaure, Martin (de Strasbourg), Coquerel, Corbon, Thouret, Woirhaye, Dupin, Gustave de Beaumont, de Vaulabelle, Odilon Barrot, Pagès (de l’Ariège), Dornès et Victor Considérant.
Elle fut votée le 4 et promulguée le 12 novembre. Elle était précédée d’une Déclaration des Droits ainsi libellée :
« En présence de Dieu et au nom du peuple français, l’Assemblée Nationale proclame :
-
La France s’est constituée en République. En adoptant cette forme définitive de gouvernement, elle s’est proposé pour but de marcher plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation, d’assurer une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la Société, d’augmenter l’aisance de chacun par la réduction graduée des dépenses publiques et des impôts et de faire parvenir tous les citoyens, sans nouvelle commotion, par l’action successive et constante des institutions et des lois, à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être.
-
La République Française est démocratique, une et indivisible.
-
Elle reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives.
-
Elle a pour principes la liberté, l’égalité, la fraternité. Elle a pour bases la famille, le travail, la propriété, l’ordre public.
-
Elle respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne, n’entreprend aucune guerre dans des vues de conquête, et n’emploie jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
-
Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la République et la République envers les citoyens.
-
Les citoyens doivent aimer la patrie, servir la République, la défendre au prix de leur vie, participer aux charges de l’État en proportion de leur fortune ; ils doivent s’assurer, par leur travail, des moyens d’existence, et, par la prévoyance, des ressources pour l’avenir ; ils doivent concourir au bien-être commun en s’entraidant fraternellement les uns les autres et à l’ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et l’individu.
-
La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail et mettre à la portée de chacun l’instruction indispensable à tous les hommes ; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l’existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d’état de travailler.
En vue de l’accomplissement de tous ces devoirs, et pour la garantie de tous ces droits, l’Assemblée nationale, fidèle aux traditions des grandes Assemblées qui ont inauguré la Révolution française, décrète, ainsi qu’il suit, la Constitution de la République ... »
VI.
La Déclaration de 1789, comme celles qui furent inspirées par le même idéal, a eu sur la mentalité du peuple français une influence durable et profonde dont il convient d’apprécier impartialement les effets.
Elle produisit un phénomène de vertige mental. Jusqu’en 1789, en effet, on n’avait défendu ou revendiqué en France que des « droits particuliers », « concrets », « limités » à « certains individus » ou à « certaines collectivités » : c’étaient les droits des nobles, les droits des clercs, les droits des gens de robe, les droits des bourgeois ou des marchands (quincailliers, bouchers, boulangers, corroyeurs, etc.) ; c’étaient aussi, mais les plus négligés de tous, les droits des ouvriers, des « compagnons ».
Disciples des « philosophes », les révolutionnaires de 1789 et des Assemblées suivantes considérèrent, non plus tel ou tel citoyen, telle ou telle collectivité d’individus, clairement et spécifiquement désignés, qu’on pouvait coudoyer tous les jours dans les rues, de qui on connaissait les besoins, les aptitudes et les aspirations, mais l’ « homme », l’homme tout court, c’est-à-dire une entité abstraite, sans nom, sans rôle social défini, un être de raison que personne n’avait rencontré nulle part.
Cette généralisation, pour excessive qu’elle fût, avait, au point de vue spéculatif, l’avantage de supprimer radicalement les classifications établies. Elle affola les imaginations. Un délire sacré s’empara des esprits. Un fanatisme d’un genre inconnu gonfla les cœurs. Dès lors, la politique parut ignorer les cas d’espèce. Elle ne s’intéressa plus qu’à l’universalité des humains, pris en bloc, à tous les hommes de toutes les conditions, de tous les peuples, de toutes les races, de toutes les couleurs, de tous les temps. Ce fut sublime et enfantin. Les politiciens, en quête de fructueux mandats électoraux et de grasses prébendes officielles, s’emparèrent des « droits imprescriptibles » comme fait le chasseur d’un miroir à alouettes et, à l’aide de vagues promesses, de formules pompeuses mais vides, où les « principes immortels » revenaient comme un leitmotiv, ils dupèrent, pendant plus d’un siècle, le peuple, qui semblait fasciné. Devant l’urne électorale, on ne fut plus serrurier, maçon, couvreur, mais « citoyen ». Au lieu de militer pour ses intérêts personnels, on s’enflamma pour l’idéologie des « clubs », des comités. On fut républicain ou monarchiste, clérical ou laïque, radical ou opportuniste, socialiste ou communiste, libéral ou fasciste. L’ex-compagnon boucher négligea ses droits de boucher ; l’ex-compagnon zingueur délaissa ses droits de zingueur ; l’ex-compagnon charron passa condamnation de ses droits de charron. L’ouvrier, frustré mais aveuglé, sembla préférer des théories générales à ses intérêts corporatifs immédiats. On se passionna pour des mythes ; on se battit pour des chimères ; on mourut pour des abstractions. Les Français, Don Quichottes éternels, que les croisades avaient promus jadis « soldats de Dieu », devinrent, par la grâce des « Droits de l’Homme », les « soldats de la liberté ». Leur devise fut : « La fraternité ou la mort ! » Ils semèrent de leurs os les champs de bataille du monde. Leurs sacrifices, pourtant, restaient vains. Ils sapaient les « abus » ; mais sur leurs cadavres immolés à la justice, les abus renaissaient aussi nombreux, avec de nouveaux noms. Ils proclamaient les « immortels principes » ; mais, eux disparus, les « droits » qu’ils avaient consacrés de leur sang étaient « soigneusement roulés dans le linceul de pourpre où dorment les dieux morts ». Durant plus d’un siècle, des millions de Français — des ouvriers, pour la plupart — moururent pour l’idéal. Quant au profit, ce fut le bourgeois qui l’obtint.
En effet, tandis que les champions de l’idée pure succombaient sans retour, l’ex-maître boucher, l’ex-maître zingueur, l’ex-maître charron, le bourgeois, le « patron », n’oubliait point ses anciennes « franchises » et, par tous les moyens, s’efforçait de les rétablir. Dans la société issue de la Révolution, la noblesse, le clergé avaient perdu leurs privilèges. Et c’était justice. Mais le bourgeois — c’est-à-dire le propriétaire, le commerçant, l’industriel, le financier, surtout — désormais tout puissant, régnait sans contrôle sur la cité nouvelle.
On connaît le piquant tableau qu’a tracé de la France républicaine la plume acérée d’Anatole France :
« L’État pingouin était démocratique, trois ou quatre compagnies financières y exerçaient un pouvoir plus étendu et surtout plus effectif et plus continu que celui des ministres de la République, petits seigneurs qu’elles gouvernaient secrètement, qu’elles obligeaient, par intimidation ou par corruption, à les favoriser aux dépens de l’État, et qu’elles détruisaient par les calomnies de la Presse, quand ils restaient honnêtes. » (L’Île des Pingouins, p. 243.)
« Le nouvel État reçut le nom de chose publique, ou République. Ses partisans étaient appelés républicanistes ou républicains. On les nommait aussi chosards et, parfois, fripouilles ; mais ce dernier terme était pris en mauvaise part.
La démocratie pingouine ne se gouvernait point par elle-même ; elle obéissait à une oligarchie financière qui faisait l’opinion par les journaux et tenait dans sa main les députés, les ministres et le président. Elle ordonnait souverainement des finances de la République et dirigeait la politique extérieure du pays. » (« L’Île des Pingouins », p. 173.)
Le témoignage d’un auteur sceptique, mais averti, semblerait-il suspect ? Détachons de la revue démocratique Les Cahiers des Droits de l’Homme, organe officiel de la Ligue du même nom, l’exergue suivant qui contient un aveu à retenir :
« Les Droits de l’Homme sont-ils proclamés ? Oui. Sont-ils appliqués ? Non. »
Ce désintéressement total des pouvoirs publics français à l’égard des Droits de l’Homme ne doit pas surprendre outre mesure. La Constitution de 1875, qui régit présentement l’État français, ignore, en effet, officiellement les Droits de l’Homme et du Citoyen.
Faut-il conclure de cette ignorance officielle — qui fut certainement volontaire, de la part de nos derniers « constituants » — qu’une loi française peut, sans violer la Constitution, attenter aux Droits de l’Homme ? M. Léon Duguit, professeur de droit international à la Faculté de Bordeaux, a répondu négativement à cette question redoutable :
« La Constitution de 1875, a-t-il écrit, est la seule des Constitutions françaises où l’on ne trouve aucune mention, aucun rappel des droits inscrits dans la Déclaration de 1789. Dans ces conditions, on peut se demander si les règles de la Déclaration des Droits de 1789 ont cessé d’avoir force légale, positive, et si le Parlement pourrait, à l’heure actuelle, faire des lois portant atteinte aux droits naturels, individuels, de l’homme, sans violer les dispositions fondamentales de notre droit public ? Nous répondons : non, sans hésiter, et nous croyons fermement que toute loi contraire aux termes de la Déclaration des Droits de 1789 serait une loi inconstitutionnelle. (Léon DUGUIT : Manuel de droit constitutionnel, Paris 1918, p. 228.)
M. Léon Duguit « croit » qu’il en est ainsi. Mais il ne propose aucune raison à l’appui de sa « croyance ». Autant dire qu’elle ne vaut rien.
La question qui se pose, en fait, à l’heure présente, est celle-ci : Les Droits de l’Homme sont-ils respectés dans la législation française ? On sait que non.
Les lois injustes qu’on maintient en vigueur, les pratiques abusives auxquelles on reconnaît force de loi sont-elles inconstitutionnelles par cela seul qu’elles sont injustes ? On aimerait en être assuré, et pour chacune d’elles, par les juristes qui, « faisant autorité » dans les prétoires, inspirent aux juges leurs arrêts. Car les dispositions législatives et les pratiques administratives ou policières qui violent les Droits de l’Homme sont en France plus nombreuses qu’on ne le croit communément.
Tels sont, pour ne citer que les plus révoltants de ces « abus légaux » :
-
L’article 75 de la Constitution de l’An VIII, qui décide que les « agents du gouvernement, autres que les ministres ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leur fonction, qu’en vertu d’une décision du Conseil d’État ». Cet article, instituant, en fait, l’irresponsabilité professionnelle des fonctionnaires de l’État, est en opposition avec les articles XV de la Déclaration de 1789 ; XXXI de la Déclaration de 1793 et XXII de la Déclaration de 1795 ;
-
L’article 10 du Code d’instruction criminelle qui arme les préfets des attributions les plus redoutables du pouvoir judiciaire, comme, par exemple, du droit de « se saisir eux-mêmes, en tous les cas, pour les crimes ou délits, flagrants ou non flagrants, pour les délits politiques comme pour les délits de droit commun » de délivrer des mandats, de faire arrêter et détenir, d’opérer des perquisitions et des saisies, de procéder à des interrogatoires, de faire, en un mot, tout ce que peuvent les juges « sauf prononcer eux-mêmes la condamnation. » (G. CLÉMENCEAU, Journal officiel, séance du 16 décembre 1904, et GARÇON, Revue Pénitentiaire, 1901.) Cet article viole le principe de la séparation des pouvoirs énoncés dans l’article XVI de la Déclaration de 1879 ;
-
La pratique des arrestations dites « administratives » qui s’exerce à l’égard des voyageurs sans passeport, des filles publiques et des aliénés ou prétendus tels. (Loi du 30 juin 1838) ;
-
Les arrestations injustifiées et les détentions préventives, opérées par l’ordre de magistrats ineptes ou trop zélés et prolongées sans motif valable.
Il nous serait aisé d’allonger cette liste indéfiniment en citant les actes arbitraires, les passe-droits et les injustices caractérisées commises quotidiennement sur tout le territoire français. (Voir, sur ce sujet passionnant, l’article Droits de l’Homme (Ligue française pour la défense des).
Devant cette carence indéniable et systématique des gouvernements, insoucieux d’assurer la séparation des pouvoirs et le respect des droits individuels, les pensées libres ont le devoir d’en appeler aux principes formulés dans les Déclarations des Droits. Ces principes, qui sont la garantie suprême des individus contre l’État oublieux de la mission qu’il s’est donnée, nous tenons à les reproduire au terme de cet article, comme la plus logique et la plus opportune conclusion :
« XVI. Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. » (1789.)
« XXXIII. La résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l’homme. »
« XXXIV. Il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé. »
« XXXV. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » (1793.)
A chaque citoyen d’y recourir, dans toute la mesure efficace et selon les possibilités du moment.
- Henri BEAUVOIS.
DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN (Ligue française pour la défense des)
I. BUT DE LA LIGUE
La Ligue française pour la défense des Droits de l’Homme et du Citoyen a été constituée, à Paris, le 4 juin 1898. L’action immédiate que se proposaient ses fondateurs (Ludovic Trarieux, Francis de Pressensé, Ferdinand Buisson, Gabriel Séailles, etc.), c’était, avant tout, la révision de l’affaire Dreyfus. Mais, dès leur premier manifeste, ils affirmèrent :
-
Que la Ligue s’appliquerait à faire vivre dans les mœurs et à réaliser dans les lois les principes de la Révolution française ;
-
Que toute personne dont le droit serait violé trouverait désormais auprès d’elle assistance et conseil. C’est vers ces deux buts que, sans arrêt ni défaillance, elle a tendu ses efforts.
II. L’OEUVRE DE LA LIGUE EN FRANCE
Depuis bientôt trente ans, par ses publications, par ses meetings, par ses interventions auprès des ministres et du Parlement, elle a tenu la conscience publique en éveil ; elle a combattu les conseils de guerre, les bagnes d’Afrique, le code militaire, les lois injustes ; elle a dénoncé les brutalités policières, les mensonges de la raison d’État, le scandale des instructions sommaires et des jugements de haine, les attentats à la liberté de pensée ; elle a défendu la légalité contre l’arbitraire des pouvoirs publics et contribué à redresser la législation française dans le sens de l’équité.
On connaît les campagnes retentissantes qu’elle a menées en France à l’occasion des affaires Dreyfus, Caillaux, Malvy. Grâce à la Ligue, Péan, N’Guyen Van Do, soldats innocents, condamnés au bagne, ont été libérés ; grâce à la Ligue, la mémoire des lieutenants Herduin, Millant, du sergent Mercey, des soldats Maillet, Loiseau, Bersot, Santer, Gonsard, des civils Copie, Strimelle, Mertz, fusillés ; du lieutenant Louis Marty mort interné pendant la guerre de 1914 à 1918, a été réhabilitée.
On connaît moins la série innombrable des petits combats qu’elle livre tous les jours, dans tous les départements ministériels, en faveur des plus humbles victimes : étrangers menacés d’expulsion, pour qui elle obtient des permis de séjour ; fonctionnaires arbitrairement déplacés ou révoqués, à qui elle fait rendre leur emploi ; militaires ou civils injustement condamnés, qu’elle fait réhabiliter.
« Redresseuse de torts » inlassable mais impartiale, elle se place au-dessus des sectes politiques et religieuses. Elle n’admet comme adhérents que les démocrates attachés aux principes de la Révolution française ; mais elle intervient pour toutes les victimes de l’injustice, quels que soient leur parti, leurs tendances, leurs antécédents.
Elle est intervenue, naguère, en faveur d’officiers catholiques, frappés disciplinairement pour être allés à la messe en uniforme ; puis, pour des pasteurs protestants molestés à Madagascar ; plus récemment pour des instituteurs et des institutrices brimés à cause de leurs opinions. Elle est intervenue de même en faveur des condamnés de droit commun mis au ban de la société. Elle a mené campagne pour des communistes faussement inculpés de « complots ». Maintes fois, elle a pris la défense des militants libertaires. On n’a pas oublié les émouvants plaidoyers de Ferdinand Buisson, de Victor Basch, d’Henri Guernut, de Maurice Viollette, de Séverine, au procès de Germaine Berton. Après plusieurs démarches, elle a obtenu la libération anticipée d’E. Armand, condamné en 1918, par le conseil de guerre de Grenoble, à 5 ans de prison pour « complicité de désertion ». On connaît ses interventions en faveur de Sacco et de Vanzetti, condamnés à mort par la justice des États-Unis d’Amérique.
La Ligue, on le voit, par ces quelques exemples, ne fait point acception de personnes ; quiconque souffre l’injustice, qu’il se nomme Joseph Caillaux ou le bagnard n° X ... , par cela seul qu’il souffre l’injustice, est son client.
III. L’OEUVRE DE LA LIGUE A L’EXTÉRIEUR
Les mêmes principes de justice et d’impartialité inspirent l’action de la Ligue à l’extérieur. Dans ses congrès, dans ses meetings, elle affirme que les nations, comme les individus, sont des personnes morales et que chaque peuple a des droits dont le respect s’impose à tous les autres.
Dès 1916, avant même que le Président Wilson l’eût rappelé dans ses propositions, la Ligue des Droits de l’Homme avait défendu le Droit des Peuples et demandé l’organisation d’une Société des Nations, fondée sur la justice et l’équité.
On n’a pas oublié ses campagnes pour l’Arménie et pour la Finlande. Dès le début de la guerre, elle revendiqua le droit à l’indépendance pour la Pologne, pour la Tchécoslovaquie, pour la Yougoslavie, pour toutes les nationalités opprimées.
Éprise d’impartiale justice, elle a défendu les populations en difficultés avec les Alliés ou avec la France : Irlande, Égypte, Albanie, Annamites, Indigènes de l’Afrique du Nord. Elle avait protesté, jadis, contre l’oppression de la Finlande par le gouvernement des tsars. Elle a protesté, depuis la révolution russe, contre l’invasion de la Géorgie par le gouvernement des Soviets.
La Ligue veut être, par-dessus tout, une Ligue de la Paix. Elle ne peut admettre qu’un État ait le droit de se faire justice par la force. Convaincue que la guerre, tout comme le pillage et l’assassinat, est un crime de droit commun, elle mène campagne depuis plus de vingt ans pour que les conflits internationaux, comme les différends des particuliers, soient réglés juridiquement, c’est-à-dire pacifiquement. Elle demande, pour la Société des Nations, le droit de poursuivre les manquements au pacte international et le pouvoir d’en châtier les auteurs.
« Point de justice sans réparation des injustices, a écrit Ferdinand Buisson, président d’honneur de la Ligue française, point de réparation des injustices sans une juste sentence des tribunaux autorisés à la rendre ; point de juges et de jugement possibles sans une Société des Nations qui prête main-forte à la justice et qui dispose souverainement des sanctions nécessaires pour faire exécuter ses justes décisions. »
IV. LA LIGUE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME
En vue d’organiser à l’extérieur l’œuvre de justice et de paix, la Ligue française des Droits de l’Homme a créé ou facilité la fondation, pour les autres nations, de plusieurs Ligues-soeurs. C’est ainsi que des Ligues des Droits de l’Homme, indépendantes dans leur action mais animées du même idéal et s’inspirant des mêmes méthodes, ont été constituées pour les pays suivants :
Albanie, Allemagne, Angleterre, Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Dantzig, Espagne, Géorgie, Grèce, Haïti, Hongrie, Italie, Luxembourg, Portugal, Pologne, Roumanie, Russie, Tchécoslovaquie.
Une Fédération, dont le siège est à Paris, leur sert d’agent de liaison sous le nom de « Ligue Internationale des Droits de l’Homme et du Citoyen ». Mme Ménard-Dorian en est la secrétaire générale.
Le IIIème Congrès de la Ligue Internationale des Droits de l’Homme, réuni à Bruxelles, les 26 et 27 juin 1926, a étudié plus spécialement la Constitution des États-Unis d’Europe dans l’esprit et dans le cadre de la Société des Nations.
V. PUBLICATIONS DE LA LIGUE FRANÇAISE
Au cours de ses campagnes, la Ligue française des Droits de l’Homme a édité une importante bibliothèque formée de nombreux tracts, brochures, comptes rendus sténographiques de Congrès. Nous en donnons ci-après un aperçu très sommaire.
Depuis 1900, elle publie régulièrement un Bulletin Officiel, devenu en 1920 une revue bi-mensuelle de grand format sous le titre : Les Cahiers des Droits de l’Homme. C’est, à l’usage des militants de la démocratie française, une source d’informations documentaires et un organe de combat.
VI. ADMINISTRATION DE LA LIGUE FRANÇAISE
La Ligue française des Droits de l’Homme, dont le siège est à Paris, 10, rue de l’Université (7ème), comprend plus de 130.000 ligueurs, groupés en 1.800 sections locales et en 81 fédérations départementales.
Elle est administrée par un Comité Central élu par l’ensemble des ligueurs à la majorité absolue.
Tous les ans, un Congrès national contrôle l’action du Comité Central au cours de l’exercice écoulé, précise la doctrine de la Ligue sur les questions à l’ordre du jour et formule, pour l’année suivante, les directives que devront suivre ses militants.
Elle a eu successivement pour présidents :
MM. Ludovic Trarieux (1898–1903), Francis de Pressensé (1903–1914), Ferdinand Buisson (1914–1926), Victor Basch.
Le Bureau du Comité Central pour 1927 est ainsi composé : MM. Victor Basch, président ; A. Aulard, C. Bouglé, A.-Ferdinand Hérold, Mme Ménard-Dorian, Paul Langevin, vice-présidents ; Henri Guernut, secrétaire général ; Alfred Westphal, trésorier général.
M. Victor Basch, élu président le 15 novembre 1926, a rappelé dans les Cahiers du 25 novembre les buts de la Ligue et défini en ces termes quelle doit être son action dans l’avenir :
« Défendre le droit des individus, à quelque parti qu’ils appartiennent, à quelque degré de la hiérarchie sociale qu’ils soient placés, et le défendre avec d’autant plus d’énergie que ce degré est plus humble ; — faire rendre au Droit, tel qu’il est inscrit dans la Loi, tout son suc de justice et travailler incessamment à adapter cette Loi à la réalité sociale et à la faire plus clémente et plus humaine ; — défendre le droit des peuples, de tous les peuples » à disposer librement d’eux-mêmes, à se développer librement, à harmoniser leur développement avec celui des autres peuples, de tous les autres peuples ; travailler passionnément à la cause sacrée de la paix ; — défendre inlassablement la démocratie ; défendre, dans cette démocratie, ce qui est conforme au fond dernier, au fond sacré de la personne morale et sociale, mais combattre inlassablement aussi la démagogie, qui n’est que la caricature de la démocratie vraie ; — défendre les droits de l’enfant et de la femme et prêter plus d’attention aux problèmes sociaux et donner aux concepts de liberté et d’égalité toute leur valeur et toute leur portée — voilà la mission de la Ligue.
« Elle est belle, elle est noble, elle est digne que l’on vive et que l’on agisse pour elle. Pour que nous puissions l’accomplir dans toute sa pureté, il faut que nous sauvegardions la Ligue de toute compromission avec la politique. La Ligue, nous l’avons dit, est à la pointe de la démocratie, elle en est la gardienne vigilante, la conscience vivante et organisée, une conscience, nous l’avons dit aussi, qui ne doit pas être inerme, qui ne doit pas se contenter de déplorer le mal quand il est fait, mais qui doit le prévenir et, quand il est là, le combattre jusqu’à ce qu’il soit terrassé.
En ce sens, la Ligue fait de la politique et doit en faire. Mais en ce sens seulement. Tout ce qui touche à la politique proprement dite, à la lutte des partis, aux batailles électorales, tout ce qui serait une dérogation à ses principes en faveur d’un gouvernement même ami, doit lui rester étranger. Rappelons-nous le suprême conseil qu’à son lit de mort, nous a donné notre cher Gabriel Séailles : « N’ayons pas peur et ne faisons pas de concessions ». Rappelons-nous que la Ligue est une libre association de citoyens qui se préoccupent de la chose publique et qui surveillent avec vigilance ceux qui ont la charge de l’administrer. »
VII. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
Voici les principales questions d’ordre général et les plus célèbres affaires particulières qui ont motivé les plus retentissantes interventions de la Ligue française et sur lesquelles des rapports documentaires ont été publiés, soit en brochures spéciales, soit dans les Cahiers des Droits de l’Homme :
-
QUESTIONS GÉNÉRALES :
-
Liberté individuelle : Tarbouriech, Rapports au Congrès de 1905 (Bulletin officiel 1905) ; Chenevier : Pour la liberté individuelle (Cahiers 1922) ; G. Clemenceau : Les garanties de la liberté individuelle (Cahiers 1922) ; F. Buisson : La résistance à l’oppression (Cahiers 1921) ; C. G. Costaforu : En Roumanie ; Les crimes de la sûreté (1926) ; U. Triaca : Le fascisme en Italie (1927).
-
Liberté d’opinion : F. Buisson et E. Glay : Pour la liberté d’opinion des fonctionnaires (Cahiers 1922) ; F. Buisson : L’affaire Baylet et Fontanier (Cahiers 1922) ; H. Guernut : Pour les fonctionnaires (Cahiers 1923) ; F. Buisson : La liberté d’opinion (Cahiers 1923) ; Pour la suppression des lois scélérates (Cahiers 1925–1926).
-
Droit de propriété : Tarbouriech : Essai sur la propriété (Bulletin officiel 1904) ; Charles Gide : Le droit de propriété (Cahiers 1921).
-
Objection de conscience : F. Corcos : L’objection de conscience (Cahiers 1926) ; Pioch : Pour les objecteurs de conscience (Cahiers 1926) ; Voir délibérations et vœux du Comité Central (Cahiers 1926).
-
Amnistie : F. Buisson : L’amnistie (Cahiers 1920) ; Albert Chenevier : La loi d’amnistie (Cahiers 1920) ; Prorogation de la loi du 29 avril 1921 (Cahiers 1923) ; Un projet de loi (Cahiers 1924) ; Les principales dispositions de la loi d’amnistie (Cahiers 1925).
-
Droits des travailleurs : Un ligueur : Un projet de loi sur les assurances sociales (Cahiers 1921) ; Robert Perdon : Le monde du travail et les assurances sociales (Cahiers 1921) ; R. Picard : Les problèmes généraux de l’assurance sociale (Cahiers 1925) ; Sicard de Plauzoles : Le droit aux soins (Cahiers 1923). V. les résolutions du Comité Central (Cahiers, passim) et les vœux des Congrès.
-
Droits des femmes : Comité Central : Adhésion de la Ligue à la pétition des femmes françaises (Bulletin officiel 1907) ; Pour l’électorat et l’éligibilité (Congrès 1909) ; F. de Pressensé : Lettre en faveur des droits politiques (Bulletin officiel 1910) ; F. Buisson : Le suffrage des femmes et la Ligue (Cahiers 1920) ; Alice La Mazière : Le vote des femmes et le Sénat (Cahiers 1923) ; G. Malaterre-Sellier : Le suffrage des femmes (Cahiers 1924) ; Suzanne Grinberg : L’incapacité des femmes mariées (Cahiers 1925) ; Sicard de Plauzoles : La réglementation de la prostitution (Cahiers 1923) ; La situation des femmes kabyles (Cahiers 1924).
-
Droits des enfants : F. Buisson : L’école démocratique (Cahiers 1921) ; F. Buisson : Les droits de l’enfant (Cahiers 1921) ; F. Buisson : L’école démocratique (Cahiers 1922) ; Sicard de Plauzoles : Les droits de l’enfant (Cahiers 1923).
-
Droits des indigènes : Marius Moutet : Les droits politiques des indigènes algériens (Bulletin officiel 1917) ; Henri Guernut : La Ligue et les indigènes (Cahiers 1923) ; G. Bunschvicg : L’arbitraire en Tunisie (Bulletin officiel 1911) ; Henri Guernut : L’affaire Bach-Hamfa (Bulletin officiel 1912) ; Congrès de 1924.
-
Justice militaire : Général Sarrail : Plus de conseils de guerre (Cahiers 1924) ; Général Sarrail : La réforme de la justice militaire (1926).
-
Droits des étrangers : Moutet, F. de Pressensé, Baylet : La situation des étrangers en France (Bulletin officiel 1913) ; W. Oualid : Le droit d’expulsion (Cahiers 1925) ; Les conseils juridiques : Le droit de l’étranger (Cahiers 1925) ; Roger Picard : Les étrangers en France (Cahiers 1926).
Voir également, sur toutes ces questions et sur l’action de la Ligue, les résolutions du Comité Central (Cahiers, passim) et les vœux adoptés par les Congrès annuels.
-
-
AFFAIRES PARTICULIERES
Théodore Reinach : Histoire sommaire de l’affaire Dreyfus (1924) ; A. Chenevier : L’affaire Abbès-ben-Hammana (1909) ; A. Delmont : L’affaire Colombini (1914) ; G. Brunschvicg : L’affaire Péan (1914) ; François-Albert : Le procès Malvy (1919) ; L’affaire Malvy (Etude juridique (1918) ; Études documentaires sur l’affaire Caillaux (1918) ; Les interrogations de M. Caillaux (1918) ; F. Buisson : L’affaire Sacco et Vanzetti (Cahiers 1921) ; René-Bloch : L’affaire Landau (1922) ; P. Loewel : Goldsky est innocent (1922) ; F. Corcos : Landau est innocent (1923) ; R. Réau : L’affaire Paul Meunier (Cahiers 1923) ; Henri Guernut : L’affaire Chapelant (1925) ; H, Guernut : Mertz et Copie (1926) ; H. Guernut : L’affaire Platon (1926) ; H. Guernut : L’affaire Strimelle (1926), etc...
On trouvera de nombreux détails sur l’action quotidienne de la Ligue en faveur des victimes de l’injustice et de l’arbitraire, dans les comptes rendus publiés, à la rubrique : « Nos interventions », par les Cahiers des Droits de l’Homme.
DUEL (Le)
Pièce en trois actes d’Henri Lavedan (1905).
Dans cette pièce, d’une psychologie pénétrante, Henri Lavedan nous présente un prêtre et un savant qui se disputent l’âme d’une femme croyante et passionnée. Ces deux hommes sont frères mais, en raison de leurs idées opposées, ils avaient abandonné toute relation. Placés l’un en face de l’autre par le hasard, ils se livrent un terrible duel ; l’un, pour asservir une femme à la religion ; l’autre, pour la délivrer de l’emprise de Dieu et la rendre à la vie et à l’amour.
C’est un drame poignant, d’une réelle profondeur et marqué d’une remarquable impartialité.
DUEL
n. m. (du latin duellum, formé de duo, deux, et de bellum, guerre)
Dans l’ancienne législature, le duel était un combat entre deux personnes dont l’issue ‘était admise comme preuve juridique dans les questions douteuses. Ex. : lorsque deux individus se querellaient pour un objet ou un sujet quelconque et en appelaient à la justice pour régler le différend qui les divisait, il arrivait parfois que le magistrat, ne sachant en faveur duquel des plaignants se prononcer, leur ordonnait de se battre. Celui qui sortait victorieux du combat singulier était considéré comme ayant légalement raison. La force et l’adresse étaient des preuves convaincantes des droits que l’on avait sur l’adversaire.
Le Français, batailleur et querelleur par excellence, a toujours eu la manie du duel et celui-ci était si répandu au XVIe siècle, que Montaigne écrivait :
« Mettez trois François aux déserts de Libye, ils ne seront pas un mois ensemble sans se harceler et s’esgratigner ».
A différentes époques, de sévères ordonnances furent rendues et, plus particulièrement, par Louis XIV, pour mettre fin à ces mœurs ridicules. Elles n’eurent aucun effet, le duel subsista et il existe encore de nos jours.
En vertu des us et coutumes et des préjugés aristocratiques qui veulent que les insultes soient lavées dans le sang, ces messieurs de la bourgeoisie se battent en duel chaque fois qu’ils estiment avoir subi un affront. Drôle de conception de l’ « honneur », en vérité ; mais, comme en toutes choses, les possesseurs de la fortune sont des privilégiés qui peuvent tout se permettre et, si le duel est interdit par la loi, le duelliste bénéficie toujours de l’indulgence des magistrats.
Pour nous, il n’y a aucune différence entre le duel aristocratique et bourgeois, qui se pratique au Bois de Boulogne avec la complicité de la police, et celui du souteneur qui se pratique dans les rues obscures de la capitale. Nous n’avons pas cette subtilité qui consiste à trouver plus noble de s’entretuer au revolver et à l’épée qu’au couteau et s’il nous fallait chercher des excuses à ceux qui perpétuent de telles mœurs, toute notre pitié serait réservée pour l’ignorant et l’imbécile, et non pas pour le bourgeois qui se prétend instruit, éduqué, évolué et qui, en réalité, ne s’est pas libéré de la barbarie ancestrale. Il est vrai que ce n’est pas la raison qui dirige les hommes en notre siècle de science et de progrès et, si le souteneur est condamné lorsqu’il blesse ou supprime un de ses semblables, son geste est considéré comme un meurtre ; le bourgeois, lui, au contraire, est honoré lorsqu’il enfonce quelques centimètres d’acier dans la peau d’un autre bourgeois. C’est ce qu’on appelle en France la « justice égale pour tous ».
Le bourgeois, cependant, y met certaines formes, lorsqu’il décide d’assassiner un adversaire. A titre documentaire, nous empruntons au « Larousse », bien informé en matière de préjugés, certains articles du Code du duel :
-
Duel à l’épée : les lames doivent être lisses, droites, triangulaires, sans défauts. Les adversaires sont visités par les témoins avant le combat. Au commandement de : « Allez, messieurs ! », le combat commence ; il doit cesser au moment indiqué par les conventions, ainsi que toutes les fois que le directeur prononce le mot : « Halte ! ».
-
Duel au pistolet : les armes, inconnues aux adversaires, sont apportées, chargées et scellées, dans une boîte. Le directeur commande « Attention ! » puis : « Feu ! Un, deux, trois ! ». Les adversaires doivent tirer entre les mots un et trois. La distance entre les combattants est de 16 à 24 mètres. Le nombre des balles à échanger ne dépasse pas normalement six (trois par adversaire). Lorsque l’un des adversaires est blessé « l’honneur est lavé », « l’honneur est sauf » ; n’est-ce pas charmant et ridicule ?
Il est bien rare, cependant, que, de nos jours, les duellistes se fassent beaucoup de mal, car, à la première éraflure le combat est arrêté par les témoins et ordinairement, après s’être quelque peu égratigné l’épiderme, les adversaires se réconcilient sur le terrain. Le duel n’est, bien souvent, qu’une source de publicité et en tous cas, quelles qu’en soient les causes, il n’est pas intéressant et les duellistes encore moins.
Combien plus terrible que ces mœurs d’opéra-comique est le duel que se livrent parfois notre sensibilité et notre raison. Ne sommes-nous pas en proie, anarchistes, à une lutte constante avec nous-mêmes et notre vie, par l’ambiance, par la contrainte que nous subissons, n’est-elle pas en éternelle contradiction avec notre pensée, nos désirs et nos espérances ?
Chaque fois qu’il faut se défendre contre la violence que nous combattons, qu’il nous faut répondre par les mêmes coups à ceux de nos adversaires, si nous ne voulons pas succomber, il se livre en nous ce duel profond qui met aux prises nos sentiments d’affection, de paix, d’amour et la nécessité dans laquelle nous nous trouvons d’opposer notre force à celle de nos ennemis.
Heureusement que l’instinct de conservation nous soutient et que notre raison sort généralement victorieuse de cette bataille intérieure ; sans quoi, nous serions bientôt écrasés, laissant le champ libre à tous les organismes de réaction et de domination sociale.
C’est un duel à mort que nous avons engagé avec la bourgeoisie ; les coups répétés que nous lui avons portés l’ont quelque peu ébranlée, ses assises ne sont plus aussi solides ; seule 1a façade résiste encore et conserve une apparence de puissance. Demain, la forteresse s’effondrera entièrement, mettant fin au duel que se livrent depuis des siècles les asservis et les oppresseurs, et les hommes, unis et heureux, pourront vivre enfin en toute fraternité.